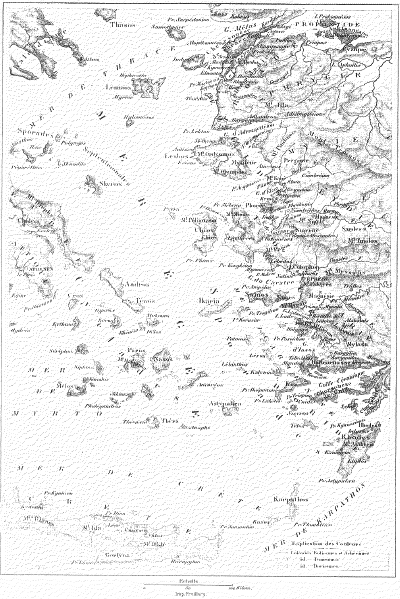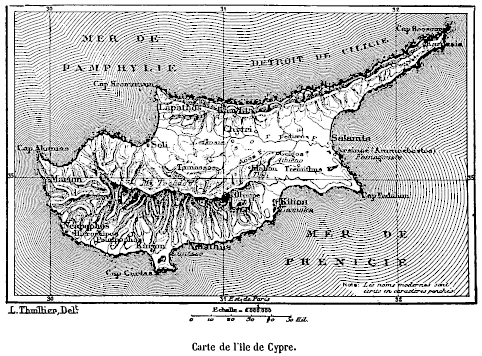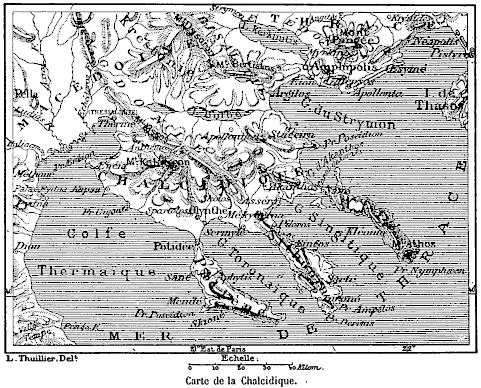HISTOIRE DES GRECS
DEUXIÈME PÉRIODE — DE L’INVASION DORIENNE AUX GUERRES MÉDIQUES (1104-490) — ISOLEMENT DES ÉTATS - RÉVOLUTIONS INTÉRIEURES - COLONIES.
Chapitre XII — Fondation des colonies grecques.
I. Colonies d’Asie-Mineure
On vient de voir combien la vie s’était multipliée dans Mille causes poussaient les Grecs vers l’émigration : religion, caractère, position géographique, révolutions intérieures, excès de population ; plus tard, le désir d’étendre les relations politiques de la mère patrie et d’occuper au loin pour elle des points d’appui pour son commerce ou sa domination. Confiants et intrépides, le plus léger signé de la divinité, l’oracle le plus obscur les fait monter sur leurs vaisseaux et les lance en pleine mer. Que l’homme d’Orient, tremblant devant ses divinités terribles, se prosterne immobile! les dieux de l’Olympe n’inspirent pas un semblable effroi. Voyez dans Homère comme leurs fidèles s’entretiennent familièrement avec eux. Quand ils les supplient, ils portent la main sur les genoux et au menton de leurs statues, ainsi que l’enfant qui joue avec son père. Le Grec est hardi et les dieux sont bons ; sous leurs auspices, il se livre à cette mer qui, par des golfes sans nombre, semble venir le chercher jusqu’au milieu des terres, et il s’abandonne au souffle des vents. Le dieu d’ailleurs le guide, car il aime comme lui ces expéditions lointaines qui multiplient ses autels et ses honneurs; Ô Phébus ! sous tes auspices, les villes s’élèvent ; tu prends plaisir à les fonder et toi-même en poses la première pierre[1]. Cette tendance expansive, que les Grecs modernes gardent encore, se montre jusque dans les légendes des temps primitifs qui font visiter deux fois tout le monde connu par les anciens héros, les Argonautes et les chefs revenus du siège de Troie. Je ne rentrerai pas, pour les colonies, dans l’histoire
légendaire. Il ne sera donc ici question ni des Pélasges, qu’on mène en tant
de lieux ; ni de Danaé, que Virgile conduit à Ardée dans le Latium; ni
de Minos et de son expédition de Sicile ; ni de la dispersion des chefs
grecs après la guerre de Troie. Je ne parlerai que du grand mouvement d’émigration
qui suivit, au douzième siècle, l’établissement des Thessaliens et l’invasion
dorienne, lorsque ces deux tribus conquérantes, pressant à la fois, par le sud
et par le nord, les populations réfugiées dans Cette mer est un lac grec. Des vents périodiques qui
soufflent le matin du mord, le soir du Celle-ci projette entre trois mers un immense plateau, aride au centre, fertile sur ses bords, surtout à l’ouest, où il s’abaisse doucement vers l’Archipel comme pour engager les populations à y descendre ou, si la mer les effraye, pour recevoir les colons aventureux que les flots et les vents y conduiront. Les ports naturels dont ce littoral est échancré, les saillies de la côte qui multiplient les golfes et les baies, les îles qui les couvrent contre les tourmentes du large, tout prédestinait ces lieux à devenir le séjour de peuples actifs et entreprenants. La première colonie fut celle des Éoliens (vers 1054). Chassés
de l’Hémonie par les Thessaliens, ils se réunirent à d’autres peuplades, et,
sous la conduite du Pélopide Penthilos, s’embarquèrent au port d’Aulis, d’où
était partie l’expédition contre Troie. Suivant la même direction, ils
abordèrent à la côte nord-ouest de l’Asie-Mineure. Une fois cette route
frayée, l’émigration continua sous le fils et le petit-fils de Penthilos, et
se répandit peu à peu sur toute Les Éoliens du continent se livrèrent à l’agriculture plus
qu’au commerce. Ceux de Cymé, disaient les anciens, n’ont pas soupçonné que leur
ville se trouvait au bord de la mer. Ils avaient apporté des grasses plaines
de L’émigration ionienne, la plus considérable qui soit
sortie de Les colons, réunis sous les auspices d’Artémis, partirent du Prytanée d’Athènes, qu’ils regardèrent comme leur métropole. La traversée fut longue, car ils s’arrêtèrent dans les Cyclades pour y former des établissements : de là vint que presque toutes ces îles se considérèrent, dans la suite, comme ioniennes. Jusqu’alors les nouveaux vertus sur les rivages asiatiques n’avaient pas rencontré d’opposition bien vive, parce qu’il n’y avait plus dans cette région de grande puissance intéressée à en interdire l’accès, et qu’il s’y trouvait, au contraire, des populations de sang hellénique, pour qui les émigrants étaient un secours contre les barbares qui les entouraient. Mais ceux qui débarquèrent à l’embouchure du Caystre eurent de longs combats à soutenir contre les Cariens, les Léléges, les Mygdons ; et ils ne devinrent maîtres paisibles du sol qu’après avoir exterminé une partie de la population mâle. Les Cariennes, dit Hérodote, forcées d’accepter les nouveaux venus pour époux, en gardèrent un long ressentiment. Elles jurèrent de ne partager jamais leurs repas avec leurs maris, de ne jamais leur donner ce nom et elles ont transmis ce serment à leurs filles. Ces violences étaient ordinaires dans la fondation des colonies : les émigrants, partant seuls d’habitude pour trouver une famille non moins qu’une patrie, prenaient les femmes en même temps que les terres. La première douleur passée, l’union revenait vite, il n’en restait plus que certains usages, comme ceux dont parle Hérodote, qui attestent moins les regrets des femmes, que la fière dignité des hommes traitant ces étrangères plus en servantes qu’en épouses. Les Ioniens occupèrent, au sud des colonies éoliennes, toute la côte qui s’étend depuis l’Hermos jusqu’au Méandre et au delà. Leurs douze cités, dont la plupart existaient avant leur arrivée, étaient, du sud au nord : Samos et Chios, dans les îles de ce nom ; Milet, avec ses quatre ports, comblés depuis par les alluvions du Méandre, et qui passa pour avoir été fondé par Nélée ; Myonte, Priène, Éphèse bâtie, disait-on, par Androclos, frère de Nélée, et où ses descendants gardèrent de grands privilèges, celui, entre autres, de remplir la charge héréditaire de prêtres de Cérès[3] ; Colophon, Lébédos, Téos, Érythrées, Clazomène et Phocée, qui ne fut admise au Panionion, dit Pausanias, qu’après qu’elle eut mis à sa tête des chefs du sang de Codrus : dans la suite enfin, Smyrne au bord du golfe magnifique dans lequel le Mélès débouche, et où les Ioniens et les Éoliens mélangèrent leur sang, leurs traditions et leur génie, pour enfanter ces merveilles de la langue et de la poésie grecque qui s’appellent l’Iliade et l’Odyssée. A l’autre extrémité de l’Ionie, dans le voisinage des Cariens, s’éleva la petite ville d’Héraclée du Latmos ; elle prétendait garder le tombeau d’Endymion que la déesse Séléné venait chaque nuit envelopper de ses rayons[4]. La plupart de ces villes étaient malheureusement assises sur le bord de fleuves travailleurs qui ont comblé leurs ports ; de sorte qu’on a peine, en examinant les sites où elles se trouvent, à se rendre compte de leur ancienne prospérité. Éphèse est aujourd’hui à deux heures de la mer ; le Méandre a comblé le golfe Latmique et les maigres chevaux des Turcomans paissent là où abordaient les galères de Milet. Priène, qui avait eu deux, ports, était déjà du temps de Strabon à 40 stades de la côte. Ces villes vivaient de la mer ; le fleuve les a tuées. Les alluvions du Scamandre empêchent de reconnaître la plaine troyenne et si l’industrie humaine n’intervient pas, l’Hermos fera du plus beau port de cette côte d’Asie, celui de Smyrne, un immense marécage. Près de ces villes étaient des peuples puissants ; le
danger venait donc pour elles de l’intérieur. Aussi les avait-on bâties dans
les îles de la côte ou sur des péninsules faciles à défendre, de sorte que la
nouvelle Ionie, bande de littoral étroite et longue, fut vouée par sa
situation au commerce maritime, tout en ayant derrière elle des voies
ouvertes au négoce avec les riches États de l’Asie antérieure. La monnaie est
un des facteurs considérables de la civilisation; si les Lydiens furent les
premiers à en frapper comme Hérodote l’assure (I, 94), les Ioniens durent s’approprier de
bonne heure l’heureuse invention, pour échapper aux difficultés du commerce
par troc et aux lenteurs des échanges faits à la balance avec des lingots[5]. Leurs villes
fabriquèrent des pièces d’argent et d’or d’après les divisions du système
métrique des Babyloniens, et la valeur des monnaies se trouvant garantie par
cette intervention de la puissance publique, le commerce prit un grand essor.
Mais en courant les mers, de L’émigration dorienne se composa de Minyens, que les
Doriens de A quelle époque Nous n’en savons pas davantage sur deux villes de Pisidie, Selgé et Sagalassos, qui se disaient d’origine laconienne ; sur Aspendos et Sidé, en Pamphylie, sur Tarse de Cilicie, ancienne ville phénicienne ou assyrienne ; sur Paphos, Salamine et Kition, en Cypre, par lesquelles la plus grande partie de l’île passa des Phéniciens aux Grecs. Mais ceux-ci, en s’emparant de cette terre, prirent aussi quelques-uns des rites licencieux et cruels de la religion punique.
Les villes grecques de Cypre prétendaient ne pas remonter moins haut que la guerre de Troie. C’était une prétention commune aussi à beaucoup de villes d’Italie. Cumes voulait dater du siècle qui avait suivi le retour des Héraclides : elle plaçait sa fondation par des habitants de Chalcis, en Eubée, et de Cyme, en Éolide, vers l’an 1050[7]. Sa prospérité fut grande du huitième au sixième siècle. Unie avec Rome contre les Étrusques et les Samnites, elle repoussa plusieurs fois leurs attaques. La tyrannie d’Aristodémos et de cruelles dissensions intestines l’affaiblirent. Elle vainquit cependant en 474, avec l’aide du Syracusain Hiéron, une grande flotte étrusque et peut-être aussi carthaginoise. Mais la conquête de Capoue par les Samnites et les continuelles hostilités de ces turbulents voisins amenèrent pour elle une décadence qui ne s’arrêta plus. II. Colonies du nord, de l’ouest et du sudQuand l’impulsion donnée par l’invasion dorienne en Grèce eut cessé de se faire sentir, et que ce pays eut jeté au dehors, durant plusieurs générations, son trop-plein d’hommes, on n’en vit plus partir d’émigrants pendant plusieurs siècles. Au septième, la population s’étant accrue par la pais et un commerce actif avant développé la prospérité des États, un nouveau courant d’émigration s’établit, qui, cette fois, se porta vers le nord et l’ouest. Le principal rôle, dans cette seconde époque de la
colonisation grecque,. fut rempli par Érétrie, Chalcis, Mégare et Corinthe,
alors les plus riches cités de La péninsule qu’enveloppent les golfes Thermaïque et
Strymoniaque est riche en métaux, comme la côte voisine de Thrace et, comme
elle encore, avait de belles forêts qui donnaient le combustible nécessaire à
la fabrication. Renommés dans toute
Cependant, des deux villes qui devinrent les plus célèbres de cette région, l’une, Potidée, avait été fondée par Corinthe ; l’autre, Olynthe, par la tribu thrace des Bottiéens ; plus tard, l’influence grecque domina dans cette ville, et l’élément barbare disparut. A l’est du Nestos commençaient les colonies des Grecs d’Asie, qui couvrirent de leurs comptoirs tous ces rivages jusqu’au Bosphore, et du Bosphore jusqu’au Danube. Mégare se fit jour pourtant à travers ces établissements des Grecs asiatiques, et, au milieu du septième siècle, fonda Byzance à la place où devait s’élever une de ces cités que leur position fait reines, Constantinople[10]. Les deux îles de la côte de Thrace, Samothrace et Thasos, furent enlevées, la première aux Pélasges par des Ioniens, la seconde aux Phéniciens par des colons de Paros. Archiloque appelait Thasos un dos d’âne couvert de forêts sauvages. Mais sous ces forêts étaient des mines d’or. De plus riches existaient sur la côte voisine, surtout à Scapié-Hylé. Les Thasiens, malgré quelques défaites, dans l’une desquelles Archiloque perdit son bouclier, les enlevèrent aux Thraces et en tirèrent de tels profits, que dans les bonnes années il leur restait, tous frais faits et sans impôt, 300 talents (1.700.000 fr.). Corinthe, devancée par Chalcis et Érétrie, n’avait de ce
côté que deux villes, Potidée et Enéia ; elle se
dédommagea en formant, dans la mer d’Ionie et l’Adriatique, un groupe d’établissements
exclusivement corinthiens : Corcyre, dans l’île de ce nom, et, à l’entrée ou
autour du golfe d’Ambracie : Leucade, Anactorion et Ambracie ;
plus au nord : Apollonie, aux bouches de l’Aoüs, et Epidamne (Dyrrachium), sur le
territoire des Taulantiens. Ces villes exploitaient le commerce de l’Épire et
de l’Illyrie. Elles tiraient de ces pays les choses nécessaires aux
constructions navales, bois, métaux, goudron, beaucoup de bétail et d’esclaves
: les simples des montagnes d’Illyrie étaient transformés à Corinthe en
essences précieuses. Corcyre avait un autre avantage, elle menait à l’Italie.
Le détroit qui l’en sépare est moins large que la mer qui s’étend de Cythère
à Les brigandages des pirates tyrrhéniens, qui couraient les
mers de L’autel d’Apollon qu’ils dressèrent sur la plage fut,
durant des siècles, comme un sanctuaire pour tous les Grecs de Sicile, parce
que c’était là que Il y avait en Sicile quatre populations différentes : les Sicanes, tribu ibérienne ou celtique ; les Sicules, probablement d’origine pélasgique ; les Phéniciens, qui occupaient quelques points de la côte ; enfin les Élymiens, population qui se disait d’origine troyenne, mais où l’élément barbare dominait. Les Élymiens, maîtres de la pointe occidentale du triangle sicilien, habitaient les villes d’Egesta et d’Éryx, celle-ci fameuse par le temple bâti sur le rocher qui la domine et qu’Énée, disait-on, avait consacré à sa mère Aphrodite ; aussi fut-il, pour les Romains, un des sanctuaires les plus respectés. Devant les Grecs, les Sicules se retirèrent dans l’intérieur de l’île et vers la côte septentrionale ; les Phéniciens, qui se fondirent peu à peu avec les Carthaginois, occupèrent Motya, Solous et Panormos (Palerme), le meilleur port de l’île entière. Les traces de Théoclès furent bientôt suivies par les Doriens.
En 734, la peste ravageait Corinthe ; Au nord de l’île, il n’y eut, jusqu’au temps de Thucydide,
que deux établissements grecs : Zancle ou la Faucille[13] (Messine), fondée
par des habitants de Cumes et de Chalcis, et Himéra, que des
Syracusains mêlés à des colons de Zancle allèrent audacieusement bâtir près
des établissements phéniciens de Solous et de Panormos. Il est juste d’ajouter
que L’histoire des colonies grecques en Italie se divise en deux
parties : l’une, commençant au huitième siècle avant notre ère, ne peut être
l’objet d’aucun doute, l’autre, remontant au douzième siècle, a contre elle
toutes les probabilités historiques. Sans doute, il se peut que, dans les
temps qui suivirent la guerre de Troie, après ce grand ébranlement de Rien ne manqua pour accréditer ces généalogies glorieuses : ni les chants des poètes, ni la crédulité aveugle ou intéressée des historiens, ni même les reliques vénérées des héros. Sur les bords du Numicius, les contemporains d’Auguste allaient voir le tombeau d’Énée, devenu le Jupiter Indigète, et tous les ans les consuls et les pontifes romains y offraient des sacrifices. Circeii montrait la coupe d’Ulysse et le tombeau d’Elpénor, un de ses compagnons ; Lavinium, le vaisseau incorruptible d’Énée et ses dieux pénates ; Thurion, l’arc et les flèches d’Hercule donnés par Philoctète ; Macella, le tombeau de ce héros ; Métaponte, les outils de fer dont s’était servi Épéios pour construire le cheval de Troie ; Lucérie, l’armure de Diomède ; Maleventum, la tête du sanglier de Calydon ; Cumes, les défenses du sanglier d’Érymanthe. Ainsi des Arméniens croient encore que les débris de l’arche de Noé se voient sur la cime du mont Traza. Personne ne tient plus à ces fabuleuses origines ; d’ailleurs, lors même qu’on regarderait comme authentiques les premiers établissements de la race grecque en Italie, on ne pourrait leur accorder aucune importance historique ; car, restés sans relations avec la mère patrie, ils perdirent le caractère de cités helléniques, et quand les Grecs arrivèrent, au huitième siècle, ils ne trouvèrent plus trace de ces incertaines colonies. A cette classe de récits légendaires appartiennent les traditions sur le Troyen Anténor, fondateur de Padoue, et sur Énée apportant dans le Latium le palladium de Troie. Les nobles Romains voulaient dater de la guerre de Troie, comme les nôtres des croisades. Suivant Hérodote, les premiers Grecs établis dans Fils de Saturne, je t’en conjure,
fais que le Phénicien et le soldat de Tyrrhénie restent dans leurs foyers,
instruits par l’outrage que leur flotte a reçu devant Cumes et par les maux
que leur fit le maître de Syracuse, alors que vainqueur, il précipita dans
les flots, du haut des poupes rapides, toute leur brillante jeunesse et tira Mais en 420 les Samnites entrèrent dans la grande cité
campanienne. Toutefois, malgré l’éloignement et malgré les Barbares, Cumes
resta longtemps grecque de langue, de moeurs et de souvenirs; et, chaque fois
qu’un danger menaçait Sur cette terre volcanique, prés des champs Phlégréens et
du sombre Averne, les Grecs se crurent aux portes des Enfers. Cumes, où,
selon Homère, Ulysse avait fait l’évocation des morts, devint le séjour d’une
des sibylles et des nécromanciennes les plus habiles de l’Italie; chaque
année, de nombreux pèlerins visitaient avec effroi le saint lieu au grand
profit des habitants. C’est là aussi, dans ce poste avancé de la civilisation
grecque, au milieu de ces Ioniens tout pleins de l’esprit homérique, que s’élaborèrent
les légendes qui amenèrent en Italie tant de héros de Les Doriens, qui dominaient en Sicile, étaient peu
nombreux en Italie, mais ils avaient Tarente, sur un golfe où se trouvait en
grande abondance et en meilleure qualité qu’en aucun autre point des mers
européennes le coquillage qui donne la pourpre[18]. Elle rivalisa
de puissance et de richesse avec Sybaris et Crotone et conserva plus
longtemps que ces deux villes son indépendance[19]. De riches
offrandes, déposées au temple de Delphes, attestaient encore au temps de
Pausanias ses victoires sur les Iapyges, les Messapiens et les Peucétiens.
Aussi avait-elle élevé à ses dieux, en signe de son courage, des statues de
taille colossale et toutes dans l’attitude du combat; mais ils ne. purent la
défendre contre Rome, et le vainqueur qui rasa ses murailles lui laissa par
dérision les images de ses belliqueuses divinités. Un Tarentin, Archytas, a
pris rang parmi les philosophes et les savants de Ancône, fondée vers 380, dans le Picénum, par des Syracusains qui fuyaient la tyrannie de Denys l’Ancien, était aussi dorienne. La plus florissante des colonies achéennes fut Sybaris,
dont les habitants ne méritèrent pas d’abord la réputation qu’on leur fit
plus tard. Leur activité répondit à la fertilité du sol ; ils s’assujettirent
beaucoup de peuples, s’enfoncèrent hardiment dans les profondeurs de D’autres Achéens s’étaient établis à Métaponte, qui dut de grandes richesses à son agriculture et à son port aujourd’hui transformé en lagune[21]. Quinze colonnes encore réunies par leurs architraves marquent la place de son acropole. Crotone eut une prospérité aussi rapide que celle de Sybaris, sa rivale, mais qui se soutint plus longtemps. Son enceinte, double en étendue (100 stades), accuse une population plus nombreuse, que sa renommée pour les luttes du pugilat nous ferait aussi regarder comme plus énergique (Milon de Crotone). A 8 milles de ses murs, elle construisit le temple fameux de Junon Lacinienne, dont une colonne est restée debout sur le promontoire qui porte, comme le cap Sunion, le nom de Capo delle colonne. Pour exploiter les deux mers qui baignent l’Italie méridionale, elle franchit l’Apennin et établit des colons sur le golfe de Terina, où ils trouvèrent des mines de cuivre anciennement exploitées. Un de ses citoyens, Phayllos, conduisit à Salamine la seule galère venue des mers occidentales, au grand combat pour la liberté. Les tyrans de Syracuse prirent trois fois Crotone, et elle avait perdu toute importance lorsque les Romains l’attaquèrent. Les Ioniens n’avaient que deux villes dans Les Locriens bâtirent Locres épizéphyrienne ou l’Occidentale, presque à l’extrémité du Bruttium. On donnait à cette ville une origine pareille à celle de Tarente, fondée qu’elle aurait été par un parti vaincu dans les luttes intestines des Locriens de l’Hellade. A en croire la légende, ses commencements avaient été souillés par une perfidie. On racontait que les Locriens, débarqués dans le pays des Sicules, leur avaient juré qu’ils garderaient la paix tant qu’ils auraient la terre sous les pieds et la tête sur les épaules; mais chacun d’eux avait de la terre dans sa chaussure et une tête d’ail sur les épaules. Croyant s’être mis, par ce stratagème, en règle avec la bonne foi et avec les dieux, ils attaquèrent les Sicules à la première occasion favorable et les dépouillèrent. Pourtant beaucoup de Sicules furent admis dans la nouvelle cité, qui prit et garda plusieurs de leurs coutumes. Pour obtenir un remède à de longues dissensions, les Locriens consultèrent l’oracle de Delphes; il leur répondit de trouver un législateur. Ce fut au berger Zaleucos[22] qu’ils s’adressèrent. On prétendit que Minerve l’avait inspiré et lui avait dicté ses lois en songe. Il les écrivit et les promulgua en 644, quarante ans avant Dracon, dont il eut toute la sévérité. Elles étaient précédées d’un magnifique préambule sur la divinité. L’ordonnance de l’univers, disait-il, prouve invinciblement son existence, et il montrait les vertus que les dieux exigent des citoyens et des magistrats. Le chef de ceux-ci portait un nom, Cosmopole, qui devait rappeler à tous que la vie sociale consiste dans l’ordre et l’harmonie. Les Locriens restèrent si attachés à leurs vieilles lois, qu’à en croire Démosthène, le citoyen qui voulait proposer une disposition nouvelle se présentait à l’assemblée une corde au cou. Si sa proposition passait, il avait la vie sauve ; si elle était rejetée, on l’étranglait sur l’heure. Les Chalcidiens avaient fondé Zancle ; pour être tout à fait maîtres du détroit, ils bâtirent sur l’autre rive une cité dont le nom montre qu’ils avaient reconnu l’antique union de file et du continent, Rhégion la ville du déchirement. On était alors au temps de la première guerre de Messénie : d’anciens compagnons d’Aristodèmos se mêlèrent aux coIons de Rhégion. Son législateur fut celui de Catane, Charondas, contemporain de Zaleucos, et qui comme lui plaça en tête de ses lois un préambule d’une grande élévation morale. Mais il est à craindre que cette déclaration des devoirs du citoyen ne soit l’ouvrage de quelque pythagoricien d’un âge postérieur. La grande déesse achéenne, Héra ou Junon, eut, au
promontoire lacinien, dans le sud de Crotone, un temple fameux qui fut le
principal sanctuaire de Il est remarquable que toutes ces villes eurent un rapide
accroissement et que peu d’années leur suffirent pour devenir des États
comptant par cent mille le nombre de leurs combattants. Ce n’est pas
seulement l’heureux climat de Les établissements formés par les Grecs, en Italie et en
Sicile, ouvrirent à ce peuple, tout à la fois avide et hardi, le bassin
occidental de Dans une de ces excursions vers les terres de l’Ouest, les
Phocéens furent portés sur les rivages de Enfin les Grecs eurent aussi en Afrique un établissement
important, de sorte qu’aucun rivages de Vers 650, des aventuriers de Carie et d’Ionie s’étaient mis au service de Psammétik, un des chefs qui se partagèrent l’Égypte après l’expulsion de la dynastie éthiopienne. Ils l’avaient fait prévaloir sur ses rivaux, et comme ce prince, d’origine libyenne, n’avait pas pour l’étranger la haine des anciens Pharaons, il reconnut le service de ces Grecs, en leur ouvrant son pays. Un grand nombre accoururent, et quand une partie des guerriers émigra d’Égypte pour fuir leur contact impur, Psammétik les mena à leur poursuite ; on lit encore, à Abou-Simbel (Ipsamboul), en Nubie, l’inscription qu’ils gravèrent sur la cuisse du colosse de Ramsès, en souvenir de cette lointaine expédition. Il leur donna des terres dans le Delta, à l’ouest, sur la bouche canopique, où ils fondèrent une ville que, pour rappeler leur première victoire sur le Nil, ils nommèrent Naucratis ; il les établit aussi à l’est, tout le long de la bouche pélusiaque, du côté par où il craignait une invasion[24]. Les marchands suivirent les soldats en tel nombre, qu’il
parut nécessaire d’établir une classe particulière, celle des interprètes.
Tout le commerce de l’Égypte et par conséquent celui de l’Arabie et d’une partie
de l’Inde se trouva alors dans les mains des Grecs. Pour l’accroître encore,
Nécos projeta un canal entre la mer Rouge et n’y était entré que pour échapper à la tempête; après avoir fait ce serinent, il lui fallait retourner avec son navire à la bouche canopique, à moins que les vents ne fussent absolument contraires : dans ce cas, il devait transporter ses marchandises, bien scellées, par les canaux du Delta, à Naucratis, seul lieu on il lui fût permis de les exposer et de les vendre. Les Grecs établis dans cette ville formèrent une communauté, qu’on appela l’Hellénion, ayant des chefs choisis par elle, un temple avec une enceinte consacrée, bâti à frais communs par quatre villes ioniennes, Chios, Téos, Phocée et Clazomène ; quatre doriennes, Rhodes, Cnide, Halicarnasse et Phasélis ; une éolienne, Mytilène. Les avantages étaient tels pour tous les membres de la communauté, que beaucoup de cités, afin d’avoir le droit de les partager, prétendaient avoir aidé à bâtir le temple de l’Hellénion. Samos, Égine et Milet, trop puissantes et trop riches pour s’unir à d’autres, avaient formé chacune une factorerie particulière, ayant aussi son temple et ses juges. Naucratis fut alors ce qu’Alexandrie devint plus tard, une
des villes les plus riches et les plus efféminées, le point de contact du
monde hellénique avec la civilisation orientale[25]. Par elle
certainement passèrent d’abord les légendes dont Hérodote s’est fait l’écho
et qui montraient l’Égypte comme la mère patrie de la religion, des arts, de
la science, et même de quelques-uns des anciens chefs de Athènes ne prit aucune part à ce premier établissement des
Grecs en Égypte ; mais quand elle envoya plus tard ses flottes et ses
armées aux bouches du Nil, ce ne fut pas seulement pour y soutenir la révolte
des satrapes ou des indigènes contre le grand roi, c’était aussi pour s’assurer
le commerce du Sud et de l’Inde, comme dans l’Hellespont elle avait pris
celui du Nord et de Nous avons fini le voyage accompli par les colons grecs le
long des côtes de l’Euxin et de la mer intérieure. Représentez-vous ces
villes, ces temples élevés sur tous les promontoires ; les terres
assainies, cultivées; les moeurs adoucies; les peuples barbares amenés à la
civilisation. Que d’efforts, de courage et d’habileté exigèrent ces
fondations audacieuses! Que de Vasco de Gama et de Cortez inconnus sortirent
de ces petites cités! Et quelle reconnaissance ne mérite pas cette race
entreprenante qui sillonna tant de mers de la proue de ses navires, commença
vraiment pour l’homme la conquête de la terre par l’intelligence et la
liberté, et alluma, au pourtour de |