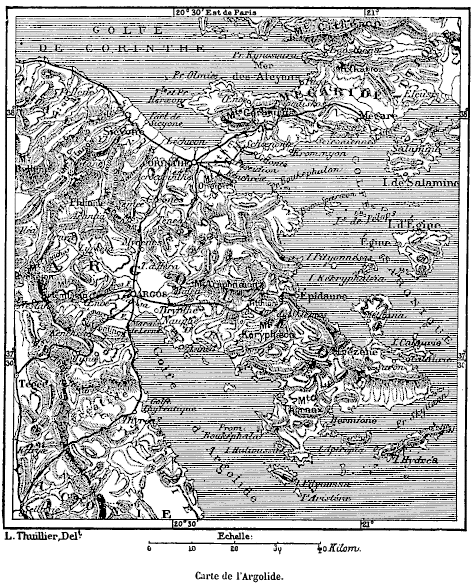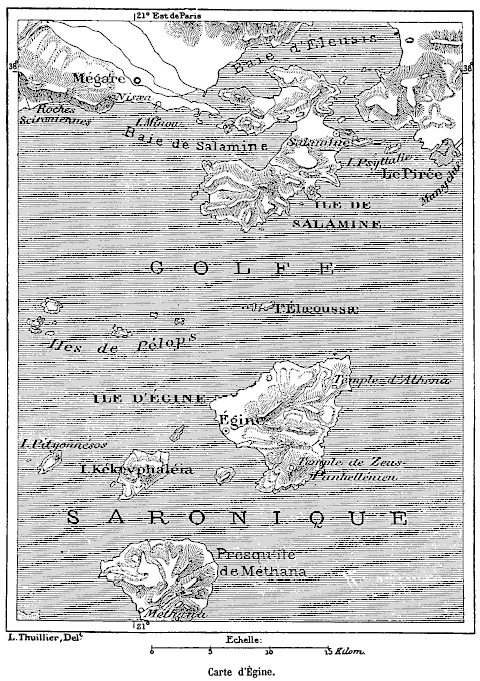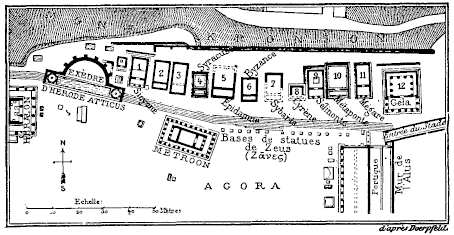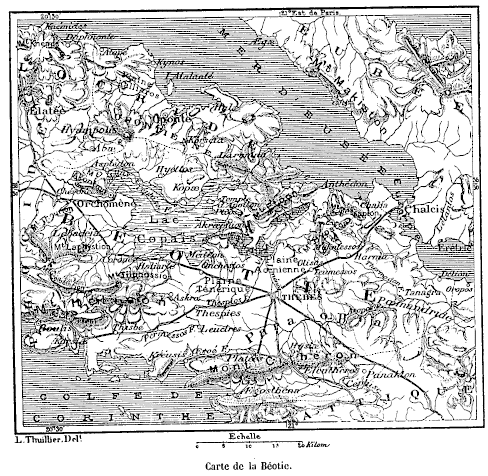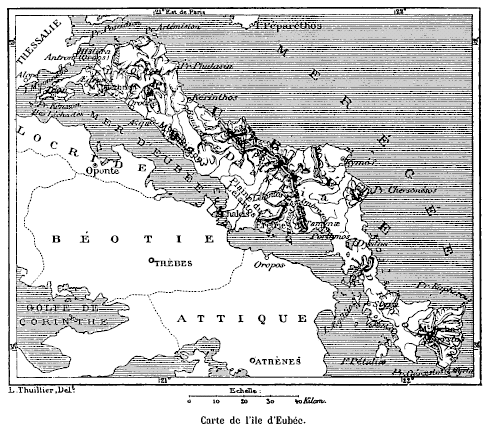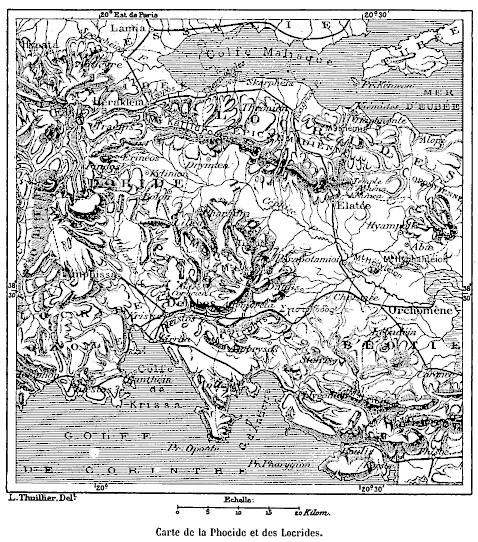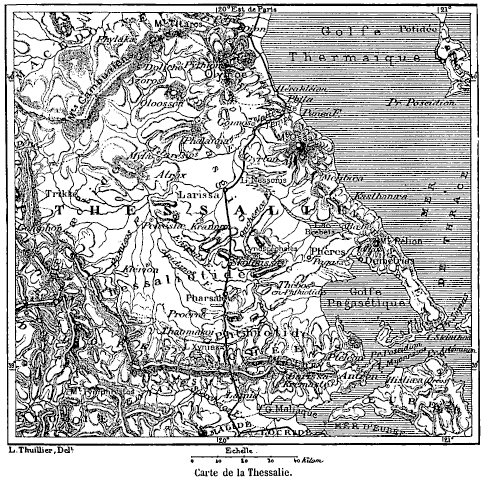|
I. États secondaires du Péloponnèse
Les petits États de la Grèce sont en nombre considérable. Chacun d’eux
eut son histoire, puisqu’il eut sa vie propre, mais cette histoire est fort
imparfaitement connue. Du reste, elle n’est, en général, pour le mouvement
intérieur, qu’une répétition de ce qu’on a vu à Athènes et à Sparte ;
pour le mouvement extérieur, elle se trouve aussi liée, le plus souvent, à
celle des deux républiques principales. Nous ne voyons qu’un fait commun à
tous ces petits peuples, la lente révolution qui les mène de la royauté,
telle qu’Homère nous la montrait, à l’aristocratie que çà et là des tyrans
renversent pour céder, à leur tour, la place à la démocratie que Thucydide et
Hérodote nous dépeignent.
Le gouvernement de l’âge héroïque, avec ses rois
descendants des dieux, avec son sénat de nobles, leur conseil, et l’assemblée
générale des hommes libres qui rejette ou approuve, sans délibérer, se
continua à Sparte et en Épire jusqu’au troisième siècle avant notre ère. Dans
le reste de la Grèce,
il disparut avec les causes qui lui avaient donné naissance, les guerres
continuelles, les invasions subites, les changements de territoire. La
société mieux assise eut moins besoin de ces fils des dieux ; et dans
toutes les cités, un peu plus tôt, un peu plus tard, la royauté fut abolie. Une
oligarchie qui datait de la conquête prit sa place et gouverna par des
prytanes ou des archontes dans l’intérêt et au profit des nobles. La
transition fut quelquefois ménagée, comme à Athènes, où l’on passa du roi à
un archonte viager, puis décennal, enfin annuel. Au septième siècle, cette
révolution oligarchique est pleinement accomplie par tout le monde grec, aux
colonies comme dans les métropoles.
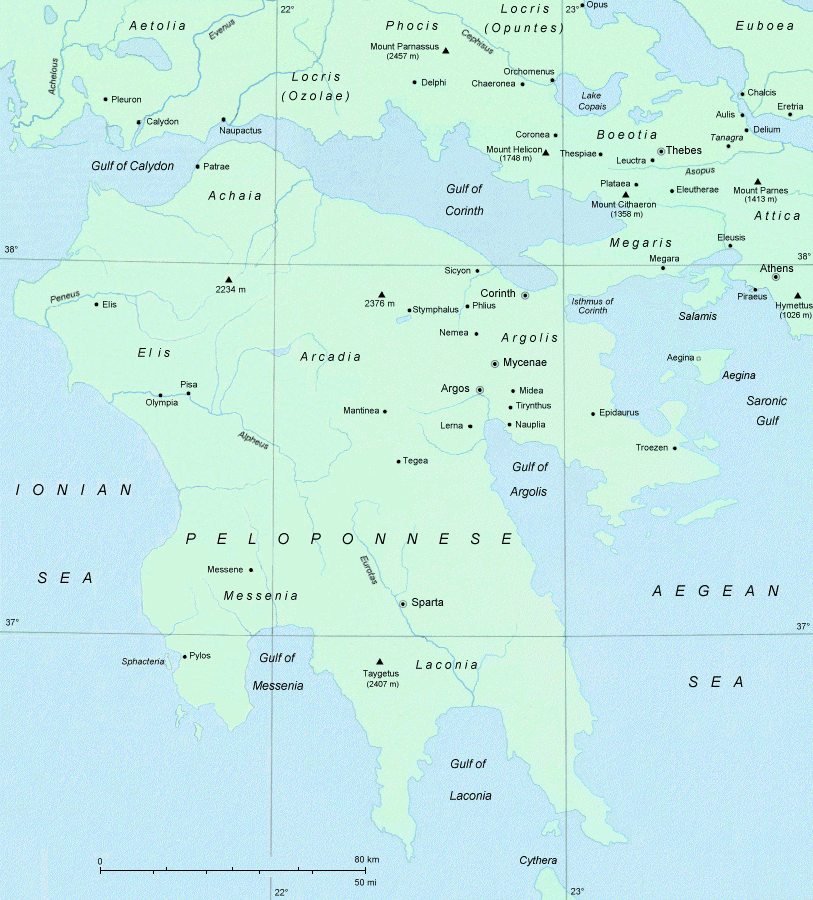
Une autre alors lui succède, de 650 à 500 ; car, une
fois sortie de la royauté des fils des dieux, la Grèce ne s’arrêta qu’à l’extrémité
opposée, à la démocratie. Les nobles, qui n’avaient plus de maîtres au-dessus
d’eux, ne voulurent voir au-dessous que des sujets; mais les sujets, à leur
tour, firent contre l’oligarchie ce que l’oligarchie avait fait contre les
rois. Toutefois, se défiant trop encore d’eux-mêmes pour fonder un pouvoir
populaire, ils mirent à leur tête quelqu’un des grands qui était passé de,
leur côté, et lui donnèrent la puissance pour qu’il leur donnât l’égalité.
Ainsi devinrent tyrans : Pisistrate à Athènes, Cypsélos à Corinthe, Panétios
à Leontini, Pittacos à Mytilène[1], etc.; tyrannies
brillantes et populaires qui faisaient vivre les villes en paix et en
prospérité. Toutes les tyrannies ne vinrent point par cette voie et n’eurent
pas ce caractère populaire. A Argos, le roi Phidon renversa les entraves qui
limitaient son pouvoir, et soumit à ses volontés grands et petits. A Milet et
dans toute l’Ionie, des magistrats établis par les nobles s’emparèrent de la
toute-puissance. En Sicile, l’Agrigentin Phalaris l’usurpa et l’exerça avec d’autant
plus de cruauté que, n’étant le représentant d’aucune classe, toutes lui
étaient ennemies. A Géla, Cléandros et Hippocratès la durent à leurs nombreux
mercenaires sicules. A Cumes, en Italie, Aristodèmos s’en saisit par la
violence. Dans la
Chersonèse de Thrace, le premier Miltiade l’obtint comme
chef d’une colonie entourée d’ennemis.
Ces tyrannies passèrent comme les oligarchies qui les
avaient amenées, car l’usage prolongé d’un pouvoir irresponsable eut ses
conséquences naturelles : les abus, les violences, d’où sortit une révolution
nouvelle. Celle-ci achevait de s’opérer quand les guerres Médiques
éclatèrent. Telle est donc la vie intérieure de la Grèce : les rois d’abord,
l’aristocratie ensuite, puis les tyrans qui s’appuient sur la classe opprimée
ou sur des mercenaires; enfin la cité se gouvernant, elle-même, ici en
accordant plus aux riches, propriétaires du sol, là en donnant davantage au
peuple. Cette dernière transformation devait être la plus heureuse; car de la
rivalité des classes naquit cette émulation, cette activité des esprits qui
tirent la civilisation de la
Grèce.
Comme signe et conséquence de cette révolution politique,
une autre s’opéra dans l’organisation militaire, qui rendit la première
irrévocable. On eut l’égalité des armes comme on avait l’égalité des droits.
Aux guerriers de l’époque homérique, qui combattaient isolément sur des chars
de guerre, succédèrent les hoplites rangés en lignes serrées et profondes.
Naguère, les héros seuls attaquaient de prés, semant autour d’eux la terreur
et la mort ; maintenant, c’est le peuple qui engage et soutient l’action.
Chaque citoyen est armé de toutes pièces, et, au lieu des merveilleux
exploits de quelques chefs intrépides, on a le grand spectacle de la cité
entière marchant calme, disciplinée et résolue à la victoire ou à la mort.
Cette organisation démocratique est celle qui prévalait au temps de l’arrivée
des Mèdes, et ce fut elle qui sauva la Grèce.
Nous retrouverons quelques-uns des incidents de ces
transformations successives dans l’histoire sommaire de chacun des petits États.
L’Arcadie, derrière sa haute ceinture de montagnes, a un
sol tourmenté où les eaux n’ont point dessiné de larges bassins, si ce n’est
la vallée du Ladon, car elles courent., pressées, dans toutes les directions,
se heurtant ü chaque pas contre des hauteurs dont elles rongent le pied, ou
qu’elles percent, pour s’ouvrir une route souterraine[2]. L’histoire de ce
pays, image et comme reflet du sol, est sans unité. Une multitude de
bourgades semées dans ces vallées sans nombre y vivaient à l’écart. Mais, grâce
à sa pauvreté et à son isolement, l’Arcadie échappa aux révolutions qui changèrent
tant de fois la population des autres cantons de la Grèce. Les Arcadiens, dit Pausanias, ont
occupé dès l’origine et occupent aujourd’hui encore le même pays. Eux-mêmes
s’appelaient προσέληνοι,
c’est-à-dire plus vieux que la lune, et ils parlaient le plus ancien dialecte
de la Grèce,
l’éolique. Leurs montagnes gardent encore çà et là, sur d’abrupts sommets, des
restes de fortification cyclopéenne, des blocs énormes, qui semblent avoir
été comme une première et informe ébauche des murs fameux de Mycènes et de
Tirynthe. Leur principale divinité, Jupiter, était adorée sur la cime du mont
Lycée, d’où l’on aperçoit la plus grande partie du Péloponnèse. Son autel
était un tertre de terre ; son temple une enceinte en pierres
grossières, et l’on offrait des victimes humaines. L’entrée en était
interdite aux hommes. Celui qui y pénétrait mourait infailliblement dans l’année.
Pour assurer la véracité de l’oracle, les habitants lapidaient sur l’heure le
coupable, quand ils pouvaient le saisir. Jupiter partageait ses honneurs et
ses temples dans toute l’Arcadie avec une divinité très populaire en cette
province, et dont le culte était probablement antérieur. Pan, le protecteur
des pâtres et de leurs troupeaux de chèvres et de boucs, dont ils lui
prêtaient les habitudes lascives, mais en même temps le dieu du feu qui
répand la vie sur la terre pour y faire germer les moissons de Cérès, et qu’il
cause de cela les Grecs appelaient le suivant de la Grande Mère[3]. Pourtant les
Arcadiens le traitaient parfois avec peu de révérence : quand la chasse avait
été mauvaise, ils fouettaient à grands coups sa statue[4]. Pan, le dieu des
bois solitaires, que les vents emplissent de bruits mystérieux et où le jeu des
ombres et de la lumière fait apparaître de fantastiques images, était l’auteur
des craintes subites et sans cause ; il jetait la terreur panique.
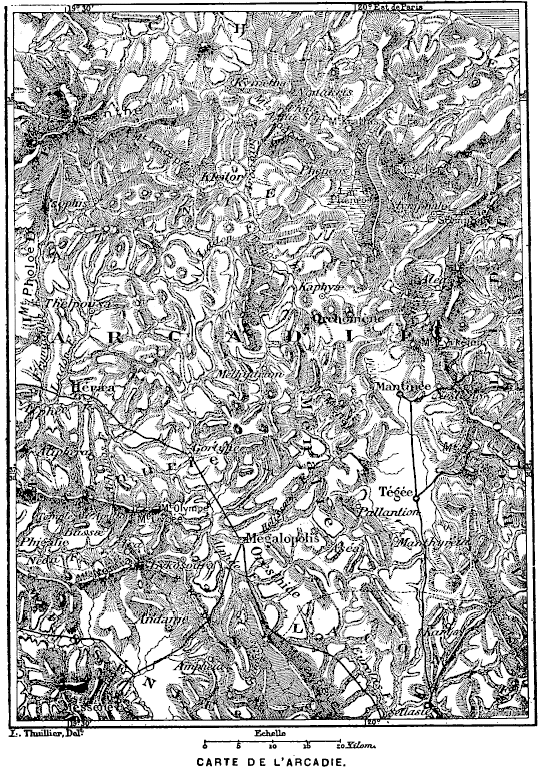
On disait qu’une suite de rois avaient commandé, dans l’origine,
à toute l’Arcadie, et on nommait, comme le premier, celui qui lui donna son
nom, Arcas. Cypsélos y régnait lors de l’invasion des Doriens, qui ne s’y
arrêtèrent pas. Ses successeurs prirent part aux guerres de Messénie. Le
dernier, Aristocratès II, assura, par sa trahison, la victoire définitive des
Spartiates : les Arcadiens indignés le lapidèrent et abolirent la royauté (628).
Deux villes s’élevèrent peu à peu au-dessus des autres
bourgades : l’aimable Mantinée, où les
Argiens favorisèrent la démocratie ; Tégée l’imprenable,
qui, plus voisine de la
Laconie, eut de longues guerres avec Sparte, puis resta
dans son alliance et dans l’esprit de son gouvernement ; de là, entre
les deux villes arcadiennes, de longues rivalités et des luttes sanglantes.
Les Arcadiens, pauvres et robustes, furent les premiers à aller chercher
fortune dans le service étranger.
On les tenait pour les meilleurs hoplites du Péloponnèse,
mais en les raillant de servir toujours des causes étrangères. C’était une
coutume en Grèce de dire de ceux qui travaillaient pour autrui qu’ils
imitaient les Arcadiens.
Élide. - La côte du nord-ouest, une des plus fertiles régions du
Péloponnèse, formait dans l’origine trois petits États, parce qu’elle avait
trois vallées s’ouvrant sur la mer d’Ionie : entre l’Alphée et la Néda, la Triphylie, dont
la capitale, Pylos, au confluent du Pénéios et du Ladon de l’Élide, avait été
la ville de Nestor ; la
Pisatide, où se trouvait Olympie, sur la rive droite de l’Alphée ;
et l’Élide, dont la capitale, Élis, avec son acropole bâtie sur une colline haute
de 500 pieds,
commandait la vallée du Pénéios. Oxylos s’y était établi avec des Étoliens,
au temps de l’invasion dorienne. La royauté subsista dans la Pisatide jusqu’il la
conquête de ce pays par les Éléens, vers 572, après de longues guerres, pour
la présidence des jeux, qui furent marquées, comme toutes les guerres
religieuses, par de sanglantes exécutions. Pise, la ville des excommuniés,
fut si bien détruite, qu’il n’en reste pas une pierre et qu’aujourd’hui on
cherche vainement la place où elle s’élevait. Le plus célèbre des rois
éléens, Iphitos, avait institué ou rétabli les jeux olympiques[5], auxquels les
Spartiates prirent part de bonne heure après avoir formé une alliance étroite
avec les Éléens. Cette institution détermina le sort de l’Élide : ce
pays devint, tous les quatre ans, le lieu de réunion de la Grèce entière, et son
territoire fut regardé, pour cette raison, comme sacré. La guerre n’en
approchait point; les troupes étrangères qui le traversaient déposaient leurs
armes en y entrant pour ne les reprendre qu’à leur sortie. Aussi les
campagnes étaient-elles bien cultivées et bien peuplées. De riches citoyens y
vivaient à demeure, sans les quitter jamais ; des tribunaux y jugeaient
les différends, de sorte que la capitale n’exerçait point sur le reste du
pays cette attraction qui, ailleurs, amenait trop de vie dans les cités et n’en
laissait pas assez dans les champs. Le pouvoir appartenait une étroite
aristocratie.
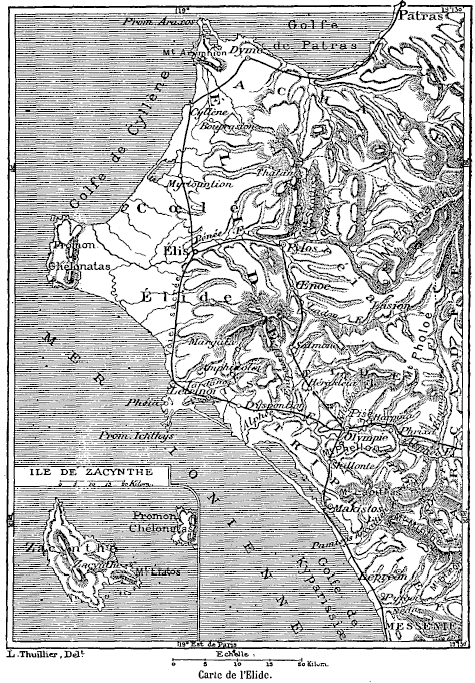
Deux magistrats suprêmes, dix plus tard, nommés hellanodices ou juges des Hellènes, avaient la
surveillance des jeux, dont ils interdisaient l’approche à ceux qui n’étaient
pas de pur sang hellénique. Le sénat, composé de quatre-vingt-dix membres nommés
a vie, se recrutait de lui- même. Les trois Théocoles ou grands prêtres d’Olympie
étaient probablement désignés parle dieu même, c’est-à-dire par le sort,
comme les grands prêtres de Delphes, et restaient quatre années en fonctions;
fonctions laborieuses, car, tous les mois,
dit Pausanias, les Éléens sacrifient une fois sur
chacun des soixante-dix autels qu’ils ont érigés aux dieux. »
En face de la côte, à 60 stades de distance, s’étendait
Zacynthe, que les marins nomment aujourd’hui la fleur de l’Orient[6]. Ses habitants
prétendaient descendre des Troyens; Thucydide, qui regarde moins dans les
légendes que dans les probabilités historiques, fait d’eux des Achéens. Ils
passaient pour avoir fondé Sagonte en Espagne.
A l’est de l’Élide est l’Achaïe. Les descendants de
Tisaménos y régnèrent jusqu’à un certain Gygès, dont les cruautés firent
abolir la royauté. on ne sait à quelle époque. La démocratie s’établit dans
le pays, qui forma une confédération de douze villes. L’Achaïe ne prit aucune
part aux affaires générales de la
Grèce, et vécut tranquille et heureuse . on vantait sa
constitution qui fut imitée par plusieurs peuples ; ses villes
brilleront un moment aux derniers jours de la Grèce.
De l’Achaïe, nous passons, en tournant Sicyone et
Corinthe, dans l’Argolide, grande péninsule sans unité géographique, hérissée
de montagnes, n’ayant ni routes, ni centre commun, ni fleuves qui la
fécondent. L’Inachos qui la traverse n’a d’eau qu’en hiver. L’Argie, en
particulier, est une terre aride; les Grecs savaient bien pourquoi : Neptune
et Héra, disaient-ils, se disputaient la possession de ce pays. Pour mettre
un terme il leur différend, ils prirent comme arbitre Phoronée, que les
fleuves Céphise, Astérion et Inachos assistèrent. Le juge prononça contre
Neptune, qui se vengea en tarissant les rivières et les sources du pays.
Depuis ce jour, elles n’ont d’eau que celle que Héra fait tomber du ciel. La
légende emprunte de toutes parts, aux choses comme aux hommes, pour accroître
son trésor de récits merveilleux.
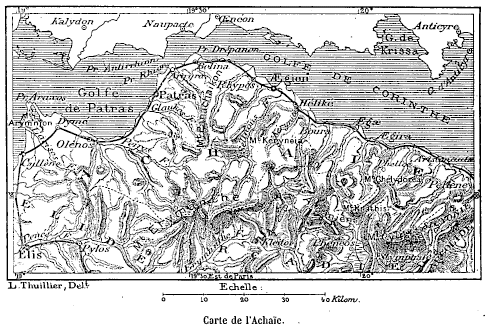 L’Argolide est couverte encore de ruines nombreuses qui
montrent. que dans ce petit espace ont vécu des cités puissantes, Mycènes,
Tirynthe, Midée, Nauplie, Trézène, Hermione, Épidaure ; on en peut
conclure que ce pays fut longtemps le théâtre d’une lutte entre des races
différentes, et l’on comprend pourquoi il ne forma jamais un État uni et
fort, comme l’Attique et la
Laconie. Il n’y avait pas, en effet, plus d’unité dans la
population que dans le sol. Trézène, par exemple, resta presque toute
ionienne. Elle conserva comme principales divinités Neptune et Minerve,
marqua ses monnaies d’un trident avec une tête d’Athéna, et, quand Xerxès
entra dans l’Attique, ce fut à Trézène que les Athéniens confièrent leurs
femmes et leurs enfants. Épidaure aussi garda un fond de population ionienne,
et tous les Achéens ne suivirent pas Tisaménos dans l’Égialée. Aussi l’Argolide
ne fut jamais qu’à demi dorienne, quoique Téménos, le chef de la maison des
Héraclides, se fût établi à Argos, et que les Doriens de cette ville eussent
colonisé successivement Sicyone, Cléone, Phlionte et Épidaure, qui regardèrent
Argos comme leur métropole. Hermione, où l’on montrait une des entrées de l’enfer,
ce qui dispensait ses habitants de mettre dans la bouche de leurs morts la
pièce d’argent que tous devaient payer à Charon, reconnut aussi cette
suprématie, que Nauplie et Asine acceptèrent encore. Argos se trouva à la
tête d’une confédération qui embrassa toute la péninsule argienne et dont la
divinité protectrice de la ligue ne fut plus la Héra achéenne, mais le dieu
dorien Apollon, qui eut son sanctuaire s’élevait dans la citadelle d’Argos.
Tous y venaient et devaient y venir sacrifier. Les Argiens, gardiens du
temple, avaient le droit d’agir par la force contre celles des cités qui n’envoyaient
pas les victimes obligatoires, de même qu’ils frappaient d’une amende ceux
des membres de la ligue qui n’en remplissaient pas les conditions. Sicyone et
Égine ayant, en 514, donné des secours au Spartiate Cléomène dans son
invasion de l’Argie, Argos imposa aux deux cités une grosse amende, et Sicyone
reconnut que c’était justice. L’Argolide est couverte encore de ruines nombreuses qui
montrent. que dans ce petit espace ont vécu des cités puissantes, Mycènes,
Tirynthe, Midée, Nauplie, Trézène, Hermione, Épidaure ; on en peut
conclure que ce pays fut longtemps le théâtre d’une lutte entre des races
différentes, et l’on comprend pourquoi il ne forma jamais un État uni et
fort, comme l’Attique et la
Laconie. Il n’y avait pas, en effet, plus d’unité dans la
population que dans le sol. Trézène, par exemple, resta presque toute
ionienne. Elle conserva comme principales divinités Neptune et Minerve,
marqua ses monnaies d’un trident avec une tête d’Athéna, et, quand Xerxès
entra dans l’Attique, ce fut à Trézène que les Athéniens confièrent leurs
femmes et leurs enfants. Épidaure aussi garda un fond de population ionienne,
et tous les Achéens ne suivirent pas Tisaménos dans l’Égialée. Aussi l’Argolide
ne fut jamais qu’à demi dorienne, quoique Téménos, le chef de la maison des
Héraclides, se fût établi à Argos, et que les Doriens de cette ville eussent
colonisé successivement Sicyone, Cléone, Phlionte et Épidaure, qui regardèrent
Argos comme leur métropole. Hermione, où l’on montrait une des entrées de l’enfer,
ce qui dispensait ses habitants de mettre dans la bouche de leurs morts la
pièce d’argent que tous devaient payer à Charon, reconnut aussi cette
suprématie, que Nauplie et Asine acceptèrent encore. Argos se trouva à la
tête d’une confédération qui embrassa toute la péninsule argienne et dont la
divinité protectrice de la ligue ne fut plus la Héra achéenne, mais le dieu
dorien Apollon, qui eut son sanctuaire s’élevait dans la citadelle d’Argos.
Tous y venaient et devaient y venir sacrifier. Les Argiens, gardiens du
temple, avaient le droit d’agir par la force contre celles des cités qui n’envoyaient
pas les victimes obligatoires, de même qu’ils frappaient d’une amende ceux
des membres de la ligue qui n’en remplissaient pas les conditions. Sicyone et
Égine ayant, en 514, donné des secours au Spartiate Cléomène dans son
invasion de l’Argie, Argos imposa aux deux cités une grosse amende, et Sicyone
reconnut que c’était justice.
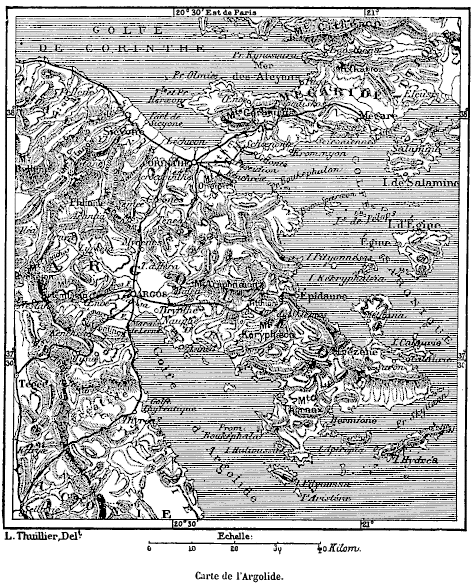
Cette réunion de tous les Doriens de l’Argolide, sous la
direction d’Argos, donna un moment à cette ville, le premier rang dans le
Péloponnèse : au temps de son roi Phidon, le dixième descendant de Téménos,
vers 750, elle exerça l’influence que Sparte n’acquit que plus tard. Phidon
ôta la présidence des jeux olympiques aux Éléens, pour la donner aux
Piséens ; il soumit toute la côte orientale de la Laconie jusqu’au cap
Malée, avec file de Cythère, et le premier, sur le continent grec, il fit
frapper de la monnaie d’argent pour remplacer la lourde et incommode. monnaie
de fer et d’airain que Sparte gardait. Le système de poids et mesures qu’il
établit et qu’on a appelé le système d’Égine fut adopté par tout le
Péloponnèse, la Béotie,
la Thessalie
et la Macédoine. On
voit que ce prince, qui fut presque contemporain de Lycurgue, avait de tout
autres idées, parce qu’il trouvait autour de lui de tout autres besoins. Il
poussait son peuple au commerce, à la navigation, avec autant de force que le
législateur de Sparte en avait mis à retenir le sien dans le cercle étroit de
ses rigides et illibérales institutions. Sparte et Argos n’étaient donc pas
doriennes de la même façon. Corinthe, ville de luxe et de mollesse, le sera
moins encore. C’est qu’il faut donner à l’influence des lieux et, des
circonstances ce que l’on a trouvé longtemps si commode, pour tout expliquer,
de donner à l’influence du sang, à la race.
Après Phidon, la royauté argienne retomba dans la faiblesse
d’où il l’avait tirée et ne fut plus guère qu’un titre. Ainsi que dans tous
les États doriens, la population était divisée en trois classes : une classe
supérieure qui gouvernait, c’étaient les descendants des conquérants; une
classe intermédiaire, les vaincus, libres comme les Laconiens; enfin une
classe de serfs, comme les hilotes, qu’on appelait par mépris les gymnésiens
ou hommes nus. Argos, à titre de cité dorienne et aristocratique, eût dû être
toujours dans l’alliance de Sparte ; mais, avec le souvenir du premier
rang qu’elle avait jadis occupé dans la Grèce, elle ne pouvait voir sans jalousie la
grandeur croissante de Lacédémone. Elle fut souvent en guerre avec elle pour
les frontières, et perdit une partie de la Cynurie. Plus
tard, en haine de Sparte, elle se jeta dans le parti d’Athènes et de la
démocratie, mais pratiqua ce gouvernement difficile sans les sages
tempéraments qu’Athènes y mit longtemps. Cicéron remarque qu’il ne trouve
nulle part mention d’un orateur argien.
A l’est d’Argos, dans la presqu’île Acté, s’élevait
Épidaure, sur la côte du golfe Saronique, en face d’Égine, qu’elle
avait colonisée et dont les destinées furent longtemps enchaînées aux
siennes. A titre de métropole, elle avait obligé les habitants de cette île à
porter leurs procès devant ses tribunaux. Elle tomba, au huitième siècle,
sous la puissance de Phidon d’Argos et recouvra son indépendance après sa
mort. Vers la fin du septième siècle et au commencement du sixième, Épidaure fut
encore soumise à un joug étranger. Proclès y régnait alors ; Périandre,
son gendre, le détrôna. Ce fut sans doute à la suite de cet événement qu’Épine
s’affranchit. Il y avait à Epidaure des esclaves semblables aux hilotes et
aux gymnésiens : on les appelait conipodes (hommes aux pieds poudreux), autre
terme de mépris qui marque en même temps leurs occupations rurales.
Égine est une des plus petites îles de la Méditerranée. Elle
n’a pas 83
kilomètres carrés de surface. Son sol est pauvre : ses
rivages aux gracieux contours sont bordés d’écueils, sauf en un point, où se
rencontre une excellente rade, et, au centre, s’élève le mont. Saint-Élie, d’où
il est facile de compter les temples de l’Acropole d’Athènes, et de voir
Salamine, Éleusis, Mégare, l’Acrocorinthe et les premières îles de l’Archipel.
D’avance, on peut dire qu’Égine dominera le golfe Saronique et la mer des
Cyclades, le jour où ce roc insulaire aura des hommes de coeur et d’intelligence,
comme il s’en est trouvé sur quelques-uns de ces îlots où les Grecs modernes
ont attiré tant de commerce et d’où sont sortis tant de marins redoutables.
Des Pélasges, puis des Achéens myrmidons, furent les plus
anciens habitants d’Égine. Les derniers avaient pour chef Éaque, que la
légende appelle fils de Jupiter. Une année, dit-elle, que la sécheresse
allait faire périr les moissons, les députés de la Grèce accoururent auprès
de lui et le supplièrent d’invoquer son père. Il monta au sommet du mont qu’on
appelle aujourd’hui Saint-Élie et pria. Aussitôt les nues s’assemblèrent et
la pluie tomba en abondance; les Grecs étaient sauvés. Leur reconnaissance
fut lugubre : ils placèrent Éaque aux Enfers pour y juger les morts, avec
Minos et Rhadamanthe. Il avait eu deux fils, Pélée qui retourna avec une
partie des Myrmidons en Thessalie, on il fut père d’Achille, et Télamon, qui
donna le jour à Ajax, le plus terrible des Grecs après le fils de Thétis. Les
Doriens d’Épidaure occupèrent Égine, sans lui donner d’abord beaucoup d’éclat,
car elle resta longtemps obscure. Mais son heureuse situation fit naître le
commerce, et avec lui quelques industries où l’art se mêla. Ses habitants
modelaient des vases élégants, avaient trouvé le bronze le plus estimé après
celui de Délos, frappèrent la première monnaie grecque et vendirent longtemps
des statues de dieux à toutes les cités, et des statues d’athlètes à tous les
vainqueurs d’Olympie, depuis les côtes de l’Asie jusqu’à celles de Sicile.
Avant le siècle de Périclès, les artistes d’Égine furent les premiers de la Grèce.
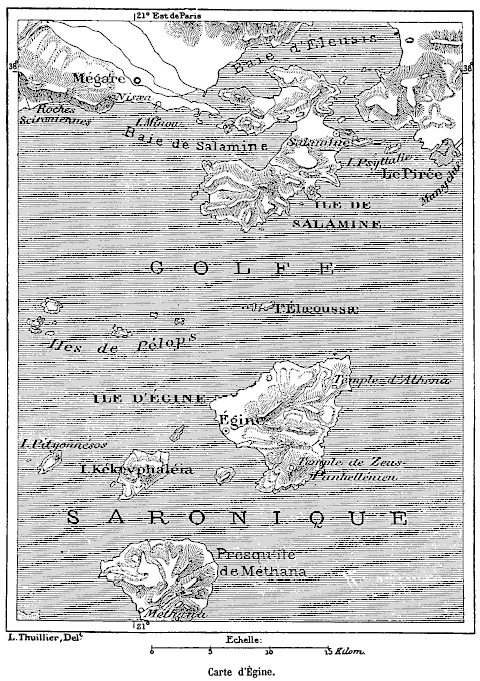
Devenus riches, ils rompirent avec Épidaure, restée pauvre
et faible, mais furent eux-mêmes en proie à des querelles violentes entre l’ancien
parti des conquérants doriens et un parti nouveau que le commerce avait formé
et enrichi. L’oligarchie l’emporta et garda le pouvoir.
A la suite de ses navires de commerce, Égine avait lancé
des navires de guerre, car personne, en ce temps-là, ne faisant la police de
la mer, les marchands portaient l’épée et devenaient bien vite conquérants.
Égine eut des victoires. En 519 elle vainquit les Samiens; mais elle se garda
de l’ambition des conquêtes lointaines; elle ne fonda qu’une seule colonie :
Cydonie, en Crète, qui est aujourd’hui la capitale de Candie, la Canée. Dès l’année
563, sous le règne du pharaon Amasis, elle avait établi un comptoir à Naucratis,
dans le Delta.
Elle eut une autre ennemie, plus redoutable que Samos et
qui finit par la tuer, Athènes. Cette haine avait une cause naturelle dans la
rivalité de deux peuples séparés seulement par une mer étroite où se
rencontraient à chaque instant leurs vaisseaux. Par un bon vent, un navire
allait du Pirée à Égine en deux heures. Hérodote, a comme toujours, pour
expliquer cette haine de deux peuples, à nous conter une vieille histoire qui
montre les mesquines rivalités, les tracasseries réciproques de ces petits
États, et où l’on voit les femmes éterniser les querelles, en conservant le
souvenir des injures dans leurs cérémonies et jusque dans la forme de leurs
vêtements[7]. À une époque de disette, les Épidauriens avaient reçu de la Pythie l’ordre de
consacrer à Cérès et à Proserpine deux statues en bois d’olivier ; pour
avoir de ce bois, s’étant adressés, aux Athéniens, dont les oliviers passaient
pour sacrés ils obtinrent la permission d’en prendre à condition qu’ils
viendraient tous les ans à Athènes offrir un sacrifice à Pallas et à
Érechthée. Les Épidauriens acceptèrent cette condition et l’exécutèrent
fidèlement. Mais, plus tard, les Éginètes leur ayant enlevé ces statues, ils
cessèrent dé se rendre à Athènes. Les Athéniens se plaignirent ; on les
renvoya à Égine, qui refusa d’exécuter la condition acceptée jadis par
Épidaure. Alors Athènes dirigea contre file une expédition qui fut si bien
vaincue, qu’un seul homme échappa. A peine cet homme eut-il annoncé le
désastre, que les femmes de ceux qui avaient péri se jetèrent sur lui, et
chacune lui enfonça dans le corps l’aiguille dont elles se servaient pour
rattacher leurs robes. Il périt par ce supplice. Les Athéniens eurent horreur
de cette cruauté, et, pour punir leurs femmes, ils les obligèrent à quitter l’habillement
dorien qu’elles portaient, et à prendre celui des Ioniennes, c’est-à-dire la
tunique de lin, pour laquelle elles n’avaient pas besoin d’aiguilles. Depuis
cet événement s’établit chez les Argiens et les Éginètes l’usage, qui
subsiste encore, de faire les aiguilles à rattacher les robes de moitié plus
grandes qu’elles n’étaient autrefois, et c’est encore pour cela que, parmi
eux, les offrandes des femmes consistent principalement en ces sortes d’aiguilles
qu’elles consacrent. Une loi défend aussi à ces peuples de faire usage, dans
les cérémonies publiques. d’aucun ustensile fabriqué dans l’Attique, ni d’employer
aucune poterie qui en sorte. On a vu les Éginètes montrer leur haine
persistante contre Athènes lorsque, en 507, ils entrèrent dans la grande
ligue formée par Thèbes et Lacédémone pour ruiner à la fois la liberté et la
fortune renaissante des Athéniens. Du temple qu’ils élevèrent à Athéna, au
temps de leur prospérité, il reste de belles ruines et des sculptures qui,
malgré leur caractère encore archaïque, annoncent le prochain avènement de la
grande statuaire hellénique.
Entre l’Argolide et l’Achaïe, s’élevaient Sicyone et
Corinthe. Sicyone, bâtie à 20 stades de la mer sur une hauteur abrupte dont
le pied est baigné par deux ruisseaux, possédait un territoire très fertile
et passait pour être, avec Argos, le siège du plus ancien royaume de la Grèce ; elle n’hésitait
pas à nommer les princes qui régnaient sur elle dix siècles avant la guerre
de Troie, et l’on racontait que c’était là que Prométhée avait trompé Zeus,
en lui faisant choisir pour un sacrifice, au lieu d’une grasse victime, des
ossements décharnés recouverts de la peau d’un boeuf. Au temps légendaire d’Agamemnon,
Sicyone fut tributaire de Mycènes. Après le retour des Héraclides, un fils de
Téménos s’y établit avec une colonie dorienne. Au-dessous de cette
aristocratie, on entrevoit une population d’autre origine, et une classe de
serfs appelés par mépris catônacophores
(porteurs de peaux de
brebis), et corynéphores (porteurs de bâtons).
Vers 670, un homme du peuple, Orthagoras, s’éleva contre
cette oligarchie et fonda une tyrannie qui subsista un siècle. Elle se conserva si longtemps, dit Aristote (Polit., V, 2), parce que ces tyrans traitèrent leurs sujets avec douceur,
que leur administration fut toujours conforme aux lois et qu’ils surent
conserver la faveur du peuple. Myron, successeur d’Orthagoras, n’est
connu que par une victoire aux jeux olympiques, à la course des chars (648) ; cette
lutte, récemment établie, valut à Sicyone beaucoup de couronnes et à sa belle
race de chevaux une grande renommée. L’arrière-petit-fils de Myron,
Clisthénès, seconda les amphictyons dans la guerre contre Crissa, et, avec
les dépouilles de cette ville, orna sa patrie de riches monuments[8].
Au sujet de ce prince, Hérodote nous a conservé une de ces
histoires qu’il raconte si bien, mais que nous ne sommes pas tenus d’accepter
tout entières.
Ce tyran de Sicyone, dit-il, homme très puissant et fort
riche, avait une fille nommée Agarista, qu’il ne voulait marier qu’au plus
accompli des Grecs. Pendant la célébration des jeux olympiques, où A avait
été vainqueur à la course des chars, il fit proclamer par un héraut que
quiconque se croirait digne de devenir son gendre se rendit à Sicyone dans
soixante jours, parce qu’il marierait sa fille un an après le soixantième
jour commencé. De nombreux prétendants accoururent de tous les points du
monde grec. Clisthénès, à leur arrivée, s’informa de leur pays et de leur
naissance, puis les retint un an auprès de lui. Il les traita chaque jour
avec magnificence et étudia leurs inclinations, leurs mœurs, l’étendue de
leur esprit et de leurs connaissances, soit dans les entretiens qu’il eut
avec eux en particulier, soit dans les conversations générales et dans les festins
auxquels il les invitait. Afin de connaître aussi leur adresse et leur force,
il les engageait à se livrer aux exercices ordinaires, et il leur avait fait
construire tout exprès un stade pour la course et une palestre pour les
autres jeux.
De tous les prétendants, celui qui jusqu’au dernier moment
parut avoir les chances les plus heureuses, était l’Athénien Hippoclidès. Le
jour fixé par Clisthénès pour déclarer son gendre étant venu, ce prince
immola cent bœufs, et invita à ce festin royal non seulement les prétendants,
mais tous les Sicyoniens. Après le repas, les prétendants s’entretinrent de
musique, d’art et de tout ce qui fait le sujet ordinaire des conversations,
chacun s’efforçant de faire briller son esprit. Hippoclidès attirait surtout l’attention,
car on avait déjà deviné la secrète préférence dont il était l’objet. A un
moment il dit au joueur de flûte de jouer un des airs qui accompagnaient les
danses. Mais, au lieu de commencer la pyrrhique, danse guerrière, inventée
par Achille et fort pratiquée à Lacédémone où elle était une image des
combats, il commença une des danses efféminées de l’Ionie. Il espérait
assurer, son triomphe, en déployant sa grâce et sa légèreté ; il ne
voyait pas que le prince, indigné de cette mollesse, le regardait d’un œil irrité,
et il se laissa aller jusqu’à imiter les gestes des bateleurs. Clisthénès ne
pouvant plusse contenir lui cria. Fils de Tisander,
ta danse défait ton mariage. — Hippoclidès s’en
soucie peu, reprit l’Athénien emporté par la vanité et trompé par les
applaudissements moqueurs de l’assemblée. — Alors Clisthénès, ayant fait
faire silence, remercia les prétendants, leur offrit à chacun un talent d’argent
pour reconnaître l’honneur qu’ils lui avaient fait en recherchant son
alliance et fiança sa fille à Mégaclès, fils de cet Alcméon dont il a été
parlé plus haut. De ce mariage naquit un fils ; suivant l’usage
athénien, il prit le nom de son grand-père, Clisthénès, et, après la chute
des Pisistratides il eut la principale autorité dans Athènes. Une petite-fille
de ce Mégaclès fut mère de Périclès.
L’ancienne aristocratie dorienne fit sans doute quelque
tentative pour recouvrer le pouvoir dans Sicyone, car on voit Clisthénès dégrader
ses tribus en leur appliquant des noms méprisants, tandis qu’il donnait à la
sienne celui d’Archélaëns ou chefs du peuple. Quand cette dynastie fut
tombée, vers 570, et que les Doriens curent recouvré l’influence, ils
prirent, à la place de ces noms humiliants, ceux des trois tribus de Sparte
et d’Argos, Hylléens, Dymanes et Pamphyliens; les Archélaëns devinrent alors
les Égialéens ou les hommes du rivage. Argos, à ce qu’il semble, avait essayé
de soutenir le parti dorien de Sicyone ; Clisthénès, pour l’en punir,
abolit les jeux où les rhapsodes se disputaient le prix en chantant les vers
d’Homère, parce que ce poète avait célébré les Argiens. J’ai raconté
précédemment sa lutte singulière contre le héros Adraste qui nous montre
tout, un côté de la vie religieuse des Grecs, le culte des hommes que leurs
exploits avaient sanctifiés. Sicyone, qui enverra 3000 hoplites à
Platée, ne retrouvera cependant un rôle politique que dans le dernier âge de la Grèce ; mais elle eut
de bonne heure une école de sculpture que deux Crétois, Dipœnos et Scyllis, y
fondèrent vers 560 et qui produisit Canachos et Lysippe. Pline (XXXV, 2) dit de
Sicyone : Elle fut la patrie de la peinture.
Corinthe[9] avait un
territoire stérile, mais aussi, pour sa défense, une acropole imprenable sur
un roc escarpé, haut de 575
mètres, et pour sa richesse, deux ports sur deux mers
: l’Archipel et la mer Ionienne ; celui de l’ouest, le Léchée, était
réuni à la ville par une forte muraille, longue de 12 stades. Les difficultés
d’une navigation autour du Péloponnèse firent la fortune de la ville qui, par
ses ports, mettait en communication le golfe Saronique avec celui de Corinthe
et qui pouvait, à son gré, fermer ou ouvrir l’isthme qui porte son nom. Cet
isthme, que Pindare appelait un pont jeté sur l’abîme, n’a que 5 à 6 kilomètres de
largeur, et le terrain est presque uni, ou du moins il n’a, dans sa partie
basse, que des pentes régulières qui permettent de s’élever insensiblement à
une altitude de 60 à 70
mètres. Aussi les Corinthiens purent-ils y établir une
route, le Diolcos, pour les navires qui, placés sur des rouleaux, passaient,
à l’aide de machines,
d’une mer à l’autre. Les modernes font mieux : ils
reprennent l’œuvre de Néron en creusant dans l’isthme un canal. Au sommet et
au pied de l’Acrocorinthe coulait une source abondante, la fontaine Pirène,
excellente, disait-on, pour la trempe du bronze corinthien, meilleure encore,
en cas de siège, pour garantir les citoyens de la soif. La prospérité de
Corinthe datait de loin. Les anciens poètes,
dit Thucydide, l’appelaient Corinthe la riche.
Dans ses chantiers fut construite, vers 700, la première trirème, et
trente-quatre ans plus tût elle avait donné naissance à deux puissantes
villes : Syracuse et Corcyre. Pour protéger son commerce, elle lit la police
de la mer contre les pirates, et, en 664, elle livra aux Corcyréens, qui
avaient bien vite oublié leur origine, le plus ancien combat naval dont on se
souvint du temps de Thucydide. Corinthe fut aussi la première à mouler des
figures, et elle précéda les autres cités grecques dans les arts du dessin.
Plus tard, elle donnera son nom au plus riche des ordres d’architecture. Dans
ses ateliers furent travaillés la laine la plus fine, les bronzes les plus
renommés, des vases peints qu’on rechercha partout et des parfums qui le
disputaient à ceux de l’Orient. Mais les fréquentes visites de ses vaisseaux aux
ports de la mer Orientale, et l’affluence des étrangers dans ses murs
développèrent, avec l’industrie et le luxe, les superstitions et les vices
honteux qu’on retrouve dans les cités asiatiques. Comme les villes syriaques
et babyloniennes, elle eut de libres prêtresses de Vénus sans avoir l’excuse
des croyances qui avaient fait naître les prostitutions sacrées. Un ancien
législateur, nommé Phidon, avait cherché en vain à guérir ces plaies.
Son premier roi dorien avait été l’Héraclide Alétas. La
dynastie qu’il fonda fournit onze générations de rois. Après eux, les Bacchiades,
de la même famille et qui étaient deux cents, s’emparèrent de la royauté, qu’ils
abolirent vers le milieu du huitième siècle, mais en gardant l’autorité, qu’ils
exercèrent sous le nom de prytanes, magistrats annuels choisis dans leurs
rangs. L’assemblée du peuple et le sénat, subsistèrent, dominés l’un et l’autre
par cette puissante maison.
Cette oligarchie fut renversée en 657 par Cypsélos. Les
Bacchiades s’étaient interdit les mariages hors de leur ordre ; mais un d’eux
eut une fille boiteuse, nommée Labda, qu’aucun des nobles ne voulut accepter
pour femme. Irritée de ces dédains, elle s’allia avec un homme étranger à l’aristocratie
et Lapithe d’origine. De cette union naquit un enfant que les Bacchiades firent
rechercher avec soin pour le mettre à mort, car un oracle avait annoncé que,
s’il vivait, il leur serait fatal. Dix d’entre eux se rendirent à la maison
de Labda ; elle, croyant que ces nobles n’étaient venus la visiter que pour
faire honneur à son père, leur laissa prendre son fils : ils avaient résolu
en chemin que le premier qui le tiendrait l’écraserait contre terre. Mais l’enfant,
remis au bras du Bacchiade, se mit à lui sourire si doucement, que l’homme en
fut touché ; n’osant le tuer, il le passa à un autre, celui-ci au troisième,
puis à un autre encore, car l’enfant toujours leur souriait ! Ils
sortirent alors de la maison, se reprochèrent mutuellement leur faiblesse, et
convinrent de rentrer et de frapper tous ensemble Mais la mère avait tout
entendu. Elle cacha son fils dans une corbeille à blé, où ils ne purent le
trouver. Après l’avoir longtemps cherché, ils prirent le parti d’aller dire à
ceux qui les avaient envoyés que le meurtre était accompli. L’enfant fut
appelé Cypsélos, du lieu où il avait été sauvé (xυψελίς, coffret),
ou plutôt la légende se forma sur le nom qu’il portait[10].
Devenu grand, Cypsélos se mit à la tête du parti populaire
et devint tyran de Corinthe. Il imposa de lourdes taxes sur les riches, exila
les oligarques, et pendant les trente années de son règne, conserva si bien l’amour
du peuple, que jamais il n’eut besoin de gardes. Peut-être cette longue tranquillité
fut-elle due aux colonies qu’il envoya au dehors. Sous lui, en effet, Corinthe,
pour disputer aux Corcyréens le commerce de l’Épire et s’assurer des stations
navales dans la ruer d’Ionie, fonda Anactorion et Ambracie, autour du golfe
de ce dernier nom, et Leucade, dans une presqu’île que les habitants séparèrent
plus tard du continent par un canal.
Cypsélos laissa, en 629, le trône à son fils Périandre,
dont le caractère nous est montré sous des aspects bien différents. Sans
doute il fut, comme son père, aimé du peuple et terrible à l’aristocratie. Il
entretenait des relations avec Thrasybule de Milet et, un jour, le consulta
sur ce qu’il avait à faire pour assurer son pouvoir. Thrasybule conduisit le
messager dans un champ de blé où, avec un bâton, il abattit, en se promenant,
tous les épis qui dominaient les autres, après quoi il le congédia, sans
réponse. L’envoyé rapporta ce qu’il lui avait vu faire, ajoutant qu’il s’étonnait
qu’on l’eût adressé à un homme assez extravagant pour ruiner son propre bien.
Mais Périandre comprit le langage muet de Thrasybule ; dès ce jour, il
renversa tout ce qui s’élevait dans l’État au-dessus du niveau de la
multitude, s’entoura de gardes étrangers, fit des lois somptuaires, qui
étaient probablement aussi des lois politiques, comme celle qui limitait le
nombre des esclaves, et, pour épuiser les ressources des grands, il leur
imposa de ruineuses offrandes au temple d’Olympie. La fin de son règne fut
signalée par la prise d’Épidaure, d’où il chassa son beau-père Proclès, mais
attristée par la fin malheureuse de sa femme Mélissé, qu’il tua, dans un
accès de jalousie, et parla douleur de son fils Lycophron, qui lui reprochait
ce crime et refusa d’être son héritier.
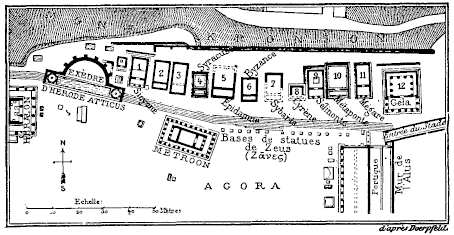
Plan
des trésors d’Olympie[11].
Périandre avait régné quarante-quatre ans, quand il
mourut, en 585. Son successeur Psammétichos ne garda que quatre années le
pouvoir[12].
Après lui, l’oligarchie, soutenue par des troupes spartiates, abolit la
royauté, vers le même temps où le parti dorien se relevait aussi à Sicyone.
Corinthe tomba alors du haut degré de puissance où les Cypsélides l’avaient
portée. Elle perdit Corcyre, que Périandre avait, tenue jusqu’à sa mort dans
l’obéissance, et ses colonies de Leucade, d’Ambracie et d’Anactorion s’affranchirent
de toute dépendance; mais elle conserva les avantages que sa position
géographique lui donnait, et elle continua de jouer un rôle considérable, par
le commerce, les arts, même par la politique, comme le jour où elle s’opposa
au rétablissement, par les Péloponnésiens, d’Hippias dans Athènes.

II. – États secondaires de la
Grèce centrale
Ce que Corinthe était au sud de l’isthme, Mégare, avec ses
deux ports sur les deux golfes, l’était au nord, la clef du passage. Homère
ne la nomme pas; pourtant elle semble ancienne. Les légendes et les noms
héroïques s’y pressent, comme les races se sont pressées sur ce territoire
dans leurs courses aventureuses, chacune y laissant un souvenir, comme chaque
flot du golfe Saronique y laisse quelque pierre arrachée aux roches
Scironiennes[13].
Un roi d’Athènes, Pandion, y avait son tombeau avec des honneurs divins, et
elle paya à Minos la moitié du tribut sanglant imposé aux Athéniens, double
signe, peut-être, d’une ancienne dépendance à l’égard de ce peuple. La royauté
fut abolie à Mégare avant la conquête dorienne. La ville eut alors des
magistrats appelés esymnètes, sorte de
rois électifs et amovibles. Après le retour des Héraclides, elle fut
assujettie par les Corinthiens, et ses habitants furent contraints de venir
pleurer aux funérailles des Bacchiades, comme les Messéniens à celles des
Spartiates. Elle s’affranchit plus tard avec l’aide d’Argos, mais resta
soumise à la domination des riches propriétaires doriens jusqu’en 625, où Théagénès,
beau-père de l’Athénien Cylon, s’empara du pouvoir. Ce fut sans doute sous
son règne que les Mégariens enlevèrent Salamine aux Athéniens. Cependant il
fut chassé et des discordes violentes éclatèrent. Les dettes en étaient la
cause ; malheureusement il n’y avait pas là un Solon pour contenir les
réformes dans les bornes de la modération et de la justice : les créanciers
furent forcés non seulement de renoncer à ce qui leur était dû, mais de
rendre les intérêts qui leur avaient été déjà payés. Alors il y eut des
bannissements et des confiscations. Ceci se passait vers l’an 600. Le poète
Théognis, qui vivait en ce temps à Mégare et qui appartenait à la faction
aristocratique, nous a laissé des vers où se montre l’animosité des partis
aux abois. Cette cité est encore une cité, mais c’est
un autre peuple, fait de gens qui ne connaissaient auparavant ni tribunaux ni
lois. Ils portaient autour de leurs flancs des peaux de chèvres, et, comme
des cerfs, ils habitaient hors de la ville. Maintenant ils sont les bons,
et ceux qui jadis étaient les braves sont les lâches maintenant.
Comme ces amis ardents du passé qui n’ont d’yeux que derrière la tête, il
trouve que tout dégénère et que toute vertu s’en est allée. La Pudeur est morte ; l’Impudence règne, et l’Injure,
victorieuse de la Justice,
est maîtresse de toute la terre. Faire du bien aux mauvais, c’est ensemencer
la mer blanchissante. Dans sa haine farouche il voit déjà s’élever le
tyran qui vengera l’aristocratie. Vienne donc au
plus vite, s’écrie-t-il, l’homme qui foulera
aux pieds ce peuple insensé, lui fera sentir la pointe de l’aiguillon et
appesantira le joug sur son cou. Pour lui, il
voudrait boire le sang noir de ses ennemis[14]. Le poète de
Mégare est un désespéré, et les pessimistes de notre temps n’ont rien à lui
envier : Pour l’homme, le premier des biens,
dit-il, serait de ne pas naître ; une fois né,
ce serait de franchir au plus vite la porte d’Hadès. Cependant ce
désespoir est si contraire à la nature humaine, qu’ailleurs Théognis écrit qu’il faut espérer toujours et que, dans les sacrifices, l’Espérance
doit être invoquée la première et la dernière (v. 425 et 1143). On doit aussi lui
tenir compte d’avoir combattu la vieille et dure croyance à l’hérédité de l’expiation,
en demandant aux dieux de ne plus punir l’enfant pour la faute du père.
Dans les vers de Théognis contre la démocratie mégarienne,
on saisit sur le fait la révolution qui s’opérait : ces hommes à peaux de
chèvres, marque de leur condition, ce sont les catônacophores
que nous avons vus à Sicyone et ailleurs ; c’est ce qui répond aux
vêtements d’esclave des hilotes laconiens. Remarquez aussi ces comparaisons
avec le cerf qui habite loin de la demeure des hommes, avec le bœuf qu’il
faut piquer de l’aiguillon et courber sous le joug ; elles montrent bien
que les vaincus, les mauvais étaient mis par les aristocraties
doriennes, par ceux qui s’appelaient les bons, les braves, au
niveau des bêtes de somme. Même parmi les dominateurs, les mœurs étaient
farouches : Mieux vaut, disait un proverbe, être le bélier que le fils d’un Mégarien.
Malgré ces discordes intérieures, malgré sa réputation
quelque peu suspecte à l’endroit de l’esprit, s’il en faut, croire les
Athéniens, juges très compétents mais prévenus, Mégare semble avoir eu, au
sixième siècle, une puissance qu’elle ne retrouvera plus dans la suite. Du
moins ses lointaines colonies, en Sicile et jusque sur les côtes de la Bithynie et du Bosphore
de Thrace, où elle fonda Byzance, annoncent une population nombreuse et un
commerce florissant. Elle lutta contre Athènes et vainquit une fois ceux qui
allaient devenir les maîtres de la mer. Une proue d’airain suspendue dans son
temple de Jupiter perpétua ce glorieux souvenir. A Platée elle envoya 3000
hoplites. Aujourd’hui, dit Plutarque, la Grèce entière n’en pourrait fournir autant.
Plus tard encore, elle donna naissance à une école de philosophie. Mais la
base d’une puissance durable lui manquait : elle n’avait pas d’agriculture : Les Mégariens labourent des pierres, dit Isocrate.
De là ces continuelles tentations d’empiéter sur la plaine fertile d’Éleusis.
De plus elle était, autant que Sparte, hostile aux étrangers : en offrant son
droit de cité à Alexandre, elle prétendit ne l’avoir donné qu’au seul
Héraklès, l’aïeul du héros.
De la
Mégaride nous entrons dans la Béotie. Voisine de l’Attique, dont elle n’est
séparée que par les défilés du Parnès, la Béotie présente un tout autre aspect : la
végétation y est plus forte; la terre, grasse et arrosée de nombreux cours d’eau,
a l’apparence de la fertilité et de la richesse; les pâturages abondent; mais
dans ce plantureux canton on chercherait en vain les lignes harmonieuses de l’Attique ;
les contours des montagnes sont moins précis,-leurs arêtes moins vives ;
le regard est partout limité ; une atmosphère épaisse et vaporeuse fait
regretter la lumière qui illumine le paysage athénien. Le contraste est aussi
grand entre les deux histoires qu’entre les deux pays.
La royauté fut abolie en Béotie de très bonne heure, dès
le douzième siècle. La contrée se partagea alors en autant de petits États qu’il
y avait de villes, dix à douze. Orchomène, bien déchue de son antique
grandeur, Thèbes, Platée et Thespies, les deux seules cités béotiennes qui
refusèrent de donner aux hérauts de Xerxès la terre et l’eau, Tanagra où
était née Corinne, la rivale de Pindare, enfin Chéronée, étaient les plus
considérables. Près de Thespies se trouvait le bourg d’Ascra, patrie d’Hésiode.
Chacune de ses villes avait son territoire et son régime particulier. Le gouvernement
était généralement oligarchique. Néanmoins des troubles s’élevèrent à Thèbes,
au. sein même de la classe dominante, à cause de l’inégalité des propriétés.
On appela de Corinthe un législateur, le Bacchiade Philolaos, pour rédiger un
code de lois. Il essaya d’organiser l’aristocratie d’une manière durable en
limitant à un nombre déterminé les familles investies des droits politiques,
et en excluant des fonctions publiques tout Thébain qui, dans les dix années
antérieures, aurait exercé quelque métier. On voit que ces lois étaient
dictées par le plus pur esprit dorien[15]. Une autre preuve
de ce même esprit est la répugnance de Thèbes à ouvrir ses portes aux
étrangers. Pour elle comme pour Sparte, on connaît très peu de concessions du
droit de cité ; mais elle diffère de Lacédémone par les troubles que
suscitèrent alternativement, une oligarchie et une démocratie effrénée[16]. À Thespies, l’exercice
d’un métier était aussi regardé comme chose dégradante pour un homme libre.
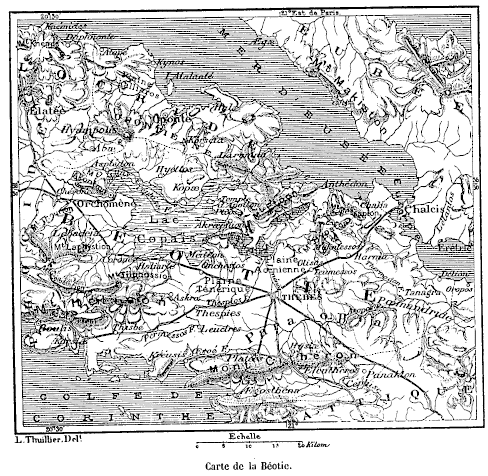
Les villes de la
Béotie formèrent entre elles une ligue, à la tête de laquelle
Thèbes se plaça ; mais cette prééminence finit par devenir une
domination absolue. Plusieurs cités, entre
autres Platée et Thespies, essayèrent de la repousser ; de là des
guerres qui amenèrent la destruction de ces deux villes par les Thébains. Les
affaires du pays étaient décidées dans quatre conseils se tenant dans les
quatre districts dont se composait la Béotie ; ils choisissaient onze béotarques,
qui étaient, comme suprêmes magistrats, a la tête de la confédération et
avaient le commandement des armées, à la condition de résigner leurs
pouvoirs, à la fin de l’année, sous peine de mort. Thèbes en nommait, à elle
seule, deux, dont l’un était le président du corps. Des fêtes solennelles
réunissaient les membres de la ligue dans les champs de Coronée, autour du
temple de Minerve. Les Béotiens, par l’étendue et la population de leur
territoire, auraient pu jouer le premier rôle dans la Grèce, sans leurs
mauvaises constitutions et leur jalousie contre Thèbes.
Toute l’antiquité s’est moquée de la lourdeur des
Béotiens. Ils ont pourtant donné à la Grèce le plus fameux de ses lyriques, Pindare,
Corinne, son émule, et celui qu’on a placé le plus près d’Homère dans la
grande poésie, Hésiode. De celui-ci, j’ai déjà cité plusieurs fragments; en
voici qui sont remarquables à un autre titre. Ne
faites jamais tort à personne. Aimez qui vous aime ; secourez qui vous secourt.
Celui qui donne éprouve en son cœur un doux ravissement. S’il dit
encore : Refusez à qui vous refuse, il ajoute
: Lorsque votre prochain reconnaît sa faute,
rendez-lui votre amitié, et sans cesse il recommande de protéger le
faible, le suppliant, l’hôte, l’orphelin. Jupiter est devenu la justice, la
morale est sa loi, et il punit ceux qui la violent. Hésiode promet au juste
ce qui était la grande récompense hébraïque, une vieillesse prolongée et
heureuse, de nombreux enfants qui lui ressembleront et tous les biens d’ici-bas ;
enfin, après cette vie, le séjour dans les îles des Bienheureux ; au méchant,
il réserve le Tartare dont le seuil inexorable est d’airain et gardé par
Cerbère.
Il est à remarquer que c’est dans la contrée qui s’étend
du Parnasse à l’Attique que s’est opéré le dernier mouvement religieux ;
là que se sont établis le culte d’Apollon et les mystères d’Éleusis ; là
qu’est née la légende d’Hercule, le premier des héros ; là encore que
Bacchus, le dernier venu des grands dieux helléniques, a pris vraiment possession
de sa divinité sur le Parnasse, près de Delphes, sur le Cithéron, près de
Thèbes, et aux environs d’Orchomène, où se célébrait son culte désordonné.
Les femmes, vêtues de la nébride des bacchantes, emplissaient les montagnes
du bruit de leurs danses sauvages et illuminaient les bois du feu de leurs torches,
en courant à la recherche du dieu.
N’oublions pas non plus que les Muses, descendues de l’Olympe,
se sont arrêtées sur le Parnasse, et que l’hélicon, dans ses gracieux replis,
cache la fontaine sacrée d’Hippocrène. Enfin, une tradition rapporte qu’Étéocle
fonda à Orchomène le culte des Charites : les Grâces, comme les Muses,
seraient donc Béotiennes. Il est certain que les arts étaient honorés dans ce
pays : son école de peinture, qui vint tard, ne fut pas sans gloire, témoin
les noms de Nicomaque et d’Aristide ; et la musique y était un goût
national : Thèbes est fondée aux accents de la lyre d’Amphion ; les
joueurs de flûte thébains sont célèbres dans toute la Grèce, et les roseaux les
plus propres à la fabrication de la flûte croissent au bord du lac Copaïs. La Béotie ne fut donc pas
aussi déshéritée que son mauvais renom pourrait le faire croire.
En face, de l’autre côté de l’Euripe, s’allonge une île
montueuse et étroite, l’Eubée, la terre aux riches troupeaux (Εϋβοια)[17]. Sa côte
orientale est abrupte et sans port; l’autre, au contraire, facilement
accessible en mille points, s’ouvre, au centre, en une grande et fertile
plaine, où s’élevaient les deux principales villes, Érétrie et Chalcis : celle-ci,
bâtie sur le penchant d’une colline, avait un bon port à ses pieds. Dans l’une
et l’autre dominait une oligarchie de riches propriétaires appelés Hippobotes (qui nourrit des chevaux). Érétrie eut une
époque de puissance : elle commandait alors à Andros, Ténos, Céos, et pouvait
mettre en ligne trois mille fantassins, six cents cavaliers et soixante
chars. Les deux villes furent longtemps en guerre, au sujet de mines qu’elles
se disputaient. Ces luttes, dans lesquelles Chalcis représentait l’aristocratie
et. Érétrie la démocratie, intéressèrent par cette raison toute la Grèce. Elles furent
l’occasion de la première ligue entre des cités lointaines; Milet entra dans
l’alliance d’Érétrie, Samos clans celle de Chalcis. Ce fut, au jugement de
Thucydide, la guerre qui agita le plus la Grèce entière entre la chute de Troie et, l’invasion
persique. Une singulière et loyale convention avait été faite entre les deux
États c’était de ne point se servir de traits ni de projectiles dans les
combats. On ne voulait pas que le lâche pût de loin tuer le brave. L’Eubée,
fertile et riche, ne sut pas garder sa liberté, elle devint comme la ferme d’Athènes.
Mais le contact avec la cité de Minerve n’échauffa pas ces lourdes
intelligences : l’Eubée ne produisit ni un philosophe ni un poète. Souvent
les pays qui ont la richesse n’ont que cela ; Dieu fait aumône aux
pauvres : il leur donne le courage ou le génie.
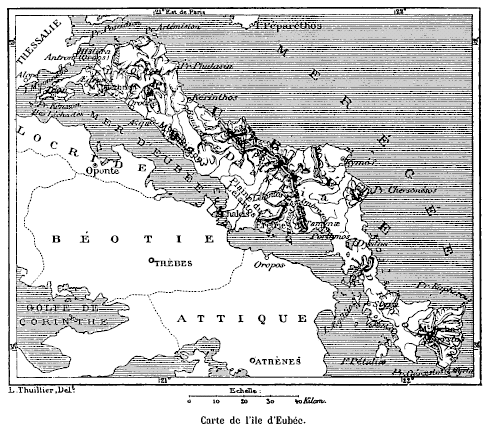
Les Chalcidiens furent tristement fameux par un vice que
nous ne comprenons pas, mais que la
Grèce pratiqua en grand, qu’elle communiqua à l’empire
romain et que l’Orient a gardé ; ils lui avaient donné leur nom χαλιδίζειν.
Sur leur place publique, ils avaient élevé un monument somptueux auquel se rattachait,
en même temps qu’une tradition héroïque, un souvenir de cette chevalerie
amoureuse dont les femmes n’étaient point l’objet. C’était le tombeau de
Cléomachos, chef thessalien, qui était venu secourir Chalcis contre Érétrie.
On le presse, dans un moment critique, de charger la cavalerie ennemie. Regarderas-tu le combat, dit-il à un jeune homme qu’il
aimait. Celui-ci jure de ne pas perdre un instant la mêlée des yeux et se
jette dans ses bras, puis attache lui-même les armes de son ami. Cléomachos s’élance,
met en fuite les cavaliers érétriens, écrase ou disperse leurs hoplites, mais
est blessé et meurt au sein de la victoire.
Ce furent des Chalcidiens qui envoyèrent, la plus ancienne
des colonies grecques de l’Occident, celle de Cumes, en Italie, au onzième
siècle ; eux encore qui, au huitième, pénétrèrent les premiers en Sicile
et, plus tard, entrèrent en relations avec Corcyre. Au nord-est, sur les
côtes de Thrace, ils pénétrèrent dans la presqu’île qui, de leur nom, s’appela
la Chalcidique
et ils y bâtirent trente-deux villes, preuve certaine de leur ancienne
puissance. Mais la défaite de 508 les ruina. Dans les guerres Médiques, ils
furent réduits à emprunter des vaisseaux à Athènes.
On pénètre de la
Béotie dans la
Phocide en traversant, près de Chéronée, la chaîne du
Parnasse et le défilé fameux que les anciens appelaient la route fendue par où l’on allait à Delphes, en
longeant le profond vallon du Pléistos. Au lieu d’un vaste bassin central,
comme le lac Copaïs, autour duquel se sont groupées les villes béotiennes, la Phocide a en son milieu
de hautes montagnes qui ont rejeté la vie et les cités à leur pourtour : au
nord, dans la vallée supérieure du Céphise, au sud, sur la mer de Corinthe,
qui pénètre profondément dans les terres par les golfes de Crissa et d’Anticyre.
La Phocide
touche même par la ville de Daphnous, entre les deux Locrides
septentrionales, à la mer Eubéenne. Elle comprenait vingt ou trente petites
républiques confédérées. dont les réunions générales avaient lieu dans un
vaste édifice appelé Phocicon.
Delphes, qui vivait de son temple, voulait rester en dehors de cette union.
Sparte l’y aida. Son gouvernement, rigoureusement aristocratique, était entre
les mains des familles chargées de l’administration du sanctuaire. Dans les
temps reculés, le premier magistrat porta d’abord le titre de roi ; plus
lard, il s’appela prytane. Un conseil de cinq personnes, de la famille de
Deucalion, administrait les affaires de l’oracle.
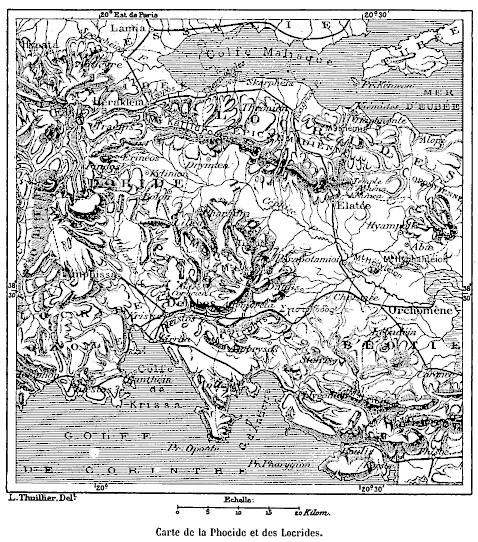
Delphes n’eut pas toujours cette indépendance.
Anciennement elle dépendait de Crissa qui, bâtie sur une chaîne détachée du
Parnasse, au-dessous des Phédriades, les roches
brillantes, dominait le ravin profond du Pléistos. En approchant
de la mer, ce ruisseau, jusque-là très encaissé, traversait, une plaine
fertile dont les eaux du golfe de Corinthe avaient échancré le bord en y
creusant une baie profonde. Comme tous les fondateurs de villes dans l’âge
héroïque, les Crisséens avaient cherché la sécurité dans l’intérieur des
terres, sur un roc escarpé et, plus tard, pour les besoins du commerce, ils
avaient établi un port à Cirrha. Dans la vallée supérieure du Pléistos, des
vapeurs sortaient d’une fissure du sol[18]. Frappés de ce
phénomène qui rendit fameux le site de Delphes, ils consacrèrent en cet
endroit un temple à Apollon, le dieu qui révélait l’avenir[19]. Ils se
trouvaient ainsi à mi-chemin de leur port et de leur sanctuaire. Mais il
était inévitable que l’un et l’autre s’accroîtraient à leurs dépens, grâce à
la foule des pèlerins arrivant par mer pour consulter l’oracle. Crissa fut
abandonné peu à peu de ses habitants, qui allèrent chercher fortune soit à
Cirrha, où affluaient les dévots d’Apollon, soit à Delphes, où ils laissaient
leurs dons au dieu et beaucoup d’argent à leurs hôtes. Quand les murs
cyclopéens de Crissa, dont on voit encore les restes, devinrent déserts, la
lutte s’établit entre les habitants du port et ceux du sanctuaire, les
premiers exerçant contre les pèlerins des exactions et des violences que les
seconds avaient intérêt à empêcher. Cette rivalité amena la première guerre
Sacrée (600)
que les amphictyons ordonnèrent, que les Thessaliens, les Sicyoniens et les
Athéniens conduisirent, et dont le résultat fut la destruction de Cirrha. C’est
encore une guerre homérique, je veux dire légendaire : le siège de Cirrha,
comme celui de Troie, dura dix ans.
Pausanias, dans son Voyage, et Frontin, dans ses Stratagèmes, content que, sur le
conseil de Solon, les alliés avaient jeté de l’ellébore dans la source où les
assiégés s’abreuvaient et que ceux-ci, affaiblis par l’usage de ces eaux,
avaient, à la fin, laissé tomber leurs armes. Une source qui possédait la
même propriété que l’ellébore et qui coule prés de la ville a donné naissance
à cette histoire. Quant il la longueur du siège, il fallait bien, puisqu’il s’agissait
d’une exécution religieuse, que les récits qui coururent en Grèce montrassent
quelle persévérance les dévots d’Apollon avaient mise à venger ses injures.
Il n’y eut, sans doute, durant plusieurs années que des dévastations
périodiques sur le territoire de Cirrha, comme celles que les Lacédémoniens
feront en Attique, au temps de la guerre du Péloponnèse. Faute de machines
pour battre les murailles, les villes à remparts cyclopéens étaient
imprenables, tant qu’il leur restait des vivres.
Les dispositions prises par les prêtres de Delphes, après
cette sanglante exécution, sont d’une grande habileté. D’abord les dépouilles
de Cirrha servirent à instituer les jeux pythiques, qui rivalisèrent d’éclat
avec ceux d’Olympie au grand profit du temple et de ses des servants. Puis,
pour empêcher qu’une autre ville ne prit la place de la cité détruite, ils
consacrèrent à Apollon les terres de Cirrha : elles devaient donc, sous peine
de sacrilège, rester incultes et désertes ; mais elles pouvaient servir
au pâturage, car il fallait que les pèlerins trouvassent des victimes à
présenter aux autels, l’oracle ne se laissant interroger qu’après un
sacrifice dont les prêtres avaient leur part. Aussi les poètes comiques, pour
dire que le Delphien vivait au milieu des fêtes et des sacrifices, le représentaient
une couronne sur la tête et un couteau à la main (Athénée, IV, 74).
Nous ne parlons pas de la Doride, petit et
triste pays avec quatre villages décorés du nom de villes, mais que
Lacédémone honorait comme sa métropole, ni des trois Locrides, pays sans
importance.
Au nord de la
Phocide s’étend la Thessalie, divisée en quatre districts :
Thessaliotide, Pélasgiotide, Phthiotide et Histiéotide. Les Thessaliens proprement
dits apparaissent comme un peuple grossier, violent et peut-être étranger à
la race hellénique, bien qu’ils parlassent un dialecte voisin de l’éolien.
Leur cavalerie était renommée, car leur noblesse servait à cheval, et ils
avaient une race de chevaux petits et sobres, mais nerveux et très résistants
à la fatigue. Leur infanterie était mauvaise : ils n’avaient que des troupes
légères, mal armées et peu belliqueuses, parce qu’elles combattaient pour des
maîtres. Ces tributaires étaient les Pénestes,
c’est-à-dire les Travailleurs ou les Pauvres, anciens habitants
de la Thessaliotide
et des régions voisines, qui, comme les hilotes de Sparte, conduisaient les
innombrables troupeaux des Thessaliens, cultivaient leurs terres, leur
faisaient cortège dans la ville et les suivaient aux combats, mais ne
pouvaient être ni vendus hors du pays, ni dépouillés sans cause légitime de
la ferme qu’ils avaient reçue, ni privés du droit de contracter mariage et d’acquérir.
Aussi quelques-uns devinrent-ils plus riches que leurs maîtres. Dans la
ville, les Pénestes habitaient un quartier à part, et jamais l’Agora, où se
rassemblaient les maîtres, ne devait être souillée par la présence de l’esclave.
Comme tant d’autres aristocraties militaires, les Thessaliens étaient
débauchés et violents, fastueux et vains. Mais l’élégance de l’esprit et des
moeurs leur manquait : la poésie les touchait peu ; Simonide ne put se
faire écouter d’eux. Autre signe de la grossièreté de ce peuple : en Thessalie,
les magiciennes pullulaient ; à Athènes, elles étaient punies de mort.
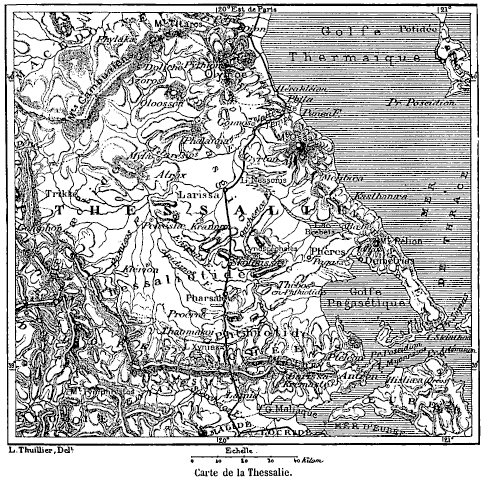
Si les Thessaliens avaient été unis, ils eussent joué un grand
rôle; mais cette noblesse turbulente et fière s’affaiblissait par de continuelles
dissensions. Non seulement les grands cantons étaient indépendants, mais
chaque canton se subdivisait en districts qui vivaient à l’écart. Ainsi le
pays des Oétéens était partagé en quatorze districts, et les habitants de l’un
pouvaient refuser de suivre à la guerre les habitants des autres. Dans quelques
villes, il s’éleva des familles dominantes : à Crannon, les Scopades ; à
Larisse, les Aleuades, qui se disaient descendants d’Hercule, et, pour
répandre leur nom dans la
Grèce plutôt que par goût pour la poésie, faisaient chanter
leur gloire par Simonide et Pindare. Parfois cependant tout le pays se
réunissait sous un tagos, sorte de
dictateur comme ceux de Rome. Deux générations avant la guerre des Perses, il
y en eut un qui usurpa le pouvoir à Larisse, mais pour peu de temps. Cette
vieille cité pélasgique, la plus riche de la Thessalie, était
fameuse par ses courses de taureaux. Dans son voisinage, on célébrait une
fête qui rappelle les saturnales de Rome : à certain jour de l’année, les
esclaves y étaient servis par les maîtres[20].
Nous ne ferons que nommer les Locriens
Ozoles, les Étoliens,
peuple brigand et à demi sauvage, dont Thucydide ne comprenait pas la langue,
et les Acarnanes, que les colonies de
Corinthe à Anactorion et à Leucade n’avaient pu civiliser. Thucydide dit de
ces trois peuples qu’ils conservaient les mœurs de l’âge héroïque, l’habitude
du brigandage et celle d’être constamment armés. Plus haut est l’Épire, qui,
n’ayant point de ports, donna peu de prise à la colonisation grecque ;
mais déjà nous sortons du monde hellénique et nous sommes chez les barbares[21].
Que ressort-il de ce tableau ? D’abord ce fait
singulier que la civilisation et la puissance, à peu près également réparties
dans toutes les provinces de la
Grèce d’Homère, se sont accumulées et concentrées dans la
partie orientale. Les peuples du Nord et de l’Ouest baissent ;
quelques-uns même se tiennent complètement à l’écart de la vie commune. Le second
fait, c’est qu’il n’y eut jamais de pays plus agité que celui des Grecs. Ce
peuple a longtemps vécu, nais surtout il a beaucoup vécu. Cherchez dans la
vraie Grèce un coin qui soit demeuré enseveli dans le repos et l’apathie :
vous ne le trouverez pas. Partout des passions, des ambitions, des luttes,
des révolutions. Cette vie était une rude éducation, et pour les esprits et
pour les corps. Aussi viennent les Perses, et ces sentiments puissants de
liberté, d’émulation, d’amour de la gloire, qui germent de toutes parts, ces
corps sains et vigoureux, élevés dans les combats et les exercices, auront
bien vite raison de multitudes qui traînent paresseusement leurs longues
robes sous les coups de fouet de leurs maîtres.
|
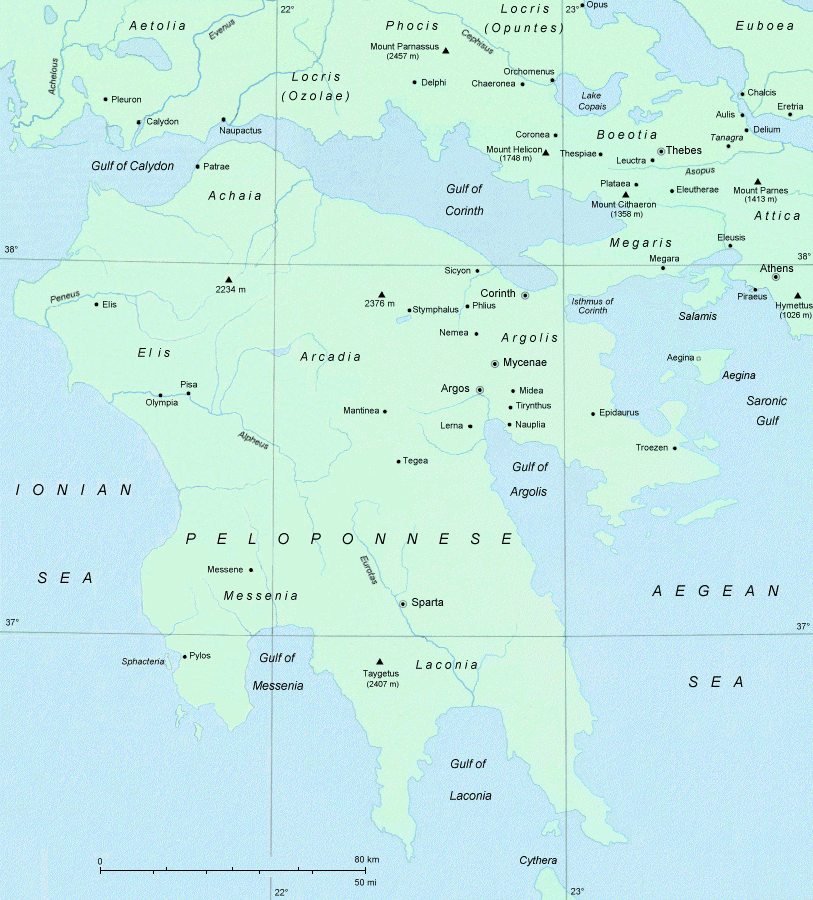
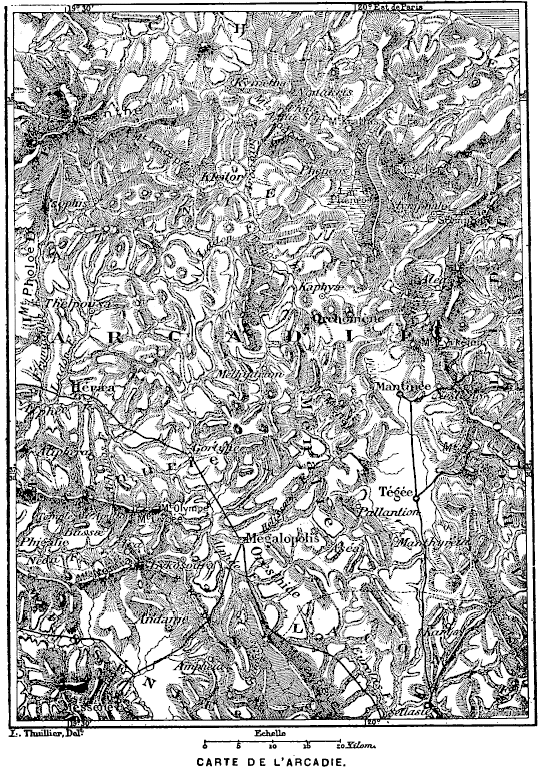
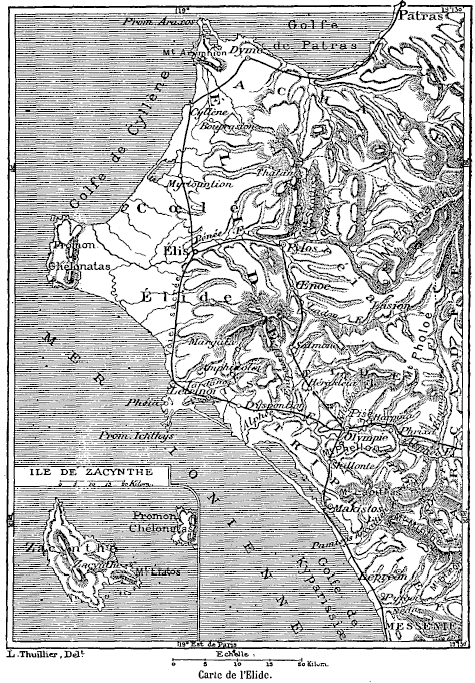
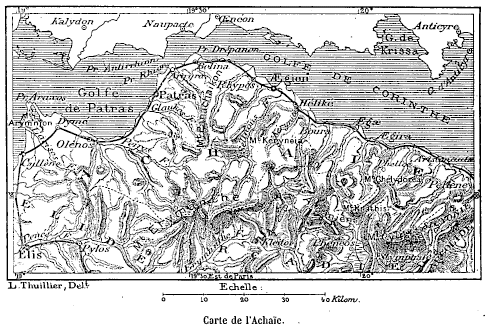 L’Argolide est couverte encore de ruines nombreuses qui
montrent. que dans ce petit espace ont vécu des cités puissantes, Mycènes,
Tirynthe, Midée, Nauplie, Trézène, Hermione, Épidaure ; on en peut
conclure que ce pays fut longtemps le théâtre d’une lutte entre des races
différentes, et l’on comprend pourquoi il ne forma jamais un État uni et
fort, comme l’Attique et
L’Argolide est couverte encore de ruines nombreuses qui
montrent. que dans ce petit espace ont vécu des cités puissantes, Mycènes,
Tirynthe, Midée, Nauplie, Trézène, Hermione, Épidaure ; on en peut
conclure que ce pays fut longtemps le théâtre d’une lutte entre des races
différentes, et l’on comprend pourquoi il ne forma jamais un État uni et
fort, comme l’Attique et