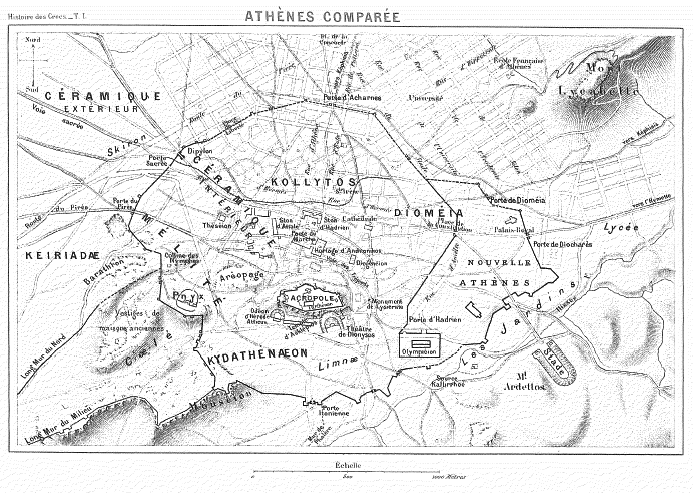HISTOIRE DES GRECS
DEUXIÈME PÉRIODE — DE L’INVASION DORIENNE AUX GUERRES MÉDIQUES (1104-490) — ISOLEMENT DES ÉTATS - RÉVOLUTIONS INTÉRIEURES - COLONIES.
Chapitre X — Les Pisistratides et Clisthénès (560-500).
I. PisistrateLes principes sur lesquels reposait la législation de Solon étaient bien d’accord avec le caractère et les besoins du peuple athénien; ses lois, par conséquent, étaient destinées à vivre. Mais il faut du temps pour que les vieux partis abdiquent et laissent les institutions nouvelles agir régulièrement. Le passé ne s’efface point d’un trait. Alors même qu’il est irrévocablement condamné à mourir, il prolonge longtemps encore son influence, et on a vu des sociétés bouleversées jusque dans leurs fondements ne pouvoir l’arracher de leur sein pour commencer librement une vie nouvelle. Dans une certaine mesure cette résistance est légitime, car elle empêche le mouvement de se précipiter, et, pour l’État comme pour la famille, la tradition est un élément qui doit avoir sa part d’influence. Qu’on ne s’étonne donc pas que la sagesse de Solon n’ait pu immédiatement désarmer toutes les ambitions, éteindre toutes les rancunes, réunir tous les partis en un seul, celui de la paix publique et de la grandeur nationale. Quand, de retour de ses voyages, il rentra dans Athènes, trois factions étaient aux prises. Les hommes de la plaine avaient à leur tête Lycurgos, ceux du rivage l’Alcméonide Mégaclès, les montagnards Pisistrate, qui se vantait de descendre de Nestor. A ces derniers s’était jointe la foule des thètes, ennemis déclarés des riches et que Solon avait trompés dans leur espérance mauvaise d’un partage des terres. On respectait encore la récente constitution, du moins on ne la violait pas ouvertement; mais, de tous côtés, on espérait une révolution au bout de laquelle le plus fort saisirait le pouvoir. Heureusement que l’histoire et les dernières lois avaient si étroitement uni les populations, que ces rivalités pouvaient bien conduire à la ruine dés libertés publiques, mais non pas au déchirement de l’État. Ainsi, chaque faction avait son chef : seul, le parti de la paix et de la loi n’en avait pas. Solon était tout naturellement. désigné pour ce rôle. Reçu avec honneur et respect, il essaya de réconcilier les trois rivaux. Mais il ne tarda pas à distinguer parmi eux un ambitieux habile et dangereux pour la liberté : C’était Pisistrate, que sa bravoure dans les guerres contre Mégare avait rendu populaire, et qui se frayait les voies avec un grand art de séduction. Il était, dit Plutarque, d’un caractère aimable, insinuant dans ses propos, secourable envers les pauvres, doux et modéré pour ses ennemis. Il savait si bien simuler les qualités que la nature lui avait refusées, qu’il passait généralement pour un homme modeste, réservé, zélé partisan de la justice et de l’égalité, ennemi déclaré de ceux qui voulaient introduire des nouveautés. Quand il crut le moment venu de renouveler la tentative de Cylon, il usa d’une ruse singulière. Après s’être fait à lui-même et à ses mules quelques légères blessures, il poussa ces animaux en désordre sur la place publique, fuyant, disait-il, des ennemis qui voulaient le tuer. La foule s’indigne ; aussitôt un des confidents de Pisistrate propose qu’il soit donné une garde de cinquante hommes à l’ami du peuple. Au bruit de cette astucieuse proposition, Solon, malgré son grand âge, accourt sur la place publique et la combat énergiquement ; mais, abandonné par les riches, il est seul au milieu de la foule menaçante des pauvres ; il rentre alors chez lui, prend ses armes et les met devant la porte de sa maison, en disant : J’ai défendu autant qu’il m’a été possible la patrie et les lois. Il les défendit encore par ses vers, mais aussi vainement : Si vous endurez ces maux par votre lâcheté, n’en accusez pas les dieux. C’est vous qui avez fait ces hommes si grands et qui vous êtes mis dans ce honteux esclavage. Par la déférence qu’il lui montra, Pisistrate le ramena, sinon à approuver son usurpation, du moins à l’aider quelquefois de ses conseils. Le sage mourut en 559. Avec la garde qu’il avait obtenue et qu’il porta
successivement à quatre cents hommes, Pisistrate s’empara de la citadelle (560). Dès lors il
fut le maître d’Athènes, d’où les mécontents sortirent, pour aller fonder,
sous la conduite de Miltiade l’Ancien, une colonie dans
Malgré cette modération, il ne réussit pas à garder le pouvoir, qu’il perdit et recouvra plusieurs fois. Mégaclès et les Alcméonides s’étaient d’eux-mêmes exilés. Lycurgos resta dans la ville, se réconcilia avec eux et les deux factions réunies parvinrent à chasser l’ennemi commun. On s’était entendu pour renverser Pisistrate, on ne put s’entendre pour partager ses dépouilles ; les alliés se brouillèrent, et la division fut partout, dans le pays comme dans la cité : plus de sécurité, plus de commerce. Pisistrate s’était retiré dans les montagnes et y vivait en chef indépendant. Mégaclès lui proposa, s’il voulait épouser sa fille, de lui laisser reprendre le pouvoir. Il accepta. Son influence était si grande encore dans la ville, qu’il ne s’était trouvé qu’un seul homme après son exil qui eût osé se rendre acquéreur de ses biens mis à l’encan. Pour donner plus d’éclat à son retour, Pisistrate organisa une cérémonie qu’on a mal comprise. Il y avait dans le bourg de Péania une femme d’une taille remarquable et d’un beau visage. Mégaclès et Pisistrate la revêtirent d’une armure complète et la placèrent sur un char, qui marcha vers la ville. Il était précédé de hérauts qui criaient : Athéniens, recevez favorablement Pisistrate, que, de tous les hommes, Minerve honore le plus, et qu’elle ramène elle-même dans la citadelle. Il suivait le char à cheval. Les habitants, persuadés que cette femme était réellement la déesse, se prosternèrent pour l’adorer, et laissèrent rentrer Pisistrate. Il n’avait pas besoin, avec son influence réunie à celle de Mégaclès. de cette ruse grossière. Les portes lui étaient ouvertes ; mais, pour rentrer dans la ville avec plus de solennité, il s’était mis sous la protection de la déesse. Au lieu de faire porter sa statue durant la solennité habituelle, il y avait montré sa vivante image, et il y eut en tout cela si peu de feinte, que la prétendue déesse épousa un de ses fils, après la cérémonie. Un mariage avec une fille des Alcméonides était la condition
imposée à Pisistrate. Mais il ne voulait pas mêler soi sang à celui d’une
race maudite. Le mépris qu’il montra à la jeune femme rejeta Mégaclès dans le
parti de Lycurgos. Pisistrate fut encore obligé de quitter Athènes, et cette
fois l’Attique même. Il se retira à Érétrie, dans l’Eubée, une des villes
alors les plus prospères de Hippias, son fils aîné, et le devin Amphilytos le décidèrent, en 541, à faire un nouvel effort. Les Argiens lui permirent de lever chez eux un corps de mercenaires, et le Naxien Lygdamis vint le rejoindre avec des soldats et de l’argent. Les Athéniens sortirent pour le combattre, mais en désordre ; la victoire fut facile, et Pisistrate entra avec les fuyards dans Athènes, d’où les Alcméonides s’exilèrent encore. Il affermit son pouvoir en promettant à tous amnistie et sûreté, à condition que chacun retournât tranquillement à ses affaires. Mais il ne se fia qu’aux troupes étrangères, qu’il put conserver à sa solde. Il se fît donner d’ailleurs en otage les enfants des principaux citoyens et les relégua dans l’île de Naxos, qu’il soumit et que gouverna son ami Lygdamis. Enfin il enleva aux Athéniens leurs armes, qu’il déposa dans le temple d’Aglaure, et il établit sa résidence sur l’Acropole, roc inaccessible, excepté en un point facile à garder. Sa tyrannie fut du moins intelligente et active[1]. Il rétablit les
relations d’amitié avec Thèbes et Argos, et se fit l’hôte de Sparte. Il
voulait de ce côté la paix, car, de même que Solon, il comprenait que ce
n’était point sur la terre ferme, où Mégare et Thèbes lui barraient la route,
qu’Athènes devait chercher la fortune, mais sur cette mer des Cyclades, par
où passait tout le commerce de Il ouvrit des routes pour relier la ville avec son port de Phalère et avec les cantons ruraux ; elles se réunissaient au Céramique, le faubourg des potiers, c’est-à-dire, de la classe industrielle ou du petit peuple, sur lequel il s’appuyait, et au centre de ce quartier qui devenait la nouvelle Athènes, au nord-ouest de l’Acropole, il éleva un autel aux douze grands dieux. Il conduisit, par des aqueducs sou terrains qui subsistent encore, les sources des montagnes jusque dans la ville, où elles alimentèrent les fontaines publiques, de sorte que la source antique de Kallirrhoé, ou la fontaine aux belles eaux, put être réservée pour le service des dieux et les cérémonies saintes. Il commença plusieurs des monuments qui devaient être une
des gloires d’Athènes[2] : le Parthénon
consacré à Minerve[3],
un temple d’Apollon et celui de Jupiter Olympien, qui fut entrepris dans de
telles proportions, qu’on ne put l’achever que sept cents ans après, et que nul
temple, dans l’univers hellénique, si ce n’est celui d’Éphèse, n’égalait pour
l’étendue de son enceinte. Il décora enfin le Lycée, beau jardin, voisin de
la ville, où la jeunesse allait s’exercer à la palestre, organisa la première
bibliothèque qu’on ait vue en Grèce, et l’ouvrit aux étrangers comme aux
citoyens. Il fit même ce que nous appellerions une première édition des
poèmes d’Homère, que les rhapsodes avaient seuls jusqu’alors conservés par la
tradition. De savants hommes, Onomacritos d’Athènes, Zopyros d’Héraclée,
Orphéos de Crotone, travaillèrent avec lui à rapprocher les fragments, à
épurer le texte, à remplacer des vers qui lui déplaisaient par d’autres qu’il
inspira. Le poème immortel reçut alors à peu près la forme sous laquelle il
nous est parvenu[4].
On fit de même pour les poètes cycliques et pour Hésiode. Quand il eut
renouvelé la fête des grandes Panathénées, il voulut qu’on y récitât ces
poèmes homériques, qui ne connaissaient pas la démocratie récente, mais qui
célébraient les exploits des héros que Pisistrate montrait comme ses aïeux et
ceux des rois dont il avait ressaisi le pouvoir. Ainsi l’héritage commun de Pisistrate n’avait point aboli la dernière constitution, seulement rien ne se faisait, élection, loi ou entreprise quelconque, que par son influence et sous sa direction. A voir les apparences, Athènes était une république ; en réalité, elle avait un maître, mais un maître populaire. Cependant, il maintint sévèrement les lois qui regardaient la police et obligeaient au travail. Il rendit générale lune disposition de Solon en faveur des soldats mutilés à la guerre : tout citoyen estropié ou infirme reçut une obole par jour (15 centimes). Pour conserver sa popularité, il fit des distributions aux pauvres et ouvrit ses jardins au peuple. Anciennement, à la fête des grandes Panathénées, il n’y avait que des courses équestres, et les riches seuls y prenaient part ; il y institua des exercices gymnastiques où le plus pauvre put disputer la couronne. Ses libéralités étaient intelligentes : pour empêcher la formation d’un prolétariat urbain, cette plaie des grandes villes, il renvoyait les indigents aux travaux des champs, et les mettait à même de se tirer des premiers embarras, en leur donnant du bétail et de la semence. Il était difficile d’exécuter tant de travaux et de réformes sans que le poids des dépenses publiques s’aggravât : Pisistrate fut obligé d’établir une dîme sur les produits de la terre. On raconte que, voyant un jour un campagnard qui poussait péniblement sa charrue sur le flanc de l’Hymette, il lui demanda ce que lui rapportait son champ : Bien du mal, répondit le laboureur, mais Pisistrate s’en moque, pourvu qu’il ait sa part des revenus. Le tyran se mit à rire et fit dégrever le pauvre homme. Il mourut en 527, assez maître du pouvoir pour le transmettre à ses fils. Ainsi la tyrannie devenait héréditaire. Athènes avait déjà parcouru toute la série des transformations politiques dont Aristote expose la théorie et qu’il montre suivie régulièrement dans presque tous les États de l’antiquité : royauté héroïque, aristocratie, oligarchie, démocratie, tyrannie. Tandis que la lente et cauteleuse Lacédémone s’arrêtait au premier pas, entre la royauté héroïque et l’aristocratie, l’impatiente et mobile Athènes courait d’une extrémité à l’autre, essayait toutes les formes de gouvernement et arrivait, au dernier période de cette longue évolution, à la tyrannie. Elle allait bientôt en sortir glorieusement pour pratiquer le vrai gouvernement républicain et démocratique. II. Les Pisistratides (527-510)Pisistrate avait laissé trois fils, Hippias, Hipparque et Thessalos, tous trois amis des lettres, mais, parce qu’ils avaient été élevés au sein de la puissance, moins prudents et moins réservés que leur père. Hippias, en qualité d’aîné, était regardé comme le souverain ; l’union cependant régnait entre eut, au point que Hipparque semblait associé au pouvoir. Thucydide, qui peut-être les ménage étant de leur maison, dit : Ces tyrans affectèrent longtemps la sagesse et la vertu ; contents de lever sur les Athéniens le vingtième des revenus, ils embellissaient la ville, soutenaient la guerre, et faisaient, dans les fêtes, les frais des sacrifices. La république, dans tout le reste, jouissait de ses droits, et la famille de Pisistrate avait seulement l’attention de placer quelques-uns des siens dans les charges (Liv. IV, c. LIV). Ainsi, un fils d’Hippias fut archonte. Ami des arts, comme son aïeul dont il portait le nom, il éleva sur l’Agora un autel aux Douze grands dieux et, dans le temenos d’Apollon, ou enceinte consacrée à ce dieu, un autre autel dont on vient de retrouver la dédicace sur les bords de l’Ilissos. Hipparque s’était fait l’ami d’Anacréon, de Simonide de Céos et d’Onomacritos, moitié poète, moitié devin, qu’il chassa quand il l’eut surpris interpolant les prophéties de Musée. On lui attribue l’établissement de ces hermès qui ornaient les places et les carrefours, dans les rues d’Athènes, les bourgs de l’Attique et le long des routes. Il y avait fait graver en vers de beaux préceptes de morale, tels que celui-ci : Prenez toujours la justice pour guide, et cet autre : Ne violez jamais les droits de l’amitié. De sorte que l’étranger, à son entrée dans l’Attique, reconnaissait qu’il allait fouler une terre où la société civile était bien ordonnée et la culture de l’esprit en honneur. Un ancien compare le temps des Pisistratides aux jours de l’âge d’or : C’était le règne de Saturne, est-il dit dans l’Hipparque, que l’on met à tort parmi les traités platoniciens ; mais le mot n’étonnerait pas dans la bouche de Platon. Un jour que les Pisistratides descendaient avec tout le peuple au Céramique pour offrir un sacrifice aux douze grands dieux, ils virent des suppliants assis sur les marches de l’autel : c’étaient des Platéens. Ils venaient implorer leur assistance contre Thèbes, qui aurait voulu accomplir en Béotie la révolution faite dans l’Attique au profit d’Athènes, et devenir, comme elle, la métropole et le centre politique du pays. Les Pisistratides oublièrent leurs vieilles relations avec Thèbes pour saisir l’occasion d’étendre leur influence au delà du Parnès et d’assurer leur frontière de terre. L’armée qu’ils envoyèrent vainquit les Thébains et scella entre Athènes et Platée une alliance qui dura autant que ces deux villes (519). Cependant, de temps à autre, la tyrannie se montrait. Cimon, le frère de Miltiade, trois fois vainqueur aux jeux olympiques, parut, à cause de sa renommée, un citoyen dangereux il fut assassiné. Harmodios ayant rejeté l’amitié d’Hipparque pour celle d’Aristogiton, citoyen d’une condition médiocre, le tyran s’en vengea lâchement. Harmodios, dit Thucydide, avait une jeune sœur : elle fut invitée à venir porter la corbeille sacrée à une fête, et, quand elle se présenta, on la chassa honteusement, en soutenant qu’on ne l’avait pas mandée et qu’elle n’était pas digne de remplir une fonction réservée aux filles des premières maisons. Harmodios fut violemment irrité de cette insulte, et Aristogiton partagea son ressentiment. Ils firent avec d’autres ennemis des Pisistratides le complot de les assassiner, et attendirent, pour l’exécution de leur dessein, la fête des grandes Panathénées, le seul jour où les citoyens se réunissaient en armes. Ce jour arrivé, Hippias, avec ses gardes, rangeait le cortège dans le Céramique, hors de la ville ; déjà s’avançaient pour le frapper Harmodios et Aristogiton, armés de poignards qu’ils tenaient, cachés sous des branches de myrte, quand ils virent un des conjurés s’entretenir familièrement avec lui, car il se laissait aborder par tout le monde. Ils se crurent dénoncés et voulurent du moins se venger avant de mourir. Ils franchirent les portes, se jetèrent dans la ville et, rencontrant Hipparque dans l’endroit nommé Léochorion, ils le frappèrent à mort. Aristogiton parvint à se soustraire aux gardes, tandis qu’ils tuaient Harmodios. Secrètement averti de ce qui venait de se passer, Hippias, au lieu de courir à l’endroit où le meurtre avait été commis, s’approcha des citoyens armés qui escortaient le cortège avant qu’ils eussent rien appris, et, composant son visage pour ne laisser paraître aucune émotion, leur ordonna de gagner, sans armes, un endroit qu’il leur montra. Ils s’y rendirent, dans l’idée qu’il avait quelque chose à leur communiquer. Aussitôt il fit enlever les armes par ses gardes et arrêter tous ceux sur qui l’on trouva des poignards. Aristogiton, suivant des récits postérieurs, avant d’être mis à mort, fut appliqué à la torture : il dénonça les plus chers amis du tyran, qui commanda de les égorger aussitôt. Et qui encore ? demanda-t-il. Il n’y a plus que toi, reprit l’Athénien, dont je voudrais la mort ; du moins je t’aurai fait tuer ceux que tu aimais le plus. Les Athéniens, pour ennoblir ce premier jour de leur liberté, racontaient encore que Lééna, une amie d’Aristogiton, avait été comme lui torturée, que, de crainte de céder à la douleur et de trahir involontairement un de ses complices, elle s’était coupé la langue avec les dents et l’avait crachée au visage du tyran. Après la chute des Pisistratides les Athéniens figurèrent Lééna sous la forme d’une lionne sans langue. Les Grecs, comme les Romains, aimaient à représenter un personnage par l’objet que son nom rappelait : telle est la stèle de Léon de Sinope. Harmodios et Aristogiton n’avaient pas été poussés au meurtre par une pensée politique; les Pisistratides ne leur avaient paru des tyrans qu’après qu’ils avaient ressenti les effets de la tyrannie : le meurtre d’Hipparque fut la vengeance d’une injure personnelle. Néanmoins les Athéniens firent des deux amis les martyrs de la liberté; ils leur élevèrent des statues ; ils accordèrent à leurs descendants des privilèges dont ceux-ci jouissaient encore au temps de Démosthène, et dans les fêtes, dans les festins, ils chantaient : Je porterai l’épée dans le rameau de myrte, comme firent Harmodios et Aristogiton, quand ils tuèrent le tyran et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité. Très cher Harmodios, tu n’es point mort ; sans doute, tu vis dans les îles des bienheureux, là où se trouvent, dit-on, Achille aux pieds rapides, et Diomède, fils de Tydée. Dans le rameau de myrte, je porterai l’épée, comme Harmodios et Aristogiton, lorsqu’aux fêtes d’Athéna ils tuèrent le tyran Hipparque. Toujours votre renom vivra sur la terre, très cher Harmodios, et toi, Aristogiton, parce que vous avez tué le tyran et établi dans Athènes l’égalité. La légende du dévouement patriotique des deux amis
s’établit si fortement, que Thucydide, Platon et Aristote[6] ne purent
l’ébranler, et elle eut de terribles conséquences. La doctrine de
l’assassinat politique gagna de proche en proche Depuis le meurtre de son frère (514), le caractère d’Hippias sembla changé.
Devenu sombre et soupçonneux, il fit périr beaucoup de citoyens, accabla les
autres d’impôts et resserra ses alliances au dehors. Son frère Thessalos
possédait Sigée, le second Miltiade tenait pour lui Les Alcméonides bannis par Pisistrate avaient fait, pour
rentrer de force dans l’Attique, une première tentative qui était restée
infructueuse. Ils cherchèrent des alliés. Le temple de Delphes avait été incendié
en 548 : on ramassa de l’argent dans toute Cet échec accrut leur zèle, ils avaient maintenant une défaite à venger. D’ailleurs, à leur tête se trouvait un chef hardi, le roi Cléomène, à qui pesaient, tant qu’il restait à Lacédémone, la surveillance des éphores et le rôle subalterne de la royauté spartiate. Il aimait la guerre, qui lui rendait le commandement ; l venait d’humilier Argos(1) souhaitait d’humilier encore une domination qui, depuis quelques années, faisait trop parler d’elle. Au bout de ces entreprises et de ces succès, il entrevoyait certainement une dernière victoire, celle qui abattrait devant lui les éphores et la constitution de son pays. Il mena donc une nouvelle armée contre Athènes. Cette fois, l’attaque, dirigée par terre, eut un meilleur succès ; les Thessaliens furent battus et Athènes assiégée. Les tyrans, dit Hérodote, s’étaient réfugiés derrière le mur pélasgique, et les Lacédémoniens, n’étant pas en état de les y forcer, n’avaient nulle intention d’entreprendre un siège contre des ennemis pourvus de provisions de toute sorte. Il songeaient même à se retirer, après un blocus de quelques jours, lorsqu’un événement imprévu amena la ruine des Pisistratides. Hippias, pour mettre ses enfants à l’abri de tout événement, voulut les faire embarquer ; ils tombèrent aux mains de l’ennemi, qui ne consentit à les rendre qu’à la condition que leur père sortirait de l’Attique dans cinq jours. Il s’y décida (510), et se retira à Sigée avec ses trésors et ses principaux partisans. III. Clisthénès (510)Avec les Alcméonides l’influence des Spartiates et l’esprit de leurs institutions semblaient devoir rentrer dans Athènes. Mais à la tête des émigrés revenus était un homme qui, dans l’exil, avait beaucoup appris, Clisthénès petit-fils du tyran de Sicyone et le vrai fondateur de la démocratie athénienne. Hérodote fait de lui un ambitieux, qui, trouvant un rival dans Isagoras, un des plus riches et des plus nobles citoyens d’Athènes, résolut de s’appuyer, comme Pisistrate, sur le petit peuple et de détruire l’influence des nobles en brisant les liens de la clientèle qui retenaient dans leur dépendance une partie de la population[7]. Peut-être ne fit-il qu’exécuter une patriotique réforme comme celle qui avait été entreprise un peu plus tôt à Rome par le roi Servius, le mélange des anciens et des nouveaux habitants. Solon, en effet, avait conservé les anciennes tribus qui, étroitement fermées par des liens religieux, refusaient, malgré les facilités données par le législateur, de s’ouvrir pour recevoir les étrangers établis en grand nombre dans l’Attique. L’oppression, qui avait pesé sur chacun, rapprocha tous les rangs, confondit les origines, et la révolution était sinon faite, du moins préparée dans les esprits, quand Clisthénès l’accomplit. Nommé archonte éponyme, Clisthénès abolit les quatre anciennes tribus et les remplaça par dix tribus nouvelles, dont les héros éponymes eurent leurs statues dans l’Agora et sur le Parthénon. Chacune comprit dix dèmes, plus tard davantage, car Strabon en compte jusqu’à cent soixante-quatorze, et on en a trouvé cent quatre-vingts. Les dèmes d’une même tribu n’étaient pas nécessairement dans le même canton. De quatre dèmes, par exemple, qui entouraient le Pirée, trois appartenaient à autant de tribus différentes. Il en résulta cet avantage que la tribu, ne représentant pas un seul intérêt territorial, ne devint jamais le foyer d’une faction politique. Chaque dème, administré par un démarque, avait son registre de citoyens ou démotes, ses assemblées, ses revenus municipaux, ses dieux et ses fêtes. Les filles étaient inscrites à la phratrie et non pas au dème[8]. Les phratries, subdivisions des tribus anciennes, ne subsistèrent que potin les affaires civiles et religieuses. Les droits politiques dérivèrent de l’organisation nouvelle; nul ne put avoir les privilèges du citoyen sans être inscrit dans un dème. Ce changement transformera le peuple athénien, qui sera animé d’un esprit nouveau. Clisthénès l’a soustrait à l’influence que les nobles se transmettaient comme un héritage, dans leurs phratries ou dans leurs γένη, et qui restait de génération en génération, dans les mêmes maisons. Auparavant l’unité politique était le génos, composé de citoyens liés les uns aux autres par les traditions et la religion, et placés sous l’influence de chefs héréditaires; depuis Clisthénès ce fut le dème, composé d’hommes réunis seulement par la communauté des intérêts, la proximité des domaines et sous la seule influence du patriotisme. Pour prendre le langage politique moderne, ce n’était rien de moins que l’établissement du suffrage universel. Le citoyen qui changeait de domicile restait attaché au dème où il était inscrit : ainsi fera Rome pour les membres de ses tribus[9]. L’augmentation du nombre des tribus fit augmenter le nombre des sénateurs. De 400 on les porta à 500, de manière que 50 membres fussent désignés dans chaque tribu, peut-être dès ce moment par la voie du sort[10]. Ce sénat, délégation du corps des citoyens, dut siéger tous les jours, les jours de fête exceptés. Chaque section, à son tour, était en permanence durant un dixième de l’année, et ses membres, nourris pendant ce temps aux frais de l’État, portaient le nom de prytanes. La section se subdivisait elle-même en cinq commissions. Chacune, durant sept jours, présidait le sénat sous la direction d’un de ses membres, appelé épistate, dont elle tirait le nom au sort. L’épistate gardait les clefs de l’Acropole et du trésor, ainsi que le sceau de l’État. Mais ses fonctions ne duraient qu’un jour. Les autres sénateurs pouvaient siéger avec les prytanes, et il n’y avait de décision valable qu’autant qu’un sénateur au moins de chacune des neuf autres tribus avait pris part à la délibération des prytanes. Ainsi, les représentants de chaque tribu avaient, à tour de rôle, la direction du gouvernement. L’assemblée du peuple fut désormais réunie quatre fois par prytanie (espace de 35 à 36 jours), davantage s’il était nécessaire, sur la convocation du sénat ou des généraux, et sous la présidence des prytanes dont le chef ou épistate indiquait les questions sur lesquelles l’assemblée votait. Les quarante-huit naucraries furent portées à cinquante, de sorte que l’Attique l’ut divisée en autant de districts de perception financière. Les héliastes formèrent dix tribunaux, et la même division prévalut dans la plupart des corps publics, sauf dans le collège des archontes qui restèrent au nombre de neuf, nommés peut-être à l’élection, et non pas encore désignés par le sort, comme ils le seront certainement plus tard quand ils auront perdu les plus importantes des prérogatives que Clisthénès leur avait laissées[11]. La nouvelle organisation fut aussi une organisation militaire chacune des dix tribus avait ses hoplites, ses cavaliers et son général chaque naucrarie fournissait une galère et deux cavaliers pour la garde du pays[12]. Le troisième archonte ou polémarque conserva voix et autorité prépondérantes dans le conseil de guerre. Les généraux ne restaient qu’une année en charge; mais leurs fonctions s’accrurent avec la démocratie. Au temps de Périclès, les archontes seront réduits à faire la police de la cité et à préparer le jugement des procès, tandis que les généraux, ou stratèges, dirigeront non seulement les affaires de la guerre, mais encore toute la politique étrangère[13]. On attribue aussi à Clisthénès l’établissement de l’ostracisme, qui fut l’application à la politique d’une idée religieuse. On a vu qu’une des croyances les plus invétérées des Grecs, était celle qui représentait la divinité comme envieuse des prospérités humaines, et que cette jalousie était un mélange de crainte et d’orgueil. Les poètes avaient tant de fois répété que renverser ce qui s’élève trop haut était une vengeance divine, que le peuple à son tour eut contre ses grands hommes l’envie qui d’ailleurs se trouve au fond du cœur de toutes les foules. A Athènes, chaque année, durant le sixième mois, la question suivante put être débattue dans le sénat et par-devant l’assemblée : La sûreté de l’État exige-t-elle qu’il y ait un vote d’ostracisme ? Si cette nécessité était reconnue, le peuple était appelé à voter. On ne lui désignait aucun nom; il écrivait lui-même sur une coquille enduite de cire (όστρxxον) le nom du citoyen qu’il jugeait utile d’éloigner de la ville, pour maintenir la commune égalité et prévenir toute tentative d’usurpation. Le vote était secret, les archontes faisaient le recensement des suffrages. Le citoyen désigné par la majorité était banni pour dix ans. Sa considération n’en souffrait pas ; ses biens n’étaient point confisqués, comme ils l’étaient pour les bannis, il en gardait même la jouissance. Depuis Clisthénès, dis citoyens furent soumis à cette mesure de haute police : Hipparchos, un parent dès Pisistratides ; Alcibiade, Mégaclès et Callias, trois chefs de puissantes et ambitieuses maisons; Aristide, Thémistocle et Cimon, trois grands citoyens ; Thucydide l’Ancien, un chef de faction ; Damon, un des maîtres de Périclès ; et Hyperbolos, un démagogue vulgaire ; après lui, l’ostracisme tomba en désuétude. Cette institution a servi de texte à beaucoup de discussions. Plutarque est bien près de la condamner, mais Aristote l’absout[14]. Elle lui parait être un moyen de maintenir l’État dans ces rigoureuses proportions qui ne permettent à personne de s’élever outre mesure dans la cité. Le peintre, dit-il, ne laissera pas dans son tableau un pied disproportionné, fût-il admirable, et le chef du chœur forcera la plus belle voix à se tenir à l’unisson des autres. On dit qu’Athènes sortait, quand elle l’établit, d’une tyrannie odieuse ; que le nouveau gouvernement n’avait pour se défendre aucune force armée; qu’enfin la liberté, tant de fois violée depuis Solon, étant devenue soupçonneuse, tout citoyen qui grandissait trop lui semblait justement à craindre ; mais que ses craintes mêmes étaient un hommage : elle honorait alors qu’elle frappait. L’ostracisme était comme le sceau des grandes renommées. Au jugement d’Aristote ajoutons celui d’Aristide : Il n’y a, disait-il, qu’un moyen de rendre la paix à la ville, c’est de nous jeter, Thémistocle et moi, dans le barathron[15]. Athènes fut plus sage, elle se contenta d’éloigner l’un des deux rivaux. Thémistocle, délivré de cette lutte de chaque jour, fut plus libre de servir sa patrie : il sauva Athènes. Aristide, revenu plus tard, l’honora par ses vertus. Montesquieu a dit : Il y a, dans les États où l’on fait le plus de cas de la liberté, des lois qui la violent contre un seul, pour la garder à tous… Cicéron veut qu’on les abolisse… J’avoue pourtant que l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre me fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur la liberté, comme l’on cachait les statues des dieux[16]. Montesquieu a peut-être raison pour les petites cités de IV. Intervention de LacédémoneLe clergé de Delphes, dévoué aux Alcméonides, avait sanctionné les réformes de Clisthénès, en désignant les dix héros éponymes des nouvelles tribus. Leurs statues furent dressées sur l’Acropole, et Minerve eut, pour gardiens de son temple, les représentants divins de la cité. Mais l’aristocratique Lacédémone, en ramenant les Alcméonides à Athènes, avait cru renverser un tyran et fonder une oligarchie. Trompée dans son attente, elle accueillit les plaintes d’Isagoras, dont Cléomène avait été l’hôte pendant qu’il assiégeait la citadelle[18], et un héraut vint réclamer le bannissement de Clisthénès, comme membre d’une famille souillée. Clisthénès ne se sentit pas assez fort pour résister et sortit d’Athènes. Cléomène y arriva, chassa sept cents familles que lui désigna Isagoras, supprima le conseil des Cinq-Cents et voulut donner tout le gouvernement à trois cents citoyens de la faction oligarchique. Le sénat, refusant de céder à la violence, appela le peuple à sauver les lois, et les conspirateurs, qui s’étaient emparé de la citadelle, y furent assiégés. Cléomène essaya vainement de gagner à sa cause la prêtresse de Minerve; elle l’arrêta lorsqu’il parut au seuil de la cella pour interroger la déesse : Étranger lacédémonien, lui cria-t-elle, recule et ne pénètre pas dans le sanctuaire ; il n’est pas permis aux Doriens d’entrer ici. Il tint deux jours ; le manque de vivres le força de capituler, et Isagoras s’échappa avec lui. Mais ceux qui l’avaient soutenu furent condamnés comme traîtres et exécutés. Pour la seconde fois, Athènes chassait la tyrannie et se retrempait dans la liberté. Elle y trouva une force nouvelle. Elle en avait besoin, car le péril était grand. Cléomène amassait une armée et allait entraîner Sparte à une guerre ouverte. Chalcis, Égine, jalouses de la marine naissante des Athéniens, voyaient avec joie l’occasion de la détruire ; Thèbes, celle de se venger : Hippias se croyait déjà rétabli. Clisthénès tenta une démarche hardie. Son père avait dû une partie de ses richesses à Crésus, il tourna comme lui les yeux vers Sardes et sollicita l’alliance du gouverneur de cette ville. Le Perse Artaphernès ne connaissait d’autre alliance avec le grand roi que la soumission à ses ordres ; il demanda aux envoyés de Clisthénès l’hommage de la terre et de l’eau. Le peuple, moins facile que ses ambassadeurs et peut-être que son chef, à qui cette aventure coûta son crédit[19], rejeta le traité, mais s’arma. Cléomène arrivait et allait attaquer du côté d’Eleusis, tandis que les Béotiens, réunis aux Chalcidiens, prendraient l’Attique à revers, du côté du nord et les Éginètes sur le littoral. Les Athéniens coururent à l’ennemi le plus dangereux, au-devant de Cléomène. Les armées, dit Hérodote, allaient engager l’action, lorsque les Corinthiens, reconnaissant les premiers qu’ils faisaient une guerre injuste, changèrent de dessein et se retirèrent. Leur exemple fut suivi par Démarate, second roi de Sparte. Son départ entraîna la retraite de toutes les troupes. Ce fut cette dissidence qui motiva la loi par laquelle il est défendu aux rois de Lacédémone de se trouver tous deux en même temps à l’armée. Corinthe avait fait défection, non par amour pour Athènes, mais par jalousie contre Égine, sa rivale, que cette guerre aurait fait grandir, et Démarate, qui n’avait nul souci d’Athènes, s’inquiétait beaucoup de l’ambition de Cléomène. Débarrassés des Spartiates, les Athéniens tombèrent sur les Béotiens avant l’arrivée des gens de Chalcis ; ils leur tuèrent beaucoup de monde, firent 700 prisonniers, et le même jour débarquèrent en Eubée, où ils remportèrent une si complète victoire, qu’ils purent envoyer dans l’île 4000 colons ou clérouques entre lesquels furent partagées les terres des plus riches habitants de Chalcis. Gardienne pour Athènes du détroit de l’Euripe, cette colonie contribua beaucoup à la grandeur de sa métropole, par les ressources qu’elle lui procura, soit en blé, soit en chevaux, et par l’influence qu’elle lui donna dans l’Eubée (507). La démocratie inaugurait glorieusement son avènement par deux importantes victoires gagnées en deux jours. Les Athéniens n’en avaient pas tant fait durant les cinquante années qu’avait duré la tyrannie. Aussi en conçurent-ils un juste sentiment d’orgueil. Ils avaient bon nombre de prisonniers et les gardèrent quelque temps enchaînés. Avec la dîme de la rançon de 2 mines par tête (200 francs) qu’ils en tirèrent, ils firent exécuter un quadrige d’airain qui fut placé dans les Propylées et consacré à Minerve. Il portait cette inscription, qui, par sa fierté, annonçait les héros de Marathon : Les enfants d’Athènes ont dompté les peuples de Béotie et de Chalcis ; ils ont humilié dans la prison et les fers l’insolence de leurs ennemis. On conserva les chaînes des captifs dans l’Acropole ; Hérodote, qui les y vit, ajoute : Depuis cet événement, Athènes ne cessa de s’accroître, et sa prospérité a prouvé, chez elle, comme partout ailleurs, les avantages d’un État où chacun jouit des mêmes droits. En effet, tant que les Athéniens furent soumis aux tyrans, on ne les vit pas supérieurs dans la guerre aux peuples qui les environnaient ; mais ils les surpassèrent du moment qu’ils eurent brisé la tyrannie. Pour un maître, ils n’avaient jamais eu le désir de s’illustrer ; devenus libres, ils le voulurent et ils y réussirent, parce qu’alors chacun travailla pour soi-même. A côté de ces trophées de la victoire s’élevèrent ceux de
la liberté. Sur la voie Sacrée qui montait à l’Acropole, où maintenant les
dieux seuils résidaient, on dressa les statues d’Harmodios et d’Aristogiton,
qui disaient à tout citoyen allant adorer les divinités poliades : Il est beau de tuer un tyran. Athènes et Lacédémone, toujours attachée bien plus à des intérêts
qu’à des principes, venait de se décider à défaire ce qu’elle avait fait, à
rétablir Hippias qu’elle avait renversé. Elle avait découvert la ruse dont
s’étaient servis les Alcméonides pour suborner l’oracle de Delphes et
provoquer l’expédition de Cléomène. Il lui pesait d’avoir été prise pour
dupe, et de plus, dit crûment Hérodote, elle pensait que l’Attique, libre, deviendrait capable de
balancer sa puissance, tandis que, courbée sous le joug, elle resterait
nécessairement faible. Hippias fut appelé de Sigée à Sparte, et les magistrats
proposèrent aux alliés une grande expédition pour le ramener dans l’Attique.
L’assemblée se tenait à Sparte même (505). Ces députés d’États libres écoutèrent d’abord en silence
l’étrange proposition de secourir un tyran. A la fin, l’un d’eux, le
Corinthien Sosiclès, se leva. Il rappela les maux que la tyrannie avait
infligés à sa patrie et aux autres cités, reprocha aux Spartiates d’aller
contre leur propre histoire et déclara que jamais les Corinthiens ne contribueraient
à rétablir un gouvernement dont ils avaient eux-mêmes tant souffert. La
plupart des alliés se rangèrent à cet avis. La ligue qui se formait fut tout
à coup dissoute, et Hippias retourna tristement à Sigée. Il justifiera
Sosiclès, en ne cessant de solliciter des Perses une armée qui lui permît de
replacer sa patrie sous le joug et de mettre Nous venons de voir Athènes, après bien des troubles et des révolutions, entrer rapidement dans les voies démocratiques et devenir ce que Solon avait voulu qu’elle fût, une réunion de citoyens au milieu desquels ni familles, ni corporations, ni castes n’avaient de droits particuliers et héréditaires. L’égalité devant la loi, la sécurité des biens et des personnes, le libre accès aux charges, aux tribunaux, à l’assemblée générale ; des lois écrites qui empêchaient l’arbitraire ; un domaine public qui appartenait vraiment au public, puisque le produit des mines, par exemple, était partagé entre les citoyens, quand la cité ne le réclamait pas pour ses nécessités ; mais la direction des affaires réservée aux riches, parce qu’ils avaient plus de loisir, et qu’ils pouvaient, au besoin, faire de plus grands sacrifices; et, avec toutes ces nouveautés, le respect des grands noms, des vieilles familles et de l’ancienne religion du pays ; de sorte que tout lien avec le passé n’étant point brisé, l’État ne pouvait se précipiter témérairement vers un avenir inconnu, et que la noblesse athénienne restait l’ornement et la force de la cité, sans être pour elle une menace et un péril. Voilà quelle était l’Athènes de Solon et de Clisthénès, un gouvernement qui poussait à la libre expansion des facultés de chacun et au dévouement absolu de tous pour la grandeur commune[20]. Et cette grandeur commençait. L’ordre une fois établi au dedans, la république avait bien vite grandi au dehors et était devenue en peu de temps assez redoutable pour exciter l’envie de la toute-puissante Lacédémone. Plusieurs peuples, plusieurs aristocraties, se sont ligués contre elle. Dans le but d’arrêter ses accroissements, Sparte essaye des moyens les plus contraires : tantôt elle chasse les tyrans ; tantôt elle les ramène ; rien ne réussit. Athènes triomphe de tous les efforts : semblable à un arbre vigoureux dont on tâche vainement de comprimer la sève et d’énerver les rameaux qui vont porter ensemble, comme sous les climats bénis, des fruits et des fleurs. Sparte n’aurait pas sans doute renoncé à sa haine jalouse,
si un grand événement n’avait tout à coup commandé aux Grecs l’oubli de leurs
injures et l’union : nous touchons aux guerres Médiques. Avant de les
raconter, il faut que le monde hellénique s’offre à nos yeux dans son
ensemble et sa variété. Nous allons parler des petits États de |