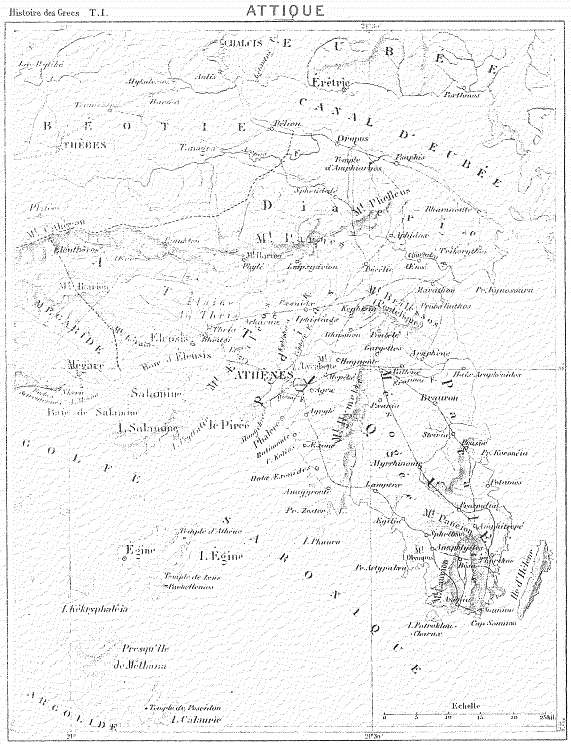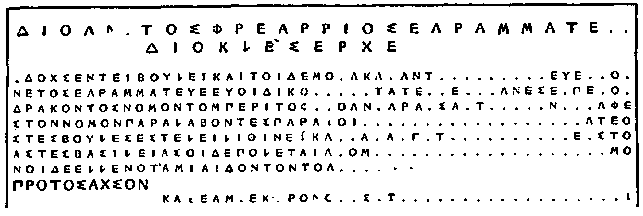HISTOIRE DES GRECS
DEUXIÈME PÉRIODE — DE L’INVASION DORIENNE AUX GUERRES MÉDIQUES (1104-490) — ISOLEMENT DES ÉTATS - RÉVOLUTIONS INTÉRIEURES - COLONIES.
Chapitre IX — Athènes et la constitution de Solon.
I. L’Attique et ses roisLe petit pays que des montagnes d’accès difficile séparent
de Ce génie, que forma l’influence des lieux, des
circonstances historiques et d’un climat qui fait le printemps si doux, l’hiver
si clément, diffère profondément du caractère spartiate : ouvert et étendu
comme l’horizon sans limites qui, du haut de l’Acropole, laisse le regard
errer au loin sur la mer Égée[2] ; vif et
piquant comme la brise marine qui souffle sur les collines empourprées de l’Attique[3] ; curieux, hardi,
industrieux, comme l’est souvent l’esprit de l’habitant des côtes qui
reçoivent beaucoup d’étrangers, et des régions qui ne se suffisent point à
elles-mêmes ; sans cesse, enfin, tenu en éveil par la multiplicité des
impressions reçues dans cet air pur et sonore, durant ces nuits
transparentes, qui ne sont pas les ténèbres, mais l’absence du jour[4]. Les Athéniens
étaient sobres à cause de la nature même de leur terroir, où l’on ne trouvait
rien en abondance; mais, ce qui valait mieux, ils avaient la sobriété de l’esprit.
Chez ce peuple de pensée ingénieuse et délicate, de vie active et pleine,
rien d’outré ni d’excessif ; tout est netteté, proportion, clarté
exquise ; rien de lourd, rien de faux ; au contraire, une naturelle
élégance : Lycurgue n’aurait pas réussi en Attique ; les lois pesantes qui
tenaient Sparte immobile n’auraient pas eu prise sur ces vives intelligences,
sur ces hommes peu disciplinables à une seule règle impérieuse, parce qu’ils
tenaient de leur sol tous les genres d’existence et qu’ils avaient dans les
veines le sang le plus mêlé[5]. Pélasges,
Achéens, Ioniens, Thraces, Éoliens, colons orientaux peut-être, tous étaient
venus là se rencontrer, non en conquérants, car cette péninsule rocheuse,
sans terre et sans eau, ne valait pas un combat, mais en fugitifs, et dans
une proportion telle, qu’une seule tribu n’avait pu asservir toutes les
autres. Athènes fut l’asile des races helléniques, comme Rome sera celui des
races italiotes. C’est pour cela que ces deux cités sont, chacune à sa
manière, la plus complète expression, celle-ci de l’Italie, celle-là de
Sparte, l’autre pôle de la société hellénique, ne fit en rien de grands progrès : dans sa longue et âpre vallée de l’Eurotas, qu’elle ferma aux étrangers, elle prit un génie dur et étroit qui ne s’assouplit jamais, et, en politique, elle organisa dès les premiers jours la forme définitive de sa constitution, l’aristocratie. Athènes, qui devait aller jusqu’à la démocratie, même plus loin, eut à parcourir plus de chemin avant de trouver la constitution qui convenait à son génie ; aussi n’arriva-t-elle que bien plus tard à la puissance extérieure. Jusqu’aux guerres Médiques, on voit dans l’histoire d’Athènes beaucoup de révolutions, et ces révolutions commencent à Thésée qui succéda à son père Égée, vers 1300, quoique certaines institutions, comme l’Aréopage et la division du peuple en nobles, en laboureurs et en artisans, fussent peut-être plus anciennes. Thésée est, pour ainsi dire, le patron d’Athènes, comme Hercule l’est du Péloponnèse et Quirinus de Rome. C’est un de ces personnages, moitié homme et moitié dieu. dont le souvenir, embelli par l’imagination populaire, plane sur le berceau d’une nation. Son histoire était véritablement nationale en Attique, et les détails merveilleux de sa vie se trouvaient rappelés sur les monuments. dans la religion, dans les fêtes, dans le calendrier même des Athéniens. Ils ont été précédemment racontés, là où ils sont à leur place, dans l’histoire légendaire. On dira seulement ici que Minerve et Neptune, la déesse de l’intelligence et le dieu de la mer, s’étaient disputés pour savoir qui serait la divinité poliade de la nouvelle cité. Athéna l’emporta et lui donna le siècle de Périclès ; mais Poséidon lui assura, pour un siècle et demi, l’empire de la mer. On n’insistera que sur le fait politique de la fondation d’Athènes comme métropole de l’Attique. La terre aux longs rivages, c’est le sens du nom de l’Attique[6], ouverte de trois côtés à la mer, avait reçu par là et par les routes des montagnes béotiennes des habitants d’origine très différente[7]. Chaque groupe se cantonna à part, et tous refusèrent d’avoir rien de commun entre eux. Il fallut beaucoup de temps et d’efforts pour réduire ces petits États à douze, les amener à s’unir par des mariages, et à porter leurs différends devant un même tribunal. Ce premier travail de rapprochement a un nom dans la légende, il s’appelle Cécrops ; le second, qui des douze bourgades, fit une seule cité et constitua l’unité politique, après l’unité civile, en a un autre, il s’appelle Thésée. Thésée, dit Plutarque, réunit en un seul corps tous les habitants de l’Attique. Dispersés auparavant en plusieurs bourgs, il était difficile de les assembler pour délibérer sur les affaires publiques ; souvent même ils étaient en guerre les uns contre les autres. Thésée parcourut les bourgs, pour proposer son plan et le faire agréer. Les simples citoyens et les pauvres l’adoptèrent sans balancer. Afin de déterminer les hommes plus puissants, il leur promit un gouvernement sans roi, dans lequel, ne se réservant que l’intendance de la guerre et l’exécution des lois, il mettrait pour tout le reste une entière égalité entre les citoyens. Il en persuada quelques-uns ; les autres cédèrent par crainte. Il fit abattre dans chaque bourg les prytanées et les maisons de conseil, cassa tous les magistrats, battit un prytanée et un palais commun dans le lieu où ils sont encore aujourd’hui, donna à la ville et à la citadelle le nom d’Athènes et établit une fête pour tous les citoyens sous le nom de Panathénées[8]. Leur divinité poliade fut Pallas-Athéna, dont la statue était tombée du ciel[9]. En d’autres ternes, l’Attique, anciennement divisée en
plusieurs États, comme les autres provinces de A côté de cette division religieuse et sociale des phratries et des familles, il y en avait une autre plus politique et beaucoup plus récente. Chaque tribu se subdivisait en trois trittyes ou tiers, et en douze naucraries. Les quarante-huit naucraries des quatre tribus étaient des divisions territoriales, dans chacune desquelles les naucrares ou principaux propriétaires levaient l’impôt ainsi que le contingent militaire du district., et plus tard se réunirent pour équiper une galère, afin de protéger l’Attique contre les pirates. Les prytanes des naucrares composaient, à Athènes, un conseil suprême. Ces naucrares appartenaient à la classe des riches, des nobles, qui formaient dans la ville de Thésée une aristocratie assez semblable à celle qu’on trouve dans la cité de Romulus, ici les patriciens, là les eupatrides, les uns et les autres tenant le peuple dans la dépendance. A Rome, où la guerre amena un second peuple en face du premier, les plébéiens furent promptement assez forts pour contraindre les patriciens à compter avec eux ; à Athènes, où il n’y eut pas de vaincus qui, introduits dans la cité après leur défaite, vinssent accroître incessamment le nombre et la puissance du peuple, l’aristocratie resta pendant plusieurs siècles inébranlable. Selon les légendes recueillies par Plutarque, ce fut cette
aristocratie qui renversa Thésée. Durant une absence
du héros, les Tyndarides, Castor et Pollux, envahirent l’Attique pour reprendre
Hélène, qu’il avait ravie ; et, dans Athènes même un mouvement se fit contre
lui. Mnesthée, descendant d’Érechthée, essaya de soulever les principaux
citoyens contre l’homme qui leur avait ôté l’empire qu’ils exerçaient chacun
dans leurs bourgs, et qui, les renfermant dans une seule ville, les avait
rendus ses sujets ou plutôt ses esclaves. Mnesthée excitait aussi les hommes
du peuple, en accusant auprès d’eux Thésée de ne leur avoir laissé qu’une
liberté imaginaire, qui. dans le fait, les avait privés de leur patrie, de
leurs sacrifices, et, au lieu de plusieurs rois légitimes, bons et humains,
leur avait donné pour maître un étranger et un inconnu. Thésée, de
retour, fut contraint de s’exiler à Scyros, où il mourut. Mnesthée atteignit
le but de ses intrigues, il régna ; mais, après lui, la royauté fut rendue à
la famille de Thésée, qui la conserva jusqu’au temps où l’invasion dorienne
bouleversa Ce n’est pas que l’Attique en ait été atteinte ; les envahisseurs ne touchèrent qu’au dernier moment sa frontière; mais, dès les premiers jours, elle fut l’asile des vaincus. Après l’invasion éolienne, les Minyens, les Tyrrhènes et les Géphyréens de Béotie cherchèrent un refuge au delà du Cithéron, et y apportèrent, avec le culte de Déméter, l’usage de l’écriture déjà ancien aux environs du lac Copaïs. Les fugitifs de Trézène franchirent le golfe Saronique et peuplèrent les dèmes de Sphettos et d’Anaphlystos, vers cette pointe de l’Attique qui se termine au cap Sunion. D’Égine vinrent les Éacides dont Miltiade et Cimon descendaient ; de Messénie, la postérité de Nélée et de Nestor. Ainsi l’Attique reçut alors des habitants nouveaux, surtout de vieilles familles puissantes par le nombre de leurs serviteurs, par leurs richesses, par les traditions religieuses et héroïques qui s’attachaient à leur nom, et qui se trouvèrent assez fortes pour s’emparer violemment du pouvoir à Athènes. Afin de sauver la vanité nationale, les Athéniens racontaient autrement cette révolution : les étrangers se seraient établis en simples particuliers dans l’Attique ; peu de temps après, un roi de Thèbes, en guerre avec Athènes, provoqua en combat singulier Thymœtès, descendant de Thésée, qui refusa le défi. Le Messénien Mélanthos l’accepta à sa place, vainquit par une ruse le roi thébain et fut en récompense nommé roi par les Athéniens. Ce qui est certain, c’est que Mélanthos laissa le trône à Codrus, son fils, et que ses frères furent les chefs des Alcméonides, des Pisistratides et des Péonides, trois familles qui tinrent le premier rang à Athènes. Sous le règne de ce Mélanthos, l’Attique reçut encore, de
gré ou de force, les Ioniens de l’Égialée, expulsés de leur pays par les
Achéens, et d’autres émigrés d’Épidaure, de Phlionte et de Corinthe. Les
nouveaux venus y portèrent un sentiment qui s’y enracina, la haine du nom
dorien. Codrus régnait à Athènes lorsque les Doriens, poursuivant les peuples
qu’ils avaient chassés du Péloponnèse, envahirent II. Abolition de la royauté ; l’archontat ; lois de DraconAprès la mort de Codrus, on prétendit que nul n’était digne de lui succéder, et, sous ce prétexte, la royauté fut abolie (1045 ?). Cette révolution fut faite par les chefs des nouveaux venus, Éoliens et Ioniens. qui, réunis à la vieille noblesse d’Athènes, formaient l’aristocratie politique et sacerdotale des eupatrides (nobles) ou des pédiéens (hommes de la plaine), par opposition aux anciens habitants refoulés dans les montagnes ou sur les rivages, ce qui les fit appeler hypéracriens et paraliens. Cantonnés dans Athènes, dont ils occupaient la forteresse, ils se disaient tous de sang royal ; ils étaient les chefs militaires et les prêtres du peuple. Ainsi une aristocratie étrangère, de connivence avec l’aristocratie nationale, menaçait d’étouffer les antiques libertés et d’assujettir l’Attique au régime des castes que subissaient les pays situés de l’autre côté de l’isthme. Ce despotisme fut àl la longue miné par l’esprit des institutions qu’on attribue à Thésée, et par l’activité laborieuse de cette population qui, forcée de recourir à l’étranger pour sa nourriture ; demanda au commerce et à l’industrie les moyens d’échange que son sol ne lui fournissait pas. Athènes ne devint pas Sparte, et Jaloux du pouvoir royal qui leur faisait ombrage, bien que depuis l’élection de Mélanthos, ce pouvoir fût aux mains d’un d’entre eux, les eupatrides le dépouillèrent de ses principales prérogatives ; ils le transformèrent en une magistrature à vie et responsable, et le titre pompeux de roi fut remplacé par celui de chef, ou archonte. Ils consentirent pourtant à laisser cette autorité affaiblie à Médon, fils de Codrus, et à douze de ses descendants; mais, le principe de l’hérédité une fois aboli, et celui de la responsabilité imposé, nulle barrière ne devait plus arrêter une aristocratie soupçonneuse : en 752, la durée de l’archontat est restreinte à dix ans. Quand sept archontes décennaux se furent succédé, la lente décomposition de la royauté s’acheva. Les eupatrides voulurent avoir, chacun, leur part du pourvoir, ils firent décider que, tous les ans, on élirait neuf archontes, οϊ ίυνέα (683). Trois d’entre eux se partagèrent les anciennes prérogatives de la royauté. Le premier, l’archonte éponyme, donna son nom à l’année ; représentant l’État, il était le protecteur légal des veuves et des orphelins, le gardien des droits des familles et des phratries. Le deuxième, l’archonte roi, avait, comme le rex sacrificulus des Romains, des fonctions religieuses, charge qui lui donnait de la considération, comme gardien légal de la religion, mais point d’autorité doctrinale; il présidait l’aréopage et les tribunaux oui étaient jugés les crimes d’impiété et d’homicide ; enfin il devait avoir épousé une vierge de pur sang athénien, la βατίλιννα, qui elle-même offrait certains sacrifices et chaque année, aux Anthestéries, jurait qu’elle n’avait point commis d’adultère[13]. Le troisième, l’archonte polémarque, commandait l’armée et décidait dans les différends entre les citoyens et les étrangers. Les six derniers, nommés archontes thesmothètes, connaissaient des causes nombreuses qui n’étaient pas du ressort de leurs collègues. Chacun des neuf archontes avait le droit de publier des décrets. A côté de ces magistrats suprêmes, tous sortis des familles nobles, étaient le prytanée des naucrares, exclusivement composé aussi d’eupatrides, et le sénat de l’aréopage, où seuls encore ils entraient, puisqu’il était formé d’archontes sortis de charge. Ils occupaient donc toutes les magistratures ; mais ils allèrent plus loin, et la servitude civile menaça de se joindre pour le peuple à la servitude politique : car elles ont coutume de s’entraîner l’une l’autre. Les nobles possédaient toute la richesse : ils portèrent l’intérêt de l’argent jusqu’à l’usure, ou plutôt ils exigèrent de ceux qui labouraient leurs terres des redevances trop élevées. Les pauvres, dit Plutarque, accablés par les dettes qu’ils avaient contractées envers les riches, étaient contraints de leur céder le sixième du produit de leurs terres ; ou bien, réduits à engager leur propre personne, ils se livraient à leurs créanciers, qui les retenaient comme esclaves, ou les faisaient vendre en pays étranger. Plusieurs mêmes vendaient leurs enfants, leurs filles, leurs sœurs, ce qu’aucune loi ne défendait, ou fuyaient leur patrie pour se dérober à la cruauté des usuriers[14]. Frappante analogie de la situation de l’Attique à cette époque avec celle de Rome un siècle plus tard ! Le pauvre, à la merci du riche, n’a pas de loi écrite à invoquer : quelques coutumes appelées lois royales, voilà la règle unique et impuissante que reconnaissent les tribunaux. Les juges, d’ailleurs, ne sont que des eupatrides, puisque leur classe remplit seule l’archontat et l’aréopage. Dans une pareille tyrannie l’Attique ne pouvait être heureuse. C’est la classe des hommes libres, des petits propriétaires francs tenanciers, γεωμόροι, qui eût fait la force de l’État, et cette classe ne se formait point, tandis que s’accroissait celle des pauvres. Aussi, pendant cette obscure période de cinq siècles et demi écoulés entre l’abolition de la royauté et la législation de Solon, l’histoire n’a aucun fait à recueillir. Cependant les pauvres avaient pour eux le nombre; il leur vint même des auxiliaires puissants, quelques eupatrides qui, ne trouvant pas assez grande la part que leur faisaient les nobles, passèrent au peuple. Ainsi les Alcméonides se mirent à la tête des habitants de la côte, et les Pisistratides devinrent les chefs des montagnards. Ces chefs régularisèrent l’opposition populaire qui arracha, en 624, la rédaction d’un code de lois, afin d’échapper à l’arbitraire des tribunaux où les eupatrides jugeaient d’après des coutumes que conservait la tradition orale et que. bien souvent, l’intérêt faisait varier. Dracon fut chargé de l’écrire. 11 ne toucha pas à la constitution politique, mais il régla la vie du citoyen depuis le moment de sa naissance jusqu’à celui de sa mort. Tous les délits, assure-t-on, le plus léger larcin comme le meurtre ou le sacrilège, devaient être punis de mort. 1l prétendait que les moindres offenses méritaient ce supplice et qu’il n’en connaissait pas d’autre pour les crimes. Ce mot est-il vrai ? J’en doute, car on trouve dans ses lois d’autres châtiments : des amendes, la privation des franchises, et même, en certains cas de meurtre, l’exil.
Loi de Dracon sur le meurtre[15] Dracon constitua ou réorganisa le tribunal des éphètes, ceux qui envoient en exil. Ils étaient au nombre de cinquante et un, tous chefs de familles considérables et choisis peut-être par l’archonte roi. Ils siégeaient au Palladion, pour les meurtres involontaires, dont l’auteur était condamné à un exil temporaire ; au Delphinion, quand le meurtrier n’avait frappé qu’en se défendant, ou pour punir un flagrant adultère[16] ; au Phréattys, sur le bord de la mer, quand l’homme exilé pour un meurtre involontaire en avait commis un second avant de quitter l’Attique. L’accusé ne devant plus fouler le sol de la patrie, plaidait sa cause du bord d’un navire. Leur principale fonction était de réconcilier les parties en faisant payer le prix du sang, τά ύποφόνια. — Au Prytanéion, les rois des tribus jugeaient les objets inanimés qui avaient causé mort d’homme et qui étaient rejetés hors des limites du territoire. Cette organisation était même un adoucissement aux anciennes coutumes; car jusque-là tout meurtre était vengé par les parents de la victime, ce qui produisait des haines héréditaires, ou déféré à l’aréopage, qui, sans examiner les circonstances, prononçait toujours la mort ou l’exil avec la confiscation des biens. Dracon a un tel renom de sévérité, qu’on a dit de ses lois qu’elles avaient été écrites avec du sang. Peut-être faut-il, au contraire, les considérer comme un adoucissement à d’anciennes et cruelles coutumes. Montesquieu a fait cette remarque, que les lois les plus sévères ne sont pas les plus efficaces : elles exaspèrent ceux qui les subissent, ou elles effrayent ceux mêmes qui les appliquent, et, par ce double motif, elles tombent vite en désuétude. Il en fut ainsi de celles de Dracon; dont quelques une tombèrent en désuétude, et l’Attique se retrouva en proie aux mêmes désordres. Cependant elles avaient produit un bien. Le droit, la loi, n’étaient plus un mystère ; le peuple avait compris l’avantage de cette publicité, et il demandera bientôt à Solon de reprendre avec d’autres idées la réforme de Dracon. III. Cylon, Épiménide et SolonLes pays voisins de l’Attique étaient, en ce temps-là, troublés par de grandes agitations. A Mégare, à Corinthe, à Épidaure, à Sicyone, l’aristocratie qui avait hérité, comme à Athènes, de la royauté héroïque, avait vu s’élever au-dessus d’elle. par l’assistance de la foule, des chefs populaires, des tyrans. Cette fortune tenta Cylon. C’était un eupatride riche et illustré par une victoire aux jeux olympiques. Théagénès, tyran de Mégare, lui avait donné sa fille et l’engageait à l’imiter, ce qui eût consolidé sa propre usurpation. Cylon consulta, comme le faisait tout Grec de ce temps-là, l’oracle de Delphes, et le dieu lui répondit que, le jour de la plus grande fête de Jupiter, il pourrait s’emparer de la citadelle d’Athènes. Il demanda du secours à Théagénés, fit entrer ses amis dans le complot, et, quand arriva la solennité des fêtes d’Olympie dans le Péloponnèse, persuadé que c’était le temps fixé, il s’empara de la citadelle. Il s’était trompé, dit Thucydide ; le dieu avait voulu parler, non de la fête célébrée par les Éléens, mais de celle que les Athéniens solennisaient à une autre époque de l’année. A peine l’audacieuse tentative fut-elle connue, que les Athéniens accoururent en foule de la campagne et investirent la citadelle. Bientôt les vivres et l’eau manquèrent aux assiégés. Cylon et son frère parvinrent à s’évader, les autres s’assirent, en suppliants, près de l’autel de Minerve qui était dans l’Acropole. Il se trouvait alors, parmi les archontes, un homme probablement aussi ambitieux que Cylon et qui, autant que lui, aspirait à la tyrannie, car il descendait des anciens princes de l’Attique, et l’on voit que son fils se mit en relations étroites avec Crésus, roi de Lydie, puis épousa la fille du tyran de Sicyone, Clisthénès. C’était Mégaclès, le chef de la grande famille des Alcméonides. Mais Mégaclès n’entendait pas qu’un autre prit ce qu’il n’avait pu encore saisir, et il s’était mis à la tête des citoyens pour enlever aux rebelles le sanctuaire national. L’Acropole reconquise, il restait à priver les Cylonides de la protection de la déesse. Il leur persuada de se présenter en jugement ; et, comme ils craignaient de perdre le droit d’asile, il leur fit attacher à la statue de Minerve un fil qu’ils tiendraient à la main. Auprès de l’autel des Euménides, le fil se rompit de lui-même. La déesse, s’écria Mégaclès, refuse sa protection aux traîtres. On lapida ceux qui furent pris hors du temple, et l’on égorgea sans scrupule, auprès des autels ceux qui s’y étaient réfugiés. Quelques-uns seulement échappèrent, en allant se jeter en suppliants aux pieds des femmes des archontes (612). Ce meurtre fit pourtant accuser Mégaclès de sacrilège, et cette accusation pesa sur toute sa maison, celle des Alcméonides, même sur sa postérité. Les partisans de Cylon, ou plutôt les ennemis des grands, étaient nombreux. Ils réclamèrent vengeance, au nom de la religion violée, au nom des dieux, qui allaient cesser d’avoir des regards favorables pour une ville où leurs sanctuaires n’étaient plus inviolables, et les discordes recommencèrent à troubler la cité, se débattant entre la démocratie qui montait et l’aristocratie qui ne voulait pas descendre. Les Mégariens, chez qui, peut-être, Cylon s’était retiré, en profitèrent pour s’emparer de l’île de Salamine, qui commande les approches des ports de Mégare[17] et d’Athènes. Les Athéniens ne pouvaient, sans honte ni péril, la laisser aux mains de leurs ennemis; ils firent de grands efforts pour la reprendre; mais, après des alternatives de succès et de revers, cette guerre traînant en longueur, ils s’en dégoûtèrent à un tel point que, pour n’en plus entendre parler, ils défendirent, sorts peine de mort, de proposer une nouvelle tentative. Dans Athènes se trouvait alors un descendant de Codrus qui vivait, sans distinctions publiques, au milieu de la foule de ses concitoyens. Dans sa jeunesse, il s’était livré au commerce pour réparer les brèches faites à son patrimoine par son père. Il avait beaucoup voyagé, recherchant à la fois, parmi tant de peuples qui passaient sous ses yeux, la fortune par le négoce et la science par l’étude des moeurs et des choses. Il avait la réputation d’un sage, mais d’un sage tempéré, qui ne méprisait point les délices de la vie, la bonne chère, l’amour ; qui même chantait ses plaisirs dans des vers assez légers, entremêlés, il est vrai, de bonnes et profondes maximes : il s’appelait Solon. Il fit d’abord un singulier usage de son talent poétique. Avec toute la jeunesse d’Athènes, il supportait impatiemment la honte de la dernière guerre ; mais une menace de mort était suspendue sur la tête de quiconque parlerait de Salamine : Solon contrefit l’insensé et joua quelque temps ce rôle. Un jour, il arrive sur la place publique, l’air égaré, et déclame à haute voix des vers qui commençaient ainsi : J’arrive en héraut de la belle Salamine et je vais vous redire les vers harmonieux qu’Apollon m’a dictés. On l’écouta : c’était un fou. Mais il arriva que, lorsqu’il eut fini, toute la multitude accourue était folle avec lui et il n’était plus question que de reprendre Salamine, l’île aimable, comme le poète l’appelait. Nommé chef de l’expédition, il vainquit les Mégariens par une ruse, fit dans l’île une descente, et la replaça sous la domination athénienne (604). Cependant cette affaire ne se termina point là ; les Mégariens s’obstinaient à reprendre à leur tour l’île aimable. Après s’être fait beaucoup de mal, les deux partis remirent le différend à l’arbitrage de Lacédémone, qui prononça en faveur des Athéniens, sur la foi, dit-on, d’un vers que Solon avait intercalé dans l’Iliade et qu’il donna pour un vers d’Homère. La sagesse et la résolution de Solon décidèrent du succès de cette guerre; mais, pour faire comprendre les idées de ce temps, il faut citer un expédient auquel il recourut et qui fut une ruse de guerre d’un caractère particulier . à force de sacrifices, il gagna les deux héros indigètes qui protégeaient Salamine et qui passèrent du côté des Athéniens[18]. Ceux-ci du moins ne doutèrent pas que les honneurs rendus aux héros salaminiens ne les eussent décidés à favoriser un peuple qui leur croyait tant de crédit pour les affaires humaines. Avant d’attaquer les Platéens, Archidamos invoquera aussi les dieux de cette ville et leur demandera de la lui abandonner. La part que Solon prit à la guerre de Cirrha accrut la considération dont il jouissait ; c’était, croyait-on, par ses conseils que la ville coupable avait été prise. Il se servit de l’influence que ses services lui donnaient pour calmer les dissensions qui déchiraient toujours la cité. Les parents de Cylon et ceux de Mégaclès se faisaient une guerre acharnée ; il persuada aux derniers, qu’on appelait les sacrilèges, de se soumettre au jugement de trois cents des plus honnêtes citoyens de la ville. Ils furent condamnés et bannis ; on déterra les ossements de leurs morts et on les jeta hors de l’Attique. Ce sévère châtiment fit disparaître un élément de discorde ; mais il y en avait tant d’autres, que les troubles continuèrent. D’ailleurs on croyait avoir vu apparaître des spectres, des fantômes ; et une peste qui désola l’Attique parut un effet évident de la malédiction des dieux. Les victimes annonçaient qu’il fallait purifier la ville souillée par des crimes et des profanations. Pour calmer l’anxiété des esprits, on fit venir, d’après les conseils de l’oracle de Delphes, le Crétois Épiménide[19]. C’était un ami des dieux ; il passait pour fils de la nymphe Balté, et on racontait sur lui de mystérieuses histoires. Dans sa jeunesse, un jour que son père l’envoya à la recherche d’une brebis égarée, il entra dans un antre écarté pour éviter la chaleur du jour. Le sommeil l’y surprit ; il y dormit cinquante-sept ans. Tout était étrange et imposant dans sa personne : ses longs cheveux, son regard sombre et profond, la solennité de ses gestes, sa gravité orientale. Il avait une merveilleuse connaissance des choses de la religion et de la nature. On voulait qu’il connût toutes les propriétés des plantes et qu’il sût lire dans l’avenir. Son apparition produisit un vif effet sur le peuple curieux d’Athènes. On s’empressa de faire tout ce qu’il ordonna. Il fit conduire sur la colline de l’aréopage plusieurs brebis blanches et noires, et les laissa aller. Chacune fut immolée au lieu où elle s’arrêta, et un autel y fut consacré aux dieux inconnus. Six siècles plus tard, saint Paul devait éloquemment rappeler ce souvenir et montrer aux Athéniens son Dieu dans le dieu inconnu d’Épiménide. Il coûte à dire que ce sage respecté exigea le sacrifice d’une victime humaine ; on en trouva deux, assure-t-on : Cratinos et Aristodémos, deux jeunes Athéniens liés d’une étroite amitié, s’offrirent au couteau sacré pour le salut de la patrie. Épiménide fit encore construire sur la colline de Mars un temple des Euménides, près duquel se réunit ensuite l’aréopage. Il introduisit quelques changements dans le culte, et interdit aux femmes, à la mort de leurs époux, ces barbares témoignages de douleur, qui laissaient sur leur corps et sur leur visage de longues et hideuses traces. Quand il eut accompli ses réformes, il partit. On voulait le combler de présents et de richesses ; il n’emporta qu’une branche de l’olivier de Minerve, et un traité d’alliance entre Athènes et Gnosse sa patrie. La mission d’Épiménide eut pour résultat de ranimer chez les Athéniens le respect des choses saintes, d’abolir, au nom de la religion, certains usages cruels, et surtout de chasser les craintes superstitieuses et vagues. Il avait été éclairé sur les vrais besoins de la cité par Solon, qu’il avait associé à toutes ses mesures, et qui, peu de temps après, fut lui-même appelé à donner des lois à son pays (594). IV. Loi sur les dettes ; division du peuple en quatre classesLe génie de Solon était essentiellement humain : humaine aussi fut sa constitution. Il ne considéra pas l’État comme une machine artificielle dont les hommes seraient les pièces, qu’on pourrait combiner et agencer à volonté pour les besoins du service. Sparte était un camp toujours sous les armes, en face de l’ennemi ; il voulut qu’Athènes s’approchât davantage de l’idéal de la cité, qui consiste à associer à l’ordre général la plus grande liberté possible des individus. Ce respect des droits de la nature humaine, cette vue nette du but que la. société doit poursuivre, introduisirent dans la constitution de Solon le principe démocratique qui était déjà au coeur de son peuple et donnèrent à ses lois un caractère plus généreux : le citoyen ne fut pas l’esclave de l’État, et l’étranger ne fut point chassé : ceci est capital dans l’histoire d’Athènes et dans celle de la civilisation. Il y avait trois partis dans la ville : les montagnards, qui voulaient tout changer; les paraliens, qui voulaient changer peu de chose ; les pédiéens, qui ne voulaient rien changer du tout. Gagnés par la modération de Solon, ils s’accordèrent tous à remettre entre ses mains les pouvoirs, les charges, les revenus, à l’investir en un mot d’une véritable dictature pendant qu’il constituerait l’État (595). Ses amis le pressaient de la garder, de se faire tyran, plutôt que législateur ; il leur répondit par de piquantes railleries et continua son ouvrage. Avant de songer à la constitution, il fallait remédier au mal présent, les redevances non payées par les pauvres et par les anciens clients des eupatrides, qui devaient abandonner à leurs créanciers ou à leurs propriétaires le sixième du produit des terres qu’ils exploitaient[20]. Solon y parvint à l’aide de sa loi de décharge, qui facilita les payements par un changement dans le taux de l’intérêt et dans la valeur nominale des monnaies[21]. Une autre disposition rendit à la liberté ceux que la misère avait jetés clans l’esclavage, et ôta pour l’avenir au créancier tout droit sur la personne du débiteur[22]. On vit disparaître des champs de l’Attique les bornes, Apt, et les écriteaux qui indiquaient les dettes dont ils étaient grevés; ce fut ce que nous appellerions la mainlevée des hypothèques[23]. Nous avons encore les vers où Solon se vante d’avoir affranchi la terre qui, avant lui, était esclave, γή δουλεύουσα, et rendu à leur patrie les débiteurs vendus à l’étranger qui, à force d’errer par le monde, avaient oublié la langue attique. Cette toi fit d’abord murmurer, mais on en reconnut la sagesse; toutefois, pendant les trois siècles qu’elle dura, la démocratie athénienne ne revint jamais à la mesure de Solon : c’est une remarque a son honneur. Le respect de la propriété s’enracina si profondément dans les esprits que nul n’osa plus réclamer une abolition des dettes et une dépréciation des monnaies. La réforme de Solon fut, en effet, toute autre chose qu’une simple abolition des dettes. Les paroles énergiques dont il se sert pour la caractériser autorisent à croire qu’il supprima une condition agricole, analogue à celle des colons romains ou de nos serfs de la glèbe[24] ; et deux mots d’Aristote nous confirment dans ce sentiment : Solon fit cesser l’esclavage du peuple[25]. Le calme que produisirent ces mesures préliminaires laissa à Solon plus de liberté d’esprit pour ses autres, lois. Il porta la même modération, et s’efforça de concilier les principes et les intérêts contraires, en unissant, comme il le disait, la force à la justice. Avant tout, il décréta une amnistie dont ne furent exclus que les meurtriers et les traîtres : les Alcméonides purent rentrer. De l’ancienne constitution, Solon conserva certaines choses et en supprima d’autres : abolition des lois de Dracon, excepté de celles qui regardaient le meurtre, et maintien de l’archontat, de l’aréopage et des quatre tribus avec leurs subdivisions. Il fit deux innovations capitales : par la première, tout citoyen eut une certaine part aux droits qu’implique ce titre; par la seconde, là population fut divisée en quatre classes d’après la fortune. La première inclinait donc l’État vers la démocratie; la seconde était démocratique encore, en ce qu’elle abolissait les privilèges de la noblesse. mais elle était aussi aristocratique en ce sens qu’elle mettait les riches à la tête de l’État. Les quatre classes lurent organisées de la manière suivante : la première comprit tous les citoyens possédant au moins un revenu annuel de 500 médimnes ou de 500 drachmes, en produits secs ou liquides[26], et qui s’appelaient pour cette raison pentacosio-médimnes[27]. L’archontat, les grandes charges, le commandement en chef de l’armée et de la flotte leur étaient réservés. La deuxième classe fut composée des chevaliers, c’est-à-dire de ceux qui avaient un revenu d’au moins 300 médimnes ou 500 drachmes, fortune jugée nécessaire pour pouvoir entretenir un cheval. Cette classe fournissait la cavalerie; on lui accordait quelques fonctions subalternes[28]. La troisième était celle des zeugites, ou possesseurs d’un attelage de bœufs, ce qui équivalait à un revenu de 150 à 200 médimnes. Ils fournissaient l’infanterie pesamment armée ; on leur réservait aussi quelques charges inférieures. La quatrième classe enfin renfermait, sous le nom de thètes ou de mercenaires, tous ceux qui avaient en biens-fonds moins de 150 médimnes, quelle que fût leur fortune mobilière. Ils recrutaient les troupes légères et l’équipage des flottes, en recevant une solde que l’État ne donnait pas aux hoplites tirés des classes supérieures. Enfin ils étaient exclus des charges et des honneurs, mais admis dans l’assemblée du peuple et dans les tribunaux. Parmi eux devaient se trouver beaucoup d’anciens clients des eupatrides, comme la plèbe de Rome se forma, pour une bonne part, de la clientèle des patriciens. Cette inégalité dans la répartition des honneurs était compensée par la manière dont l’impôt était organisé. La quatrième classe ne le payait point, tandis que les trois premières étaient taxées suivant une progression qui montre que, dans l’esprit de Solon, les devoirs des citoyens envers la communauté croissaient avec leur fortune. Elles payaient en raison de la valeur nominale attribuée à leurs propriétés : mais, tandis que cette valeur était estimée, pour la première classe, au pair de la valeur réelle, elle était réduite pour la seconde d’un sixième et pour la troisième des quatre neuvièmes. Ainsi, une propriété donnant 500 médimnes de revenu était évaluée 12 fois cette somme, c’est-à-dire 6.000 drachmes, ou un talent, tandis que les biens des chevaliers, au lieu d’être estimés 12 fois 300 drachmes, ou 3.600 ; n’étaient portés qu’à 3.000 et ceux des zeugites à 1.000, au lieu de 1.800[29]. Cet avantage était plus apparent que réel, l’impôt direct sur le revenu n’étant établi que dans les cas d’urgente nécessité, tandis que l’impôt indirect sur les marchandises importées était permanent et payé par les pauvres aussi bien que par les riches. On a vu qu’il existait des poids et mesures dans les
villages ensevelis sous les laves de Santorin ; à plus forte raison, les
cités commerçantes et industrielles de V. Institutions politiquesQuatre corps politiques formaient le gouvernement : les archontes, l’aréopage, le sénat, l’assemblée. Les archontes furent toujours au nombre de neuf et, comme les prêtres, ils ne devaient avoir aucune difformité corporelle[30]. Ils se partageaient le pouvoir exécutif, de la manière qui a été indiquée ci-dessus, et répondaient assez à nos ministres. Ils conservèrent aussi leurs fonctions judiciaires, sauf les appels attribués à des tribunaux recrutés dans toutes les classes et dont ils tiraient les membres au sort[31]. A leur entrée en charge, ils juraient de maintenir les lois ; lorsqu’ils en sortaient, ils rendaient compte de leur administration à l’assemblée générale et étaient admis dans l’Aréopage. Tant qu’ils étaient fonctions, leur personne était sacrée. Les deux ancres qui retenaient, dit Plutarque, le vaisseau de l’État, même dans la tempête, étaient l’aréopage et le sénat, ou conseil des quatre cents. L’Aréopage, ancienne cour de justice fort respectée,
siégeait sur la colline de Afars, en plein air, parce qu’il ne pouvait se
trouver sous le même toit avec l’homme dont les mains étaient supposées impures.
Il jugeait les crimes de meurtre, de mutilation, d’empoisonnement et de
trahison, était composé des archontes sortis de charges, par conséquent en
général d’hommes âgés et exercés aux affaires. Solon l’érigea en tribunal
suprême et le chargea de surveiller toute la cité, les mœurs, l’éducation et
la religion, de réviser même les jugements du peuple, avec pouvoir de faire recommencer
l’instruction d’une affaire ou d’un procès. Ses membres étaient nommés à vie,
mais pouvaient être exclus par une décision de leurs collègues, comme le
furent cet aréopagite qu’on avait vu dans un lieu de débauche[32] et un autre,
assure-t-on, qui avait étouffé un oiseau réfugié dans son sein pour fuir un
épervier. Les formes de la procédure devant l’Aréopage étaient solennelles et
sévères. Il siégeait la nuit[33], présidé par le
second archonte. Point de digression de la part de l’accusé ou de l’accusateur,
qui ne pouvaient se faire assister d’un avocat, point d’appel aux passions, à
la pitié, mais le simple récit des faits et avant tout le serinent de ne rien
dire que de vrai. Pour voter, les aréopagites prenaient un caillou sur l’autel
et le déposaient en silence dans l’urne de L’Aréopage était le gardien de livres mystérieux où se trouvaient indiqués les moyens d’assurer le salut de la ville[36]. Mais ce peuple, tout. superstitieux qu’il était, avait trop d’esprit pour accorder à de vieilles insanités la robuste confiance que les Romains mettaient dans les oracles sibyllins. Les livres de l’Aréopage n’ont joué aucun rôle dans l’histoire d’Athènes. Les quatre cents sénateurs étaient choisis dans les trois premières classes. Chacune des quatre tribus fournissait cent membres élus à la majorité des voix et plus tard désignés par le sort, dont les erreurs furent alors corrigées par l’épreuve sévère à laquelle on soumit les candidats. Une seule chose marque bien la différence entre le sénat d’Athènes et celui de Lacédémone, en même temps que le caractère des deux républiques. A Sparte, on n’est admis clans le sénat qu’à soixante ans ; on y est nommé à vie, et les décisions de l’assemblée sont couvertes par l’irresponsabilité de ses membres. A Athènes, trente ans est l’âge fixé ; le sénat est annuel, il est responsable. Nous avons eu occasion d’indiquer combien ceci est de principe démocratique. De plus, quelle différence, pour l’énergique activité du gouvernement, entre les résolutions d’un sénat de vieillards et celles duit sénat d’hommes dans la vigueur du corps et de l’esprit ! — Le sénat préparait les lois qui devaient être soumises à l’assemblée du peuple, s’occupait des finances et de l’administration, rendait des décrets qui avaient force de loi pendant l’année; enfin, il pouvait imposer certaines amendes. Il se divisait en dix commissions de nombre égal appelées prytanies, qui successivement avaient pendant 35 ou 36 jours la présidence du sénat et de l’assemblée. La prytanie en exercice s’assemblait au Prytanée et y prenait les mesures d’intérêt immédiat. Elle y était nourrie aux frais de l’État. Le sénat était le conseil perpétuel du peuple, mais le peuple était l’unique souverain. L’assemblée populaire, convoquée par le sénat, se composait de tous les citoyens[37] ; d’ordinaire un petit nombre seulement se rendaient à l’Agora. L’étranger qui s’y serait glissé avant d’avoir obtenu le droit de cité eût été puni de mort ou vendu comme esclave, car il eût usurpé sur la puissance souveraine. L’assemblée se réunissait à l’Agora, ont la place n’est pas encore déterminée rigoureusement, ou au Pnyx, qui semble, malgré les doutes contraires, devoir être cherché au nord de la colline des Muses, là où le roc a été entaillé de manière à former une tribune. La séance commençait par un sacrifice et une prière[38], puis on lisait à haute voix le sujet mis en délibération, et le héraut invitait à monter à la tribune ceux qui avaient à donner un avis utile à l’État. Le vote avait lieu à mains levées, sans distinction de classes ni de fortune. Par un mouvement unanime de tout le peuple, dit Eschyle, l’air s’est comme hérissé de mains droites pour sanctionner le décret[39]. L’assemblée faisait les lois, élisait les magistrats qui devaient lui rendre compte à l’expiration de leur charge, délibérait sur les affaires publiques qui lui étaient soumises par le sénat. Elle approuvait, rejetait, modifiait. Tout citoyen avait le droit de porter une proposition devant le peuple, mais nul ne pouvait le faire, même les archontes, que par l’intermédiaire du sénat. Tout citoyen aussi pouvait prendre la parole dans l’assemblée dès l’âge de vingt ans, mais les hommes de cinquante ans parlaient les premiers : faible privilège donné à la vieillesse et bien inférieur à la toute-puissance qu’elle exerçait à Sparte. Était-ce accorder assez à l’expérience ? N’était-ce pas trop permettre à la fougue de la jeunesse ? Un siècle et, demi plus tard, Aristophane se plaindra amèrement du dédain que les Athéniens professeront pour les vieillards. Disons pourtant que l’usage était plus sévère que le droit, et qu’on ne voyait d’ordinaire à la tribune que les orateurs de l’État, dix citoyens qui avaient été chargés, après examen public, de défendre par la parole les intérêts de la république. C’était donc une fonction très influente et des plus honorables. Tout citoyen avait le droit de poursuivre un orateur en justice, si sa vie n’était pas irréprochable ; s’il avait été mauvais fils ou mauvais soldat; s’il avait proposé un décret contraire aux lois existantes. Dans ce dernier cas, un procès lui était intenté au nom des anciennes lois, et l’orateur pouvait être puni de l’exil ou d’une ruineuse amende[40]. Lorsqu’il était à la tribune, il avait sur la tête la couronne de myrte que portaient les sénateurs et les magistrats : c’était le symbole qui désignait les citoyens agissant ou parlant dans l’intérêt de l’État. On n’avait point fixé le nombre nécessaire pour rendre valables les décisions de l’assemblée, excepté dans certains cas où il fallait 6000 citoyens. Thucydide remarque que rarement l’assemblée ordinaire s’élevait à 5000 membres : c’est que les Athéniens n’étaient pas, comme les Spartiates, une association oligarchique nourrie par des Hilotes. En Attique, il fallait gagner son pain par l’agriculture, par l’industrie, par le commerce. D’ailleurs la loi qui défendait l’oisiveté et qui obligeait chaque citoyen à déclarer tous les ans de quelle occupation il vivait, était faite pour entretenir l’habitude du travail. On fut même, par la suite, dans la nécessité d’indemniser le peuple pour l’assistance à l’assemblée[41]. Mais alors l’Athénien badaud s’oubliait à babiller au marché pendant que les prytanes, avec quelques fidèles, attendaient en vain clans le Pnyx, et il fallait lancer contre l’oublieux souverain les Scythes entretenus aux frais de l’État pour faire la police de la cité. Ils allaient par les rues, par les marchés, armés d’une corde teinte de vermillon et marquaient les retardataires, qui ne pouvaient plus se présenter au lexiarque, pour toucher leur jeton de présence. A leur approche, c’était à qui courrait le mieux, afin de les éviter et d’arriver à temps dans l’enceinte consacrée. Qu’on juge si ce peuple gai, turbulent, devait s’amuser à une longue séance, dans une assemblée d’où il était défendu, sous peine d’amende, de sortir avant la fin ! Aussi dans quelles dispositions y allait-on souvent ! Voyez, dans le héros des Acharniens d’Aristophane, cet ami de la paix, bonhomme au fond, qui s’installe au Pnyx avec le parti pris d’interrompre quiconque parlera de la guerre. Quelle vie! quel mouvement! quels assauts de plaisanteries et de railleries spirituelles! quelles interpellations! quelles interruptions! quel tumulte ! Eh ! comment rester silencieux quand on vient du Pirée, des querelles des matelots, du mouvement des vaisseaux et de la foule, des cris du port, des bruits de la mer ; quand les oreilles et les yeux sont encore pleins de tant de scènes diverses, mobiles, tumultueuses ? — Mais, avec Solon, nous sommes bien loin encore du temps où ce tableau sera vrai. A côté de l’assemblée générale, la puissance populaire s’exerçait encore par les tribunaux que les archontes présidaient, et par le corps des héliastes qui, d’après un règlement postérieur, renfermait 5.000 citoyens, âgés de 30 ans au moins et choisis par le sort sans distinction de fortune, mais à condition d’avoir bonne renommée, et de n’être point débiteurs du trésor public[42]. Ces héliastes[43] divisés en dix sections, ainsi que le peuple sera par Clisthénès partagé en dix tribus, jugeaient, par commission de 500, de 1.000, de 1.500, les causes les plus graves et les délits politiques. Leur nombre les montrait comme la justice du peuple en action et ne permettait pas aux accusés’ riches ou puissants de maîtriser par la vénalité et l’intimidation ce tribunal où siégeait la cité presque entière[44]. Le serment qu’ils prêtaient[45] impliquait l’obligation de juger selon les lois et de punir les auteurs de propositions illégales, ce qui leur donnait un droit de contrôle sur les actes de l’assemblée générale, que sa composition ne mettait pas â l’abri des votes téméraires. Cette institution était un complément et une sanction du pouvoir politique exercé par l’assemblée ; et comme les héliastes changeaient chaque année, ils étaient bien animés du même esprit que le peuple d’où ils sortaient et où ils rentraient. Pour prévenir l’encombrement des procès, Solon avait établi que des citoyens âgés de soixante ans et agréés par les deus parties pourraient se constituer en tribunal arbitral dont la sentence serait saris appel. On institua aussi clans les tribus des diétètes, sortes de juges de pais qui avaient la décision pour les contestations peu importantes. Ces juges étaient en si grand nombre, qu’une inscription récemment découverte en nomme 104 pour une seule année. Un tribunal particulier, celui des 51 éphètes, jugeait les meurtres involontaires ou ceux qui n’avaient été commis qu’en cas de légitime défense. Une pierre tombée du haut d’un mur et qui tuait un passant devenait un objet maudit. On instruisait en quelque sorte le procès qui était obligatoire pour tout meurtre et elle était portée par les magistrats hors de l’Attique, comme un criminel exilé. Les éphètes, âgés de 50 ans au moins et tous de noble maison, se réunissaient, suivant les cas, en quatre lieux différents, Delphinion, Palladion, Prvtaneion et Phréatto[46]. Les progrès de la démocratie finirent par leur ôter toute importance. Les peines habituelles étaient l’amende, la confiscation des biens, la prison et la mort ; une peine particulière, l’atimie, enlevait au citoyen une partie ou la totalité de ses droits civiques[47]. On voit que, des trois corps délibérants, l’assemblée représentait la démocratie et, comme on dit aujourd’hui, le mouvement ; le sénat, l’aristocratie de richesse ou la bourgeoisie et la prudence de l’intérêt ; enfin l’Aréopage, assez semblable au sénat de Sparte, l’aristocratie d’âge et d’honneurs, l’expérience des affaires, l’esprit de conservation, qui, porté trop loin par les vieux corps et les vieux partis, peut devenir souvent le désir. le besoin de l’immobilité. Ce régime mixte et tempéré caractérise le génie de Solon et montre les difficultés qu’il eut à résoudre. Il concilia fort habilement des intérêts en lutte : le peuple y gagna beaucoup et pourtant la noblesse n’y fit pas d’opposition, parce que, possédant alors tous les biens, elle ne vit pas la portée de cette substitution démocratique de la richesse à la naissance, de la fortune qui se perd ou se gagne à la noblesse qu’on ne tient que de ses aïeux. C’est la même révolution pacifique que, vers ce temps-là, Servius Tullius opéra dans Rome. Une magistrature qui jeta un grand éclat à Rome, celle des censeurs, manquait à Athènes. Mais on a vu que la censure n’y manquait point, qu’elle était exercée par l’Aréopage, qu’elle pouvait l’être par tout citoyen, qu’enfin chaque candidat aux fonctions publiques était soumis à un examen, la δοxιμασία, dont les conditions étaient sévères[48]. Il eût mieux valu sans doute que ce pouvoir fût exercé par une magistrature spéciale, mais, à Rome même, la censure n’empêcha rien, quand arriva le débordement des passions mauvaises. La censure la plus efficace est celle des moeurs publiques, lorsqu’elles sont pures. A Athènes, non plus, ne se faisaient ni le cens ni la grande solennité romaine de la lustratio. Cependant la purification de la ville avait lieu chaque année, au milieu de cérémonies religieuses, pour expier et effacer ce qui avait pu irriter les dieux contre le peuple[49]. Il est possible que quelques-unes des dispositions réglementaires que nous venons de rapporter aient été introduites postérieurement, surtout depuis Clisthénès ; mais, à part ces détails, la législation de Solon se laisse bien saisir clans sort ensemble. Comme il le dit dans un de ses pæans, il avait mis un terme à l’irritation des pauvres contre les riches, et donné à chacun des deux partis, non pas une épée pour attaquer et gagner une victoire fatale, mais un bouclier pour se couvrir et se défendre[50]. Remarquons encore que la part faite par Solon, même aux plus pauvres, dans l’assemblée générale et dans les tribunaux, montre que ce vrai sage eut au plus haut degré le sentiment de la dignité de l’homme, et qu’il avait compris que les bonnes lois sont celles qui relèvent le citoyen, non celles qui l’abaissent et le dégradent. A Athènes, il n’y a point de parias politiques : Solon veut que tout citoyen ait une assez nette intelligence des intérêts de la cité pour bien voter à l’assemblée, et. des lois de la morale pour bien juger aux tribunaux. Tous, le pauvre comme le riche, le libre comme l’esclave, sont appelés aux fêtes, qui, en même temps qu’elles représentent et développent le sentiment religieux, éveillent celui du patriotisme et de l’art. Quelle éducation pour le peuple que ce continuel exercice des plus hautes facultés! Aussi quand vous verrez les Athéniens appelés encore au concours des poètes, des sculpteurs et des peintres, pour prononcer entre Eschyle et Sophocle, Zeuxis et Polygnote, Phidias et Polyclète, ne vous étonnerez-vous pas qu’ils soient devenus le plus intelligent des peuples du monde ! VI. Institutions civiles, industrie et commerce, étrangers et esclavesOn sent moins à Athènes qu’à Sparte le lien qui unit les institutions civiles aux institutions politiques. Tout ne va pas d’une seule pièce, comme dans la cité de Lycurgue, où l’homme disparaît pour ne laisser voir que le citoyen, partout et toujours enchaîné à l’État. La propriété n’est pas absorbée à Athènes par l’État, ni gênée par le formalisme étroit des modes d’acquérir qu’on trouvera en Italie ; elle existe au contraire dans toute la liberté et l’indépendance qui la constituent véritablement. Solon fonda cette liberté par sa loi sur les testaments. Jusqu’à lui, dit Plutarque, les Athéniens n’avaient pas eu le pouvoir de tester ; tous les biens du citoyen qui mourait sans enfants retournaient à ses gennètes. Solon, qui préférait l’amitié à la parenté, la liberté du choix à la contrainte, et qui voulait que chacun fût véritablement maître de ce qu’il avait, permit à ceux qui étaient sans enfants de disposer de leurs biens comme ils le voudraient. Il n’approuva pas indistinctement toute espèce de donation ; il n’autorisa que celles qu’on aurait faites sans avoir l’esprit aliéné ou affaibli par des maladies, des breuvages et des enchantements, sans avoir éprouvé de violence, ou avoir été séduit par des caresses. Les gennètes n’héritaient plus alors qu’en l’absence d’un testament. S’il y avait des enfants, les fils partageaient la succession en portions égales, et conformément à l’ancienne coutume, ils constituaient une dot de leurs sœurs. A défaut de fils, la fille héritait ; mais l’absence d’un fils semblait une calamité, parce que la fille ne pouvant continuer la religion domestique, les aïeux allaient manquer des honneurs funèbres nécessaires au repos des mânes. L’enfant illégitime n’avait aucun droit à la succession qui, dans ce cas, retournait aux plus proches parents du mort ; il n’était pas même citoyen ; mais la recherche de la paternité était permise à l’enfant né d’une mère athénienne. Le père pouvait du reste exhéréder son fils, à condition que le conseil de famille y consentit par une délibération que l’autorité publique homologuait[51]. Beaucoup de villes grecques avaient interdit le célibat; Platon répète encore dans ses Lois que le citoyen qui n’aura pas contracté mariage avant trente-cinq ans doit être soumis à une amende annuelle de 100 drachmes et qu’il ne pourra réclamer des jeunes hommes les marques de respect et d’honneur dus à la vieillesse[52]. Nous ne savons pas si Solon eut besoin de pareille sévérité. De son temps la religion était encore obéie, et comme elle exigeait que le foyer domestique eût toujours des offrandes, les morts, des libations, elle imposait le mariage. Une famille qui ne se continuait pas, c’était un foyer éteint, un tombeau oublié et des aïeux privés des honneurs qui les consolaient dans leur vie d’outre-tombe. Les jeunes filles vivant très retirées, le mariage se concluait surtout d’après les convenances des parents, habituellement dans le mois de γαμηλιών, janvier-février, temps où la nature commence à se réveiller du sommeil hivernal[53]. Cette solennité était toujours accompagnée de cérémonies religieuses : d’abord des sacrifices en l’honneur des dieux protecteurs de l’hyménée ; puis le bain nuptial dans l’eau sacrée que des jeunes filles avaient puisée à la fontaine Kallirrhoé. Après le dernier repas fait par la fiancée dans la maison paternelle, elle attendait, en habits de fête, son époux, qui l’emmenait sur un char que suivait un cortège de jeunes filles chantant l’épithalame. Théocrite nous en a conservé quelques traits dans le chant nuptial d’Hélène. Quand le blond Ménélas épousa celle
qui, dans toute l’Achaïe, ne voyait point de beauté égale à la sienne, douze
vierges, des plus nobles familles de Lacédémone, leur soyeuse chevelure ornée
de guirlandes d’hyacinthe, se réunirent devant l’asile heureux des deux époux
et, frappant la terre en cadence, elles remplissaient le palais des doux
chants d’hyménée. Comme la brillante aurore se lève
au premier jour du printemps, quand le froid hiver s’enfuit vers les pôles
glacés, telle paraissait, au milieu de nous, Hélène au teint de rose. Quelle femme a rempli sa
corbeille de plus beaux tissus ? Quelle a su mélanger avec plus de goût
les laines aux couleurs variées sur des trames délicates et tirer de la lyre
des sons harmonieux, ou chanter avec grâce les louanges d’Artémis et d’Athéna ?
Éros habite dans ses yeux. Ô belle et aimable fille, tu es
épouse maintenant. Demain, nous irons dans la prairie cueillir les fleurs
nouvelles et former des couronnes odorantes pour en parer un platane que nous
arroserons des plus doux parfums. Salut à toi, nouvelle épousée !
Salut à toi, Ménélas, fils du roi des cieux! Puissent Aphrodite enflammer vos
cœurs de mutuels transports et Latone vous donner des enfants dignes de
vous !... Dormez, couple charmant, mais
réveillez-vous avec l’aurore. Dès que le chantre du matin, levant sa crête
altière, annoncera le retour d’Apollon, nous viendrons toutes encore chanter
en chœur : Hymen, Hymen, réjouis-toi de cette belle union ! Le mariage à Athènes avait plus de vraie dignité qu’à Sparte. Cependant, pour assurer la continuité des familles lorsqu’elle était menacée par la stérilité d’un des époux, Solon conserva dans ses lois de vieilles coutumes en apparence très singulières, celle, par exemple, concernant le vieillard qui, par cupidité, avait épousé une jeune et riche héritière[54]. Il avait pour excuse des idées religieuses très respectables, mais qui ne sont plus les nôtres ; aussi nos lois n’ont pas eu besoin, comme à Athènes, d’autoriser une suppléance que le législateur imposait au frère ou à un parent du mari. En Grèce, les familles ne paraissent pas avoir été nombreuses. L’avortement était fréquent, comme il l’est encore en Orient ; le serment hippocratique, par lequel les médecins s’engageaient à ne le point provoquer, en est une preuve, et Aristote le recommande pour que la population ne dépasse pas un chiffre déterminé. La comédie moyenne atteste aussi que les mœurs ne réprouvaient pas l’exposition, surtout pour les filles qui ne pouvaient continuer la famille et le culte domestique. On sait quel était, à Sparte, le sort de l’enfant débile; à Thèbes, la loi ordonnait aux parents trop pauvres de remettre leurs nouveau-nés aux magistrats[55], obligation qui ne doit pas en avoir sauvé beaucoup. Cependant il ne faudrait pas croire que le mariage grec ne fût qu’un acte religieux d’où l’affection aurait été exclue. Ce serait supposer que les anciens étaient d’une autre nature que nous. Il est vrai qu’alors comme aujourd’hui le législateur se préoccupait des rites, non des sentiments, mais Solon a défini le mariage en des ternies qui sont les nôtres : Une société intime entre le mari et la femme, ayant pour but de fonder une nouvelle famille et de goûter ensemble les douceurs d’une tendresse mutuelle. De là ses règlements sur les dots. La fiancée ne devait apporter à son mari que trois robes et quelques meubles de peu de valeur[56]. Soigneux de la dignité des femmes, qu’il entendait autrement que le législateur des phénomérides, il restreignit leur liberté en faveur de la décence : il régla leurs voyages, leur deuil, leurs sacrifices; il leur défendit de sortir de la ville avec plus de trois robes, de porter des provisions pour plus d’une obole et de traverser le soir les rues autrement que sur un char et précédées d’un flambeau. Il consacra un ancien droit des familles (γένη) : si une jeune fille restait orpheline, le plus proche parent du côté paternel devait l’épouser, tout au moins lui constituer une dot calculée sur l’étendue de ses propres biens et lui trouver un mari. Mais il abolit la loi contre nature qui autorisait le citoyen à vendre son fils, sa fille, ou sa sœur restée sa pupille, à moins que celle-ci n’eût justifié par sa conduite cette sévérité. La famille conserve ici tout son mystère ; elle est respectée et non pas mise à nu, au grand jour, comme à Lacédémone ; et elle n’est pas non plus absorbée, comme elle le sera chez les Romains, dans le paterfamilias. A Athènes, la puissance maritale et la puissance maternelle ne sont que des moyens de protection et de défense. Solon retire même au père le vieux droit de vendre ou de tuer son enfant Celui-ci grandit dans les bras du père et de la mère, sans que l’État vienne indiscrètement porter ses regards dans le sanctuaire du foyer domestique. De là résultent, du père au fils et réciproquement, des relations et des devoirs particuliers tout à l’ait conformes à la nature. A Sparte, le fils ne doit guère plus de respect à son père qu’à tout autre citoyen d’âge mûr : son père n’est à ses yeux qu’un des vieillards membres de l’État. A Athènes, Solon répète à son insu un mot du Décalogue que Platon redira après lui[57] : Honore les dieux et respecte ceux qui t’ont donné la vie ; il oblige le fils devenu grand à nourrir son père infirme, et, avant de déférer une haute magistrature à un citoyen, la loi recherchera s’il a été bon fils, s’il a honoré ses parents pendant leur vie et après leur mort[58]. Jusqu’à seize ans, les parents élèvent l’enfant de la façon qui leur plait : usage qu’Aristote réprouve parce que cette éducation abandonnée aux parents sera souvent faible, capricieuse et contribuera à dissoudre la cité. A partir de la seizième année, ils se rendaient au gymnase, où l’Hermès Hégémonios, celui qui conduit, présidait à leurs exercices. On ne visait pas remplir l’esprit des enfants d’une foule de connaissances qui surchargent la mémoire, sans développer l’intelligence. Leur éducation était partagée en deux séries d’études A dix-huit ans accomplis, majorité civile : le jeune homme peut prendre possession de son patrimoine ; il est inscrit sur le livre des éphèbes et il va commencer son noviciat politique et militaire. Chaque année, les Athéniens de cet âge se réunissent devant l’autel appelé le foyer commun du peuple et, en présence des exégètes, chargés d’interpréter les oracles, du prêtre des Grâces qui a le devoir d’appeler sur la ville la protection de tous les dieux, l’éphèbe prête le serment suivant : Je ne déshonorerai pas les armes sacrées que la patrie me donne et je ne quitterai pas mon compagnon de rang. Je combattrai pour tout ce qui est saint et sacré, seul ou avec beaucoup, et je ne rendrai point à ceux qui nous succèderont ma patrie moindre que je ne l’aurai reçue, mais plus grande et plus forte. J’obéirai aux magistrats et aux lois, et si quelqu’un détruit ces lois, ou n’y obéit pas, je les vengerai, seul ou avec mes concitoyens, et j’honorerai la religion de mes pères. Je prends les dieux à témoin de ce serment. Après ce serment héroïque, les éphèbes passent sous la surveillance d’un magistrat annuel, le cosmète. Ils assistent à des cours de philosophie, de musique, d’éloquence et de poésie pour former leur esprit; aux fêtes religieuses parce que le culte et la patrie se confondent ; aux assemblées du peuple, afin d’étudier les affaires publiques ; aux exercices gymnastiques, qui rendront leur corps souple et fort ; enfin, comme apprentissage de guerres ils feront un service de police dans l’intérieur et un service de garde dans les forteresses de la frontière et du littoral. Quelle éducation complète du corps et de l’âme[60] ! C’est que la guerre sans merci rôde sans cesse autour de la cité et, comme on n’a point de machines pour en défendre les remparts, il faut avoir des hommes forts, lestes, résistants, pour les combats corps à corps, et de fermes esprits résolus à tous les sacrifices que la patrie demandera. A vingt ans, majorité politique : le jeune homme devient citoyen dans toute l’acception du mot ; il vote dans l’assemblée générale il peut même y prendre la parole. Nous avons indiqué ce que ces orateurs de vingt ans devaient apporter de mouvement et d’activité, mais souvent aussi de turbulence et de désordre, dans les assemblées publiques. Au moyen-âge commence aussi sérieusement le service à l’armée. Cette double majorité était bien prématurée c’était parler au jeune homme trop tôt de ses droits, et pas assez longtemps de ses devoirs. Toutefois ce ne sera que dans la décadence générale des mœurs, alors que les meilleures lois seraient impuissantes, qu’on verra ces jeunes dissipateurs devenus des types sur les scènes grecque et latine. A trente ans, le citoyen peut entrer au sénat. A soixante, il est quitte du service militaire et peut se reposer. L’adoption conférait les mêmes droits que la filiation naturelle et par les mêmes raisons tirées du culte des morts ; Si vous annulez l’adoption faite par Ménéclès, dit un orateur aux juges d’Athènes, il sera mort sans enfant ; personne ne lui fera les libations funèbres, et il n’aura plus de culte[61]. J’ai déjà dit que l’Attique est un sol généralement stérile parce que l’eau y manquait. Cependant la rosée y répandait chaque nuit quelque humidité ; et les Athéniens qui la voyaient, au matin, en remerciaient l’Aurore. L’agriculture pourtant y était fort en honneur, et les Grecs disaient que c’était là que le premier grain de blé avait été confié à la terre par Triptolème[62]. Les lois d’Athènes punissaient de mort celui qui tuait un bœuf[63], et cette défense n’était éludée que pour les sacrifices à Jupiter Polieus. On plaçait de l’orge sur un autel et on amenait un boeuf tout auprès : lorsqu’il avait touché au grain on l’immolait, mais le victimaire, après avoir frappé, laissait tomber sa hache et s’enfuyait. Les assistants paraissaient n’avoir point vu le meurtrier ; ils ramassaient la hache et la portaient au juge, qui condamnait le fer comme auteur du meurtre, et le faisait jeter à la mer[64]. Après Périclès, le travail des champs et la surveillance des cultures était encore la principale occupation des citoyens, même riches. Le bonhomme Strepsiade, dans les Nuées d’Aristophane, n’en a pas d’autre. Solon n’avait donc aucune prescription à établir pour favoriser l’agriculture. Préoccupé du désir d’encourager l’industrie et le commerce, il voulut que chaque citoyen sût un métier. Jérusalem avait une loi semblable. Singulier rapport! Les deux villes qui ont le plus profondément remué le monde de l’esprit sont celles aussi qui ont le plus honoré le travail des mains. D’après une loi de Solon, le père qui n’avait pas fait apprendre un métier à son fils ne pouvait exiger que celui-ci le nourrit dans sa vieillesse[65] ; et l’Aréopage, chargé de s’assurer des moyens d’existence de chaque citoyen, dut punir ceux qui restaient dans l’oisiveté. Ainsi Lacédémone avait proscrit le travail, et Athènes en faisait une loi. Toute la différence de leur destinée et de leur gloire est là. Afin de tenir les denrées de première nécessité à bas prit, Solon défendit l’exportation des produits du sol, l’huile d’olive exceptée ; c’était un encouragement à l’industrie. Une loi interdisait de reprocher à un autre citoyen le gain qu’il avait fait au marché, mais une autre loi lui défendait de surfaire en employant le mensonge. C’était une tentative pour donner de la moralité au commerce. Athènes ne pouvait faire le commerce de terre que vers le
nord, avec Pleine liberté pour le citoyen d’aller et de venir. Il peut s’établir à l’étranger et y porter tout son bien, si, dit le Criton de Platon, nous ou la république ne lui plaisons pas. Les peuples commerçants et industrieux n’ont point de fierté dédaigneuse à l’égard des étrangers : ce n’est même que par des relations fréquentes avec eux qu’ils assurent et développent leur prospérité. Loin de fermer l’Attique, Solon ordonna d’accueillir les nombreux émigrants qu’y attirait la liberté dont on y jouissait. Il ne donnait le droit de cité qu’if ceux qui avaient été bannis à perpétuité de leur pays, n’estimant pas qu’il fût meilleur d’avoir deux patries que de servir deux maîtres ; mais il jetait dans les fers, même avant le jugement, ceux qui usurpaient ce titre, parce qu’il ne fallait pas que la souveraineté fût viciée à sa source par le mélange confus d’éléments impurs. Ce n’était qu’à la seconde génération que l’archontat et le sacerdoce pouvaient s’ouvrir à la famille du nouveau citoyen. L’étranger établi à Athènes portait le nom de métèque (qui habite avec). Il fournissait une contribution personnelle de 12 drachmes comme chef de famille, en retour de la protection que l’État lui accordait, sous peine, s’il ne l’acquittait pas, d’être vendu comme esclave. C’eût été, par exemple, le sort du philosophe Xénocrate, si un riche citoyen ne l’avait reconnu en passant par le marché aux enchères et n’eût payé sa dette. La taxe de la femme étrangère était moitié moindre; celle du fils exemptait la mère, comme celle du mari exemptait l’épouse. Mêmes conditions pour l’affranchi. Le métèque devait se choisir parmi les citoyens un patron qui répondit de sa conduite et lui servit de caution. Ces obligations remplies, il trafiquait et exerçait librement sa profession. Mais les métèques ne pouvaient acquérir de propriété territoriale, et l’usage s’était introduit de leur imposer dans les fêtes certaines corvées humiliantes ; ainsi aux Panathénées, ils portaient les vases, les ustensiles sacrés, et leurs femmes tenaient le parasol sur la tête des matrones athéniennes. Xénophon souhaita plus tard qu’on abolit ces distinctions irritantes; beaucoup en effet, à la suite de longues guerres, furent admis au rang de citoyen, et la condition générale du métèque fut, quelque peu adoucie. Ils l’avaient mérité, car ils prenaient leur part des dangers de la commune patrie, en servant sur sa flotte comme rameurs ou soldats, même dans ses armées de terre comme hoplites, c’est-à-dire au milieu des troupes nationales. Même esprit libéral à l’égard des esclaves, et pour les mêmes raisons. Solon voulut que, maltraités par leur maître, ils pussent exiger la vente et passer ainsi sous une autorité moins dure. La loi leur assurait un défenseur ; et, en attendant le jugement, ils trouvaient dans le temple de Thésée[66] un asile inviolable. Il n’était pas permis au premier venu de les frapper. Leur mort, un outrage même, étaient vengés comme si la victime eût été un homme libre. Et en voici la raison, suivant Xénophon : Si la coutume autorisait un homme libre à frapper un esclave, un étranger ou un affranchi, le citoyen pourrait bien souvent être victime d’une méprise. Il n’y a rien, soit dans le maintien, soit dans l’habillement, qui le distingue de l’étranger ou de l’esclave. Démosthène n’a pas cette sécheresse toute spartiate. Il voit là une grande et glorieuse loi d’humanité. Et que diraient les barbares, s’écrie-t-il, si on leur apprenait que vous protégez même contre l’outrage l’esclave acheté chez les nations qui vous ont pourtant donné un juste motif de haine héréditaire, et que souvent les infracteurs de cette loi ont été punis de mort ! — La loi, avec raison, dit Montesquieu, ne voulait pas ajouter la perte de la sûreté à celle de la liberté. Ils pouvaient, comme les étrangers, entrer et prier dans les temples d’où la loi chassait la femme adultère[67], et ils étaient admis à servir la flotte comme rameurs ou soldats de marine. Ceux qui avaient combattu aux Arginuses furent naturalisés. Ainsi la constitution athénienne stipulait en faveur de l’esclave. Athènes fut récompensée de cette douceur. Jamais, même au temps de ses plus dures épreuves, elle, ne vit éclater contre elle ces guerres serviles, qui, tant de fois, demandèrent à Sparte et à Rome un compte terrible de leur cruauté[68]. L’État avait des esclaves publics : c’était un corps d’archers, appelés les Scythes, qui faisaient la police des rues, gardaient la prison et exécutaient les condamnés. Plus tard, leur nombre s’élèvera de trois cents à six cents, a douze cents et on en emploiera même quelques-uns à l’armée, les hippotoxotes ou archers à cheval. Il faut dire pourtant que l’esclave athénien n’échappait point à toutes les misères de la servitude. Les Grecs n’ayant pas ces machines qui font pour l’ouvrier moderne les plus rudes besognes, l’esclave en tenait lieu et. comme partout, il était soumis aux volontés de son maître quelles qu’elles fussent. En cas de procès, les citoyens libres, qui ne pouvaient être mis à la question,y livraient réciproquement leurs esclaves, sous prétexte d’éclairer lai justice. Prends mon esclave et qu’on le torture, dit un personnage d’Aristophane[69]. L’arsenal du tortionnaire était largement fourni de tout ce qui fait crier la chair. Que le malheureux expirât dans ce supplice, il importait peu : le maître battu au procès payait à son adversaire une indemnité pour l’esclave mort. On conte, ce serait plus odieux si ce récit était vrai, que Parrhasios, pour reproduire dans un tableau les douleurs de Prométhée, aurait fait torturer un vieux captif olynthien qu’il avait acheté[70]. Nous savons aussi que les Athéniens connaissaient les eunuques. J’aime à croire qu’ils les achetaient en Asie et qu’ils ne pratiquaient pas eux-mêmes cette coutume[71]. Toutes les femmes achetées ne restaient pas dans la famille pour tirer la laine et veiller aux soins domestiques. Leurs maîtres avaient le droit d’abuser d’elles et de tirer profit. de leurs charmes en les plaçant dans certaines maisons où le vice habite ; c’était une industrie de bon rapport. Mais si l’esclavage était la plaie hideuse de tout le inonde ancien, du moins eut-il dans Athènes ce caractère particulier d’y être moins dur qu’ailleurs ; et l’on ne peut demander aux Athéniens d’avoir fait davantage. Solon établit comme lien de sa législation la solidarité des citoyens. Ils se devaient une protection mutuelle; le témoin d’un outrage fait à un autre était obligé d’en informer aussitôt les juges; dans le cas de meurtre, les parents du mort, ou à leur défaut, ses gennètes, devaient demander aux tribunaux la punition du coupable. Enfin, pour détruire l’indifférence politique, qui dans une république est un mal mortel, il fit cette loi qui lui est particulière : Tout citoyen prendra les armes dans la guerre civile. Loi bonne dans une petite cité et chez un peuple très éclairé, parce qu’elle assure le triomphe de la majorité véritable et met aux discordes un terme plus court. Bonne encore partout, aux moments de crise, quand les questions se posent nettement entre le oui et le non. Mauvaise en un grand État dont la vie régulière ne peut être qu’une suite de concessions réciproques obtenues par la persuasion, et où la place du bon citoyen se trouve entre les passions des partis extrêmes. Lors même que l’un d’eux aurait la vérité pour lui, une grande société ne peut aller d’un bond à cette vérité nouvelle sans d’affreux déchirements qu’une transition ménagée lui épargne. Montesquieu approuve que Solon ait voulu faire rentrer le petit nombre des gens sages et tranquilles parmi les séditieux : c’est ainsi que la fermentation d’une liqueur peut être arrêtée par une seule goutte d’une autre[72]. J’ajouterai que, dans les républiques anciennes, les magistrats n’ayant pas de force armée qui les protégeât contre le coup de main d’un ambitieux, les amis des lois devaient être toujours prêts à accourir pour les défendre. Cet ami sincère de la liberté la protégea dans toutes ses manifestations. Il rendit une loi fameuse pour autoriser les citoyens ayant les mêmes intérêts à s’unir en corporations[73], et cette loi a passé dans le code romain. Solon ne crut pas avoir fait une oeuvre éternelle, il voulut que sa constitution pût céder au temps sans se rompre, au lieu de se faire briser en lui résistant. Il reconnut à l’assemblée générale le droit de décider, à la première réunion de chaque année, s’il y avait lieu de créer une commission législative, celle des nomothètes, pour introduire une loi nouvelle ou pour modifier une ancienne loi. On procédait à ces changements avec toute la solennité d’un jugement public. La proposition était affichée pour que toute la cité la connût. Cinq orateurs étaient chargés de présenter la défense de la loi qu’il s’agissait d’abroger, et la commission législative, dont les membres étaient des héliastes élus ou désignés parle sort, préparait le travail de révision à soumettre au sénat qui en délibérait, puis à l’assemblée générale qui approuvait ou rejetait. Ainsi se maintenait l’ordre et la clarté dans l’ensemble des lois. Si une disposition nouvelle portait le désordre dans la législation, les nomothètes provoquaient d’office un second examen. C’est à ces conditions qu’une constitution dure, comme toute chose dans ce monde, en se transformant avec sagesse et prudence; car la vie véritable est le mouvement, l’action, la recherche du bien, même du mieux. Il n’y a de repos absolu que dans la mort. Quand Solon eut publié sa législation, on la grava sur des rouleaux de bois tournants, dans l’Acropole, afin que le peuple les eût toujours sous les yeux. Mais il se vit assailli de tant de sollicitations, de tant de prières d’interpréter certaines de ses lois, qu’il demanda à ses concitoyens la permission de ‘s’éloigner, après avoir fait jurer aux sénateurs et aux archontes de conserver ses institutions intactes pendant dix années. C’est alors qu’il visita l’Égypte, où les prêtres lui parlèrent de l’Atlantide, cette grande île de l’Océan qui s’était abîmée sous les flots ; il vit Chypre où le roi du pays voulut qu’il fondât une ville de son nom, Soli, les côtes de l’Asie Mineure et la cour de Lydie. S’il fallait en croire une tradition qu’Hérodote nous a transmise, il aurait conversé avec Crésus. Ce fameux roi, dit l’aimable conteur, reçut Solon avec une grande distinction et le logea dans son palais. Un jour, il lui fit ouvrir les chambres où l’on gardait ses trésors, et quand l’Athénien eut tout vu : Quel est l’homme le plus heureux que vous ayez rencontré ? lui demanda-t-il. Crésus ne voulait pas être seulement le plus puissant et le plus riche des princes ; il prétendait, parce que rien n’avait été refusé à ses désirs, prendre encore pour lui seul ce trésor que les dieux accordent parfois aux plus pauvres, le bonheur. — Le plus heureux homme que j’aie connu, dit Solon, c’est Tellus d’Athènes : il a vécu dans une cité florissante ; il a eu des enfants beaux et vertueux ; et il est tombé dans une guerre, après avoir vaillamment combattu et en voyant l’ennemi repoussé par son courage. Athènes lui a rendu de grands honneurs, l’État a fait les frais de ses funérailles et de son tombeau. Crésus s’étonne et croit que Solon lui accordera au moins la seconde place. Après lui, je placerais, continue l’Athénien, deux Argiens, Cléobis et Biton, qui tous deux furent vainqueurs dans les jeux publics. Un jour que leur mère, prêtresse de Junon, devait se rendre au temple, sur un char traîné par une couple de bœufs, l’attelage manqua. Ses deus fils se mirent sous le joug et allèrent ainsi l’espace de quarante-cinq stades, au milieu des acclamations du peuple, qui louait leur piété envers les dieux et leur mère, et félicitait la prêtresse d’avoir de tels enfants. Elle, en accomplissant le sacrifice, supplia la déesse d’accorder à ses fils le plus grand bonheur qu’un mortel pût obtenir. Elle fut exaucée : ses fils s’endormirent dans le temple et ne se réveillèrent pas. Les Argiens estimèrent que Junon avait voulu les soustraire, par cette douce mort, aux misères de la vie ; ils leur dressèrent des statues qu’ils placèrent au temple de Delphes, pour consacrer à jamais leur mémoire. — Quant aux deux jeunes Argiens, un médecin d’aujourd’hui trouverait une très facile explication de leur mort ; les contemporains de Solon y voyaient un acte divin, comme dans tout ce qui les surprenait. Ces récits sont controuvés ; l’inexorable chronologie les repousse[74] et tout autant la vraisemblance historique; mais ils plaisaient à l’imagination des Grecs. Crésus et Solon représentaient, à leurs yeux, les deux civilisations contraires de l’Asie et de l’Hellade : l’une agenouillée devant ses rois et l’or ; l’autre réservant tout son amour et sa vénération au dévouement pour les dieux et la patrie. Si donc l’entrevue est fausse, il est certain que les Grecs se proposaient ce type de perfection, et qu’à force de le contempler, plusieurs l’ont réalisé. Avec leur esprit net et prompt, ils ont fait, au lieu d’une théorie discutable, une anecdote précise, et Solon méritait d’en être le héros. Bien souvent il se trouve ainsi, à côté de l’histoire réelle, une histoire idéale qui, à certains égards, n’est pas moins vraie que l’autre. Le nom de Solon est un des plus grands de l’histoire.
Action et pensée, politique et poésie, il réunit tout, et sur tout il répand
sa douce sagesse et son aimable vertu. Il nous reste bien peu de ses vers :
nous ne citerons que son Invocation aux Muses. Puisque nous cherchons
à faire l’histoire des idées et des sentiments de Brillantes filles de Mnémosyne et
de Jupiter, Muses de Rappelons encore ce mot que chacun de nous doit lui prendre : Je vieillis en apprenant toujours[76]. Mais il ajoutait, ce qui est moins sage, sauf le dernier mot : Ce que j’aime encore ce sont les dons de Cypris, de Bacchus et des Muses. |