|
I. La Laconie
; ses premiers rois
La masse confuse des montagnes de l’Arcadie se détachent
les deux chaînes du Taygète et du Parnon, qui se prolongent, vers le sud,
jusqu’aux caps Ténare et Malée que fouette souvent la tempête. Lorsque tu vas tourner le cap Azalée, disaient les
matelots, oublie ce que tu as laissé à la maison[1]. Entre ces
montagnes coule l’Eurotas qui descend en torrent jusqu’au-dessous de Sparte[2], là il rencontre
une plaine légèrement inclinée où son cours ralenti le mène plus lentement à
la mer.
Une vallée, resserrée entre les versants abrupts des
montagnes comme entre deux murailles, accidentée de collines. nombreuses et
brûlée en été par les ardeurs d’un soleil presque tropical que ne tempèrent
pas les brises marines, tandis qu’on aperçoit au-dessus de sa tête les pics
du Taygète, souvent couverts de neige : voilà le pays de la Creuse Lacédémone[3].
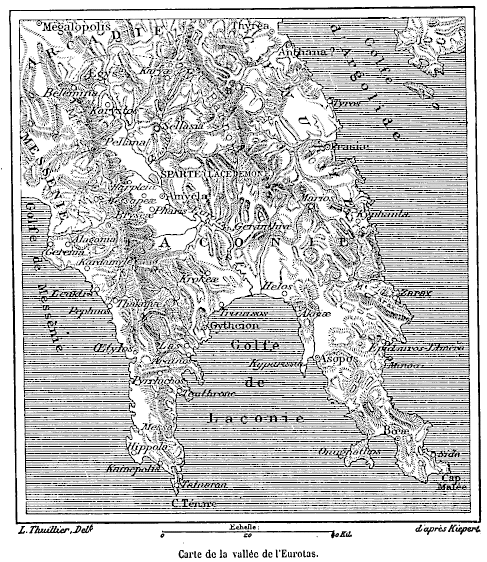
Ce pays, par sa nature et son climat, devait rendre les
hommes énergiques et durs. Il n’est pas infertile, mais ne livre ses dons qu’en
retour de pénibles travaux: c’est sur les flancs des montagnes qu’il faut
pousser la charrue, car il n’a qu’une seule plaine, délicieuse, il est vrai,
celle que baigne l’Eurotas dans son cours inférieur. Du reste, jusqu’au
sommet du Taygète, la vigne croît au milieu de forêts de platanes, et
produit, sur certains coteaux, des vins célébrés par Alcman et
Théognis ; en d’autres parties, tout près de la plus riche végétation.
on trouve un sol aride et ferrugineux.
Pour un peuple guerrier, les mines de fer de la Laconie étaient une
précieuse ressource. Le pays était aussi admirablement disposé pour porter la
guerre chez les autres sans la recevoir chez soi, véritable forteresse oit l’on
ne pouvait entrer qu’au nord-ouest, par la vallée de l’Eurotas, très facile à
défendre, et au nord-est par celle de Sellasie, presque impraticable à son
extrémité supérieure[4]. Du côté de la Messénie, il n’existait
qu’un sentier étroit et dangereux à travers le Taygète. Toutes ces routes
aboutissaient à un même point, Sparte. — Euripide peint en deux vers la Laconie : Pays riche en productions, mais difficile à
labourer ; enfermé de tous côtés par une barrière d’âpres montagnes,
presque inaccessible à l’ennemi.
Le premier roi qu’on donnait à la Laconie était un autochtone,
Lélex, ce qui veut dire qu’un peuple de ce nom avait laissé là les plus anciens
souvenirs. Certains traits de la mythologie locale rattachent ces Lélèges à l’Orient
et aux peuples navigateurs de la mer Égée. Ainsi, c’était au cap Ténare que
régnait un fils de Neptune, l’argonaute Euphémos, si léger à la course, qu’il
effleurait de ses pas la cime des vagues ; c’était sur les roches de
Thalamées qu’étaient nés les Dioscures, ces gémeaux qui, pour guider les
marins, allumaient au ciel leurs feux protecteurs avant même que le Soleil
eût éteint ses derniers rayons. Le petit-fils de Lélex, Eurotas, fit creuser
une sorte de canal pour conduire à la mer l’eau stagnante de la plaine. N’ayant
pas de postérité mâle, Eurotas donna sa fille Sparta et son royaume à
Lacédémon, fils lui-même de Taygète et de Jupiter. Telle est la facile
imagination des peuples jeunes, que quelques noms leur suffisent pour créer
tout une histoire et de longues généalogies.
Un des successeurs de ce Lacédémon, Tyndare, fut l’époux
de Léda, la mère des Dioscures, d’Hélène et de Clytemnestre. Hippocoon, son
frère, lui ayant ravi le trône, Hercule le lui rendit, à condition qu’il le
laisserait à sa mort aux Héraclides. Mais il oublia sa promesse et donna ses
États avec sa fille Hélène à l’Atride Ménélas ; Hermione, héritière de
ce prince, épousa Oreste. Sous leur fils Tisaménos, les Héraclides vinrent
réclamer le trône promis à la postérité d’Hercule. La Laconie échut par le
sort aux fils d’Aristodémos, Eurysthénès et Proclès. Comme ils étaient
jumeaux, on décida qu’ils seraient tous deux rois. La Pythie l’avait ainsi ordonné.
Ils fondèrent les deux maisons royales des Agides et des Eurypontides, qui
régnèrent simultanément à Sparte pendant plus de neuf cents ans. La branche
aînée prit le nom du fils d’Eurysthénès, Agis; la branche cadette, celui du
petit-fils de Proclès, Eurypon[5].
Les nouveaux maîtres de la Laconie, au lieu de se
disperser dans les campagnes, se concentrèrent en un lieu semé de collines
faciles à défendre, à Sparte, afin de se tenir en garde contre toute
surprise. Ils avaient d’abord laissé leurs lois aux anciens habitants ;
sous le règne d’Eurysthénès, les .Laconiens jouirent même de l’égalité avec
les conquérants. Mais Agis retira cette concession. Les Doriens ou Spartiates
eurent seuls des droits politiques ; les Laconiens, devenus leurs sujets, n’eurent
que des droits civils. La plupart acceptèrent ce changement de condition ;
les habitants d’Hélos, qui le repoussèrent, furent vaincus et réduits en
servitude. Tous ceux qui les imitèrent eurent un pareil sort.
Tel est le récit ordinaire. On a déjà vu que les Doriens n’occupèrent
d’abord que la haute vallée de l’Eurotas, par où ils étaient venus. Pausanias
parle de la longue résistance de plusieurs cités, de Géronthrées, de Pharis
et surtout d’Amyclées, l’antique capitale des rois achéens, qui ne fut prise
que sous le règne de Téléclès, une génération avant la première olympiade. L’existence
de deux rois dans une même cité fait soupçonner la réunion de deux peuples
dans une même ville ; ainsi en arriva-t-il à Rome sous Romulus et Tatius.
Les Doriens avaient sans doute été contraints de faire cette concession aux
Achéens. De là ces deux rois qui conservaient quelques prérogatives de la
royauté héroïque, mais qui, contrairement à la tradition, n’étaient point de
la même famille, puisqu’ils ne mêlèrent jamais leur sang ni leurs tombeaux.
Un jour, à Athènes, on refusait à l’Agide Cléomène l’entrée du temple de
Minerve, parce qu’il était de race dorienne : Non,
répondit-il, je suis Achéen (Hérodote, V, 72).
Les Spartiates n’avaient pas le vif et mobile esprit des
hommes de l’Ionie. Essentiellement conservateurs, ils gardèrent leur double
royauté, même quand elle ne répondit plus à une nécessité politique, c’est-à-dire
après la soumission de toute la Laconie. Ils eurent alors le caractère de race
dominante et oppressive qui provoqua des haines dont ils ne purent contenir l’explosion
que par une continuelle vigilance, et ils s’en imposèrent la nécessité en ne
s’enfermant point derrière des murailles. Sparte fut une ville ouverte et son
peuple resta toujours sous les armes, astreint à une sévère discipline, comme
une armée campée en pays ennemi. Les Spartiates formèrent seuls l’État ;
seuls ils eurent le droit d’assister aux assemblées où se faisaient les lois
et d’aspirer aux charges publiques. Au-dessous d’eux étaient leurs sujets :
dans les bourgs de la plaine ou dans ceux du Taygète, les Laconiens propriétaires de leurs
champs, mais astreints à payer aux rois des redevances ; dans les
campagnes, les Hilotes, esclaves de la glèbe, condamnés à labourer
pour leurs maîtres.
Les deux premiers rois, Eurysthénès et Proclès, vécurent
en perpétuelle mésintelligence. Rien n’était plus propre à affaiblir leur pouvoir,
mais ce fut cette faiblesse qui le sauva. L’aristocratie dorienne garda cette
double royauté, nécessairement inoffensive, comme les patriciens de Rome
eurent deux consuls pour n’avoir pas un maître. A l’exemple des deux maisons
régnantes, toutes les ramilles se divisèrent ; l’égalité établie après
la conquête par un premier partage des terres disparut dans les fortunes
comme dans les conditions, et même parmi la race dominante, il y eut des
oppresseurs et des opprimés, des riches et des pauvres. De là des secousses
qui ébranlèrent l’État et chassèrent du pays quelques-uns des conquérants. Un
petit-fils de Tisaménos, Théras, conduisit une colonie dans l’île qui prit
son nom; d’autres allèrent se fixer à l’ouest du Péloponnèse, dans la Triphylie. Cependant,
malgré ces discordes, Sparte, dans la vigueur de la sève barbare, trouva le
moyen de faire des conquêtes ; elle attaqua les Cynuriens, qui pillaient
tour à tour l’Argolide et la
Laconie, et les chassa de leur territoire. Les Argiens
ayant voulu s’emparer de ce petit pays, elle se tourna contre eux et les
battit. Ce fut l’origine d’une querelle qui dura plusieurs siècles.
Cette situation des conquérants de la Laconie, entourés d’ennemis
au milieu de leur conquête et menacés sur leurs frontières par des peuples
belliqueux, leur imposait l’obligation de vivre étroitement unis. Des
dissensions intestines pouvaient compromettre cette discipline et augmenter
le péril extérieur. Lycurgue se donna la tâche de la raffermir, en resserrant
les liens qui enchaînaient les citoyens à l’État.

II. Lycurgue et ses lois
Il y a sur Lycurgue comme sur ses lois des incertitudes
que la critique moderne n’a pu dissiper ; ce qui va suivre tient donc
plus de la tradition que de l’histoire ; il en est de même pour la
plupart des faits antérieurs aux guerres Médiques[6].
On croit que Lycurgue naquit dans le neuvième siècle[7], du roi Eunomos.
Son père, en voulant séparer des gens qui se battaient, reçut un coup de
couteau dont il mourut. Son frère aîné, Polydectès, eut de même une fin
prématurée et Lycurgue fut roi tant qu’on ignora la grossesse de la reine, sa
belle-sœur; celle-ci lui offrit de faire périr l’enfant qu’elle portait dans
son sein, à condition qu’il l’épouserait. Il trompa ses désirs coupables et
sauva le fils de son frère. Les grands, irrités de la sagesse de son
administration pendant la minorité du jeune Charilaos, le forcèrent à s’exiler.
Il voyagea longtemps pour converser avec les sages et étudier les coutumes
des nations étrangères. Dans l’île de Crète, il se fit instruire des lois de
Minos par le poète Thalétas qui chantait ses vers sur la lyre, et il l’appela
ensuite à Sparte pour qu’il l’aidât à apaiser les esprits. De l’Asie Mineure
il n’emporta que les poésies d’Homère ; mais les prêtres égyptiens le
comptèrent parmi leurs disciples. Les Spartiates des derniers temps voulaient
qu’il fût allé jusque dans l’Inde interroger l’antique sagesse des brahmes,
et visiter ces lieux, berceau du jour, d’où il semblait aux anciens que
devait sortir toute lumière. C’étaient de bien grands et difficiles voyages
pour les hommes de ce temps ; Lycurgue ne les a point faits, et les
prêtres de l’Égypte ou de l’Inde ne lui ont rien appris.
Le rapport des institutions de Sparte avec celles de la Crète est évident. La
division en esclaves, en vaincus de condition libre et en conquérants, le
partage de ces derniers en trois tribus, les repas publics, l’influence des
vieillards, et un sénat d’anciens se retrouvent dans cette île. Mais ils
existaient chez tous les peuples doriens, par suite d’usages communs à la
race entière et de nécessités politiques provenant de situations analogues.
Lycurgue n’inventa donc point sa législation, pas plus qu’il ne l’importa
toute faite des pays étrangers, car les lois qui durent naissent des moeurs,
et ce n’est qu’ensuite que les législateurs les rédigent. Il fit revivre et
coordonna d’anciennes coutumes, précisa ce qui était vague, compléta ce qui
était imparfait, et forma d’éléments épars, mais vivaces, un corps de lois rigoureusement
enchaînées.
A son retour, après une absence que l’on fait durer
dix-huit ans, Lycurgue trouva la ville pleine de troubles; le peuple sentait
lui-même le besoin d’une réforme. Le moment était donc favorable. Afin d’ajouter
â l’autorité de son nom celui d’Apollon Delphien, le dieu national des
Doriens, il consulta l’oracle sur ses projets. La Pythie le salua du nom d’ami
de Jupiter.
Fort de l’appui du dieu, gagné ou complice, il commença
par intéresser à ses desseins un parti nombreux et puissant, de sorte qu’il
pût compter au besoin sur la force pour l’aire accepter ses lois. Charilaos
était un de ses plus zélés partisans.
Tous les maux de Sparte provenaient de l’anarchie qu’enfantaient
l’extrême richesse des uns et l’extrême pauvreté des autres, mises face à
face et se déchirant sous les yeux des vaincus, qui espéraient sans doute
profiter de ces discordes pour briser un joug détesté. Le mal dont l’État se
mourait étant l’inégalité, Lycurgue prétendit le guérir par l’égalité.
Au lendemain de l’invasion, les Doriens avaient, suivant l’usage,
partagé entre eux, par le sort, les terres conquises. Mais l’égalité des
lots, Ylrpo5, avait été bien vite troublée; Lycurgue se proposa de la
rétablir en renouvelant cette vieille coutume agraire. Il divisa les terres
réservées aux Spartiates en portions égales. Suivant Plutarque, il partagea la Laconie en 39.000 parts,
dont 30.000 pour les Laconiens et 9.000 pour les Spartiates ; celles-ci
beaucoup plus considérables que celles-là et comprenant les meilleures terres
du pays, mais à peu près égales entre elles, sinon pour l’étendue, du moins pour
la valeur et les revenus[8].
Les personnes formaient trois classes : Spartiates,
Provinciaux ou Périèques, Hilotes. Les Spartiates, le
peuple souverain, étaient les descendants des conquérants doriens ; ils
vivaient réunis à Sparte et s’appelaient les égaux, οί
δυοιοι. Les Provinciaux ou Périèques
étaient les anciens Achéens qui n’avaient pas fui avec Tisaménos vers l’Égialée,
les étrangers qui avaient accompagné les conquérants, même des -Doriens qu’une
cause ou une autre, l’impossibilité, par exemple, de donner ce que chacun
devait fournir pour les repas publics, avait fait tomber du rang des
citoyens.
Le Spartiate et l’Hilote ne peuvent être séparés ;
ils se complètent l’un l’autre.
Les Laconiens ou Provinciaux qu’on nommait les Périèques, ceux qui habitent autour de la cité sans y être compris,
cultivaient les flancs des montagnes et les bords de la mer. Ils occupaient
les cent villes de la Laconie,
misérables hameaux, pour la plupart représentés, à Sparte, par une hécatombe
annuelle. Ils n’avaient point de droits politiques, étaient soumis pour l’administration
de leurs communes à la surveillance des Spartiates, devaient un tribut, la
moitié, probablement, du produit de leurs terres[9], et le service
militaire ; 10.000 combattront à Platée, à côté des 5.000 Spartiates, et
Léonidas en aura 700 aux Thermopyles. Les éphores, et sans doute avant eux
les rois, avaient le droit de les faire exécuter sans jugement[10]. Leur situation
était cependant adoucie par certains avantages : s’ils n’avaient pas les
droits des Spartiates, ils n’étaient pas condamnés à leurs mœurs austères, l’industrie
et le commerce, dédaignés par les conquérants, leur appartenaient ; c’était
peu de chose, car tout luxe était interdit aux Spartiates, mais ils
trouvaient une ressource dans la magnificence que l’État déployait pour ses
temples et ses solennités. Même au dehors, on recherchait certains produits
de leur industrie. Brasidas montra dans ses expéditions loin du Péloponnèse
quels services ils pouvaient rendre ; quand Sparte eut des flottes, ils
en formèrent les équipages. Ces services et la richesse qui ne leur était pas
interdite permirent à quelques-uns d’entre eux de s’élever aux dignités. On
prétend que Lysandre, Callicratidas et Gylippos étaient de cette classe ;
il est certain que plusieurs des vainqueurs d’Olympie et quelques artistes en
faisaient partie. Avant la guerre du Péloponnèse toute trace physique d’une
différence originelle entre les Périèques et les Spartiates s’était effacée.
Tous parlaient dorien, quoique les lignes de démarcation politique fussent
sévèrement maintenues.
Il ne faut pas chercher à Lacédémone la politique qui fut
une des causes actives de là fortune de Rome : la facile concession du droit
de cité. Tout l’esprit de sa constitution y était contraire. Hérodote assure
que deux hommes seulement obtinrent ce titre : le devin Tisaménos et son
frère Hégias. Tisaménos, à qui l’oracle de Delphes avait promis de grands
succès, se trouvait dans l’armée des Grecs à Platée. Les Spartiates, très
superstitieux surtout à l’égard de leur dieu national, Apollon, voulurent que
cet homme prédestiné devint un des leurs, pour partager avec lui sa fortune.
Le devin n’y consentit qu’à la condition que son frère fut fait aussi citoyen
de Sparte[11].
Toute aristocratie fermée est destinée à périr; attendons-nous donc à voir
Sparte tomber faute d’hommes, 61Lyxvarix, dit Polybe.
On a vu l’origine des Hilotes. Ils étaient en plus grand
nombre que les esclaves d’aucune autre cité grecque, et ils représentaient l’esclavage
dans sa forme la plus complète[12]. Cette servitude
est double; l’Hilote a deux maîtres : le Spartiate, dont il cultive la terre,
et l’État ; il appartient à tous et à un seul. Sa volonté et sa vie sont
dans les mains de Sparte, qui de l’une et de l’autre fait ce qui lui plait.
Mais une limite est imposée à la puissance du maître ; il ne peut ni
tuer ni vendre hors du pays ses Hilotes, qui restent attachés à la terré
comme le seront les serfs du moyen âge ; cette position fixe est même
pour eux la source d’un certain bien-être. Comme le Spartiate a un régime de
vie simple et invariable, il se borne à exiger des Hilotes qui cultivent sa
terre une redevance en nature toujours la même, suffisante pour le nourrir
lui et les siens : au delà, il ne demande rien, et ce qui reste des
produits demeure à l’esclave, qui peut s’en former un pécule et se rendre
plus douces les conditions matérielles de la vie. L’espoir de la liberté rte
lui est pas non plus à jamais interdit : il peut s’y élever par l’affranchissement
et mériter l’affranchissement par des services à l’intérieur ou par son
courage dans la guerre, car l’État l’emploie à ses travaux et souvent l’appelle
à l’honneur de combattre pour la commune patrie. Les Hilotes affranchis
formaient la classe des Néodamodes. Cette position n’aurait pas été
intolérable, et le mot d’Hilote ne serait pas devenu l’expression de tout ce
qu’il y a de plus affreux dans l’esclavage, si leur condition eût été
simplement telle que nous venons de la décrire. Mais cette classe active,
industrieuse, nombreuse surtout, tenait les Spartiates en de continuelles
alarmes. Il est dangereux à l’esclave de faire peur à son maître. Sparte eut
contre les siens un code plus atroce que notre code noir. D’abord elle les
dégrada ; un vêtement, qu’ils ne pouvaient quitter, servait à les
reconnaître ; défense leur était faite de chanter les hymnes guerriers
des Spartiates ; et pour se faire un jeu de leurs vices, ou v trouver
une leçon que ceux-ci estimaient bonne à donner aux enfants, ils forçaient
des Hilotes à s’enivrer. De plus, chose horrible ! Sparte affaiblissait
cette classe redoutée en lui tirant du sang. Chaque année, à en croire
certains récits, on lâchait sur les Hilotes les jeunes Spartiates armés de
poignards pour leur faire la main et les habituer au sang. Tous les malheureux
qui, passé une certaine heure, étaient trouvés sur les routes, tombaient
égorgés ; cette chasse aux hommes avait un nom officiel, elle s’appelait
la cryptie. Quelquefois, au lieu de se faire en détail, l’exécution se
faisait en masse. Thucydide raconte qu’à une certaine époque, Sparte ayant quelques raisons de redouter une insurrection
des Hilotes, invita par déclaration publique tous ceux qui, par leurs
services passés, croyaient avoir mérité d’être affranchis, à venir réclamer
la récompense à laquelle ils avaient droit. Les plus braves et les plus
ambitieux de liberté se présentèrent; sur le nombre total, deux mille furent
choisis comme les plus dignes ; dans leur joie, ils se réunirent, la
tête couronnée de fleurs, autour des temples, afin de remercier les dieux.
Peu de temps après, les Lacédémoniens les firent disparaître. On ne sut point
quel avait été leur sort, mais on ne les revit jamais. Ce fait,
rapporté sans aucune hésitation par un historien qui n’est point hostile aux
Spartiates, force de croire qu’il n’y a pas trop d’exagération dans ce que
les anciens nous disent de la cryptie. Un habile critique (M. Wallon, Recherches sur la cryptie) ne
voit dans cette étrange institution qu’une loi de couvre-feu comme il en a
été tant de fois rendu, une mesure de police contre les vagabondages et les
réunions nocturnes ; ici, seulement, avec une pénalité atroce. L’explication
est bonne ; Sparte, en effet, ainsi qu’une place forte assiégée, avait besoin
pour se défendre de plus dures rigueurs que n’en ont jamais établi les lois
militaires. Aristote, que l’on n’accusera pas de tendresse pour les esclaves,
disait : Les traitements barbares infligés aux
Hilotes en font autant d’ennemis et de conspirateurs (Pol., II, 7) ;
aussi conspiraient-ils sans cesse. On les verra profiter de tous les périls
de Lacédémone[13].
Le Spartiate n’est pas complet sans l’Hilote. Il combat, s’exerce
ou délibère ; mais dès qu’il a quitté le camp, le plataniste ou le
conseil, son labeur est fini et il a tout le loisir qu’Aristote exigeait pour
le citoyen parfait. Afin de le mieux garder toujours prêt à son service, la
cité lui interdit, même alors qu’elle ne lui demande rien, toute occupation
domestique ; il faut donc que l’Hilote travaille pour lui et le
nourrisse, en lui donnant la moitié du produit de ses terres. Supprimez l’Hilote,
et il n’y a plus de Spartiates, car les lois de Lycurgue tomberont dès que la
hache et la bêche remplaceront la lance dans la main de ses Doriens, dès qu’ils
oublieront la guerre pour l’agriculture et le commerce. Le labeur des uns est
la conséquence du loisir des autres. Voilà comment cet esclavage resta jusqu’au
dernier jour la condition nécessaire de l’existence même de Sparte ; il
s’aggrava à mesure que Sparte fléchissant devint plus soupçonneuse. Mais le
Spartiate ne garde lui-même son titre et son rang qu’à deux conditions : il
faut qu’il se soumette à la sévère discipline de Lycurgue et qu’il fournisse
ce que la loi exige de lui pour les repas publics. S’il ne remplit pas ses
obligations, il est destitué de ses droits. Tout Spartiate a une part assurée
dans le gouvernement, comme roi, comme sénateur, ou comme simple citoyen. En
effet le gouvernement de Sparte est démocratique, c’est-à-dire que les
Spartiates, considérés seuls, forment une société d’égaux; mais si vous
considérez tout l’empire de Sparte, c’est une aristocratie qui tourne même à
l’oligarchie, tant il y a disproportion entre la masse des habitants du pays
et le nombre, relativement fort petit, de ceux qui gouvernent[14].
J’ai dit que tous les Spartiates étaient égaux. Lycurgue
voulut encore qu’ils fussent étroitement unis par une sorte de fraternité d’armes.
Il les divisa ou plutôt conserva la division en trois tribus sœurs :
Hylléens, Dymanes, Pamphyliens, qui ne se distinguaient entre elles que par l’unique
privilège qu’avait la première de posséder les familles royales. Chaque tribu
fut partagée en 10 sections appelées obées, subdivisées chacune en 30 triacides,
en tout 30 obées et 900 triacades. Chaque triacade comprenait 10
familles ; on trouve ainsi le nombre de 9.000, qui était celui des lots
de terre destinés aux Spartiates et des citoyens en état de porter les armes.
Chaque mois, à la nouvelle lune, se réunissait l’assemblée
publique un Héraclide n’y avait pas plus d’influence légale que le dernier
des citoyens. Cette assemblée votait sans délibérer, par oui ou par non, sur
les propositions qui lui étaient présentées par les magistrats. Ce n’est que
plus tard que s’introduisit l’usage de la discussion et des amendements :
encore fallut-il que l’orateur obtint des magistrats l’autorisation de
parler. Plus tard aussi il y eut la petite et la grande assemblée ; la
première se réunissait pour nommer les magistrats et les prêtres, la seconde
pour régler les grandes questions, comme la paix et la guerre, les
changements à la constitution, la succession au trône vacant.
Au-dessus de cette assemblée fut placé un sénat dans la
véritable acception du mot, γερουσία.
Il était d’institution démocratique, puisqu’on ne demandait à ses membres ni
condition de naissance ni condition de fortune ; il avait cependant
quelque chose d’aristocratique : on exigeait un cens d’années : il fallait,
pour y entrer, avoir 60 ans. A cause de cette condition qui n’y laissait
accès qu’aux vieillards, ce sénat eut un esprit particulier qui se retrouve
dans la politique habituelle de Sparte où domine la lenteur, la
circonspection, une prudence souvent excessive et une égale méfiance à l’égard
des hommes et de la fortune.
Le sénat se composait de 30 membres pris dans les 30 obées.
De ce nombre étaient les rois qui représentaient chacun leur obée et n’avaient
du reste d’autre privilège que celui d’une voix prépondérante accordée au roi
Agide. Le sénat délibérait sur les propositions à présenter à l’assemblée,
jugeait au criminel et exerçait une partie des fonctions censoriales qui
furent ensuite envahies par les éphores. Ses membres étaient élus d’une
singulière façon : on faisait défiler tour à tour les candidats devant le
peuple, qui saluait chacun d’eux par des acclamations plus ou moins fortes.
Des vieillards, enfermés dans une chambre, voisine, d’où ils ne pouvaient
rien voir, notaient ceux qui avaient obtenu les plus fortes acclamations, et
ceux-là étaient déclarés sénateurs. Nommés à vie, ils étaient inamovibles et
irresponsables, ce qui contribuait à leur donner un caractère aristocratique,
rien n’étant plus contraire à la démocratie qu’une fonction politique
conférée en viager, et qu’une assemblée dont les membres ne rentrent pas, au
bout d’un certain temps, dans la foule.
Les deux rois, qui ne devaient avoir aucune infirmité
corporelle, furent maintenus. On vient de voir dans quelles étroites limites
se renfermait leur influence, soit au sénat, soit à l’assemblée : c’était à
peu près celle qu’avaient eue les rois de l’âge héroïque; en gardant ce
caractère, la royauté se sauva à Sparte, alors qu’elle succombait partout ailleurs.
Soumis au même régime et aux mêmes costumes que les simples citoyens, ils ne
se distinguent de ceux-ci que par des prérogatives dont quelques-unes rappellent
la royauté des anciens jours. Ils commandent l’armée, où une garde de cent
hommes les suit, et, hors de la
Laconie, ils exercent un pouvoir à peu près absolu[15] ; ce qui
les rend très partisans de toute guerre, puisqu’ils sont affranchis au camp des
entraves qui les gênent dans la cité. Si leurs prérogatives publiques sont
faibles, le peuple respecte profondément en eux les descendants d’Hercule, et
attache une idée religieuse au maintien de leur maison et de leur titre.
Sparte croyait pouvoir compter sur l’appui des dieux tant qu’elle aurait des
Héraclides à sa tête. Aussi ont-ils la garde des oracles et sont-ils, avec
les officiers pythiens attachés à leur personne, les intermédiaires entre la
cité et le temple de Delphes. Le premier et le septième jour de chaque mois l’État
leur donne une victime; car, prêtres de Jupiter, ils lui sacrifient, dans les
cérémonies publiques, au nom de tous les citoyens; mais ils doivent offrir ce
sacrifice dès la pointe du jour, afin d’être les
premiers à obtenir la bienveillance du dieu, qui lui semblait devoir
céder, comme un roi débonnaire, aux instances du plus empressé des
solliciteurs. A chaque portée de truie, il leur appartient un porc, afin qu’ils
ne manquent pas d’offrandes lorsqu’il faut consulter la volonté des dieux, ce
qu’on fait à Lacédémone plus fréquemment qu’ailleurs[16] : et, aux
repas, ils ont double portion, par honneur et pour qu’ils puissent envoyer de
leur table à ceux qu’ils voudraient distinguer, mais aussi pour que, mangeant
davantage, ils soient dans le combat les plus forts[17]. On se tient
debout en présence du roi, excepté les éphores, qui demeurent assis, et à
tout sacrifice public fait par un citoyen, ils ont la place la plus
honorable. Chaque mois ils renouvellent le serment d’être fidèles aux lois de
la république. Leur mort amène un deuil public de dix jours ; leur
avènement, des fêtes et une remise de toutes dettes pour les débiteurs de l’État.
Ces prérogatives sont des honneurs, non du pouvoir; on a
même pris soin qu’ils n’aient pas la tentation d’y rien changer. Les rois de
l’âge héroïque se cantonnaient dans une forteresse d’où ils bravaient au besoin
les ressentiments populaires ; ceux de Sparte habitèrent en des maisons
tout ouvertes comme celles des particuliers. Aussi Hérodote ne trouve point
que Sparte ait un gouvernement monarchique, et Aristote n’y voit qu’une
aristocratie[18].
Je ne dis rien ici des éphores qu’on retrouve chez d’autres
peuples doriens, et dont les attributions, fort obscures et restreintes sans
doute dans l’origine à la surveillance des marchés, devaient s’accroître considérablement
jusqu’à forcer les rois, dit Polybe, à les respecter comme leurs pères. Ils étaient au
nombre de cinq et annuellement élus, d’une manière bizarre, qui permettait au
dernier des citoyens d’arriver à ce poste. Leur création est placée par
Aristote un siècle après Lycurgue, sous les rois Théopompos et Polydoros. Il
en sera parlé plus tard (Pol.,
V, 2).
Jusqu’à présent on n’a rien vu qui appartienne
exclusivement à Lycurgue ou à Sparte. Les intentions du législateur
paraissent mieux dans les institutions relatives à la vie privée. Le principe
qui les domine est celui de toute l’antiquité : le citoyen naît et vit pour l’État
: son temps, ses forces, ses facultés lui sont dus. Mais nulle part ce principe
ne fut pratiqué avec autant de rigueur qu’à Sparte. Lycurgue y ramena
sévèrement toutes les vieilles coutumes qui pouvaient s’y prêter et toutes
les innovations qu’il introduisit. Il dénatura l’homme,
dit Rousseau, pour renforcer en lui le citoyen.
Il avait fait une répartition égale des terres, mais ne
conféra pas aux Spartiates tous les droits que donne la propriété. On
pourrait dire qu’il n’existait réellement pas de propriétaires à Sparte, car
ce qui constitue par essence la propriété, c’est le droit de disposer de son
bien, et le Spartiate n’a pas cette liberté. Comme chez les Hébreux, les lots
de terre sont incommutables. La loi juive permettait d’aliéner le lot, sauf à
rétablir les choses dans le premier état, quand venait le jubilé. A Lacédémone,
toute aliénation de patrimoine fit défendue; un Spartiate n’avait le droit ni
de vendre ni d’acheter de la terre. Le père ne pouvait même diviser son
héritage. Ce n’est qu’au quatrième siècle[19] qu’il lui fut
permis d’en disposer par testament : il fallait qu’il laissât son xλήρος, ou lot primitif, à
son fils aîné, son héritier nécessaire, et, à défaut de mâle, à sa fille
aînée. C’était ce que nos lois modernes appellent un majorat ou une terre
substituée.
Ainsi, la liberté du citoyen, comme propriétaire, est
considérablement atteinte, mais l’immobilité est assurée à l’état des terres.
Elle l’est aussi à l’état de la population, par certaines
mesures qui doivent maintenir au même niveau le nombre des citoyens. La
grande préoccupation des législateurs et des politiques de l’antiquité est de
conserver la cité dans son cadre, sans lui permettre jamais de rester en deçà
ou de s’étendre au delà. A l’excès de citoyens, Lycurgue remédie par l’exposition
des enfants faibles ou mal conformés. Mais, chez un petit peuple guerrier, où
tout citoyen est soldat et sert, les combats suffisent, et de reste, pour
limiter la population, et l’on doit bien plutôt songer à l’empêcher de s’épuiser
. le législateur y pourvoit par les peines portées contre le célibat, et par
l’espèce de déshonneur qui atteint les citoyens sans enfants. Un jour
Dercyllidas, général de grande réputation, se présente à une assemblée : un
jeune Lacédémonien ne se lève point à son approche, comme c’était l’usage. le
vieux guerrier s’en étonne. Tu n’as point d’enfants,
dit le jeune homme, qui puissent un jour me rendre
le même honneur. Personne ne le blâma. Plus tard, le gouvernement
accorda des récompenses aux citoyens qui avaient le plus d’enfants, et il
favorisa les adoptions et les mariages entre les riches héritières et les
citoyens pauvres. Les rois qui devaient sanctionner toutes les adoptions et
qui disposaient de la main des orphelines, quand le père n’avait pas fait
connaître sa volonté, purent aussi, pendant quelque temps, sauver de l’indigence
un citoyen utile et empêcher l’accumulation des richesses dans les mêmes
mains.
Tout citoyen doit donc à la patrie des enfants. Celui dont
l’union est stérile peut prêter sa femme et remplir ainsi l’obligation de
donner à la patrie de futurs soldats, c’est si bien une dette que les enfants
appartiennent plus à la cité qu’au père. En sortant du sein de sa mère, le
jeune Spartiate tombe dans les mains de l’État ; le père doit l’aller
exposer dans la Lesché,
lieu de réunion des vieillards. En vain il voudrait sauver son fils : si les
vieillards le trouvent faible ou mal constitué, il est précipité du sommet du
Taygète, et le pauvre petit est puni de mort au premier jour de sa vie parce
qu’il ne promet pas un assez robuste guerrier. Cruel et monstrueux usage que
des philosophes et des politiques, à commencer par Platon et Aristote, acceptaient
comme une nécessité !
Après cette terrible inspection sur ceux qui doivent être
ses membres, l’État rend le fils à sa mère et le lui laisse jusqu’à sept ans;
à cet âge, il le reprend pour ne plus le lâcher, et la vie de l’enfant n’est
depuis ce moment qu’un long apprentissage de la patience, de la sobriété,
même de la douleur. Il est aussitôt classé dans les bandes que des
instituteurs, choisis parmi les jeunes hommes les plus braves, dirigent sous
la surveillance d’un magistrat appelé pédonome. On les exerce à la
palestre, à la course, au maniement des armes, à tout ce qui peut donner à
leur corps force et agilité ; à leur âme, courage et patience. Vous trouverez difficilement, dit Xénophon, des hommes mieux constitués et plus souples de corps que
les Spartiates : ils exercent avec un même soin et le cou, et les mains, et
les jambes. Point de chaussures ; même vêtement été comme hiver ;
pour lit, des roseaux coupés par eux-mêmes dans l’Eurotas : peu de
nourriture, afin de les forcer à dérober par ruse et adresse de quoi
satisfaire leur appétit. Il est étrange de voir ainsi enseigner le
vol ; mais, à cause de la communauté qui unit les Spartiates, ce n’est
point un vol véritable. Celui qui se laisse prendre est châtié, non comme
coupable, mais comme maladroit. A la guerre, ils se souviendront, pour
dépister l’ennemi, des ruses qu’enfants ils auront pratiquées pour trouver
leur nourriture. Un d’eux avait volé un jeune renard; voyant venir quelqu’un,
il le cacha sous sa robe, et aima mieux se laisser ronger le ventre et les
entrailles, sans pousser un seul cri, que de se trahir. Pour les endurcir à
la souffrance, on les soumettait à de rudes épreuves, comme font encore les
Indiens du nouveau monde ; ils étaient battus de verges devant l’autel
de Diane, et c’était à qui supporterait le mieux la douleur et mériterait le
titre de vainqueur de l’autel, βωμονίxης :
on en vit expirer sous les coups, sans qu’un gémissement eût décelé leurs
souffrances[20].
A ces exercices il s’en mêlait d’une autre sorte : on leur apprenait à jouer
de la flûte et de la lyre, à chanter des hymnes sacrés ou des poésies guerrières.
Homère, Tyrtée et toute poésie virile qui élève et fortifie l’âme étaient
fort en honneur; mais les vers d’Alcée, qui avait honteusement chanté sa
fuite et son bouclier laissé à l’ennemi, étaient proscrits. Après le
dévouement à la patrie, la vertu qu’on leur enseignait le plus était le
respect de la vieillesse : rien n’était plus nécessaire dans une cité où presque
tous les magistrats étaient des vieillards, et où la loi, qui ne fut pas
écrite, devait s’exprimer par la bouche des anciens. Il leur semblait obéir
aux dieux en honorant ceux que la
Divinité avait jugés dignes d’une longue vie. Un jour, au
théâtre d’Athènes un vieillard cherchait une place parmi la foule et
parcourait les bancs, repoussé des uns, raillé des autres ; des députés
lacédémoniens l’aperçurent, et, se levant de leurs sièges, lui firent signe
de venir prendre place au milieu d’eux ; on applaudit : Je vois bien, dit le vieillard, que les Athéniens savent ce qui est beau ; mais les Lacédémoniens
seuls le pratiquent.
A vingt ans, le jeune homme était admis dans l’armée et
faisait le service soit à l’intérieur, soit au dehors. A trente, il devenait
époux et exerçait ses droits de citoyen, mais en restant soumis à toute la
sévérité de la discipline spartiate. A soixante, sa carrière militaire était
finie, il s’occupait alors de l’administration des affaires publiques et de l’éducation
des enfants.
L’éducation des Lacédémoniennes était à peine moins dure.
Au lieu de les condamner à l’existence sédentaire au fond d’un gynécée,
Lycurgue remit aux femmes esclaves le soin de filer la laine et de préparer
les vêtements[21] ;
quant aux jeunes Spartiates, il voulut qu’elles se missent en état de donner
un jour de robustes enfants à la patrie.
Il établit pour elles, comme pour les hommes, des
exercices du corps, des courses, des luttes, qui les rendaient saines et
fortes. Les Phainomérides s’y livraient sous les yeux des citoyens, presque
sans autre voile que leur vertu[22], jusqu’à la
vingtième année, âge habituel du mariage. Alors commençaient les soins
domestiques qui leur laissaient une grande liberté, sans que les moeurs en
souffrissent, parce qu’elles vivaient sous les yeux de tous et qu’elles ne
cherchaient point à amollir l’austérité farouche de la cité. Cette éducation,
qui élevait leurs sentiments et leur courage, leur assura longtemps une
influence enviée par les autres femmes de la Grèce. Vous autres Lacédémoniennes, vous êtes les seules qui
commandiez aux hommes, disait une étrangère à la femme de Léonidas. — C’est que nous sommes les seules, répondit-elle, qui mettions au monde des hommes.
Sparte voulait être l’unique objet de l’affection de ses
enfants; afin de n’en rien perdre, elle avait, par ses lois, détruit l’amour
du père pour le fils, du mari pour l’épouse. Il était honteux qu’un homme se
laissât voir dans la compagnie de sa femme et d’être aperçu entrant chez elle
ou en sortant[23].
Aussi la déesse des douces voluptés était bannie de Lacédémone. Aphrodite y
avait un temple pourtant : c’était celui de Vénus, armée non de ses grâces,
mais du glaive, et représentée assise, avec un voile sur là tête et des fers
aux pieds (Pausanias,
III, 15, 11).
Cependant la vie de famille existait à Sparte, comme dans
toute la Grèce
: chaque famille avait son foyer, son dieu domestique et son tombeau[24]. La femme
Spartiate était traitée avec respect, et elle montra souvent, aux beaux jours
de Lacédémone, une grandeur de caractère, qui fait d’elle la digne rivale de
la matrone romaine. Elle est bien courte,
disait un jeune soldat à sa mère en lui montrant son épée. — Fais un pas de plus, répondit-elle. Une autre
donnant le bouclier à son fils pour une expédition lui dit : Reviens dessus ou dessous, c’est-à-dire : Tue ou sois tué ; mais point de déshonneur ;
mieux vaut la mort. Une autre, Démænéta, envoie ses huit fils au
combat ; tous y restent. Elle ne répand pas une larme, mais dit : Sparte, je te les avais donnés afin qu’ils pussent mourir
pour toi !
Lycurgue voulut que les Spartiates eussent des mœurs austères.
Point de luxe ; il y mit bon ordre par sa lourde monnaie de fer, dont on
ne pouvait transporter la plus petite somme que sur des chariots[25], et qui n’avait point
cours au dehors. Mais si Lacédémone ne frappait pas de monnaie d’or[26], elle en recevra
beaucoup quand elle sera devenue puissante, et la vénalité spartiate
laissera, dans l’histoire de la
Grèce, des exemples fameux. Comme Lycurgue chassait le
luxe, il chassa le commerce qui l’amène à sa suite. Les étrangers auraient
apporté des idées nouvelles : l’entrée de Sparte leur fut interdite, excepté
à certains jours. Un Spartiate ne pouvait, non plus, voyager sans la
permission des magistrats, et il y avait peine de mort pour celui qui s’établissait
en pays étranger : c’était un déserteur.
II tendit au même but par l’institution des repas en
commun auxquels tout Spartiate, même les rois, était tenu d’assister sous
peine de perdre ses droits politiques, à moins que l’absent n’eût l’excuse d’un
sacrifice ou d’une chasse prolongée qui promettait aux convives un présent
pour le festin. Ces repas, appelés phidities, étaient sobres[27], chacun fournissait
une part égale de farine d’orge, de vin, de froment, de figues et une légère
contribution pour les assaisonnements ou la viande. On ne pouvait y ajouter
que le produit de la chasse ou une portion des victimes immolées aux dieux.
Celui qui était trop pauvre pour rien apporter était exclu des tables et
déchu de ses droits de citoyen. Leur mets favori, par lequel commençait le
repas, était ce brouet noir qui fit faire la grimacé à Denys de Syracuse. Il y manque vraiment quelque chose, dit le cuisinier
qui le lui avait apprêté. — Et quoi donc ?
— De vous être baigné dans l’Eurotas. Les
vieillards assistaient à ces repas ainsi que les enfants : on y racontait
avec éloge les belles actions, on y flétrissait les actions honteuses, on s’y
exerçait à une raillerie agréable et piquante[28].
Cet usage entretenait parmi les Spartiates une confraternité
dont s’étonneraient quelques-uns de nos plus hardis utopistes qui, si souvent,
prennent pour des nouveautés d’antiques, mais fort peu vénérables,
vieilleries. Celle-ci, mauvaise à tant d’égards, avait pourtant un avantage.
Des convives d’une même table devenaient, en temps de guerre, les soldats d’une
même section, de sorte que chacun, combattant sous les yeux de ses amis, en
avait plus d’ardeur (Denys,
II, 23).
Tout citoyen pouvait châtier les enfants d’autrui. En cas
de besoin, il était permis d’emprunter les esclaves d’un voisin, ses chiens
de chasse, ses chevaux, à condition de tout remettre dans le même état et à
la même place. Les Spartiates poussèrent même quelquefois l’abnégation du
propriétaire jusqu’à des conséquences que Xénophon admire beaucoup et qui
répugneraient singulièrement à nos idées sur la sainteté des liens de famille[29].
Hormis la guerre et les exercices par lesquels il s’y
prépare, les seules occupations du Spartiate sont la chasse et la
conversation dans les lieux publics, où il s’habitue à cette façon de parler
brève et sentencieuse qu’on a appelée le laconisme. Aux tables communes,
on se dédommageait de cette réserve apprêtée : on y parlait librement, mais
rien de ce qui s’y disait ne devait transpirer au dehors. Celui qui présidait
au repas répétait souvent aux convives, en leur montrant la porte : Par là, pas un mot ne doit sortir.
Une fois quitte de ses devoirs envers la patrie, comme le
Spartiate méprise l’industrie, le commerce et tout travail manuel, comme il
ne se soucie pas plus de philosophie que de beaux-arts et de littérature,
bien qu’on lui apprenne quelques vers et un peu de musique[30], il jouit de
cette oisiveté qui lui semble l’apanage de l’homme libre. On raconte qu’un
Spartiate, se trouvant à Athènes, apprit qu’un citoyen de cette ville venait
d’être condamné à l’amende pour cause d’oisiveté. Il s’étonna fort et demanda
à voir celui qu’on punissait pour s’être conduit en homme, par le juste
mépris qu’il montrait pour des travaux serviles.
Cette uniformité de vie ne donnait pas aux Spartiates l’esprit
souple, ingénieux, hardi, plein de ressources et promptement familier avec l’inconnu,
que les Athéniens durent à un mélange harmonieux d’exercices physiques et de
culture intellectuelle. Aristote les trouve grossiers, Isocrate est bien près
de les appeler des barbares[31], et leur
histoire les montre très superstitieux. C’était le cas de beaucoup d’autres ;
mais ils l’étaient à l’excès : mauvaise disposition pour la bonne
conduite de la vie, puisque c’est la sagesse remise au hasard et la
soumission de la volonté à de prétendues puissances surnaturelles. Ils s’embarrassaient
pour peu de chose. Cela se remarque même à la guerre : un siège, la mer,
tout ce dont ils n’ont pas l’habitude les déroute. A Platée, il leur faut attendre
les Athéniens pour forcer les retranchements de Mardonius ; les sièges
qu’ils entreprennent ont une durée homérique, Ira, Ithôme.
L’organisation militaire des Spartiates a fait, dans l’antiquité,
l’admiration d’hommes très compétents, tels que Thucydide et Xénophon. Une
discipline rigoureuse fortifiée par le sentiment de l’honneur, une hiérarchie
qui, allant du roi au simple chef de file, assurait la régularité des
mouvements, une ordonnance avec une cohésion que le bataillon sacré des
Thébains et la phalange macédonienne auront seuls à un degré supérieur,
enfin, l’aspect imposant de ces beaux hommes aux traits graves et immobiles,
de ces rangs hérissés de piques, de ces vêtements écarlates que portent les
guerriers, de leurs casques et de leurs boucliers d’airain au sombre éclat,
de leurs bataillons qui s’avancent au son des flûtes, d’un pas lent ou
pressé, que rien n’arrête, tout cela arrache à Xénophon ce cri d’enthousiasme
: Vous croiriez que la seule république de Sparte a
produit de vrais guerriers, tandis que l’art militaire est resté dans l’enfance
chez la plupart des nations. Celles-ci avaient bien des citoyens qui,
à l’occasion, devenaient des soldats ; Sparte seule posséda ce que nous
appellerions une armée régulière et permanente qui lui eût soumis la Grèce entière, si cette
ambition, qu’elle conçut après Ægos-Potamos, lui était venue avant Marathon.
Platon disait de Sparte qu’elle était moins une ville qu’une armée campée
sous la tente.
Cependant on prétend que Lycurgue chercha à modérer l’esprit
belliqueux des Spartiates, qu’il leur défendit de faite la guerre pendant
certaines fêtes, et qu’il établit des trêves sacrées. Il leur donna du moins
pour la guerre quelques maximes fort sages ; en voici plusieurs : Ne pas faire longtemps la guerre au même peuple, pour
ne pas lui apprendre à la bien faire. — Ne pas
poursuivre trop loin l’ennemi vaincu : c’est lâche et quelquefois
dangereux. — Ne pas dépouiller les morts avant la
fin du combat : c’est imprudent.
La constitution de Lycurgue était surtout propre à faire
des héros, et elle en fit. Servir la patrie et mourir pour elle, voilà la
plus grande ambition des Spartiates. Victoire ou mort ! était leur cri
de guerre ; l’honneur était leur loi suprême. Ce
qui mérite d’être admiré dans Lycurgue, dit Xénophon, c’est d’avoir su faire préférer une belle mort à une vie
déshonorée. Ce grand législateur a pourvu au bonheur de l’homme brave et a
dévoué le lâche à l’infamie. Dans les autres républiques, quand un homme est
lâche. on se contente de lui en donner le nom ; du reste, il délibère sur la
place publique avec l’homme brave, il s’assied prés de lui, il lutte avec lui.
A Lacédémone, on rougirait de manger avec un lâche, de toucher ses armes ou
sa main; au jeu de paume, les deux camps le repoussent. La dernière place
dans les salles de danse et dans les spectacles est la sienne. Dans les rues,
il cède le haut du pavé à de plus jeunes que lui. Ses filles partagent sa
flétrissure ; elles sont exclues des repas publics et ne peuvent trouver
d’époux. On lui fait mille outrages. Vêtu de haillons, la barbe rasée d’un
côté, il est frappé impunément par ceux qui ne l’évitent pas avec horreur. D’après
cela, faut-il s’étonner qu’à Sparte on préfère la mort à une vie condamnée à l’opprobre
et à l’infamie ?
Je n’ai pas encore parlé d’une autre singularité : Sparte
n’avait pas de murs. Pleins de confiance dans leur courage, pleins de mépris
pour leurs sujets, ils n’avaient pas cru nécessaire d’ajouter à la force des
collines où ils avaient établi leur principale demeure. Des fortifications
qui, d’ailleurs, n’auraient enveloppé qu’un petit espace. auraient séparé une
partie du peuple de l’autre et peut-être porté atteinte à la commune égalité.
Ils estimèrent que les remparts de Sparte étaient le Taygète, les monts d’Arcadie,
la mer et surtout, ce que le poète préfère aux plus solides murailles, de
vaillantes poitrines. L’événement montra qu’ils avaient raison.
Ce ne fut pas sans orages que Lycurgue parvint à établir
sa constitution. Quand il voulut introduire la frugalité avec les repas en
commun, les riches, habitués déjà au luxe et à la débauche, firent une
sédition et voulurent le lapider; ils le poursuivirent jusque dans nu temple
et le blessèrent : il eut un oeil crevé. Le patriotisme pourtant et le
sentiment des dangers que courait la cité à la suite de ces divisions l’emportèrent
: les lois furent acceptées.
On raconte qu’après les avoir vu adopter, il fit jurer aux
rois, aux sénateurs, à tous les citoyens, de n’y rien changer jusqu’à son
retour. Puis, s’éloignant, il alla consulter l’oracle d’Apollon. Le dieu
répondit que Sparte effacerait la gloire de toute autre cité tant qu’elle
conserverait ses lois. Lycurgue envoya cet oracle à Lacédémone, fit un
nouveau sacrifice, embrassa ses amis et son fils, et, pour ne pas dégager ses
concitoyens de leur serment, se laissa mourir de faim.
Le meilleur commentaire des lois de Lycurgue est l’histoire
de Sparte; qu’on la lise, l’arbre sera jugé par ses fruits.
Lycurgue, et je réunis sous son nom toutes les lois dont
il vient d’être parlé sans examiner si toutes lui appartiennent, Lycurgue
avait tout combiné avec une rare sagacité pour rendre Sparte immuable et sa
constitution immortelle. Mais il y a un grand ennemi des choses de ce monde
qui veulent être éternelles, ce vieillard à tête chauve et à barbe blanche
que l’antiquité armait d’une faux. Les législateurs n’aiment pas plus que les
poètes à compter avec lui ; ils disent volontiers qu’ils ont bâti un
édifice plus solide que l’airain : le temps marche, tout s’écroule[32]. Sparte le brava
pendant des siècles, mais parce qu’elle sacrifia davantage la liberté de ses
citoyens’ qu’elle tint sous la plus rude discipline. Elle a longtemps duré;
elle n’a pas vécu. Dès que cette constitution inflexible et, à certains
égards, immorale, qui était établie en dehors des conditions habituelles des
sociétés, fut ébranlée, sa décadence fut rapide, irrévocable.
Lycurgue avait voulu immobiliser l’homme et la terre, le
nombre et la fortune des citoyens; et à la fin, il n’y eut pas de cité où la
terre fût plus mobile, la condition des citoyens plus diverse, leur nombre
plus réduit[33].
Il avait singulièrement amoindri les droits de la
propriété individuelle pour fortifier le pouvoir de l’État ; et Aristote
dit : À Sparte, l’État est pauvre, le
particulier riche et cupide.
Il avait méconnu les lois de la nature dans le sort et l’éducation
des femmes, et Aristote, accusant leurs mœurs, leur avidité, même leur
courage, voit dans leur licence une des causes de la chute de Lacédémone.
Il mit les Hilotes sous la terreur; ils la renvoyèrent à
leurs maîtres.
Il défendit les longues guerres, mais il avait rendu la
guerre attrayante en délivrant le soldat des règles sévères imposées au
citoyen ; et ce fut par la guerre, par la victoire que sa république
périt.
Il ôta toute liberté d’action à ses concitoyens; il
assigna à chaque instant de leur vie son emploi; enfin, pour parler comme
Rousseau, qui s’entendait, lui aussi, en paradoxes politiques : Ses lois dénaturèrent l’homme pour renforcer en lui le
citoyen ; et Sparte, devenue une cité révolutionnaire, mourut faute d’hommes ;
όλιγανδρα[34].
Il avait proscrit l’or et l’argent, pour proscrire la
corruption ; et nulle part, depuis les guerres Médiques, la vénalité ne
fut si ordinaire, si éhontée.
Il bannit les arts[35], excepté pour
son temple d’Apollon à Amyclées; en cela il réussit. Pausanias cite bien cinquante
temples à Lacédémone, mais il n’en reste pas une pierre. C’est qu’une piété
rustique, et non point l’art, les avait construits. Si l’on met à part un
certain goût pour la musique, la danse et une poésie sévère, Sparte resta une
cité barbare au milieu de la
Grèce, un point sombre dans la lumière; elle ne connut même
pas bien le seul art qu’elle pratiquât, la guerre; du moins en ignora-t-elle
toujours certaines parties.
Aristote l’a dit : faite pour la guerre, Lacédémone se
rouilla dans la paix, comme une épée dans le fourreau. Toutes ses institutions
lui apprenaient à se battre, aucune à vivre de la vie de l’esprit. Vertu
égoïste et farouche, elle a pu contenter l’orgueil de ses enfants et gagner
les éloges de ceux qui admirent la force et le succès ; mais qu’a-t-elle
fait pour le monde ? Machine de guerre bonne pour détruire, incapable de
produire, qu’a-t-elle laissé ? Pas un artiste, pas un homme de génie,
pas même une ruine qui porte son nom, tant elle est bien morte tout entière,
comme Thucydide l’avait prédit (Hist., I, 10), tandis qu’Athènes, si calomniée par les
rhéteurs de tous les âges, montre encore les ruines majestueuses de ses
temples, où l’art moderne des deux mondes vient chercher l’inspiration, comme
nous cherchons dans ses poètes, dans ses philosophes, l’éternelle beauté.
Au résumé, et c’est la leçon qu’il faut tirer de cette
histoire Lycurgue eut beau décréter pour Sparte l’égalité des biens, qui est
contraire aux conditions de la nature comme à celles de la société, nulle
part, en Grèce, les inégalités sociales ne furent aussi grandes[36]. Mais de sa
discipline, il subsista longtemps quelque chose, et ce fut elle qui valut à
Lacédémone sa puissance et sa renommée, car cette singulière ordonnance
sociale frappa les autres peuples d’étonnement.
Les Spartiates ont aussi donné un grand exemple de
sobriété et de mépris pour les passions, la douleur et la mort. Ils savaient
obéir et mourir. La loi était pour eux, suivant la belle expression de
Pindare et de Montaigne, « la reine et impératrice du monde[37] ».
Reconnaissons-leur encore une vertu qui les honore, le respect pour ceux à
qui les années ont mis sur la tête la couronne de cheveux blancs.
Le poète aristocratique de la Béotie, qui, comme un
autre Dorien, Théognis de Mégare, haïssait la foule populaire, eut de l’admiration
pour la cité où régnait, sous des rois héréditaires,
la sagesse des vieillards et les lances des jeunes hommes, les choeurs de la
muse et la douce harmonie. Simonide vit mieux ce qui fit la grandeur
de Sparte : il appelait Lacédémone la ville qui
dompte les hommes (Plutarque, Agés., 1). Cet empire sur soi-même donne
habituellement l’empire sur les autres, et, longtemps, les Spartiates les ont
eus tous les deux.
|