|
I. La Grèce
préhistorique
Eschyle, qui, à titre de grand poète, est un voyant,
décrit avec une étrange fidélité la vie des premiers hommes, avant que
Prométhée leur eût apporté le feu et les arts : Dans
le principe, les hommes avaient des yeux, et ils ne voyaient pas, des
oreilles, et ils n’entendaient point. Durant des milliers d’années, tout
resta pour eux confus et brouillé ; ils étaient comme les fantômes qui
flottent en nos songes. Ni maisons de briques ouvertes au soleil ni
charpentes; pour abris, des trous où, comme la fourmi au corps allongé, ils
se glissaient au fond des grottes sombres[2]. C’est bien
l’homme des cavernes que nous n’avons reconnu que depuis une trentaine
d’années. Homère en parle de même dans l’Odyssée[3] ; ses
Cyclopes habitent des grottes au sommet des monts. Ils n’ont ni outils pour
travailler la terre, ni navires aux proues rouges
pour porter les denrées aux villes des hommes.
Point de chevaux ; seulement des brebis et des chèvres ; pas même
de dieux. Lorsque Ulysse réclame de Polyphème l’hospitalité, au nom de Zeus protecteur des suppliants, le cyclope répond : De Zeus, je n’ai nul souci, et pas davantage de vos dieux
immortels.
La littérature classique a gardé comme un écho de ce
premier âge du monde, qui subsiste encore pour quantité de peuples sauvages,
et Lucrèce semble avoir pressenti quelques-uns des résultats de l’archéologie
préhistorique lorsqu’il a tracé le tableau des mœurs primitives. Si l’on
dépouillait Hercule de l’auréole divine que les poètes lui ont donnée, le
rude lutteur parcourant la
Grèce, armé de sa massue et couvert d’une peau de lion,
serait encore le représentant de ces premiers hommes qui ont commencé la
lutte contre les fauves et préparé, sur la terre, la place pour une humanité
moins malheureuse.
Le problème des origines de la population hellénique a
été, en ces derniers temps, compliqué plutôt qu’éclairci par le résultat de
fouilles exécutées dans la
Grèce et ses îles ; car elles ont révélé l’existence
d’hommes ayant déjà parcouru plusieurs étapes de civilisation, depuis les
silex taillés jusqu’à des oeuvres d’un art délicat. On a même reconnu
quelques-unes de leurs demeures sous d’énormes amoncellements de ruines,
comme à Hissarlik, et sous d’épaisses couches de lave, comme à Santorin. Les
géologues font remonter jusqu’à vingt siècles au moins avant J.-C.
l’effroyable cataclysme qui, secouant cette île comme un chêne fouetté par
l’ouragan, en a précipité une partie dans un abîme profond de 400 mètres, tandis
qu’une autre était soulevée jusqu’à une hauteur de 800 mètres (le mont Saint-Élie)[4]. Dans cette
Pompeï de la Grèce
antélégendaire, on a recueilli des armes et des instruments en silex, des
poids en lave, des vases en terre cuite faits au tour, et couverts de dessins
grossiers, etc. Il existait donc à Santorin, deux mille ans avant notre ère,
des hommes qui possédaient les premiers éléments de la civilisation et qui
trafiquaient avec les îles voisines.
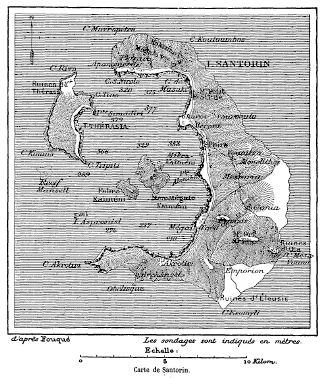
Hérodote commence ainsi son histoire : Les hommes les plus instruits parmi les Perses disent que
les Phéniciens ont été les premiers auteurs de l’inimitié entre la Grèce et les Barbares.
Adonnés à la navigation, ils transportaient les productions de l’Égypte et de
la Syrie chez
les autres nations. Dans une de leurs expéditions, ils abordèrent à Argos et
étalèrent sur le rivage leur chargement ; ils l’avaient presque
entièrement vendu, lorsque, le cinquième ou le sixième jour après leur
arrivée, plusieurs femmes, et parmi elles Io, fille du roi Inachos,
s’approchèrent des navires pour acheter quelques marchandises. Les Phéniciens
se jetèrent sur elles, enlevèrent Io avec ses compagnes et les conduisirent
en Égypte[5].
Voilà le commerce ancien, celui que nous avons fait
longtemps sur les côtes d’Afrique, et l’ancienne piraterie, comme naguère on
exerçait la traite à la côte de Guinée[6].
L’enlèvement d’Io n’a pas été, ainsi que le dit le bon
vieil historien, la cause de la guerre de Troie; mais le récit d’Hérodote est
le souvenir de relations anciennement établies par les Phéniciens au pourtour
du grand lac grec que forme la mer Égée. Les Assyriens, eux aussi, ces
premiers-nés de la civilisation occidentale, avaient touché les bords de
cette mer, en portant leur domination et quelques-uns de leurs arts jusque
dans la Lydie;
à leur tour, les Grecs préhistoriques en visitaient les rivages asiatiques,
et il a dû se trouver des Pélasgo-Ioniens parmi ces
peuples de la mer qui envahirent l’Égypte au dix-septième siècle. Des
deux parts, on enlevait des captifs, qui apportaient dans leur nouvelle
patrie des arts, des croyances et des dieux. Au palais de Priam, dans
l’Ithaque d’Ulysse, le grand voyageur, on voit des Sidoniennes occupées à de
merveilleux ouvrages de broderie. La piraterie et le commerce mêlaient les
trois mondes entre lesquels courent les flots de l’archipel et de la mer de
Syrie[7]. On en a la
preuve par le résultat des fouilles faites en ces dernières années à
Hissarlik, Santorin, Ialysos, Spata, Knossos, et qui ont révélé une Grèce
antérieure à la Grèce
d’Homère.
A Hissarlik, la petite forteresse,
sur un plateau long de 470
mètres, large de 140, moins grand par conséquent que
l’aire de l’Acropole d’Athènes, M. Schliemann a cru retrouver Troie, qui
était peut-être plus loin, à Bounarbachi[8]. La pioche de ses
ouvriers y a rencontré, en traversant 16 mètres de décombres,
les débris de plusieurs villes successivement détruites et rebâties. Le mode
des plus anciennes constructions ressemble à celui des maisons préhistoriques
de Santorin et des villages de l’Asie Mineure décrits dans l’Anabase de
Xénophon. On a exhumé de ce vieux sol beaucoup d’instruments de pierre, mais
aussi du bronze dont l’étain venait de bien loin, et des objets en métaux
précieux, que M. Schliemann a appelés le Trésor de Priam. Ils avaient dû être
achetés en Lydie, où le Pactole charriait des paillettes d’or[9]. Comme dans ces
débris rien ne rappelle l’art phénicien, ni les terres émaillées, les
scarabées avec hiéroglyphes et la faïence d’Égypte, que l’on rencontre à
Mycènes, à Ialysos, dans l’île de Rhodes, et à Spata, près d’Athènes; comme
enfin on ne voit sur les vases les plus anciens que l’ornement géométrique,
dans ce qu’il a de plus rudimentaire, et quelques essais très grossiers
d’imitation de la figure humaine sur les vases dits à tête de chouette, il
faut admettre que la première civilisation d’Hissarlik représente une époque
antérieure à celle de Santorin et de Mycènes ; mais on peut y voir la
civilisation primitive de l’Orient hellénique.
La seconde étape est marquée par les objets découverts à
Santorin.
Cette île, autrefois ronde et qui n’a plus aujourd’hui que
la forme d’un croissant, fut ébranlée, à l’époque que nous avons marquée plus
haut, par une effroyable éruption volcanique. Toute la partie centrale
s’effondra et fut remplacée par un gouffre où la sonde descend à 400 mètres, tandis
qu’une couche de ponce, épaisse de 30 mètres, recouvrait ce qui restait de
l’île. C’est sous ce linceul qu’on a découvert les habitations des victimes
et les débris d’une industrie avancée : des vases contenant de l’orge
carbonisée et de la paille hachée pour la nourriture des moutons et des
chèvres dont les squelettes gisaient à côté ; des meules, des moulins à
huile, des poids de 250, 750 et 3 kilogrammes environ, progression qui
suppose un système régulier de mesures ; des enduits colorés qui
recouvraient les murs[10] ; l’emploi
de la chaux et de la pouzzolane- pour ciment, et partout des dessins et des
figures, qui montrent d’abord le goût de l’ornementation géométrique, puis
celui de la décoration florale et maritime, enfin un certain sentiment de
l’esthétique.
Ces poteries révèlent des relations avec les plus
anciennes populations de Rhodes, de Chypre, de Milo et de la Grèce continentale, par
conséquent un commerce déjà actif.
La ville rhodienne d’Ialysos, qui se trouvait au voisinage
des grands foyers de la civilisation égyptienne et orientale, a un art plus
avancé et probablement plus récent qui relie les types de Santorin à ceux de
Mycènes.
Les heureuses fouilles faites dans cette dernière ville
par M. Schliemann ont été une autre révélation. Si l’on ne peut affirmer
qu’il a réellement retrouvé, ainsi qu’il le croit, le corps d’Agamemnon, il a
mis au jour des sépultures royales où les morts portent des masques d’or et
avaient des vêtements, des armes, qui attestent la richesse d’un puissant
royaume. Les vases ont des formes et des dessins qui rappellent ceux de
Santorin et d’Ialysos, mais avec un tour de main plus habile ; et des
fragments de porcelaine égyptienne, des bagues, des pierres gravées, un oeuf
d’autruche orné de dessins, attestent des rapports avec l’Égypte et l’Assyrie
par l’intermédiaire des Phéniciens.
Malheureusement les tombes de Spata, près d’Athènes,
avaient été violées avant qu’on les retrouvât en 1877. Les débris laissés par
les maraudeurs : objets en ivoire, pâtes de verre semblables â celles
d’Ialysos, bijoux recouverts d’une feuille d’or, représentation du lotus et
du sphinx, tête tout orientale coiffée d’une mitre conique, suffisent
cependant à faire reconnaître que, dans l’Attique des anciens jours,
l’influence orientale fut plus grande que dans l’Argolide.
Ces découvertes, qui sont d’hier, mais qui vont
certainement se multiplier, montrent les vieilles nations de l’Asie et de
l’Égypte éveillant en Grèce la vie civilisée d’un nouveau peuple. C’est le
fait que la géographie indiquait, que l’archéologie confirme et que
l’histoire doit retenir[11].

II. Les Pélasges et les Ioniens
Des hommes qui habitaient Santorin dix ou douze siècles
avant Isomère, notes ne saurions rien dire, l’archéologie préhistorique
n’ayant point d’inscriptions qui révèlent l’origine de ces peuplades par le
caractère de leur langue. Il nous faut donc passer par-dessus ces temps
qu’enveloppe une obscurité profonde pour interroger une autre science, la
philologie, et d’autres hommes, les poètes et les logographes.
On a vu, au chapitre précédent, que la Grèce est, pour ainsi
dire, réunie à l’Asie par une foule de péninsules et d’îles qui vont comme à
la rencontre du grand continent oriental ; ajoutez qu’une race, au fond
la même, s’est assise sur ces beaux rivages, et que les relations rendues
nécessaires par la nature des lieux furent facilitées par la similitude des
idiomes et des moeurs. Ces pays n’ont même jamais changé d’habitants : depuis
les jours de Priam, la race hellénique est restée en possession de son
patrimoine ; car les Turcs, chassés de la Grèce, sont campés sur les
côtes de la Thrace,
plutôt qu’ils n’en ont pris fortement possession. La tente d’Osman y est
déployée, mais qui peut dire qu’un ouragan ne l’emportera pas ?
Qu’était cette race ? Les Grecs ne connaissaient pas
leurs aïeux et se croyaient nés du sol, autochtones. La question d’origine
est pour toutes les populations primitives très difficile à résoudre, car
elles existent durant des siècles avant d’avoir une histoire. Une seule
science peut entrer dans ces ténèbres, une lumière à la main, la philologie.
L’étude comparée des langues a révélé que les Indiens, les Perses, les Grecs,
les Italiens, les Celtes, les Germains et les Slaves ont eu des ancêtres
communs, dont la Bactriane
et les pays voisins étaient le berceau. Quelques efforts en sens contraire
n’ont pu encore détruire cette révélation de l’unité originelle de la race
aryane[12].
Les Grecs sont donc un rameau de la grande race
indo-européenne. Mais une foule de peuples établis sur les côtes de l’Asie
Mineure et dans la péninsule orientale de l’Europe, sous des dénominations
bien différentes, ont droit de revendiquer ce nom illustre, soit parce que
leurs descendants directs l’ont porté à Salamine et à Platée, à Sparte et à
Athènes, à Milet et à Syracuse ; soit parce que, sans être entrés jamais
dans le cercle brillant de la vie hellénique, ils ont eu cependant dans leurs
veines le sang, et sur leurs lèvres l’idiome des Hellènes.
Aux premières lueurs, bien vacillantes encore, que
l’histoire ou, plutôt, que la poésie projette sur ces vieux âges, se montre
perdu dans la nuit des temps un grand peuple, les Pélasges, qui semble avoir
couvert l’Asie Mineure, la
Grèce et une partie de l’Italie, où il laissa sa langue,
qui a formé le grec et le latin, et ses dieux, que les Hellènes et les
Italiotes adoptèrent[13]. Le plus ancien
oracle de la Grèce
était celui de Jupiter dodonéen, qu’Homère appelle le Pélasgique. Dans les
anciennes traditions, ces Pélasges sont divisés en une multitude de tribus
qui formaient peut-être, au sud du Danube, entre l’Adriatique et la nier
Noire, trois groupes principaux, les ILLYRIENS, les THRACES et les PÉLASGES, que nous appellerons HELLÉNIQUES pour les
distinguer de ceux qui passèrent en Italie. Tous les peuples établis dans ces
régions paraissent en effet avoir eu, à l’origine, d’étroits rapports. Dans
les légendes, ils sont fréquemment associés, et bien des divinités qu’ont
adorées les premiers peuples de la
Grèce semblent être venues par la Macédoine et la Thessalie.
Les Illyriens s’étendirent le long de la côte orientale de
l’Adriatique, depuis l’Épire jusqu’aux bouches du Pô, et sur les rivages
opposés de l’Italie. Les Dardaniens s’arrêtèrent aux frontières de la Macédoine ; les
Pannoniens, plus au nord, étaient de cette race, dont il ne reste qu’un
faible débris, les Albanais ou Arnautes de l’empire turc[14]. L’Épire était
le point de contact des deux populations illyrienne et pélasgico-hellénique.
Les Thraces, dit Hérodote[15], sont, après les
Indiens, la plus grande de toutes les nations. S’ils n’avaient eu qu’un chef,
ou s’ils avaient su s’entendre, ils eussent été invincibles. Ils habitaient à
l’orient des Illyriens et dans l’Asie Mineure, où les Phrygiens, les Mysiens
et les Bithyniens étaient de leur sang. Il paraît qu’un rameau de ce peuple
s’étendit à travers la
Macédoine jusque dans la Piérie, où il serait arrivé à un développement
relativement avancé de civilisation, et d’où il exerça une influence
considérable sur la Grèce.
Il honorait Arès, le dieu des combats, figuré par un fer de
lance ou un glaive sanglant[16], et Hermès, le
dieu des pâtres, pour qui l’on entassait les pierres en monceaux au bord des
chemins. Les dieux de la Grèce
lui sont arrivés de deux côtés, par mer dans le Sud, par terre dans le Nord,
et il n’est pas toujours facile de reconnaître quel courant apporta telle
légende et tel dieu. De la
Thrace paraissent être venues :
Les Muses, chastes déesses, nées dans la Piérie macédonienne, mais
dont Hésiode croyait entendre les chœurs gracieux sur l’Hélicon de
Béotie ;
Jupiter, que les Grecs faisaient siéger au-dessus des
nuages qui couvrent la cime de l’Olympe ;
Apollon, divinité asiatique qui, par certains rites de ses
fêtes, se rattache aux pays du Nord ;
Bacchus, enfin, ou Dionysos, qui eut des adorateurs dans la Thrace et la Macédoine bien
longtemps avant d’en avoir dans la Grèce. On faisait naître encore parmi les
Thraces d’anciens poètes : Orphée, Musée et Eumolpos. Homère ne connaît pas
ces premiers chantres de la
Grèce, qui n’ont sans doute nulle réalité historique[17], mais il nomme
Thamyris, le musicien thrace qui osa défier les Muses au combat du chant et
qu’elles punirent de sa défaite en brisant sa lyre et en lui ôtant la voix.
A une époque postérieure, quand la Grèce avait déjà la
plupart de ses peuples, ces Thraces pénétrèrent, dit-on, avec leurs dieux et
leurs légendes jusqu’à Daulis, dans la Phocide, oit les poètes plaçaient la tragique
histoire de Philomèle, et celle du festin sanglant de Térée, un de leurs rois[18] ; ils se
seraient établis sur les pentes de l’Hélicon, où l’on montrait le tombeau
d’Orphée et le temple des Muses, peut-être même jusque dans l’Attique, où ils
auraient institué, à Éleusis, le culte de Cérès[19]. Les Athéniens
prétendaient avoir sur une de leurs collines le tombeau de Musée.
Contre ces poétiques traditions s’élèvent les récits
d’Hérodote sur les Thraces de son temps. Les Gètes,
dit-il, sont les plus nobles et les plus justes des
Thraces, et ils se croient immortels parce qu’ils s’imaginent que celui
qu’ils perdent ne meurt pas, mais va retrouver leur dieu Zalmoxis. Tous les
cinq ans, ils tirent au sort quelqu’un de leur nation et l’envoient auprès de
Zalmoxis porter de leurs nouvelles et représenter leurs besoins. Voici
comment se fait la députation. Trois d’entre eux sont chargés de tenir chacun
un javelot la pointe en haut, tandis que d’autres saisissent par les pieds et
par les mains celui qu’on envoie à Zalmoxis. Ils le mettent en branle et le
lancent en l’air de façon qu’il retombe sur la pointe des javelines. S’il
meurt de ses blessures, ils croient que la divinité leur est propice; s’il
n’en meurt pas, ils l’accusent d’être un méchant. Quand ils sont las de lui
faire des reproches, ils en députent un autre vers leur dieu, de la même
manière, et lui donnent aussi leurs ordres, tandis qu’il est encore en vie[20]. Ce récit ne
montre pas des mœurs bien douces, mais il attesterait que les Gètes avaient
sur l’immortalité de l’âme une plus ferme croyance que celle des Grecs aux
anciens jours, et l’on s’étonnera moins de voir arriver plus tard de la Thrace les idées qui
formeront le fond de l’orphisme[21].
Quant aux tribus qui peuplèrent la Grèce proprement dite,
elles sont connues sous les noms fameux de Pélasges et d’Hellènes, les
premiers précédant les seconds, et ceux-ci héritant de ceux-là, que peu à peu
ils chassent, exterminent, ou absorbent, de manière à rester seuls maîtres du
pays : révolution lente, qui n’est pas encore pleinement accomplie au temps
d’Homère.
Les Grecs désignaient, sous la dénomination générale de PÉLASGES, les
peuplades qui les avaient précédés sur le sol de la Hellade. Mais ils
avaient aussi pour chacune d’elles des noms particuliers, ceux de Dryopes
ou hommes des forêts, de Lélèges ou troupes choisies
(?), de Caucones qui laissèrent leur nom à une partie de l’Élide, de Lapithes,
de Perrhèbes, qui avaient un sanctuaire dodonéen avec ses chênes
sacrés sur l’Olympe, de Phlégyens, d’Aones, de Hyantes,
etc.
D’après les traditions et les probabilités historiques,
mais sans aucune certitude, on peut dire que les Pélasges helléniques
descendirent des régions du Nord, dans la Grèce. Après avoir
traversé la Thrace
et la Macédoine,
ils occupèrent l’Épire et la
Thessalie ; de là ils gagnèrent, de proche en proche, la Grèce centrale et le
Péloponnèse, où l’Attique et l’Arcadie passèrent pour avoir donné naissance à
toute la race. Dans les îles, qu’ils occupèrent aussi, ils durent admettre au
partage les Curètes, les Corybantes, les Dactyles Idéens
et les Telchines, qui leur apprirent à travailler les métaux. Mais
ceux qu’on désigne sous ces noms étaient moins des tribus étrangères que des
colonies de Pélasges ou d’Hellènes asiatiques plus avancés en civilisation,
et qui apportaient leur industrie et des notions religieuses plus développées
à leurs frères restés barbares, dans leur long voyage autour de la mer Égée.
Ces peuples disparurent de bonne heure, et leur nom ne subsista que pour
désigner les prêtres de certains dieux. Peut-être ne furent-ils jamais autre
chose.

III. Renseignements préhistoriques fournis par les légendes
Quelle confiance faut-il accorder aux légendes conservées
par les poètes ou recueillies par les écrivains des âges postérieurs ?
Comme la mer joue, le long de ses rivages, avec les
rochers que la falaise lui jette ; comme elle les roule incessamment
sous ses flots, les use et les brise, ou les transforme en les couvrant de
toutes les richesses de la double vie qu’elle peut faire éclore, ainsi
l’imagination des peuples et la fantaisie des poètes jouent avec les noms et
les faits que la tradition leur apporte, les divisent ou les unissent, les
mélangent d’éléments étrangers ou les enveloppent des plus riches parures :
et l’histoire se perd sous la fiction. Lorsqu’à cette puissance créatrice de
l’imagination populaire, qui ne se plaît qu’aux récits merveilleux, succède
la réflexion, qui remplace la foi au surnaturel par l’analyse patiente et la
comparaison des faits; quand la critique, en un mot, veut interpréter les
particularités de la légende et expliquer les traditions des vieux âges,
alors naît le chaos des systèmes. A ne voir que les détails, on reste dans
l’incertitude ; à regarder l’ensemble, on peut découvrir une vérité
générale et suffisante.
L’histoire doit donc étudier ces légendes par le motif qui
vient d’être dit, et aussi par un autre : c’est que la Grèce a vécu de ces
fictions, et qu’elles ont inspiré ses artistes et ses poètes, qui ont
transmis aux générations les plus reculées des types que nous retrouvons
partout autour de nous. Si les littératures modernes parlent moins qu’au
siècle dernier d’Apollon, des Muses et des Nymphes, les peintres et les
sculpteurs n’ont encore oublié ni Homère ni Phidias, qui ont consacré, l’un
par ses vers, l’autre par le marbre ou le bronze, les grandes aventures des
héros et des dieux.
La vérité générale que révèlent les récits relatifs aux
plus anciens temps de la Grèce
nous semble être l’existence d’une période pélasgico-ionienne qui vit la
formation des premières villes ainsi que des premiers cultes, et où étaient
déjà unis par des liens étroits le continent grec et cette côte asiatique
entre lesquels les îles de la mer Égée s’élevaient comme les arches brisées
d’un pont. L’histoire répond ainsi à la géographie.
Les rivages orientaux de la Grèce ont été, en effet,
dés les plus anciens jours, visités par les peuples des rives opposées de
l’Asie, qui s’avançaient sans crainte sur cette mer pacifique où chaque soir
une île donnait refuge à leurs vaisseaux. A l’occident, les côtes de l’Élide
et de la Messénie
sont bien autrement fertiles : c’est pourtant à celles d’Argos et d’Athènes
que se sont attachées les plus anciennes légendes, preuve certaine que la vie
s’y est éveillée d’abord. Les Grecs des âges postérieurs trouvant ce fait
dans leurs traditions ont, selon l’habitude, remplacé ces mille voyages
obscurs par quelques expéditions fameuses, et attribué à un petit nombre
d’hommes les effets produits par l’influence de relations dix fois peut-être
séculaires.
Ces personnages, devenus les représentants de l’influence
orientale sur la Grèce,
sont surtout Cadmus, qu’on a fait Phénicien, Danaüs et Cécrops, qu’on a faits
Égyptiens. Voici en quelques mots leur légende.
Le premier, fils d’Agénor, roi de Tyr et de Sidon, avait
pour frères Phénix et Cilix (les Phéniciens et les Ciliciens), et pour sœur Europe, que
Jupiter enleva et transporta en Crète, où, en face de l’Asie, l’Europe
commence. Cadmus poursuivit sa sœur ; pour la trouver, il voyagea
longtemps et visita maint pays. Arrivé en Grèce, il consulta l’oracle de
Delphes. Ne cherche plus ta sœur, répondit
Apollon, mais suis la première génisse qui se
trouvera sur ton chemin et fonde une ville au lieu où elle s’arrêtera.
Elle le conduisit en Béotie, auprès de la fontaine Arcia. Un dragon gardait
ses eaux sacrées ; Cadmus le tua, et sema ses dents sur la terre. Il en
sortit des hommes armés qui aussitôt s’attaquèrent, tous périrent, excepté
cinq, qui l’aidèrent à bâtir une forteresse, la Cadmée, autour de
laquelle Thèbes plus tard s’éleva, et qui devinrent les chefs des cinq plus
nobles maisons thébaines. Cadmus avait apporté l’alphabet phénicien, que les
Grecs adoptèrent[22], l’art
d’exploiter les mines et de fondre les métaux. Ses descendants furent
célèbres par leurs malheurs : Penthée, que les Bacchantes mirent en
pièces ; Actéon, le rival de Diane à la chasse, qui, un jour, osa la
regarder se baignant dans une fontaine et fut par la déesse irritée changé en
cerf, puis dévoré par ses propres chiens; enfin Sémélé, que Jupiter aima. Sur
le perfide conseil de Junon, elle voulut voir le dieu dans l’éclat de sa
majesté, au milieu des éclairs et des tonnerres, mais le feu céleste la
consuma. L’enfant qu’elle portait dans son sein ne périt pas : Jupiter le
prit et le plaça dans sa cuisse, jusqu’au moment fixé pour sa naissance :
c’était Dionysos, ou Bacchus, qui donna l’ivresse joyeuse, mais aussi
l’exaltation farouche, quand les initiées à ses mystères, courant par les
montagnes, échevelées, demi nues, déchiraient les proies vivantes et buvaient
leur sang[23].
Lycos, Amphion à la lyre harmonieuse, Laïos et Œdipe sont
nommés parmi les successeurs de Cadmus, lesquels payèrent souvent tribut à la
puissante ville d’Orchomène. Notons en passant que les tragiques Grecs, qui
se sont tant occupés des malheurs de la postérité de Cadmus, ne savent rien
de l’origine phénicienne de cette race.
Argos, au bord de son golfe hospitalier, fut peut-être la
plus ancienne cité de la Grèce,
le point où se rencontrèrent les indigènes et les étrangers. On a vu que,
selon Hérodote, les Phéniciens ravirent Io sur ce rivage, par représailles de
l’enlèvement d’Europe. Ces noms sont faux, mais le fait est vrai, en ce sens
que l’homme et la femme étaient alors et restèrent longtemps le principal
objet de la piraterie et des échanges. La tradition établissait de nombreux
rapports entre Argos et l’Égypte. C’est de la Libye que les Argiens
avaient reçu le blé qui leur servit de semence; c’est au bord du Nil qu’In
termina ses courses aventureuses, de là enfin qu’arriva Danaüs avec ses
cinquante filles, qui tuèrent, sauf un, leurs cinquante époux, et furent
condamnées, dans les Enfers, à remplir éternellement un tonneau sans fond.
Fils de Bélus, Cadmus propagea le culte d’Apollon, et sa galère à cinquante
rameurs apprit aux indigènes à se risquer sur les flots. Après lui, on voit,
dans l’Argolide, Prœtos qui appelle les Cyclopes de Lycie[24] pour construire
les murailles de Tirynthe ; le héros Palamède, fondateur de Nauplie et
l’inventeur des poids, des mesures, des lettres et du calcul[25].
Dans l’Attique, c’est un sage d’Égypte, Cécrops, qui,
chassé de Saïs sa patrie, par la guerre civile, aborde au Pirée, épouse la
fille du roi du pays et lui succède après sa mort. Les habitants vivaient
encore épars, il les réunit en douze bourgades, leur enseigna à cultiver
l’olivier. à extraire l’huile de ses fruits et à retirer de la terre diverses
espèces de grains.. Afin de mieux resserrer les liens du nouvel État, Cécrops
institua les lois du mariage, les lites funéraires, qui consacrèrent la
mémoire des morts, et le tribunal de l’Aréopage, qui siégea sur la colline de
Mars (Arès) et
dut prévenir les violences par des jugements équitables. Avant de mourir,
Cécrops bâtit, à 8
kilomètres de la mer, sur une masse de rochers
largement aplanie à son sommet et pourtant inaccessible, si ce n’est du côté
de l’ouest, la forteresse imprenable qui porta son nom, Cecropia, et
au pied de laquelle se forma peu à peu la ville d’Athènes. Au nombre de ses
seize successeurs on compte : Amphictyon, qui réunit tous les peuples voisins
des Thermopyles dans une ligue à laquelle il donna son nom; Érichthonios, qui
immola sa fille pour obtenir une victoire ; Érechthée[26], qu’on dit chef
d’une nouvelle colonie égyptienne de laquelle Triptolème apprit une méthode
plus sûre pour semer et recueillir le blé ; enfin Égée, père de Thésée.
Les Mégariens nommaient aussi parmi leurs anciens princes
un Égyptien du nom de Lélex.
Ces traditions sont aujourd’hui abandonnées. La plupart
des écrivains de l’antiquité regardent Cécrops comme un indigène de
l’Attique ; il faudrait probablement aller plus loin et ne voir en lui,
comme dans Érichthonios, le dieu serpent, dans Triptolème, l’inventeur de la
charrue et de l’agriculture, et dans la plupart des personnages de ces
vieilles légendes, que des allégories personnifiées, des idées dont la poésie
a fait des rois, des héros ou des dieux[27]. Thucydide dit
bien qu’avant la guerre de Troie les Cariens et les Phéniciens avaient occupé
une partie des îles, mais il ne fait aucune mention de ces colonies de Danaüs
et de Cadmus venues de l’Égypte et de la Phénicie sur le continent grec, et, à la
différence d’Hérodote, qui, d’après le témoignage intéressé des prêtres de
Memphis, sait tant de choses de ces vieux âges, le sévère historien doute
que, pour ces temps, on puisse rien affirmer[28]. Enfin ces
étrangers qui fondent des maisons royales, et qui, pour y parvenir, ont dû
être nombreux, parlaient des langues profondément distinctes de celle des
Hellènes. Si leur influence avait été assez grande pour qu’ils saisissent la
suprématie politique, elle leur aurait donné la force de dominer aussi
l’idiome national. Ce ne sont pas d’ordinaire les conquérants d’un pays,
supérieurs aux vaincus en civilisation comme en puissance, qui désapprennent
leur langue. Le grec n’ayant gardé que bien peu de traces des langues
sémitiques, c’est que les Sémites, s’ils sont jamais venus dans l’Hellade, en
ont disparu sans avoir pu fonder les dynasties puissantes et durables qu’on leur
attribue. Ajoutons que les ruines les plus anciennes de la Grèce ne révèlent pas un
art égyptien, quoiqu’on y ait trouvé beaucoup d’objets apportés de ce pays et
de la côte phénicienne.
Il est vrai qu’au temps où l’on met l’arrivée de ces
émigrants orientaux, il y avait en Asie de grands mouvements de peuples ; que
les traditions font passer tour à tour les Phrygiens d’Asie en Europe, puis
de Thrace en Asie, et qu’elles amènent les Amazones jusque dans l’Attique,
Memnon jusque dans la Troade,
les Cariens dans les Cyclades et sur les côtes du golfe Saronique, les
Telchines de Rhodes à Sicyone ; qu’enfin, vers le même temps, eurent
lieu en Égypte ce qu’on appelle la sortie des Hébreux et la proscription des
impurs, puis les grandes expéditions des Pharaons, qui ébranlèrent l’Asie
jusqu’à l’Inde. Autour de la mer Égée, tout était donc en mouvement; quelque
chose de ce bruit a pu retentir en Grèce, quelques-uns de ces hommes y venir,
quelques-unes des idées et des coutumes de l’Asie y être portées.
Ce n’est pas le fait de la venue de colons orientaux qui
est invraisemblable, mais la patrie qu’on leur donne. Les côtes de l’Asie
Mineure étaient couvertes, ne l’oublions pas, de populations
helléniques ; montées sur leurs coursiers
marins et guidant leur marche d’après les étoiles, elles chassèrent
peu à peu les Phéniciens des îles de la mer Égée et arrivèrent à leur suite
sur presque tous les rivages que baigne la Méditerranée
orientale. Dès le onzième siècle, les Hébreux connaissaient le nom des fils
de Javan (Ioniens)
qui habitent les côtes et les îles de la grande mer,
et ce nom, on le lit encore dans les inscriptions hiéroglyphiques des
Pharaons de la dix-huitième dynastie[29]. On peut donc
admettre une période, pour nous inconnue, durant laquelle les Grecs asiatiques
préludèrent à leur fortune, en nouant des rapports avec les riches nations de
l’Orient. Quelques-uns de leurs chefs, habitués à négocier avec l’Égypte et la Phénicie, auront, dans
les moments de révolution, quitté leur pays troublé pour se fixer dans la Grèce pélasgique au milieu
de peuples de même langue, auxquels ils apportèrent les connaissances qu’ils
avaient acquises dans leur commerce avec les nations de l’Est et du Sud.
Mille choses nous montrent les liens étroits qui unissaient les deux continents.
L’histoire la plus reculée des Grecs nous ramène constamment en Asie, où ils
ont pris la plupart de leurs dieux[30]. Quelques-uns de
leurs procédés d’art et certains types fort anciens peuvent être regardés
comme des imitations orientales. La porte aux Lions, de Mycènes, rappelle les
gardiens symboliques de la citadelle de Sardes et du palais de Ninive, tandis
que les Trésors de Minyas et d’Atrée semblent un
souvenir des édifices à demi souterrains de la Phrygie[31]. On a vu que
l’alphabet primitif des Hellènes était un emprunt fait aux Phéniciens, comme
le fut leur système métrique.
Une autre légende, celle du Crétois Minos, prise aussi
dans sa généralité, confirme le fait de ces antiques relations entre la Grèce et l’Asie.
Ce sage roi, dit-elle, le plus puissant des princes de son
temps, régnait dans la Crète,
dont il avait réuni tous les peuples sous sa domination, et où il avait fondé
trois villes : Cnosse, Cydonie et Phœstos. Ses lois reposaient sur un
principe étranger aux législations orientales, que les citoyens sont égaux
entre eux. Si ce qu’on lui attribue ne fut pas une importation postérieure
d’une colonie dorienne, il aurait interdit la propriété privée et voulu que
des tables communes, dressées en des lieux publics, réunissent tous les
habitants. Un temps de guerre, la puissance royale était illimitée : dans la
paix, un sénat administrait l’État. Aux esclaves seuls était remis le soin de
cultiver la terre. Les jeunes Crétois, délivrés des travaux matériels,
étaient soumis à une éducation sévère qui avait pour but de développer leurs
forces et de leur inspirer les vertus qui font les citoyens utiles. Minos fut
aussi un conquérant ; il créa une flotte et chassa de l’Archipel les
pirates carions et lélèges qui l’infestaient. Toutes les îles, depuis la Thrace jusqu’à Rhodes,
reconnurent son pouvoir, et les colonies qu’il fonda dans quelques-unes, ou
qu’il établit sur les côtes de l’Asie, en assurèrent la durée. Mégare et
l’Attique lui payèrent tribut. Une expédition contre la Sicile échoua ; il y
périt lui-même. Pourtant on tonnait dans l’île une ville de son nom, Minoa.
Son tombeau s’y trouvait à côté d’un sanctuaire de Vénus, l’Astarté de Tyr,
dont les Phéniciens lui avaient transmis le culte, qu’ils portèrent aussi
dans l’île de Cythère. Jupiter, pour récompenser sa justice, le chargea avec
ses frères, Éaque et Rhadamante, de juger aux Enfers les ombres des morts.
Plus tard, on se trouva embarrassé, de toutes les
aventures mises sur le compte de Minos, et, par un procédé fort habituel aux
écrivains qui voulaient, comme Plutarque avoue l’avoir fait pour Thésée,
donner à la légende l’apparence de l’histoire, on dédoubla ce personnage et
l’on fit vivre, une génération après le législateur de la Crète, un second Minos
sous lequel aurait paru l’industrieux Dédale, et qui aurait bâti le
Labyrinthe pour enfermer le Minotaure, que Thésée tua avec l’aide d’Ariane[32]. Sous Minos II, la Crète était la plus grande
puissance de la Grèce ;
mais, après lui, cette domination tomba Idoménée, le petit-fils du premier
roi de la mer, ne put conduire contre les Troyens que quatre-vingts navires.
Nous nous garderons bien de rien affirmer touchant cette
histoire de Minos, mais il nous semble qu’ici encore se dégage sans peine de
l’ensemble des traditions un fait incontestable, celui d’une grande puissance
exercée, aux premiers jours de la
Grèce, par les Crétois. Ajoutons que cette domination
maritime et insulaire qui s’établit avant toutes les autres était inévitable.
On a distingué dans l’histoire de la formation de notre globe la période
insulaire qui précéda celle où apparurent les grands continents. Dans
l’histoire de la Grèce,
il fut aussi un temps oit la vie la plus active était dans les îles et sur
les côtes de la mer Égée. La
Crète, placée au centre de ce mouvement, le maîtrisa et lui
donna sa plus grande force. Voilà le règne de Minos, je veux dire : un effort
fait du haut de cette terre qui domine la mer Égée comme une citadelle, pour
organiser ce monde mobile et violent, réprimer la piraterie, mettre le
commerce à sa place et reconnaître les mers de la Grèce jusqu’à la grande
île de l’Occident, qui était alors l’Ultima Thule, la Sicile.
Hérodote serait d’accord, au fond, avec cette
interprétation des anciennes choses de la Grèce, puisqu’il fait des Ioniens les
descendants des Pélasges[33]. Il faut
toujours tenir grand compte des paroles du vieil historien, qui était si
curieux de recueillir les traditions populaires. Or cette parenté s’explique
par ce qui vient d’être exposé. Les Pélasges couvrent les premiers la Grèce ; les Ioniens
d’Asie y arrivent ensuite par mer, en petit nombre, comme cela doit être pour
des temps où la navigation était si précaire, et sans femmes, ce qui oblige à
prendre celles du pays. D’abord ils pillent, ravissent ou tuent; puis, peu à
peu, ils s’établissent sur ces côtes orientales où nous ramènent toutes les
traditions de l’âge primitif, se mêlent aux Pélasges, rameau séparé de leur
race depuis plusieurs siècles, et font naître la première civilisation du
pays.

IV. Les monuments cyclopéens
Les lieux où elle se développa furent en Épire les
environs du temple de Dodone, qui, avec ses chênes fatidiques et ses colombes
sacrées, semble avoir été pour les Pélasges ce que Delphes fut pour les
Hellènes, le sanctuaire et l’oracle le plus vénéré ; la Thessalie, qui prit
une telle avance sur les autres provinces, qu’une partie de la poésie
homérique y est née et que les Muses en sont sorties ; la Béotie, où s’éleva, dans
les environs du lac Copaïs, la puissante cité d’Orchomène, dont les
habitants, les Minyens, creusèrent, disait-on, à travers une montagne, des
canaux d’écoulement pour se préserver des inondations du lac Copaïs :
travail immense et qui accuserait des connaissances déjà bien avancées, si la
nature n’en avait pas fait elle-même tous les frais[34].
L’Attique, peuplée de bonne heure, n’a pourtant rien gardé
des temps pélasgiques, si. ce n’est une partie des murs de son Acropole. Les
Arcadiens prétendaient que Lycosure était la plus vieille cité du monde; il
est vrai qu’ils croyaient être nés eux-mêmes avant que la lune envoyât à la
terre ses pâles rayons. Mais la contrée qui semble avoir joué alors le rôle
le plus important est l’Argolide, où subsistent tant de traces de ces vieux
âges, et où vivaient, tant de souvenirs d’antiques relations avec l’Orient.
A cette période antéhistorique se rapportent des monuments
d’une construction particulière, que les générations postérieures
attribuaient à une race de géants, les Cyclopes. On voit encore des restes de
ces constructions cyclopéennes à Mycènes, à Argos dont les Lyciens avaient,
dit-on, bâti les murs, à Tirynthe, à Athènes, à Orchomène, à Lycosure, et
peut-être dans deux cents autres villes helléniques. Ce sont d’énormes
quartiers de roc souvent bruts, quelquefois taillés, mais toujours placés les
uns sur les autres, sans ciment, en polygones irréguliers[35]. Les plus
remarquables de ces monuments sont les murs et les galeries de Tirynthe,
bâtis de pierres dont deux chevaux attelés ne pourraient ébranler la plus
petite, et l’édifice appelé le Trésor d’Atrée, à Mycènes, dont la porte a
pour linteau une pierre, longue de 8m,25 sur 5m,10 de
largeur, qui est la plus considérable qu’on ait jusqu’à présent trouvée dans
une construction régulière. Une partie des murs de Mycènes et une porte
surmontée de deux lions offrent le même genre d’architecture. Ces lions,
gardiens farouches de l’acropole, sont le plus ancien bas-relief qui existe
en Europe. Leurs deux têtes, peut-être en bronze, mais à coup sûr rapportées,
comme le prouvent la coupure nette du cou et les trous qu’on y voit, ont
disparu; tournées, sans doute, aux anciens jours, vers ceux qui approchaient
de l’enceinte, elles les regardaient d’un oeil menaçant[36].
L’Acarnanie est encore couverte de ces monuments en
appareil cyclopéen ou polygonal, dont l’usage s’est très certainement
maintenu fort tard dans cette province. Du reste il est à remarquer que les
Grecs, qui trouvaient la pierre partout sous leur main, employèrent rarement
dans leurs murailles la brique et le mortier. Ils les formaient de pierres
posées les unes sur les autres, se maintenant en équilibre par leur
disposition et leur poids. Même à Éleusis, on a découvert un tombeau qui
reproduit en de plus petites proportions le Trésor d’Atrée, avec le passage
en ogive, la salle ronde et l’appareil cyclopéen des murailles de Tirynthe[37].
Ces monuments, qui ont un même caractère général, marquent
cependant, par quelques détails, des époques différentes. Ainsi on a cru
pouvoir attribuer aux Pélopides le Trésor d’Atrée ou tombeau d’Agamemnon, et
la porte aux Lions, qui attestent un art plus avancé, surtout plus asiatique.
Mais comment de telles masses ont-elles été remuées avec le seul instrument
que ces peuples connussent, le levier ? Des constructions qui ont exigé
une telle dépense de force musculaire, et par conséquent d’hommes, doivent
appartenir à une époque de servitude publique, sous des chefs militaires ou
sous une caste dominante de prêtres guerriers, que les traditions laissent
entrevoir ; et les Pélasges furent sans doute condamnés par leurs
maîtres à de pénibles corvées, comme les Romains, sous Tarquin le Superbe,
quand ils construisirent le grand Cloaque et le Capitole ; comme les
Égyptiens, quand ils bâtissaient leurs pyramides et leurs temples; comme les
habitants de la Gaule,
quand ils dressaient les alignements de Karnak et d’immenses cromlecs.
L’influence orientale à laquelle les Grecs devaient arracher le monde durait
donc encore parmi les tribus pélasgiques[38].
Notons toutefois que les murailles cyclopéennes ne
servaient pas â enfermer un dieu ou à garder une momie de roi, comme les
fastueux monuments qu’éleva aux bords du Nil l’orgueil des prêtres et des
monarques; ce n’étaient pas non plus, comme en Gaule, d’inutiles
constructions dont le but est resté pour nous une énigme. Ni temple, ni
insolent tombeau, ni forteresse imprenable d’un chef, mais cité de tout le
peuple, ces ruines nous disent que, dès l’époque la plus reculée, la Grèce commença la vie
urbaine qui a fait sa grandeur. Ses premiers peuples fondèrent les villes où
s’est élaborée plus tard la civilisation du monde.
|