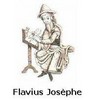|
I. —
FLAVIUS
JOSÈPHE À ROME.
Triomphe de Vespasien et de Titus. — Premières démarches de Josèphe à
Rome. — Guerre de Judée. — Affaire de Tarichée. — Siège de Jotapat. —
Prophétie de Josèphe. — Siège de Jérusalem. — Josèphe à la cour des empereurs.
II. —
LES ANTIQUITÉS JUDAÏQUES ET LE MARTYRE DES MACHABÉES.
Jugement d'Abrabanel sur Josèphe. — Josippon ben Gorion. — Controverse
sur le passage relatif à Jésus-Christ. — Collaborateurs de Josèphe et
composition de ses œuvres. - Examen des Antiquités et du récit de la mort des
Machabées.
III. —
LA GUERRE JUDAÏQUE
ET LE TRAITÉ CONTRE APION.
Panégyrique des Romains par Josèphe. — Situation politique de Jérusalem
et des partis. — Le droit du Zèle. — Falsifications de l'histoire par
Josèphe. — Son invective contre les Grecs. — Ses accusateurs et ses
défenseurs. — Bayle et Voltaire.
IV. —
CONCLUSION. - VALEUR HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DE FLAVIUS JOSÈPHE.
Époque et mouvement de civilisation qu'il représente. — Son influence sur
les littératures modernes. — Josèphe comparé aux grands historiens de
l'antiquité.

I. — FLAVIUS JOSÈPHE À ROME
L'an de Rome 822 et de l'ère chrétienne 71, au jour fixé
pour le triomphe de Vespasien et de Titus[1], vainqueurs de la Judée, tous les habitants de Rome quittèrent leurs demeures[2]. Cette population
innombrable avait occupé de bonne heure les
avenues et les places, d'où, même debout[3], elle espérait
entrevoir les triomphateurs. C'était une grande joie pour le peuple[4], et les beaux
jours de la patrie semblaient renaître. La nation la plus abhorrée et la plus
dangereuse[5]
était écrasée. La haine contre les Juifs, mélange singulier de mépris et de
colère, irritée de leur résistance[6], s'était accrue et
enflammée par la connaissance plus exacte que Ton avait acquise de leurs rites
hostiles au genre humain[7], peut-être aussi
par cette rivalité d'héroïsme à laquelle Rome ne pardonnait pas. Un siècle
plus tôt, le mépris l'emportait encore sur la colère : Cicéron avait insulté
Pompée en lui donnant le sobriquet de Jérusalémite[8]. Horace avait
raillé le crédule Apella[9] ; et ce roi
Hérode plus clément envers ses pourceaux qu'envers
ses fils[10],
avait fourni un bon mot à l'empereur Auguste.
Ce peuple méprisé n'était cependant pas méprisable.
Reconnaissant envers Pompée, soumis et obéissant à Vitellius, qui, tous deux,
l'avaient ménagé, il se révolta sous les exactions et devint terrible sous
les outrages. Il abattit à coups de hache l'aigle d'or que l'on voulait placer
sur la porte du temple de Jéhovah. Il égorgea les soldats romains, lorsqu'un
d'entre eux eut insulté, par un geste obscène[11], le culte du
Dieu unique. On vit éclater toute la rage vengeresse[12] du caractère
oriental et judaïque. Il fallut tuer un million trois cent trente-huit mille
quatre cent soixante Juifs[13], dévaster le
pays, détruire le temple, abolir la nation, pour venir à bout de cette
indomptable fureur. Encore ne réussit-on pas à en effacer la trace ; ce qui
restait de la nation juive poursuivit, à travers les siècles, Rome de sa
colère ; les rabbins ne l'appelèrent plus que l'empire scélérat[14] ; Titus et
Vespasien furent à jamais les maudits[15].
Le patriotisme judaïque était vaincu par la constance et
la bravoure romaines. Moins discipliné, plus farouche, et tombant d'une
hauteur plus sublime que le patriotisme romain, il devait se perpétuer après
sa défaite et survivre à la patrie avec une persévérance acharnée que les
vainqueurs ne prévoyaient pas. L'allégresse régnait à Rome. Les chevaux qui
portaient les deux triomphateurs avaient peine à fendre les flots du peuple[16]. On voyait l'image
de la Judée,
une femme[17]
assise dans la poussière, sous un palmier, versant des larmes, la tête
enveloppée de sa robe de deuil. Plus loin, l'épée glorieuse des Machabées
surmontait un trophée d'armes Israélites, conquises pendant le siège de
Jérusalem. Plus loin encore, les dépouilles du Temple, la Table d'or[18], le Chandelier
aux sept branches[19] ; enfin, les
Livres de la Loi,
a dernière proie[20], précédaient
immédiatement les coursiers de Vespasien et de Titus. Ce n'était point un spectacle
ordinaire, de voir le vrai Dieu, le Dieu unique[21], captif des faux
Dieux, qu'Isaïe[22]
avait raillés et maudits, et Jéhovah traîné en triomphe sous la foudre
irritée de Jupiter Capitolin. Mais ce qu'il y avait de plus singulier dans
cette journée triomphale, c'était la présence d'un homme.
Parmi les spectateurs, se trouvait un Juif qui avait
renoncé à sa patrie vaincue, et l'avait assez complètement effacée de son
souvenir pourvoir d'un œil sec et joyeux cette pompe ignominieuse. Il l'a
décrite tout entière ; il en a recueilli les moindres détails, et son exactitude
scrupuleuse étonne encore le lecteur. On ne trouve cette description que dans
ses œuvres. Suétone, Dion Cassius et Zonaras se contentent de rappeler en
passant le triomphe de Vespasien et de Titus, comme s'ils partageaient encore
ce dédain pour la Judée,
attesté par le refus des vainqueurs, qui ne voulurent
point s'appeler Judaïques[23]. Flavius Josèphe
supplée à leur silence ; il n'omet rien, il n'oublie rien. Tout en avouant
l'impuissance du langage à reproduire ces magnificences et ces splendeurs[24], il essaie de
lutter avec elles par le luie des paroles. Les statues de la Victoire sont d'ivoire
et d'or. Des machines à trois et quatre étages[25], surchargées de
trophées, s'avancent, soutenues par les épaules tremblantes qui s'affaissent
sous leur poids. L'or de la
Chaldée, les pierreries de l'Inde, les étoffes brodées de
Babylone et d'Ecbatane étincellent de toutes parts. L'Israélite, ébloui de
ces merveilles, ne se souvient pas que ce sont les dépouilles de ses
concitoyens ; qu'il s'agit de la Judée anéantie ; que ce Dieu outragé est son
Dieu, et qu'il assiste aux funérailles de son pays. Il décrit en dix lignes
le Chandelier aux sept branches, et brode cette description de toutes les
élégances du rhéteur. Pas un mot de sympathie, de consolation ou de tristesse
en faveur de ces captifs qui traînent devant lui, sous les chaînes, leurs
corps épuisés : ce sont ses frères. Il ne voit, lui, que la variété et la
beauté des robes dont les Romains ont habillé leurs prisonniers[26]. Il ne soulève
point les draperies qui couvrent les victimes et qui lui cachent ces chairs
flétries, blessées et sanglantes[27]. Il trouve
convenable de n'avoir pas déshonoré une si belle cérémonie par l'aspect
odieux d'une foule d'esclaves déguenillés et affreux à voir[28]. Ces chefs
hébreux, sculptés dans le marbre et l'ivoire, et représentés au moment de
leur défaite[29],
ne lui arrachent pas un soupir. La minutie de sa narration atteste les
fidèles souvenirs d'un témoin oculaire, et son adresse à faire ressortir la
grandeur romaine[30] et à la déployer
sous un jour éclatant, prouve que ce qu'il a surtout oublié, c'est lui-même.
Un seul cri involontaire lui échappe ; quelques images triomphales
représentent la dévastation de la Judée, région très-heureuse[31], dit-il. Pour
corriger cet aveu et dérober cette larme furtive, il ajoute que ces tableaux
lui causent un plaisir mêlé de terreur[32]. Ce que Josèphe
jugeait agréable à voir, c'était, comme il l'avoue, le sang coulant à flots,
le meurtre partout[33], les temples en
flammes[34]
et le sol couvert d'incendies et de ruines. C'est de son pays que cet homme
parle. Le paragraphe suivant est encore plus odieux[35]. Quand la pompe
triomphale se trouvé avoir atteint le sommet de la colline, elle s'arrête, et
Josèphe nous raconte le supplice d'un de ses concitoyens, Simon Bargiora,
traîné, la corde au cou, battu de verges, et enfin égorgé comme victime
expiatoire. Habile à trouver les seuls palliatifs possibles de cette
narration, si étrange sous sa plume, l'historien juif la termine en
justifiant les vainqueurs ; et ces mots d'excuse philosophique sembleraient
empreints d'une froideur extraordinaire si elle n'était calculée. — Telle est, dit-il, la coutume
ancienne des Romains[36].
Je ne connais rien dans l'histoire littéraire qui soit
comparable ou analogue au récit de ce triomphe, que nous a laissé Flavius Josèphe.
Tandis que les plus éloquents et les plus sensés des écrivains romains
honoraient chez les peuples ennemis de Rome, les nobles actions et les
héroïques résistances ; se montrant généreux et compatissants envers les
vaincus ; rendant hommage au mérite guerrier de Vercingétorix le Gaulois, et
à la fierté indomptable du Breton Caradoc[37] et de la reine
Bowditch[38]
; voici un écrivain disert et un homme politique, qui consacre l'opulence de
ses loisirs, la souplesse de son talent et l'abondance de son érudition à
relever la grandeur de ses maîtres, de ceux qui viennent de détruire sa
patrie, et de l'effacer de la liste des royaumes. Pour comble de singularité,
c'est un Juif, un enfant de cette nation, dont chaque membre était l'élu de
Dieu ; nation remarquable entre toutes par l'amour
fraternelle[39] de ses membres ;
par leur fidélité mutuelle et inviolable, leur
dévouement aux coutumes transmises, leur horreur des choses
étrangères[40], et ce fanatisme
de la race et de la patrie, qui leur montrait sans cesse dans un Juif tous
les Juifs, dans un père tous ses enfants[41], dans un homme
tous ses aïeux, dans leur race, le genre humain, et dans le genre humain la
volonté de Dieu présent et vengeur. Josèphe, fils de Mathias, Israélite
déguisé sous le nom romain de Flavius, s'affiliant à la clientèle et à la
famille de Vespasien, et paraissant comme un favori à la cour de ce prince,
est donc un problème historique, dont l'intérêt singulier et l'énigme obscure
ne promettraient point de solution, si Josèphe n'avait laissé des livres qui
nous sont parvenus. C'est là qu'il faut chercher le sens, le but et la
conduite de sa vie. En éclairant le caractère de Josèphe, ses ouvrages
s'éclaireront eux-mêmes. Le critique qui les interroge avec bonne foi,
n'approuve pas sans doute les invectives du Père Hardouin, de Baronius et de
Salien, que le savant Casaubon nomme les bourreaux[42] de Josèphe ;
mais il est forcé de reconnaître dans les actions comme dans les œuvres de
cet homme trop habile, l'absence complète du sens moral et un caractère
d'ineffaçable duplicité.
Issu de race sacerdotale et royale, on le voit paraître
pour la première fois dans l'histoire, l'an 61 de l'ère chrétienne, lorsque
Festus[43] était intendant
de la Judée. Il
débute par un succès. Une contestation s'était élevée entre les prêtres du
Temple et Agrippa, le dernier roi des Juifs, que le procurateur romain
soutenait. Agrippa et Festus exigeaient la démolition d'une muraille, qui
dérobait les mystères à la vue des profanes. Les prêtres résistèrent, furent mis
aux fers, puis envoyés à Rome. A vingt-six ans, Josèphe, chargé d'aller
réclamer leur liberté et défendre leur cause, prouva la dextérité
diplomatique dont sa vie et ses œuvres offrent tant d'exemples. Néron régnait.
Il ne s'adressa pas directement à l'Empereur. Un personnage obscurément
puissant, accomplit cette transaction. Josèphe se lia d'intimité avec un de
ces bommes qui amusaient le peuple et le prince par l'imitation impudente et
nue[44] des vices privés
; et les sollicitations de ce mime ou baladin juif, nommé Alitur[45], lui
concilièrent la protection de Poppée, l'amitié de cette maîtresse du prince,
célèbre par ses vices, la liberté des captifs et la conservation de la
muraille en litige. Poppée, dans son Histoire, reçoit de lui, le nom d'amie des Dieux[46]. Il la nomme
impératrice et épouse du prince, dont elle n'était encore que la favorite
adultère[47]
; il laisse dans l'ombre Alitur, qui ne reparaît que dans un coin obscur de
ses Mémoires, cité comme par inadvertance. Tel est le début d'une vie
pleine de finesses et d'embûches. La Judée était réduite, depuis un siècle, à une
situation déplorable. Les gouverneurs romains la spoliaient ; ses rois,
vassaux de Rome, ne faisaient sentir leur pouvoir aux peuples que par des
exactions et des fureurs. Les nations voisines, qui haïssaient l'isolement
des mœurs judaïques, profitaient de cette faiblesse et de cette anarchie,
pour ruiner des provinces et égorger leurs habitants. Le sentiment religieux
et national, toujours ardent à Jérusalem, éclatait en révoltes partielles et
en séditions inutiles. Poppée, la protectrice de Josèphe, mit la dernière main
à cette misère, en obtenant l'intendance de la Judée pour l'un des
hommes les plus dépravés et les plus cruels de ce temps corrompu, Gessius
Florus, Tacite, Josèphe, Suétone et Dion Cassius sont unanimes sur l'excès
des iniquités que cet homme se permit. Les juifs qui avaient respecté Pompée
et béni Vitellius, qui, épuisés d'impôts, s'étaient contentés de demander à
Tibère un peu d'allégement[48], s'armèrent
enfin par désespoir. L'oracle de Jacob s'accomplissait ; le sceptre sortait
de la maison de Juda. Depuis la mort du Messie, tout périssait. U arriva ce
qui est commun aux sociétés qui se dissolvent : les vertus même devinrent des
poisons pour un corps désorganisé ; la bravoure embrassa le brigandage ; la
fidélité religieuse se tourna en frénésie ; et des hommes que la même horreur
de la servitude romaine aurait dû réunir, se déchirèrent dans leur mutuelle
fureur. L'histoire doit garder du respect pour une calamité si effroyable et
une constance si héroïque. C'était une petite nation divisée, sans alliés,
sans discipline, sans arsenaux, sans habitude de la guerre, qui soutenait à
elle seule le poids du colosse romain. On la vit défendre muraille après
muraille, village après village, vendre au prix du sang ennemi chacune de ses
positions, ne reculer qu'en laissant devant elle des cadavres et des ruines,
concentrer enfin ses forces mourantes, et son énergie désespérée sous les
remparts du Temple, et insulter encore l'ennemi vainqueur par l'obstination
de sa résistance et de son orgueil. La nation juive,
dit Photius, aima mieux périr tout entière, libre et
les armes à la main, que de se laisser consumer petit à petit dans un lent
esclavage[49]. Ainsi le
patriarche grec, moins injuste que Josèphe, n'attribue pas comme lui les
calamités de la Judée
aux seuls vices de ses habitants, mais au poids de cette tyrannie que l'on ne
pouvait secouer que par la mort.
Josèphe, à son retour, voyant la guerre prête à éclater et
tout le peuple ému, se retira dans le sanctuaire, en qualité de prêtre. Là il
attendit les événements. Deux partis, étaient à prendre pour lui ; celui de
la révolte nationale contre les Romains ; ou celui de la civilisation romaine
contre le judaïsme. Ces deux résolutions avaient leurs dangers. Il n'embrassa
ni l'une ni l'autre et se ménagea une position plus équivoque et plus sûre.
D'accord avec les principaux Pharisiens, il encouragea[50] la rébellion du
peuple, feignit de l'approuver et n'y prit aucune part. Cependant la
difficulté de soutenir une guerre contre la discipline et le pouvoir de Rome,
difficulté comprise par les rebelles, imprimait à tous leurs actes un
caractère de violence effrénée et d'enthousiasme forcené. Josèphe voudrait
nous faire croire que des bataillons de sicaires, armés de poignards cachés,
parcouraient alors Jérusalem, tuant leurs semblables, pour le plaisir de
tuer, sans intérêt comme sans but. Cela est impossible. Le cours entier de
son histoire démontre un fait que toutes ses réticences ne peuvent voiler ;
c'est que la passion universelle, le vœu général devenu frénésie chez
quelques uns, tendaient à la conservation de l'institution judaïque, et à la
répulsion définitive de l'invasion romaine. Le désir de la vengeance, la
haine inspirée par Gessius Florus irritaient encore cette fureur. Une fois précipités (comme
dit Josèphe lui-même) dans la rébellion[51] par la nécessité
non par leur volonté, les juifs ne
s'arrêtèrent plus et périrent. Josèphe, pour plaire à ses maîtres, transforma
en assassins romanesques, artisans de meurtres inexplicables, les partisans
d'une insurrection qu'il avait déclarée nécessaire.
Pour lui, quand cette insurrection fut étouffée dans le sang, il alla vivre à
Rome, paisible, dans la maison que Vespasien avait habitée, et calomnier ses
frères ensevelis sous les ruines du temple. Cependant les événements
acquirent tant de gravité, et les Romains, attaqués de toutes parts, massacrèrent
tant de populations, que la perfide neutralité de Josèphe et des Pharisiens
devint impossible. Le gouvernement civil et militaire des deux Galilées fut
donné à Josèphe. Il commença par se détacher du pouvoir central résidant à
Jérusalem, et par organiser[52] avec une
habileté très-remarquable, une résistance isolée ; ménageant Agrippa, vassal
des Romains, entretenant des rapports constants avec Bérénice leur protégée,
et se préparant ainsi ou un royaume séparé ou un accommodement facile avec l'étranger.
Les conséquences de cette conduite n'échappèrent pas aux magistrats de
Jérusalem, et à ceux des Galiléens qui favorisaient l'insurrection. Cent
raille hommes s'assemblèrent en tumulte, autour de la ville de Tarichée, où
se trouvait Josèphe. Averti au milieu de la nuit par l^mon, chargé de la
garde particulière de sa personne, que le peuple remplissait le cirque, et
que déjà des cris de mort retentissaient, il repoussa le glaive que cet homme
lut présentait, afin qu'il put mourir comme un général
et non comme un lâche[53] ; sortit par une
porte dérobée, passa une robe de deuil, en lambeaux, couvrit sa tête de
cendres, suspendit un glaive à son col, et se dirigea vers la place publique,
où le peuple était assemblé. A peine arrivé, il se prosterne, baigne la terre
de larmes[54],
la frappe de son front, confesse qu'il est coupable[55], obtient du
temps, éveille la pitié, promet de se mieux conduire, invente un stratagème
habile qui met aux prises les vieilles rivalités des Tarichéens et des
habitants de Tibériade, et rentre dans sa maison, suivi par un groupe de
séditieux. Il monte alors sur la terrasse de cet édifice et invite leur chef
à entrer seul, ayant, dit-il, une somme d'argent à lui donner pour les siens.
Maître de ce dernier, il le conduit dans une chambre écartée, le fait battre
de verges, jusqu'à mettre à nu ses entrailles[56], et le renvoie, une main coupée et suspendue au col[57].
C'est lui-même qui raconte cette scène et qui en triomphe.
Les deux versions[58] différentes
qu'il en a données, selon son habitude, offrent quelques détails disparates,
mais elles sont également remarquables par le mélange d'une ruse profonde et
d'une inexorable férocité. S'il avait peu de scrupules, l'habileté ne lui
manquait pas ; son gouvernement, jusqu'à l'arrivée de Vespasien, est un
chef-d'œuvre de fourberie. Il échappe aux décrets comme aux embûches de la
magistrature centrale établie à Jérusalem, qui envoie inutilement des députés
et deux mille cinq cents hommes pour lui arracher ce gouvernement dont il a
fait son empire[59].
Entre lui et le parti hébreu, commandé par Jean de Giscala et Jonathas, commence
une grande lutte de stratagèmes. On essaie de se surprendre ; on rivalise de
ruses ; on ne se fait pas faute de crimes. Dans ce singulier combat, qu'il
développe complaisamment, c'est à lui que reste l'avantage. Il manœuvre avec
un sang-froid que rien ne déconcerte, opposant mensonge à mensonge,
stratagème à stratagème, interceptant les lettres de ses ennemis, enivrant
leurs messagers, les prenant dans leurs propres filets, les exposant sans
cesse à la vengeance populaire, enlevant ses antagonistes et les escamotant
quand il le peut[60]. On a beaucoup
de peine à démêler le nœud de ces intrigues, et à en comprendre le sens,
quand on lit la vie de Josèphe écrite par lui-même, ou le second livre de son
Histoire. Il efface à plaisir les motifs du soulèvement qui avait lieu
contre lui ; il remplace les reproches réels de ses adversaires par des
prétextes ridicules. Il ne dit point pourquoi on l'attaque ; pourquoi il se
défend. Selon lui, la révolte des cent mille hommes assemblés autour de
Tarichée a été suscitée par le caprice d'un ou deux jeunes gens, mécontents
du gouverneur, et qui, en peu de jours, ont appelé aux armes tous les
citoyens[61].
Il passe rapidement sur le fait si grave de sa désobéissance aux ordres venus
de Jérusalem. Il dit que Jean de Giscala était un homme abominable et un
ancien voleur ; mais il ne dit pas comment cet ancien voleur se trouve appuyé
dans ses accusations par toute la magistrature du gouvernement central. A
Jérusalem, on avait le droit de s'inquiéter dé ses ménagements envers Agrippa
et Bérénice, de ses flatteries pour les ennemis communs, et de l'autorité
exclusive qu'il s'était arrogée. Craintes qui n'avaient rien d'illusoire : il
arma en effet les deux Galilées contre les députés de Jérusalem vaincu par
son habileté supérieure et la vigilante activité de ses ruses. Juste de
Tibériade, contre lequel il dirige une[62] de ses plus
véhémentes allocutions, attribuait aux troubles de la Galilée soulevée
par Josèphe la première impulsion du grand désastre qui devait bientôt
accabler Jérusalem. Nous pensons que Juste avait raison. Le commencement de
l'incendie et le signal de la destruction judaïque se rapportent à ce moment
y où Josèphe mit tout en feu plutôt que d'obéir et de céder le pouvoir.
Il s'était créé un gouvernement indépendant et commandait
à une armée de cent mille hommes, lorsque Vespasien parut en Judée. Le seul
usage que Josèphe fit de cette armée, fut de s'enfermer dans un bourg fortifié,
nommé Jotapat, dont le siège, raconté par lui dans tous ses détails, dura
sept semaines. Ainsi, maître de cent mille hommes, comme l'observe très-bien
Basnage, il tient un mois et demi contre les Romains
; c'est l'unique exploit de toute sa campagne. Il
comptait bien (dit-il lui-même) recevoir sa grâce des vainqueurs[63], et la suite de
son histoire le prouve assez. Dès qu'il prévoit que la ville dans laquelle il
s'est enfermé tombera au pouvoir de l'ennemi, il prépare sa fuite ; il songe
à se soustraire aux dangers du dernier assaut[64], laissant à la
merci des vainqueurs, le peuple qu'il doit défendre et la garnison qu'il
commande. cette nouvelle, on s'assemble en tumulte ; on ne veut pas souffrir
cette lâche désertion. Josèphe harangue le peuple, et tente de lui persuader
que le salut de la ville dépend de sa propre sûreté ; on ne le croit pas sur
parole ; on exige qu'il reste. Je fus contraint
d'obéir, dit-il encore[65], et j'eus l'air de prendre pour une supplication ce qui
était un ordre.
Il imagine alors de puérils stratagèmes dont l'invention
lui paraît merveilleuse, jetant du fenouil cuit sur les machines des Romains
pour faire glisser leurs pieds, et de l'huile bouillante dans leurs
cuirasses, pour les contraindre à fuir ; ordonnant à ceux qui vont chercher
des vivres de se cacher sous des peaux de bêtes, et de se traîner sur les
pieds et sur les mains, afin de tromper l'ennemi. Il raconte gravement ces
misérables finesses[66], et se complaît
dans leur récit. Cependant la patrie est sur le point de périr. Il ne remplit
aucun de ses devoirs de général, d'homme d'honneur, de citoyen. Par une
forfanterie oratoire qui lui est assez familière, il s'indigne contre la
pensée de trahir sa patrie, et de déshonorer le
pouvoir qu'il a reçu de ses compatriotes. Action infâme : il aimerait mieux mourir mille fois[67]. Cependant les
faits vont démentir ses paroles ; il commettra tout à l'heure le crime que
lui-même a flétri ; il va quitter son poste, renier son pays, passer dans les
rangs des envahisseurs, et chercher une vie paisible
parmi ceux que son devoir était de combattre.
On le force à défendre la brèche que le bélier romain
vient de creuser. Il prétend s'être placé, lui sixième[68], au pied de
cette brèche. Mais lorsque Vespasien, averti par un transfuge, eût surpris la
ville endormie, Josèphe avait disparu ; et c'est une remarque due à Crévier,
l'un de ses plus ardents panégyristes, que Josèphe, à cette heure suprême, ne
se montra nulle part[69]. On n'entend
parler de lui que longtemps après la décision de l'affaire, lorsque la ville
n'est que cendres, lorsque douze cents captifs, restes de cette population
infortunée, sont traînés en servitude, lorsque quarante mille cadavres
hébreux jonchent le sol. Alors il se retrouve au fond d'une caverne, à
laquelle aboutissait une citerne de la ville. Il prétend que quarante Hébreux
s'y trouvaient avec lui ; il raconte qu'il sut les engager, à force
d'éloquence, à se tuer l'un l'autre en tirant au sort l'ordre des victimes.
Nous examinerons plus tard les détails de ce roman chimérique, soutenu avec
beaucoup de sang-froid, mais dont l'ensemble et les circonstances répugnent à
la raison.
Il est enfin découvert et traîné devant Vespasien. Comment,
du fond de ce repaire où on le trouve blotti, du sein de cette ruine de sa
patrie, fera-t-il sortir sa propre fortune ? L'entreprise est difficile ;
c'est son coup de maître ; c'est le chef-d'œuvre de sa présence d'esprit et
de sa ruse.
Néron était empereur. On le haïssait, et l'on méprisait à
juste titre ceux que leur naissance rapprochait du trône, gens sans mœurs,
perdus de vices. Vespasien seul était estimé ; il commandait aux plus grandes
armées de l'empire, victorieuses sous son étendard. En Orient, et de l'Orient
dans les régions occidentales de l'empire, un pressentiment vague s'était répandu[70], attesté par
tous les historiens, transformé par le peuple en miracles et en signes
célestes, et qui promettait la puissance souveraine au vainqueur des contrées
du soleil ; un tressaillement singulier avertissait le monde qu'il se ferait
un grand changement dans ses destinées. Les Juifs attendaient le Messie ;
Rome, fatiguée, attendait un maître honnête homme. Quand le désir est
universel et l'attente générale, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste,
c'est le cours nécessaire des choses humaines qui se trahit. Notre race, dit Tacite[71], voit, dans ce pressentiment, des prodiges qu'elle
interprète à son gré. L'oracle du mont Carmel[72], consulté par Vespasien,
lui avait promis tous les succès. Les victoires justifiaient l'oracle ;
Tamour des soldats s'en augmentait, et leur superstitieux dévouement voyait
partout des signes favorables à leur général, des avertissements divins[73], et des
promesses d'empire, donnés par les songes et les prodiges[74]. Josèphe ne
perdit pas de vue une seule de ces circonstances ; il était Juif et fils de
prêtre ; il se donna pour prophète. Il était captif ; il prétendit être
résigné à son sort. Il paraissait devant un général vainqueur qui désirait le
trône ; il lui prédit le trône.
L'Israélite se présenta donc en riant[75], et tombant à
genoux devant le général : Tu crois, Vespasien,
dit-il, n'avoir ici qu'un prisonnier[76] qui se remet entre tes mains ; tu as mieux ; je suis
l'ange qui annonce de grandes destinées. Tu veux m'envoyer à Néron ; pourquoi
? Toi-même tu seras empereur !... Garde-moi
près de toi ; rends mes chaînes plus pesantes ; et si j'ai menti, punis-moi.
Tu seras maître dans peu, non de Josèphe seulement, mais de la terre, de la
mer et de tous les hommes ![77]
C'était ne rien hasarder et se rendre maître de l'avenir,
que de confondre ainsi par une habile équivoque Vespasien et le Messie de
l'Orient ; c'était se donner pour prophète, relever son importance, empêcher Vespasien
d'envoyer le captif à la mort, c'est-à-dire à Néron, que cette prophétie eût
épouvanté ; enfin sauver sa vie par cet admirable mélange de terreur et de
promesses, et se ménager la faveur prochaine d'un prince nouveau. Il
calculait bien. Vespasien se défia de lui, mais le garda vivant. Cet homme, disait-il, invente
des contes pour détourner ma colère[78]. S'il est prophète, que ne prédisait-il sa propre captivité
? Josèphe affirma qu'il l'avait prédite. Vespasien,
comme le remarque Basnage[79], ne fut pas plus dupe de cette seconde prophétie que de la
première ; mais il avait intérêt à feindre d'y ajouter foi, et l'envoi
d'un tel prisonnier et d'un tel oracle à Néron eût été dangereux. Josèphe fut
sauvé.
Parmi les savants qui ont signalé cette spirituelle
fraude, nous citerons Georges Olearius[80], Basnage[81], et l'anglais
Crull[82], qui attribue
même à l'Israélite une intention que Josèphe n'a jamais eue, celle de donner Vespasien
pour le fils de Dieu. Comment ces écrivains, avertis par une si éclatante
preuve de fourberie, n'ont-ils pas rapproché de cette circonstance notable
les actes différents de la même vie et les écrits du même auteur ? Il mentait
en se prétendant prophète ; il mentait en affirmant que Dieu lui révélait la
souveraineté prochaine de Vespasien ; mais il mentait à propos, ce qui est un
grand art.
Quand même on admettrait cette explication toute moderne, qui
efface les vestiges de l'Orient judaïque et donne les prophètes pour des hommes éclairés et des sages, cette confusion de l'israélitisme
et de la philosophie, de l'inspiration divine et du raisonnement humain,
n'excuserait point Josèphe. Il n'est pas l'homme dont parle Maimonide, qui s'adonne à la recherche de la vérité d'une manière
exclusive, parce que la substance de son cerveau est parfaite[83]. Il admet le mot
prophète dans le sens populaire ; il a eu un songe ; il a causé avec Dieu ;
il accourt de la part de Jéhovah, dont il est l'ange.
Il ne se donne pas pour un homme qui voit bien ; il annonce la parole divine.
Captif, il suivit l'armée de Vespasien, jusqu'au moment où
ce prince devint maître de l'empire. La grande prophétie était réalisée. Vespasien
pensa qu'il y allait de sa gloire de payer un mensonge comme une dette, et
qu'il devait laisser entrevoir des récompenses éclatantes à quiconque
imiterait Josèphe et croirait à sa fortune. Il brisa les fers du Juif. Un homme qui est venu m'annoncer l'empire ne doit pas
rester esclave ; cela serait honteux pour moi[84], dit-il. Rien ne
prouve mieux la sagacité de Josèphe, que le passage de son histoire dans
lequel il démêle et caractérise ce qu'il y avait de prudence et de politique
au fond de cette générosité impériale[85]. Titus se
chargea d'achever l'oeuvre de son père et la fortune du faux prophète.
Josèphe, se jetant sans réserve dans les bras des Romains, reçut le nom de
Flavius, abjura les coutumes nationales, épousa une captive de Tarichée,
mariage défendu par la loi judaïque, et suivit son protecteur Titus sous les
murs de Jérusalem, de la ville sacrée, dont il devint l'ennemi le plus
dangereux. Il indiqua les points d'attaque, dirigea les campements[86] et le jeu des
machines, essaya de persuader à ses compatriotes de se rendre à discrétion[87], et ne réussit
qu'à se faire chasser à coups de pierres par la fureur de ces assiégés, décidés
à se laisser exterminer par le glaive ou la famine. La seule grâce qu'ils
demandèrent quand la ville fut pleine de morts, et que la disette et
l'incendie eurent tout dévasté, ce fut la permission de se retirer an désert,
comme leurs ancêtres. On la leur refusa. Ils périrent alors avec le Temple,
et Josèphe ose les accuser de peu de courage ![88] Dion Cassius,
qui était Grec, n'en parle pas ainsi ; il admire cette invincible résolution
d'une race qui meurt tout entière, le peuple devant le sanctuaire, les
sénateurs sur les degrés, et les prêtres devant l'autel[89] ; vaincus, ajoute-t-il, non
par les Romains, mais par les flammes. Josèphe s'est bien gardé de
faire de tels aveux ; il écrivait pour les Romains. Après avoir enlevé du
Temple en ruines les livres saints, que Titus lui donna, il revint à Rome à
la suite de ses nouveaux maîtres, et fut témoin de ce triomphe^que nous avons
décrit d'après lui. Il recueillit ensuite le prix de toutes ses finesses. Le
reste de sa vie, protégé par les Flavius dont il avait pris le nom et dont il
était le fils adoptif ; par Titus, qui lui donna de vastes domaines en Judée
; par Vespasien, qui lui assigna une pension annuelle ; par le cruel Domitien
et par un affranchi nommé Épaphrodite, que l'on croit être non le secrétaire
de Néron[90],
mais l'affranchi de Trajan ; s'écoula doucement au milieu de sa famille, de
la considération publique et de ses travaux littéraires. Le même Épaphrodite,
qui le protégeait à la cour, avait pour esclave Epictète, c'est-à-dire la
vertu et le génie. Sous l'abri de la bienveillance impériale, Josèphe brava
la haine persévérante des Juifs, qu'il avait bien méritée, et qui lui tendit,
à ce qu'il raconte, plusieurs pièges. L'amitié des Romains lui suffisait.
Narrateur disert de leurs exploits dans l'Orient, il avait droit à leur
reconnaissance, et, selon Eusèbe[91], ils lui
élevèrent une statue.
C'est ainsi qu'il vécut.
Il nous reste à examiner si, dans ses œuvres, il a pu dire
la vérité, s'il a voulu la dire, et s'il l'a dite.

II. — LES ANTIQUITÉS JUDAÏQUES. - LE MARTYRE DES MACCHABÉES.
Rome croyait avoir vaincu la Judée, elle se
trompait ; elle fut vaincue par la Judée. Les chrétiens, qui, dans le sens
temporel et selon les Romains, n'étaient qu'une secte juive, étendirent plus
loin leur empire que Rome elle-même, et firent de Rome leur capitale. Aujourd'hui nos esclaves nous oppriment, disait au
Ve siècle un Romain de la
Gaule. Les voilà ces Juifs avec leur triste religion et a leurs âmes
sombres, avec leurs rites farouches et leurs mœurs associables ! Ils nous
envahissent, ils nous dominent ; et plût au ciel que jamais Titus ne les eût
vaincus ![92]
La conquête chrétienne continua. Rome, devenue chrétienne,
guida la civilisation pendant le moyen-âge. Les vieux Juifs la poursuivirent
d'une haine infinie et impuissante ; héritière des destructeurs de Jérusalem
et centre lumineux du catholicisme, elle avait un double titre à leur
exécration. Souvent charitable et tolérante envers eux, elle ne les dompta
pas. Saint Grégoire, Alexandre II, saint Bernard, Clément YI, les protégèrent
contre la fureur des peuples. Saint Hilaire d'Arles
fut tellement chéri par eux (dit l'abbé
Grégoire), qu'à ses obsèques ils mêlèrent
leurs larmes à celles des chrétiens, et chantèrent des prières hébraïques[93]. Mais, pour la
masse des israélites, le souvenir de Jérusalem détruite vivait toujours, et
Rome victorieuse était maudite. Apipior,
mot araméen qui, selon les rabbins, indique un oiseau
de proie, désigna le chef de l'Église. Les plus effroyables anathèmes
tombèrent sur cette villa abhorrée. En 1495, c'est-à-dire quatorze cent vingt-trois
années après le triomphe de Titus et l'apostasie de Josèphe, un autre juif,
exilé de Portugal et d'Espagne, don Isaac Abrabanel, le dernier et éclatant
rayon de l'école rabbinique espagnole, longtemps ministre de quatre rois
chrétiens, alla se réfugier à Rome, dans cette ville même qui avait offert,
quatorze siècles plus tôt, un asile au fils de Mathias. L'aspect de la Rome moderne n'inspirait au
rabbin que des imprécations furieuses et insensées, qui s'expliquent par la
longue agonie que sa race subissait. — Rome (écrivait-il alors),
tu seras détruite, parce que tu as détruit Jérusalem... Tu es la Bostrah
qui sera vendangée, et il y aura dans Rome un grand massacre... Et, au lieu de cardinaux, d'évêques et de moines, on verra
s'asseoir sur tes ruines le corbeau, le héron, le pélican, le hérisson, tous
les animaux malfaisants et maudits... Ce jour
de vengeance viendra ![94] Le proscrit qui
vomissait ces anathèmes, voyait César Borgia cardinal et Alexandre VI pape.
Il ne pardonnait d'ailleurs à aucun ennemi de sa race ; et quand le nom de
son prédécesseur, l'exilé Flavius, se présentait sous sa plume, un redoublement
de colère la précipitait. Nous ne le recevons pas,
ce Josèphe (dit-il dans son style
oriental) ; il a beaucoup écrit toujours avec
altération de la vérité ; afin d'élever la face des Romains ; — comme un esclave existant dans la main d'un maître dur,
parlant pour lui faire plaisir ; — aussi
beaucoup de choses se trouvent-elles dans ses livres, choses qui viennent de
la crainte qu'il avait de leur colère. Il leur parlait avec des mots sonores
et des flatteries qu'ils ne savaient pas être flatteries ; — et il les adulait selon leur désir. Se voyant à Rome, au
milieu des rois et des sénateurs de la terre, — placé sous leurs yeux, — il
écrivit les choses comme il voyait qu'elles étaient gravées dans leurs
fausses opinions. C'est un flatteur[95].
Ainsi se perpétua l'héritage de la colère juive contre
Flavius Josèphe ; un rabbin du XVe siècle ramassait pour la lui lancer la
pierre dont un de ses concitoyens assiégés l'avait blessé à la tête. Il
suffisait que les israélites récusassent son témoignage pour que les
chrétiens l'acceptassent sans restriction. Ils fermèrent les yeux sur les
nombreux passages de ses œuvres dans lesquels la Bible est contredite ou
falsifiée ; ils lui pardonnèrent ses doctrines pharisaïques, et ses
nombreuses omissions. Ils ne virent, dans ses œuvres, qu'un immense
témoignage en faveur de la sainteté de leur foi, Jérusalem détruite et le
Messie vengé. Ce spectateur de la catastrophe qui accomplissait la prophétie,
ce pathétique narrateur des désastres annoncés, devint, par ce seul fait, un
père de l'Église. Saint Jérôme[96], Eusèbe, saint
Grégoire, tous les chrétiens des six premiers siècles l'acceptèrent sans
critique. On voulut faire de lui un chrétien ou un demi-chrétien[97]. On prétendit
que saint Jean-le-Précurseur avait versé sur sa tête l'eau du baptême[98]. Les juifs, de
leur côté, s'obstinèrent à le repousser avec horreur. On lui opposa, au VIIe
ou au VIIIe siècle, un petit livre détestable, que l'on prétendit être l'original
hébreu de ses Antiquités et de sa Guerre judaïque. Un juif,
habitant de la Gaule
centrale, paraît avoir composé, sans goût et sans savoir, ce résumé informe
que les juifs vantèrent démesurément. En effet, on n'y trouvait aucun des
passages qui blessaient leur croyance ou leurs souvenirs, et la prophétie
relative à Vespasien en avait été supprimée. C'est ce petit traité
pseudonyme, attribué à Josippon ben Gorion[99], que le même Abrabanel
considère comme seul digne de crédit et de foi. Jamais livre n'a porté de
plus évidentes traces d'une fraude ridicule. Dès le début, l'auteur se donne
pour prêtre ; et à la fin, déposant ce masque, il avoue que n'étant pas
prêtre, il n'a pu entrer dans le temple. Il parle des Francs conquis par César, nomme les villes de Tours et de
Chinon, et cite les Goths établis en Espagne
; — écrivain frivole et absurde, (nugatarius scriptor)
comme le dit Joseph Scaliger. Son œuvre, que tous les savants ont raillée à l'envi[100], a cependant
conservé son autorité parmi les Hébreux ; la haine persistante qu'ils ont
vouée au véritable Josèphe n'a pas de meilleure preuve que cette étrange
préférence.
Quant aux chrétiens, ils ne se contentèrent pas de
l'admettre comme un des historiens les plus véridiques de l'antiquité ; ils
consacrèrent des volumes à l'examen contradictoire d'un seul paragraphe,
énonçant, en quelques lignes, l'avènement du Christ, et dont l'interpolation,
évidente pour les uns, inadmissible aux yeux des autres, ne nous occupera pas
ici. Ces lignes insignifiantes, que l'on a discutées avec un infatigable
acharnement[101],
peuvent appartenir à Josèphe, à un scoliaste, à un chrétien, à un juif, sans
que les fondements de la religion chrétienne en soient ébranlés ou affermis.
Que, contre la coutume des israélites, attentifs (dit
Photius), à ne jamais nommer le Christ,
Josèphe ait raconté sèchement qu'un certain Jésus,
homme sage, fit des choses merveilleuses et fut crucifié ; ces mots
seraient tout au plus une preuve de l'apparition de Jésus-Christ. Mais
l'importance que les parties adverses ont attribuée à cet aveu nous semble très-exagérée.
Élevé dans le pharisaïsme, pharisien parla doctrine et la conduite, Josèphe
n'a pas pu confesser la divinité du Christ ; en effet ce passage est loin de
l'admettre. Asservi aux Romains, il n'a pas dû vanter, dans un livre écrit
pour les Flavius, ces chrétiens que Tacite livre au mépris ; en effet, le
passage ne contient pas un seul éloge, mais le plus bref résumé des faits.
Que prouvent donc ces huit lignes ? Josèphe peut les avoir écrites ; elles
sont remplies de ses ménagements ordinaires et de ses habituelles réticences
; il peut ne les voir pas écrites, fidèle à cette habitude qu'il n'oublie
jamais, de taire ce qui peut lui nuire. La seule question sérieuse est celle
de la véracité de Josèphe ; placé dans la main de
ses maîtres, comme le dit Abrabanel, écrivant
sous leurs yeux, et tremblant sous leur loi.
L'indignation du rabbin espagnol n'a point marqué avec
assez de précision les divers buts que la prudence de Josèphe se proposait en
écrivant ses ouvrages. S'il se fût contenté de flatter les Romains, cette
complaisance eût avili son caractère, sans avancer sa fortune. Essayer une
conciliation apparente entre les mœurs, les rites, les idées de Rome, et les
dogmes, l'histoire, le caractère de la Judée ; effacer la trace de cette séparation profonde
que la loi de Moïse avait établie entre le peuple élu et les autres nations ;
c'était un plan beaucoup plus habile. On revendiquait ainsi pour les
Israélites vaincus les droits et la sympathie que la générosité de Rome
accordait aux barbares réunis à la civilisation romaine.
Pour atteindre ce résultat, il fallait attribuer à un
petit nombre d'assassins désavoués de toute la nation la résistance acharnée
et le patriotisme farouche de ces défenseurs de Jérusalem, qui avaient tenu
si longtemps en échec la discipline et les forces de Rome. Il fallait en
outre arracher des Écritures saintes ces pages nombreuses qui, exaltant
l'orgueil individuel de la race juive, lui défendaient comme un crime toute
union avec les peuples étrangers. Enfin il était nécessaire de compléter la
falsification, en rapprochant par une identité factice les croyances juives
des croyances stoïques ; et il fallait confondre les exemples anciens de
l'obstination juive avec les actes de vertu héroïque admirés par les Romains
et consacrés comme des témoignages de force virile et de puissance morale par
la philosophie contemporaine de Sénèque et d'Helvidius. Toutes ces
métamorphoses furent accomplies par l'historien, dans ses Antiquités
judaïques, version des histoires bibliques, ramenées au sens romain ;
dans son Livre contre Apion, défense de l'antiquité juive et de la
moralité juive contre les assertions des Égyptiens et des Grecs ; et dans la Déclamation
sur les Machabées, qui fait disparaître de cette tradition sublime la
tache primitive du fanatisme national et lui prête le caractère d'une thèse
philosophique. La voie une fois aplanie par ces précautions, il ne restait
plus à Flavius Josèphe qu'une seule tâche, celle de présenter sa propre vie
sous des couleurs pompeuses, de s'associer intimement à la politique romaine,
d'attribuer la ruine de la
Judée aux fureurs sanglantes de quelques fanatiques, et de
se placer lui-même au milieu des ruines de son pays, comme un prophète et un
vengeur. Il a rempli ce dernier dessein dans sa Guerre judaïque et
dans ses Mémoires. La conception de cet ensemble est si forte, si bien
soutenue et si homogène, qu'on ne peut qu'en admirer la structure et la
cohésion : c'est un chef-d'œuvre de finesse ; jamais la vérité n'a été
faussée avec une habileté plus résolue, plus subtile et plus décevante.
Vivant à Rome dans l'opulence, environné de sophistes
grecs[102]
dont sa connaissance encore imparfaite de la langue hellénique lui rendait le
secours nécessaire, car il ne savait pas prononcer cette langue[103], il fit de ce
travail l'œuvre de toute sa vie. Son premier soin fut de protester hautement
qu'il dirait la vérité. Il était prêtre ; il se prétendait prophète ; il
était fils de rois[104]. Mentir eût été
une infamie indigne de son rang, de son nom et de sa consécration divine.
Mais, au lieu d'altérer les faits, il les plaçait sous un jour favorable à
ses desseins. Aux traditions bibliques, il ajoutait les ornements des fables
populaires. On reconnaît même aisément que ses Collaborateurs qui
traduisirent et amplifièrent apparemment son œuvre, écrite d'abord en syro-chaldaïque,
pour les Barbares[105] ; ces Grecs,
habitués au mensonge historique[106], ne se firent
point faute de mêler au texte les additions brillantes, nées de leur
imagination.
Ce qui paraît le prouver, ce sont les doubles versions du
même événement qui, diversement brodé, se reproduit sous des formes
dissemblables dans les ouvrages différents de Josèphe ; comme si deux
collaborateurs avaient développé selon leur fantaisie un seul thème original.
Tel fait, consigné dans les Antiquités, reparaît dans les Mémoires,
chargé de détails contradictoires. Ce que les Mémoires racontent d'une
manière romanesque, est rapporté dans la Guerre judaïque, sous d'autres
couleurs invraisemblables, mais différentes. Cette double élaboration
s'applique même aux événements personnels à Josèphe, événements qu'il devait
fort bien connaître et raconter d'une seule façon. Pour concilier les
disparates des deux récits, il suffit de supposer qu'il en a confié le soin à
des rédacteurs différents, peu scrupuleux sur l'emploi des ornements. De là
ce mélange de romans incroyables, de versions doubles, de légèretés et de
contradictions, dont se compose le singulier caractère des œuvres de Josèphe.
Le nombre de ces contradictions est trop considérable pour qu'il soit
possible de les résumer ; il faudrait un volume. Dans le livre XVII des Antiquités[107], Josèphe trace
un portrait de la secte pharisienne, qui ne s'accorde nullement avec un autre
portrait de la même secte, inséré quelques chapitres plus loin[108]. Il dit dans la Guerre judaïque
que le roi Agrippa donna un repas et exprima le souhait public de voir
bientôt le monde débarrassé de Tibère. Dans les Antiquités, il prétend
que le même roi se promenait alors en voiture. Ce dernier ouvrage fait mourir
Mariamne après la bataille d'Actium, sur l'ordre des officiers d'Hérode[109]. La Guerre judaïque[110] la montre,
exécutée par l'ordre d'Hérode, dès que ce roi fut revenu de Laodicée.
Josèphe, dans un endroit, dit que le même Hérode ne fit construire aucun
édifice en Judée[111] et ailleurs,
qu'il l'a remplie de magnifiques temples[112] ; puis,
ailleurs encore, que les Juifs n'auraient souffert l'édification d'aucun
temple en Judée[113]. Il traite
Ananiel de prêtre d'origine obscure ; et bientôt après[114] il dit que cet
Ananiel est de la famille des grands-prêtres. — Paul Brinch, dans son petit
traité sur Flavius Josèphe[115], a tort de le
taxer de crédulité ; jamais historien ne fut moins crédule que lui. Le juif
Pineda se rapproche davantage du vrai, quand il dit que Josèphe a composé et arrangé son histoire pour les païens, qui n'en
a auraient pas accepté une autre[116]. Mais ces deux
opinions sont aussi incomplètes que la diatribe d'Abrabanel. D'autres motifs
à la fois plus élevés et plus divers avaient présidé à la composition de ses
œuvres. Nous avons essayé de les indiquer.
Dès le début des Antiquités, il efface
l'anthropomorphisme judaïque et omet ces mots importants : Dieu fit l'homme à son image ; il dit seulement
: Dieu forma l'homme[117]. C'est mal
remplir la promesse qu'il vient de faire, de conserver exactement les mots,
le sens et l'ordre des Écritures Saintes, d'apporter à ce travail une
fidélité extrême, de ne rien ajouter et de ne rien omettre. Il a beaucoup
ajouté et beaucoup omis. Après avoir fait disparaître celte présence matérielle
de Dieu, gloire, terreur et espérance des Israélites, il détruit, dès
l'origine, l'isolement judaïque ; il prétend qu'Abraham voulut aller en
Egypte pour y étudier la religion de ses prêtres[118] ; il affirme que
Moïse protesta de sa vénération pour les philosophes étrangers[119] ; il va jusqu'à
détruire cette hostilité contre les rites des autres peuples, la plus juste
et la mieux prouvée des accusations intentées contre les Israélites. Josèphe
insère, dans le Deutéronome, l'injonction divine de ne point blasphémer
les Dieux étrangers et de ne pas piller leurs temples[120] ; il revient
encore sur ce mensonge fondamental dans son livre contre Apion[121]. Il sait bien
cependant que Dieu commandait aux Juifs la destruction des idoles et des
temples[122],
et que toute l'institution judaïque était fondée sur l'isolement de la race.
Mais, comme le dit l'abbé Anselme[123], il avait les
Romains sous les yeux, et songeait à leur plaire.
Une analogie, même éloignée, semble-t-elle se présenter à
lui entre un miracle biblique et un événement ou un fait païens, il saisit
avidement cette analogie. C'est ainsi qu'il fait chanter à Moïse un cantique
en vers hexamètres[124], confond le
passage de la mer Rouge avec celui de la mer de Pamphylie par les troupes
d'Alexandre, disant que Dieu qui a permis l'un a bien pu permettre l'autre[125] ; attribue au grand-prêtre
Mathathias au discours tout stoïque, qui semble emprunté à Zénon ou Gaméade[126], et cherche à
faire passer pour authentiques deux prétendus décrets de Claude, qui
accordent aux Juifs, alors si méprisés, des privilèges considérables :
falsifications dont l'audace paraît extraordinaire.
A la tête de l'un de ces faux documents, Claude, qui ne prit jamais le titre d'empereur, selon Suétone,
se déclare empereur[127]. Il se dit
ensuite consul pour la quatrième fois, tandis qu'il n'était consul que pour
la troisième fois, et il cite enfin, dans le corps de l'édit, contre toute
coutume, le nom des porteurs du message[128]. L'autre
document[129]
attribue aux Juifs le droit de cité dans toutes les villes de l'empire, ce qui
les aurait constitués citoyens de Rome : Rome les chassa cependant en masse.
On voit ainsi se manifester partout, chez Josèphe, le désir ardent de relever
la condition des Israélites, en les assimilant aux Romains, de les introduire
au sein de la civilisation romaine, de les présenter comme frères des païens,
et de faire oublier l'antipathie religieuse qui avait causé leur perte. Le
but de l'homme politique est évident ; que dire de l'historien qui opère
cette grande fraude historique ?
Ainsi s'évanouit, sous l'habileté de Josèphe, le mystère
de la race juive et ce que les païens appelaient[130] son énorme
impiété ; car elle était impie à leurs yeux. Josèphe ne veut plus que les autres peuples haïssent la Judée ; comme
ennemie de la divinité que ces peuples adorent ; il le dit expressément[131].
A la fin de ses Antiquités, il annonce qu'il
complétera un jour son œuvre, et qu'il éclaircira tous les doutes relatifs
aux rites des Juifs, à leur abstinence de certains mets et à leurs coutumes[132] ; c'est-à-dire
qu'il ramènera ces coutumes nationales aux idées romaines. C'est le but de
tous ses écrits ; long commentaire destiné à vaincre l'antipathie et le
mépris de Rome, en captant sa bienveillance et son estime. Ce compromis
systématique est l'œuvre non seulement d'un courtisan qui, ne pouvant
s'abjurer, se transforme ; qui étouffe sa voix quand elle déplaît, et cache
sa pensée quand elle blesse ; mais aussi d'un diplomate habile, et qui
cherche à se confondre avec ceux qui l'ont vaincu.
Il est vrai que, dans les temps modernes, on a essayé
d'effacer encore ce caractère primitif des institutions de Moïse[133]. L'idée paradoxale de composer un commentaire libéral et
constitutionnel dans le sens américain, sur une législation asiatique, ne
pouvait, dit un autre Israélite[134], venir qu'à un homme d'esprit, et être exécutée que par
un écrivain de talent. Si l'on s'en tenait en effet aux passages
habilement rapprochés par l'écrivain du XIXe siècle, et à ses ingénieux
commentaires, toute la philosophie moderne, sa vaste charité, son indulgence
énervée, appartiendraient à Moïse ; et ce redoutable législateur qui a dit
aux hébreux : Vous ne ferez pas grâce[135] aux Amalécites ; serait un philanthrope aussi
éclairé que Voltaire. Mais cette hypothèse n'a rien de vraisemblable. Les
Hébreux, supérieurs par leur dogme à tout ce qui les environnait, avaient
cette supériorité qui offense, cet orgueil qui irrite ; et ils étaient
faibles. Si la race juive, comme un soldat indomptable et châtié, a passé par les verges, à travers toute l'histoire,
comme le dit avec éloquence et justesse un autre historien Israélite[136] moderne, c'est
qu'elle a professé dès l'origine cet isolement que les peuples ne pardonnent
pas et que Josèphe veut faire oublier. Dépositaire farouche de la grande
idée, l'unité de Dieu, elle a conservé avec une opiniâtre constance ce trésor
inviolable ; elle s'en est enorgueillie, et, trop faible pour soutenir les
prétentions de sa fierté, elle a irrité et armé le monde. Le peuple d'Israël, dit le Deutéronome, est un peuple de choix... supérieur
à tous les autres[137]. La haine de
l'étranger est son principal caractère. Moïse gradue comme il suit l'antipathie
sacrée des Israélites contre les autres peuples : ils doivent haïr, 1° les
Amalécites ; 2° les Chananéens ; 3° les Ammonites et les Moabites ; 4° les
Égyptiens, et enfin les Édomites. Sois béni,
répètent encore aujourd'hui, dans leurs prières, les Hébreux fidèles à la
loi, Dieu qui as choisi ton peuple avec amour !...
Toi qui ne nous a pas faits comme les autres.
Le Talmud va plus loin : on y lit ces paroles : L'univers n'a été fait que pour les Juifs[138]. — Nulle nation, dit le Deutéronome, n'a son Dieu aussi proche, et nous l'invoquons pour toutes
choses[139]. — L'imprécation
et l'anathème contre les nations que Dieu n'a pas choisies retentissent dans Isaïe,
dans les Psaumes de David et dans les Machabées. Pour la
première fois, l'apôtre Paul vint proclamer, d'après le Christ, la fraternité
humaine : Entre le Juif et le Grec, dit-il, il n'y a point de différence[140]. Mais de son
vivant même et du temps de Josèphe, on lisait sous les portiques du Temple
les malédictions d'Isaïe contre l'étranger, son culte, ses mœurs et ses
idoles. Dans les Machabées, mêmes anathèmes : Moi,
passer aux coutumes étrangères[141], s'écrie
Éléazar ! j'aime mieux la mort. Je ne veux point
trahir la loi nationale[142].
C'est une curieuse étude que celle de la transformation
subie par les deux livres des Machabées sous la plume de Josèphe. Il les
change en héros stoïques ; il ne laisse pas trace de cet invincible
attachement aux mœurs judaïques qui fait le fonds du récit ; il efface
complètement ce fanatisme indomptable, pour ne laisser paraître que la force
morale dans les supplices, et se mêler ainsi aux déclamateurs païens. C'est un thème très-philosophique que je soutiens,
dit-il au commencement de son ouvrage ; et ce thème, un peu moins éloquent
que les amplifications de Sénèque sur la souveraineté
de la raison, contredit formellement les idées et les principes de
l'hébraïsme : c'est un contresens moral dont Josèphe connaît la portée. Les
Machabées et leur mère n'obéissent plus à Jéhovah et à Moïse ; ils songent
seulement à la sagesse stoïque, à l'εύλογιστία,
à la volonté raisonnable, que Cicéron
a si bien décrite, d'après Carnéade[143]. Ce n'est point
une volonté raisonnable de se refuser obstinément à manger de la chair de
porc Éléazar et les Machabées, dans le récit original, veulent rester fidèles
aux lois de Dieu, Dei leges[144] ; ils ne
veulent point abandonner les coutumes nationales[145]. A quatre-vingt-dix ans, s'écrie Éléazar, je ne passerai point aux coutumes étrangères[146]. Josèphe lui
attribue une longue harangue explicative, et lui fait dire qu'un bon citoyen doit respecter la loi dans les petites
comme dans les grandes choses. Cet appareil de subtilités n'a aucune
analogie avec le texte ; les frères Machabées ne prétendent point remporter
les palmes de la vertu[147], mais ils
craignent de devenir Grecs, et d'abjurer leur patrie en mangeant des viandes
prohibées[148].
Dieu les voit ; Dieu les consolera[149] s'ils
succombent. C'est la patrie qu'ils croient défendre. Leur mère, pour les
encourager, leur parle en hébreu et leur rappelle que Jéhovah est plus grand
que les rois terrestres[150]. C'est le
monothéisme qui lui inspire ce mouvement sublime : Je
ne suis pas votre mère ; je ne sais comment vous avez paru dans mon ventre ;
mais celui qui vous a créé, qui a fait vos nerfs et vos muscles, c'est le Créateur
du monde, et on vous ordonne de l'abjurer[151]. Au lieu de
cette allocation terrible, Josèphe invoque la raison abstraite, la sagesse
métaphysique, le système philosophique. Je ne te
démentirai pas, loi souveraine ; je ne te repousserai pas, abstinence chérie
; je ne te déshonorerai pas, raison philosophique ![152] A la un de
cette belle déclamation, Josèphe s'écrie encore : Ô
raison, maîtresse des passions ![153] En vain
voudrait-on enlever à Josèphe l'honneur de cette amplification ou écrite ou
commandée par lui. C'est toute sa méthode ordinaire ; le roman mêlé à
l'histoire ; des détails puérils, une description circonstanciée des tortures
infligées aux Machabées, de longs discours placés dans la bouche de chacun
des personnages. C'est ainsi qu'il traduit toujours, à l'usage des Romains,
et toujours en le trahissant, le génie de sa nation.
Je ne pense pas que toutes les additions et tous les
changements introduits par Josèphe dans ses Antiquités aient eu pour
origine cet intérêt politique. La recherche de l'élégance, l'imitation des
Grecs, la crainte de donner prise à la, raillerie par l'exacte reproduction
de la brièveté biblique, peut-être l'admission des commentaires des docteurs
et des gloses populaires ; mais surtout les libres paraphrases de ses collaborateurs
ont concouru à cet ensemble romanesque.
Un des écrivains les plus judicieux de l'Angleterre
actuelle observe avec raison que l'emploi des ornements affectés et le luxe
des détails inutiles prouvent le peu de sérieux de l'historien ou de
l'orateur[154].
Josèphe en est rempli. Samuel Bochart, Leydecker, Le Clerc, dom Calmet, le P.
Gillet, se plaignent sans cesse de ces altérations. On
ne peut savoir, dit Bochart, pour quelle
raison il s'écarte si souvent du texte sacré. C'est que Josèphe veut
composer un livre agréable. Il n'a pas d'autre raison que Varillas ou le P.
Berruyer, pour imaginer ou adopter un roman sur Caïn, chef de brigands, inventeur des poids et mesures[155] ; sur les connaissances stratégiques de Jacob disposant son
arrière-garde et son avant-garde, pour aller à la rencontre de son frère[156] ; sur la
jeunesse de Moïse, dont il fait, longtemps avant l'auteur de Moïse sauvé[157], une pastorale
élégante[158]
; sur les trésors incalculables, ensevelis par Salomon dans le tombeau de
David[159],
et qu'il suppute comme s'il les avait vus et touchés ; sur Nabuchodonosor,
dont il ne trouve pas l'histoire asses merveilleuse[160] ; sur les
bandits Asinée et Anilée[161] ; et sur
l'étrange spectacle que, selon lui, Agrippa voulut donner aux Hébreux,
lorsqu'il força quatorze cents de leurs compatriotes, divisés en deux bandes,
à se tuer les uns les autres, sans qu'il en restât
un seul[162]. Le bon père
Gillet, bibliothécaire de Sainte-Geneviève, traducteur de Josèphe et son
apologiste fidèle, a des scrupules sur cette affaire ; il pense que les quatorze cents combattants auraient dû se jeter
sur leurs persécuteurs, et ne pas s'entr'égorger si complaisamment. Il n'est
pas moins embarrassé, quand il veut expliquer l'histoire des cheveux
d'Absalon, qui pesaient deux cents sicles, et que
l'on ne pouvait couper[163] qu'après huit
jours de travail. Ces puérilités ajoutées aux merveilles de la Bible dérangent le sérieux
du bibliothécaire, qui examine à ce propos, dans une note savante, si ces
cheveux n'étaient pas une perruque, si les Syriens et les Égyptiens portaient
perruque, et si le fait matériel raconté par Josèphe est vraisemblable. Selon le témoignage de quelques perruquiers,
ajoute-t-il gravement, les cheveux de certaines
femmes pèsent jusqu'à trente-deux onces[164]. Ici, comme
ailleurs, il se donne une peine infinie pour corriger Josèphe, pour
l'accorder avec lui-même, et lui prêter, en supposant quelque erreur de
copiste, un sens à peu près raisonnable. Il refait Josèphe à tout moment, par
considération pour cet écrivain.
Le roman inventé par Josèphe ou ses scribes est-il trop
développé et trop important, pour qu'on l'attribue à l'interpolation d'un
copiste ; le P. Gillet se rejette alors sur les Deutéroses
(Δευτερώσεις)
ou sur les traditions secondaires que Josèphe a pu recueillir dans le temple,
adopter et introduire dans sa compilation. Quand même on admettrait cette
hypothèse, ce n'est point un procédé judicieux, c'est le travail d'un
romancier frivole de mêler ainsi, dans une histoire sérieuse, la tradition
orale et populaire aux écrits consacrés. Justinien condamne les Deutéroses, nommées par les Israélites Mischna. Sa Novelle cent quarante-sixième,
relative aux Hébreux, déclare indignes de foi, comme n'étant point comprises
dans les Livres saints, et n'émanant ni de Dieu ni des prophètes[165], les traditions
vagues ou Deutéroses dont on avait rempli, aux IIe et IVe siècles, la Mischna, ou Loi
répétée, et la Guémarah,
ou le Complément. Buxtorff[166] et Bartolocci[167], ainsi que
Maimonide et Moïse Mekkotzi, conviennent qu'il faut attacher peu d'importance
à ces traditions orales, dont les premières furent publiées en 230, et qui
n'avaient été avant cette époque confiées qu'au souvenir des docteurs. Le Thalmud
babylonien, qui les comprend toutes, effrayant amas de folie et de
sagesse, accumulées par cette nation éperdue avec la précipitation du
désespoir, n'offre, dans les parties qui ont été traduites, aucune analogie
avec les embellissements et les amplifications de Josèphe. Son système de
composition est hellénique ; il emprunte les formes oratoires et les détails
fleuris dont il parsème ses narrations aux déclamateurs sortis des écoles
grecques et surtout de l'école alexandrine. Quant aux contradictions du même
écrivain, le P. Gillet ne sait trop comment les expliquer. Les contradictions, a dit-il, et les altérations naissent pour ainsi dire à chaque pas...
Je suis obligé de dire si souvent que le texte est altéré
et qu'il se contredit soi-même, que j'ai tout sujet a de craindre qu'une si
fréquente répétition ne soit importune et à charge[168]. Ces prétendues
altérations du texte nous semblent chimériques. Dans beaucoup de
circonstances, il est facile d'assigner un motif aux inventions du narrateur.
S'il donne pour un guerrier célèbre[169] Isaac, si patient
sous les insultes des pasteurs du roi de Gérare, c'est qu'il veut relever ce
patriarche aux yeux des Romains. Les longues harangues, souvent ridicules,
toujours emphatiques, qu'il prête à Daniel[170], à Éléazar[171], à Moïse[172], et même à Dieu,
qui justifie le Déluge[173] et s'exprime comme
l'Apollon d'Homère, sont des imitations évidentes des discours politiques de
Thucydide et des harangues de Tite-Live. Nous serions fort tentés de croire
ses collaborateurs, coupables de ces paraphrases brillantes. Le morceau
oratoire que prononce Hérode dans les Antiquités[174], et celui que
la même circonstance est censée lui inspirer dans la Guerre judaïque[175], diffèrent
complètement et paraissent dus au génie fécond de deux amplificateurs
différents, qui se sont exercés sur le même sujet. De cette broderie
surajoutée aux traditions, Josèphe a soin d'éliminer tout ce qui peut blesser
les Romains civilisés ; il supprime, par exemple, les singularités de
l'histoire de Jonas[176] ; il ne parle
ni du veau d'or, ni de l'étrange ex-voto des cinq bijoux en or, qui eussent
fait rire les philosophes[177] ; ni de l'envoi
des soixante trophées de la circoncision, dont l'explication est difficile à
donner en bon français[178]. Selon Josèphe,
ce sont soixante têtes coupées, et non sexaginta prœputia, que David fait parvenir à
Saül. Selon lui, les prêtres ne renferment pas dans une cassette, auprès du
tabernacle, quinque podices (objets peu convenables), mais cinq images
d'or[179],
ce qui déguise fort décemment l'incongruité de l'ex-voto. De telles
substitutions ne sont pas l'effet de la négligence ou de l'oubli. La Bible offrait dans ces
passages un sens oriental, dont la nudité et la bizarrerie eussent paru justifier
les reproches de Tacite[180]. Josèphe y
substitue les idées et les objets familiers à la civilisation romaine. Deux
mots, enfin, ne sont pas prononcés dans le cours entier des œuvres de
Josèphe, les mots sacramentels du judaïsme : le Messie,
ou le fils de Dieu ; et Sion (Tsiône), la montagne sainte. Son silence
lui épargne la difficulté d'une explication. À chaque période d'oppression
succède un Messie [Mochia],
un Sauveur, un Libérateur attendu. En parler, ce serait porter ombrage aux
maîtres ; il se tait donc. Au moins devrait-il ne pas répéter si souvent
qu'il est le plus fidèle des traducteurs, qu'il copie textuellement les livres
sacrés, et qu'il ne se permettra pas l'altération la plus légère.
Moyennant ces réticences, ces omissions et ces
embellissements, un Israélite sans probité pouvait donner aux Romains quelque
idée, mensongère il est vrai, des traditions anciennes de sa patrie, et y
ajouter l'histoire judaïque depuis les Maccabées jusqu'au règne d'Hérode.
Hais une fois parvenu à l'époque du grand conflit entre la nationalité juive
et la toute-puissance romaine, l'embarras devenait excessif. Il y avait là
deux passions en regard, deux obstinations également acharnées, deux génies
inconciliables dont l'un avait écrasé l'autre et tenait l'historien sous sa
main. Si Josèphe eût été le compatriote et le compagnon d'armes des vainqueurs,
rien n'eût été plus facile que de s'écrier : Malheur
aux vaincus ! les dieux de Rome triomphent ! Mais Josèphe
est resté Juif ; c'est en qualité de prophète qu'il a reconstruit hardiment
sa fortune. Il ne peut ni blasphémer sa patrie, ni irriter Rome victorieuse.
La difficulté de cette situation de Juif demi-apostat, de citoyen romain né
en Orient, d'Italien adoptif et de prophète civilisé, situation
extraordinaire et unique, ne l'a point effrayé. Nous verrons bientôt par
quels ménagements il a tout concilié dans sa Guerre judaïque, celui de
ses ouvrages qui excite le plus d'intérêt et mérite le plus d'attention.

III. — LA
GUERRE JUDAÏQUE. — LE TRAITÉ CONTRE APION.
Un fait qui ne contribuait pas à la gloire de l'historien
facilitait son entreprise. Des défenseurs de Jotapat, il ne restait que lui. Josèphe
seul avait racheté sa vie en pactisant^ avec l'ennemi et en flattant l'avenir
du vainqueur. Les quatre-vingt-dix mille captifs de Jérusalem, traînés en
servitude, jetés dans les carrières d'Egypte, ou périssant de faim sur les
routes, n'avaient pas d'éloquence à opposer au narrateur ; dix mille d'entre
eux fournissaient aux boucheries des cirques la pâture de leurs corps. Qui
donc pouvait le contredire ? Peut-être quelque Juif obscur, étranger à Jérusalem
; Juste de Tibériade l'osa, et Josèphe le fit taire au nom des maîtres du
monde. La famille des Flavius, marquée du sceau divin par l'invention de sa
prophétie, se portait sa caution ; Titus venait de parapher de sa propre main[181] l'œuvre du
panégyriste ; l'allié de Rome, le roi Agrippa, certifiait l'authenticité des
faits[182].
L'accusateur n'avait rien à répliquer, ces témoignages des parties
intéressées, que Josèphe avait louées ou défendues, et qui le soutenaient à
leur tour. Il avait donc le champ libre. Supposer des motifs, satisfaire ses
haines, disposer ses acteurs, arranger son drame, tout lui était permis :
point de contrôle, rien à redouter des Juifs, rien même des Romains, pourvu
que les Flavius fussent contents. Il s'y prenait à merveille pour cela.
Poppée devenait l'amie des dieux ; Domitien était éclatant,
sublime[183], digne de son père par la grandeur de l'âme ; Rome
devait la souveraineté du monde non au destin, mais
à la vertu[184]. Les limites de son empire, dit Josèphe, sont l'Euphrate, l'Océan, le Danube, le Rhin, l'Afrique ;
quoi d'étonnant[185] ? τί
θαυμαστόν ; — Les maîtres sont aussi grands que le domaine.
On ne peut être surpris que Rome lui ait élevé une statue.
Le chapitre dans lequel la sagacité politique[186] de Josèphe a
développé les causes de la grandeur romaine, contient le germe de plus d'un
passage de Machiavel et de Montesquieu. Il démontre avec autant de profondeur
que de finesse, la conquête du globe opérée par la puissance de la
discipline. Rien d'inconsidéré, rien d'étourdi, rien
qui ne soit réglé d'avance[187]. Puis, après
cette analyse digne d'un maître, il descend des hauteurs que son intelligence
a gravies, pour tomber dans les bassesses que sa flatterie lui dicte, et il
loue jusqu'aux goujats de Rome (calones, οί
παμπληθεΐς), qui, dit-il, partageant
les dangers de leurs maîtres, leur cèdent a sans doute, mais ne cèdent qu'à
eux[188].
Tous les nobles ennemis de Rome, Mithridate, Cynobeline, Vercingétorix,
Arminius, Caradoc et les héros juifs, ne valaient donc pas un goujat romain.
S'étant ainsi prosterné, il ajoute lestement qu'il n'a pas voulu louer les
Romains, mais consoler[189] les vaincus : pauvre et misérable
consolation !
Il a soin de placer ce panégyrique immédiatement avant le
récit des troubles qui suivirent à la mort d'Hérode. Il prépare ainsi ses
lecteurs à la bienveillance, et ces lecteurs sont citoyens de Rome. Il
n'insulte pas ouvertement sa patrie ; au contraire, il la fait valoir en
exaltant ceux qui l'ont domptée. Il ose dire du mal d'un procurateur mort,
dont tout le monde en disait, de Gessius Florus ; et c'est ainsi qu'il assure
ses droits au titre d'historien véridique et à l'adhésion de l'avenir. Mais
d'où vient l'insurrection des Juifs ? qui l'a causée ? Il en révèle les
symptômes l'un après l'autre, jamais le mobile. Il se garde bien de pénétrer
dans la philosophie des faits comme Polybe ; il ne les groupe pas comme
Thucydide ; il ne remonte pas à leurs causes, comme Tacite ; il n'indique
point les sources des mouvements et des passions ; il se contente d'accumuler
les détails. Ainsi Pilate veut introduire à Jérusalem les effigies de César,
Caligula ordonne la consécration de sa statue dans le sanctuaire, un soldat
de Cumanus insulte le peuple, un citoyen dépose des oiseaux dans un vase
destiné aux cérémonies du culte, les troupes de Florus ne rendent pas le
salut aux Hébreux. La signification de ces faits est supprimée ; la raison
logique leur manque, et leur succession ne laisse aucune trace dans l'esprit.
Tous ils jaillissent du même fond et remontent à la même source ; Josèphe ne
le dit pas. Cette cause est la fatigue et le désespoir, naissant des intérêts
blessés, des croyances outragées, de la fierté humiliée, de l'existence
Israélite compromise depuis deux cents ans. Après deux siècles de souffrance,
la révolte éclate : on s'arme ; des bandes organisées parcourent les
campagnes et animent l'insurrection ; Jérusalem se remplit de groupes furieux
et d'assemblées populaires. Les révoltés assiègent une légion romaine que le
gouverneur de Syrie vient délivrer ; Agrippa, l'ami des Romains, est chassé
de Judée, et les vingt mille hommes de Gestius Gallus sont battus. A la tête
des insurgés, se place le grand-pontife Ananus, probe,
vénéré, désintéressé, modéré, dit Josèphe, qui soutient les
combattants et conseille au peuple de repousser les Romains, de prouver la
forcé d'Israël, et d'acheter ainsi une honorable paix. Contre lui s'élèvent
les Pharisiens et les riches, familiers avec la bassesse, attachés à la
famille d*Hérode, soumis ou vendus à Rome, et qui inclinent vers l'humble
silence et le prompt paiement du tribut qu'exigent les envahisseurs. La masse
du peuple frémit de colère : jeunes gens, prêtres, femmes, âmes exaltées et
véhémentes, maudissent le pharisaïsme qui délaisse la patrie. La nation se précipite
comme un seul homme à la voix de ces chefs. Exterminez,
criaient-ils, quiconque traite avec l'ennemi,
frappez les lâches, retranchez d'Israël ceux qui ne veulent pas mourir avec
Jérusalem !
Non seulement c'était du fanatisme, mais toute l'institution
juive le rendait plus redoutable et plus farouche. Elle ne reconnaissait que
Dieu pour maître, l'inspiration immédiate pour guide, et le zèle était sa
vraie loi. De là cette terrible ferveur de ceux que Josèphe, dans son prudent
mensonge, appelle les Fanatiques, Ζηλωταί (Zélés),
ou Σικάριοι
(Porte-Poignards),
ou Λησταί (Brigands),
ou Ίδουμαΐοι
(Iduméens)
; quatre armées de bandits, à ce qu'il prétend ; les défenseurs et les
vengeurs désespérés de la patrie, dans la réalité. D'abominables cruautés
durent se commettre. A l'imminence du péril, à la ruine prochaine du pays, à
la désolation du temple se joignait, pour les précipiter dans la frénésie,
l'influence de cette législation orientale et judaïque, à la fois loi et
dogme, ivresse et devoir[190], qui ordonne au
citoyen de se faire législateur, juge et vengeur, dès que la loi est attaquée
dans sa source ; loi du zèle, à laquelle l'historien ne fait jamais allusion
; magistrature du bourreau, vengeance de Dieu devenu citoyen et du citoyen
devenu Dieu ; droit de la fureur, aussi blâmable en théorie que dangereux en
fait, mais qu'on ne pouvait extirper qu'avec les racines asiatiques du culte
législatif et de la législation sacrée institués par Moïse. La jurisprudence
spéciale du zèle est consignée dans le Code
du Sanhédrin[191], qui en énumère
les différents cas légitimes, et dit en quelles circonstances les a enflammés
du zèle de Dieu doivent exercer leur terrible
office. Au XIIe siècle, Maimonide admet encore cette législation[192]. Selden pense
que Jésus, lorsqu'il chassa du temple les marchands, usa du droit du Zèle.
Embrasé par l'égoïsme oriental, par les traditions d'Israël, par une longue
oppression, par la mort nationale qui approchait, ce zèle dut éclater par des
crimes.
Josèphe a calomnié sa nation, non parce qu'il les a redits,
mais parce qu'il en a tu les causes. Il arrache le bénéfice de la pitié à des
hommes qui eussent vécu paisibles, si l'impatience de souffrir et
l'impuissance de se venger ne les eussent jetés dans la rage. Il falsifie la
portion morale de l'histoire, il en altère l'âme ; plus coupable que s'il
supprimait les événements ou les déguisait. Dans sa crainte de déplaire aux
Romains, et de laisser entrevoir le courage, la constance, le dévouement,
l'héroïsme de ces fanatiques, il les travestit. Ce n'est pas assez de
raconter leurs violences, il accumule les tableaux chimériques, il les charge
de forfaits inventés et inouïs. Sa lâcheté et son embarras lui font perdre de
vue non seulement la vérité, mais la vraisemblance de son récit. Il imagine a
des hommes vêtus de robes de femmes, parfumés
d'odeurs, couronnés de roses, et tuant tout le a monde sur leur passage[193] ; conte
milésien, qui ne ressemble à aucunes mœurs, qui ne se rapporte à rien, et qui
est sans raison, sans analogie, sans vraisemblance : tout, même le crime, a
une vraisemblance, une analogie, une raison. Il n'explique d'aucune manière
ces démentis burlesques donnés à l'humanité ; il s'étend avec complaisance
sur l'anomalie de ces crimes, comme s'il aimait à les exposer au grand jour ;
il établit dans Jérusalem trois nations d'égorgeurs, qui se livrent une
guerre d'extermination et se réunissent contre les honnêtes citoyens ; il
adjoint à ces voleurs, à ces zélés, à ces sicaires,
les paysans de l'Idumée, qui accourent aussi
pour prendre leur part à ces saturnales. Tout cela se plonge et se vautre
dans la boue et dans le sang, en face du temple, en présence de l'ennemi, au
milieu d'une vaste orgie. L'écrivain ne prête à ces horreurs nul motif, nul
intérêt de cupidité ou de domination ; ce sont les passe-temps d'un caprice
voluptueux et meurtrier.
Ces monstruosités sont démenties par le petit nombre de
faits avérés que Josèphe est obligé d'admettre comme canevas de sa narration.
Les pharisiens, les riches et les vieillards demandaient la paix et couraient
au devant du joug des Romains. Les jeunes, les forts et le peuple[194] voulaient
combattre et mourir. C'est dans le temple qu'ils se rassemblaient[195], c'est de là
qu'ils s'élançaient sur l'ennemi. Avant de baigner les parvis de leur sang[196], ils jetèrent
en prison les partisans de la paix ; ils élurent un pontife sorti du peuple[197]. Nous ne
doutons pas qu'ils n'aient commis d'affreuses barbaries. Mais le crime de Josèphe
est d'avoir exagéré les excès, d'avoir calomnié les intentions, d'avoir
présenté comme des voleurs les derniers défenseurs de leur pays, et comme un
amas de chimériques infamies l'insurrection désespérée du peuple contre les
conquérants que le pharisaïsme encourageait. Il faut avoir vécu dans des
temps de troubles pour savoir toute la facilité du mensonge politique, pour
comprendre l'étendue de celui de Josèphe, et reconnaître qu'il ne pouvait ni
se passer de cette base frauduleuse, écrivant pour les Romains, ni satisfaire
Rome sans rejeter le crime de la révolte sur des morts, ni livrer au monde
autre chose qu'un travestissement de l'histoire.
Revenons au commencement de la guerre. Les chefs des
insurgés s'étaient déclarés les ennemis personnels de Josèphe. Ils essayèrent
de le déposséder de son gouvernement et n'y purent réussir. Cependant Vespasien,
à la tête de soixante mille hommes, vient anéantir cette nation rebelle qui
ose s'insurger contre Rome. Titus et Trajan assiègent Japha, Céréalis marche
contre Joppé, Vespasien prend Jotapat ; passe au fil de l'épée la garnison et
les habitants, et ne laisse vivre qu'un seul homme, Josèphe, qui lui promet
l'empire. Quand on apprit ces choses à Jérusalem,
une violente haine s'éleva contre Josèphe ; on l'appela traître et lâche ; un
cri universel répéta contre lui mille imprécations[198]. Il suit le
vainqueur. Une année s'écoule avant que les conquêtes qui devaient précéder
le siège de Jérusalem fussent terminées. II fallut cinq mois de combats
sanglants, livrés le jour comme la nuit, et deux terribles auxiliaires, la
famine et l'incendie, non pas pour réduire, mais pour exterminer les
assiégés. Chaque position devient une ville nouvelle et exige un siège
nouveau. L'histoire a vanté le dévouement des guerriers de Numance ; elle a
respecté l'héroïsme des Gaulois, des Bretons et des Bataves, qui, à la même
époque, soulevaient leur tête fatiguée. Les Juifs de Jérusalem seront-ils
maudits par l'histoire parce que leur dévouement a été plus complet et leur
courage plus invincible ? Non. Mais il y avait dans le camp romain un
Juif transfuge, spirituel et traître, qui s'est chargé de mentir devant la
postérité. C'est son récit qui a trompé l'histoire, et l'immense crédulité
des siècles doit étonner le philosophe ; car son récit est un tissu de
chimères, dont la fausseté apparaît d'elle-même. Il prétend avoir choisi pour
tribune une montagne ; de cette élévation, il harangue, à ce qu'il prétend,
les factieux de Jérusalem. Il rapporte textuellement ces oraisons qui ne
manquent pas d'une certaine faconde, mais qui ne s'accordent ni avec les
circonstances d'une telle guerre, ni avec les probabilités locales. Du sommet
de sa montagne, exposé aux balistes romaines et aux machines des Juifs,
l'historien affirme avoir parlé deux heures de suite pour engager ces
derniers à se rendre. Jetez vos armes,
Ριψατε τάς
πανοπλίας, leur dit-il[199].
Leur réponse est plus vraisemblable que son allocution. Malédiction à César et à son père ! criaient-ils du
haut des remparts ; nous méprisons la mort, meilleure que la servitude ; nous
ferons aux Romains, tant que nous respirerons, tous les maux possibles. Nous
allons périr avec la patrie et avec le temple ; la patrie et le temple ne
nous inquiètent plus. Dieu a un temple plus magnifique, c'est le monde[200]. Mot sublime
qu'on n'a pas cité et qui est digne de l'être. Ce sont précisément les
paroles que devaient lancer à leurs assiégeants ces hommes désespérés. Ainsi
la vérité tombait quelquefois de la plume de l'historien. Tout en vantant la
clémence de Titus, il avoue que ce général poussa vers la ville une foule de prisonniers
juifs, les mains coupées[201], et qu'il en
fit pendre un grand nombre à des gibets élevés devant les murs. Le bois manquait aux gibets et les gibets aux cadavres[202]. Simon, fils de
Gioras, et Jean de Giscala déployèrent, dans ces circonstances suprêmes, un
courage et une habileté auxquels Josèphe, leur ennemi, ne rend aucune
justice, mais que les faits attestent. Quand il n'y avait plus de vivres
d'aucune espèce à Jérusalem et que les remparts, la citadelle, le temple
furent détruits, Simon et Jean essayèrent de gagner la campagne ; Josèphe les
accuse de manquer de courage. On trouva Jean mourant de faim dans une caverne
après le pillage et la dévastation de la ville ; abattu, exténué, il demanda
la vie. Simon, âme plus forte, se cacha longtemps sous les ruines du temple,
et enfin sortant comme un spectre du fond de la terre que recouvraient des
cendres, il apparut, pâle, enveloppé d'une robe blanche et un manteau de
pourpre flottant sur ses épaules[203]. Qui es-tu ? lui demandent les soldats effrayés. — Faites venir votre chef et je le dirai. Térentius
Rufus lui demande son nom, qu'il déclare. C'est ce même Simon qui, réservé au
supplice, passa devant Josèphe, devenu Romain, pendant la pompe triomphale.
Quant à Jean de Giscala, les vainqueurs le condamnèrent à des fers perpétuels[204]. Ces degrés de
clémence correspondaient aux degrés d'infamie. Au plus brave, la mort ; au
rebelle suppliant, hi prison ; à la perfidie habile, les honneurs.
Comment peut-on ajouter foi aux détails que Josèphe a
donnés sur cette guerre, à ses imprécations incessantes contre les défenseurs
de Jérusalem et à ses adulations innombrables. Il prétend que les sources
voisines, qui vivaient tari pour les Juifs, se rouvrirent tout à coup en
faveur des Romains[205]. Dion Cassius
est plus véridique ; il convient que les assiégeants manquaient d'eau et
qu'ils souffrirent beaucoup[206]. Quant à la
peinture effroyable des supplices, des forfaits, des carnages et des orgies,
dont Jérusalem affamée fut le théâtre, une seule question suffit pour les
détruire. Comment a-t-il pu savoir ces détails hideux ? Il ne se trouvait pas
dans la ville ; il n'a dû les apprendre, ni des prêtres, ni des grands, ni
des soldats massacrés, mais seulement des femmes, des enfants et des
vieillards, captifs misérables, traînés dans les marchés et dans les cirques
; pauvres restes d'Israël avec lesquels l'heureux habitant de Rome eut fort
peu de relations sans doute. Par quelle audace cet homme que Voltaire a
dévoilé en une seule et lumineuse expression, quand il l'a nommé l'exagérateur Josèphe[207], entre-t-il
dans les plus obscènes et les plus atroces particularités d'un drame qu'il ne
connaît pas, auquel il n'assistait pas et qu'il n'a pas vu. La même
perversité de goût littéraire, la même avidité d'amplifications romanesques,
dont la Bible
falsifiée offre mille preuves, nous ont valu cette mère qui tue et mange ses
enfants[208]
et tous ces faits ridicules, dont le souvenir des hommes a daigné se charger[209]. C'était d'ailleurs
la nécessité de Josèphe, de mentir. En inculpant ses compatriotes, il se
disculpe. S'il ne prouvait que les martyrs de Jérusalem étaient des monstres,
il resterait convaincu d'infamie. Défenseur de son intérêt comme de sa
vanité, il n'épargne ni les apologies aux Romains, ni les injures à ses
ennemis, ni les éloges à Flavius Josèphe. Il exige de ses lecteurs une
crédulité excessive, quand il rapporte que les sacrificateurs
le consultaient, à quatorze ans, sur l'intelligence des lois ; assertion qui répugne à Boivin[210] et scandalise le bon père Gillet
lui-même[211]. Il prétend, ailleurs, que, doué
de plus de vigueur que la plupart des hommes, il a
nagé une entière nuit[212], après le naufrage de son vaisseau ; il raconte
par quel prodige de son éloquence quarante personnes réfugiées dans une
grotte, et voulant le tuer, parce qu'il parlait de se rendre, se laissèrent
convaincre, suivirent ses avis, tirèrent au sort à qui égorgerait le premier
son camarade, se poignardèrent les ans les autres pour éviter le péché du
suicide, et ne laissèrent en vie que Josèphe et un de ses compagnons. Se
jeter sur le glaive, tenu par la main d'autrui, n'est-ce pas le suicide même,
sous une forme légèrement variée ?
Cet égoïsme vaniteux de l'historien se manifeste, tantôt
par des historiettes de ce genre, tantôt par de graves omissions. Ainsi, tout
occupé de lui-même, il néglige de dire quels furent, au commencement de
l'insurrection, les préparatifs militaires et les succès variés de ses
collègues, chargés du gouvernement des autres provinces. II ne parle d'eux
qu'à propos de lui. Le siège d'une seule ville, Jotapat, usurpe un livre
entier ; c'était lui qui la défendait. Les autres actions de la campagne sont
omises ou brièvement résumées. Parait-il devant Vespasien ? Tous les yeux
sont fixés sur Josèphe ; on s'attroupe, on s'étonne, on le plaint, on le blâme,
on le loue ; il existe seul dans la Judée, ou plutôt seul dans le monde. A
l'entendre, il est l'homme nécessaire, l'homme attendu, le prophète. Il a, dit-il, étudié toutes
les sectes ; il a même vécu dans le désert, avec un nommé Banus, pour
connaître la vie contemplative[213]. Il est
philosophe, orateur, diplomate, guerrier, poète, prêtre, avocat.
Ce dernier talent est celui que je lui contesterais le
moins. Il faut l'entendre plaider la cause des Juifs contre Juste de
Tibériade, et réfuter les accusations des Alexandrins et des Grecs,
personnifiés par lui sous le nom de ce célèbre Apion qui fit tant de livres
et dont nous n'avons pas une page. L'audace insultante de sa défense ne
l'expose à aucun danger ; il peut attaquer et dénoncer à son aise toutes les
faiblesses de l'ingénieuse Grèce ; sa pénétration ne déplaira point aux
Romains. Quel droit avez-vous, dit-il aux Grecs,
de parler contre notre antiquité ? Vous êtes d'hier,
vous ne savez écrire que des fables ; il vous suffit de quelques traditions
orales pour bâtir des édifices de mensonges. Votre Homère que vous vantez est
un problème ; et l'on n'est pas certain qu'il ait écrit ses poèmes. Vos
historiens arrogants ne songent qu'à rivaliser de belles paroles, pour flatter
ou les villes ou les rois. Quant à nous, un petit nombre de livres sacrés
nous suffit ; et ils sont d'accord. Je les ai fidèlement traduits. On
dirait un esclave qui en battrait un autre, devant le maître commun. Deux
faits curieux se présentent ici. D'abord ces invectives contre la Grèce ont été sans
doute traduites ou corrigées par des Grecs, comme l'avoue l'historien dans un
passage que nous avons cité plus haut ; tant la dignité humaine s'était
abaissée et avilie à l'ombre de la tyrannie universelle. Puis c'est Josèphe,
si constamment infidèle, même dans les sujets frivoles, qui attribue à la Grèce l'habitude du
mensonge historique, et qui le réprouve. Mais lui, tout ce qu'il touche
s'altère ; il emploie à chaque instant la nuance équivoque et intermédiaire
qui, confondant le vrai et le faux dans un crépuscule romanesque, force la
vérité de mentir.
Tout le favorisait ; et, dans les temps modernes, il a
trouvé des partisans nombreux parmi les chrétiens abusés. A peine quelques
esprits pénétrants ont-ils osé douter de la véracité partielle des faits
qu'il raconte. Le dernier historien des Juifs, J. M. Jost, savant Allemand[214], ne trouvant à
consulter que Josèphe sur toute l'époque d'Hérode et celle de Vespasien, a
défendu résolument le témoignage de l'unique auteur sur lequel il pût s'appuyer.
Mais ses raisons sont bien faibles. Les meilleurs
d'entre les critiques, dit-il, ont lavé
Josèphe des accusations nombreuses intentées contre lui ; son amour pour la
vérité a été prouvé aux a dépens d'écrivains plus modernes, d'Eusèbe, du
Pseudo-Philon, du Pseudo-Hégésippe, du pitoyable Hébreu Josippon, et de
beaucoup d'autres inconnus tant romains que grecs-romains, et des légendes
thalmudiques[215]. (Die
besten critiker…. haben den jüdischen
geschichtschreiber von so vielen verleumdungen gerettet, und seine wahrheitsliebe
auf kosten des spœtem Eusebius, des Pseudo-Philo... etc. …. und mancher nngenauen Rœmischer und Griechisch-Rœmischer
skribenten, ....unverkennbar dargetban....) Quoi qu'en dise l'auteur
allemand, je ne pense pas que le P. Gillet et Prideaux soient de meilleurs
critiques que Bayle, Voltaire et Basnage[216]. Quand même
Eusèbe, Philon et le prétendu Josippon, auraient tort contre Josèphe, cet
avantage ne prouverait rien. Ce ne sont pas eux que l'on peut opposer à
l'historien juif ; c'est la
Bible ancienne qu'il prétend traduire et qu'il défigure ;
ce sont les faits qu'il prétend transmettre et qu'il arrange ; c'est
l'évidence même des choses et de sa situation personnelle qui s'élèvent à la
fois contre lui. Par une singularité remarquable, tous les écrits de la même
époque[217],
relatifs aux événements auxquels il a pris part, sont perdus ; on ne peut
contrôler son récit qu'au moyen de quelques lignes de Suétone, de quelques
phrases de Tacite, et de quelques
pages de Dion Cassius ; cette même destinée, qui l'a protégé vivant contre
les récriminations de ses frères, l'a protégé mort contre la justice de l'histoire.

IV. — CONCLUSION. - VALEUR HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DE FLAVIUS JOSÈPHE.
Si je regarde Flavius Josèphe comme un guide
très-dangereux, comme un interprète infidèle et intéressé, non seulement des
traditions judaïques, mais des faits contemporains et du génie de l'histoire,
non seulement de l'esprit de son temps, mais de celui de sa race, je ne
prétends point diminuer sa véritable valeur. Il faut rarement le croire, mais
il faut toujours l'écouter. Ses mensonges mêmes sont des lumières. S'il
essaie d'obscurcir et d'embrouiller les événements qui se passèrent en
Palestine, il laisse tomber en dehors de ce cercle et bien loin dans l'avenir
des enseignements curieux. Il sent et il comprend, sans se l'expliquer à
lui-même, ce mouvement de civilisation, qui brise l'unité judaïque, qui va
briser l'unité romaine, toutes deux exclusives, et qui élargira bientôt le
cadre des destinées humaines. Sous ce rapport, Josèphe, malgré son pharisaïsme,
ses remarques puériles sur les nombres, sa superstition du détail, ses
habitudes juives dépravées, cède à je ne sais quelle impulsion demi-chrétienne,
mêlée de stoïcisme, de platonisme mal compris, et de souvenirs esséniens mal
digérés. Après avoir exposé toutes les partialités de cet historien, toutes
les concessions de cet homme politique, toutes les lâchetés de ce citoyen
apostat, il serait injuste d'oublier que la sagacité de son intelligence
compensa, jusqu'à un certain point, les faiblesses ou les malheurs de sa
conduite. Le dévouement et le sacrifice restèrent inconnus à cette âme
intéressée ; mais le développement des sociétés se fit sentir sourdement à
cet esprit vigilant et alerte. Il fut infidèle à ce qui tombait en ruines ;
il passa toute sa vie à défigurer et à mutiler ces ruines ; mais il eut
l'intérieure et vague révélation de ce qui devait naître un jour. Il ne fut
ni vrai, ni grand, ni honnête ; seulement un confus et lointain pressentiment
agita sa pensée. L'Allemand Wachler dit avec raison que son mérite est de ne s'être pas contenté des lumières
voisines et hébraïques, et d'avoir essayé la fusion a des lumières étrangères[218]. Grand dessein
pour lequel la vigueur morale lui manquait : il lui eût fallu, au lieu d'une
impartialité inférieure et lâche, une impartialité supérieure et héroïque.
C'est encore une remarque juste de l'écrivain que nous venons de citer, que
le génie spécial du judaïsme, ou, comme il s'exprime, le particularisme (Particularimus) des hébreux cherche à se concilier en lui avec la civilisation universelle
des Romains[219]. Il est Juif et
veut se faire Latin ; il est Oriental et veut devenir Occidental, double
empreinte qui le rend équivoque et louche. Les deux maîtres qu'il sert le
repoussent. Les deux civilisations qu'il veut concentrer le renient. Il n'est
ni du passé ni de l'avenir, et toute sa finesse, toute sa capacité,
n'aboutissent qu'au mensonge.
Il représente ainsi, par ses vices comme par ses qualités,
une destruction commencée ; le moment où l'esprit national et local des
peuples céda, et fut sur le point d'entraîner Rome elle-même dans cette
absorption universelle. La déclamation et l'astuce du Grec, l'orgueil et le théisme
du Juif, la crédulité de l'Oriental, la politique pratique du Romain (et tout cela, c'est le même homme), lui
forment un style mêlé comme sa conduite et comme sa vie. On voit dans ses
pages, ainsi que dans les rues de certaines villes d'Orient, toutes les
physionomies et tous les costumes ; esclaves, hommes libres, soldats,
préteurs, philosophes, prêtres, impératrices, courtisanes, femmes juives.
Syriens, Arabes, Égyptiens, Alexandrins ; le Romain, qui sait obéir et
commander ; le Grec, qui plaît et se laisse séduire ; l'Asiatique, dont la
passion éclate ou dort comme la foudre ; éléments inconciliables et toujours
ennemis ; faisceau impossible à contenir longtemps dans ses liens factices,
mais que la main des Empereurs ne laissa point échapper jusqu'au Bas-Empire.
Toute la portion des œuvres de Josèphe qui se rapporte aux
temps d'Hérode, d'Agrippa et de Vespasien, celle que l'on peut lui attribuer
exclusivement et à juste titre, falsifiée il est vrai, quant à l'esprit
général, mais vive, pittoresque et animée, est d'une vérité de costume que
l'on chercherait vainement ailleurs, et qui comble une vaste lacune
historique. L'amour de l'écrivain pour la description détaillée, pour
l'ornement frêle, pour le luxe des accessoires, pour leur reproduction fine
et servile, se tourne en avantage et en richesse. L'historien blesse le goût,
le romancier amuse l'esprit. Il est impossible d'intéresser plus qu'il le
fait, lorsqu'il ouvre au lecteur le palais d'Hérode et lui montre tout
l'intérieur de cette famille ensanglantée et éperdue de passions. La ruine de
Jérusalem offre le même mérite. Rien de plus dramatique et de plus puissant
que l'ouverture subite des portes du temple, sans qu'une main d'homme les
force à céder, et cette terrible voix qui retentit comme un tonnerre, à
travers le Saint des Saints : ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΜΕΝ
ΕΝΤΕΥΘΕΝ !
Si nous avions à nous occuper ici spécialement du mérite
littéraire de Josèphe, nous détacherions avec soin du reste de ses œuvres les
narrations du siège de Jérusalem et du règne d'Hérode, que la vigueur et la
finesse du coloris ne permettent pas d'attribuer aux collaborateurs de l'historien.
Ce n'est plus la touche vague et molle qui a corrompu la sauvage grandeur de la Genèse, ni la
déclamation fleurie qui règne dans les harangues de Josèphe[220]. Il a deviné le
secret de Richardson, l'intérêt par le détail ; il rend les scènes présentes
et voisines ; il fait couler le sang et siffler la pierre ; il montre un
enfant qui a soif et sa mère qui meurt en lui donnant le dernier lait de sa
mamelle tarie. Un pan de mur tombe, et vous en entendez le fracas ; vous voyez
le nuage de poussière qui s'élève, les membres sanglants et écrasés sont sons
vos yeux. Si ce genre de talent était le génie, on devrait placer Josèphe
au-dessus d'Hérodote, au-dessus de Tacite, au-dessus de Thucydide. Souvent il
marque ses narrations d'un point lumineux, plus vif au regard ; il fait
saillir ses personnages et ses couleurs avec une vigueur plus éblouissante ;
on voit circuler dans ses tableaux une atmosphère plus rare et plus diaphane
que chez ces grands maîtres. Cependant il reste bien au-dessous d'eux.
C'est que leur but était élevé, et le sien vulgaire. Il
voulait être lu. Ces hommes aimaient la vérité, et ils avaient une patrie.
Conservateurs et non destructeurs des traditions, ils n'appelaient pas
l'intérêt sur une famille, un ménage, un roi ou un crime ; mais sur leur
nation, centre et premier acteur de leur drame ; mais sur la vertu nationale,
sur les dieux du pays, sur la foi du pays, sur les douleurs du pays. S'ils
pleuraient comme Tacite l'agonie des grandes vertus publiques, c'étaient des
pleurs sévères qu'ils répandaient, plus touchantes que toutes les élégies du
poète. Enfin Josèphe, homme d'un talent flexible et d'un esprit très-sagace,
eût été peut-être un grand historien, s'il eût été un honnête homme.
FIN DE L'OUVRAGE
|