LA TRIÈRE ATHÉNIENNE - ÉTUDE D’ARCHÉOLOGIE NAVALE
CHAPITRE VI. — LES MÂTS ET LES VOILES.
|
§ 1er. — Du mât en lui-même et de ses diverses parties. Il est fort difficile de déterminer quel était le gréement de la trière ; en effet les textes à consulter sur ce .sujet sont peu nombreux et généralement insuffisants ; en outre, ils se rapportent ordinairement à une époque de beaucoup postérieure à celle de la puissance d’Athènes et contiennent de regrettables confusions. Enfin les monuments figurés nous représentent ordinairement la trière sans voiles, ce qui se comprend à la rigueur, puisque nous avons vu que la trière était avant tout une arme de combat, et que pour aller au combat on déposait à terre les grandes voiles. Mais, chose plus bizarre, la trière est souvent figurée ou sans mât ou avec un seul mât portant une voile carrée, et le plus habituellement les cordages nécessaires à la manœuvre de la voile manquent ou sont très sommairement indiqués à cause de l’exiguïté de la représentation. Nous ferons donc ici ce que nous avons fait jusqu’à présent, c’est-à-dire que nous mettrons en lumière les résultats malheureusement incomplets qui ressortent des textes et des monuments, en passant sous silence les hypothèses individuelles ou en mentionnant rapidement celles qui nous semblent le mieux concorder avec la réalité des faits. Pollux (I, 93), citant Xénophon, partage les agrès du navire en deux catégories : les premiers sont nommés par lui σκεύη κρεμαστά, les autres σκεύη ξύλινα. Toutefois sa citation n’est pas absolument exacte, puisque Xénophon mentionne une autre classe d’agrès, qu’il appelle σκεύη πλεκτά [1]. La division adoptée par les inscriptions navales est la même que celle de Pollux. Elles comprennent, sous le nom de σκεύη ξύλινα έντελή les agrès suivants : Les rames, les gouvernails, les échelles, les crocs, les παραστάται, le mât, les vergues, et, sous le nom de σκεύη κρεμαστά έντελή : les ύποζώματα, la voile, les cordages, l’ύπόβλημα, le κατάβλημα, les παραρρύματα λευκά, les παραρρύματα τρίχινα, quatre câbles de huit δάκτυλοι de circonférence, quatre câbles de six δάκτυλοι, deux ancres en fer. La subdivision introduite par Xénophon, sans être absolument nécessaire, est cependant conforme à la nature des choses. Ces σκεύη πλεκτά, qu’il distingue des agrès en bois et qui servent à mouiller le navire ou au contraire à le mettre en marche, ne peuvent être que les câbles. Les agrès des trières étaient par leurs dimensions distincts des agrès des autres navires et portaient un nom particulier : σκεύη τριηριτικά[2]. Les autres classes de navires ont aussi leurs agrès[3]. Toutes les trières de la République athénienne étant semblables et de mêmes dimensions, les agrès de l’une pouvaient être transportés à l’autre. Bœckh[4] fait cependant remarquer que dans certains cas on employait, évidemment comme auxiliaires, les agrès de navires d’une classe inférieure sur des vaisseaux de la classe supérieure. Ainsi les triérarques qui passent d’une trière à une tétrère ou d’une tétrère à une pentère emportent avec eux leurs agrès. Le principal agrès d’un navire, c’est le mât. Dans les barques primitives, le mât était un arbre de pin ou de sapin, soigneusement arrondi et bien lissé à sa surface, destiné à porter la vergue ou l’antenne à laquelle était attachée la voile. Le navire grandissant[5], le mât grandit aussi. Un seul pin ne suffit plus à l’effort qu’il devait supporter ; il fallut recourir à une combinaison de pièces, véritable construction qui produisit ce qu’on nomma un mât d’assemblage, à la différence du mât d’une seule pièce, ou, comme on dit, d’un seul brin... On attacha à la tête d’un arbre inférieur un arbre moins gros et moins long. C’est ainsi qu’on fit successivement un, deux et trois étages de mâts au-dessus du bas-mât. Les bas-mâts se multiplièrent. On planta un arbre au milieu, un vers la proue, un à la poupe et quelquefois un quatrième tout à fait à l’arrière. Le mât, dans les inscriptions navales et dans Pollux, s’appelle tonde, ce qui est le terme consacré[6]. Il faut d’abord noter que les anciens ne connaissaient que les mâts d’un seul brin. En effet, quand il s’agit de mâter le navire d’Hiéron, on cherche dans les forêts des arbres qui aient les dimensions voulues ; on trouve sans trop de peine le second mât et le troisième ; quant au premier, ce n’est qu’au prix de beaucoup d’efforts qu’on le découvre dans les montagnes du Bruttium[7]. On ne se serait évidemment pas livré à ces recherches, si l’on avait connu les mâts d’assemblage[8]. Les inscriptions navales ne nous donnent, sur les diverses parties du mât et sur les noms qu’elles portaient, aucun renseignement. Ces détails, nous les trouvons dans trois passages importants de Pollux, du Scol. d’Apollonius de Rhodes et d’Athénée[9]. Pollux (I, 91) : La cavité qui reçoit le mât s’appelle ληνός, et la partie du mât qui s’y emboîte anima ; vers l’extrémité du mât, aux environs de la vergue, se trouvent l’ήλακάτη, le θωράκιον, le καρχήσιον, et au-dessus de la vergue l’άτρακτος, où l’on suspend la flamme. Scoliaste d’Apollonius de Rhode[10] : L’ήλακάτη est la partie la plus fine et la plus haute du mât ; au-dessus est le καρχήσιον. Ils hissent donc, dit le poète, les voiles jusqu’au bout du mât... L’ΐκριον est une partie du mât. Eratosthène, dans son Architektonikos, dit : ίστός πτέρνη καρχήσιον θωράκιον ήλαάτη κεραία ΐκριον. L’ήλακάτη est, suivant Eratosthène, la partie la plus élevée du mât. Asklépiadès de Myrléa dans Athénée (XI, 49) : La partie inférieure du mât s’appelle πτέρνα et s’emboîte dans le ληνός. La partie moyenne s’appelle τράχηλος ; vers l’extrémité est le καρχήσιον... Au-dessus du θωράκιον se trouve l’ήλακάτη qui s’élève et s’amincit. Si l’on examine de près ces trois descriptions, on verra d’abord que les diverses parties du mât sont énumérées par Eratosthène dans un ordre absolument arbitraire. Si, en effet, on acceptait cet ordre, on mettrait la vergue au-dessus de la hune, ce qui est matériellement impossible ; nous ne pouvons donc rien tirer de ce passage pour nous rendre compte de la façon dont les diverses parties du mât se succédaient l’une à l’autre et nous ne retiendrons de ce texte que la définition de l’ήλακάτη. Nous restons donc en présence du passage d’Athénée et de celui de Pollux. Ils s’accordent tous deux pour ce qui concerne la partie inférieure du mât. On appelle pied du mât, dit Jal[11], l’extrémité inférieure du mât qui repose dans la carlingue où il est implanté. Quelquefois on désigne par pied du mât la partie du mât qui est à la hauteur du pont. Ainsi, déposer un objet au pied du mât, c’est souvent le mettre sur le pont, à l’endroit où le mât le traverse. Quant à la carlingue[12], c’est un assemblage de pièces de charpente combinées de telle sorte qu’elles présentent au pied du mât qui va s’y insérer une cavité, une sorte de puits. Comme cette construction est faite sur la carlingue, elle prend le nom de carlingue. Un billot de bois creusé est quelquefois toute la carlingue d’un mât. On voit par là que le mot πτέρνα correspond exactement au pied du mât ; la métaphore est même identique en français et en grec, puisque πτέρνα signifie à proprement parler le talon. Le mot ληνός qui désigne primitivement l’auge dans laquelle les troupeaux viennent boire, convient bien à la cavité rectangulaire dans laquelle entre le pied du mât. Tandis que le corps du mât est arrondi, le pied est taillé rectangulairement pour s’adapter à la carlingue, et, comme l’adhérence entre le mât et la carlingue ne serait pas suffisante pour rendre la construction inébranlable, on la renforce par des coins qu’on introduit violemment dans l’espace resté libre[13]. Les difficultés ne commencent que pour ce qui concerne l’extrémité supérieure du mât. On remarquera d’abord combien la description de Pollux est incomplète ; il passe en effet du pied du mât à la hauteur où est suspendue la vergue, sans nous parler des parties intermédiaires. Il y a donc là une lacune que Pollux lui-même peut nous aider à combler. Il dit on effet ailleurs (X, 134) que la partie inférieure du mât s’appelle όρθίαξ comme le haut s’appelle καρχήσιον. L’explication est un peu vague ; on peut supposer toutefois que l’όρθίαξ est la partie du mât qui s’élève à partir du pont supérieur. Quant au corps du mât lui-même, il est désigné dans Athénée par le mot τράχηλος. Le passage est tellement formel, qu’il est impossible d’entendre par là, comme le veut Jal[14], le capelage. En effet le capelage se trouve à la tête du mât et non au milieu. Athénée et Pollux sont en désaccord, quand il s’agit de désigner l’extrémité du mât. En effet, pour Pollux l’ήλακάτη est cette partie du mât qui se trouve à son extrémité dans le voisinage de la vergue et qui supporte la hune. Il est d’accord là-dessus avec le Scol. d’Apollonius de Rhodes, qui dit que l’ήλακάτη est surmontée par la hune, et avec le Grand Etymologique[15], pour lequel l’ήλακάτη s’étend au-dessus de la voile. Mais il en diffère en ce que ni le Scol. d’Apollonius de Rhodes, ni le Grand Etymologique ne superposent rien à la hune. Eratosthène dit même formellement que c’est la partie la plus haute du mât. Au contraire, du milieu de la hune part pour Pollux l’άτρακτος ou flèche, à laquelle est suspendue une flamme. Pour Athénée, l’extrémité du mât qui avoisine la hune et que Pollux nomme ήλακάτη s’appelle simplement τέλος et l’ήλακάτη s’élève au-dessus de la hune, sans qu’il soit question de l’άτρακτος. Au fond, c’est plutôt une divergence de dénominations qu’autre chose. Ainsi que Graser le fait remarquer, le mot τέλος n’est vraisemblablement pas un mot nautique. D’autre part, άτρακτος signifiant fuseau, tandis qu’ήλακάτη veut dire quenouille, ce sont des mots bien voisins l’un de l’autre par le sens. Il est donc raisonnable de s’en tenir à l’explication de Pollux, qui met l’ήλακάτη au-dessous de la hune et qui termine le mât par l’άτρακτος, en supposant qu’au lieu du terme technique ήλακάτη, Athénée a pris un mot de la langue vulgaire et qu’il a ensuite désigné l’άτρακτος par le mot très voisin de sens ήλακάτη. Ce n’est pas là la conclusion de Graser. Graser adopte l’opinion de Pollux qui à l’ήλακάτη superpose l’άτρακτος et l’opinion d’Athénée en ce qui concerne la place de l’ήλακάτη. Il obtient ainsi, au-dessus de la hune, une assez grande hauteur de mât, qu’il divise en mât de hune et en mât de perroquet, de façon à pouvoir superposer plusieurs vergues et plusieurs voiles. Mais ce n’est là qu’une hypothèse toute gratuite. En effet, il est certain que, dans leurs descriptions, Athénée et Pollux n’ont eu en vue que le mât primitif, celui qui ne porte qu’une vergue surmontée d’une hune. C’est donc faire fausse route que de chercher dans ces deux passages des dénominations applicables au mât de la trière, qui était vraisemblablement fort haut et qui portait plusieurs étages de voiles. Quant au mot ΐκριον, il désigne le mât à l’époque primitive[16] ; nous avons vu que les ΐκριον étaient les étais verticaux sur lesquels reposent le château d’avant et le château d’arrière. Le mât n’étant qu’une pièce de bois verticale implantée dans le navire, il n’est pas étonnant qu’il ait reçu ce nom. La vergue qu’il supporte s’appelait έπίκρίον. La seule particularité que nous fassent connaître les inscriptions navales à propos du mât de la trière, c’est qu’il était accompagné de παραστάται [17]. Il y en avait régulièrement deux par navire ; lorsqu’il s’en rencontre trois, c’est par exception ; lorsqu’un seul est mentionné, c’est que l’autre manque. Il est encore question des παραστάται dans l’inscription X de Bœckh, parmi les agrès reçus par les triérarques. A partir de cette inscription, ils ne figurent plus que pour les triakontores. Bœckh[18] citant Isidore (Origg. XIX, 2, 11) y voit des étais verticaux qui s’élèvent de la quille et se dressent parallèlement au mât qu’ils maintiennent. Il a constaté leur présence sur une peinture de Pompéi, où ils sont au nombre de trois[19]. Ces παραστάται de l’époque de Démosthène ont remplacé l’ίστοπέδη des temps homériques, qui remplissait exactement le même office, celui de maintenir solidement le bas du mât. Pour Graser[20], l’ίστοπέδη est une poutre transversale correspondant au ζυγός primitif, percée d’un trou au milieu et qui tient le mât, comme font les solives du pont dans les bâtiments pontés. C’est là une erreur contredite par les explications des lexicographes. Pour Eustathe (1710, 28) en effet, l’ίστοπέδη est l’endroit où l’on place le mât, ou une pièce de bois verticale à laquelle on l’assujettit ; Suidas[21] dit formellement que c’est un étai vertical, qui s’élève sur la quille et sert à assujettir le mât. Hesychius[22] est plus précis encore, quand il nous apprend que c’est un montant vertical qui part de la τράπεζα et auquel le mât est fixé. Or nous savons que la τράπεζα est une pièce de bois établie sur la quille et au centre de laquelle se trouve le trou carré dans lequel pénètre le mât. Ces montants étaient surtout nécessaires à une époque où on abaissait et où on hissait sans cesse le mât pour les besoins de la navigation ; quand il était dressé, il fallait qu’il pût s’appuyer sur une pièce de bois fixe et solidement implantée dans la quille ; on voit qu’ils ont persisté sous un autre nom dans la marine grecque, à une époque où les mâts n’étaient plus mobiles, mais à poste fixe. Dans les galères du moyen âge, l’extrémité supérieure du mât était garnie d’une pièce de bois nommée calcet, dans la tête de laquelle étaient passées les poulies des amants.
La figure 88, empruntée au Glossaire nautique de Jal, art. Gabie, nous montre le calcet dans lequel sont logées ces poulies et, derrière, une espèce de cage appelée gabie pouvant servir aux guetteurs et aux combattants. Dans les vaisseaux modernes, la hune[23] est une plate-forme établie horizontalement au sommet d’un mât qui la traverse. Elle repose sur des barres. Ces barres sont quatre pièces de bois placées à la tête d’un bas-mât et destinées à supporter la hune. Deux d’entre elles droites, parallèles et mises dans le sens de la longueur du navire, sont appelées élongis. Les autres, légèrement recourbées et croisant les premières, sont nommées traversins. Nous retrouvons dans la marine grecque quelques-unes de ces particularités. Pour Pollux (X, 134), le καρχήσιον n’est guère que l’extrémité du mât ; il se borne à l’opposer à l’όρθίαξ. Zonaras[24] en donne précisément cette définition. Pour Hesychius[25], c’est une pièce de bois établie en haut du mât ; enfin Servius[26] dit que c’est le sommet du mât au travers duquel on fait passer les cordages. C’est là précisément, comme on le voit, la définition du calcet, donnée très nettement du reste par le scoliaste de Pindare[27] et par Galien. Nous trouvons dans Athénée citant Asklépiadès de Myrléa une description de la hune perfectionnée, qui, tout en conservant une forme originale et particulière à la marine grecque, présente avec la hune moderne assez de ressemblance, pour que nous puissions nous rendre compte exactement de ce qu’elle était[28] : A l’extrémité du mât se trouve le καρχήσεον. Il présente des barres qui se recourbent en haut de chaque côté et supportent le θωράκιον, carré dans toute son étendue, excepté pourtant au bord inférieur et au bord supérieur. Elles dépassent un peu le θωράκιον dans le sens horizontal. Nous voyons ici très nettement désignées les barres de hune, et l’on remarquera qu’elles sont précisément recourbées comme les traversins modernes. Elles sont nommées ici κεραΐαι, et, dans Hesychius[29], κέρατα ; celui-ci définit en effet la hune : Les barres qui se trouvent en haut de l’arbre du navire et le sommet du mât. Quant au θωράκιον, c’est une sorte de rempart ou de parapet formant une cage ou s’abritent les combattants ; il est rectangulaire, sauf à ses extrémités inférieure et supérieure qui affectent la forme ronde. Il ressemblait beaucoup au vase à boire qui portait le nom de καρχήσεον et qui était, dit Athénée (XI, 49), allongé et insensiblement resserré en son milieu. Un vase de la collection Campana, dessiné par Graser, fait bien comprendre cette forme particulière. Nous savons que dans le navire d’Hiéron[30] les remparts des hunes étaient non en bois, mais garnis d’airain, pour offrir un abri plus résistant et plus solide ; il y avait trois hommes dans la hune du premier mât, et ainsi de suite en diminuant progressivement d’un homme. Des servants hissaient jusqu’aux hunes, au moyen de poulies, des pierres et des traits. Il est vraisemblable que les trières ne possédaient qu’une hune au grand mât ; nous ignorons combien celle-ci pouvait contenir de combattants. § 2. — Le nombre des mâts de la trière et leurs noms. Il est intéressant pour nous de connaître exactement le nombre des mâts de la trière, leurs noms et la place qu’ils occupaient sur le navire. Malheureusement, tout ce qui concerne le gréement n’est indiqué, en général, sur les monuments figurés que d’une manière sommaire et insuffisante. En outre, de la bataille de Salamine à l’empire romain et de l’époque des trières à celle des liburnes, il s’est produit dans le gréement des navires de profondes modifications. Ces modifications, nous ne les connaissons qu’imparfaitement ; elles jettent dans les explications des grammairiens beaucoup de confusion et d’inexactitude. Le mieux est donc de nous en tenir sur ce sujet aux renseignements fournis par les inscriptions navales ; bien que mutilées, elles nous font connaître d’une façon suffisante la mâture de la trière. Elles font mention de deux mâts auxquels elles donnent des noms différents : l’ίστός μέγας et l’ίστός άκάτιεος[31]. En général, il n’est question que d’un ίστός μέγας et d’un ίστός άκάτιεος par trière[32]. Bœckh[33] en a conclu que la trière ne portait que deux mâts et que ces deux mâts étaient désignés par les mots qu’emploient les inscriptions. Cette conclusion est rejetée par Graser et non sans raison. En effet, dans certaines de nos inscriptions, il n’est question parmi les agrès que d’une voile[34] ; est-ce à dire que la trière ne portait qu’une voile, quand nous venons de voir qu’elle avait au moins deux mâts et plusieurs vergues ? Il ne faut pas oublier que les inscriptions navales mentionnent seulement les agrès donnés par l’État et que le gréement des navires était, dans une certaine mesure, complété par les triérarques. Mais la conjecture de Bœckh n’est pas seulement hasardée, elle est démentie par les faits[35]. En effet, en parlant des agrès que possède encore une trière, nous trouvons[36] cette expression : un mât άκάτιεος, le grand mât, les grandes vergues, les vergues άκάτιεοι. Or nos inscriptions ne s’expriment ainsi que quand l’agrès est au moins double. Ailleurs l’affirmation est encore plus formelle : en parlant d’une seule trière dont le nom a disparu, on cite[37] parmi les agrès le grand mât, les grandes vergues et, au pluriel, les mâts άκάτιεοι. Bœckh, pour échapper à cette assertion qui contredit son système, est obligé de conclure à une erreur du lapicide[38]. La trière avait donc vraisemblablement non pas deux, mais trois mâts, un ίστός μέγας et deux ίστοί άκάτιεοι ; quant à leurs dimensions respectives, nous savons que le premier ne pouvait pas être remplacé par l’un des deux autres. Ainsi dans un inventaire[39] des agrès qui manquent à certains navires, les Epimélètes ont soin de noter que la trière Panthéra a un mât άκάτιεος à la place de son grand mât. Du reste les noms mêmes qu’ils portent nous instruisent jusqu’à un certain point de ce qu’ils étaient. L’ίστός μέγας ne pouvait être que le grand mât. Quant à l’ίστός άκάτιεος, c’était évidemment un mât analogue à celui de l’άκατος, qui était une petite barque ; il devait être par conséquent plus petit que le premier. Il est naturel de supposer que le grand mât était au centre du navire[40] et les deux mâts άκάτιεοι l’un à l’avant et l’autre à l’arrière. C’est sans doute à l’un de ces mâts άκάτιεοι que s’appliquait la qualification de περίνεως, donnée par Hesychius[41] et Photius[42]. Nous avons déjà dit que les agrès περίνεω étaient non pas des agrès de rechange, mais des agrès qui pouvaient jusqu’à un certain point en suppléer d’autres. Or, en cas de bris du grand mât ou de l’un des mâts άκάτιεοι, il est certain que celui qui subsistait devait en remplir la fonction[43]. Graser[44] résume ainsi, d’après les inscriptions navales, les variations qui se sont produites pendant la période qu’elles embrassent sur le nombre des agrès fournis par l’État. Il est possible que l’État ait fourni les deux mâts άκάτιεοι jusqu’à l’ol. 108, 1 ; il l’a fait certainement jusqu’à l’ol. 101, 4 inclusivement (Inscr. nav. n° I de Bœckh). Plus tard, il ne donne plus aux triérarques avec l’ίστός μέγας qu’un ίστός άκάτιεος, et cela dure ainsi au plus tard jusqu’à l’ol. 112, 2. Si dans l’inscription navale n° X, qui est de l’ol. 109, 4, nous voyons encore figurer les deux ίστός άκάτιεοι, c’est qu’il s’agit de la restitution d’agrès prêtés longtemps auparavant. A partir de l’ol. 112, 3, l’État ne fournit plus que l’ίστός μέγας et laisse le triérarque se procurer à ses frais les ίστοί άκάτιεοι, qui ne figurent plus dans les inscriptions, non plus que les κεραΐαι άκάτειοι et les ίστία άκάτεια. Voilà tout ce que nous savons de la mâture des trières ; nous sommes ici sur un terrain solide qu’il ne faut pas abandonner. Si nous examinons maintenant les passages des lexicographes, nous y trouverons la tradition lointaine et affaiblie de cette mâture que nous venons de déterminer, en même temps que l’affirmation d’une mâture postérieure et différente ; les commentateurs, embarrassés et incertains entre l’usage ancien et l’usage récent, confondent quelquefois l’un avec l’autre. Le grand, le véritable mât, dit Pollux[45], c’est l’ίστός άκάτιεος ; celui de l’arrière est l’έπίδρομος ; le plus petit est le δόλων ; on l’appelle aussi λοίπαδος, et quelques-uns croient devoir lui donner le nom d’άκάτιεος. Ce texte est parfaitement net : c’est la description d’un navire qui porte trois mâts ; celui du milieu s’appelle άκάτιεος, celui de l’arrière l’έπίδρομος et celui de l’avant δόλων. On voit quels changements profonds se sont produits et combien l’acception des termes s’est modifiée, puisque c’est le mât du milieu qui porte ici le nom d’άκάτιεος. Mais en même temps, — et la fin du passage est précieuse à cause de cela, — un reste de l’ancien usage avait subsisté et l’on trouvait encore quelquefois le mât de l’avant désigné par le mot d’axant«. Pollux le constate ; mais cette double dénomination, qui exposait à de notables erreurs, devait tendre à disparaître de la langue maritime. Nous retrouvons la trace de cette confusion dans des passages des lexicographes, qui éclairent et font comprendre à merveille le dire de Pollux. Ainsi, pour Phrynichus[46], άκάτια signifie les voiles des mâts άκάτιοι ; proprement le mot désigne les petites voiles, mais il s’applique aussi aux grandes. On appelle άκάτια les gens de petite taille. Hesychius[47] dit de même : L’άκάτιον est la voile du mât άκάτιος ; άκάτιος signifie aussi le grand mât. Pour n’avoir pas voulu tenir compte de ce fait, Graser[48] s’est vu obligé de corriger le passage de Pollux cité ci-dessus, afin de ramener de force sa description à celle du gréement des trières. Il l’a fait d’une façon malheureuse. Nous voici donc en présence d’un navire qui a quatre mâts, ce qui n’est pas le gréement de la trière, et ainsi Graser n’a pas atteint son but. Le grand mât a repris, il est vrai, son nom d’ίστός μέγας, et le mât de l’avant celui d’ίστός άκάτιεος. Mais où doit se placer le quatrième mât, le δόλων ? C’est ce qui est embarrassant pour Graser. En outre, que signifie maintenant la fin de la phrase de Pollux et pourquoi aurait-on donné à ce dolon le nom d’άκάτιεος, qu’il n’a plus aucune raison de porter, puisque Graser a rétabli un mât άκάτιεος à l’avant ? Graser n’a pas manqué de voir la difficulté, et, pour y échapper, il a d’abord adopté la correction de Saumaise que nous avons signalée plus haut, et il a fait du δόλων une voile de perroquet. Il pense qu’on a pu donner à cette voile le nom d’άκάτιεος, parce qu’elle était fort haute, comme les άκάτεια. Mais d’abord ici le δόλων n’est pas une voile, mais un mât ; ensuite les passages des auteurs confirment tous, à une exception près, le gréement parfaitement rationnel décrit par Pollux. Notons d’abord que, pour les lexicographes, le dolon est à la fois un mât et une voile. Suidas[49] dit en effet que les dolons sont les petites voiles, et Hesychius[50] que ce sont les petits mâts dans les navires. Cela concorde parfaitement avec l’assertion de Pollux que le δόλων est le plus petit des trois mâts. Un précieux passage d’Isidore[51], qui a été mal à propos corrigé par Smith, mérite toute notre attention et confirme ce que nous venons de dire. Il y a différentes espèces de voiles : l’άκάτιεος, le δόλων, l’άρτέμων, le siparum, le mendicium. De ces voiles, la plus grande est l’acatium, qui se trouve au centre du navire. Vient ensuite, pour la grandeur, l’epidromus, qui est à l’arrière. Le dolon est la plus petite voile, et il est fixé à l’avant ; l’artémon sert plutôt à faire évoluer facilement le navire qu’à augmenter sa vitesse. Le siparum est une espèce de voile qui n’a qu’une écoute et qui facilite la marche du navire, quand le vent vient à faiblir ; on croit que son nom (siparum) vient de ce qu’elle est séparée. Ce texte s’accorde mot pour mot avec celui de Pollux, sauf qu’il s’agit ici des voiles et non plus des mâts ; nous voyons au centre du navire la voile la plus grande, l’acatium ; à l’arrière une voile plus petite, l’epidromus ; et enfin à l’avant la plus petite de toutes le dolon. Mais Graser commet la double erreur, d’abord de rétablir l’άκάτειος, comme mât de l’avant, dans le passage de Pollux, et ensuite de vouloir faire figurer le dolon dans le gréement des trières. Or les voiles άκάτεια étant des voiles latines, il ne peut pas le mettre au-dessus d’elles ; il le met donc au grand mât, comme une troisième voile carrée, au-dessus des deux autres. Le principal argument sur lequel il s’appuie, c’est qu’on hisse les dolons quand le navire a besoin d’avoir toute sa vitesse. En effet nous lisons dans Diodore de Sicile (XX, 61, 8) : On hissa le dolon, et le navire, favorisé par le vent, échappa au danger ; dans Tite-Live[52] : Voyant les autres navires entourés par l’ennemi et le vaisseau amiral de Polyxenidas mettre à la voile eu abandonnant les siens, ils hissèrent rapidement les dolons, et, profitant de ce que le vent était favorable pour gagner Ephèse, ils prirent la fuite ; dans Polybe (XVI, 15, 2) : Un navire ayant hissé le dolon, ce qui nous montre qu’il n’y avait qu’un dolon par navire. Mais il n’y a rien dans ces passages qui désigne spécialement le dolon comme une voile de perroquet. En effet des expressions comme αΐρειν, έπαίρεσθαι, tollere, erigere s’appliquent à toutes les voiles et non pas seulement à celles qui se trouvent au sommet du mât. Les textes que nous venons de citer ne signifient donc qu’une chose, c’est qu’au moment du danger on met toutes voiles dehors[53] ; ils sont si peu concluants que, comme nous le verrons plus loin, on disait dans la langue courante : hisser les άκάτεια, pour : fuir rapidement un grand danger ; or les άκάτεια n’étaient pas des voiles de perroquet ; c’étaient précisément les voiles que le dolon remplaça en partie. il ne reste donc en faveur de l’opinion de Graser que le passage de Festus[54] qui identifie le dolon avec le supparum, ce qui semble indiquer que le dolon se trouvait à la tète du mât. Mais cette confusion, difficile à expliquer, ne peut prévaloir contre ce fait que le dolon est pour les grammairiens non seulement une voile, mais aussi un mât distinct des autres mâts du navire et non superposé à l’un d’eux, et contre l’affirmation si nette de Pollux et d’Isidore, qui font du dolon le mât et la voile de l’avant. Je considère donc le dolon comme jouant, dans un gréement différent, le rôle de l’άκάτειος antérieur dans le gréement de la trière : c’est ce mât que le dolon a remplacé ; peut-être faut-il le reconnaître dans ce mât incliné et supportant une petite voile carrée qu’on aperçoit sur certains monuments[55]. Quant à l’έπίδρομος, Graser[56] en est assez embarrassé. Il se demande si la voile de ce nom ne devait pas être suspendue au grand mât ou peut-être au mât de pavillon. Il avait pourtant entrevu la vérité, quand il dit que l’έπίδρομος paraît avoir été placé à l’arrière pour remplacer l’άκάτειος. En effet, dans la mâture particulière décrite par Pollux, l’έπίδρομος joue à l’arrière le même rôle que le δόλων à l’avant ; ce sont là les deux mâts qui remplacent les ίστός άκάτειοι des trières. C’est ce qui nous est du reste confirmé par ce texte malheureusement mutilé d’Hesychius : έπίδρομον . ... καί τό ίστίον τό έν τή πρύμνη κρεμάμενον, δ καλοΰσι φορόν καί έλασσον[57]. En résumé, la trière avait trois mâts : l’ίστός μέγας au centre, les deux ίστός άκάτειοι à l’avant et à l’arrière ; dans le trois-mâts décrit par Pollux, le mât du milieu a pris le nom d’ίστός άκάτειος, celui de l’arrière s’appelle έπίδρομος celui de l’avant δόλων. Par un ressouvenir des dénominations anciennes, ce dernier était quelquefois appelé άκάτειος. § 3. — Les vergues. On appelle vergue[58] une pièce d’un bois léger, longue et grosse en proportion de la grandeur de la voile qu’elle doit porter, ronde dans toute sa longueur et plus mince à ses extrémités qu’à son milieu. Dans les bâtiments à trait carré, c’est-à-dire qui se servent essentiellement de voiles carrées, les vergues sont placées horizontalement et en avant des mâts... Les vergues, quand elles doivent être grosses, sont quelquefois composées de plusieurs morceaux ajustés ; on les nomme alors vergues d’assemblage. Des cercles de fer et des chevilles consolident cette construction, dont le volume, malgré son importance, conserve cependant le nom primitif, qui suppose un bois mince et flexible. — L’extrémité d’une vergue, ce qui, de cette vergue, est en dehors de la largeur de la voile, s’appelle bout de vergue[59]. Quant à l’antenne[60], c’est le nom de la vergue sur laquelle est attachée, par son plus grand côté nommé antenal, la voile triangulaire appelée voile latine ou à la latine. Deux pièces de bois, liées ensemble et jointes de telle sorte que le tiers de la longueur de chacune soit appuyé sur l’autre et le fortifie, composent l’antenne. La plus grosse de ces pièces, celle qui, lorsque l’antenne est à la tête du mât, s’incline vers l’avant et va quelquefois jusqu’à l’étrave, s’appelle le car ; l’autre, qui s’élève au-dessus de la poupe... reçoit le nom de penne. L’antenne n’est pas suspendue par son milieu, comme la vergue qui porte la voile carrée : le dormant de l’itague de sa drisse, quand cette itague est simple, ou, quand elle est double, la poulie par laquelle elle passe, se trouvent plus près de l’extrémité du car que de celle de la penne. Nous retrouvons dans la marine grecque ces pièces si importantes du gréement des vaisseaux. Photius[61] nous donne du mât et de la vergue une définition qui n’a point vieilli : Le mât est une longue pièce de bois dressée en l’air, et la vergue le croise de manière à produire la lettre T. Suidas[62] dit simplement que la vergue est ce qui se trouve en travers du mât. Zonaras[63] la définit plus complètement : la pièce de bois suspendue à la tête du mât et qui le croise, à laquelle on attache la toile. Nous savons que la vergue était nommée par les Grecs κέρας et par les Attiques κεραία[64]. Les diverses parties de la vergue nous sont connues par ce passage de Pollux (I, 91) : Le milieu de la vergue, aux environs du mât, s’appelle άμβολα et σύμβολα ; ce qui en retient les deux parties, άγκύλαι ; les extrémités, άκροκέραια. On voit que si les anciens se servaient habituellement de vergues d’une seule pièce, ils connaissaient aussi les vergues d’assemblage. Bœckh[65] en cite un exemple qu’il emprunte à Goro, Wanderungen durch Pornpeji, pl. VI, 2, et à Mazois, Les ruines de Pompéi, pl. XXII, 2. Il s’agit ici d’une vergue proprement dite ; cependant le fait est plus fréquent pour les antennes. Le point où s’ajustaient les pièces de rapport se nommait άμβολα ou σύμβολα ; les άγκύλαι étaient les liens, — peut-être des anneaux de fer, — qui maintenaient l’ensemble. La Synag. Lex. d’I. Bekker[66] nous apprend que άγκύλη signifiait quelquefois un lien. C’était la courroie dont on se servait pour lancer le javelot et qui l’enserrait par son milieu. Le mot est pris aussi dans le sens de collier. Enfin la Synag. Lex., Suidas et Zonaras[67] entendent par άγκύλια les anneaux de fer qui composent une chaîne. Les extrémités des vergues portaient le nom d’άκροκέραια[68]. Chez nous le matelot que la manœuvre de la voile appelle dans la mâture circule le long de la vergue en s’appuyant sur le marchepied. Le marchepied était connu des anciens, bien que Graser ne veuille point l’admettre ; nous le voyons figuré sur l’un des deux navires du bas-relief Torlonia, où il supporte un homme de l’équipage occupé à ferler une voile, dans l’attitude d’un matelot de nos jours. Parfois le matelot marchait sur la vergue elle-même en se tenant par les mains aux κεροίακες[69]. Graser[70] entend par ce mot une longue perche parallèle à la vergue, à laquelle elle est assujettie par des montants verticaux de trois pieds de haut, et, comme le mot est au pluriel, il croit qu’il y en avait peut-être deux faisant l’office de balustrade. Ce serait un appendice assez gênant pour une vergue qu’on hisse ou qu’on abaisse selon les besoins. Sans doute les κεροίακες ne sont pas autre chose que les deux cordages qui vont des extrémités de la vergue à une poulie fixée au mât et qu’on appelle les balancines. Ils ne sont donc pas distincts des κεροΰχοι. Tout au plus pourrait-on y voir des espèces d’anneaux de corde fixés à la balancine et que saisissait la main du matelot. C’est ainsi que le Scoliaste[71] explique ce terme dans le passage qui nous occupe. Si la vergue proprement dite était la plus usitée chez les anciens, ils connaissaient cependant une autre espèce de vergue qui correspondait peut-être à notre antenne. Nous trouvons en effet dans les inscriptions navales, citées à côté l’une de l’autre comme complètement distinctes, les κεραΐαι μεγάλαι et les κεραΐαι άκάτειοι, les unes étant les vergues du grand mât et les autres celles du άκάτειος[72]. Les κεραΐαι μεγάλαι étant toujours au pluriel, comme nous savons qu’il n’y avait qu’un ίστός μέγας, il en résulte que la trière avait plusieurs vergues horizontales. Il en est de même pour les κεραΐαι άκάτειοι, même dans les inscriptions où il n’est question que d’un seul mât άκάτειος ; d’où il suit que ce mât avait plusieurs vergues obliques[73]. Il ne s’agit pas, dans l’un et l’autre cas, d’agrès de rechange, mais bien de vergues superposées et par suite de dimensions différentes. Il est très vraisemblable que le grand mât ne portait que deux vergues horizontales[74], et le premier mât άκάτειος, fourni par l’État jusqu’à l’ol. 112, 2, deux antennes ; l’État, au moins primitivement, donnait les unes et les autres[75]. Quant au second mât άκάτειος fourni primitivement par l’État et, au moins depuis l’ol. 108, 2, par le triérarque, était-il gréé d’une façon identique au premier ou, au contraire, ne portait-il qu’une antenne ? C’est ce que nous ignorons. Les vergues ne servaient pas seulement, dans la marine grecque, à supporter les voiles ; on les employait encore comme moyen de défense pour le navire. Il n’est pas nécessaire de supposer pour ces deux fonctions deux espèces de vergues différentes. En effet nous avons vu qu’on ne se servait pas des voiles pendant le combat ; mais il n’en était pas de la trière comme de la barque primitive, où on abaissait le mât à volonté. Les mâts des trières restaient debout pendant le combat, et par conséquent on pouvait transformer les vergues en engins de guerre. Dans le navire d’Hiéron[76], chacun des trois mâts était pourvu de deux κεραΐαι λιθοφόροι qui lançaient sur les assaillants des grappins et des masses de plomb. Un engin redoutable, qui causait souvent des avaries capables d’amener la perte du vaisseau ennemi, c’était le δελφίς. La vergue à laquelle il était suspendu s’appelait κεραία δελφινοφόρος[77], et le navire lui-même ναΰς δελφινοφόρος[78]. Le Scoliaste d’Aristophane[79] nous apprend qu’il était en fer ou en plomb et qu’il avait la forme d’un dauphin. On le lançait pendant le combat pour couler le navire ennemi. Eustathe citant Pausanias[80], Hesychius[81], Suidas[82], le Scoliaste de Thucydide (VII, 41) confirment ce renseignement. L’assertion d’Hesychius, qui prétend qu’on s’en servait plus particulièrement contre les corsaires, n’est pas confirmée par le passage de Thucydide, qui fait figurer cet engin de destruction dans le combat naval entre les Athéniens et les Syracusains. C’est par erreur que le Grand Etymologique[83] définit le dauphin : μέρος νεώς. D’après Pollux (I, 86), le dauphin était suspendu au-dessus de l’éperon, de sorte qu’on devait le lancer sur l’ennemi au moment même où il recevait le coup d’éperon. Aristophane indique une autre manœuvre lorsque, dans les Chevaliers, le chœur engage le marchand de boudins à prendre ses précautions pour vaincre son adversaire (v. 761 et suiv.). Mets-toi sur tes gardes ; hisse les dauphins, avant que ton ennemi ne s’approche, et présente-lui ta barque de flanc. Nous voyons par ce passage qu’il y avait plusieurs dauphins sur un navire, et qu’on attendait, pour les envoyer, qu’on fût côte à côte avec le vaisseau ennemi. Graser[84], qui croit à tort que chaque navire ne possédait qu’un dauphin, pense que c’était un projectile en fer garni de plomb à l’intérieur et qui pesait plusieurs tonnes. D’après lui, au moment du combat, il se trouvait sur le pont, d’où l’on pouvait, au moyen d’un câble courant sur des poulies, le porter, suivant le besoin, à l’une ou à l’autre extrémité de la vergue. On faisait d’abord tourner la vergue de façon qu’elle Mt parallèle à l’axe du bâtiment, puis on la ramenait à sa position naturelle, et, comme ses extrémités débordaient le pont du navire, on laissait glisser le dauphin sur le vaisseau assaillant. Le dauphin était fixé à une corde, de sorte qu’après un premier coup porté on le hissait de nouveau et on recommençait. Tout n’est peut-être pas absolument exact dans l’hypothèse de Graser : nous avons vu qu’il y avait plusieurs dauphins à bord, ce qui en diminue nécessairement le poids. En outre, si nous en croyons Aristophane et Pollux, on hissait les dauphins d’avance, et c’était une manœuvre qui faisait partie du branle-bas de combat. Quant à savoir si le dauphin, une fois lancé, était abandonné ou si on le remontait à bord, c’est ce que nos textes ne nous apprennent pas. § 4. — La voile et ses accessoires. Dans le navire moderne, la voile[85], qu’il est inutile de définir ici, n’est pas faite d’un seul morceau, mais composée de laizes ou de portions de laizes de toile ou autres tissus cousus ensemble. On appelle laize la largeur de la toile à voile. Comme la voile a besoin d’être fortifiée sur ses bords pour éviter les déchirures, on assujettit tout autour des cordes qui la consolident et qu’on nomme ralingues. La ralingue qui borde la voile par en haut contre la vergue s’appelle têtière. Les deux cordes cousues le long des rebords extérieurs sont les ralingues de chute et celle qui fortifie la toile par en bas est la ralingue de fond. L’envergure d’une voile est l’étendue du côté de la voile qu’on attache à la vergue. Attacher une voile à la vergue qui doit la porter, c’est l’enverguer. On fait cette opération au moyen de petites cordelettes appelées rabans d’envergure. Quand, pour une raison ou pour une autre, on veut soustraire la voile à l’action du vent pour faire cesser l’impulsion qu’elle lui communique, on la cargue, c’est-à-dire qu’on agit sur les cargues pour la retrousser et la porter contre la vergue à laquelle elle est fixée. Les cargues sont des cordages dont la fonction est de relever une certaine partie d’une voile pour la rapprocher de la vergue. Les voiles d’une certaine dimension ont plusieurs cargues, qui prennent leur nom de l’endroit où, sur le bord de la voile, elles sont fixées par un nœud. On distingue les cargues-point, les cargues-fond et les cargues-bouline. La cargue-point est attachée au coin ou point de la voile, la cargue-fond à la ralingue qui borde le fond de la voile et la cargue-bouline à la ralingue de chute de la voile carrée à la hauteur de la bouline. Une cargue qu’on frappe quelquefois sur le fond d’une basse voile, pour en relever un peu la toile et permettre de voir l’avant du navire, quand on est sur le gaillard d’arrière, reçoit le nom de cargue à vue. On peut agir sur l’une ou l’autre de ces cargues ou sur toutes à la fois, selon qu’on veut dérober une portion ou l’étendue entière de la voile au souffle du vent. Quand la voile est carguée, on la ferle, c’est-à-dire qu’on la plisse en l’apportant sur et le long de la vergue pour la réduire au plus petit volume possible ; en cet état, on l’assujettit avec des cordelettes nommées rabans de ferlage. Si, au contraire, on veut, pour naviguer, se servir de la voile, on détache les rabans et on laisse la toile se dérouler : c’est ce qu’on appelle larguer la voile, opération précisément contraire à celle que nous venons de décrire. Souvent on a besoin non pas de soustraire entièrement la voile au vent, mais de diminuer la surface qu’elle lui présente : c’est à cet usage que servent les ris. On applique sur une des faces de la voile, pour la fortifier et prévenir les déchirures, une bande de toile ; puis, dans cette double épaisseur, on perce des trous qui sont les yeux-de-pie et par lesquels passent les garcettes de ris, c’est-à-dire des tresses de fil carret, qui servent à attacher la toile contre la vergue, quand on veut en diminuer la surface ; les ris sont, à proprement parler, les plis que fait une voile dans la partie qu’on soustrait au vent ; par extension, on donne ce nom à une partie de la voile comprise entre la têtière et la bande de ris qui lui est parallèle. Ployer contre la vergue la partie supérieure de la voile comprise entre la ralingue et la première, la seconde ou la dernière bande de ris, c’est prendre un ou des ris. Lorsqu’on navigue avec des voiles carrées, il faut non seulement proportionner à l’effort du vent l’étendue de la toile qu’on lui abandonne, mais aussi tenir compte de sa direction et orienter obliquement les voiles, de façon à courir au besoin au plus près du vent. On se sert pour cela de boulines, c’est-à-dire de cordages frappés par le moyen de branches sur la ralingue latérale d’une voile. On tire les boulines vers l’avant du vaisseau, de façon que la voile orientée obliquement à l’axe longitudinal du navire se présente mieux au vent. La voile carrée étant de beaucoup la plus habituellement employée chez les anciens, c’est d’elle que nous nous occuperons tout d’abord. Les textes ne nous donnent malheureusement sur elle que peu de renseignements. Nous avons déjà vu que le grand mât, ίστός μέγας, de la trière, avait au moins deux vergues qui lui empruntaient leur nom, κεραΐαι μεάλαι. Ces vergues, qui étaient de même nature, n’étaient pas de mêmes dimensions, la plus grande se trouvant placée à la partie inférieure, la plus petite à la partie supérieure du mât. Le grand mât des trières avait donc au moins deux voiles carrées[86]. C’est du reste ce que confirment les inscriptions navales. Si la voile, ίστίον, y figure presque toujours au singulier[87], c’est qu’à l’époque de nos documents l’État ne fournissait que la grand voile, laissant aux triérarques le soin de se procurer les autres. Ainsi les triérarques mentionnés sur les stèles comme ayant reçu de l’État les agrès κρεμαστά, et comme en étant redevables, n’ont qu’une voile, ίστίον[88]. Mais nous voyons ailleurs des triérarques qui ont reçu plusieurs voiles[89]. Sans nous arrêter à ces variations, que nous avons déjà signalées, dans le nombre des agrès fournis pendant des périodes différentes par la république athénienne à ses triérarques, le fait de l’existence de plusieurs voiles carrées dans la trière est suffisamment attesté pour que nous n’y insistions pas. Le seul point en question, c’est de savoir s’il y en avait plus de deux par navire ; il est vraisemblable que non. Le dolon ne figure pas dans nos inscriptions et n’a jamais été une voile de perroquet ; c’est donc à tort que Graser, dans ses restitutions de la trière et de la pentère, le superpose aux deux seules voiles carrées positivement connues. Quant aux σίπαροι, retrouvés dernièrement sur le relief Torlonia, Graser en a très heureusement déterminé la forme et l’emplacement[90] ; mais rien ne nous autorise à supposer qu’ils existaient dans les trières ; il faut donc nous en tenir aux résultats acquis, sans nous lancer dans des hypothèses hasardeuses. Nous savons seulement que les arsenaux athéniens possédaient des voiles de différentes qualités, les unes d’un tissu grossier, les autres plus fines. Ces dernières étaient les plus chères. Aussi a-t-on soin de faire remarquer que les Epimélètes de l’archontat d’Anticlès, qui avaient reçu des voiles fines, en ont restitué de grossières[91]. Quand on avait donné à un triérarque une voile fine, on le mentionnait, afin de prévenir, au moment de la reddition des comptes, une substitution défavorable à l’État[92]. Voilà tout ce que nous apprennent les inscriptions navales sur les voiles carrées des trières. Les lexicographes établissent l’équivalence des trois mots ίστίον, άρμενον et λαΐφος pour désigner la voile[93]. En réalité, le terme usuel et nautique qui signifie voile, c’est ίστίον. C’est celui qu’emploient les inscriptions. Eustathe (130, 33) définit la voile : La toile de lin attachée à la vergue, qui accélère la course du navire et est pour lui comme une aile. Il constate que c’est par abus que le mot άρμενον est devenu l’équivalent d’ίστίον et que c’est un terme plus particulier, bien qu’il ne soit pas employé sans raison dans ce sens (1533, 45). Quant à λαΐφος, c’est un mot poétique. On dit souvent en français la toile pour la voilure. Faire de la toile, c’est, pour un navire, augmenter sa voilure. On disait dans le même sens en grec όθόνη[94]. Quant aux accessoires de la voile, les textes nous font connaître les ralingues qui, dans les navires d’apparat, étaient d’une couleur voyante pour entourer la voile d’un cadre plus éclatant. Kallixénos, dans Athénée (V, 39), dit que le mât de la tessarakontère de Ptolémée Philopator mesurait soixante et dix coudées et que la voile était du lin le plus fin et ornée d’une ralingue de pourpre. La ralingue s’appelait donc παράσειρον, et c’est le mot qu’il faut rétablir dans un passage très tourmenté et très mal compris de Lucien[95]. Les curieux qui viennent pour visiter le navire de commerce égyptien racontent qu’entre autres merveilles sa voile avait une ralingue couleur de feu. La scolie évidemment corrompue de ce passage applique le παράσειρον au mât et entend par là la hune. Peut-être, dans son état primitif, disait-elle simplement, qu’il s’agit de la ralingue située auprès de la hune, qui serait par conséquent la têtière. Enfin nous savons que les voiles, dans la marine ancienne comme dans certaines marines modernes, n’étaient pas toujours de toile[96]. On en faisait aussi d’autres matières, par exemple de cuir[97]. La voile était alors composée de grandes pièces de cuir cousues ensemble. Cela nous donne une explication toute naturelle d’un passage de Lucien[98], qui a donné beaucoup de peine aux commentateurs[99]. Les visiteurs, qui s’extasient sur les proportions colossales du navire égyptien, restent debout près du mât, les yeux levés en l’air et comptent τών βυρσών τάς έπιβολάς, c’est-à-dire le nombre des morceaux de cuir superposés qui formaient la voile. Plus la quantité en est grande, plus aussi les dimensions de la voile sont considérables. Quand on avait bon vent et qu’on voulait aller vite, on mettait toutes voiles dehors. Cela s’appelait[100] larguer toutes les voiles, déployer toutes les voiles, ouvrir toute la toile, ne rien laisser perdre du vent. Le vent qui soufflait de l’arrière emplissait alors la voile[101]. On disait[102] qu’on avait déployé toutes les manœuvres, qu’on avait laissé flotter toutes les voiles et tomber toute la toile, que la voile était gonflée, qu’elle était pleine, qu’elle était bombée, qu’on abandonnait les voiles au vent, qu’on avait détaché toutes les voiles. Philostrate, pour indiquer que les voiles sont gonflées par le vent, emploie l’expression de πλήρεσιν ίστίοις, et Synecius[103] celle de όλοις ίστίοις pour signifier que toute la surface des voiles est exposée au vent. Quand, au contraire, on voulait arrêter brusquement le navire, on se servait des cargues pour plier la voile[104]. Pendant la tempête, on ferlait toutes les voiles, et on disait qu’on naviguait[105] en ne laissant dehors que les cordages, en ne conservant que la vergue, avec la vergue dégarnie. Toutes ces manœuvres supposent l’existence des cargues et des rabans de ferlage. Les cargues étaient comprises sous le nom générique de κάλοι ou κάλωες. Ce sont, nous dit le Scol. d’Apollonius de Rhodes, les cordages qui servent à carguer la voile[106], et ils passent au travers de cosses. Les monuments figurés nous montrent que les cargues étaient nombreuses chez les anciens, et les textes nous permettent de retrouver les noms de quelques-unes d’entre elles. Certaines s’appelaient μέσουροι[107], d’autres τέρθριοι. Or nous savons par Galien[108] que l’extrémité de la vergue s’appelait τέρθρον, et que les cordages attachés aux extrémités supérieures de la voile prenaient de là le nom de τέρθριοι. Nous voyons en effet très distinctement, sur une gemme publiée par Graser[109], ces cargues attachées à l’extrémité de la vergue. Seulement, tandis que la gemme nous les montre assujetties par leur autre bout au mât lui-même, le Scol. d’Aristophane[110] nous apprend qu’elles descendaient quelquefois sur le pont vers l’avant. C’est ce qui explique pourquoi le Scol. d’Apollonius[111] de Rhodes les cite après les amures. Si donc, comme cola est de toute évidence, ces cargues portaient le nom de τέρθριοι, on peut supposer que les cordages nommés μέσουροι ou μέσοι et cités sans plus d’explication par le Scol. d’Apollonius de Rhodes étaient celles des cargues qui se trouvaient vers le milieu de la vergue. Les premiers correspondaient à nos cargues-point, les seconds à nos cargues-fond. Suivant la force plus ou moins grande du vent, on diminuait proportionnellement la surface de la voile. On disait alors[112] qu’on avait diminué de moitié la surface des voiles, qu’on les avait retroussées à demi, qu’on n’avait déroulé qu’un peu de toile de la vergue. Dans Aristophane[113], quand le chœur engage Eschyle à répondre avec calme à Euripide et sans se fâcher, il le fait en empruntant ses métaphores à la marine. Diminue ta toile, lui dit-il, et ne te sers plus que du bord de tes voiles. Le scoliaste a bien vu qu’il s’agissait de soustraire au vent une partie de la voile, et il ajoute avec raison que, cette manœuvre faite, le vent ne frappait plus la voile dans le milieu, mais seulement sur le bord ; il est évident qu’il ne peut être question que du bord inférieur, colt me cela arrive quand on a pris plusieurs ris. Dans les Chevaliers[114], le scoliaste explique le même terme συστέλλειν d’une façon encore plus nette. Quand les navigateurs, dit-il, sont surpris par un vent trop violent, ils relèvent et soustraient à son action la plus grande partie de la voilure ; ils laissent flotter une partie de la voile et retroussent le reste, lorsqu’ils n’en ont pas besoin ou que les circonstances l’exigent. Nous trouvons la même manœuvre dans la Médée d’Euripide[115]. Il faut, comme un timonier habile, échapper au danger en ne me servant que du bas de la voile. Evidemment la partie supérieure, toute celle qui était occupée par les bandes de ris, est enroulée autour de la vergue au moyen des garcettes. Sophocle[116] dit la même chose en employant un autre mot, celui d’ύφέσθαι : Maintenant, dans la tourmente, il faut naviguer en repliant mes voiles. Le scoliaste ajoute que la métaphore est empruntée à la marine, lorsque, ne pouvant résister à la violence de l’orage, on diminue la surface des voiles. Il est donc indubitable que les anciens connaissaient les ris, puisque la manœuvre dont parlent Aristophane, Sophocle et Euripide et qu’expliquent si clairement les scoliastes consiste précisément à prendre des ris[117]. Nous savons également qu’ils naviguaient au plus près du vent. Ainsi nous voyons dans Lucien[118] que le navire égyptien, dont il a déjà été question, n’est entré ail. Pirée qu’après avoir été forcé de louvoyer contre les vents étésiens. Voyons maintenant si les monuments figurés confirment les inductions que nous avons tirées des textes et ce qu’ils ajoutent à notre connaissance de la voile[119]. Si l’on jette les yeux sur les reproductions ci-jointes, et particulièrement sur la voile carrée du navire archaïque de la pl. II, on verra que les voiles des anciens étaient composées d’un certain nombre de morceaux rectangulaires, vraisemblablement de toile ou de cuir, cousus ensemble. Les jointures, sur certaines monnaies, sont tellement apparentes, qu’il faut les supposer recouvertes de lanières de cuir ou de bandes de toiles destinées à les consolider, sans quoi l’on s’expliquerait difficilement que l’artiste leur ait donné tant d’importance. Généralement on aperçoit distinctement les ralingues. La têtière, la ralingue de fond et la ralingue de chute sont parfaitement visibles dans la voile du navire marchand reproduit fig. 89[120]. Habituellement la têtière n’est pas apparente, à cause de l’exiguïté de la reproduction, et l’artiste ne la fait pas ressortir à côté et au-dessous de la vergue ; mais les ralingues de chute et de fond sont scrupuleusement dessinées, comme on peut s’en convaincre en examinant la voile de la fig. 90[121].
Nous constatons également la présence des cargues. La voile d’un navire de guerre représentée fig. 91[122] est relevée au milieu comme par une cargue à vue. Sur la fig. 92[123], la voile est
entièrement carguée, et nous voyons les cargues, qui sont au nombre de six,
réunies à la partie basse du mât et sans doute attachées à des taquets que le
manque d’espace et la crainte de Si maintenant on examine la voile à demi ployée de la fig. 93[124], on constatera qu’elle subit l’action de la cargue-bouline. Les ris ne sont pas visibles sur les voiles reproduites
ici, parce que d’aussi petits détails sont impossibles à représenter sur une
pierre gravée ou sur une monnaie et nuiraient à l’ensemble. Nous ne pouvons
donc pas dire si la voile de la fig. 94[125] est une voile
qu’on est en train de carguer ou si on en a diminué la surface en prenant des
ris à cause de la violence du vent. En re § 5. — Du nombre et de la nature des voiles de la trière. Les mâts de la trière étaient de deux espèces : l’ίστός μέγας et les ίστοί άκάτειοι. Nous avons vu comment le grand mât était gréé et comment il donnait son nom à ses vergues, κεραΐαι μεγάλαι, et à ses voiles, ίστία μεγάλα. De même, les mâts άκάτειοι avaient leurs vergues spéciales, κεραΐαι άκάτειοι, et leurs voiles, ίστία άκάτεια, sur lesquelles nous sommes mal renseignés, parce que les passages des inscriptions navales où il en devait être question sont malheureusement mutilés. Nous avons maintenant à déterminer en quoi le gréement des ίστοί άκάτειοι différait de celui du grand mât. Nous écarterons d’abord une difficulté que nous avons déjà rencontrée à propos des mâts. Nous avons vu que les lexicographes confondaient souvent le grand mât avec l’ίστός άκάτειος et les voiles carrées avec les ίστία άκάτεια. Aux passages cités plus haut, nous pouvons encore ajouter celui d’Hesychius : άκάτιας . ...ή τά μεγάλα άρμενα. Nous avons montré que cette confusion provenait de ce que les lexicographes n’avaient pas tenu compte des changements apportés par le temps au gréement des navires. A la suite de ces modifications, les mots qui servaient à en désigner les différentes parties avaient acquis une signification nouvelle. Ainsi le grand mât qui se trouvait au milieu du navire prit, nous ne savons pourquoi ni quand, le nom de mât άκάτειος. Il en fut de même pour les voiles ; mais cette confusion n’a rien à voir avec l’époque qui nous occupe et le gréement de la trière. L’existence, dans la trière, des voiles άκάτεια se déduit de la présence des mâts qui portent ce nom, et leur pluralité de ce fait que les κεραΐαι άκάτειοι sont citées au pluriel, aux époques mêmes où l’État athénien ne fournit au triérarque qu’un seul mât άκάτειος. Graser[127] a bien établi contre Bœckh que les grandes voiles carrées et les voiles άκάτεια ne différaient pas seulement par leurs dimensions, mais aussi par leur nature, comme le prouve l’emploi de deux termes distincts pour les désigner. Ces dernières devaient être analogues à celles de l’άκατος. Le scoliaste d’Aristophane[128] et Suidas[129] nous apprennent que l’άκάτιον, diminutif d’άκατος, était une barque de pêche, et le Grand Etymologique[130], qui en donne une étymologie hasardée, dit que c’était un bateau côtier. La Syn. Lex. d’I. Bekker[131] entend par là un petit, et le scoliaste de Pindare[132] un tout petit navire. L’άκατος était même quelquefois une simple chaloupe[133] dépendante d’un grand vaisseau. C’était, dans tous les cas, un bateau de petites dimensions, bien qu’Hesychius[134] explique simplement le mot par vaisseau ou navire. Strabon[135] nous parle de barques de corsaires qui ne pouvaient porter que vingt-cinq ou, tout au plus, trente hommes, et qu’il appelle άκάτια. L’άκατος était donc une barque de petites dimensions, d’une marche rapide, pouvant longer les côtes, s’abriter dans les criques et, de là, fondre rapidement sur les navigateurs. Il est naturel de supposer qu’un bateau de cette espèce portait des voiles obliques et par suite que c’est ainsi qu’il faut se représenter les ίστία άκάτεια. Graser tire de ce fait des conclusions ingénieuses[136] : après avoir examiné les diverses espèces de voiles obliques, il conclut que les ίστία άκάτεια devaient être des voiles latines. La voile latine, si fréquente encore aujourd’hui dans la Méditerranée, devrait donc son origine aux Hellènes et, si elle porte le nom des Romains, c’est que ceux-ci l’auraient empruntée aux Grecs avec tant d’autres choses. Un passage d’Euripide[137], mal à propos corrigé par M. Weil dans son édition, vient appuyer cette hypothèse. Grâce au vent, dit le chœur, les voiles d’un navire rapide déployées le long de l’étai tendront leur écoute au-dessus du stolos vers l’avant. Cette phrase, en effet, ne peut s’entendre que d’une voile latine. La voile carrée, suspendue à une vergue, reste toujours en arrière de l’étai, qu’elle ne peut dépasser ; au contraire, la voile latine étant dans sa position normale parallèle à l’axe du bâtiment se trouve, elle et son antenne, le long de l’étai. En outre, si gonflée qu’on suppose une voile carrée, elle ne tendra jamais son écoute au delà de l’avant du navire ; c’est ce qui arrive, au contraire, pour la voile latine, dont la longue antenne, pour peu que le mât soit voisin de la proue, fait saillie au delà de l’avant : l’écoute qui la retient dépasse alors le stolos. On peut donc supposer que les ίστία άκάτεια étaient des voiles latines, mais Graser est moins heureux quand il essaie d’en déterminer le nombre. En effet nous savons que l’un des deux ίστοί άκάτεια portait deux voiles nécessairement superposées et de grandeur différente ; mais rien ne nous autorise à conclure que l’autre eût exactement les mêmes dimensions et fût gréé d’une façon identique. Nous ignorons donc absolument s’il portait une ou deux voiles άκάτεια. Il pouvait se faire que le mât de l’avant fût plus petit et n’eût qu’une voile. C’est peut-être pour cela que, quand l’État se montra moins libéral dans les fournitures d’agrès, on laissa au triérarque le soin de se le procurer. En résumé, nous savons que le navire de guerre athénien avait trois mâts, un au milieu, les autres à l’avant et à l’arrière ; que celui du milieu portait au moins deux voiles carrées et les deux autres des voiles latines ; l’un de ces mâts en avait sûrement deux. Mais nous ne pouvons nous représenter le gréement de la trière que d’une façon approximative, sans prétendre arriver à une restitution absolument exacte. Les voiles άκάτεια complétaient du reste heureusement ce gréement. Tandis que les grandes voiles carrées servaient surtout à naviguer en pleine mer vent arrière, on pouvait utiliser plus spécialement les autres, quand on longeait les côtes ou qu’on s’aventurait au milieu des îles de l’Archipel. Tous ceux qui ont fréquenté ces parages savent en effet qu’on y reçoit souvent des rafales, descendant le long des montagnes si brusquement, qu’il faut carguer en un instant la voile, sous peine de chavirer. Or, c’est là une manœuvre qui s’accomplit beaucoup plus facilement avec les voiles latines qu’avec les voiles carrées. Les voiles chuinta pouvaient donc servir utilement dans certaines circonstances où l’emploi des voiles carrées eût été dangereux. Nous avons même vu qu’elles suffisaient au besoin pour remplacer celles-ci, quand une escadre cherchait l’ennemi avec l’intention de le joindre et de le combattre le plus tôt possible. Mais habituellement on ne les employait pas seules ; nous voyons, par les textes où il en est question, qu’on les considérait comme des voiles auxiliaires, auxquelles on recourait quand il fallait donner à tout prix au navire toute sa vitesse. Ils leur ordonnent, dit Plutarque[138], de s’enfuir loin d’eux en larguant leurs voiles άκάτια. Ailleurs[139], en parlant de la poésie, il se demande si ce n’est pas un pays dangereux qu’il faut faire côtoyer aux jeunes gens le plus rapidement possible, en hissant la voile auxiliaire άκάτιον, soit qu’il s’agisse de l’άκάτειον supérieur qui aurait eu le nom particulier d’έπικούρειον, soit que l’épithète s’applique à la voile άκάτειον prise en général. En tout cas, on voit par ces passages, qu’on faisait usage des άκάτεια pour imprimer au navire une vitesse exceptionnelle et qu’on les considérait comme complétant la voilure, dont la partie principale consistait dans les voiles carrées. C’est peut-être pour cela qu’elles sont négligées sur les monuments figurés, qui ne nous représentent dans les navires que ce qu’ils ont d’essentiel. Enfin, nous avons déjà remarqué qu’une des qualités principales, recherchées dans la construction de la trière antique, c’était de pouvoir évoluer facilement en décrivant une circonférence d’un très petit rayon. La présence des deux gouvernails et, le long de chaque flanc du navire, de deux rangs de rameurs qu’on pouvait faire agir en même temps en sens contraire, rendait facile la solution de cette difficulté. Mais le mouvement était singulièrement favorisé par la présence de voiles obliques à l’arrière et à l’avant ; elles jouaient sans doute par un vent favorable le rôle que joue le foc dans nos petites embarcations, lorsqu’on les fait virer de bord. |
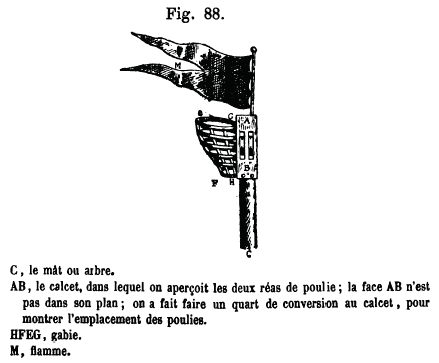
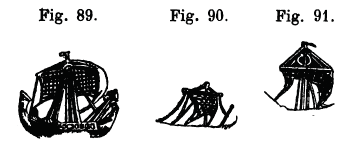
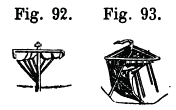 la confusion a probablement empêché de
figurer. Les cargues ayant agi chacune sur le point où elle est figée, la
toile a été ramenée bouffante et ballonnée le long de la vergue, à laquelle
elle n’est pas encore appliquée par les rabans de ferlage.
la confusion a probablement empêché de
figurer. Les cargues ayant agi chacune sur le point où elle est figée, la
toile a été ramenée bouffante et ballonnée le long de la vergue, à laquelle
elle n’est pas encore appliquée par les rabans de ferlage.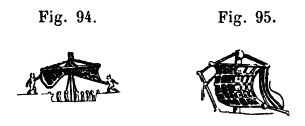 vanche, il est difficile de ne pas
reconnaître la bouline dans le cordage frappé au moyen de branches sur la
ralingue de chute de la voile représentée ici fig. 90. C’est aussi une
bouline qui, sur la fig. 95
vanche, il est difficile de ne pas
reconnaître la bouline dans le cordage frappé au moyen de branches sur la
ralingue de chute de la voile représentée ici fig. 90. C’est aussi une
bouline qui, sur la fig. 95