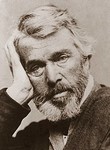HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
LA GUILLOTINE
LIVRE TROISIÈME. — LES GIRONDINS.
I. — CAUSE ET EFFET.Cet immense mouvement insurrectionnel, que nous comparons à un débordement du Tophet et de l'Enfer, a balayé la royauté, l'aristocratie et la vie d'un roi. La question est maintenant que faire après ; quelle forme prendra-t-il ? Fera-t-il place au règne de la loi et de la liberté, comme le demandent les habitudes, les croyances, les efforts de la classe bien élevée, riche, respectable ? C'est-à-dire, cette lave volcanique dont nous avons décrit l'éruption éclatera-t-elle et coulera-t-elle selon la formule des Girondins et un système préconçu de philosophie ? S'il en est ainsi, tant mieux pour nos amis de la Gironde. Cependant ne peut-on pas prophétiser plutôt que, puisque aucune force extérieure, royale ou autre, ne reste maintenant pour diriger ce mouvement, le mouvement suivra une marche qui lui sera propre, et probablement une bien étrange ? De plus, l'homme ou les hommes quels qu'ils soient, qui réussiront le mieux à en interpréter les tendances intérieures, à leur donner une voix, à les traduire en actes, n'en obtiendront-ils pas la direction ? Enfin, en sa qualité de chose sans ordre, de chose qui est au delà et au-dessous de la région de l'ordre, ne doit-il pas tout détruire et se détruire lui-même, jusqu'à ce que quelque chose qui ait de l'ordre s'élève, assez puissant pour le soumettre ? Ce quelque chose, nous pouvons encore le conjecturer, ne sera pas une formule accompagnée de propositions philosophiques et do déclamations, mais une réalité, probablement avec une épée dans la main. Quant à la formule girondine d'une république respectable pour la classe moyenne, toutes les sortes d'aristocratie étant aujourd'hui suffisamment abolies, ii semble qu'il y ait quelque raison d'espérer que l'affaire en restera là. Liberté, Egalité, Fraternité, ce sont les trois mots expressifs et prophétiques. Une république pour les classes moyennes, respectables, pour les gens qui se lavent les mains, peut-elle en être l'accomplissement ? La faim et la nudité, et le cauchemar de l'oppression pesant sur 25 millions de cœurs — c'est cela et non les vanités blessées ou les philosophies contredites des avocats philosophes, des riches boutiquiers, des nobles — les campagnes, qui a été le premier moteur dans cette révolution française ; comme cela arrivera toujours dans toute révolution de ce genre, et dans toutes les contrées. La féodale fleur de lis était devenue une bannière insupportable et lourde pour la marche et avait besoin d'être mise en pièces et foulée aux pieds ; mais le sac à argent de Mammon — car c'est là de notre temps, ce que signifie la respectable république pour les classes moyennes — en est une pire encore, tant qu'il dure. En propres termes, c'est, en vérité, la plus mauvaise et la plus vile des bannières et des symboles de domination chez l'espèce humaine ; elle n'est vraiment possible que dans un temps d'athéisme général, dans un temps où l'on ne croit à rien qu'à la force brutale et au sensualisme ; l'orgueil de la naissance, celui de la place, toute espèce d'orgueil connue étant d'un degré au-dessus de l'orgueil de la bourse. Liberté, Égalité, Fraternité : ce n'est pas dans le sac à monnaie, mais bien loin de là que le sans-culottisme cherchera tout cela. Aussi disons-nous qu'une France insurrectionnelle déliée de tout contrôle de l'extérieur, privée de tout ordre suprême à l'intérieur, formera une des plus tumultueuses activités qu'on ait jamais vues sur cette terre, et nulle formule girondine ne pourra la diriger. Force incommensurable, formée de forces de plusieurs sortes, hétérogènes, compatibles et incompatibles. En termes plus précis, cette France doit avoir besoin de se diviser en partis ; chacun d'eux cherchant à dominer, la contradiction et l'exaspération en surgiront ; et partis contre partis trouveront qu'ils ne peuvent agir d'accord ni exister ensemble. Quant au nombre des partis, il y en aura, à compter rigoureusement, autant qu'il y a d'opinions ; suivant cette règle, dans cette Convention nationale seule, sans parler de la France en général, le nombre des partis doit être de sept cent quarante-neuf, car chaque individu a son opinion. Mais maintenant, comme chaque individu a en même temps une nature individuelle, un besoin de suivre sa propre route, et une nature moutonnière, un besoin de se voir marcher en société avec d'autres, — que peut-il en résulter, si ce n'est des dissolutions, des précipités, des mouvements désordonnés et incessants d'attraction et de répulsion, jusqu'à ce qu'enfin l'élément dominant se dégage, et que cette sauvage alchimie s'organise de nouveau. Ce chiffre élevé de sept cent quarante-neuf partis cependant, on n'a jamais vu une nation y arriver. Jamais, à vrai dire, aucun peuple n'a été beaucoup au delà de deux partis, deux à la fois ; — tant est insurmontable chez l'homme la tendance à l'unité, malgré son insurmontable tendance à la di vision Deux partis, disons-nous, voilà ordinairement le nombre pour une époque ; que ces deux partis iideut leurs différends par la lutte, tous les partis secondaires se rallient à l'ombre de celui qui leur ressemble le plus ; lorsque Fun a renversé l'autre, alors celui-là à son tour, se divise, se détruit lui-même, et ainsi se continue la lutte, autant que cela est nécessaire. Telle est la marche des révolutions qui s'étendent autant que la révolution française Pa fait, quand les prétendus liens de la société se brisent et que toutes les lois, qui ne sont pas des lois de la nature, sont renversées et ne sont plus que de vaines formules. Mais, quittant ces considérations tant soit peu abstraites, que l'histoire note cette réalité concrète, que les nies de Paris exposent le lundi 25 février 1793. Bien avant le jour, ce matin-là le bruit et la fureur parcourent ces rues. Il y a eu assez de pétitions, la Convention a été souvent sollicitée. Hier encore est arrivée une députation de blanchisseuses avec une pétition, se plaignant qu'il n'y ait pas autant de savon qu'il en faudrait ; sans parler du pain et de ce qui l'accompagne. Le cri plaintif des femmes autour de la salle de marne était : Du pain et du savon ![1] Et maintenant dès six heures du matin, ce lundi, on voit aux portes des boulangers des queues extraordinaires s'agitant avec furie. Non-seulement le boulanger, mais aussi deux commissaires de sections pour l'aider, règlent avec difficulté la distribution journalière du pain. Ils s'appliquent à parler avec douceur, à la clarté des lampes du matin, ces boulangers et ces commissaires ; et alors le pâle et frileux soleil de février se lève et montre une scène inattendue. Les femmes patriotes indignées, en partie pourvues de pain, se précipitent alors dans les boutiques criant qu'elles auront des épices. Des épices, il y en a assez ; les barils de sucre circulent dans les rues, les citoyennes patriotes les prennent au taux exact de 22 sous la livre ; de même pour les caisses de café, de savon, voire même de cannelle et de girofle ; avec de Veau-de-vie- et autres alcools de toute sorte, — à un prix fixé, que quelques-unes ne payent pas ; le tout en face du pâle épicier qui se tord silencieusement les mains ! que faire ! quelle aide espérer ? Les citoyennes distributrices sont violentes dans leurs paroles et leurs gesses, leurs longs cheveux d'Euménides flottant en désordre ; on voit de plus des pistolets pendus à leurs ceintures, et même quelques-unes, dit-on, portent de la barbe, — patriotes mâles en jupons et en bonnets. Ainsi, dans les rues des Lombards, des Cinq-Diamants, des Poulies, dans la majeure partie des rues de Paris règne cette effervescence, durant tout le jour ; ni la municipalité, ni le maire Flache, bien que tout récemment encore il fût ministre de la guerre, n'envoient aucune force militaire pour y mettre ordre, et n'emploient d'autre pouvoir que celui d'une éloquence persuasive et cela jusqu'à sept heures du soir, ou même plus tard. Cinq semaines avant, le lundi 21. janvier, nous avons vu Paris guillotiner son roi, et, se tenir silencieux, comme une cité pétrifiée par enchantement ; et aujourd'hui, ce lundi, le voilà rempli de tumulte par la vente du sucre ! Les cités, surtout. tes cités en état de révolution, sont soumises à ces sortes de vicissitudes ; le courant secret de l'existence et des affaires civiques se manifestent aux yeux en un phénomène concret. Et ce phénomène, quand son existence secrète devient publique et se manifeste dans la rue, il n'est pas facile au philosophe d'en trouver les causes et les effets. Quelles sont par exemple, la cause ou les causes exactes et philosophiques de cette vente de sucre ? Ces choses qui sont devenues visibles dans les rues des Poulies et dans tout Paris, d'où proviennent-elles, demandons-nous, et où tendent-elles ? Pitt y a la main, For de Pitt c'est ce qui parait évident aux yeux de tous les patriotes. Mais alors par l'intermédiaire de quels agents de Pitt ? Varlet, apôtre de la liberté, s'était fait remarquer depuis peu, avec sa pique et son bonnet rouge. Le député Marat, a publié dans son journal, aujourd'hui même, des plaintes sur la cruelle disette et les souffrances du peuple, allant jusqu'à la fureur. Si vos droits de l'homme étaient autre chose qu'une vaine feuille de papier, le pillage de quelques boutiques, lm accapareur ou deux pendus aux linteaux 3des portes, mettraient un terme à cet état de choses[2]. Ces paroles ne sont-elles pas, disent les Girondins, pleines d'indications ? Pitt a corrompu les anarchistes ; Marat est un agent de Pitt ; de là cette vente de sucre. Quant à la société mère, il est clair pour elle que la disette est factice ; c’est l'ouvrage des Girondins, et de leurs pareils un lot d'hommes vendus en partie à Pitt, vendus en totalité à leur propre ambition, et à leur pédantisme sans cœur ; ils ne fixeront pas le prix des grain, mais parleront d'une manière pédantesque en faveur du commerce libre ; désirant affamer Paris pour l'exaspérer et le brouiller avec les départements : de là cette vente de sucre. Et, hélas ! à ces deux choses remarquables, savoir ce phénomène et de telles théories de ce phénomène, ajoutons cette troisième, que la nation française a cru, pendant plusieurs années, à la possibilité, voire même à la certitude et la venue prochaine, d'un millennium universel, règne de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, sous lequel tous les hommes seront frères, et d'où la douleur et le crime seront bannis. Pas de pain à manger, point de savon pour laver ; et le règne de la félicité parfaite prêt à surgir, toujours annoncé depuis la chute de la Bastilles Comme nos cœurs brûlaient en nous, à la fête des piques, quand le frère se précipitait sur le sein de son frère, et que dans un éclatant jubilé, vingt-cinq millions d'hommes éclataient en transports de joie au milieu des grondements et de la fumée du canon ! alors notre espérance était aussi claire que le soleil brillant ; rouge est aujourd'hui cette espérance, semblable au feu qui consume. Mais, ô ciel, par quel enchantement, par quel tour de passe-passe diabolique, cette félicité parfaite, toujours à portée de la main, se dérobe-t-elle toujours, ne laissant à sa place que la disette, ces traitres-ci après ceux-là ! Tremblez, traîtres, redoutez un peuple qui se dit patient, endurant, niais qui ne peut toujours souffrir que ses poches soient idées de cette façon, sous prétexte de millenniurn ! Ô vous, lecteurs, voici le miracle. De ces débris putrides de scepticisme, de sensualisme, de sentimentalisme, d'hypocrite machiavélisme, une telle foi s'est réellement élevée, elle flamboie dans le cœur d'un peuple. Un peuple entier s'éveillant, pour ainsi dire, à la conscience, dans une profonde misère, croit pouvoir atteindre sur cette terre un paradis de fraternité. Avec des bras avides, il lutte pour saisir l'ineffable. Il ne peut le saisir, pour certaines causes. — Rarement trouvons-nous qu'un peuple entier ait une foi, excepté dans les choses qu'il peut manger et toucher. Quand il a une foi, son histoire devient saisissante et palpitante. Mais depuis le temps où l'Europe, sous son armure de fer, s'ébranla tout entière à la parole de Pierre l'Hermite, et se précipita vers le sépulcre qui avait renfermé Dieu, il n'y a eu aucune impulsion générale de foi qu'on ait pu remarquer. Depuis que le protestantisme marche en silence, depuis que la voix d*aucun Luther, le tambour d'aucun Zisca ne proclame que la vérité de Dieu n'est pas le mensonge du démon ; depuis que le dernier des Caméroniens — Renwick était son nom, honneur au nom du brave ! — est, tombé sous les balles dans la citadelle d'Edimbourg, il n'y avait pas eu de mouvement partiel de foi parmi les nations ! Mais aujourd'hui, voilà que cette nation française croit encore une fois ! Ici, dirons-nous, dans cette foi extraordinaire est le miracle. C'est certes une foi de la plus singulière espèce, même entre toutes les fois, et elle se traduira en prodiges. C'est l'âme de ce inonde-prodige appelé la révolution française, que l'univers regarde encore avec, stupeur. Mais, du reste, que personne ne demande à l'histoire d'expliquer par quelle cause et quel effet les choses procèderont à l'avenir. Cette lutte entre la Montagne et la Gironde, et, ce qui suivra, est la lutte entre le fanatisme et les miracles ; cherchez-y donc les causes et les effets. Son bruit est, pour l'esprit, un vacarme confus de voix, que l'on comprend un peu à force d'écouter et d'étudier : le bruit d'une bataille, les hourras d'un triomphe, des cris de désespoir. La Montagne n'a laissé aucun mémoire ; les Girondins en ont laissé qui ne sont que trop souvent des interjections 'sans fin de : Malheur à moi ! et Malédiction sur vous ! Quand l'histoire pourra tracer philosophiquement la conflagration d'un brûlot enflammé, qu'elle tente cette autre tache. Ici repose la couche de bitume, là le souffre ; là s'étend la veine de poudre, de nitre, de térébenthine et de graisse ; voilà ce que peut connaitre en partie l'histoire, si elle s'enquiert assez pour cela. Mais comment ils ont agi et réagi au-dessous des ponts, les couches de feu jouant rune dans l'autre, par leur nature, et par l'art de l'homme, alors que toutes les mains s'agitent avec rage, et que les flammes s'élancent au-dessus des haubans et des mats de perroquet, que l'histoire n'essaye pas de le montrer. Le brûlot, c'est la vieille France, l'ancienne forme de l'existence française ; son équipage, une génération d'hommes. Bien sauvages sont leurs cris et leur fureur ; on dirait des esprits tourmentés dans cette flamme ; mais, après tout, lecteurs, n'ont-ils pas disparu ? leur brûlot et eux, en effrayant l'univers, ont fait voiles ; leurs flammes et leurs foudres sont entièrement perdues dans les profondeurs du temps. L'histoire n'a donc qu'une seule chose à faire, les plaindre tous, car ils en ont eu tous de dures à supporter. Lui-même, l'incorruptible au teint couleur vert de mer, obtiendra quelque pitié ; on aura pour lui quelque tendresse humaine, bien qu'il en coûte quelque effort. Et maintenant, cela une fois bien obtenu, le reste deviendra plus facile. Aux yeux d'une compassion fraternelle, les innombrables dépravations se dissipent d'elles-mêmes, les exagérations et les exécrations tombent volontairement. Debout, en sûreté sur le rivage, nous regarderons attentivement et verrons ce qu'il y a d'intéressant pour nous, ce qui peut nous être adapté. II. — CULOTTISME ET SANS-CULOTTISME.La Gironde et la Montagne sont aujourd'hui en pleine querelle ; la rage de part et d'autre, dit Toulongeon, lève jusqu'à une rage blanche. Ce qu'il y a de curieux, de pitoyable, c'est que tous ces êtres ont sur leurs lèvres le mot république ; dans le cœur de chacun est un désir passionné pour quelque chose qu'il appelle république. Voyez cependant leur lutte à mort ! ainsi pourtant sont faits les hommes. Des créatures qui vivent dans le désordre, qui, une fois jetées ensemble, sont toutes prêtes à tomber dans cette confusion des confusions qui est leur querelle, tout simplement parce que leurs confusions diffèrent les unes des autres, ou plutôt parce qu'elles semblent différer ! La parole de l'homme est un pauvre interprète de sa pensée ; sa pensée même est un triste interprète de son mystère intérieur, sans nom, d'où la pensée et l'action tirent naissance. Nul homme ne peut s'expliquer lui-même, et ne peut être expliqué. Les hommes ne se voient pas les uns les autres, mais quand ils croient se voir, ils ne voient que des fantômes déformés, qu'ils haïssent et qu'ils combattent ; car toute bataille est, on le dit avec raison, une mésintelligence. Mais vraiment cette comparaison du brûlot, qui montrait nos pauvres frères français, si ardents déjà de nature, travaillant en outre dans un milieu enflammé, n'était pas dépourvue de sens. Considérez-la bien, elle renferme une ombre de vérité. En effet, un homme, une fois lancé la tête la première dans le républicanisme ou dans un autre transcendantalisme, luttant et faisant du fanatisme au milieu d'une nation qui lui ressemble, se trouve, pour ainsi dire, enveloppé d'une atmosphère de transcendantalisme et de délire ; son propre individu se perd dans quelque chose qui n'est pas lui, mais dans une chose étrangère bien qu'inséparable de lui. Il est étrange de penser à cela, que le vêtement de l'homme semble toujours couvrir le même homme ; et pourtant l'homme n'est pas là sa volonté n'y est pas, ni la' source de ce qu'il fera et projettera ; à la place de l'homme et de sa volonté, il y a un fanatisme et un fatalisme incarnés sous ses traits. Ce pauvre fanatisme incarné poursuit sa route ; nul ne peut le secourir, et lui-même moins que tout autre. C'est un prodigieux et tragique objet, — tel que le langage humain, qui n'est pas accoutumé à exprimer des choses pareilles, ayant été inventé pour les usages de la vie commune, a peine à en donner par des figures une idée imparfaite. L'élément ambiant du feu matériel n'est pas plus violent que celui du fanatisme ; et bien que visible à l'œil il n'est pas plus rée ?. La volonté agit, libre et asservie en même temps, dans un continuel entraînement ; le mouvement des libres esprits humains devient un tourbillon furieux de fatalisme aveugle comme les vents ; et la Montagne et la Gironde, quand elles reviennent à elles-mêmes, sont tout étonnées de voir où cela les a jetées et renversées. Telle est la façon merveilleuse dont l'homme peut agir sur l'homme ; c'est la conscience et l'inconscience fondues mystérieusement dans notre existence mystérieuse ; c'est la nécessité sans borne enveloppant le libre arbitre. Les armes des Girondins sont la philosophie politique, l'honorabilité et l'éloquence. L'éloquence, ou, si vous voulez, la rhétorique, réellement d'un ordre supérieur ; Vergniaud, par exemple, tourne une période aussi gracieusement qu'aucun homme de cette génération. Les armes de la Montagne sont celles de ta simple nature l'audace et l'impétuosité qui peuvent devenir de la férocité ; ces hommes sont entiers dans leurs déterminations, dans leurs convictions ; oui, ces hommes, dans quelques cas, comme les septembriseurs, doivent ou vaincre ou périr. Le terrain pour lequel on doit combattre est la popularité ; mais vous devez chercher la popularité ou avec les amis de l'ordre et de la liberté, ou bien avec les amis de la liberté seulement ; la chercher avec les deux cela est malheureusement impossible. Avec les premiers et généralement avec les autorités des départements, et ceux qui lisent les débats parlementaires, qui ont de la respectabilité, de la fortune, et qui sont de nature pacifique, la Gironde l'emporte ; avec les patriotes extrêmes, avec les millions d'indigents, surtout avec la population de Paris qui ne lit pas autant qu'elle entend et voit, les Girondins ont le dessous, et les Montagnards le dessus. L'égoïsme et la bassesse d'esprit ne font défaut d'aucun côté. Bien certainement non, du côté des Girondins, où dans le fait l'instinct de conservation personnelle trop fortement développé par les circonstances fait presque une triste figure ; où une certaine finesse, qui va même jusqu'à la ruse et à la rouerie, se montre de temps en temps. Ce sont des hommes habiles dans l'escrime du barreau. Ils ont été dénommés les Jésuites de la révolution[3] ; c'est vraiment une trop dure dénomination. Il faut avouer aussi que cette rude et turbulente Montagne a un sentiment de ce que signifie la révolution, qui manque tout à fait à ces éloquents Girondins. La révolution s'est-elle faite et a-t-elle lutté contre le monde, ces quatre fatigantes années, pour qu'une formule pût être réalisée, pour que cette société pût devenir méthodique, logiquement démontrable, et que la vieille noblesse s'évanouit avec ses prétentions ? ou ne doit-elle pas en même temps apporter quelque rayon de lumière et de soulagement aux vingt-cinq millions d'individus qui étaient assis dans l'obscurité et dans la misère, jusqu'au moment où ils se levèrent, la pique à la main ? Tout au moins ne peut-on pas penser qu'elle leur devait apporter assez de pain pour subsister ? Il y a çà et là dans la Montagne, dans Marat l'ami du peuple, dans l'incorruptible à la couleur vert de mer lui-même, quoique d'ailleurs si sec et si formulaire, le sentiment intime de cette dernière nécessité ; sans cette conviction, tous les talents ne sont rien, et l'éloquence du barreau la plus choisie n'est qu'un airain sonore et une cymbale résonnante, D'un autre côté, bien plus froid, bien plus protecteur, bien moins sincère, est le ton des Girondins à l'égard de nos pauvres frères. — Ces frères que souvent on désigne sous ce nom les masses comme si ce n'étaient point des personnes, mais des amas de matière combustible, explosive, propre à renverser les bastilles ! En vérité, un révolutionnaire de cette sorte n'est-il pas un solécisme, désavoué par la nature et l'art, ne méritant que d'être effacé et de disparaître ? Certainement, aux oreilles de nos pauvres frères de Paris, tout ce patronage Girondin sonne l'homicide et la mort ; s'ils parlent bien et s'ils sont irréfutables en logique, ils n'en sont que plus faux, plus haïssables en fait. Oui, sans nul doute, quand il aspire à la popularité, le Girondin a un jeu bien difficile à jouer ici parmi nos pauvres frères de Paris. S'il se fait écouter par la respectabilité au loin, c'est en insistant sur septembre et autres événements de même sorte ; c'est aux dépens de ce Paris où il demeure et où il pérore. Qu'il est pénible de pérorer au milieu d'un tel auditoire ! C'est pourquoi la question s'élève : ne pourrions-nous pas aller hors de ce Paris ? Deux fois, ou même davantage, cet essai est tenté ; si nous ne le faisons pas nous-mêmes, pense Guadet, du moins nos suppléants peuvent le faire. Car chaque député a un suppléant ou substitut, qui le remplace en cas de besoin ; ceux-ci ne peuvent-ils pas se réunir, par exemple à Bourges, paisible ville épiscopale, dans le paisible Berry, à quarante lieues de Paris ? Dans ce cas-là que gagnerait le sans-culotte Parisien à nous insulter, nos suppléants siégeant tranquillement à Bourges, où nous pourrions courir. Bien plus, les assemblées électorales primaires, pense Guadet, pourraient être convoquées de nouveau, et une nouvelle Convention formée avec de nouveaux mandats du peuple souverain ; et Lyon, Bordeaux, Rouen, Marseille, qui ne sont que des villes de province, seraient charmées de nous bien accueillir à leur tour, et de devenir des sortes de capitales, et de faire entendre raison à ces Parisiens. peaux projets, qui tous avortent ! Si aujourd'hui on les décrète dans la chaleur d'une logique éloquente, d'autres considérations les font révoquer avec passion et clameurs, le lendemain[4]. Voulez-vous, ô Girondins, nous partager en républiques séparées, comme les Suisses, comme vos Américaine ? Ainsi il n'y aura plus de métropole ni de nation française indivisible ? Votre garde départementale semblait pousser à ce but ! une république fédérale ! Fédéralistes ! Hommes et tricoteuses répètent fédéralistes, sans savoir au juste ce que le mot signifie ; mais ils vont toujours le répétant, comme c'est l'ordinaire en pareils cas, jusqu'à ce que le sens en devienne presque magique, bon pour désigner tout mystère d'iniquité ; fédéraliste devient un mot d'exorcisme, une sorte d’Apage-Satanas. Mais de plus, considérez comme l'opinion publique est empoisonnée dans les départements par les journaux de ces Brissot, de ces Gorsas, de ces Caritat-Condorcet ! Et alors aussi quel contrepoison encore plus barbare, plus pernicieux, est répandu par le Père Duchesne d'Hébert, le plus brutal des journaux publiés sur la terre, par le Rougiff de Guffroy, par les feuilles incendiaires de Marat ! Plus d'une fois, à l'occasion des plaintes déposées et de l'effervescence soulevée, on décrète que nul ne pourra être à la fois législateur et journaliste, et qu'on devra choisir entre l'une ou l'autre de ces fonctions[5]. Mais ce décret aussi qui rie pouvait être vraiment que de peu d'utilité est révoqué ou éludé, et resta uniquement comme un désir pieux. Cependant, comme triste fruit d'une telle dispute, voyez, ô représentants de la nation, combien entre les amis de la loi et les amis de la liberté il s'est élevé de haines et de jalousies profondes, donnant la fièvre à la république entière ? Le département, la ville de province, est en opposition avec la métropole, riche contre pauvre, culotté contre sans-culotte, homme contre homme. Des cités méridionales arrivent des adresses empreintes d'un cachet presque accusateur ; car Paris a longtemps souffert la calomnie des journaux. Bordeaux demande avec force le règne de la loi et de l'honnêteté, ayant en vue le girondisme. Avec force, Marseille forme la même demande. De Marseille arrivent deux adresses ; l'une des Girondins, l'autre des Jacobins sans- culottes. Le chaleureux Rebecqui, dégoûté de ce travail de la Convention, s'est fait remplacer par son substitut et est retourné chez lui, où il est également dégoûté de querelles semblables. Lyon, ville de capitalistes et d'aristocrates, est encore dans une mauvaise position, elle est presque en insurrection. Le jacobin Chalier, conseiller municipal, a, à la lettre, tiré le poignard contre Nièvre-Chol, maire modérantin, un de vos maires modérés, peut-être aristocrates, royalistes ou fédéralistes ! Chalier qui fit un pèlerinage, à Paris, pour admirer Marat et la Montagne s'est enflammé vraiment à leur autel sacré ; car le février dernier l'histoire ou la rumeur publique dit qu'on le vit haranguant ses patriotes lyonnais d'une manière tout à fait supérieure, avec un poignard na à la main : recommandant — dit-on — les énergiques moyens de septembre, la patience étant à bout, et disant qu'il fallait que les frères jacobins jouassent eux-mêmes, sans tarder, le rôle de la guillotine ! on le voit encore dans des gravures, monté sur une table, le pied en avant, se démenant, face grossière, dure, aux sourcils froncés, mufle de dogue enragé, les yeux sortant de leurs orbites ; sa puissante main droite brandit tantôt un poignard, tantôt un pistolet d'arçon ; d'autres museaux de dogues s'échauffant au-dessous de lui ; — un homme qui probablement ne finira pas bien. Cependant la guillotine ne fonctionna pas impromptu ce jour-là sur le pont Saint-Clair ni ailleurs ; mais elle continua de reposer toute rouillée dans son grenier[6]. — Nièvre-Chol arriva avec des soldats, avec des canons roulants, de la manière la plus confuse ; et les 900 prisonniers ne reçurent aucun mal. Tout Lyon est en désordre, avec le fracas des canons qui roulent. Les commissaires de la Convention doivent y être expédiés au plus vite ; pourront-ils le calmer et conserver la guillotine dans son grenier ? Finalement considérez si, dans toutes ces folles querelles des cités méridionales et de, la France en général, une classe perfide de crypto-royalistes n'observe et ne surveille pas prête à frapper en temps opportun ! Il n'y a ni pain, ni savon ; voyez les femmes patriotes vendre le sucre au juste taux de vingt-deux sous la livre ! Citoyens représentants, il serait bon, vraiment, que vos querelles se terminassent, et que le règne de la félicité parfaite commençât ! III. — L'AIGREUR S'AUGMENTE.En somme, nul ne peut dire que les Girondins se manquent à eux-mêmes ; ils vont aussi loin que la bonne volonté peut aller. Ils piquent sans cesse la Montagne aux endroits sensibles, par principe, et aussi par jésuitisme. Outre septembre, dont il y a très-peu à tirer, excepté de l'effervescence, nous remarquerons deux endroits sensibles où la Montagne souffre souvent : Marat et Orléans-Égalité. Le sale Marat, pour son compte et pour celui de la Montagne, est attaqué à tout moment, il est signalé à la France comme un prodige dégoûtant et sanguinaire, poussant au pillage des boutiques : que la Montagne en porte la responsabilité ! La Montagne murmure, mal à l'aise ce maximum de patriotisme, comment l'avouer ou le désavouer ? — Quant à Marat personnellement, avec son idée fixe, il reste invulnérable à de telles attaques ; l'ami du peuple gagne bien évidemment en importance, à mesure que son peuple bien-aimé grandit. Point de cris, à présent, lorsqu'il va parler ; il y a plutôt des applaudissements de temps en temps, appui qui lui donne confiance. Le jour où les Girondins proposèrent de le décréter d'accusation pour ce paragraphe de février où il conseillait de pendre un accapareur ou deux aux linteaux des portes, Marat proposa de les décréter de folie, et en descendant les marches de la tribune, on l'entendit proférer ces exclamations très-peu parlementaires : Les cochons, les imbéciles ! Bien souvent il croasse un amer sarcasme, ayant vraiment une langue rude et mordante, et un profond mépris pour tout extérieur délicat, et une ou deux fois, il rit, et même rit aux éclats, des gentillesses et des airs superfins de ces Girondins hommes d'État, avec leur pédantisme, leurs beaux arguments leur pusillanimité. Voici deux ans, dit-il, que vous vous plaignez des attaques, des complots et du danser qui vous menace, et vous n'avez pas une égratignure à montrer[7]. — Danton avec rudesse le rembarre de temps en temps : c'est un maximum de patriotisme qu'on ne peut ni avouer ni désavouer. Mais le second endroit sensible de la Montagne est ce personnage contradictoire, Monseigneur Égalité prince d'Orléans. Contemplez ces hommes, dit la Gironde, ayant parmi eux un ancien prince Bourbon ; ce sont des créatures de la faction d'Orléans ; ils veulent faire roi Philippe ; un roi n'est pas plutôt guillotiné qu'ils en vont faire un autre à sa place ! Les Girondins ont fait cette motion, Buzot l'a faite il y a longtemps, par principe et par jésuitisme, que toute la race des Bourbons eût à sortir de France, ce prince Égalité marchant à l'arrière-garde. Mort tiens qui pourraient produire quelque effet sur le public, et vis-à-vis desquelles la Montagne, mal à l'aise, ne sait que faire. Et le pauvre Orléans-Égalité lui-même, car on commence à le plaindre, que fait-il avec eux ? Désavoua de tons les partis, rejeté et renvoyé de l'un à l'autre, dans quel coin de la nature pourra-t-il aujourd'hui intriguer en sûreté ? D'espérances raisonnables il n'en reste pas pour lui ; quelques rayons pâles et douteux d'une espérance chimérique luisent encore du quartier de Dumouriez ; comment, je ne dis pas le vie ! Orléans-Égalité, corn-piétement usé, mais le jeune Chartres-Égalité lui-même pourrait-il s'élever à une sorte de royauté ? Abrité, si c'est là un abri, dans les crevasses de la Montagne, le pauvre Égalité attendra ; un refuge dans le Jacobinisme, un autre du côté de Dumouriez et de la contre-révolution ne sont-ce pas là deux chances ? Cependant son air, dit Madame de Genlis, est devenu sombre ; il fait peine à voir. Sillery également, le fermier de Genlis, qui voltige autour de la Montagne, non au-dessus, est dans une mauvaise route. La darne de Genlis est venue au Raincy, ayant à cette époque quitté l'Angleterre et Bury Saint-Edmond ; elle a été rappelée par Égalité avec sa jeune élève Mademoiselle Égalité, afin que Mademoiselle ne pût être comptée au nombre des émigrés, et traitée comme telle. Mais c'est une fausse démarche. Genlis et son élève trouvent qu'elles doivent se retirer en Hollande, attendre sur la frontière pendant une ou deux semaines, jusqu'â ce que Monseigneur, avec l'aide des Jacobins ait réussi à l'atteindre. Le lendemain matin, dit la darne de Genlis, Monseigneur, plus sombre que jamais, m'offrit son bras pour me conduire à la voiture, j'étais grandement troublée ; Mademoiselle fondait en larmes, son père était pile et tremblant. Après que je rue fus assise, il se tint immobile à la portière, les yeux fixés sur moi ; son regard triste et douloureux semblait implorer la pitié. — Adieu, madame, dit-il. L'altération de sa voix me bouleversa tout à fait ; incapable de prononcer une syllabe, je tenu dis la main, il la saisit fortement, et alors se retournant et s'avançant vers les postillons, il leur fit signe, et nous partîmes[8]. Les partisans de la paix ne manquent pas non plus ; nous en citerons deux : l'un ferme sur le sommet de la Montagne, l'autre qui n'est encore fixé nulle part : Danton et Ban ère. L'ingénieux Barrère, ancien constituant et journaliste, descendu des pentes des Pyrénées, est un des membres les plus utiles de cette Convention, à sa façon. Le vrai peut se trouver des deux côtés, d'un seul ciné, ou n'être ni d'un côté ni de l'autre ; mes amis, vous devez donner et prendre ; du reste, bonne chance à qui gagnera ! Telle est la devise de Barrère. Ingénieux, presque jovial, l'œil perçant, souple, gracieux, un homme qui réussira. Bélial dans le Pandemonium assemblé était à peine plus habile à charmer les oreilles et les yeux. Homme indispensable : dans le grand art de vernir, on peut dire qu'il n'a pas son pareil. Qu'il y ait une explosion, comme il en éclate tant, une confusion, un spectacle pénible, qu'aucune langue ne peut rendre, qu'aucun œil ne peut fixer, livrez-le à Barr ère ; Barr ère sera le rapporteur de la commission dans cette circonstance, vous la verrez se transformer en chose régulière, prendre tout le charme et toute la beauté désirables. Sans un tel homme, nous le disons, comment ferait la Convention ? Ne l'appelez pas, comme l'hyperbolique Mercier : Le plus grand menteur de France. On ne peut pas dire qu'il y ait chez lui assez de vérité pour faire un vrai mensonge. Appelez-le ainsi que le fait. Burke, l'Anacréon de la guillotine, et un homme utile à cette Convention. L'autre partisan de la paix que nous nommerons, est Danton. La paix, la paix entre nous ! s'écrie Danton bien souvent : ne sommes-nous pas seuls contre l'univers ? une petite poignée de frères ! le large Danton est aimé de toute la Montagne, mais elle le trouve trop coulant, trop modéré, pas assez défiant ; il se tient entre Dumouriez et ses nombreux censeurs se gardant avec un soin anxieux d'exaspérer notre seul général ; dans ce tapage tumultueux la forte voix de Danton résonne pour l'union et la pacification. Il y a des réunions, des dîners avec les Girondins ; il est si essentiel que l'on soit unis ! Mais les Girondins sont altiers et respectables ce Titan de Danton n'est point un homme à formules, il reste sur lui une ombre de septembre : Vos Girondins n'ont point de confiance en moi, est la réponse qu'en obtient le conciliant Meillan ; à tous les arguments, à tous les raisonnements que peut avancer ce conciliant Meillan, la réponse est toujours ils n'ont point de confiance[9]. Le tapage deviendra encore plus bruyant ; la rage tourne au pâle. Au fait, quelle angoisse pour le cœur d'un Girondin que cette première probabilité navrante quoi ! cette Montagne anarchique, si méprisable et si peu philosophique pourrait en somme triompher ! Les cruels septembriseurs, un Tallien de cinquième étage, cc un Robespierre sans une idée en tête, selon Condorcet, sans un sentiment dans le cœur n ! Et cependant nous, la fleur de la France, nous ne pouvons leur résister ; tenez, le sceptre nous échappe, de nos mains il passe dans les leurs ! L'éloquence, la philosophie, l'honorabilité, tout cela ne sert à rien ; contre la stupidité, les dieux même combattent inutilement : Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens ! Bruyantes sont les lamentations de Louvet ; sa pauvre existence tout aigrie par la rage et par une sorte de seconde vue soupçonneuse. Furieux est le jeune Barbaroux, furieux et dédaigneux ; muette comme une reine avec l'aspic sur le sein, se tient la femme de Roland ; les comptes de Roland ne sont jamais examinés, son nom est, devenu un sobriquet. Telle est la fortune de la guerre, surtout de la révolution. Le gouffre immense du Tophet et le 10 août s'est ouvert par la magie de votre parole éloquente, et voici que maintenant il ne se ferme pas à votre voix ! C'est une chose dangereuse qu'une telle magie. Le famulus du magicien a pris possession du livre défendu, et a évoqué un esprit : Plaît-il ? dit l'Esprit. Le famulus, légèrement ému, lui a ordonné d'apporter de l'eau ; le léger esprit est allé en chercher un seau de chaque main, et malheur ! il ne cesse plus d'en apporter ! Désespéré, le famulus crie après lui, le frappe, le coupe en deux ; voilà maintenant deux esprits porteurs d'eau h. l'œuvre, et la maison sera inondée comme au déluge de Deucalion. IV. — LA PATRIE EN DANGER.Ou plutôt, disons mieux : cette guerre sénatoriale pourrait durer longtemps, les partis se heurtant, se prenant à la gorge pourraient se détruire et s'étouffer l'un l'autre, avec les formes parlementaires, sans effusion de sang, mais à une condition, c'est que la France pût au moins subsister pendant ce temps-là Mais ce peuple souverain a des facultés digestives et ne peut pas les exercer sans pain. Nous sommes missi en guerre, et il nous faut vaincre, en guerre avec, l'Europe, avec le destin avec la famine, et voilà qu'au printemps de l'année toute victoire nous abandonne. Les postes avancés de Dumouriez s'étendent jusqu'à Aix-la-Chapelle ; il a combiné le plus beau plan pour écraser la Hollande, à l'aide de stratagèmes, de bateaux à fonds plats et d'une rapidité foudroyante ; il avait d'abord réussi ; mais malheureusement ses succès sont, arrêtés. Aix-la-Chapelle est perdue, la fumée et le bruit ne suffiront pas à assurer la reddition de Maëstricht ; les bateaux à fonds plats doivent se remettre en marche et reprendre le chemin par o ils sont venus. De la fermeté à présent, vous, hommes intrépides et prompts ; battez en retraite avec courage, comme des Parthes. Hélas ! est-ce la faute du ministre de la guerre, celle de Dumouriez ou celle de la destinée ? peu importe, il n'y a pas d’autre parti à prendre, que. celui de la retraite, heureux, si elle ne se change pas en faite ! car déjà les cohortes frappées de terreur et les traînards se dispersent sans attendre aucun ordre, retraite désastreuse ! dix mille hommes fuient sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'ils aient revu la France[10]. Ce qui est pis encore, Dumouriez lui-même est peut-être secrètement un traître. Bien dur est le ton sur lequel il écrit à nos comités. Les commissaires et les Jacobins pillards ont fait un mal incalculable ; Hassenfratz n'envoie ni cartouches ni vêtements ; nous avons bien des souliers, mais qui n'ont que des semelles dérisoires de bois ou de carton. Rien, en un mot, ne va bien. Danton et Lacroix, lorsqu'ils étaient commissaires, sentirent le besoin d'unir à la France la Belgique, dont Dumouriez aurait fait le plus joli petit duché, à son profit ! Le général est furieux de tout cela, il nous écrit amèrement. Oui sait ce que médite ce bouillant petit général ? Dumouriez, duc de Belgique ou de Brabant, et, dit-on, le jeune Égalité roi de France voilà un moyen de finir notre révolution ! Le comité de défense observe, et secoue la tête ; qui, si ce n'est Danton, incapable de soupçon, pourrait encore espérer Et le général Custine revient des contrées du Rhin ; Mayence conquise sera reconquise, les Prussiens s'assemblent autour pour la couvrir de boulets et de bombes. Mayence résiste, le commissaire Merlin de Thionville faisant des sorties à la tête des assiégés, résiste jusqu'à la mort, mais pas plus longtemps. Quel triste revers pour Mayence ! Le brave Forster, le brave Lux y ont planté des arbres de la liberté, au milieu du chant du Ça ira, dans les neiges de l'hiver dernier, et formé des sociétés de Jacobins, et ont incorporé le territoire à la France : ils sont à Paris, comme députés ou délégués, et ont leurs 18 fr. par jour ; mais voyez, avant que l'arbre de la liberté ait toutes ses feuilles, Mayence se change en un cratère qui vomit le feu, et sur lequel tombe une pluie de feu ! Aucun de ces hommes ne reverra Mayence ; ils ne sont venus ici que pour mourir. Forster a fait le tour du globe, il a vu Cook périr sous les massues d'Owaï ; mais il n'a encore rien vu ni souffert comme ce Paris. La pauvreté lui sert d'escorte, rien ne peut lui venir de chez lui, excepté les nouvelles de Job ; les 18 fr. par jour qu'en qualité de député ou délégué, nous touchons avec tant de peine, sont en assignats, et leur valeur baisse rapidement. Pauvreté, désappointement, inaction, calomnie, le brave cœur se déchire lentement ! Tel est le partage de Forster. Du reste, la demoiselle Théroigne vous sourit dans les soirées une belle tête aux boucles brunes, d'un caractère exalté, et s'efforce de conserver sa voiture. Le Prussien Trenck, le pauvre baron souterrain, jargonne et querelle d'une manière très-peu mélodieuse. La face de Thomas Paine est rouge de pustules mais ses yeux brillent d'un éclat extraordinaire. Les députés de la Convention vous invitent à dîner, très-courtoisement et nous jouons tous au plumpsack[11]. C'est l'explosion et la nouvelle création d'un monde, dit Forster ; et les acteurs, êtres chétifs et insignifiants, bourdonnent autour, comme une poignée de moucherons. On est aussi en guerre avec l'Espagne. L'Espagne s'avancera à travers les gorges des Pyrénées, sous les bannières des Bourbons, faisant retentir son artillerie et ses menaces. Et l'Angleterre a endossé l'habit rouge et marche avec son altesse royale le duc d'York à qui quelques-uns parlent d'offrir notre couronne. On a bien changé d'avis depuis, et l'on change toujours davantage, si bien que rien ne nous sera plus odieux sur la terre qu'un citoyen de cette île tyrannique, et que Pitt sera déclaré et décrété l'ennemi du genre humain et, chose étrange, on défendra qu'aucun soldat de la liberté fasse quartier à un Anglais ; cependant le soldat de la liberté n'obéit qu'en partie à un tel ordre. Nous ne ferons donc aucun prisonnier, disent les soldats de la liberté, tous ceux que nous prendrons seront des déserteurs[12]. C'est un ordre cruel, et non sans inconvénient. Car, en vérité, si vous ne faites aucun quartier, le résultat clair est que vous n'en obtiendrez aucun. — Nos levées de trois cent mille hommes, car telle est la force décrétée pour cette année, auront probablement assez d'ouvrage sur les bras. Une multitude d'ennemis nous entourent, pénétrant par les gorges des montagnes, traversant les mers salées ; ils accourent vers tous les points de notre territoire, faisant sonner les chaînes qu'ils nous apportent. De plus, ce qui est pis encore, il y a un ennemi au cœur même de notre territoire. Dans les premiers jours de mars, les malles de Nantes n'arrivent pas ; à leur place arrivent des conjectures, des appréhensions, des rumeurs pleines de présages. Tous ces présages sont justifiés. Ces gens fanatiques de la Vendée ne peuvent être contenus plus longtemps ; le feu de l'insurrection, auparavant dissipé avec difficulté, éclate de nouveau, après la mort du roi, en une vaste conflagration ; ce n'est pins un complot, c'est une guerre civile. Vos Cathelineau, vos Stofflet, vos Charette, sont d'autres hommes qu'on ne pensait ; voyez leurs paysans, avec toute leur rusticité et leur grossièreté, avec leurs armes grossières, leurs grossiers vêtements, leur frénésie gauloise fanatique, et leur sauvage cri de bataille : Dieu et le Roi, fondre sur nous comme un sombre tourbillon, disperser les nationaux les mieux dressés, frappés d'une terreur panique ! Ils gagnent bataille sur bataille, nul ne peut savoir où cela finira. Le commandant Santerre y est envoyé mais sans résultat ; il ferait tout aussi bien de s'en retourner brasser de la bière. Il est devenu absolument nécessaire que la Convention nationale cesse de disputer, et commence à agir, que vous vous confondiez en un seul parti, et que vous le fassiez promptement. Il ne s'agit plus de vagues prévisions ; la ruine, une ruine certaine, est imminente ; c'est du jour présent qu'il faut s'occuper. Ce fut le vendredi, 8 mars, que ce terrible message de Dumouriez, précédé et escorté par tant d'autres messages aussi terribles, parvint à la Convention nationale. Bien pâles sont la plupart des figures. Il s'agit bien de savoir si nos septembriseurs seront punis ou non, quand Pitt et Cobourg s'avancent, pour nous châtier tous ; il n'y a plus rien aujourd'hui entre Paris même et les tyrans que le douteux Dumouriez et des armées en pleine retraite ! Le titan Danton se lève à cette heure, comme toujours l'heure du besoin. Grande est sa voix, répercutée par les dômes ; — Citoyens représentants, ne mettrons-nous pas, dans une crise pareille, toutes les discordes de côté ? La réputation oh ! qu'est-ce que à réputation de tel ou tel homme : Que mon nom soit flétri, que la France soit libre ! Il est de nouveau nécessaire que la France se lève, pour une prompte vengeance, avec ses millions de bras, avec un seul cœur. Que les levées se fassent instantanément dans Paris, que chaque section de Paris, que chaque section de la France fournisse ses milliers d'hommes ! Quatre-vingt-seize commissaires pris parmi nous, deux pour chacune des quarante-huit sections, doivent partir immédiatement et dire à Paris ce que le pays attend de lui. Que quatre-vingts autres d'entre nous soient envoyés, en poste, â travers la France, pour y donner le signal, y promener la croix de feu[13] et y rassembler toutes les forces de la nation. Qu'ils partent et qu'ils réfléchissent à ce qu'est leur mission. Qu'il y ait un camp de cinquante mille hommes entre Paris et la frontière du nord ; Paris lancera en avant ses volontaires ! Épaule contre épaule, que de tous côtés un défi de mort s'élève et retentisse ; nous repousserons encore une fois ces enfants de la nuit, et la France, en d4pit de l'univers, sera libre[14] ! — Ainsi résonne la voix du titan, dans tout endroit où se tiennent les sections, dans tous les cœurs français. Les sections sont en permanence, pour les recrutements, les enrôlements, cette nuit même. Les commissaires de la Convention, emportés par des roues rapides, portent la croix de feu de ville en ville, jusqu'à ce que la France entière soit embrasée. A l'Hôtel de ville flotte aussi le drapeau de la patrie en danger, et le drapeau noir sur le sommet de Notre-Dame. Il y a une proclamation d'éloquence brûlante ; Paris sort brusquement de nouveau pour terrasser ses ennemis. Dans une telle position, que Paris ne fût pas d'humeur douce, cela peut se concevoir. Les rues sont agitées, elles le sont encore plus autour de la salle du Manège ! La terrasse des Feuillants est couverte de citoyens furieux et de citoyennes plus furieuses encore. Varlet se promène dans une chaise à porteur ; d'ardentes invectives de toutes sortes, contre les hommes d'État au langage perfide, amis de Dumouriez et partisans secrets de Pitt et Cobourg s'échappent de tous les cœurs et toutes les bouches. Combattre l'ennemi ? Oui, et bien plus, le glacer d'effroi mais avant tout que les traître s de l'intérieur soient punis ! ces hommes qui ne font que critiquer et quereller, qui avec leur modération jésuitique cherchent à entraver l'élan du patriotisme ! Ils indisposent la France contre Paris, et empoisonnent l'opinion publique dans les départements. Lorsque nous demandons du pain et un maxi. mura ils nous répondent par des discours sur le commerce libre des grains ! Est-ce que l'estomac humain peut se contenter de discours sur le commerce libre, et devons-nous lutter contre les Autrichiens avec modération ou avec fureur ? Cette convention doit être nettoyée. Donnez-nous un tribunal expéditif pour les traîtres, un maximum pour les grains, voilà ce que réclament avec énergie les volontaires patriotes, pendant qu'ils défilent dans la salle de la Convention, pour voler à l'instant vers la frontière ; — pérorant avec cette verve héroïque, cette verve de Cambyse qui leur est propre, au milieu des cris de joie des galeries et de la Montagne, et des murmures du côté droit et de la plaine. Les prodiges ne manquent pas non plus ; pendant qu'un capitaine de la section Poissonnière parle avec véhémence de Dumouriez, du maximum et des traîtres crypto-royalistes, et que la troupe fait chorus avec lui, le drapeau flottant au-dessus de leurs têtes, voilà que l'œil d'un député remarque que, sur ce même drapeau, les cravates ou les banderoles ont des fleurs de lis ! Le capitaine de la section crie, sa troupe crie, frappée d'horreur et foule aux pieds le drapeau. C'est, selon l'apparence, l'œuvre de quelque conspirateur crypto-royaliste ! on peut le croire[15] ; mais peut-être, au fond, n'était-ce qu'un ancien drapeau de la section, fabriqué antérieurement au 10 août, alors que ces sortes de drapeaux étaient à l'ordre du jour[16]. L'histoire, examinant les mémoires des Girondins, et s'efforçant de distinguer la vérité à travers ces hallucinations, voit que ces jours de mars, surtout ce dimanche du 10 mars jouent un grand rôle. Complots sur complots ; complot pour égorger les députés Girondins, complot d'anarchistes et de royalistes secrets, intriguant avec un concert infernal, pour en arriver à cette fin. Presque tout cela n'est que pure imagination. Ce qu'il y a d'incontestable pour nous, c'est que Louvet et certains Girondins craignant d'être assassinés, le samedi, n'allèrent pas à la séance du soir, mais tinrent conseil ; chacun d'eux excitait son camarade à prendre une résolution et à en finir avec les anarchistes ; sur quoi, cependant, Pétion, ouvrant la fenêtre, et voyant une nuit très-pluvieuse, répliqua seulement : Ils ne feront rien, et reprit tranquillement son violon[17], dit Louvet. Ainsi, sur un doux mode lydien, il s'efforçait d'oublier les soucis dévorants. Il est certain que Louvet se sentit particulièrement exposé à être massacré, et que plusieurs Girondins allèrent chercher des lits hors de chez eux ; ils craignaient d'être tués, mais ils ne le furent pas. Plus tard, à dire vrai, le député journaliste Gorsas, l'empoisonneur des départements, lui et son imprimeur, virent leurs demeures envahies par une foule tumultueuse de patriotes, parmi lesquels étaient Varlet au bonnet rouge, l'Américain Fournier, au milieu de l'obscurité de la pluie et de l'émeute. Leurs femmes furent effrayées ; leurs presses, leurs caractères et les objets qui se trouvaient là furent mis en pièces. Aucun maire n'intervint à temps. Gorsas s'échappa un pistolet en main, en marchant sur la crête du mur de derrière. De plus, le dimanche au matin n'étant pas un jour de travail, les rues étaient plus agitées que jamais ; est-ce donc un nouveau septembre que ces anarchistes méditent ? Finalement aucun septembre n'est survenu ; — et toutes ces craintes des Girondins n'étaient que des hallucinations[18]. Vergniaud dénonce et se lamente en périodes artistement tournées. La section de Bonconseil — comme on la nomme maintenant, et non pas Mauconseil, comme on la nommait autrefois — — fait une chose bien plus remarquable elle demande que Vergniaud, Brissot, Guadet et autres Girondins dénonciateurs au beau langage, au nombre de vingt-deux, soient arrêtés ! La section de Bonconseil, ainsi nommée depuis le 10 août, est durement réprimandée, comme une section de mauvais conseil[19] ; mais elle a lancé un mot qui ne tombera pas à terre. Au fait, une chose nous frappe chez ces pauvres Girondins c'est leur malheureux aveuglement, et la fatale pauvreté de caractère, qui en est cause. Ils sont comme étrangers au peuple qu'ils voudraient gouverner, à la chose pour laquelle ils sont venus travailler. Les formules, la philosophie, l'honorabilité, ce qui a été écrit dans les livres et adopté par les classes instruites, cette pâle copie de la nature est tout ce que la nature, quoi qu'elle fasse, peut révéler à ces hommes. Ainsi ils pérorent et dissertent, et ils en appellent aux amis de la loi, quand la question n'est pas entre la loi et l'illégalité, mais entre la vie et la mort Pédants de la révolution, sinon ses jésuites Leur formalisme est grand ; grand aussi est leur égoïsme. A les en croire, la France, se soulevant pour combattre l'Autriche, a été soulevée seulement par le complot du 10 mars pour massacrer vingt-deux d'entre eux ! Cette révolution prodige, se développant dans ses proportions épouvantables par ses propres lois et celles de la nature, non par les lois de la formule, est devenue inintelligible, incroyable, comme une impossibilité, le vaste chaos d'un rêve. Une république basée sur ce qu'ils appellent vertus, sur ce que nous appelons bienséance et respectabilité, voilà ce qu'ils veulent avoir, et rien de plus. Quelque autre république que la nature ou la réalité leur envoie, elle sera considérée comme non avenue ; comme une sorte de vision, de cauchemar, de chose sans existence, désavouée par les lois de la nature et de la formule. Hélas ! obscure aux yeux les plus clairvoyants est cette réalité ; et pour ces hommes, ils ne la veulent pas regarder avec leurs yeux, mais seulement à travers le prisme du pédantisme, de la vanité blessée, qui ne leur fait voir que des images effrayantes et trompeuses. Avec leurs doléances, leurs accusations de complots et d'anarchie, ils feront une chose : ils prouveront par démonstration, que la réalité ne peut s'enfermer dans leur formule ; qu'eux et leur formule sont incompatibles avec la réalité ; et dans sa sombre rage la réalité les détruira, eux et leur formule ! Ce qu'un homme voit nettement, il le peut. Mais on peut dire qu'un homme est condamné, quand la faculté de voir lui est enlevée, quand il n'aperçoit pas la réalité, mais un spectre trompeur de la réalité, et qu'il suit ce fantôme, dans l'obscurité, d'un pas plus ou moins rapide, jusqu'au fond des ténèbres, jusqu'à la ruine, qui est le grand océan de la nuit, où toutes les faussetés tôt ou tard finissent par se perdre. Ce 10 mars, nous devons le remarquer comme une époque dans les destinées des Girondins ; tant la rage s'est exaspérée, tant leur aveuglement s'épaissit. Beaucoup désertent l'assemblée ; beaucoup s'y rendent armés. Un honorable député, après son déjeuner, doit maintenant, tout en prenant ses notes, voir si l'amorce de ses pistolets est en bon état. Cependant, avec Dumouriez, tout va pis que jamais en Belgique. Que ce soit encore la faute du général Miranda ou celle de quelque autre, il n'y a pas de doute que la bataille de Nerwinde du 18 mars a été perdue, et notre rapide retraite est devenue une retraite beaucoup trop rapide. Cobourg, victorieux avec ses cavaliers autrichiens, est suspendu sur notre arrière-garde comme un sombre nuage ; Dumouriez est sans cesse nuit et jour à cheval ; il y a des engagements de trois en trois heures ; notre armée en déroute se précipite avec rapidité vers l'intérieur, pleine de rage, de soupçons et de sauve-qui-peut ! Et Dumouriez lui-même, quelles peuvent être ses intentions ? Criminelles, probablement, et peu charitables. Ses dépêches au comité dénoncent ouvertement une Convention factieuse, qu'il accuse des malheurs de la France et des siens. Et dans ses discours — car le général ne connaît pas les réticences —, ce Dumouriez appelle l'exécution du tyran le meurtre du roi. Danton et Lacroix vont encore une fois là-bas comme commissaires, et reviennent très-inquiets ; Danton même a des soupçons à présent. Trois envoyés jacobins, Proty, Dubuisson, Pereyra, sont partis promptement, expédiés par la vigilante Société-Mère. Ils sont frappés de mutisme en entendant le général parler. La Convention, selon le général, se compose de trois cents coquins et de quatre cents imbéciles ; la France ne peut se passer de roi. Mais nous avons exécuté notre roi. — Et qu'est-ce que cela me fait, s'écrie en colère Dumouriez, général sans réticences, que le nom de ce roi soit Ludovicus ou Jacobus ? — Ou Philippus ! réplique Proly. — Et il se hâte de faire son rapport sur les progrès. Sur les frontières voilà ce que nous avons à espérer. V. — LES SANS-CULOTTES HABILLÉS.Voyons cependant si le grand prodige du sans-culottisme et de la révolution se meut et se forme. Là, et non ailleurs, il peut encore y avoir espérance pour la France. Le monstre révolutionnaire, à mesure que décrets sur décrets sortent de la Montagne, comme des Fiat créateurs conformes à la nature de la chose, — développe rapidement, à ce moment, sa taille gigantesque et se déploie, membre par membre. Au mois de mars dernier (1792), nous vines la France plongée dans une terreur aveugle fermant les barrières des villes, fondant de la poix pour les brigands. Mars, cette année, est plus heureux en ce que sa terreur est clairvoyante, en ce qu'une Montagne créatrice existe, qui peut dire Fiat ! Le recrutement marche avec une célérité furieuse ; cependant nos volontaires hésitent à s'en aller au dehors, avant que toute trahison soit châtiée au dedans ; ils ne se précipitent pas aux frontières, mais ils vont seulement par-ci par-là exigeant et dénonçant. La Montagne devra dire un nouveau Fiat, de nouveaux Fiat. Et n'est-ce pas ce qu'elle fait ? Prenez d'abord, par exemple, ces comités révolutionnaires pour l'arrestation des personnes suspectes. Un comité révolutionnaire de douze patriotes de choix est en permanence dans toutes les communes de France, examinant les suspects, recherchant les armes, faisant des visites domiciliaires et des arrestations, veillant, en général, à ce que la république ne souffre aucune atteinte. Élus par le suffrage universel, chacun dans sa section, ils sont une sorte d'élixir de jacobinisme ; ils sont quarante-quatre mille environ qui veillent et travaillent par toute la France ! A Paris et dans toutes les villes, chaque porte de maison doit porter, inscrits bien lisiblement, les noms des locataires. à une hauteur n'excédant pas cinq pieds au-dessus du sol. Chaque citoyen doit produire sa carte de civisme signée par le président de la section ; chacun doit être prêt à rendre compte de ses opinions. Les suspects feront aussi bien de quitter ce sol de la liberté. Et encore ce départ même a ses dangers ; tous les émigrants sont déclarés traîtres, leurs propriétés deviennent nationales, ils sont morts de par la loi. Cependant il y a une restriction : dans notre intérêt, ils vivront encore cinquante ans, devant la loi, et si quelque héritage leur échoit pendant ce temps-là il deviendra également national r Une folle vitalité de jacobinisme, avec quarante-quatre mille centres d'activité, circule à travers les fibres de la France. Bien remarquable aussi est le tribunal extraordinaire[20] : il fut décrété par la Montagne, critiqué par quelques Girondins, car certainement une telle cour est en contradiction avec toute formule ; — d'autres Girondins l'approuvent, même y coopèrent, car ne haïssons-nous pas tous les traîtres, ô vous, gens de Paris ? — lie tribunal des dix-sept, en automne dernier, était très-expéditif, celui.-ci sera plus expéditif encore. Cinq juges, un jury établi, nommés par Paris et les environs, sans perte de temps. Il n'y a point d'appel, presque pas de forme légale, mais ils doivent se convaincre par les voies les plus promptes ; et pour plus de sécurité, ils doivent voter à haute voix, à haute voix dans l’oreille du public parisien. Voilà ce tribunal extraordinaire, qui, en peu de mois, agissant de la manière la plus vive, sera intitulé le tribw4a1 révolutionnaire, comme il se nommait lui-même dès le principe. Avec un Hermann ou un Dumas pour juge-président, avec un Fouquier-Tinville pour procureur général, et avec un jury composé d'hommes comme le citoyen Leroy, qui s'est surnommé lui-même 10 août, Leroy 10 août, il deviendra la merveille du monde. Le sans-culottisme s'est fait une épée tranchante, une arme magique, trempée dans les eaux infernales du Styx, avec un tranchant tel que nulle armure, mille force, nulle adresse ne lui résistera ; elle détruira et existences et barrières d'airain, et ses éclairs répandront la terreur dans le cœur des hommes. Mais en parlant d'un sans-culottisme amorphe qui prend une forme, ne devons-nous pas, avant tout, indiquer comment ce monstre amorphe se donne une tête ? Sans métaphore, ce gouvernement révolutionnaire s'agite jusqu'ici dans un état très-anarchique. Il y a un conseil exécutif de ministres composé de six membres ; mais, surtout depuis la retraite de Roland, ils ont à peine su s'ils étaient ministres ou non. Les comités conventionnels les dominent ; mais un comité est aussi suprême que l'autre. Le comité des vingt et un, le comité de défense, le comité de sûreté générale, simultanés ou successifs, ayant chacun son objet particulier. La Convention seule est toute-puissante, surtout si la Commune marche avec elle, seulement elle est trop nombreuse pour un corps administratif ; c'est pourquoi, dans cette situation périlleuse et vertigineuse de la république, avant la fin de mars, nous obtenons notre petit comité de salut public[21]. En apparence il doit faire face à diverses éventualités qui exigent une prompte décision ; en réalité il exerce une sorte de surveillance générale, de domination universelle. Ils ont à faire des rapports toutes les semaines, ces hommes du nouveau comité ; mais leurs délibérations sont secrètes. Ils sont neuf membres, tous patriotes solides ; Danton est parmi eux ; ils doivent être renouvelés tous les mois. — Pourquoi ne pas les réélire, s'ils marchent bien ? Le beau de l'affaire, c'est qu'ils ne sont que neuf et qu'ils délibèrent en secret. C'est tout d'abord une insignifiante chose que ce comité, dans lequel il y a pourtant un germe qui grandira ! Pousse par la chance, par l'énergie intérieure des Jacobins, il réduira tous les autres comités et la Convention elle-même à une muette obéissance, les six ministres au rôle de six commis assidus, et fera sa volonté, sur la terre et sous la voûte des cieux, pendant quelque temps. Comité de salut public, dont le souvenir fait encore frémir et trembler le monde. Si nous appelons ce tribunal révolutionnaire une épée dont s'est pourvu le sans-culottisme, alors appelons la loi du maximum une besace, un havresac, dans lequel on peut trouver quelques rations de pain, bon ou mauvais. Il est vrai, l'économie politique, le libre commerce des Girondins, et toutes les lois sont par ce moyen mises sens dessus dessous, mais comment faire ? Il faut que le patriotisme vive, et la cupidité des fermiers semble n'avoir point d'entrailles. C'est pourquoi cette loi du maximum, en fixant le plus haut prix des grains, finit, après des efforts incroyables, par passer, et s'étendra progressivement à toutes sortes de comestibles et de denrées ; avec des luttes et des bouleversements que l'on peut s'imaginer ! Car, supposons, par exemple, que le fermier ne veuille pas vendre ? Eh bien ! le fermier sera forcé de vendre. lin compte exact des grains qu'il aura sera remis aux autorités constituées : qu'il n'en déclare pas trop ; car, dans ce cas-là ses fermages, ses taxes et ses contributions s'élèveront en proportion ; qu'il se garde d'en déclarer trop peu ; à un jour fixé ou avant ce jour, supposons en avril, moins d’un tiers de la quantité déclarée doit rester dans ses granges, plus des deux tiers doivent être battus et vendus. On peut le dénoncer et lui infliger une amende. Avec un tel renversement de toutes relations commerciales, le sans-culottisme vivra, puisqu'il ne peut vivre autrement. Avant tout, comme Camille Desmoulins l'a dit un jour : Pendant que le sans-culottisme se bat, ces messieurs doivent payer. Ainsi arrivent les impôts progressifs, qui absorbent avec une prompte et croissante voracité les revenus superflus des citoyens ; au delà de 60 livres (1.250 fr.) par an, vous n'en êtes point exempt ; au delà de 100 livres — 2.500 fr. —, vous êtes saigné hardiment ; au-dessus de 1000 et 1.0 000 vous ruisselez de sang. Viennent également les réquisitions ; arrive aussi l’emprunt forcé d'un milliard, quelque 50 millions de livres sterling, qui naturellement doivent être prêtés par ceux qui possèdent. Prodige saris exemple ! Ce n'est plus ici un pays pour le riche, mais un pays pour le pauvre. Et alors si Von fuit, à quoi cela sert-ii ? Mort de par la loi, qui ne -vous laisse la vie cinquante ans encore qu'au profit de ces maudits ! De cette façon les choses marchent, avec des bouleversements, aux cris de Ça ira ! — et de plus il y a une vente sans fin de propriétés nationales provenant des émigrants ; il y a Cambon avec sa corne d'abondance d'assignats. Le commerce et les finances du sans-culottisme, les moyens qu'il a trouvés, avec le maximum, les queues qui sont aux portes des boulangers, avec la cupidité, la faim, les dénonciations et le papier-monnaie, de prolonger sa vie galvanique, la façon dont il a commencé, dont il a fini, tout cela compose le plus intéressant de tous les chapitres de l'économie politique : il est encore à écrire. Tout cela n'est-il pas clairement contre la formule ? Ô Girondins, mes amis, ce n'est pas une république de vertus que nous avons ; mais seulement une république de forces avec ou sans vertus. VI. — LE TRAITRE.Mais Dumouriez, avec son armée fugitive, avec son roi Ludovicus ou son roi Philippus ? Là gît la crise ; là est la question : révolution ou contre-révolution ? —Un cri sauvage emplit cette région du nord-est. Les soldats, pleins de rage, de soupçons et de terreur, vont et viennent çà et là Dumouriez, l'homme aria nombreux conseillers, toujours à cheval, n'a plus maintenant que des conseils tels qu'il vaudrait mieux n'en pas avoir : par exemple, le conseil de se réunir à Cobourg, de marcher sur Paris, d'anéantir le jacobinisme, et, avec un nouveau souverain Ludovicus ou Philippus, rétablir la Constitution de 1791[22]. La sagesse abandonne-t-elle Dumouriez ? Le héraut de la fortune le quitte-t-il ? Principes, foi politique ou autre, excepté une certaine foi de caserne et son honneur d'officier, n'avaient pas besoin de le quitter. En tout cas ses quartiers sont dans le bourg de Saint-Amand ; son quartier général, dans le village de Saint-Amand-des-Boues, à quelque distance de là est devenu un Bedlam — maison de fous —. Les représentants nationaux, les missionnaires jacobins, sont à cheval et courent. Des trois villes, Lille, Valenciennes et même Condé, que Dumouriez voulait saisir pour son propre compte, aucune ne se laisse enlever ; votre capitaine est admis, mais les portes de la ville se ferment sur lui, hélas ! ce sont alors des portes de prison, et ses soldats rôdent autour des remparts. Les courriers galopent à perdre haleine ; les hommes attendent ou semblent attendre le moment d'assassiner ou d'être assassinés ; les bataillons, rendus presque fous par une telle défiance et une telle incertitude, se jettent de côté et d'autre, aux cris de : Vive la république ! et de Sauve qui peut ! La ruine et le désespoir sont campés et retranchés tout près de là sous la forme de Cobourg. La darne Genlis et sa belle princesse d'Orléans trouvent que ce bourg de Saint-Amand n'est pas une place qui leur convienne ; la protection de Dumouriez devient plus mauvaise qu'aucune autre. La dure Genlis, une des femmes les plus dures, que rien ne peut abattre, comme s'il y avait en elle neuf existences, fait ses malles et se tient prête à fuir secrètement. Sa bien- aimée la princesse, elle la laissera ici avec son frère, le prince Chartres-Égalité. Un matin froid et gris, nous la voyons établie dans sa voiture de louage, dans la rue de Saint-Amand ; les postillons font claquer leurs fouets pour partir, lorsque voilà le jeune prince qui se précipite de ce côté, l'appelant en hâte, portant la princesse dans ses bras. A la hâte il a enlevé la pauvre demoiselle qui n'a pour tout vêtement que sa robe de chambre ; nul de ses effets n'a été sauvé, excepté la montre qui était sous l'oreiller. Avec le désespoir d'un frère, il la jette à travers les malles, dans la chaise de poste, dans les bras de Genlis : Ne la quittez pas, de grâce, au nom du ciel ! Scène émouvante, mais courte. Les postillons font claquer leurs fouets et partent. Où vont-ils ? A travers des chemins 6ca.rtés, des passages montagneux, difficiles ; cherchant leur chemin au moyen des lanternes lorsque arrive la nuit, à travers les périls, les Autrichiens de Cobourg et les gardes nationaux français soupçonneux ; enfin ils arrivent en Suisse, sains et saufs, et presque sans un sou. Le brave jeune Égalité doit s'attendre à un dur lendemain, mais du moins maintenant il n'a plus à craindre que pour lui. Car, en vérité, dans ce village de Saint-Amand-des-Boues, les affaires vont de mal en pis. Le mardi, vers quatre heures après midi, le 2 avril 1793, deux courriers arrivent galopant comme s'il s'agissait de la vie : Mon général ! quatre représentants nationaux, le ministre de la guerre à leur tête, viennent en poste de Valenciennes ; ils sont tout près ; — avec quelles intentions, on petit le deviner ! Pendant que les courriers parlent encore, arrivent le ministre de la guerre et les représentants nationaux, ayant le vieux Camus l'archiviste pour orateur. Mon général a à peine le temps d'assembler le régiment de hussards de Berchigny, qu'il met en rang et qu'il fait attendre tout près, en cas d'accident. Et alors se présente le ministre de la guerre, Beurnonville, avec un baiser — l'amitié, car c'est un vieil ami ; entrent également l’archiviste Camus et les trois autres qui raccompagnent. Ils exhibent des papiers, citent le général à la barre de la Convention, simplement pour donner une ou deux explications. Le général trouve cela peu convenable, pour ne pas dire impossible, et dit que le service en souffrira. Alors viennent les arguments ; la voix du vieil archiviste s'élève, il est inutile de discuter et de crier, avec ce Dumouriez, il ne répond que des impertinences. Et ainsi, parmi des officiers d'état-major empanachés, à l'air sombre, dans le péril et dans l'incertitude, ces pauvres messagers nationaux discutent et se consultent, sortent et rentrent, cela pendant deux heures, et sans résultat. Sur quoi, l'archiviste Camus, élevant tout à fait la voix, proclame au nom de la Convention, car il en a le pouvoir, que le général est en état d'arrestation Voulez-vous obéir au mandat national, général ? — Pas dans ce moment-ci, répond à haute voix le général ; puis, tournant ses yeux d'un autre côté, il profère quelques paroles incompréhensibles, d'un ton de commandement, probablement quelque signal convenu, fait en allemand[23]. Les hussards empoignent les quatre représentants nationaux et l3eurnonville, le ministre de la guerre, les entraînent tous hors de l'appartement, hors du village, au delà des lignes de Cobourg, dans deux chaises de poste cette même nuit, — comme otages, comme prisonniers ; pour aller se reposer dans Maëstricht et les forteresses autrichiennes[24]. Jacta est alea. Cette nuit, Dumouriez fait imprimer sa proclamation ; cette nuit et le lendemain matin, l'armée de Dumouriez, plongée dans les ténèbres de l'incertitude, fi-rieuse et à demi désespérée, réfléchit sur ce que fait le général, sur ce qu'elle fera elle-même dans cette circonstance. Jugez si ce mercredi fut un jour de calme pour personnel mais le jeudi matin, nous apercevons Dumouriez avec une petite escorte, avec Chartres-Égalité et quelques officiers d'état-major, allant à l'amble le long de la grande route de Condé ; peut-être vont-ils à Condé pour essayer d'en gagner la garnison. En tout cas, ils auront une entrevue avec Cobourg qui attend dans la forêt voisine, par suite d'un rendez-vous. Près du village de Donnet, trois bataillons de gardes nationaux, troupes toujours pleines de jacobinisme, passent rapidement à côté de nous ; ils suivent, sans doute par erreur, un chemin que nous n'avions pas prescrit. Le général descend de cheval, entre dans une chaumière, située à quelques pas de la route, dans l'intention de leur donner un ordre écrit. Écoutez ! quel étrange bruit on entend ! quels aboiements se font entendre ; les cris de traîtres ! de arrêtez ! retentissent. Les gardes nationaux sont revenus sur leurs pas ; ils font feu. Remonte à cheval, Dumouriez, et pique des deux : il s'agit de ta vie ! Dumouriez et l'état-major jouent des éperons, franchissent des fossés, traversent des champs qui se trouvent être des marécages, se débattent et s'enfoncent pour sauver leur existence, pendant que les malédictions et les halles sifflent à leurs oreilles. Enfonçant jusqu'à la ceinture avec ou sans leurs chevaux, après avoir perdu plusieurs hommes de leur escorte, ils échappent aux feux de file, et se glissent dans les quartiers autrichiens, près du général Mack. Néanmoins ils retournent le lendemain à Saint-Amand et auprès du fidèle étranger Berchigny, mais à quoi bon Toute l'artillerie s'est révoltée et s'est dirigée en grand tumulte vers Valenciennes ; tous se sont révoltés ou se révoltent, excepté l'étranger Berchigny et quelques misérables quinze cents hommes ; nul ne suit Dumouriez contre la France et la république indivisible. Il n'y a plus rien à faire, Dumouriez[25]. Il y a un tel instinct de patriotisme français et de sans-culottisme chez ces hommes, qu'ils ne suivront ni Dumouriez, ni Lafayette, ni aucun autre mortel de même opinion. On peut crier : Sauve qui peut ! mais on crie également : Vive la république ! De nouveaux représentants nationaux arrivent ; un nouveau général, Dampierre, tué bientôt sur le chan de bataille ; un autre encore, Custine. Les armées, agitées, se retirent dans le camp de Famars, et tiennent tête à Cobourg comme elles peuvent. Ainsi Dumouriez est dans les quartiers autrichiens ; son drame a eu ce triste dénouement ; un homme si adroit, si souple ; un suisse envoyé du ciel, qui ne demandait que de l'emploi. Cinquante années de fatigues et de valeur, passées inaperçues, une année seulement de peines et de courage, remarquée et vue dans tous les pays et dans tous les siècles ; plus trente autres années également passées inaperçues, avec une pension de l'Angleterre, à écrire des mémoires, à former des plans et des projets sans but. Adieu, suisse envoyé du ciel ; tu méritais mieux. Son état-major prend diverses routes ; le brave jeune Égalité atteint la Suisse et la chaumière de Genlis, avec un solide Mon de pommier sauvage à la main, un cœur solide dans sa poitrine ; c'est à cela que se réduit aujourd'hui sa principauté. Égalité, le père, est assis à jouer le whist dans son Palais-Égalité, à Paris, le 6 de ce même mois d'avril, lorsque entre un sergent on demande le citoyen Égalité à la Convention[26]. Il y a interrogatoire, demande d'arrestation ; finalement l’emprisonnement est requis, et le transfert à Marseille, au château d'Ill Triste naufrage des Orléans t le Palais-Égalité, ci-devant Palais-Royal, va devenir le Palais-National. VII. — LA LUTTE.Notre république, par décret sûr papier, doit être une et indivisible. Mais qu'importe ce décret quand il y a des fédéralistes dans le sénat, des renégats dans l'armée, des traîtres partout ! La France entière, en proie, depuis le 10 mars, à un furie de recrutement, ne vole pas à la frontière, mais va seulement par-ci par-là Cette défection de l'altier et diplomatique Dumouriez retombe lourdement sur les beaux parleurs et les présomptueux hommes d'État dont il était escorté ; elle forme une seconde époque de leur destinée. Ou peut-être devons-nous dire avec plus de raison que la seconde période des Girondins, quoiqu'on l'ait peu remarquée alors, commença le jour où, au sujet de cette défection, les Girondins rompirent avec Danton. C'était le 1 er avril. Dumouriez ne s'était pas encore enfoncé dans les marais pour aller trouver Cobourg, mais il avait évidemment l'intention de le faire, et nos commissaires allaient l'arrêter 4, alors ce que le Girondin la Source trouve de mieux à faire, c'est de poser une question jésuitique et de demander, avec des phrases entortillées, si un des principaux complices de Dumouriez n'avait pas été probablement — Danton ! La Gironde semble approuver par Lui ricanement sardonique ; la Montagne retient son haleine. La figure de Danton, dit Levasseur, pendant ce discours, étau à remarquer. Il se tient, roide sur son siège, agité par une sorte de convulsion intérieure, faisant des efforts pour rester calme ; ses yeux lancent de temps à autre des éclairs terribles, ses lèvres expriment un dédain de titan[27]. La Source, dans un brillant discours semblable à une plaidoirie d'avocat, continue. Il voit, dit-il, cette probabilité-ci, et puis celle-là ; probabilités qui pèsent péniblement sur lui, qui jettent sur le patriotisme de Danton une ombre pénible ; — et cette ombre pénible, lui, la Source, espère qu'il ne sera pas impossible Danton de la dissiper. Les scélérats ! s'écrie Danton, en se levant, la main droite fermée, quand la Source a fini ; il descend de la Montagne comme une lave coulante, sa réponse est toute prête. Les probabilités de la Source se dissipent et volent comme une poussière ; cependant elles laissent un résultat après elles. Vous aviez raison, mes amis de la Montagne, commence Danton, et j'avais tort ; il n'y a pas de paix possible avec ces hommes. Eh bien ! soit ! la guerre ! Ils ne veulent pas sauver la république avec nous ; elle sera sauvée sans eux, sauvée malgré eux. C'était réellement un éclat de brutale éloquence parlementaire que ces mots, qui valent encore la peine d'être lus dans l'ancien Moniteur. Avec des paroles enflammées, le titan, dans son délire furieux, brise et écrase ces Girondins à chaque coup la Montagne joyeuse fait chorus ; Marat répète comme un refrain chaque dernière phrase[28]. Les probabilités de la Source ont disparu, mais le gage de défi lanc6 par Danton reste à terre ; personne nia osé le relever. Une troisième période ou scène dans le drame girondin, ou ce qui est plutôt le complément de la seconde période, commence à ce jour où la patience du vertueux Pétion fit enfin place à la fureur, et où les Girondins relevèrent le défi de Danton et décrétèrent Marat d'accusation. Ce fut le 11 de ce même mois d'avril, à l'occasion de quelque tumulte qui s'était élevé, comme il s'en élevait souvent, et le président s'était couvert ; un véritable Bedlam était décharné, et la Montagne et la Gironde se précipitaient l'une sur l'autre, les poings Fermés, et même le pistolet à la main, lorsque voici Le Girondin Duperret qui tire une épée ! Un cri d'horreur étouffant tout autre bruit s'élève à la vue de ce brillant et homicide acier ; sur ce, Duperret le remit au fourreau, — confessant qu'il l'avait tiré, excité par une sorte de sainte fureur et par les pistolets dirigés contre lui ; mais que s'il avait eu le malheur d'effleurer seulement avec cette épée l'épiderme d'un représentant de la nation, il avait, lui aussi, des pistolets, et se serait, en punition de ce parricide, fait sauter la cervelle sur la place[29]. Ce fut dans de telles conjonctures, le lendemain de cet incident, que le vertueux Pétion se leva pour déplorer ces effervescences, cette anarchie incessante qui envahissait jusqu'au sanctuaire législatif. Ici, comme sa voix était couverte par les murmures et les hurlements de la Montagne, sa patience longtemps à l'épreuve finit par s'échauffer ; il parla avec véhémence, sur un ton haut, l'écume à la bouche, d'où je conclus, dit Marat, qu'il avait attrapé la rage. Celui qui est enragé donne la rage aux autres. Aussi une nouvelle demande se présente, toujours avec l'écume sur les lèvres, pour l'extinction de l'anarchie et la mise en accusation de Marat. Envoyer un représentant au tribunal révolutionnaire ! prenez garde, ô amis ! Ce pauvre Marat a commis des fautes ; mais contre la liberté ou l'égalité qu'a-t-il à se reprocher ? De l'avoir aimée et d'avoir lutté pour elle, non avec sagesse, mais trop bien, dans les donjons, dans les caves, dans une misérable pauvreté, sous l'anathème des hommes ; aussi dans une telle lutte est-il devenu sale, aveugle, sa tête est devenue celle d'un stylite. Le passerez-vous au fil de votre épée, pendant que Cobourg- et Pitt s'avancent sur nous, crachant le feu ? La Montagne est bruyante ; la Gironde est bruyante et sourde, toutes les lèvres sont écumantes. Après une session de vingt-quatre heures sans suspension, après un vote personnel, avec des efforts mortels, la Gironde l'emporte Marat reçoit l'ordre de comparaître devant le tribunal révolutionnaire, pour y répondre au sujet de ce paragraphe de février à propos des monopoleurs, apposé sur les linteaux des portes et pour d'autres offenses. Après quelque peu d'hésitation, il obéit. Ainsi le défi de Danton est accepté ; il y a, comme il s'avait dit, une guerre sans trêve ni composition. La formule et la réalité sont maintenant face à face, dans une étreinte mortelle. Vous ne pouvez plus exister ensemble, il faut qu'une des deux meure. VIII. — LUTTE À MORT.Ce qui montre quelle force, quand ce ne serait qu'une force d'inertie, réside dans les formules établies, et quelle est la faiblesse des réalités naissantes, ce qui explique bien des choses, c'est que cette lutte mortelle ait encore duré six semaines et davantage. Les affaires nationales, la discussion de l'acte constitutionnel, car notre constitution sera décidément achevée, se poursuivent en même temps. Nous changeons même de local, nous allons, le 10 mai, de notre ancienne salle du Manège dans notre nouvelle, dans le palais des Tuileries, qui était jadis celui du roi, qui est à présent celui de la république. L'espérance et la pitié luttant contre le désespoir et la rage, se disputent encore les esprits des hommes. Bien sombre et bien confuse est cette lutte de mort, cette lutte de six semaines. Le formalisme furieux contre la réalité frénétique ; le patriotisme, l'égoïsme, l'orgueil, la colère, la vanité, l’espérance et le désespoir, tous surexcités jusqu'à la folie ; la frénésie et la frénésie se heurtent, semblables à de sombres et bruyants tourbillons ; ils ne se comprennent pas l'un l'autre ; le plus faible, un jour, sentira qu'il est perdu. Le Girondin est fort, comme la formule et la respectabilité établie ; est-ce que soixante-douze départements, ou beaucoup de têtes respectables de départements ne se déclarent pas pour nous ? Le Calvados, qui aime son Buzot, se révoltera ; c'est ce que laissent entendre ses adresses. Marseille, ce berceau du patriotisme, se soulèvera. Bordeaux se mettra en état d'insurrection, avec le département de la Gironde, comme un seul homme. En un mot, qui ne se soulèvera pas, si notre représentation nationale est insultée, ou si l'on touche à un seul des cheveux de la tête d'un député La Montagne, de son côté, est forte comme la réalité et l'audace. Peur la réalité de la Montagne est-il rien d'impossible ? Elle fera un nouveau 10 août, s'il le faut ; oui et même un 2 septembre. Mais le vendredi 24 avril de l'année 1793, dans l'après-midi, quel est ce tumulte de joie furieuse ? C'est Marat qui revient du tribunal révolutionnaire ! Après être resté une semaine et plus en danger de mort, il revient avec un acquittement glorieux ; le tribunal révolutionnaire n'a pu trouver de motif d'accusation contre cet homme. Et ainsi l'œil de l'histoire contemple le patriotisme, qui avait fait dans l'ombre des choses inénarrables toute la semaine, éclater de joie, embrasser son Marat, l'enlever sur une chaise de triomphe le porter sur ses épaules à travers les rues. Au-dessus des épaules on voit l'ami calomnié du peuple, la rête ceinte d'une couronne de chêne -, à travers cette mer flottante de bonnets rouges, de carmagnoles, de bonnets de grenadiers et de bonnets de femmes qui gronde au loin comme une véritable mer ! L'ami calomnié du peuple est arrivé ici à son zénith ; lui aussi frappe les étoiles de sa tête sublime. Mais le lecteur peut juger de quels yeux le président la Source, lui l'homme des probabilités douloureuses, qui préside dans cette salle de la Convention, doit considérer ce torrent, cette marée de joie, quand elle arrive, portant sur ses flots celui qu'il avait fait décréter d'accusation ! Un sapeur national, orateur pour la circonstance, dit que le peuple connaît son ami, et tient à sa vie comme à la sienne propre. Quiconque demande la tête de Marat devra d'abord prendre celle du sapeur[30]. La Source murmura quelques mots embarrassés, dont on ne put s'empêcher de rire[31], dit Levasseur. Les sections patriotes, les volontaires qui ne se sont pas encore dirigés vers les frontières, viennent demander que la Convention, chasse les traites de son propre sein ; ils réclament l'expulsion ou même le jugement et la condamnation des vingt-deux factieux. Néanmoins la Gironde a sa commission des douze ; commission spécialement nommée pour faire des perquisitions au sujet de ces troubles du sanctuaire législatif : que le sans-culottisme dise ce qu'il voudra, la loi triomphera. L'ancien constituant Rabaut Saint-Étienne préside cette commission. C'est la dernière planche sur laquelle la république naufragée pourra peut-être se sauver. Aussi Rabaut siège avec, eux ; attentifs, ils examinent les témoins, lancent des mandats d'arrêt, pénètrent dans une vaste et sombre mer de peines, — le berceau de la formule et peut-être sa tombe ! N'entrez pas dans cette mer, ô lecteur ! ce n'est que désolation et confusion, que femmes furieuses, qu'hommes enragés. Les sections viennent réclamer les vingt-deux membres, car le nombre fixé d'abord par la section Bonconseil tient toujours, quand même les noms changeraient. D'autres sections composées de gens plus riches surviennent et dénoncent une telle demande ; et la même section tantôt fait la demande, et tantôt la dénonce, suivant que ce sont les riches ou les pauvres qui siègent. Voila pourquoi les Girondins décrètent que toutes les sections seront fermées à dix heures du soir, avant l'arrivée des ouvriers ; mais ce décret reste sans effet. Et pendant la nuit, la Mère du patriotisme se lamente tristement, pleine de tristesse — pleine de tristesse, mais les yeux en feu ! Et Fournier l'Américain est occupé, ainsi que les deux banquiers Freys, et Varlet, l'apôtre de la liberté ; la voix de bouledogue du marquis Saint-Huruge se fait entendre. Et les femmes aux cris perçants vocifèrent des galeries de la Convention et de haut en bas. De plus un comité central composé de toutes les quarante-huit sections commence à poindre, obscur et formidable ; il siège obscurément à l'archevêché, il envoie des résolutions, en reçoit ; centre des sections, toujours en délibérations redoutables, comme pour un nouveau 10 août ! Choisissons un trait qui jette la lumière sur bien des points : c'est l'aspect sous lequel se présente aux yeux de ces douze Girondins, et même aux yeux de chacun, le patriotisme du sexe le plus doux. Il y a des patriotes femelles que les Girondins appellent des mégères, et le nombre en est évalué à huit mille ; leur chevelure de serpents flotte librement ; elles ont changé la quenouille pour le poignard. Elles font partie de la société fraternelle qui se réunit sous le toit des Jacobins. Deux mille poignards à peu près ont été commandés, sans nul doute pour elles. Elles voient à Versailles pour soulever plus de femmes, mais les femmes de Versailles ne se soulèvent pas[32]. Mais voilà que dans le jardin national des Tuileries, — la demoiselle Théroigne elle-même, semblable, sauf un point, à une Diane aux boucles brunes, est attaquée par ses propres chiens ou plutôt par ses chiennes ! La demoiselle qui a gardé sa voiture, est certainement pour la liberté comme elle l'a bien fait voir ; mais pour la liberté avec la respectabilité ; c’est pourquoi ces femmes patriotes à la chevelure de serpents la saisissent, déchirent ses habits et la frappent honteusement avec une ignoble brutalité ; elles l'auraient presque jetée dans un des bassins du jardin, s'il n'était pas survenu du secours. Secours, hélas : peu utile. La tête et le système nerveux de la pauvre demoiselle, qui n'étaient pas des plus sains, sont tellement troublés, bouleversés, qu'ils ne reprendront jamais leur état normal, et se troubleront de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin ils se détraquent complètement ; et dans le cours de l'année nous entendrons dire qu'elle est dans une maison d'aliénés avec la camisole de force, pour n'en plus sortir ! — Cette figure aux boucles brunes s'est trémoussée, a péroré et gesticulé, peu capable d'exprimer l'obscure pensée qui l'inspirait, pendant une courte période de ce XVIIIe siècle. Elle disparaît ici pour jamais de la révolution et de l'histoire publique[33]. Il est une autre chose sur laquelle nous ne nous arrêterons pas, mais que nous prions nos lecteurs de s'imaginer, c'est le règne de la fraternité et de la perfection. Imagine-toi, disons-nous, ô lecteur ! que le millénium soit à notre seuil, s'efforçant d'entrer, et que pourtant on ne puisse pas même se procurer d'épiceries, et cela à cause des traîtres. En pareil cas, avec quel acharnement frapperait-on les traîtres ! Ah ! tu ne peux te l'imaginer ; tu as tes épiceries en sûreté dans les boutiques, et peu ou point d'espérance d'un millénium à venir ! — mais vraiment, quant aux dispositions où se trouvaient alors les hommes et femmes, ce seul fait ne dit-il pas assez à quel degré la méfiance s'était élevée ? Nous l'avons souvent appelée surnaturelle, ce qui paraissait le langage de l'exagération mais faites attention à la froide déposition des témoins nul patriote musicien ne pourra tirer d'un cor un son mélodieux, tranquillement assis et pensif sur le toit d'une maison, sans que Mercier reconnaisse là un signal l`ait par un comité conspirateur à un autre. La discorde s'est emparée de l'harmonie même ; elle se cache sous l'air de la Marseillaise et du Ça ira. Louvet, qui n'y voit pas phis clair que le plus grand nombre, prévoit que nous serons engagés par une députation à retourner à notre ancienne salie du Manège ; et alors les anarchistes massacreront vingt-deux d'entre nous, pendant que nous serons en marche. Ce sont Pitt et Cobourg, l'or de Pitt. — Pauvre Pitt ! On sait bien peu ce qu'il a à faire avec ses propres amis du peuple ; les méprisant, les décapitant, suspendant leur habeas corpus et défendant vigoureusement son propre ordre social et ses coffres-forts, — pour s'imaginer qu'il soulève les masses chez ses voisins ! Mais le fait le plus étrange lié à la défiance française ou plutôt à la défiance humaine, est peut-être celui de Camille Desmoulins. La tête de Canaille, l'une des plus saines de France> est tellement saturée dans toutes ses fibres par une défiance surnaturelle, que reportant ses regards sur ce 12 juillet 1789, où des milliers d'individus se levaient autour de lui, poussant des hurlements à sa parole dans le jardin du Palais-Royal, et prenant la cocarde, il trouve que cela ne peut s'expliquer que par cette hypothèse, qu'ils étaient tous payés pour agir ainsi et excités par des conspirateurs étrangers et autres. Ce n'était pas pour rien, dit Camille d'un air profond, que cette multitude poussa de telles acclamations autour de moi, quand je parlai ! Non, ce n'est pas pour rien. Par derrière, par devant, de tous côtés, il y a. un immense et surnaturel jeu de marionnettes complotant, dont Pitt tire les fils. Je crois presque que moi, Camille, je suis un complot, tout de bois et qu'on manœuvre avec des fils[34]. La pénétration et la clairvoyance ne vont pas plus loin. Quoi qu'il en soit, l'histoire remarque que la commission des douze, assez éclairée maintenant au sujet des complots, et ayant heureusement entre ses mains les bouts de tous les fils, comme elle dit, — lance rapidement une foule de mandats d'arrêt dans ces jours de mai ; elle mène les affaires avec vigueur, déterminée à donner une digue à cet océan de troubles. Quel est le chef patriote, le président de section même, qui soit en sûreté ? On peut l'arrêter, l'arracher de son lit bien chaud, pour avoir opéré des arrestations injustes ! On arrête Varlet, l'apôtre de la liberté. On arrête le procureur-substitut Hébert, le père Duchesne ; magistrat du peuple siégeant à l'hôtel de ville, qui, avec la dignité solennelle du martyr, prend congé de ses collègues ; il s'empresse d'obéir à la loi, et avec une docilité solennelle disparaît dans les prisons. Les sections n'en volent que plus rapidement pour demander énergiquement qu'on le ramène, exigeant non pas l'arrestation des magistrats populaires, mais celle des vingt-deux traitres. Elles arrivent les unes après les autres, défilant dans une attitude énergique, avec leur éloquence à la Cambyse ; la Commune elle-même arrive, le maire Pache erg tête. Il ne s'agit plus seulement d'Hébert et des vin-gt-deux, mais de cette question de mauvais augure, qui d'ancienne est devenue nouvelle : Pouvez-vous sauver la république, ou devons-nous la sauver nous-mêmes ? A quoi le président Max Isnard fait avec emportement cette réponse : Si par un sort fatal, dans une de ces émeutes qui depuis le 10 mars reparaissent sans cesse, Paris levait une main sacrilège contre la représentation nationale, la France se lèverait comme un seul homme, pleine d'une soif implacable de vengeance, et bientôt le voyageur demanderait de quel côté de la Seine se trouvait Paris ![35] Sur quoi, la Montagne mugit encore plus fort, ainsi que toutes les galeries ; le Paris patriote bouillonne de tous cotés. De son côté, le Girondin Valaz6 a des réunions noc turnes chez lui ; il envoie des notes Venez promptement et bien armés, car il y aura de la besogne. Et les mégères circulent dans les rues, avec des drapeaux et de lamentables alléluia[36]. Les portes de la Convention sont obstruées par des multitudes rugissantes ; les hommes d'État au beau parlage sont bousculés, maltraités quand ils passent. Marat vous apostrophera, dans un tel péril de mort, et vous dira : Tu en es aussi. Si Roland demande à quitter Paris, il y a ordre du jour. Que faire ? Le substitut Hébert, l'apôtre Varlet sont délivrés ; on les couronne de branche de chênes. La commission des douze, dans une Convention que dominent les sections régissantes, est détruite ; puis le lendemain, dans une Convention de Girondins ralliés, elle est réinstallée. Sombre chaos, ou océan de troubles bouleversé dans tous ses éléments, se tordant et bouillonnant pour quelque création. IX. — EXTINCTION.Sur ces entrefaites, le vendredi 31 mai 1793, il y eut à la lumière d'un soleil d'été une scène des plus extraordinaires. Le maire ['ache, suivi de la municipalité, arrive aux Tuileries, dans la salle de la Convention. On l'a envoyé chercher des messages, Paris étant en pleine fermentation, et il annonce les plus étranges nouvelles. Il raconte comment, dans le gris de cette matinée, pendant que nous étions assis en permanence à l'hôtel de ville, surveillant pour la république, il entra, précisément comme au 10 août, quatre-vingt-seize personnes étrangères, qui se déclarèrent être en état d'insurrection, et les commissaires plénipotentiaires des quatre-vingt-huit sections, sections ou membres de la souveraineté du peuple, toutes en état d'insurrection, et de plus, qu'an nom du susdit souverain en insurrection, nous étions révoqués de nos fonctions. Sur ce nous fûmes dépouillés de nos ceintures, et nous nous retirâmes dans le salon adjacent de la Liberté. Quelques minutes plus tard, nous fûmes rappelés et réinstallés, le souverain voulant bien nous juger encore dignes de confiance. Sur ce, avant prêté un nouveau serment pour notre charge, nous nous trouvons tout à coup être des magistrats insurrectionnels, avec un comité étrange de quatre-vingt-seize siégeant près de nous ; et un citoyen Henriot, que l'on taxe de septembriseur, est fait général en chef de la garde nationale, et depuis six heures les tocsins résonnent et les tambours battent. Dans ces circonstances particulières, que plaira-t-il à l'auguste Convention nationale de nous indiquer à faire ? Oui, voilà la question ! Renverser les autorités insurrectionnelles, répliquent quelques-uns avec véhémence. Vergniaud à la fin verra toute la représentation nationale mourir à son poste On le jure avec haute et prompte acclamation. Mais, hélas ! pendant que nous nous disputons encore, quel est ce bruit que l'on entend ? C'est le bruit du canon d'alarme sur le Pont-Neuf, qui lance la mort de par la loi sans ordre provenant de nous ! Il y fait une barre cependant, envoyant un frémissement dans tous les cœurs. Et les tocsins rendent une sinistre musique, et Henriot avec sa force armée nous a enveloppés ! Et les sections se succèdent toute la journée, demandant avec des discours à la Cambyse, avec des roulements de mousquets, que les traîtres, au nombre de vingt-deux et plus, soient châtiés, que la commission des douze soit irrévocablement renversée. Le cœur manque à la Gironde. Ils sont bien loin les soixante-douze respectables départements, cette ardente municipalité est tout, près ! Barrère est pour un terme moyen, pour faire quelques concessions. La commission des douze déclare qu'elle n'attendra pas qu'on la casse ; elle se casse elle-même, et il n'en est plus question. Le rapporteur Rabaut voudrait bien prononcer quelques mots, les derniers, en son nom et au nom de la commission ; mais les cris étouffent sa voix. Trop heureux que les vingt-deux soient encore épargnés ! Vergniaud, faisant de nécessité vertu, propose, à la surprise de quelques-uns, de déclarer que les sections de Paris ont bien mérité de leur pays. Sur quoi, à une heure avancée de la soirée, les sections qui ont, bien mérité se retirent chacune dans son quartier. Barrère fera à ce sujet un rapport. La cervelle et la plume occupées, il s'assied dans la retraite ; pour lui point de repos cette nuit ainsi finit le vendredi dernier jour de mai. Les sections ont bien mérité ; mais ne doivent-elles pas mériter mieux encore ? Faction et girondisme sont abattus pour le moment et consentent à n'être rien ; mais ne se relèveront-ils pas plus furieux dans un moment plus favorable, et la république ne devra-t-elle pas être sauvée en dépit d'eux ? Ainsi raisonne le patriotisme toujours en éveil ; ainsi parle Marat visible le lendemain dans le monde des sections. Ces raisonnements portent la conviction dans les esprits ! — et aussi dans la soirée du samedi, lorsque Barrère venait de donner le dernier vernis à l'affaire après un travail d'une nuit et d'un jour, tandis que son rapport allait partir par le courrier du soir, le tocsin se fait entendre de nouveau. On bat la générale ; des hommes arillés prennent position sur la place Vendôme et ailleurs pendant la nuit, fournis de provisions et de liqueurs. Là sous les étoiles de l'été, ils attendront cette nuit le moment de l'action ; Henriot et l'hôtel de ville doivent donner le signal convenu. La Convention, au bruit de la générale, retourne en hâte à sa salle ; mais elle compte seulement cent membres, et elle fait peu de besogne ; elle renvoie le travail au lendemain. Les Girondins se gardent bien d'y paraître : les Girondins sont dehors, cherchant des lits. Le pauvre Flahaut, le lendemain matin, en retournant à son poste avec Louvet et quelques autres, à travers les rues tumultueuses, s'écrie en se tordant les mains : Illa suprema dies ![37] Nous sommes au dimanche 2 juin, de l'année 1793, d'après l'ancien style, et, d'après le nouveau style, de la première année de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous sommes arrivés au dernier acte, qui termine cette histoire de la puissance des Girondins. On ne sait si jamais une Convention en ce monde s'est trouvée en des circonstances telles que celle où se trouve aujourd'hui celle-ci. Le tocsin est sonné, les barrières sont fermées, Paris entier est en observation ou sous les armes. On compte jusqu'à cent mille hommes sous les armes ; la force nationale, et les volontaires armés qui auraient dû voler vers la frontière et la Vendée, mais qui ne l'ont pas fait parce que la trahison n'a point été châtiée ; qui, par conséquent, viennent çà et là : toute cette foule armée environne les Tuileries et leur jardin. Il y a de la cavalerie, de l'infanterie, de l'artillerie, des sapeurs aux longues barbes : On peut voir l'artillerie avec ses fournaises de camp dans ce jardin national, chauffant des boulets rouges et les mèches allumées. Henriot empanaché court à cheval au milieu d'un état-major empanaché, pour s'assurer si tous les postes et les issues sont gardés ; des réserves veillent la nuit, jusque dans le bois de Boulogne ; les meilleurs patriotes sont les plus près de la scène. Nous noterons une autre circonstance que la prévoyante municipalité, prodigue de fourneaux pour l'artillerie, n'a pas oublié non plus les chars à provisions. Nul membre du peuple souverain n'a besoin maintenant d'aller chez lui pour dîner, il peut rester dans les rangs, — les vivres circulent en abondance sans qu'on ait à s'en occuper. Ce peuple ne comprend-il pas l'insurrection ? Vous ne manquez pas d'imagination, Welches ! Que la représentation nationale mandataire du souverain y réfléchisse bien ; nous resterons ici jusqu'à ce que l'expulsion de vos vingt-deux et de votre commission des douze soit réalisée ! Députations sur députations, le langage le plus violent sur les lèvres, arrivent chargées d'un tel message. Barrère propose un moyen ternie : — Peut-être que les députés inculpés consentiront à se retirer volontairement, à donner généreusement leur démission et à se sacrifier pour le bien de leur patrie ? Isnard, qui se repent d'avoir dit qu'on chercherait un jour sur quelle rive de la Seine avait été Paris, se déclare prêt à donner sa démission. De même Fauchet Te Deum ; le vieux Dussaulx de la Bastille, vieux radoteur, ainsi que Marat l'appelle, est encore plus prêt. Le Breton Lanjuinais, au contraire, déclare qu'il y a un homme qui jamais ne se démettra volontairement, mais qui protestera jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que la voix lui manque. Aussi continue-t-il à protester au milieu de la fureur et des vociférations. A la fin Legendre s'écrie : Lanjuinais, descends de la tribune, ou je te jette en bas ! Car les affaires en sont arrivées à la dernière extrémité. Certains Montagnards zélés empoignent même Lanjuinais pour l'enlever, mais ils ne peuvent le faire descendre, car il se cramponne à la rampe et ses vêtement sont déchirés. Courageux sénateur digne de pitié ! Barbaroux non plus ne se désistera pas. Il a juré de mourir à son poste, et il tiendra son serment. Sur ce, les galeries se lèvent en entier avec explosion ; quelques-uns brandissent leurs armes et se précipitent en criant : Eh bien ! allons ! il nous faut sauver la patrie ! Telle est la séance de ce dimanche 2 juin. Les églises s'emplissent ce jour-là dans l'Europe chrétienne, et se vident ; mais cette Convention ne se vide pas ; un jour de discussion bruyante, d'agonie, d'humiliation et de déchirement de pans d'habits, illa suprema dies ! Tout autour se tiennent Henriot et ses cent, mille hommes, copieusement reniais par le contenu des caisses et des paniers ; il distribue même à chaque homme une pièce de cinq francs ; nous Girondins, nous le voyons de nos propres yeux : cinq francs pour entretenir leur courage ! Et la confusion, le tumulte des hommes armés embarrassent nos bancs, escaladent notre tribune ; nous sommes captifs dans notre propre salle l'évêque Grégoire ne peut pas sortir pour un besoin actuel, sans être accompagné de quatre gendarmes qui veillent sur lui ! Qu'est devenu le caractère de la représentation nationale ? Et maintenant la lumière du soleil entre plus jaune par les fenêtres de l'ouest, et les cheminées dessinent des ombres plus allongées ; mais ni les cent mille hommes rafraîchis, ni leurs ombres, ne s'éloignent. Que décidera-t-on ? On fait une motion, inutile, sans doute, pour que la Convention sorte en corps, et s'assure par elle-même si elle est libre ou non ; et voyez ! des portes de Pest sort une Convention en détresse, le beau Hérault de Séchelles ouvrant la marche, la tête couverte, en signe de calamité publique, les autres, tête nue, se dirigeant vers la grille du Carrousel, spectacle étrange ! vers Henriot et son état-major empanaché. Au nom de la Convention nationale, faites place ! Henriot ne se recule pas d'un pouce. Je ne reçois aucun ordre, jusqu'à ce que le souverain, le vôtre et le mien, ait été obéi. La Convention insiste prie ; Henriot recule avec son état-major une quinzaine de pas. Aux armes ! Canonniers, à vos pièces ! — Il tire sa puissante épée du fourreau ; tout l'état-major et les hussards en font autant. Les canonniers brandissent les mèches allumées, l'infanterie présente les armes ; — mais, hélas ! horizontalement et comme pour faire feu. Hérault, toujours couvert, conduit son malheureux troupeau à travers ce parc des Tuileries, traverse le jardin et se dirige vers la grille du côté opposé. Voici la terrasse des Feuillants ; hélas l voilà notre ancienne salle du Manège ; mais à cette grille du Pont-Tournant ils ne trouvent non plus d'issue. Nous essayons d'une autre, puis d'une autre ; pas de sortie ! Nous errons çà et là désolés, au milieu de rangs armés qui nous saluent des cris de : Vive la république ! mais aussi de ceux de : Meure la Gironde ! Jamais, dans l'an Ier de la liberté, le soleil couchant ne vit un tel spectacle. Et maintenant, voici Marat qui nous rejoint, car il suivait de loin notre procession suppliante ; il a sur ses talons quelques centaines de patriotes choisis ; il nous ordonne, au nom du souverain, de retourner à notre place et de faire ce qui nous est commandé. La Convention s'en retourne : La Convention, dit Couthon avec un air de singulière autorité, ne voit-elle pas qu'elle est libre, qu'elle n'a que des amis autour d'elle ? La Convention, enveloppée d'amis et de sectionnaires armés, vient pour voter comme on te lui a commandée Beaucoup refusent de voter, mais gardent le silence ; un ou deux protestent ; la Montagne a l'unanimité. La commission des douze et les vingt-deux dénoncés, auxquels nous ajoutons les ex-ministres Clavière et Lebrun, ceux-ci avec quelques modifications légères — tel ou tel orateur proposant, mais Marat disposant —, sont déclarés par vote en état d'arrestation dans leurs propres domiciles. Brissot, Buzot, Vergniaud, Guadet, Louvet, Gensonné, Barbaroux, la Source, Lanjuinais, Rabaut, — trente-deux bien comptés ; tous ceux que nous avons connus comme Girondins, et plus que nous n'en avons connu. Ces hommes, sous la sauvegarde du peuple français, tout à l'heure sous la garde de deux gendarmes, resteront paisiblement dans leurs domiciles, comme non sénateurs, jusqu'à nouvel ordre. Ainsi se termine la séance du dimanche 2 juin 1793. A dix heures, sous la douce lueur des étoiles, les cent mille, leur besogne parfaitement achevée, s'en retournent chez eux. Ce même jour, le comité central de l'insurrection a fait arrêter madame Roland ; on l'emprisonne à l'Abbaye. Roland s'est enfui, nul ne sait où. Ainsi tombèrent les Girondins, par l'insurrection ; ils disparurent comme parti, non sans un soupir de la plupart des historiens. C'étaient des hommes de mérite, cultivés par la philosophie, de conduite honorable ; on ne peut les blâmer de n'avoir été que des pédants, et de n'avoir pas eu plus d'intelligence ; ils ne furent pas blâmables, mais très-malheureux. Ils voulaient une république de vertus dont ils auraient été les chefs, et ne purent avoir qu'une république de forces que d'autres qu'eux dirigèrent. Pour le reste, Barr ère en rendra compte dans son rapport. La soirée se termine par une promenade civique à la lueur des torches[38] : bien certainement le véritable règne de la fraternité n'est pas éloigné maintenant. |