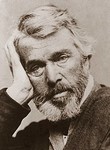HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
LA CONSTITUTION
LIVRE CINQUIÈME. — LE PREMIER PARLEMENT.
I. — GRANDE ACCEPTATION.Dans les dernières soirées de septembre, lorsque l'équinoxe d'automne est passé, et que le gris septembre prend la teinte foncée d'octobre, pourquoi les Champs-Élysées sont-ils illuminées ? Pourquoi Paris danse-il ? Pourquoi les feux d'artifice lancent-ils leurs lumières ? Ce sont des nuits de réjouissance, ces dernières nuits de septembre ; Paris peut, avec raison, se livrer à la joie ainsi que l'univers : l'aurore de la constitution est complète ! Complète, non, mais révisée, pour s'assurer s'il ne manque rien à cette œuvre présentée solennellement à Sa Majesté, et solennellement acceptée par elle, au bruit des canons, le 14 de ce mois. Et maintenant par ces illuminations et ces réjouissances, par ces danses et ces feux d'artifice, ne devons-nous pas étrenner gaîment le nouvel édifice social, et, avant tout, provoquer la chaleur et la fumée au nom de l'Espérance. La révision de la constitution, surtout en présence d'un trône encore solide, a été un travail plein de difficultés et de délicatesse. Pour étayer et soutenir, choses si indispensables alors, il y avait beaucoup à faire, et, ainsi qu'on le craignait, on n'a pas fait assez. Un triumvirat revenant sur ses erreurs, composé de Barnave, Rabut, Duport, Thouret, et par le fait de tous les députés constitutionnels, agitaient tous les nerfs, puis l'extrême côté gauche était si turbulent, les masses si ombrageuses et si impatientes de voir la fin du travail ; et enfin le loyal côté droit, faible et pétulant tout à la fois, siégeait paraissant toujours boudeur et irrité, incapable d'être utile, tout en ayant la meilleure volonté. Les 290 avaient déjà fait solennellement une scission auparavant et quitté la salle en secouant la poussière de leurs souliers. Devant une telle fermentation et avec l'espoir plus qu'incertain que cette situation, la pire de toutes, aurait au plus tôt son terme et amènerait par conséquent le bien, le loyal et infortuné côté droit parait ! Néanmoins, à cette force on ajouta encore quelques soutiens, autant qu'il était possible de le faire. La liste civile et les fonds secrets furent rétablis comme anciennement. La garde constitutionnelle du roi, composée de 1200 hommes sur la fidélité desquels on pouvait compter, provenant des quatre-vingt-trois départements, sous le commandement du loyal duc de Brissac. jointe aux Suisses dévoués, était quelque chose par elle-même. Les anciens et fidèles gardes du corps sont dissous autant de nom que de fait, et se dirigent vers Coblentz. Ces violents sans-culottes, ces gardes françaises ou grenadiers du centre, vraies sentinelles, sont licenciés ignominieusement et publient dans les journaux leurs adieux en langage un peu rude, tout en faisant des vœux pour que les aristocrates occupent à Paris les sépultures qu'on leur dénie. Ils partent, ces premiers soldats de la révolution ; ils errent au loin dans l'obscurité la plus profonde pendant environ une année, jusqu'à ce qu'enfin ils soient reconstitués sous une nouvelle dénomination et envoyés contre les Autrichiens ; depuis l'histoire n'en parle plus. Ce fut un des corps les plus remarquables qui ait eu sa place dans l'histoire du monde, bien que, ainsi s'écrit l'histoire, ils soient toujours pour nous des hommes de sang, des rouges enfin, sans nom, une masse de grenadiers à longs poils et à ceinturons de buffle. Et cependant, encore aujourd'hui, ne pouvons-nous pas nous demander : Quels Argonautes, quel Léonidas, quels Spartiates ont exécuté des actions semblables aux leurs ? Réfléchissez sur leur destinée : depuis cette matinée de mai, il y a quelque trois ans, quand, sans intérêt personnel, ils repoussaient honteusement d'Esprémesnil dans les îles de Calypso ; depuis ce soir de juillet, il y a deux ans, quand le front bandé ils lançaient des volées à Besenval, prince de Lambesc ! L'histoire roule, pour eux, dans ses vagues son muet et silencieux adieu. Alors le pouvoir souverain, une fois ces sans-culottes, vrais chiens de garde, ou plutôt vrais loups tenus en laisse et domptés, respire plus librement. Il sera désormais gardé par les 1800 hommes loyaux dont le nombre, sous divers prétextes, s'élèvera graduellement à 6000, et empêchera toute marche sur Saint-Cloud. La triste affaire de Varennes a été soudée, cimentée, dans le sang même du Champ de Mars ; et depuis lors, comme autrefois, le roi eut vraiment ses privilèges et le choix de sa résidence. Bien que, pour de bons motifs, le souverain ait persisté de rester à Paris. Pauvre roi ! pauvre Paris ! ils auront à assister à des mascarades enveloppées de spéciosités, de faussetés, qu'on sait fort bien être telles ; ils auront à jouer mutuellement cette pénible farce tragique, ce n'était pas autre chose, et devront avant tout espérer toujours, en dépit de l'espérance. Maintenant que Sa Majesté a accepté la constitution au bruit des salves du canon, qui n'aurait pas d'espoir ? Notre roi a été induit en erreur, mais ses intentions sont bonnes. Lafayette a parlé pour une amnistie, pour un oubli total des fautes de la révolution ; et maintenant cette révolution glorieuse, purgée de ses impuretés, est achevée ; et, chose étrange, sous un certain point, le vieux cri de Vive le roi ! se fait de nouveau entendre avec plus de force que jamais autour de Louis, le représentant de l'hérédité. Leurs Majestés allèrent à l'Opéra, distribuèrent de l'argent aux pauvres ; la reine elle-même, aujourd'hui que la constitution est acceptée, entend des acclamations sans fin. Ce qui est passé est passé. La nouvelle ère commence. Çà et là, au milieu de ces illuminations joyeuses des Champs-Élysées, le char royal va et vient lentement, suivi partout des vivats d'une multitude exhalant à l'envi son bonheur. Sur le visage de Sa Majesté, sous ce sourire gracieux et doux, se trahit cependant une tristesse profonde. Toutes les sommités en valeur et en talents se meuvent avec respect dans ces Champs-Élysées, entre autres une dame de Staël s'appuyant sans doute au bras de son Narbonne. Elle y rencontre les députés qui ont fabriqué cette constitution, et qui marchent absorbés par de vagues pensées, réfléchissant si cette constitution se maintiendra ou non. Mais comme les violons font entendre partout leurs cris aigus qui se mêlent au bruit des danses légères et fantastiques, que les nombreuses et brillantes illuminations jettent avec abondance leurs couleurs variées et que les colporteurs aux poumons de fer coudoient en criant à tue-tête : Grande acceptation, constitution monarchique ! Tout cela, disons-le, porte le fils d'Adam à espérer. Lafayette, Barnave, tous les constitutionnels, n'ont-ils pas galamment offert leurs épaules pour soutenir la pyramide du trône chancelant ? Les feuillants, se composant de la presque totalité de la partie respectable constitutionnelle de France, discourent chaque jour à la tribune, correspondent par lettres, dénonçant le jacobinisme ; croyant de bonne foi que sa fin est proche ; chose bien incertaine, douteuse. Cependant si le souverain est prudent, heureux, ne peut-on pas croire, avec ces dispositions chaleureuses naturelles au caractère gaulois, que sa position sera meilleure ou pire, qu'il acquerra au fur et à mesure ce dont il a besoin ? Du reste, ainsi que nous le répétons, dans cet édifice de fabrique constitutionnelle, dans sa révision surtout, rien de ce qu'on croyait pouvoir lui donner une force nouvelle, le consolider principalement, lui assurer la stabilité et, si l'on peut dire, une durée éternelle, n'a été oublié. Une assemblée biennale, sous la dénomination d'Assemblée législative, composée de 745 membres judicieusement choisis seulement parmi des citoyens remuants, et élus par des électeurs plus remuants encore, viendra lutter contre les privilèges du Parlement, s'appropriera au besoin le pouvoir et se dissoudra, fixera les impôts et discourra, veillera de près sur l'administration et les autorités, remplira les fonctions d'un grand conseil constitutionnel, représentera le bon sens général, et parlera de superfluités prétendues nationales comme si elles leur venaient des cieux. Cette première assemblée biennale, formée depuis le commencement du mois d'août, est à présent aussi bonne que bien choisie. Elle siégera le plus souvent à Paris, à la fin s'y fixera, non sans avoir adressé un pathétique adieu à sa vénérable parente, la moribonde constituante ; elle s'assiéra dans les galeries avec respect, prête à commencer dès que le moment et le terrain seront disposés. Alors, quant aux modifications dans la constitution elle-même, ce qui est impossible pour toute assemblée législative ou assemblée biennale du peuple, et possible pour quelque constituante ou convention nationale, est évidemment un des points les plus chatouilleux. L'auguste assemblée défaillante se débattit pendant quatre jours entiers. Les uns pensaient qu'un changement ou qu'au moins une révision, une nouvelle amélio- ration, pouvait être admissible dans trente ans ; d'autres, allant moins loin, en fixaient le terme à vingt et même quinze ans. L'auguste assemblée l'avait d'abord limitée à trente ans ; mais réfléchissant davantage, elle révoqua cette décision, et ne fixa aucune époque, l'abandonnant entièrement à la disposition de circonstances étrangères et incertaines, en un mot, elle laissa la question pendante. Sans doute, une convention nationale peut être assemblée avant trente ans, mais doit-on l'espérer ? Ces assemblées législatives, ces assemblées populaires pour deux ans, avec leurs pouvoirs limités, avec quelques légères additions successives, peuvent servir pour les générations, mais pendant qu'il est calculé le temps passe. De plus, on doit remarquer que pas un des membres de cette constituante n'a été ou ne pouvait être élu, ni faire partie de la nouvelle assemblée législative. Ils sont mus par de si nobles sentiments, ces faiseurs de lois ! disent quelques-uns, et en véritables Solon ils se banniront d'eux-mêmes. Ils sont si ombrageux ! s'écrie le plus grand nombre ; se portant envie l'un à l'autre, nul ne voulant être surpassé en abnégation par son collègue. Dans tous les cas, ils sont si maladroits ! disent les hommes pratiques. Et remarquez encore cette autre loi de désintéressement personnel qui porte qu'aucun d'eux ne peut être ministre du roi, ou accepter le plus petit emploi à la cour avant quatre ans ; puis après un long débat, au moins avant deux ans ! Ainsi s'explique l'incorruptible Robespierre, et sa magnanimité qui lui coûte peu ; mais nul ne veut être dirigé par lui. C'était une loi non inutile alors, et telle était cette loi qu'elle envoya Mirabeau aux jardins de Saint-Cloud, sous le manteau du secret, pour assister à ce colloque des dieux et s'opposer à beaucoup de choses. Heureusement et malheureusement tout à la fois, il n'y a plus de Mirabeau aujourd'hui pour faire de l'opposition et venir à la traverse. Qu'elle soit la bienvenue, bienvenue en vérité pour tous les cœurs honnêtes, la noble amnistie proposée par Lafayette. Bienvenue aussi cette rude et entortillée union d'Avignon, qui nous a valu, depuis le commencement jusqu'à la fin, trente sessions de débats et tant d'autres ! Puisse-t-elle enfin donner le bonheur ! On décrète une statue à Rousseau, le vertueux Jean-Jacques, l'évangéliste du Contrat social. Ni Drouet (de Varenne), ni le digne Lataille, maître de l'ancien et fameux jeu de paume, ne sont oubliés ; chacun d'eux a sa mention honorable, sa récompense pécuniaire, récompense bien due. Les choses étant ainsi clairement réglées, et les députations, les commissions, les cérémonies royales et autres ayant agi sans trop de bruit ; et le roi ayant parlé alors avec ardeur de paix et de tranquillité, et les membres ayant répondu : oui, avec effusion, voire même les larmes aux yeux, le président Thouret, ce partisan des lois de réforme, se lève et d'une voix forte prononce ces paroles remarquables : L'Assemblée nationale déclare qu'elle a terminé sa mission, et que ses séances sont closes. L'incorruptible Robespierre, le vertueux Pétion, sont portés à leurs domiciles sur les épaules du peuple, au milieu de vivat qui s'élèvent jusqu'au ciel. Quant aux autres membres, ils regagnent tranquillement leurs demeures. Nous sommes au dernier après-midi de septembre 1791, le lendemain matin la nouvelle assemblée législative commencera ses travaux. Ainsi, au milieu de l'éclat des illuminations des Champs-Élysées, du pétillement des feux d'artifice et du joyeux désordre, s'est évanouie la première Assemblée nationale, qui s'est, on peut le dire avec raison, dissoute dans le vide, pas davantage. L'Assemblée nationale a disparu, son œuvre est restée. Comme il en est de toutes les choses humaines, de l'homme lui-même, elle a eu son commencement et devait avoir sa fin ; réalité illusoire, fille du temps, ainsi que nous le sommes tous ; soumise maintenant pour jamais au flux et au reflux du temps, elle restera pendant de longues années dans la mémoire des hommes. Bien des étranges assemblées, des conseils héguméniques, des parlements et des congrès, se sont rencontrés sous cette planète et se sont dispersés, mais il ne s'y est peut-être jamais présenté un plus étrange assemblage que cette auguste constituante, avec une plus étrange mission. Vu de loin, dans l'avenir, cela paraîtra également un prodige. Douze cents individus, l'évangile de J.-J. Rousseau à la main, se réunissent au nom de 25 millions de personnes, avec l'entière conviction de faire la constitution : notre époque seule peut être témoin d'un tel spectacle, produit le plus extraordinaire et le plus surprenant du XVIIIe siècle. Cette époque, riche en merveilles, plus riche encore en monstruosités, ne se reproduira plus, ou du moins on ne reverra plus aucun de ses évangiles, ni surtout cet évangile de Jean-Jacques. Une fois c'est bien, et même c'est nécessaire pour prouver jusqu'où peut aller la croyance de l'homme, mais une fois c'est assez. Ils ont fait la constitution, ces douze cents J.-J. évangélistes, et non sans résultat. Ils siégèrent pendant vingt-neuf mois environ, avec diverses chances, diverse habileté, et, nous pouvons le dire, avec cette habileté qui dirigeait le char de Caraccio et l'étendard miraculeux de la révolte, chose sublime et digne de provoquer l'orgueil ; cependant, pour tout observateur, il y avait espoir d'amélioration. Ils ont vu beaucoup, ces hommes ; ils ont vu les canons braqués sur eux, et tout à coup, par l'intervention des pouvoirs, ces mêmes canons se retirer. Ils ont vu Broglie, ce dieu de la guerre, disparaître au milieu de la poussière ; ils ont vu la chute de la Bastille et le renversement de la France féodale. Ils ont eu un peu à souffrir ; les séances royales, les orages politiques et le serment du jeu de paume, les nuits de la Pentecôte et les insurrections des femmes. N'ont-ils pas encore fait plus ! Ils ont fait la constitution, tout réglé, dirigé ; ils ont rendu pendant le cours de ces vingt-neuf mois 2500 décrets, ce qui fait environ trois décrets par jour, y compris les dimanches ! On voit que la brièveté est possible quelquefois : Moreau de Saint-Méry n'a-t-il pas donné 3000 ordres avant de quitter son poste ? Il y avait chez ces hommes de la valeur et une sorte de foi ; mais la foi seule, c'est de la toile d'araignée, non de l'étoffe, et avec cela une constitution peut-elle être faite ? Toile d'araignée et chimères doivent indubitablement disparaître pour faire place à la réalité. Que ces formules intolérables qui tuent l'âme, et en se propageant sont également mortelles au corps, disparaissent au nom du ciel et de la terre ! L'époque, disons-nous, produisit ces douze cents hommes avec l'éternité devant eux, l'éternité derrière ; ils ont agi, comme nous le faisons tous, sous l'influence de deux éternités ils ont accompli la tâche qui leur avait été imposée. Qu'on ne dise pas qu'ils n'ont rien fait : ils ont fait quelque chose consciencieusement, mais combien en ont-ils fait inconsciencieusement ? Ils ont eu leurs géants et leurs nains ; ils ont donné leur part de bien et de mal ; ils ont disparu et ne reparaîtront plus. Dans ces conditions, ont-ils emporté nos bénédictions et nos tendres adieux ? Ils se sont dirigés en poste, en diligence, à cheval ou à pied, vers les quatre points cardinaux. Une grande partie a franchi les frontières pour ajouter au nombre des partisans de Coblentz ; entre autres Maury, qui après alla à Rome, pour y être revêtu de la pourpre du cardinalat, toujours faux sous ce costume de couleur écarlate, couleur tant affectionnée par la femme. — Talleyrand-Périgord, cet évêque constitutionnel excommunié, se rend à Londres en qualité d'ambassadeur en dépit de la loi d'abnégation. Là se trouvait aussi le marquis Chauvelin représentant la cour. Dans cette ville se trouve également le vertueux Pétion, recevant des harangues et haranguant lui-même, parlant raison, le verre en main, aux membres des clubs réformistes constitutionnels dans un dîner solennel tenu dans une taverne. L'incorruptible Robespierre se retire pour quelque temps à Arras, sa ville natale ; il y reste sept courtes semaines, terme fixé pour son dernier repos en ce monde, accusateur public pour la commune de Paris, grand-prêtre du jacobinisme, miroir du mince et incorruptible patriotisme, son talent oratoire rétréci est aimé par tout esprit étroit ; cet homme semble vouloir s'élever, mais jusqu'où ? Il vend le peu de biens qu'il possède à Arras, et, accompagné d'un frère et d'une sœur, il revient à Paris, projetant avec une sorte de ferme timidité, une modeste position, mais sûre, pour eux et pour lui-même ; il reprend son ancien logement chez l'ébéniste de la rue Saint-Honoré. Ô homme incorruptible, résolu et trembleur tout à la fois, à quelle destinée court-il ? Lafayette, de son côté, se démet du commandement, et nouveau Cincinnatus, se retire dans son cœur et sa propriété, que bientôt il quitte de nouveau. La garde nationale sera désormais sans chef, mais chaque colonel la commandera à tour de rôle pendant environ un mois. Les autres représentants que nous avons connus ou que madame de Staël a connus, errent absorbés par de profondes pensées, ne sachant pas ce qu'il y a à faire. Quelques-uns, tels que Barnave, les Lambeth et Duport, continuent à rester à Paris, surveillant la nouvelle assemblée biennale, le premier Parlement, lui traçant sa marche de conduite, et indiquant à la cour la manière de la diriger. Tels sont ces hommes, absorbés de pensées, voyageant en poste ou en diligence vers les lieux que leur indique le destin. Le géant Mirabeau sommeille dans le panthéon des grands hommes : et la France ? et l'Europe ? Les colporteurs aux poumons de fer y crient à pleine voix : Grande acceptation, constitution monarchique au travers de la foule joyeuse. Demain petit-fils d'hier sera ce qu'il pourra, c'est-à-dire ce qu'est aujourd'hui son père. La nouvelle Assemblée biennale législative commence à se constituer le 1er octobre 1791. II. — LE LIVRE DE LA LOI.Si l'auguste Assemblée constituante elle-même, attirant les regards de l'univers, peut, malgré la distance des temps et des lieux, mériter, sous certain rapport, quelque attention de notre part, combien le doit moins cette pauvre Assemblée législative ! Elle a son côté droit et son côté gauche, plus ou moins patriotes, car des aristocrates il n'en existe point à présent. On y fait des sorties violentes, on y pérore, on y entend les rapports, on y lit les projets de lois et les lois ; on y exécute les travaux auxquels on est appelé pour un temps déterminé ; quant à l'histoire de France, comme on peut le voir, elle y est rarement, même pas du tout intéressée. Malheureuse Assemblée législative, qu'a à faire l'histoire avec elle, si ce n'est que de verser des pleurs sur elle, et presque en secret ! Le premier Parlement biennal de France, qui devait, si une constitution, un serment national souvent renouvelé pouvait servir à quelque chose, avoir avec le temps une conséquence indissoluble, forte et douce tout à la fois, a disparu tristement dans le cours d'une année, et un second semblable ne s'est pas représenté. Hélas ! vos parlements de deux ans, comme tous ceux de fabrique constitutionnelle avec leurs conséquences indissolubles, construits avec de tels serments de fédération explosive, et leurs sommets entourés de splendeur variée et légère, s'en vont en pièces comme une frêle poterie dans le fracas des choses. Déjà, dans l'espace de onze mois, ils étaient dans les limbes lunaires avec les esprits d'autres chimères ; qu'ils y restent en paix, excepté pour de rares et spécieux projets. Avant tout, combien un homme se connaît peu, ou combien un corps public s'ignore lui-même ! C'est la mouche d'Ésope sur la roue du charriot qui s'écrie : Quelle poussière j'élève ! Les grands qui gouvernent, recouverts de cordons et d'insignes, sont gouvernés eux-mêmes par leurs subalternes, par leurs femmes et leurs enfants à mine renfrognée, ou bien dans les contrées constitutionnelles par les écrits de leurs habiles éditeurs. Ces sept cent quarante-cinq individus choisis ne doutent pas qu'ils ne soient le premier parlement biennal, venu pour gouverner la France par la force de l'éloquence parlementaire. Et que sont-ils ? pourquoi sont-ils venus ? pour faire quoi ? des folies et des fautes. Il est bien à regretter que cette Assemblée biennale n'ait dans son sein aucun des membres de l'ancienne Constituante, avec leur connaissance des partis et leur talent parlementaire, tel fut le résultat de cette ridicule loi d'abnégation personnelle. Bien certainement les anciens membres de l'Assemblée constituante y auraient été les bienvenus ; mais, d'un autre côté, quels sont ceux des anciens ou nouveaux membres de toute constituante sous le soleil qui auraient pu profiter de cet avantage. Il y a des premiers parlements de deux ans, placés de telle manière, qu'ils sont, dans un sens, loin de la sagesse, où la sagesse et la folie ne diffèrent seulement qu'en degrés, et ruine et désolation sont les fins réservées à chacune d'elles. Les anciens constituants, vos Barnave, vos Lameth et autres de cette espèce, pour lesquels une galerie à part a été réservée, et où ils siègent par déférence et prêtent l'oreille ; ils rient de pitié, la plupart du temps, de ces nouveaux législateurs ; mais n'en rions pas ! Ces pauvres sept cent quarante-cinq envoyés par la portion active de la France sont ce qu'ils doivent être, font ce qui leur est marqué par le destin. Que, par dispositions, ils soient patriotes, nous pouvons très-bien le comprendre. Le noble aristocrate s'est enfui au delà des frontières, ou vit dans ses châteaux non incendiés, couvant des projets en silence, attendant peu de ces premières assemblées électorales. Quoi, après cette fuite à Varenne, avec ces journées des poignards, avec ces complots sur complots, le peuple est livré à lui-même, le peuple doit pourvoir au choix de ses défenseurs, quels qu'ils puissent être, choisissant, comme il le fera toujours, non pas l'homme le plus habile, mais le plus adroit pour se faire élire ! Des dispositions chaleureuses et des sentiments constitutionnels et patriotiques sont des qualités ; mais la parole libre avec pouvoir de la limiter, voilà la qualité des qualités. On remarque avec quelque étonnement, que dans cette première assemblée biennale se trouvent quatre cents membres, avocats ou procureurs, hommes capables de porter la parole s'il est nécessaire ; il s'y trouve aussi des hommes de pensées et d'actions ; la franchise dira de ce premier parlement français qu'il n'était pas sans avoir besoin d'un peu de talent et de probité, ce qui, sous un rapport ou sous un autre, annihile ou augmente les devoirs des parlements. Ces devoirs, si le monde ne les guillotine pas et ne les livre pas à une longue infamie, que les parlements n'en soient pas reconnaissants à eux-mêmes, mais bien à leur étoile ! La France, ainsi que nous le disons, a fait ce qu'elle a pu. Des hommes ardents marchent ensemble, après une dure séparation et pour d'étranges fins. Le bouillant Max Isnard arrive des dernières limites du sud-est ; le chaleureux Fauchet, le Te Deum Fauchet, évêque du Calvados, des confins du nord-ouest ; plus de Mirabeau, aujourd'hui, ne siégera, il a emporté avec lui les formules. Notre unique Mirabeau, maintenant, est Danton qui travaille comme toujours au dehors, quelques-uns l'appellent le Mirabeau des sans-culottes. Néanmoins, nous avons nos merveilles, surtout en orateurs et en logiciens ; nous possédons l'éloquent Vergniaud, le plus mielleux, le plus impétueux des orateurs publics venant de cette région appelée la Gironde ; homme malheureusement indolent par caractère, qui s'assiéra pour jouer avec vos enfants, quand il devrait être discutant et pérorant. Le rude et bruyant Guadet, le grave et judicieux Gensonné, le jeune, bon, étincelant et joyeux Ducos, Valazé, destiné à une triste fin ; tous ces hommes viennent de la Gironde ou de Bordeaux, tous à principes constitutionnels très-prononcés, doués d'un esprit prompt, d'une logique incontestable, d'une honorabilité sans tache ; ils veulent voir s'établir le règne de la liberté, mais seulement par des moyens respectables. Autour d'eux se trouvent d'autres individus ayant les mêmes principes, et désignés tout à l'heure sous le nom de Girondins, triste merveille offerte au monde. Parmi eux, on remarque Condorcet, marquis et philosophe, qui s'est occupé de beaucoup de choses à Paris ; il a travaillé à la Constitution municipale, aux calculs différentiels, au journal la Chronique de Paris ; biographe et philosophe, il siège là à titre de député pour deux ans. Le remarquable Condorcet, avec son air romain et stoïque, le cœur plein de feu, volcan sous la neige, désigné encore en langage peu respectueux mouton enragé, la plus pacifique des créatures voraces ! Remarquez enfin Jean-Pierre Brissot, que le destin, après un long et bruyant travail, a lancé là en disant : C'en est fait avec lui, est également député biennal, et pour le présent, le roi parmi eux. L'impatient, l'entreprenant, le pauvre écrivain Brissot, qui prit le titre de de Warville, s'ennoblissant sans savoir le moins du monde pourquoi ; à moins qu'il n'eût l'intention de faire oublier que son père avait exercé irréprochablement les professions de cuisinier et de cabaretier dans le village de Quarville, homme de l'espèce des moulins qui toujours broient et tournent à tous vents, mais non pas de la manière la plus ferme et la plus régulière. Chez tous ces hommes, il y a talent et facilité de travail, ils feront quelque chose ; travaillant et formant non sans résultat, bien que ce ne soit pas sur le marbre, mais sur du sable mouvant ! Leur plus belle production est encore à mentionner ou n'est pas assez remarquable pour qu'on en parle. Le capitaine Hippolyte Carnot, envoyé par le Pas-de-Calais, avec sa tête froide et calculatrice, son opiniâtreté silencieuse, dans ses volontés ; Carnot, l'homme de fer, grand faiseur de projets, imperturbable, indomptable, qui au moment du besoin sera toujours là ; ses cheveux encore noirs tourneront au gris par suite de nombreuses chances, bonnes ou mauvaises ; mais cet homme, avec sa volonté de fer, son inébranlable résolution, répondra à toutes et les dominera. Le côté droit et les partisans de la royauté ne font pas défaut. Vaublanc, Dumas, l'honorable chevalier Jaucourt, qui aiment la liberté, mais avant tout la monarchie, parlent hardiment d'après leur foi, que détruiront les orages en s'amoncelant. Parmi eux citons un Lameth, ce nouveau militaire ; il se trouve là seulement par égard pour ses deux frères, qui le regardent et le félicitent de la galerie réservée aux anciens constituants. Le léger Pastoret, le conciliateur Lamourette à la langue de miel, puis les êtres muets appelés les modérés, siègent au centre en grand nombre. Le côté gauche fait encore moins défaut ; l'extrême gauche occupant les sièges les plus élevés de la salle ; de cette hauteur, prise avec une intention spéculatrice, et appelée la Montagne, partira la foudre, et en rendra le nom célèbre parmi les noms effrayants dans tous les temps, dans tous les lieux. L'honneur ne siégera pas sur cette montagne, non plus qu'un grand déshonneur pour le temps. Elle ne possède ni le don brillant, ni les grâces du langage et de la pensée ; le seul don qu'elle ait c'est celui d'une conviction profonde, d'une audace qui défierait le ciel et la terre. Les plus avancés, les plus hardis sont : le cordelier Tréo, le fougueux Merlin de Thionville, le chaleureux Bazère, ces deux derniers procureurs ; Chabot, capucin défroqué, adroit agioteur ; l'avocat Lacroix, qui naguère portait la simple épaulette d'officier subalterne, sa voix est foi te et son cœur bilieux. Il y a aussi Couthon, réfléchissant peu à ce qu'il est, dont une mauvaise chance a paralysé les extrémités inférieures ; il paraît qu'après être resté une nuit entière, transi de froid, sous le berceau d'un amour sincère — que l'on peut avec raison d'après la loi qualifier autrement —, il fut plongé dans une tourbière, après avoir été séparé de l'objet de sa passion tremblant pour sa vie dans ce marais glacé ; et depuis il ne marche plus qu'avec des béquilles ; et aussi Gambon, qui développa un talent tout particulier qui lui valut le nom de père du papier-monnaie, et qui, à l'heure de la menace, lancera cette terrible sentence : Guerre aux châteaux, paix aux chaumières ! Lecointre, l'intrépide drapier de Versailles, y est aussi le bienvenu, il est très-connu depuis le festin à l'Opéra et l'insurrection des femmes. On y voit également Thuriot, l'électeur Thuriot, qui se tenait dans les embrasures de la Bastille, qui assista au soulèvement en masse du faubourg Saint-Antoine et qui devra être, en outre plus tard, témoin de beaucoup d'autres choses ; enfin, le dernier et le plus sombre de tous, le vieux Rühl avec sa face brunie et chagrine, et ses longs cheveux blancs ; il est de la secte luthérienne d'Alsace ; homme que ni l'âge ni la lecture n'ont instruit, qui dira un jour aux vieilles gens de Reims en leur montrant la Sainte-Ampoule — envoi du ciel pour oindre Clovis et tous les rois — : que ce n'est qu'une simple bouteille d'huile sans vertu, et la brisera en pièces sur le pavé. Homme qui, hélas ! sera brisé à son tour ; plus tard sa tête de sauvage sautera d'un coup de pistolet ; telle sera sa fin. Une lave de feu bouillonne dans les entrailles de cette montagne, inconnue à la terre et à elle-même ! jusqu'à présent montagne sans importance, distinguée de la plaine principalement par sa supériorité en stérilité et par le peu d'étendue de sa vue. L'être le plus complaisant peut y remarquer, cependant, de la fumée, tout est si solide, si tranquille, et on ne doute pas, comme on l'a dit, qu'elle ne s'affermisse avec la marche du temps. N'aiment-ils pas tous la liberté et la constitution ? tous, de cœur, et encore avec degrés, quelques-uns, comme le chevalier de Jaucourt et le côté droit, doivent l'aimer moins que la royauté, ils en donneront la preuve. D'autres, comme Brissot et le côté gauche, peuvent l'aimer plus que la royauté, et quelques-uns parmi ces derniers, encore plus que la loi ; d'autres pas davantage. Les partis se montreront, on ne sait encore comment. Les violences agissent au dehors chez ces hommes ; au désaccord surgit l'opposition, qui, s'étendant toujours, engendrera l'incompatibilité et la haine mortelle, jusqu'à ce que le fort soit renversé par un plus fort, lequel le sera à son tour par le plus fort de tous. Que faire à cela ? Jaucourt et les monarchistes, les Feuillants et les modérés ; Brissot et ses brissotins, les Jacobins et les Girondins ; ceux-ci, avec le cordelier Trio et ses partisans, exécutent les travaux qui leur ont été déterminés, et de la manière qui leur est prescrite. Et quand on pense pour quelle destinée ces pauvres sept cent quarante-cinq sont assemblés, et sans le savoir le moins du monde, il n'est pas de cœur assez dur pour ne pas les plaindre ; leur plus profond désir était de vivre et d'agir comme le premier parlement de France, de faire une constitution qui marchât ; ne l'essayèrent-ils pas lors de leur installation, et presque en versant des pleurs dans cette cérémonie constitutionnelle des plus touchantes ? Les douze plus âgés furent chargés solennellement d'apporter la constitution, le livre de la loi. Camus, ancien constituant nommé archiviste, lui et les douze anciens, au milieu d'une pompe militaire et de sons perçants,, entrent portant avec eux le livre sacré ; le président et tous les députés, étendant tous ensemble leurs mains au-dessus, prêtent le serment au milieu d'acclamations et d'effusion de cœur et de trois vivat trois fois répétés. Ainsi s'ouvrit leur session. Infortunés mortels ! car le même jour le roi ayant reçu un peu sèchement leur députation qui croyait devoir être la bienvenue auprès de lui, elle ne put que se sentir blessée et déplorer ce dédain. En conséquence, dès le lendemain, notre premier parlement, si joyeux des vivat poussés au moment du serment, se vit forcé d'éclater en vifs reproches contre la conduite du roi, et on discuta comment, de son côté, on recevrait Sa Majesté et si elle ne serait pas, à l'avenir, privée du titre de Sire ; mais le jour suivant on revint sur cette décision comme ayant été prise avec trop de précipitation, comme n'étant qu'un simple acte d'emportement non provoqué. Réunions de chaleureux mais bien intentionnés députés, d'où partaient sans cesse des étincelles inflammables ! Leur histoire est un enchaînement de désordres et de querelles, de désirs vrais et sincères de remplir leurs devoirs, de fatale impossibilité de le faire, de dénonciations, de réprimandes aux ministres du Roi, de trahisons réelles et imaginaires, de rage et de fureur contre les fulminants émigrés, de terreur de l'empereur d'Autriche et de la commission autrichienne, siégeant dans les Tuileries même. Rage et terreurs continuelles, précipitation, trouble et doute profonds ! La précipitation, disons-le, la constitution l'a prévue et défendue ; aucun projet de loi ne peut être soumis avant qu'il n'ait été imprimé, lu trois fois, et cela pendant huit jours, à moins que l'assemblée ne déclare qu'il y a urgence, chose que cette scrupuleuse assemblée, observatrice de la constitution, ne manque jamais de faire ; considérant ceci, considérant cela, et encore autre chose, elle décrète toujours qu'il y a urgence, et alors l'Assemblée ayant déclaré l'urgence, est libre, tout à fait libre, d'ordonner ce qui lui semble indispensable, bien que dénué de sens. Deux mille décrets extraordinaires, tout calcul fait, sont rendus en onze mois. La promptitude de la Constituante semblait grande ; mais celle de cette assemblée l'est trois fois plus. Le temps marche vite, ils ont à le suivre avec la même rapidité. Les malheureux sept cent quarante-cinq, vrais patriotes si inflammables étant attaqués, devraient se défendre, sénat composé d'amadou et de fusées, au milieu de la vapeur épaisse de l'orage, et d'étincelles continuellement poussées par les vents ! D'un autre côté, revenez en arrière de quelques mois, à cette scène qu'ils appellent le baiser de Lamourette ! Les périls du pays deviennent imminents, immenses ; l'Assemblée nationale, l'espoir de la France, se divise. Dans ces circonstances extrêmes, l'abbé Lamourette à la langue de miel, nouvel évêque de Lyon, se lève — Lamourette signifie amante Dalila la prostituée —, il se lève, et d'une voix éloquente, mielleuse et pathétique, il engage tous les augustes sénateurs à oublier leurs griefs et leur haine, à renouveler leurs serments et à se montrer unis comme des frères. Après quoi, tous s'embrassent et prêtent le serment au bruit des vivat ; le côté gauche se mêle au côté droit, la stérile montagne se précipite dans la fertile plaine, Pastoret est dans les bras de Condorcet, l'offensé sur le sein de l'offenseur, et tous versent des pleurs, et chacun jure, qu'il soit feuillant, monarchiste, ou extra-jacobin, la Constitution seule ; qu'il soit frappé d'anathème comme les Juifs celui qui désire autre chose ! Scène touchante à contempler ! Mais le lendemain matin ils doivent se disputer, poussés par le destin ; et leur sublime réconciliation est appelée par dérision le baiser de Lamourette ou le baiser de Dalila. Ainsi des frères Etéocle et Polynice, les prédestinés s'embrassant, mais inutilement, déplorant qu'ils ne puissent s'aimer, seulement se haïr et mourir chacun de son côté, ou plutôt d'être comme des lutins condamnés parla magie, sous peine de châtiment, à un travail plus difficile que celui de faire de la corde sans matière, celui de faire marcher la Constitution, si la Constitution pouvait seulement marcher. Hélas ! la Constitution ne bougera pas ; elle s'affaisse sur elle-même, tous, en tremblant la relèvent en lui disant : Marche, toi, Constitution d'or ! la Constitution ne marchera pas. Il marchera, dit le bon oncle Toby, il a même juré ; il ne marchera jamais sur cette terre, répondit tristement le caporal. Une constitution, ainsi que nous le disons souvent, marchera lorsqu'elle représentera, sinon les vieilles coutumes et les anciennes croyances, mais exactement leurs droits et leurs pouvoirs encore mieux. Ces deux choses bien comprises n'en font-elles pas qu'une seule, ne sont-elles pas semblables ? Les vieilles coutumes de la France ont disparu ; ses nouveaux droits, ses nouveaux pouvoirs ne sont pas encore bien établis, si ce n'est seulement sur le papier en théorie, il ne peut en être autrement jusqu'à : ce qu'elle en ait fait l'essai, jusqu'à ce qu'elle se soit mesurée, couverte d'un linceul et excitée par un spasme surnaturel de folie, avec les principautés et les pouvoirs plus ou moins élevés, intérieurs et extérieurs, avec la terre, l'enfer et surtout le ciel ! Alors elle le saura. Trois choses principales présagent le malheur dans la marche de cette constitution française, d'abord le peuple français, ensuite le roi de France, et en dernier lieu la noblesse française et toute l'Europe coalisée. III. — AVIGNON.Mais, abandonnant les généralités, quel étrange fait que celui-ci, dans le sud-ouest, sur lequel se portent maintenant, à la fin d'octobre, tous les regards. Une terrible combustion dissimulée longtemps sous une fumée épaisse et sombre, éclate en un incendie. Bien chaud est ce sang provençal ; hélas ! les collisions doivent se présenter dans la carrière de la liberté ; les diverses directions produisent indubitablement ce résultat, de même que les différentes célérités. Pour ce qui se passe dans ce pays, l'histoire, occupée ailleurs, ne s'en préoccupera pas d'une manière spéciale. Quant aux troubles d'Uzès, de Nîmes, entre protestants et catholiques, patriotes et aristocrates, quant à ceux de Marseille, Montpellier, Arles, au camp aristocratique de Jolis, cette merveille tout à la fois réelle et imaginaire, maintenant d'une grande fadeur, tous s'agitent de nouveau — principalement en imagination —, présage magique et secret, tableau aristocratique d'une guerre reproduite naturellement ; tout était combustion mortellement tragique, avec complots et luttes, tumultes de jour et de nuit, mais une combustion sombre, sans clarté et non remarquée, et qu'on ne peut cependant s'empêcher d'observer. Entre autres lieux, les désordres dans Avignon et le comté Venaissin étaient terribles. Avignon dépendant du pape, avec son château dominant sur le Rhône, ville des plus belles avec des vignes pourprées et des oranges vermeilles ; pourquoi le fou, l'ancien rimailleur René, dernier souverain de la Provence, l'a-t-il donné au pape, à la riche tiare, plutôt qu'à Louis XI, portant la vierge attachée au cordon de sa casquette ; il l'a fait pour le bien et le mal ! Les papes et les antipapes ont habité, dans toute leur pompe, le château d'Avignon planant sur le fleuve ; Laure de Sade y alla entendre la messe pendant que son Pétrarque chantait la fontaine de Vaucluse avec des sons empreints de la plus profonde mélancolie ; c'était les anciens temps. Et de nos jours, depuis bien des siècles, de telles choses ne coulent plus de la plume de René rimailleur ; voici tout ce que nous en avons : Jourdan coupe-têtes dirige les sièges à la tête d'une armée de trois à quinze mille hommes appelés les brigands d'Avignon, titre qu'ils ont accepté en le modifiant par celui-ci : les braves brigands d'Avignon. Il en est souvent ainsi. Jourdan, ce chef qui a échappé à cette enquête du Châtelet et à cette insurrection des femmes, commençait à devenir plus enragé ; mais la scène changea de face ; aussi Jourdan mit un frein à sa férocité, il s'est levé parce qu'il était l'homme à agir. La barbe couleur brique de Jourdan est coupée, sa face large est devenue cuivrée, et s'est couverte de taches rouges et sombres ; ce Silène s'est engraissé, résultat de la forte nourriture et du vin. Il porte l'uniforme national bleu avec épaulettes, un sabre énorme, deux pistolets d'arçon en bandoulière et deux autres plus petits sortent de ses poches ; il se dit général et est le tyran de ses soldats ; remarquez ce fait, lecteurs, et quelles sortes d'actions l'ont précédé et doivent le suivre ! de telles actions sont dignes de l'ancien René et de la question qui s'est élevée, et que voici : Avignon ne doit-il pas cesser d'être papal et devenir ville française et libre ? Il y a eu confusion pendant vingt-cinq mois. Disons trois mois à argumenter, sept à se fâcher, tempêter, et enfin les quinze autres environ, dans lesquels nous nous trouvons, sont employés à la lutte et occupés par l'échafaud. Car déjà, en février 1790, les aristocrates papistes étaient envoyés au gibet sur un signe seulement. Le peuple se soulève en juin avec frénésie comme dédommagement, et force l'exécuteur public à fonctionner ; on pend quatre aristocrates chacun à un gibet papiste. Alors eurent lieu les émigrations d'Avignon ; les aristocrates passent le Rhône, le consul des États catholiques donne sa démission ; combats, victoires, rentrée du légat du pape, trêve et nouvelle attaque, avec diverses chances dans la lutte. Des pétitions furent envoyées à l'Assemblée nationale ; des congrès se tiennent dans les principales villes ; soixante des plus importantes cités votent pour une réunion à la France et les douceurs de la liberté, quand, d'un autre côté, douze des moins importantes, dirigées par les aristocrates, votent en sens opposé, et tout cela avec tumulte et opposition ! Capitale contre capitale, ville contre ville ; Carpentras, longtemps jaloux d'Avignon, se déclare ouvertement pour la guerre, et Jourdan coupe-tête, général en chef, ayant été tué au milieu de la sédition, ferme pour toujours sa boutique de teinture. Il y était venu, bien entendu, avec son artillerie, mais surtout avec fracas et tumulte et les braves brigands d'Avignon ; ils assiégèrent la ville rivale pendant deux mois à la vue du monde entier. Des exploits eurent lieu, sans nul doute, qui ont de la renommée dans l'histoire du pays, mais qui sont inconnus dans l'histoire universelle. Les échafauds s'élèvent de tous côtés, et de malheureux cadavres gisent rangés par douzaine. Le misérable maire de Vaison est enterré vivant. Les champs couverts de blés ne sont pas moissonnés, les vignes sont foulées aux pieds, partout on voit cruauté sanguinaire, folie, fiel et fureur ; ravage et anarchie partout ; en un mot, une combustion des plus terribles, trop pénible pour en faire ici mention ! Enfin, ainsi que nous le voyons, à la date du 14 septembre dernier, l'Assemblée nationale constituante, après avoir envoyé des commissaires et les avoir entendus, après avoir aussi pris connaissance des pétitions, siège tous les mois depuis août 1789, et a tenu en tout trente séances sur cette question et décréta qu'Avignon et le comté seraient incorporés à la France, et que Sa Sainteté le pape recevrait une indemnité raisonnable. Ainsi tout est pardonné, terminé ? Hélas ! dès que la folie, fille de la colère, a passé dans le sang de l'homme, et que les échafauds se sont dressés de toute part, que peuvent un décret sur parchemin et l'amnistie de Lafayette ? Le fleuve d'oubli, le Léthé, ne coule pas sur la terre ! Les aristocrates et les brigands patriotes se regardent toujours d'un œil furieux, soupçonnés, soupçonneux pour tout ce qui se fait et ne se fait pas. L'auguste Assemblée constituante est partie pour un congé de quinzaine seulement, quand, le dimanche au matin 16 octobre 1791, l'incendie non éteint éclata de nouveau subitement. Des affiches anticonstitutionnelles sont apposées sur tous les murs, et la statue de la Vierge, dit-on, répandit des pleurs et rougit. C'est pourquoi, ce matin-là, le-patriote L'Escuyer, l'un de nos six chefs patriotes, après s'être consulté avec ses collègues et le général Jourdan, se décida à aller à l'église accompagné d'un ou deux amis, non pas pour y entendre la messe à laquelle ils tenaient très-peu, mais pour y rencontrer les papistes en masse, et y voir cette vierge en pleurs ; c'était l'église des Cordeliers, et là, L'Escuyer leur donna quelques avis. Démarche hasardeuse qui eut le plus fatal résultat ; quelles paroles L'Escuyer a débitées alors, l'histoire n'en parle pas, seulement la réponse fut un hurlement épouvantable de la part des adorateurs' de la papauté, dont beaucoup étaient femmes. Des milliers de personnes poussent des cris avec menaces, qui devinrent de plus en plus fortes voyant que L'Escuyer ne quittait pas. Des milliers frappent la terre du pied, L'Escuyer est percé avec des outils de couturière, des ciseaux et des aiguilles. Il est pénible de penser que c'est là, dans ce lieu, que dorment depuis longtemps Pétrarque et sa Laure. Le maître-autel, avec ses cierges allumés, les regarde, la vierge a les yeux tout à fait secs à présent et a conservé sa couleur de pierre. L'ami ou les amis de L'Escuyer courent au plus vite, comme les messagers de bonnes nouvelles, vers Jourdan et le pouvoir national. Mais l'épais Jourdan commencera d'abord par s'emparer des barrières, il ne marche pas ainsi qu'il le faisait jadis à pas précipités. En arrivant à l'église des Cordeliers, elle est silencieuse et vide. L'Escuyer seul s'y trouve, nageant dans son sang au pied du maître-autel, couvert de coups de pointes de ciseaux, écrasé, massacré ; il pousse un muet sanglot et termine pour toujours sa misérable existence. Spectacle à émouvoir le cœur de tout homme, bien plus encore ceux des cruels brigands d'Avignon ! Le cadavre de L'Escuyer, couché dans une bière, le front livide ceint de lauriers, est promené dans les rues au milieu de discordantes menées exécutées par un grand nombre d'assistants, chants funèbres, encore plus tristes que les cris. La face cuivrée de Jourdan, sans expression de patriotisme, a tourné au noir. La municipalité répand dans Paris des rapports et des nouvelles officiels ; de nombreux ordres sont donnés et d'innombrables arrestations faites par suite d'enquêtes et de perquisitions. Aristocrates, hommes et femmes, sont traînés au château pour être entassés dans les souterrains du donjon, que viennent baigner les eaux du Rhône, et leur enlever tout secours. Ainsi sont-ils, attendant l'enquête et la perquisition. Hélas ! avec le bourreau Jourdan, général en chef au teint cuivré, tourné au noir, et ses brigands patriotes, faisant entendre leurs chants funèbres, l'enquête sera probablement courte. Le lendemain et le surlendemain, que la municipalité consente ou non, une cour martiale de brigands s'installera dans les souterrains d'Avignon. Les scélérats attendent à la porte, le sabre nu, le résultat du verdict d'un brigand. Jugement bref, sans appel ! Telle est la colère et la vengeance de ces bourreaux que ne calme pas l'eau-de-vie. Tout près est le donjon de la Glacière : il doit être témoin d'actes pour lesquels la langue n'a pas d'expression. L'obscurité et un nuage, cachant des crimes horribles, enveloppent ces donjons, cette tour de la Glacière. Ce qu'il y a de clair, c'est que beaucoup y sont entrés et que peu en sont sortis. Jourdan et ses brigands dominent dorénavant les municipaux, toutes les autorités patriotes ou papales, et règnent à Avignon, protégés par la terreur et le silence. Le résultat de tout ceci, est que, le 15 novembre 1791, on voit l'ami Dampmartin et des subalternes, et au-dessus de lui le général Choisy, avec infanterie et cavalerie, canons, caissons et munitions nécessaires, avec bannières déployées, au son du fifre et du tambour, marcher d'un air terrible et décidé vers le château, vers ces fortes barrières d'Avignon, suivis par derrière de trois commissaires désignés par la nouvelle Assemblée nationale, à une distance qui les tranquillise sur leur vie. Avignon, sommée au nom de l'Assemblée et de la loi, se porte aux barrières et les ouvre. Choisy avec les autres, Champmartin et les Bons enfants de Beaufremont, ainsi étaient appelés ces braves dragons constitutionnels qu'Avignon avait autrefois connus, entrèrent dans la ville au milieu d'acclamations et de fleurs répandues sur leurs pas, à la joie de tout citoyen honnête, à la terreur seulement du bourreau Jourdan et de ses brigands. Le lendemain, nous voyons l'épais et dégoûtant Jourdan montrer sa face de cuivre, son sabre et ses pistolets, affectant de parler haut et s'engageant, cependant, à rendre le château à l'instant même. Alors les grenadiers y entrèrent avec lui. Ils marchent, s'arrêtent, traversant cette glacière exhalant sa fétide et affreuse haleine, au milieu des cris de : Que le boucher soit égorgé ! Jourdan s'enfonce alors dans les passages et disparaît instantanément. Pourquoi le mystère de l'iniquité ne les a-t-il pas ensevelis alors ! Cent trente cadavres d'hommes et femmes, voire même d'enfants — car la pauvre mère effrayée et arrêtée à l'improviste n'a pu se séparer de son enfant —, gisent en monceau dans cette glacière putride sous des fumiers ; horreur pour le monde ! Quatre jours furent employés pour les en retirer et les reconnaître, au milieu des cris et de l'agitation de méridionaux exaltés, dans ce moment-ci agenouillés, priant, remplis de pitié et de rage. Enfin on procède à la sépulture au bruit du tambour, au chant du Requiem et au milieu des regrets et des larmes. Leurs restes mutilés reposent maintenant dans une terre bénie, dans une seule et même fosse. Et Jourdan coupe-tête ? — nous le revoyons après un ou deux jours, fuyant à travers la romantique et montagneuse contrée de Pétrarque, éperonnant avec violence sa monture ; le jeune Ligonnet, jeune écervelé d'Avignon avec les dragons de Choisy, le poursuit de près ! En présence d'une masse aussi exaspérée de cavaliers, il n'est pas de cheval qui puisse courir avec avantage. Celui de Jourdan, harassé et éperonné, s'élance dans la rivière de la Sorgue, ferme sur ce chiaro fondo di Sorga, et il n'aura plus à souffrir de l'éperon ; le jeune Ligonnet se rue de toute vitesse, l'homme à la face de cuivre menace et rugit, il tire son pistolet ; néanmoins il est saisi au collet, ses jambes sont solidement liées sous le corps d'un cheval et ramené à Avignon, échappant avec peine à un massacre dans les rues. Telle est l'excitation d'Avignon et du sud-ouest, lorsque sa position s'éclaircit. De longs et orageux débats ont lieu dans l'auguste Assemblée législative, dans le sein de la société-mère, pour savoir ce qu'il y a à faire en pareille circonstance. L'amnistie, s'écrient l'éloquent Vergniaud et tous les patriotes, qu'un pardon général et le repentir, le rétablissement des choses, la pacification, de quelque manière que cela se fasse ! Ce vote en définitive prévalut. Ainsi les incendiaires, les agitateurs du sud-ouest, eurent de nouveau une amnistie, ou un oubli qui ne peut s'oublier, car le Léthé ne promène pas ses eaux sur la terre ! Jourdan même n'est pas pendu, il est rendu à la liberté, comme un être pas encore mûr pour la potence. Tenez, nous l'apercevons de loin, porté en triomphe dans les villes du Midi. Quelle chose ne portent pas les hommes ! En voyant avec quel éclat passager une face cuivrée est portée dans les rues des cités du Midi, nous devons quitter ces régions, qu'on les laisse avec ses feux sous la cendre. Ils n'ont que faire de leurs aristocrates, de ces anciens nobles si fiers qui n'ont point encore émigré. Arles dite la chiffonne, désignation symbolique donnée à cette association secrète d'aristocrates, Arles en a ses pavés couverts et aura aussi bientôt ses barricades élevées par eux, et contre lesquels Rebecqui, patriote vraiment ardent, doit lancer les Marseillais munis de canons. La barre de fer ne s'est pas encore levée sur le haut de la baie de Marseille, et les chaleureux fils des Phocéens n'ont point encore été réduits à soumission. Par une conduite prudente et un vigoureux exemple, Rebecqui dissipe cette chiffonne sans répandre de sang, et rétablit l'ordre dans les rues d'Arles. Il s'embarque sur un bâtiment côtier, ce Rebecqui, pour surveiller les suspectes tours Martella avec l'œil perçant du patriotisme. Il fait des excursions sur terre, porteur simplement de dépêches, ou accompagné par la force ; il va de ville en ville, éclaircissant partout ce qui n'est pas clair, discutant, raisonnant et au besoin se battant. Il y a beaucoup à faire ; Jalès même parait suspect. Aussi, le législateur Fauchet, après débats, proposera d'élire des commissaires et de former un camp dans la plaine de Beaucaire, avec ou sans avantage. Avant toutes choses, remarquons seulement cette légère circonstance, que le jeune Barbaroux, avocat, secrétaire de la ville de Marseille, étant chargé de trouver un remède à cet état de choses, arrive à Paris au mois de février 1792 ; beau et brave, jeune Spartiate mûr pour l'énergie, mais non pour la sagesse ; sous cet air sombre et réfléchi, on découvre cependant une certaine ardeur farouche, ayant le teint brillant du Midi, non entièrement exempt d'une pâleur mortelle ; notez également que les Roland de Lyon sont de nouveau à Paris, pour la seconde et dernière fois. La charge d'inspecteur général du roi est supprimée à Lyon, ainsi qu'ailleurs. Roland a à réclamer sa pension de retraite, s'il y a droit. Il a des amis patriotes avec lesquels il aura des relations, il a même un ouvrage à publier. Ce jeune Barbaroux et Roland arrivèrent ensemble à Paris ; ce vieux Spartiate Roland aime et même beaucoup le jeune Spartiate qui le paye de retour, ainsi qu'on peut le penser. Et madame. ? ne souffle pas mot, ton souffle est un poison, c'est le langage du démon ! Cette âme est pure, aussi claire que le miroir de la mer. Si tous les deux se regardent en face et chacun en silence, avec une sorte d'abnégation tragique, l'un trouvera que l'autre est trop beau ? Honni soit ! Elle l'appelle le bel Antinoüs. Nous parlerons quelque part de cette femme étonnante. Une madame Dudon — ou un nom semblable, Dumont, on ne se le rappelle pas exactement —, donne d'excellents déjeuners aux députés brissotins et aux amis de la liberté, dans sa demeure, place Vendôme, lesquels déjeuners, célébrités à cette époque, sont assaisonnés de grâces, de sourires forcés, non sans frais. Là, au milieu d'un babil vide, notre plan pour les débats législatifs est fixé, et beaucoup d'autres plans y ont été proposés ; le strict Roland y a été vu, mais pas souvent. IV. — PAS DE SUCRE.Tels sont nos troubles intérieurs dans les villes du midi, existants, vus et non vus, dans toutes les cités et tous les districts, dans le Nord, comme dans le Midi. Car ils ont tous leurs aristocrates plus ou moins dangereux, surveillés par le patriotisme, qui, étant encore composé de diverses nuances, depuis le clair feuillant jusqu'au sombre et obscur jacobin, a à se surveiller lui-même. Les directeurs des départements, ce que nous appelons les magistrats des comtés, étant choisis par les citoyens d'une classe trop mouvante, sont pris d'un côté ; les municipalités, les magistrats des villes de l'autre. Partout se trouvent aussi des prêtres dissidents, avec lesquels l'Assemblée aura à faire, individus obstinés, agissant sous l'empire des passions les plus exaltées, complotant, recrutant pour Coblentz, soupçonnés de complots, véritables sarments à provoquer partout l'ardeur incendiaire contre la Constitution ! que faire avec eux ? Ils peuvent être consciencieux autant qu'opiniâtres ; ils devraient être accommodants, et vite encore. Dans l'ignorante Vendée, le simple doit être sous leur domination. Parmi eux, un habitant des campagnes, un paysan, — un Cathelineau, marchand-mercier, parcourant les hameaux tout en méditant, avec ses paquets de laine sur le dos, secoue la tête sans détermination prise ! Deux commissaires de l'Assemblée y vinrent l'automne dernier, le prudent Gensonné, non encore sénateur, et Gallois éditeur. Ces deux personnages, s'étant consultés avec le général Dumouriez, discutèrent et travaillèrent sans bruit, avec douceur et jugement, ils ont apaisé l'irritation et fait un rapport favorable et bon — pour le temps. Le général ne doute pas le moins du monde de conserver la tranquillité dans ce pays, étant un homme habile. Il passe ces mois de gelée parmi les habitants agréables de Niort, occupant dans le château de cette ville des appartements assez beaux, et calmant les esprits des habitants. Pourquoi n'y a-t-il là que Dumouriez ? Partout dans le Nord et le Midi, vous ne voyez autre chose que disputeurs obscurs et irréfléchis, qui vont subitement se lancer au milieu du fracas d'une émeute. Le méridional Perpignan a son tocsin avec ses torches allumées. Le septentrional Caen de même, avec des aristocrates sous les armes dans les places principales, une entente entre départements étant reconnue impossible ; une prise d'armes et un complot furent découverts ; ajoutez à cela la famine, le pain déjà cher le devient encore plus, pas autant cependant que le sucre, pour de bonnes raisons. Le pauvre Simoneau, maire d'Étampes, dans la partie nord de la France, ayant déployé son drapeau rouge dans des émeutes au sujet du grain, trouve la mort, écrasé par une foule exaspérée et affamée. Quel métier que celui de maire dans ce temps-là ! Le maire de Saint-Denis est pendu à la lanterne, par suite de soupçon, nous le savons depuis longtemps. Le maire de Vaison, enterré tout vivant, comme nous venons de le voir, et maintenant ce pauvre Simoneau, tanneur d'Étampes, que n'oubliera pas le vrai constitutionnel ? Avec des factions, des défiances, le manque de pain et de sucre, c'est bien là ce que l'on appelle déchirée, bien déchirée est cette pauvre contrée, la France et tous les Français. En outre, des pays d'outre-mer arrivent également de mauvaises nouvelles. Saint-Domingue-la-Noire, avant ces illuminations si variées des Champs-Élysées, avait été dotée d'une constitution acceptée, elle y parut et mourut par le feu, autre genre d'illuminations tout à fait différent que celui que nous connaissons ; les esprits violents, les chaudières à sucre, les plantations, les meubles, les bestiaux et les hommes, tout y passe. Plus loin, sur la plaine du cap français, on ne voit qu'un tourbillon de fumée et de flammes. Quel changement ici dans le cours de deux ans ! depuis que cette première caisse de cocardes tricolores passa par la douane et que ces créoles atrabilaires se réjouissaient également de n'avoir de bastilles qu'à niveau de terre. Ce niveau, comme nous le disons souvent, est agréable ; jusqu'à présent, ce niveau n'existe que pour soi-même. Vos criards, d'une pâleur fade, ont aussi leurs griefs, et vos jeunes quarterons ? et vos jaunes foncés, les mulâtres ? et vos esclaves noirs de suie ? Le quarteron Ogé, l'ami de notre parisien Brissotin et celui des noirs, sent également que l'insurrection est le plus sacré des devoirs. Ainsi donc les cocardes aux trois couleurs se sont agitées et ont brillé pendant quelques mois seulement sur le bonnet du créole, depuis le jour où la conflagration, excitée par Ogé, était à son apogée, et était annoncée par des cris de rage et de fureur. Arrêté et condamné à mort, il prit de la poudre blanche ou des graines dans le creux de sa main, cet Ogé, et en jetant quelques-unes dans le haut de la salle, il dit à ses juges : Voyez, ils sont blancs, alors il secoua la main et dit : Où sont les blancs ? Maintenant, en automne de 1791, en regardant sur les hauteurs du cap français, on voit un nuage de fumée qui couvre notre horizon, c'est de la fumée le jour, c'est du feu la nuit, précédée par les cris et la terreur des femmes blanches. Les escadrons noirs, vrais démons, pillent et massacrent avec une barbarie sans nom. Ils font la guerre et allument l'incendie cachés derrière les fourrés et sous les couverts, car le noir aime les buissons ; forts de plusieurs mille, ils s'élancent à l'attaque, avec coutelas et fusils qu'ils brandissent, tout en faisant des sauts et en poussant des hurlements ; si les compagnies de volontaires blancs tiennent ferme, ils commencent à chanceler, cèdent et fuient à la première volée, peut-être avant. Le pauvre Ogé sera broyé sur la roue ; ce tourbillon est dissipé et chassé sur les hauteurs des montagnes ; Saint-Domingue est soumis aux tourments d'une cruelle agonie de mort, sans ressources, et il reste un avertissement pour le monde. Ô mes amis parisiens, ceci n'est-il pas avec les monopoleurs et les feuillants conspirateurs, une des causes de la cherté extraordinaire du sucre. L'épicier agité, les lèvres contractés, voit son sucre taxé, pesé par une femme patriote. vite et en détail au prix exorbitant de 25 sous la livre, s'en privera-t-on ? oui, vous les sections patriotes, vous tous, les Jacobins, vous vous en priverez. Louvet et Collot d'Herbois le conseillent, résolus eux-mêmes à faire ce sacrifice ; cependant, sans café, que peut faire un écrivain ? s'abstenir d'un serment serait le plus sûr ! Brest et les intérêts maritimes ne doivent-ils pas souffrir de cela ? Les pauvres victimes de Brest s'en attristent non sans aigreur ; on dénonce l'aristocrate Bertrand de Molleville, ministre de la marine, comme traître. Est-ce que ses navires et ceux de Sa Majesté ne pourrissent pas dans la rade ; les officiers de marine quittent en masse ou vont en congé sans paye, ils s'agiteraient bien un peu, s'il n'y avait pas là les galères de Brest, le fouet et les gardes-chiourme. Hélas ! il y a là quarante de nos pauvres soldats suisses de Château-Vieux ! Ce sont ces quarante suisses pensant toujours à Nancy, avec leurs bonnets de laine rouge, ils manœuvrent tristement et avec peine la rame pénible, plongeant leurs regards sur l'Atlantique qui ne reflète que leur visage triste et couvert de poils, ils semblent avoir oublié l'espérance. Mais avant tout, ne pouvons-nous pas dire figurativement que la constitution française qui marchera, est atteinte d'un fort rhumatisme, qu'elle est intérieurement tourmentée, ainsi que dans les jointures et les muscles, et qu'elle ne marchera pas sans peine. V. — LE ROI ET LES ÉMIGRÉS.On a vu des constitutions fortement atteintes de rhumatismes, pouvoir marcher, et se tenir sur leurs jambes bien que difficilement et en chancelant, pendant de longues périodes, par une seule raison, c'est que la tête était saine. Mais cette tête de la constitution française ! qu'est le roi Louis, que peut-il faire, les lecteurs le savent déjà. Un roi qui ne peut présenter la constitution, ni la rejeter, en un mot qui ne fait rien du tout, si ce n'est que de se demander continuellement que ferai-je ? un roi environné de perturbateurs infatigables dans l'esprit desquels il n'y a pas la moindre énergie, ni la moindre initiative. Les restes d'une noblesse fière et implacable luttant avec les Barnave et les Lameth ; ces représentants, luttant dans l'élément obscur de recruteurs, de messagers, de fanfarons à demi-solde du café Valois, de valets de chambre, de chuchoteurs et de gens serviables et de belle condition ; le patriotisme a les regards fixés sur tout ce qui se fait au dehors, de plus en plus suspect. Dans une telle confusion, que peuvent-ils faire ? S'annihiler les uns les autres et produire zéro. Pauvre roi ! Barnave et votre sénateur Jaucourt parlent fortement dans ce sens-ci, Bertrand de Molleville et les messagers de Coblentz parlent chaudement dans ce sens-là ; la pauvre tête royale tourne tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ne pouvant s'arrêter nulle part que la bienséance jette un voile sur cela. On a rarement ici-bas une plus triste position ; ce petit incident ne fait-il pas bien voir combien elle est misérable ? La reine se désole auprès de madame Campan. Que dois-je faire quand ces Barnave nous poussent à certains actes, à prendre certaines mesures que la noblesse n'approuve pas, j'en suis de mauvaise humeur, personne ne vient à ma table de jeu, il n'y a personne au coucher du roi ; dans une telle position d'incertitude, que doit-on faire ? aller inévitablement à la tombe, mourir. Le roi a accepté la constitution, sachant bien à l'avance qu'elle ne serait d'aucune utilité ; il l'étudié, l'exécute, avec l'espérance, surtout, qu'elle ne sera pas exécutable. Les vaisseaux du roi pourrissent dans les rades ; leurs officiers sont partis ; l'armée est désorganisée, les voleurs parcourent les grands chemins qui se détériorent et ne sont pas réparés ; tous les services publics se relâchent, ou même sont abandonnés. Sa commission exécutive ne fait aucun effort, elle en fait un cependant, c'est de rejeter le blâme sur la constitution, faisant la morte, quelle est la constitution qui, exécutée de cette manière, peut marcher ? Elle ne peut que faire naître l'aversion de la nation, cela arrivera bien certainement, à moins que vous, vous ne continuiez à provoquer l'aversion de la nation, contre vous ! Le plan de M. de Molleville et de Sa Majesté est ce qu'on peut faire de mieux. Mais après tout, si ce plan jugé le meilleur arrive trop lentement, c'est la perte complète. Prévoyant cela, la reine, avec le plus profond secret, écrit sans relâche en chiffres, jour par jour, à Coblentz. L'ingénieur Goguelat, celui de la nuit aux éperons et que l'armistice de Lafayette a retiré de prison, va porter les messages, brides abattues, à leur destination : de temps en temps, lorsque l'occasion est convenable, la famille royale fait une visite à la salle de manège ; alors des paroles encourageantes partent des lèvres du roi, — paroles sincères sans nul doute pour le moment —, et tous les sénateurs d'applaudir et presque de pleurer. Dans le même temps, Mallet du Pan a ostensiblement cessé d'éditer, mais clandestinement il porte au dehors de la France les lettres autographes du roi, sollicitant l'appui des princes étrangers ; malheureux Louis, fais cela ou autre chose si tu peux ! Le gouvernement du roi tombe follement de contradiction en contradiction, mélangeant le feu et l'eau, et s'entourant de blâmes et de nuages épais. Danton, et les corruptibles patriotes nécessiteux sont gorgés d'argent. Ils acceptent les cadeaux ; ils se sentent plus soulagés et continuent leur propre chemin. Le gouvernement a également ses claqueurs payés. Le discret Rivarol à 1500 hommes à la charge du roi au taux de 250.000 fr. — 10.000 livres — par mois, c'est ce qu'il appelle un état-major du génie. Des orateurs, des journalistes, deux cent quatre-vingts claqueurs à 3 fr. 75 c. par jour, l'un des plus étranges états-majors, qu'ait jamais commandé un homme. Les rôles de revue et les livres des comptes existent encore. Bertrand Molleville lui-même pensant que, sous un certain rapport, c'était très-adroit, imagine de remplir à sa guise les galeries de Assemblée législative. Les sans-culottes payés doivent y aller et applaudir au moindre signe. Pétion les dirigeait ; cet artifice ne fut pas découvert pendant toute une semaine, chose assez adroite ; c'est comme si un homme trouvant que le jour passe vite, réglait à son gré les aiguilles de la pendule, cela lui est possible. Notons aussi une apparition imprévue de Philippe d'Orléans à la cour, sa dernière au lever du roi. Peu de temps auparavant d'Orléans avait été élevé, pour la forme, au rang d'amiral, convoité anciennement, bien que les bâtiments se gâtassent dans les ports. Il venait trop tard ! Cependant il visite Bertrand Molleville pour les remercîments à faire à Sa Majesté, ne croyant pas devoir remercier en personne. Malgré tout ce qu'on a dit et chanté d'affreux, il est loin au fond d'être ennemi de Sa Majesté, Bertrand s'acquitte de sa commission et obtient une entrevue royale qui se passe à la satisfaction de Sa Majesté ; le duc d'Orléans paraissant reconnaître ses fautes se décide à prendre une nouvelle marche de conduite, mais le dimanche suivant que voyons-nous ? Le dimanche suivant, il se présente au lever du roi ; les courtisans, ne sachant pas ce qui s'était passé, la foule des royalistes qui avaient l'habitude de se rendre au palais pour faire leur cour à Leurs Majestés firent au prince la réception la plus humiliante. Ils se pressent autour de lui, lui marchant sur les pieds, comme si c'était par maladresse, le poussent du coude vers la porte, de manière qu'il ne puisse plus rentrer ; il sortit, descendit dans les appartements de Sa Majesté où le couvert était dressé. Aussitôt qu'il se montra, on entendit de tous côtés : Messieurs prenez garde aux mets, comme s'il avait eu du poison dans ses poches. Les insultes que sa présence excita partout le forcèrent à se retirer sans avoir vu la famille royale, la foule le suivit jusque dans l'escalier de la reine ; en descendant il reçut un crachat sur la tête et sur les vêtements ; on voyait, à n'en point douter, sur ses traits la rage et la haine, ainsi que cela devait être. Il rejeta le tout sur le roi et la reine qui n'en savaient rien, et qui en furent même très-mécontents ; Bertrand était ce jour-là au château, et vit le tout de ses propres yeux. Du reste les prêtres qui n'avaient pu prêter serment à la constitution étant tourmentés, cela troublait la conscience du roi ; les princes, les nobles émigrés, le forcèrent à jouer double jeu ; il y aura véto sur véto, au milieu de l'indignation toujours croissante du peuple, car le patriotisme, nous l'avons déjà dit, devient avec raison ou non de plus en plus soupçonneux. Tempête opiniâtre, bouffée sur bouffée d'indignation patriotique venant du dehors ; tourbillons épais et confus d'intrigues, d'impertinences au dedans ! De Staël intrigue pour elle et son galant Narbonne, afin de le faire arriver au ministère de la guerre, et ne s'arrête pas qu'elle n'ait réussi. Le roi s'enfuira à Rouen, où, aidé du brave Narbonne, il modifiera la constitution. C'est ce même fou de Narbonne qui, l'année dernière, coupa court, par la force de ses dragons, aux embarras de ces pauvres tantes royales, fugitives ; on prétend qu'il est réellement leur frère, et même plus, tant est scandaleux le scandale. Il court aujourd'hui en voiture avec sa Staël, vers les armées, aux frontières, envoie des rapports couleur de rose, pas toujours exacts ; il parle, gesticule ; mais arrivé en haut, il chancèle un instant, il a vu les hommes ; puis il tremble, il est renversé et emporté par les flots du temps. Cette belle princesse de Lamballe intrigue aussi, cette amie de cœur de Sa Majesté victime de la fureur patriotique, beauté infortunée ; que ne fût-elle restée en l'Angleterre au lieu de revenir en France ! son organe doux et faible, que peut-il faire de bien dans cette fournaise, au milieu des orages du monde ? qui la protégera, pauvre et timide oiseau du paradis, des aspérités des rochers. Lamballe et de Staël intriguent ouvertement, ensemble ou séparément ; qui peut dire combien d'autres, et par combien de manières, cela se fait secrètement ! ce n'est pas ce qu'on doit appeler le comité autrichien, siégeant clandestinement dans les Tuileries, centre d'une occulte et antinationale assemblée ; véritable araignée qui, surtout, quand nous ne vivons que de mystères, étend ses toiles jusqu'au bout du monde ? Le journaliste Carra en a la preuve la plus certaine ; pour les patriotes et même pour toute la France en général, cela devient de plus en plus vraisemblable. Ô lecteur, n'as-tu pas pitié de cette constitution dont les membres sont frappés de rhumatisme, d'hydropisie et dont le cerveau est plein des vapeurs de la folie, une constitution qui se contredit ne peut jamais marcher ; à peine même se remuer ! Pourquoi Drouet et le procureur Sausse n'étaient-ils pas au lit, cette maudite nuit de Varenne ! Pourquoi au nom du ciel, la berline de madame de Korff ne s'est-elle pas trouvée au lieu indiqué ? incohérence et incompatibilité sans égales ; peut-être des horreurs dont le monde frémit encore auraient été évitées. Maintenant se présente la troisième chose qui présage mal pour la marche de cette constitution française, outre le peuple français et le roi, voici la troisième : la coalition de l'Europe entière. Il faut également y porter ses regards. La belle France est si brillante ; elle est entourée d'ombres agitées. Les Calonne, les Breteuil, dans l'obscurité, se sont envolés au loin remplissant l'Europe de leurs intrigues ; à Turin à Vienne, à Berlin, plus loin même, à Saint-Pétersbourg dans les glaces du Nord, le célèbre Burke a fait entendre sa grande voix il y a longtemps pour démontrer avec talent que la fin d'une époque est arrivée, selon toute apparence, la fin de l'époque civilisée. Beaucoup lui ont répondu ; Camille Desmoulins, Clootz le défenseur de l'humanité, le rebelle Paine tailleur, les honorables défenseurs gaulois dans cette contrée-là et dans celle-ci ; le célèbre Burke reste sans réponse, l'époque de la chevalerie est passée, et ne pourra que s'éloigner, ayant produit aujourd'hui l'époque de la plus indomptable animosité. Assez d'autels du genre de celui de Rohan et se changeant en ceux du genre de Gobel et Talleyrand, qui vont par une prompte transmutation, dirons-nous à leur véritable propriétaire ! Le gibier français et les gardes-chasse abordèrent aux rochers de Douvres en poussant des cris de détresse. Qui peut dire que la fin du monde n'est pas arrivée devant un tel spectacle ? un lot de mortels s'est montré qui croit que la vérité n'est pas une spéculation imprimée mais un fait pratique, que la liberté et la fraternité sont possibles sur cette terre qu'on suppose toujours être l'œuvre du démon, dont doit hériter le suprême charlatanisme ; qui dira que l'église, l'État, le trône et l'autel ne sont pas en danger, que le trône sacré même, ce palladium de l'humanité, n'est pas sur le point, ses cadenas brisés, d'être traité irréligieusement ? La pauvre assemblée constituante peut agir avec telle réserve et diplomatie qu'elle voudra, déclarer qu'elle renonce à toute intervention avec ses voisins, aux conquêtes à l'étranger et ainsi du reste, on peut avant tout prédire que la vieille Europe et la nouvelle France ne pourront subsister ensemble. Une glorieuse révolution renversant les prisons d'État et la féodalité, publiant au dehors au bruit du canon de la fédération, en face de l'Europe que l'apparence n'est pas la réalité, comment subsistera-t-elle au milieu de gouvernements qui, si l'apparence n'est pas une réalité, sont on ne sait quoi ? Dans une haine et une guerre à mort, elle devra lutter avec eux, et pas autrement. Les droits de l'homme imprimés sur des mouchoirs de poche de coton, en dialectes différents, sont envoyés à la foire de Francfort, que disons-nous, à la foire de Frankfort ? ils ont traversé l'Euphrate et le fabuleux Hydaspe ; ils sont allés au delà de l'Oural, d'Altaï, d'Himalaya, stéréotypés sur bois, en caractères angulaires, ils sont traduits en langues chinoise et japonaise, où s'arrêteront-ils ? Kien-Sung y sent le mal ; Dalaï-lama plus éloigné fabrique ses pilules de paix. Détestables pour nous autant que l'est la nuit ! Remuez-vous seuls, vous, défenseurs de l'ordre ! Ils s'agitent ; Tous les rois et roitelets avec leurs ornements spirituels et temporels sont pleins de vanité, leurs fronts ridés par la menace. Les commissaires diplomatiques volent au plus vite ; les assemblées, les-conclaves, se réunissent en secret, et les sages perruques se remuent acceptant tout avis possible. Disons-le aussi, de côté et d'autre, les pamphlétaires prennent la plume ; des poings zélés frappent la chaire ; non sans succès ! Birmingham, cette ville où se travaille le fer, en criant, l'Église et le roi ! éclata en juillet dernier, en rage, en ivresse et en incendie ne sachant pas pourquoi, et vos Priestley et gens de même espèce y venaient en masse le jour de la Bastille, poussaient aux actions les plus insensées et les plus destructives. Quoi de plus scandaleux ! à la même époque, ainsi que nous pouvons le remarquer, les grands potentats autrichien et prussien, avec les émigrés, étaient en plein festin à Pillnitz en Saxe. Là, et le 27 août, conservant pour eux seuls, suivant le traité secret, ce qu'il y aurait ou non à faire, ils y affichèrent leurs espérances et leurs menaces, leur devise était la cause commune des rois. Où le désir de quereller existe, il y a route pour y arriver. Nos lecteurs se rappellent cette nuit de Pentecôte, A août 1789, quand en quelques heures succomba la féodalité. L'Assemblée nationale, en l'abolissant, avait promis une compensation qu'elle s'efforça de donner. Néanmoins, l'empereur autrichien répond que les princes allemands, pour leur part, ne peuvent pas vivre sans féodalité ; qu'ils ont en Alsace des possessions et des droits féodaux à défendre et à assurer, pour lesquels aucune compensation ne pourrait suffire ; cette déclaration des princes possessionnés est envoyée de puissance à puissance, couvre des masses de papier à diplomatie, à ennuyer tout le monde. Kaunitz argumente de Vienne, Delessard répond de Paris, pas assez vigoureusement peut-être. L'empereur et ses princes possessionnés viendront, trop évidemment, prendre compensation autant qu'ils le pourront. On ne partagera pas la France, comme nous l'avons fait de la Pologne et le faisons encore, mais on la pacifiera, tout en tirant vengeance. Du midi au nord, pour aujourd'hui, c'est la cause commune des rois : Gustave de Suède prête serment comme chevalier de la reine de France, qu'il soutiendra les armées coalisées, si Ankarstron ne l'avait pas tué traîtreusement ; il existait donc des griefs plus près de lui. L'Autriche et la Prusse discutent à Pillnitz ; tout le monde les écoute avec une vive attention. Des rescrits impériaux partent de Turin ; il y aura une convention secrète à Vienne. Catherine de Russie envoie son approbation, elle aidera quand elle sera prête. Le bourbon d'Espagne s'agite sur ses oreillers, de lui aussi, même de lui, il y aura appui. Le mince Pitt, le ministère des préparatifs, regarde de sa loge de Saint-James d'une manière suspecte. Les conseillers conspirent, les Calonne se meuvent en secret. Hélas ! des agents s'agitent de toutes les manières, et ouvertement dans les villes d'Allemagne où il y a des marchés, enrôlant des soldats, de la valeur en haillons. Regardez où vous voudrez, l'obscurantisme le plus illimité environne cette France, qui n'en sera pas encore enveloppée. L'Europe est en travail ; attaques sur attaques, quelles clameurs que ces clameurs de Pillnitz ! Le résultat sera... la guerre. Mais le plus mauvais côté de l'affaire ce sont les émigrés à Coblentz. Tant de milliers y figurent sous les armes, animés de la haine la plus amère et de la vengeance la plus vive. Les frères du roi, tous les princes du sang, excepté l'infâme d'Orléans, le batailleur de Castries, l'éloquent Cazalès, le bouledogue Malseigne, le vaillant Broglie, des seigneurs à filer la quenouille, des officiers déshonorés, enfin tous ceux qui ont passé le Rhin ; d'Artois recevant avec un baiser l'abbé Maury et le pressant publiquement sur son royal cœur ! L'émigration franchissant la frontière, soit en petit nombre, soit en masse, avec différentes dispositions de crainte ou de pétulance, de fureur et d'espoir ; jamais depuis ces premiers jours de la Bastille, lorsque d'Artois alla pour humilier les citoyens de Paris, le monde n'avait été témoin d'un aussi grand phénomène. Coblentz est devenue un petit Versailles ultra-national, un Versailles in partibus. Disputes, intrigues, favoritisme, corruption même, dit-on, tout s'y rendait, tous les anciens esprits remuants, en petit nombre, animés par la soif de vengeance. L'enthousiasme de loyauté, de haine et d'espoir, est élevé à un haut degré, ainsi que vous pouvez vous en assurer dans les tavernes de Coblentz, par les chansons et les discours qui s'y font .entendre. Maury assiste au conseil secret, on y décide beaucoup ; une chose avant tout : on y tient note de la date de chaque émigration. Un mois de plus ou de moins vous donnera plus ou moins de droit dans le premier partage du butin. Cazalès fut reçu d'abord très-froidement pour avoir, en certaine occasion, tenu un langage constitutionnel, tant sont purs nos principes ! Des armes sont fabriquées à Liège, trois mille chevaux arrivent des foires de l'Allemagne ; de la cavalerie, ainsi que de l'infanterie en habits bleus, gilets et pantalon de nankin. On a correspondances secrètes pour l'intérieur et correspondances ouvertes pour l'extérieur. On a de plus, les aristocrates mécontents comme espions, les prêtres contumaces et le comité autrichien aux Tuileries. Les désertions sont encouragées par d'actifs agents. Le royal-allemand est parti presque en totalité. Sa marche à travers la France et ses différentes parties, est indiquée, pour l'endroit où l'empereur sera prêt. On dit qu'ils empoisonnent les sources d'eau, mais ajoute le patriotisme dans son rapport à ce sujet, ils n'empoisonneront pas la source de la liberté ; sur quoi on applaudit, nous ne pouvons aussi qu'applaudir. Ils ont également leur fabrique de faux assignats, et des hommes circulent dans l'intérieur pour les distribuer et les dépenser ; nous en dénonçons un aujourd'hui au patriotisme, c'est un homme ayant nom Lebrun, d'environ trente ans, cheveux blonds et épais, il a pour le présent un œil poché ; il est dans un wiski traîné par un cheval noir qu'il ne quitte pas ! Malheureux émigrés, c'était leur destinée et celle de la France ! Ils ignorent beaucoup de ce qu'ils devraient savoir et d'eux-mêmes et de ce qui les entoure. Un parti politique qui ne sait pas quand il est battu, doit devenir un objet des plus funestes pour lui-même et pour tous. Rien ne peut convaincre ces hommes de leur impossibilité de renverser la Révolution française au son de leurs trompettes de guerre ; ils sont persuadés que cette Révolution n'est autre chose qu'une effervescence de brailleurs et de querelleurs qui, à la première vue des poignards chevaleresques, au son aigu du gibet, s'enterrera d'elle-même dans ses cavernes, et les plus profondes seront les meilleures. Mais, hélas ! quel est l'homme qui se connaisse et se juge, et qui connaisse également les choses qui l'entourent. D'ailleurs où était la nécessité de se battre réellement. Jamais depuis qu'elles se sont coalisées, ces têtes n'ont pu croire qu'il y eût de la vigueur dans le bras d'un sans-culotte. Il sera trop tard pour le croire ? On peut dire sans rancune contre ces pauvres frères errant de tous côtés que leur plus grande faute sont les actes fâcheux des nobles émigrés contre la France. Qu'ont-ils appris, qu'ont-ils compris ? Dans le commencement de 1789, une splendeur et une terreur les entouraient, l'incendie de leurs châteaux ayant été provoqué par plusieurs mois d'opiniâtreté, ils partirent après le 4 août, et ont continué d'ignorer ce qui était à défendre raisonnablement ou à abandonner comme indéfendable. Il y avait encore parmi eux une hiérarchie graduée de pouvoirs ou quelque chose de semblable ; ils ne faisaient qu'un, du roi et du peuple, et transféraient graduellement le pourvoir de l'un sous l'obéissance de l'autre, rendant cependant le commandement et l'obéissance possibles. Avaient-ils compris leur position et ce qu'ils avaient à faire, avec cette Révolution française, qui s'agite depuis des années et des mois, et se répandra sur toutes les générations futures. Mais ils étaient fiers et hautains, ces hommes, ils n'étaient pas assez sages pour observer. Ils repoussaient tout avec une haine dédaigneuse, ils tiraient du fourreau l'épée et lançaient le poignard. La France n'a plus la hiérarchie des pouvoirs, cette hiérarchie s'est enfuie vers les ennemis du pays ; elle crie fortement contre les ennemis de la France pour leur intervention à main armée, eux qui n'ont besoin que d'un prétexte pour le faire. Les rois et les empereurs ont dû longtemps réfléchir, ils ont dû avoir des conférences spéciales, tout effrayés et confus d'intervenir. Mais les frères du roi et les nobles français, les dignitaires et les autorités, ne sont-ils pas libres de parler, autant que le roi lui-même, de nous engager au nom du droit et du pouvoir ? Enrégimentés à Coblentz au nombre de 15 à 20.000, ils brandissaient leurs sabres avec le cri, en avant ! en avant ! Oui, messieurs en avant, vous aurez part au partage du sol suivant la date de votre émigration. De tout cela, la pauvre assemblée législative a connaissance par des dénonciateurs amis, par un triomphant ennemi. Les pamphlets de Sulleau, de Rivarol de l'état-major du génie, circulent partout, annonçant avant tout l'espérance ; les placards de Durosoy, tapissent les murs, le chant du coq se fait entendre répété par l'ami des citoyens de Tallien. Royon dans l'ami du roi doit donner exactement en chiffres les contingents des divers potentats futurs envahisseurs en tout 419.000 combattants étrangers, plus 15.000 émigrés sans compter ces désertions journalières et continuelles qu'un éditeur doit chaque jour enregistrer, des compagnies entières, voire même des régiments, aux cris de vive le roi, vive la reine, franchissent les frontières, enseignes déployées. Tout est mensonge, tout est vent. Pour le patriotisme point de vent, ni un jour, hélas ! Le patriotisme peut encore crier et parler pendant quelque temps ; mais les heures sont comptées. L'Europe arrive avec 419.000 hommes et la chevalerie de France, les gibets, on l'espère, auront leur tour. VI. — LES BRIGANDS ET JALÈS.Nous aurons alors la guerre, et dans quelles conditions ! avec une commission exécutive prétendant, maintenant réellement avec de moins en moins de déception, être morte, et jetant même un regard d'impatience sur l'ennemi ; dans une telle condition nous aurons la guerre. De fonctionnaires publics actifs pour agir, il n'en est point ; si ce n'est Rivarol avec son état-major du génie et 280 partisans, le service public est sans utilité, le collecteur d'impôts a perdu son adresse. De côté et d'autre, le Directoire de département trouve bon de conserver des taxes ce qu'on peut en recueillir pour payer les dépenses inévitables. Nos ressources sont les assignats, émission sur émission de papier-monnaie, et l'armée, nos trois grandes armées de Rochambeau, de Luckner et de Lafayette ? Pauvres, bien tristes sont ces trois grandes armées, surveillant les frontières, trois volées de grues au long cou dans le temps de la mue ; armées sans utilité, désobéissantes, désorganisées n'ayant jamais vu le feu, dont les anciens généraux et officiers ont passé le Rhin. Le ministre de la guerre, Narbonne, l'homme aux rapports couleur de rose, sollicite des recrues, des équipements, de l'argent, toujours de l'argent ; il menace depuis qu'il ne peut plus en obtenir de tirer son épée qui n'appartient qu'à lui seul et de s'en servir au service de sa patrie. La question des questions est : que doit-on faire ? Tirerons-nous l'épée avec cette sorte de défi terrible que la chance favorise quelquefois, lancerons-nous cette épée à la face de cette masse d'émigrés et d'obscurantistes, ou bien temporiserons-nous, ferons-nous de la diplomatie jusqu'à ce que nos ressources, si c'est possible, s'améliorent un peu. Nos ressources vont-elles en augmentant ou en diminuant ? question douteuse. Les plus habiles patriotes sont divisés sur ce point ; Brissot et ses Brissotins, ou Girondins dans l'assemblée législative, parlent haut pour le premier plan, pour le défi. Robespierre parmi les Jacobins parle aussi très-haut en faveur du dernier, pour temporiser ; de part et d'autre, réplique et mêmes reproches, ce qui rend folle la mère du patriotisme. Songez aussi quelle agitation présidait à ces déjeuners de madame d'Udon, place Vendôme ! Chez tous l'alarme est grande, car l'heure presse. L'hiver n'était pas encore passé quand dans cet appartement assez élégant du château de Niort arriva une lettre. Le général Dumouriez doit venir à Paris. C'est le ministre de la guerre Narbonne qui écrit, le général donnera des avis sur bien des choses. Dans le mois de février 1792, les amis Brissotins accueillirent chaleureusement leur Dumouriez Polymetis, semblable vraiment à l'antique Ulysse, dans un costume moderne, vif, souple, aigrefin, indomptable, homme aux nombreux avis. Que le lecteur se figure cette belle France ceinte de tous côtés par l'Europe se précipitant en masse sur elle et y faisant éclater les foudres de la guerre. La belle France secouée des pieds à la tête par les complexités obscures que comporte son établissement social ou cette constitution qu'ils ont fabriquée pour elle, la France qui avec une telle constitution ne peut pas marcher ! La colère, les complots des aristocrates et les prêtres dissidents excommuniés, le nommé Lebrun étalant son sombre wiski aux regards de tout le monde, mais plus terrible lorsqu'il est invisible, l'ingénieur Goguelat avec la correspondance en chiffres de la reine, courant à cheval au galop. Les prêtres excommuniés suscitent de nouveaux troubles dans le Maine et la Loire ; la Vendée avec Cathelineau le mercier, n'a cessé de grogner et de murmurer encore une fois, voici Jalès. Que de fois ce camp réel et imaginaire a disparu ! Pendant deux années, languissant, il s'est éclipsé, et aujourd'hui il reprend de l'éclat par les embarras intérieurs du patriotisme ; c'est aujourd'hui, si le patriotisme le savait, un des plus beaux produits d'art de la nature. Les seigneurs royalistes sous un prétexte ou sous un autre, rassemblent les simples habitants des Cévennes, peuplade non habituée à la révolte, au cœur brave et aimant la lutte ; leurs pauvres têtes seront tournées et persuadées. Le seigneur royaliste les harangue, en touchant surtout les cordes vibrantes de la religion, les bons, les vrais prêtres tourmentés, les mauvais, les faux protégés, les protestants — autrefois massacrés — maintenant triomphants, des objets sacrés jetés aux chiens, c'est en présentant de pareils récits qu'il fait sortir de la poitrine du pieux montagnard de rudes grognements. N'affirmerons-nous pas qu'alors vous, braves cœurs des Cévennes, vous êtes accourus à leur appel ? Sainte religion, devoirs dus à Dieu et au roi ? — Si fait, si fait, est toujours la réponse de ces cœurs honnêtes ; mais il y a aussi de bien bonnes choses dans la Révolution ! Ainsi le sujet, disons-le avec cajolerie, ne fera que tourner sur son axe, sans changer de position et restera purement théâtral. Néanmoins cessez votre cajolerie, pincez les cordes de plus en plus vite, vous, seigneurs royalistes ; avec un effort inouï vous pouvez y arriver. Dans le mois de juin suivant, le camp de Jalès s'avancera, comme si de théâtral seulement il devenait tout à coup réel, fort de 2000 hommes bien qu'il se vantât qu'il fût de 70.000, chose la plus étrange, avec drapeaux flottants, baïonnettes au bout du fusil, porteur de la proclamation et de la commission de l'Artois, pour la propagation de la guerre civile ! Que quelques Rebecqui et autres de cette espèce de patriotes, purs et chaleureux ; qu'un lieutenant-colonel Aubry, si par hasard Rebecqui est occupé ailleurs mettant tout à coup sur pied les gardes nationaux le disperse, le détruise et renverse le vieux château ; que nous n'entendions plus parler de cela, si c'est possible ! Dans les mois de février et mars, dit-on, la terreur principale dans les campagnes de France s'était élevée au plus haut degré, très près de la folie. Dans les villes, les hameaux, il y a rumeur de guerre, de massacre ; il circule que les Autrichiens, que les aristocrates principalement, que les brigands sont tout près. Les hommes quittent leurs demeures, leurs chaumières, courent en fugitifs, en poussant des cris perçants avec leurs femmes et leurs enfants, sans savoir où. Une terreur semblable, dit un témoin oculaire, n'a jamais frappé une nation et ne se reproduira plus même dans les jours de la terreur ainsi appelés. Les contrées de la Loire, toutes les parties centrales et du sud-est, se levant simultanément comme frappées d'électricité, le grain devint de plus en plus rare. Les habitants font des barricades à l'entrée des villes, entassent des pavés dans les étages supérieurs, les femmes font chauffer de l'eau, attendant l'attaque d'un moment à l'autre. Dans la campagne le tocsin ne cesse de se faire entendre ; les bandes de paysans, rassemblés par son bruit, courent sur les routes après un ennemi imaginaire ; ils sont pour la plupart armés de faux, ils s'avancent en masse avec un air si féroce qu'on les prend pour des brigands. Ainsi marche la vieille France, elle marche courbée cette vieille France. Quelle sera sa fin, nul mortel ne le sait ; mais que cette fin soit proche, tout le monde peut le savoir. VII. — LA CONSTITUTION NE MARCHERA PAS.Quant à notre pauvre Assemblée législative, liée par une constitution sans force, que peut-elle opposer à tout cela, comme remède ? rien si ce n'est de pauvre bouffée d'éloquence ! On discute, on dénonce, on censure ; épais et immense chaos, qui s'absorbe lui-même. Mais leurs deux mille étranges décrets ? Lecteurs, ils n'ont fort heureusement aucun rapport avec toi ni avec moi ; étranges décrets de circonstance, absurdes ou non ; à chaque jour a suffi la peine. De ces deux mille décrets, il n'en existe pas la moitié ; ils ont été ordinairement cassés par le véto royal, ce qui nous sera utile ou inutile. Le 17 janvier l'Assemblée législative, pour un motif, tint sa haute cour à Orléans. L'idée en a été inspirée par la constituante en mai dernier, ceci est certain ; c'est une cour de justice pour les offenses publiques, cour qui ne doit pas manquer de travail. De plus, on décréta qu'on n'avait pas besoin de l'autorisation royale, par conséquent pas de véto possible. Les prêtres peuvent maintenant se marier depuis le mois d'octobre dernier. Un prêtre patriote a eu l'impudence de prendre femme, et pensant que ce n'était pas encore assez, il amena son épouse à la cour de justice pour qu'on prît part à sa lune de miel, et qu'une loi fût rendue à ce sujet. Moins plaisants sont les décrets contre les prêtres obstinés, et aussi non moins nécessaires ! Les décrets sur les prêtres et les émigrés sont les deux séries de décrets, fruits de débats sans fin, qui furent alors frappées du véto et qui nous intéressent principalement ; une auguste Assemblée nationale doit avoir besoin de dompter ses réfractaires, prêtres ou laïques, et de les forcer à l'obéissance ; ainsi agit toujours la puissance législative, elle pressera, écrasera même, jusqu'à ce que ces réfractaires partent. Le véto royal tombe paralysé comme par magie, et votre pouvoir fortement serré, beaucoup moins opprimé, n'agit pas ! Assortiments de décrets vraiment tristes, paralysés par le véto ! D'abord nous avons, à la date du 28 octobre 1791, un édit législatif publié par des crieurs et des afficheurs, enjoignant à Monsieur, frère du roi, de rentrer en France dans les deux mois sous peine d'amende ; à laquelle injonction, Monsieur ne répond pas, ou plutôt il répond par le journal, en manière de parodie ; il engage l'auguste Assemblée à rentrer dans son bon sens dans le cours de deux mois sous peine d'amende ; à propos de quoi l'Assemblée doit prendre de fortes mesures. Ensuite, également le 9 novembre, nous déclarons tous les émigrés suspects de conspirations et en un mot hors la loi, s'ils ne rentrent pas avant le 1er janvier. Le roi lancera-t-il son véto. Un impôt triplé sera levé sur les propriétés de ces hommes, et même leurs biens mis sous séquestre ; cela doit se comprendre. Mais d'abord le 1er de l'an, pas un seul des émigrés n'étant rentré, nous déclarons quinze jours après, avec une nouvelle vigueur, que Monsieur est déchu, dépouillé de ses droits au trône ; de plus que Condé, Calonne et beaucoup d'autres encore, sont accusés de haute trahison et devront être jugés par la haute cour de justice d'Orléans. Véto !... Alors, comme pour les prêtres non assermentés au mois de novembre précédent, on décréta qu'ils n'auraient plus droit aux pensions qu'ils touchaient, et seraient soumis à la surveillance et, au besoin, expatriés. Véto ! encore nouvelles mesures plus rigoureuses ; mais à tout on répondra toujours par véto. Véto sur véto, votre autorité est paralysée ! les dieux et les hommes doivent voir que l'Assemblée législative est dans une fausse position. Hélas ! qui est dans le vrai ? Des voix murmurent déjà pour une convention nationale. Cette pauvre Assemblée législative, éperonnée et pour ainsi martyrisée par toute la France et toute l'Europe, ne peut agir ; elle ne peut que réprimander et pérorer, tout en lançant des propositions violentes, lesquelles n'ont aucune issue C'est de l'effervescence, du tapage et de la sombre furie ! Quelles scènes dans la salle nationale ! Le président agite une sonnette qu'on n'entend pas, ou comme dernière marque de désespoir, il frappe sur son chapeau ; le tapage, pendant vingt minutes, s'apaise un peu, et quelques membres imprudents sont envoyés pour trois jours dans la prison de l'Abbaye ! Les personnes suspectes doivent être soumises et interrogées. Le vieux de Sombreuil des Invalides a à répondre, pour son compte personnel, pourquoi il laisse ses portes ouvertes. Une fumée extraordinaire s'élève de la manufacture de porcelaine de Sèvres, ce qui dénote une conspiration ; les ouvriers donnent pour raison que ce sont les mémoires du collier de Lamotte, achetés par S. M., qu'ils tâchent de détruire par les flammes ; mémoires qu'on peut malgré cela, lire encore. En outre, il paraîtrait que le duc de Brissac et la garde constitutionnelle du roi, fabrique secrètement des cartouches dans les caves : un lot de royalistes purs et impurs, dont beaucoup sont d'infâmes coupe-gorges, tirés des maisons de jeux et de corruption ; ils sont en tout 6.000 au lieu de 1.800 ; ils jettent, c'est certain, sur nous des regards farouches, chaque fois que nous allons au château. Après des débats infinis Brissac et la garde sont renvoyés ; ils sont licenciés après deux mois d'existence seulement, car ils n'atteignirent pas le mois de mars de la même année. La maison militaire nouvellement formée fut également annulée, et le roi ne dut plus être gardé que par les suisses fidèles et par les nationaux à l'uniforme bleu, cela paraît être le lot de ce qui est constitutionnel. La nouvelle maison civile n'aurait jamais été établie si Barnave n'y avait pas poussé ; les vieilles duchesses non émigrées en rirent et la rejetèrent bien loin ; avant tout, S. M. pensa que cela n'en valait pas la peine et que la noblesse reviendrait bientôt triomphante. De plus, jetant de nouveau les regards dans l'intérieur de cette salle nationale et sur la scène qui s'y passe, voici ce que l'on voit. Torné, évêque constitutionnel de morale facile demandant que les costumes religieux soient abolis. L'évêque tisonne le feu, et finit par détacher la croix pontificale et la jette avec indignation comme si c'eût été un gage ou un pari, laquelle croix est aussitôt couverte par celle du Te Deum Fouchet ; alors les autres croix et insignes sont foulés aux pieds ; ce sénateur ecclésiastique ôte son bonnet, d'autres leurs collets brodés, de peur que le fanatisme ne revienne parmi nous. Le mouvement y est vif ! et tellement confus et peu substantiel que vous pouvez presque lui donner le nom de fantôme ; fantôme pâle, sombre, agité, comme le séjour de Pluton ! Le mutin Langlet nous sembla une sorte de spectre ; il soutint des thèses à lui, au milieu de rumeurs et d'interruptions, qui poussent à bout la patience humaine ; il met en pièces ses papiers, et il sort, l'inflammable, l'irascible petit homme. D'autres honorables membres déchireront également leurs paperasses dans un moment d'effervescence ; ainsi fait Merlin en s'écriant : Ainsi donc le peuple ne peut pas être sauvé par vous. Les députations ne manquent pas non plus ; députation des sections, ordinairement accompagnées de plaintes et de dénonciations, et toujours de sentiments de ferveur patriotique ; députation des femmes, qui demandent à leur tour qu'il leur soit permis de prendre la pique, et de s'exercer au Champ de Mars. Pourquoi pas, vous, amazones si cela vous convient ? Alors après avoir rempli leur mission et reçu une réponse, elles défilent dans la-salle en chantant Ça-ira, ou plutôt elles tournent et pirouettent, dansant notre ronde patriotique, notre jeune carmagnole, ou plutôt danse militaire pyrrhique ou danse de la Liberté. La patriote Huguenin ex-avocat, ex-carabinier, ex-commis aux barrières, arrive, député par le faubourg Saint-Antoine qui est sur ses talons, dénoncer l'antipatriotisme, la famine, les fripons et les mangeurs d'hommes ; il dit à l'auguste Assemblée : n'y a-t-il pas un tocsin dans votre cœur contre ces mangeurs d'hommes ? Mais avant toute chose, car c'est l'affaire qui occupe le plus, l'Assemblée législative a à réprimander les ministres du roi. De ces ministres du roi nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, et n'en dirons rien après. Quels fantômes ils sont également ! Accablé d'ennui et de peine, point de stabilité pour eux, pas un seul depuis le départ de Montmorin n'a eu plus de dix jours d'existence, et cela pour le plus ancien en fonction. Les feuillants constitutionnels, tels que notre respectable Cahier de Gerville, notre honorable et infortuné Delessart, ou les royalistes aristocrates tels que Montmorin ami de Necker, ou les aristocrates comme Bertrand Molleville, disparaissent comme des fantômes dans l'énorme et frémissante confusion ; pauvres nuages tourmentés par des vents furieux, sans force, sans soutien, dont la mémoire de l'homme n'a pas besoin de se charger. Que de fois ces pauvres ministres du roi ont été sommés de paraître, questionnés, torturés, menacés même, presque insultés. Ils répondent ce que peut répondre l'homme le plus adroit, dissimulé et casuiste. Sur quoi, la pauvre Assemblée ne sait que faire. Une seule chose évidente, c'est que l'Europe nous entoure, que la France — bien certainement, pas morte, aujourd'hui — ne peut marcher. Prenez garde, vous, ministres ! Le dur Guadet vous écharpe avec des questions acérées, avec ses soudaines questions d'avocat ; la tempête est soulevée par Vergniaud. L'infatigable Brissot soumet des rapports, des actes d'accusation, d'une logique peu solide et sans fin ; il est maintenant à son apogée. Condorcet rédige fortement l'adresse de l'Assemblée législative à la nation française. L'ardent Max Isnard qui, du reste, ne portera jamais le fer ni le feu chez les ennemis, mais bien la liberté, est là pour déclarer qu'il faut rendre les ministres responsables, et par cette responsabilité nous entendons la mort. En vérité, la position devient sérieuse ; le temps presse, les traîtres sont là. Le doucereux Molleville, aristocrate bien connu, enrage du fond du cœur ; comme ses réponses et ses explications arrivent promptement, jésuitiques et spécieuses à l'oreille ! Mais ce qu'il y a peut-être de plus remarquable, est ce qui survint un jour que Bertrand faisant une réplique, cette réplique tomba à plat. A peine l'Assemblée, avait-elle commencé à discuter sur ce qu'il y avait à faire à son égard, que la salle s'emplit de fumée. Épaisse fumée de suie ; alors point de discours, seulement des étouffements et des cris sans remède ; aussi l'auguste Assemblée s'ajourna-t-elle ! Miracle ! miracle emblématique ! on ne sait pas, seulement on croit savoir que l'homme chargé de l'entretien des feux a été choisi par Bertrand, pour remplir cette besogne, ou par un de ses suppôts ! ô sombre et confus royaume de l'enfer, avec tes supplices de Tantale et d'Ixion, avec tes flots de feu destructeur et tes fleuves de lamentations, pourquoi n'as-tu pas aussi ton Léthé, tout aurait une fin ? VIII. — LES JACOBINS.Néanmoins que le patriotisme ne perde pas l'espoir. N'avons-nous pas encore à Paris un vertueux Pétion et une municipalité patriotique ? Le vertueux Pétion depuis novembre maire de Paris ; dans notre municipalité, le public, car tout le monde y est aujourd'hui admis, peut remarquer l'énergique Danton, plus loin l'épigrammiste Manuel, le déterminé, l'impatient Billaud-Varennes, de source jésuitique, Tallien éditeur capable et pas d'autres, que des patriotes plus ou moins bons ou mauvais. Telles sont les élections de novembre, à la joie de tous les citoyens. La vérité est que la cour appuya Pétion plus qu'elle ne le fit pour Lafayette ; ainsi Bailly et ses feuillants semblables à la lune, décroissant beaucoup, disparurent alors après avoir fait une pénible soumission, ce qui est pis encore anéantis, pâles, défigurés par l'ombre de leur drapeau rouge et l'amère souvenir du Champs-de-Mars. Comme est rapide la marche des hommes et des choses ! Aujourd'hui Lafayette, comme ce jour de la fédération en mai, lorsqu'il était à son midi dépose-t-il son épée sur l'autel de la patrie en prêtant serment aux yeux de la France ; Ah ! non, déchu et ne siégeant plus depuis ce moment ? il se tient maintenant malheureux au loin. Mais voilà le pis. Le patriotisme fort de plusieurs milliers de fanatiques dans la capitale du monde, ne peut-il pas se soutenir lui-même ? n'a-t-il pas la force en main, les piques ? Les piques qui n'ont pas été défendues par le maire Bailly et ont été sanctionnées par le maire Pétion et par l'Assemblée législative. Pourquoi pas, quand la garde constitutionnelle du roi, ainsi dénommée, fabriquait des cartouches clandestinement. Des changements sont nécessaires pour la garde nationale même ; tout cet état-major d'aristocrates feuillants de la garde doit être licencié. De plus les citoyens sans uniforme peuvent prendre rang dans cette garde, la pique près du mousquet ; dans un pareil temps, les citoyens actifs et passifs qui peuvent se battre pour nous ne sont-ils pas les bienvenus ! Ô mes amis patriotes, sans nul doute, oui ! mais ce qui est encore plus vrai, c'est que partout le patriotisme n'est jamais si clair, si logique et si respectable que lorsqu'il peut s'appuyer de cœur sur le sombre, l'impénétrable sans-culotte, autrement il disparaît et prend le chemin le plus affreux pour arriver aux limbes ! quelques-uns aussi, tous détournant le nez renifleront sur le patriotisme avec un air de mépris, d'autres s'appuieront sincèrement sur lui, d'autres encore le feront avec crainte ; trois sortes, et chaque sorte avec une destinée correspondante. Sous un tel point de vue, n'avons-nous pas encore une alliée volontaire, plus forte que tout le reste ; à savoir la faim ? La faim, quelle terreur panique, quel chiffre de maux n'entraîne-t-elle pas avec elle ! Le sans-culottisme s'engraisse avec ce qui donne la mort. Le stupide Pierre Baille fera presque une épigramme, sans y penser, et le monde patriote rira, non de l'épigramme, mais de l'auteur, quand il écrivit ; tout va bien ici, le pain manque. Le patriotisme, si vous le saviez, ne peut marcher sans sa constitution, ni son impuissant parlement, ou appelez-le le conseil œcuménique et assemblée générale des églises de J. J. — Savoir : la Société-Mère ! la Société-Mère avec ses trois cents filles devenues femmes avec ce que nous appelons Petites-Filles, essayant de marcher dans tous les villages de France, se comptant, pense Burke, par centaines de mille. Voilà la vraie constitution faite, non par 1200 vénérables sénateurs, mais par la nature même, qui s'est accrue d'une manière non consciencieuse, sans le besoin ni les efforts de ces 25 millions d'individus ; Voici les principaux articles : nos Jacobins provoquent les débats pour la législative, discutent sur la paix et la guerre et fixent à l'avance ce que la législative a à faire, à la grande honte des philosophes et de la majeure partie des historiens qui jugent cela naturel mais cependant pas sagement. Un pouvoir suprême doit exister, vos autres pouvoirs sont des simulacres ; ce pouvoir est cela. Puissante est la Société-Mère, elle a eu l'honneur d'être dénoncée par l'autrichien Kaunitz, et n'en est que plus chère au patriotisme. Par chance et par courage, elle a anéanti le feuillantisme, du moins le club des feuillants ; ce dernier, qui levait jadis la tête bien haut, a la satisfaction de se voir fermé, supprimé, le 18 février ; les patriotes s'y étaient rendus en tumulte pour le railler dans sa peine. La Société-Mère s'est accrue ; elle occupe maintenant l'église entière. Entrons-y avec le digne Toulongeon, l'ex-constituant, notre vieil ami, qui heureusement a des yeux pour voir. La nef de l'église des Jacobins, dit-il, est transformée en un vaste cirque, dont les sièges s'élèvent circulairement en amphithéâtre, jusqu'à la charpente du toit en forme de dôme ; une haute pyramide de marbre noir appuyée contre le mur, qui était autrefois un monument funéraire, a seule été conservée, et sert maintenant aux garçons de bureau. Ici, sur une plateforme élevée, sont les sièges du président et des secrétaires, derrière et au-dessus d'eux, les bustes de Mirabeau, de Franklin et de différents autres, enfin celui de Marat. En face est la tribune, élevée juste entre le plancher et la charpente du dôme, ainsi la voix de l'orateur part du milieu. De cet endroit vient le tonnerre des voix qui ébranle toute l'Europe. En bas, en silence, sont les tisons et la foudre. En entrant dans ce vaste circuit, où tout est gigantesque, outre mesure, l'esprit ne peut réprimer quelque mouvement de terreur et d'étonnement ; l'imagination se reporte à ces temples redoutables que la poésie des anciens temps a consacrés aux divinités vengeresses. Il y a aussi des scènes dans cet amphithéâtre jacobin, l'histoire leur a donné une place. Les drapeaux des trois peuples libres de l'univers, les drapeaux frères d'Angleterre, d'Amérique et de France, y ont été posés de concert, par une députation de Londres, composée de whigs ou wighs et leur club, d'un côté et de l'autre par les citoyennes de France ; belles citoyennes au doux parler, qui solennellement envoient en même temps respect et assurance de fraternité avec le drapeau aux trois couleurs, ouvrages de leurs propres mains, et enfin un épi de blé. Le dôme retentit des cris de vivent les trois peuples libres ! sortant de toutes les poitrines ; scènes des plus dramatiques. La demoiselle Théroigne rend compte à cette tribune de ses persécutions en Autriche ; elle vient appuyée au bras de Joseph Chénier, le poète Chénier, demander la liberté des malheureux Suisses de Château-Vieux. Espérez, vous, les quarante Suisses, qui tirez la rame avec effort dans les eaux de Brest, vous n'avez pas été oubliés. Le député Brissot pérore de cette tribune ; Desmoulins notre méchant Camille, entend distinctement provenir d'en bas : Coquin ! Ici, quoique plus souvent qu'aux cordeliers, résonne la voix de Stentor de Danton ; le refrogné Billaud-Varennes y est aussi ; Collot d'Herbois excité au dernier degré y parle en faveur des quarante Suisses ; Le sentencieux Manuel s'anima au point de s'écrier un ministre doit périr ! à quoi l'amphithéâtre répondit : Tous, tous ; le grand-prêtre, président de ce lieu est, ainsi que nous l'avons dit, le grand parleur, l'incorruptible Robespierre. Quel esprit de patriotisme existait chez les hommes de cette époque ; ce fait, cela nous paraît ainsi, ce fait seul nous démontre que quinze cents créatures humaines non destinées pour cette situation, siègent tranquilles sous la parole de Robespierre, l'entendant chaque nuit et pendant longtemps, l'applaudissant la bouche béante comme pour recevoir la parole de vie. Nul individu peut-on dire, plus fatigant, n'a parlé à la tribune. Aigre, impuissant, incapable, d'une longueur assommante, stérile comme le veut Harmattan, il s'oppose, dans un discours insipide et sans fin, à une guerre immédiate contre les bonnets rouges, contre beaucoup de choses, et il est le Trismégistus et le Dalaï-lama des patriotes. Néanmoins un petit homme à voix criarde, mais avec de beaux yeux et un large front agréablement oblique, se lève avec cet air de respect, pour contester ; c'est disent les journalistes M. Louvet, auteur du charmant roman de Faublas. Soyez fermes, vous patriotes ! n'allez pas par deux chemins, avec une France frappée d'une terreur panique à l'intérieur, et une Europe coalisée portant l'orage chez vous. IX. — LE MINISTÈRE ROLAND.Vers l'équinoxe du printemps, une lueur d'espoir vint cependant briller sur le patriotisme, la nomination d'un ministère vraiment patriote, chose que S. M. au milieu de ses innombrables essais pour calmer l'agitation et amener la paix, va essayer. Les déjeuners de madame d'Udon avaient pris une nouvelle énergie ; le genevois Dumont même y prenait la parole. Enfin du 15 au 23 mars 1792, quand tout avait été négocié, le résultat bienheureux fut ce ministère patriote que nous voyons. Le général Dumouriez aux affaires étrangères, s'occupera de Kaunitz et de l'empereur d'Autriche, autrement que ne le fit ce pauvre Delessart, qui fut renvoyé devant la haute-cour d'Orléans, pour sa nonchalance ; Narbonne, le ministre de la guerre, est emporté par le courant du jour ; le pauvre chevalier de Grave choisi par la cour est renvoyé, alors l'austère Servan, officier capable du génie, s'élève subitement au poste de ministre de la guerre ; le Genevois Glavière voit son rêve se réaliser, il passe aux financés ; depuis plusieurs années pauvre exilé de sa patrie, il s'était merveilleusement gravé dans l'esprit qu'il devait être un jour ministre des finances, et aujourd'hui il l'est. Et sa pauvre femme, remise sur pieds par les docteurs, se soutient et marche, non victime des nerfs, mais bien leur vainqueur. Avant tout, qui sera ministre de l'intérieur ? Roland de la Plâtrière, celui de Lyon ! ainsi l'ont voulu les Brissotins, ainsi que l'opinion publique et privée et les déjeuners de la place Vendôme. Le strict Roland semblable à un quaker endimanché, va baiser la main royale aux Tuileries avec chapeau rond et cheveux plats, avec souliers attachés avec de pauvre cordons ou ferrats. Le grand écuyer dit à Dumouriez, tout en le pinçant : Quoi ! monsieur, pas de boucles à vos souliers ! — Ah, monsieur, réplique Dumouriez, jetant les regards sur le ferrat, tout est perdu. Et ainsi notre beau Roland quitte son appartement élevé de la rue Saint-Jacques pour aller prendre possession des salons somptueux occupés auparavant par madame Necker. Mais bien auparavant encore, Calonne les avait embellis ; ce fut lui qui, le premier, introduisit ce luxe brillant, ces glaces de Venise, cette marqueterie, ce placage et cet or moulés ; il en fit un palais d'Aladin. Et maintenant il est errant à travers l'Europe ; presque noyé dans le Rhin pouvant avec peine sauver ses papiers ! vos non vobis. Le beau Rolland à la hauteur de sa destinée, a son dîner de cérémonie tous les vendredis, les ministres y vont en corps. Roland se met à son bureau lorsque le couvert est levé et semble occupé à écrire, cependant il ne perd pas un mot, si par exemple, le député Brissot et le ministre Clavière entrent dans une vive discussion, il s'interpose, non sans quelque timidité, mais toujours avec une bonne grâce pleine de finesse. La tête de Brissot, dit-on, commence à tourner à cette hauteur soudaine, ainsi qu'il en est pour les faibles cerveaux. Des jaloux insinuent que le ministre, c'est la femme de Roland, et non le mari ! c'est heureux car ils peuvent la charger de tout ce qui se fait de plus mauvais. Du reste, que ces têtes quelles qu'elles soient, tournent au vertige, ce n'est pas celle de cette courageuse femme. Elle est là, sereine et semblable à une reine, telle qu'elle était dans son ancienne mansarde louée dans le couvent des Ursulines ! Elle qui a écossé des pois pour son dîner, faisant tout, comme une jeune servante, avec une parfaite raison et avec une parfaite connaissance, sachant ce que c'était et ce qu'elle était ; de même que celui qui vit au sein de l'or moulu et du placage ne l'oublie pas non plus. Calonne introduisit le placage, donna des dîners, où le vieux Bezenval lui chuchotait à l'oreille diplomatiquement, et c'était important, nous y vîmes encore à la fin Calonne marcher à grandes enjambées. Puis, Necker ; où est-il, Necker, maintenant ? Un changement rapide nous y a amenés, un rapide changement nous en chassera. Ce n'est pas un palais, c'est un caravansérail. Ainsi s'agite et flotte ce monde inquiet, jour après jour, mois après mois. Les rues de Paris et toutes les cités roulent journellement leurs flux d'hommes, flux qui disparaissent chaque nuit, se reposent, horizontalement sur des lits ou des bahuts, et reprennent le lendemain matin le perpendicularité et le mouvement. Tous les hommes fous ou sages poursuivent leur route ; l'ingénieur Coquelat dérouté et d'autres portant la correspondance chiffrée de la reine ; madame de Staël est occupée, elle ne peut retirer son Narbonne du flux du temps ; la princesse de Lamballe est affairée, elle ne peut sauver là reine. Barnave voyant les feuillants dispersés, et Coblentz si joyeux, demande comme dernière faveur à baiser les mains de la reine ; il n'augure rien de bon de sa nouvelle marche, et se retire chez lui, à Grenoble, pour s'y marier avec une riche héritière. Le café Valois et le restaurant Miot résonnent chaque jour de gasconnades ; les royalistes grands braillards à demi-solde avec ou sans poignards, ce qui reste des aristocrates de salon appelle le nouveau ministère, le ministère sans-culotte. M. Louvet, auteur du roman de Faublas, est occupé aux Jacobins ; Casotte, l'auteur du Diable amoureux, est occupé ailleurs ; le mieux pour toi, serait de rester tranquille, vieux Casotte ; c'est un monde celui-ci, qui de théâtral devient réel ! Tous les hommes sont occupés, qu'on devine à quoi, à répandre des semences, ordinairement sans qualité, dans les champs fertiles du temps : Ce sera bientôt reconnu. Les explosions sociales ont en elles quelque chose de redoutable, quelque chose comme de la folie et de la magie ; ce que du reste, la vie possède toujours en elle-même. Ainsi le mutisme terrestre — dit la fable — rendra, si vous arrachez ses mandragores, un gémissement démoniaque à rendre fou. Ces explosions, ces révoltes arrivées à maturité, sourdent comme les mandragores de la nature, telles sont les forces de l'homme, et tels ils sont en partie. Le démonisme ou la démonocratie qui est inhérente à l'existence de l'homme a éclaté parmi nous et nous enlèvera aussi ! Les jours se succèdent toujours les mêmes sans différence, comme ils grandissent irrésistibles à la sourdine ; à tout moment les pensées s'accumulent, les formes du langage se multiplient, les usages, voire même les costumes, et bien plus encore les actes et les transactions, et ces disputes destructives de la France avec elle-même et avec le monde entier. Le mot de liberté aujourd'hui n'est plus prononcé que suivi d'un autre : liberté et égalité ; tandis que ces mots de monsieur, obéissant serviteur, avoir l'honneur et autres de même espèce, que signifient-ils ? — Misère et féodalité ; lesquelles expressions, qui ne se trouvent seulement que dans les provinces à Académie, doivent être supprimées ! La Société-Mère a reçu depuis longtemps des propositions à ce sujet, propositions qu'elle ne peut accepter pour le présent. Remarquez également les frères Jacobins portant une coiffure symbolique, le bonnet de laine, plus connu sous la dénomination de bonnet rouge, la couleur étant pourpre, porté non-seulement comme bonnet phrygien de la liberté, mais aussi pour la commodité, et pour flatter la belle classe des patriotes et les héros de la Bastille, car le bonnet rouge se combine avec ces trois natures. Les cocardes même commencent à être de laine aux trois couleurs, la cocarde enrubannée, signe distinctif des feuillants de la haute classe, devient suspecte. Symbole du temps. Bien plus encore, notez les pénibles enfantements de l'Europe ou plutôt notez ce qu'elle produit. Les douleurs et les cris de l'alliance autrichienne et prussienne ; des dépêches antijacobines de Kaunitz, le renvoi des ambassadeurs français, et ainsi du reste qui serait trop long à noter. Dumouriez correspond avec Kaunitz, et Metternich ou Coblenz et, d'une toute autre manière que ne le fit Delessart ; on devient plus serré, des réponses catégoriques de la nature de celle de Coblentz, et plus encore, seront données. Le 20 avril 1792, le roi et ses ministres vont à la salle du Manège ; ils annoncent dans quel état sont les affaires, et le malheureux Louis, les larmes aux yeux, propose que l'Assemblée décrète la guerre ; après beaucoup d'éloquence d'à-propos, cette nuit la guerre est décrétée. Vraiment, la guerre ! Paris s'assemble en masse remplie d'attente, et reste là non-seulement toute la matinée, mais encore jusqu'à la séance du soir. D'Orléans avec ses deux fils y est aussi, il jette des regards furieux de la galerie d'en face. Tu peux regarder, ò Philippe, c'est une guerre terrible avec ses fruits pour toi et pour tous. L'obscurantisme avec ses trois glorieuses révolutions luttera pour elle. Alors, ils lutteront pendant vingt-deux ans environ, avec acharnement, trépignant et se désolant, avant d'en arriver à quelque chose, non pas à un accord, mais à un compromis et à un prochain règlement sur ce que possèdent les uns et les autres. C'est pourquoi nos trois généraux sur la frontière la surveillent, le pauvre chevalier de Grave, ministre de la guerre réfléchit ; ce qu'il y a chez ces trois généraux et ces armées qu'on le devine. Quant au malheureux chevalier de Grave dans ce tourbillon de choses, toutes le poussant et s'appesantissant sur lui, il perd la tête, et tourne purement et simplement avec elles d'une manière pénible ; se décidant enfin à être : de Grave, maire de Paris. Plus tard, il donne sa démission, retraverse le détroit pour aller se promener dans les jardins de Kensington — Kensington gardens — et l'austère Servan, l'habile officier du génie, le remplace dans ses fonctions ; au poste d'honneur ! à ce poste, au moins difficile. X. — LA PIQUE-NATIONALE-PÉTION.Et de plus, comme sur ces sombres cataractes sans fond jouent de la plus folle manière l'écume et le nuage aux couleurs fantastiques, dissimulant l'abîme sous la vapeur de l'arc-en-ciel ! A travers cette discussion au sujet de la guerre avec l'Autriche et la Prusse, il s'en éleva une autre non moins violente, pour savoir, si les quarante ou quarante-deux. Suisses de Château-Vieux seraient retirés des galères de Brest ? Et si, libérés, il y aurait alors, en leur honneur, des réjouissances publiques ou seulement privées ? Théroigne, comme nous l'avons vu, en a parlé, et Collot l'a appuyée. Bouillé ne s'est-il pas montré pendant cette nuit décisive des éperons, lors de la révolte de Nancy, changée en massacre de Nancy ? Odieux est ce massacre, odieux sont les remercîments publics donnés à ce sujet par le feuillant Lafayette ! Pour parler vrai, le patriotisme Jacobin et les feuillants dispersés sont aujourd'hui au bord de la tombe ; ils luttent avec toutes armes, voire même avec des armes de théâtre. Les murs de Paris sont en conséquence couverts de placards et contre-placards concernant les simples suisses. Répliques de journal à journal ; l'acteur Collot au poétereau Boucher ; le jacobin Joseph Chénier, l'écuyer de Théroigne à son frère André le feuillant ; le maire Pétion à Dupont de Nemours, et cela, pendant le cours de deux mois ; il n'y a aujourd'hui tranquillité nulle part pour l'esprit de l'homme, jusqu'à ce que cette affaire soit décidée. Gloria in excelsis ! Les quarante Suisses sont enfin libérés. Réjouissez-vous, quarante Suisses ; lancez en l'air vos sales bonnets de laine qui vont devenir des bonnets de la liberté, La Société de Brest, fille de la Société-Mère, vous félicite à bord et dépose un baiser sur chacune de vos joues ; on se dispute vos fers comme des reliques de saints, la Société de Brest doit en toute justice en avoir une part qui sera transformée en piques, une sorte de piques sacrées ; mais l'autre portion doit appartenir à Paris pour être suspendue au dôme avec les drapeaux des trois peuples libres ! quelle oie est l'homme ! il glousse sur la peluche et le velours des puissants monarques et sur la laine des galériens, sur tout et sur rien, et il gloussera de toutes ses forces, surtout si les autres gloussent. Le 9 d'avril au matin, ces quarante benêts de Suisses arrivent. Depuis Versailles au milieu de vivats s'élevant jusqu'aux deux, et d'une foule d'hommes et de femmes. On les conduit à la mairie, non à l'Assemblée législative, ce qui ne se fit pas sans peine. La, ils sont harangués, logés et récompensés ; la cour même, non par acquit de conscience, y contribue pour quelque chose, et la fête publique aura lieu le dimanche suivant ; ce jour-là conséquemment elle est célébrée ; ils sont placés sur un char triomphal de la forme d'un navire, roulés à travers Paris au son des cymbales et des tambours. Tous les habitants y assistaient et applaudissaient, puis ils furent conduits au Champ de Mars et à l'hôtel de la patrie, enfin traînés, car le temps apporte toujours un terme, vers une invisible éternité. Le feuillantisme dispersé, ou plutôt ce parti qui aime la liberté, mais pas plus que la monarchie, aura également ses fêtes. La fête de Simoneau, de cet infortuné maire d'Etampes qui mourut pour la loi, certainement pour la loi, bien que le jacobisme le conteste, et qui fut foulé aux pieds avec son drapeau rouge dans l'émeute des grains ; à laquelle fête le peuple assiste, mais sans applaudir, ni nous non plus. Du reste, les fêtes ne manquent pas, ni les belles couleurs de l'arc-en-ciel ; et tout se précipite avec une force triple vers une chute, semblable à celle du Niagara. Il y a des festins nationaux favorisés par le maire Pétion, Saint-Antoine et les Halles défilent au milieu du club jacobin, leur félicité, selon Santerre, serait incomplète, s'ils n'entonnaient pas le Ça-ira, et n'exécutaient pas leur ronde patriotique. Parmi eux on est satisfait de remarquer saint Hurugue, en chapeau blanc, bien entendu, le saint Christophe de la Carmagnole ; ensuite un certain tambour ou tambour national venant d'être offert par une petite fille, on décide qu'à l'avenir, et partout, les femmes seront baptisées sur l'autel de la patrie. Le repas terminé cette petite fille fut en conséquence baptisée sous le nom de Nationale-Pique-Pétion. Fauchet, l'évêque Te Deum, agissant en chef, Thuriot et d'honorables personnes comme parrains et marraines ! Cette remarquable citoyenne se meut peut-être encore sur terre, ou peut-être est-elle morte en faisant ses dents, l'histoire universelle n'y est point indifférente. XI. — LA REPRÉSENTATION HÉRÉDITAIRE.Mais ce n'est pas avec des danses de Carmagnoles et des chants de Ça-ira que le travail peut se faire. Le duc de Brunswick ne danse pas la Carmagnole, il a ses adroits agents fort occupés à autre chose. Sur les frontières, nos armées, soit par trahison, soit autrement, se comportent on ne peut plus mal ; les troupes ne sont pas bien commandées, dirons-nous ? nos soldats foncièrement mauvais ? Sans chef, indisciplinés, séditieux. En paix pendant trente ans, ils n'ont jamais vu le feu. Dans tous les cas, les légères escarmouches de Lafayette et de Rochambeau dans les Flandres autrichiennes ont aussi mal profité qu'ils le devaient ; les soldats effrayés de leur ombre s'écrient tout à coup : on nous trahit ! et s'enfuient saisis d'une frayeur panique, avant ou au premier coup de feu, se contentant de prendre deux ou trois prisonniers qu'ils avaient faits, et de massacrer leur commandant, le pauvre Théobald Dillon, emporté par eux dans une grange de la ville de Lille. Et le pauvre Gouvion qui figura si maladroitement dans l'insurrection des femmes, Gouvion a quitté l'Assemblée législative et s'est démis des fonctions parlementaires par dégoût et désespoir, lorsque ces galériens de Château-Vieux furent admis dans la salle. Il a dit : Entre les Autrichiens et les Jacobins il n'y a autre chose que la mort d'un soldat ! et pendant une nuit sombre et orageuse, il s'exposa à la bouche du canon autrichien et périt dans l'escarmouche de Maubeuge, le 9 juin. Les patriotes législateurs portèrent son deuil et célébrèrent ses funérailles au son d'une musique funèbre, au Champ de Mars ; beaucoup de patriotes le regrettèrent, mais pas un sincèrement. Lafayette même paraissait aussi douteux ; au lieu de se battre contre les Autrichiens, il écrit pour dénoncer les Jacobins. Rochambeau inconsolable quitte le service ; il ne reste plus que Luckner, cet ancien grenadier babillard prussien. Sans armée, sans généraux ! Et le danger augmentait ; Brunswick prépare sa proclamation pour marcher contre l'ennemi ! Le ministère patriote et l'Assemblée législative se demandent ce qu'ils feront en pareille circonstance. D'abord, détruire les ennemis de l'intérieur répond la patriote Législative, et elle propose, le 24 mai, son décret pour le bannissement des prêtres ; ensuite, lever des impôts dans l'intérieur au moyen d'amis dévoués, ajoute le ministre de la guerre Servan, qui propose le 7 juin son camp de vingt mille hommes, vingt mille volontaires nationaux ; cinq pris dans chaque canton, patriotes de choix car Roland est ministre de l'intérieur ; ils seront assemblés à Paris et réservés pour la défense, sagement imaginée contre les Autrichiens de l'extérieur et le comité autrichien de l'intérieur. C'est là tout ce que peuvent faire un ministère patriote et une Assemblée législative. Tout sage et adroit que paraisse un semblable plan aux yeux de Servan et des patriotes, il ne se présente pas ainsi aux regards des feuillants, à cette bande d'aristocrates feuillants, ces gardes de Paris, ces gardes qu'il sera, diton, nécessaire de dissoudre. Ces hommes voient dans cette proposition de Servan, de la formation d'un camp, une insulte. Les pétitions arrivent alors, par conséquent, du côté des feuillants bleus à épaulettes, mais elles sont mal reçues. De plus, il en arrive une de Pétion ayant en titre : Pétition des huit mille gardes nationaux : elle est signée par un grand nombre de citoyens dans lesquels se trouvent des femmes et des enfants ; laquelle fameuse pétition de Pétion des huit mille est acceptée, et les pétitionnaires sous les armes sont admis aux honneurs d'une réception, si toutefois c'était un honneur d'être reçu. Dès que leurs baïonnettes parurent à l'une des portes, l'Assemblée prononça l'ajournement et commença à s'évader par une autre. Dans ces mêmes jours, il est également pitoyable de voir comment la garde nationale escortant la procession de la Fête-Dieu, empoigne et châtie ceux des patriotes qui ne se découvrent pas au passage du Sacrement. Ils font résonner leurs baïonnettes sur la poitrine du boucher Legendre, patriote bien connu depuis les jours de la Bastille, et menacent de l'égorger ; malgré cela, il reste tranquille et respectueux, dit-on, dans sa voiture à cinquante pas de distance, attendant le résultat. Les femmes orthodoxes crient pour qu'il soit mis à la lanterne. Si l'esprit du feuillantisme est arrivé à un tel point dans ce corps, quoi d'extraordinaire ! n'a-t-il pas pour officiers des créatures du feuillant Lafayette ?La cour aussi a été tout naturellement modérée envers eux, les cajolant ; depuis cette dissolution de la garde dite constitutionnelle, quelques bataillons sont entièrement composés de feuillants,' vrais aristocrates au fond ; par exemple les bataillons des filles Saint-Thomas, qui sont composés de banquiers, d'agents de change et autres richards de la rue Vivienne. Notre digne et vieil ami Weber, Weber le frère de lait de la reine, porte le fusil dans ce bataillon ; on peut juger par là le degré du sentiment patriotique. L'imprudence ou plutôt la prudence veut que la Législative soutenue par la France patriote, et le sentiment de la nécessité, décrète ce camp de vingt mille hommes. Le bannissement décisif des prêtres de conditionnel qu'il était passé à l'état de décret. On verra maintenant si la représentation héréditaire est pour ou contre nous ? oui ou non ; à toutes nos autres misères, ceci doit encore être ajouté ; ce qui nous fait une nation non pas menacée de périls extrêmes, mais une nation comme un solécisme paralytique posé dans le suaire d'un vêtement constitutionnel qui n'est autre chose qu'une chemise étroite ; notre main droite collée à notre gauche ; forcés d'y rester, tout en nous tordant et nous repliant, incapables de quitter la place, jusqu'à ce que la corde prussienne nous élève au gibet. Que la représentation héréditaire réfléchisse bien à cela, le décret contre les prêtres ? le camp de vingt mille hommes ? au nom du ciel, on répond véto ! véto ! Le strict Roland écrit au roi, ou pour mieux dire, la lettre était de madame Roland qui l'écrivit en entier dans une séance ; lettre la plus franche qui ait jamais été adressée à un souverain ; laquelle lettre claire et explicative le roi Louis eut l'avantage de lire dans la soirée. Il la lut, la digéra intérieurement, et lendemain matin le ministère patriote en masse fut renversé ; ce fut le 13 juin 1792. Dumouriez, l'homme aux nombreux conseils, avec un nommé Duranthon ministre de la justice, traîne en longueur pendant un jour ou deux, d'une manière un peu suspecte ; il eut un entretien avec la reine, pleura presque avec elle ; mais enfin il rejoignit l'armée, laissant quoi ? un ministère non patriote, ou demi-patriote. Des ministres peuvent maintenant prendre le gouvernail et l'accepter. Ne les appelez-vous pas, des fantômes disparaissant promptement, comme ces tableaux magiques, plus fantômes que jamais ! Malheureuse reine, malheureux Louis ! Les deux vétos étaient bien naturels ; n'y avait-t-il pas des prêtres martyrs et des amis ? le camp de vingt mille hommes ne doit-il pas être autre chose qu'une réunion de sans-culottes les plus dangereux ! c'est bien naturel, et de plus, insupportable pour la France. Les prêtres qui agissent pour Coblentz doivent porter ailleurs leurs souffrances. Les fougueux sans-culottes, eux, eux seuls, repousseront les Autrichiens. Si tu préfères les Autrichiens, alors, pour l'amour de Dieu, va les rejoindre, sinon joins-toi franchement à la cause qui porte à s'opposer à eux ; un terme moyen n'en est pas un. Hélas, quelle ressource extrême était alors laissée à un homme comme Louis ? Des royalistes en sous-main, l'ex-ministre Bertrand-Molle ville, l'ex-constituant Malouet, et des individus incapables d'aider, avis sur avis. Avec une apparence d'espoir sur l'Assemblée législative, sur l'Autriche et Coblentz, joignez à cela le chapitre des chances, une vieille royauté peut hésiter, voguer, on le sait, non sans précaution, sur le flot des événements. XII. — PROCESSION DES CULOTTES NOIRES.Y a-t-il un homme réfléchissant en France qui, dans ces circonstances, puisse se persuader que la Constitution marchera ? Brunswick se remue ; dans peu de jours il se mettra en marche. La France se tiendra-t-elle tranquille enveloppée dans son drap mortuaire et son linceul, la main droite collée à la gauche jusqu'à ce que la Saint-Barthélemy de Brunswick arrive ; jusqu'à ce que la France soit écartelée comme la Pologne, et que ses droits de l'homme deviennent une potence prussienne. C'est en vérité un moment effrayant pour tout mortel. La mort de la nation, ou bien un débordement convulsif surnaturel de nationalité ; débordement diabolique ! Les patriotes dont l'audace a des limites feraient mieux de se retirer, comme Barnave qui jouit à Grenoble des félicités de la vie privée. Les patriotes dont l'audace n'a pas de bornes doivent tomber dans l'obscurité, et en bravant et défiant tout, chercher le salut dans le stratagème, les complots et l'insurrection. Roland et le jeune Barbaroux déploient la carte de la France ; Barbaroux, les larmes aux yeux, dit : ils regardent quelles sont ses rivières, les chaînes de montagnes qui s'y trouvent ; ils se retireront au delà de la Loire, occuperont ces labyrinthes de monticules de l'Auvergne, sauveront quelques petites portions' du territoire sacré de la liberté, et périront à la fin, dans le dernier fossé : Lafayette rédige sa lettre vigoureuse à l'Assemblée législative contre le jacobinisme, laquelle lettre ne guérira pas l'incurable. En avant, patriotes libres, vous, dont l'audace n'a pas de limites, c'est à vous aujourd'hui à agir ou mourir ! Les sections de Paris discutent profondément, envoient députations sur députations à la salle de manège, pour pétitionner et dénoncer. Grande est leur colère contre le tyrannique véto, et la commission autrichienne et la coalition des rois coalisés. A quoi bon cela ! L'Assemblée législative entend le tocsin qui gronde dans nos cœurs, nous accorde la faveur de siéger ; elle nous regarde défiler avec bruit et fanfaronnade ; mais le camp des vingt mille, le décret contre les prêtres annulés par le roi, sont devenus impossibles, inutiles pour la législative. L'ardent Isnard s'écrie : nous aurons l'égalité ou nous descendrons dans la tombe ! Vergniaud rappelle hypothétiquement ses terribles visions d'Ezéchiel pour les rois antinationaux ; mais la question est : des prophéties hypothétiques, du bruit et des fanfaronnades, détruiront-ils le véto ; ou bien le véto en sûreté dans son château des Tuileries restera-t-il toujours en vie ? Barbaroux, séchant ses larmes, écrit à la municipalité de Marseille, qu'elle doit lui envoyer six cents hommes qui sachent mourir. Ce n'est pas un message larmoyant que ce message, mais bien un message sec, auquel on acquiescera. Cependant le 20 juin est proche, jour anniversaire de ce fameux serment du Jeu de paume ; ce jour-là,, dit-on, quelques citoyens ont l'intention de planter un mai ou arbre de la liberté sur la terrasse des feuillants aux Tuileries, et probablement aussi d'adresser une pétition à l'Assemblée législative et à la représentation héréditaire au sujet des véto, et cela avec une démonstration, un éclat et un développement qui semblent devoir être utiles. Les sections s'y sont rendues séparément, se sont agitées et retirées ; mais tous s'en sont allés, ou la majeure partie, après avoir planté leur mai dans cette circonstance alarmante, le tocsin n'en sonnait pas moins en eux. Parmi les amis du roi, il ne peut y avoir qu'une seule opinion en pareil cas ! Parmi les amis de la nation il en est deux. D'un côté ne serait-il pas possible d'annihiler ces maudits véto ; tout patriote et même les représentants législatifs peuvent avoir chacun leur opinion personnelle ; mais la tâche la plus dure tombe évidemment en partage au maire Pétion et aux membres municipaux, tout à la fois patriotes et gardiens de la tranquillité publique. D'un côté, rejeter la question, et de l'autre l'accepter ; le maire Pétion et la municipalité prendront cette route-ci, le directoire du département avec le procureur syndic Rœderer, ayant une tendance au feuillantisme suivront celle-là. Avant tout, chaque homme doit agir suivant sa seule opinion, ou ses deux opinions, et toutes ces sortes d'influence, toutes les représentations officielles se contrarient l'une l'autre de la plus absurde manière. Peut-être après tout que le projet désirable, voire même non désirable, s'éclipsera de lui-même, marchant de travers par suite de tant de complications, et n'aboutira à rien ? Il n'en fut pas ainsi ; le 20 juin au matin, un grand arbre de la liberté, peuplier de la Lombardie, est exposé à tous les regards, posé sur son chariot dans le faubourg Saint-Antoine ; dans le faubourg Saint-Marceau également, dans la partie sud-est la plus éloignée, et toute cette région orientale reculée, porteurs et porteuses de piques, gardes nationaux et curieux sans armes, sont assemblés avec les intentions les plus pacifiques du monde, un officier municipal aux trois couleurs survient, parle. Tout est paisible, disons-le, conformément à la loi. Le droit de pétition et le patriotisme des mais ne sont-ils pas permis ? L'officier municipal s'en retourne, sans résultat ; le flot de sans-culottes continue à couler en se grossissant jusqu'à la marée de midi, poussé par Santerre, de haute taille en uniforme bleu, par le grand Saint-Hurugue en chapeau gris ; il va vers l'ouest, c'est alors une rivière importante ou plutôt c'est un amas de fleuves grossis. Quelles processions n'avons-nous pas vu ? Celle de Corpus Christi, avec Legendre sur sa voiture ; celles des restes de Voltaire avec char à bœufs et bouviers en costume romain. Les fêtes de Château-Vieux et de Simoneau ; celles des funérailles de Gouvion, de Rousseau, et enfin la procession de Nationale-Pique-Pétion ! néanmoins cette procession a son cachet particulier. Les rubans tricolores brillent et flottent au bout des piques ; on y voit des bâtons ferrés et des emblèmes non en petites quantités, parmi lesquels on remarque ces deux-ci, tragiques et non tragiques, un cœur de taureau percé d'un fer, portant, cette épigraphe : Cœur d'aristocrate, et l'autre plus frappante encore, l'étendard des hôtes de ces lieux, une paire de vieilles culottes noires — de soie, dit-on — placée au haut d'un arbalétrier avec ces mots remarquables : Tremblez tyrans, voilà les sans-culottes ; de plus la procession traîne avec elle deux canons. Les officiers municipaux avec l'écharpe tricolore se présentèrent devant elle de nouveau sur le quai Saint-Bernard et ordonnèrent de s'arrêter. Pacifiques, honorables municipaux aux trois couleurs, pacifiques autant que la jeune colombe ; voici notre jeu de paume, le mai. La pétition est de droit, de même que la défense ; une auguste assemblée n'a-t-elle pas reçu les huit mille hommes armés, les feuillants ne le furent-ils pas aussi ? nos piques ne sont- elles pas fabriquées avec le fer de la nation ? la loi est pour nous un père et une mère que nous ne déshonorerons pas, mais le patriotisme est notre âme ; pacifiques municipaux, et avant tout, subordonnés aux nécessités du temps ! s'arrêter, nous ne le pouvons pas, marchez avec nous. Les culottes noires s'agitent, elles sont impatientes ; les roues des chariots à canon crient, les nombreux piétons avancent. Comment atteignirent-ils la salle de manège ? Comme un fleuve à pleins bords ; ils obtinrent l'entrée après débats. Ils lurent leur adresse et défilèrent en dansant et chantant le Ça-ira, dirigés par les grands et bruyants Santerre et Saint-Hurugue ; et comment s'écoulèrent-ils, alors, non en forte rivière, mais serrés comme un lac Caspion, aux alentours des Tuileries ; les premiers poussés par ceux de derrière contre les grilles fermées, au point d'en être étouffés, et en présence de la bouche ouverte et meurtrière du canon ; attendu que les bataillons nationaux sont en rang dans l'intérieur ; avec quelle rapidité accourent les municipaux tricolores, et les royalistes avec leurs billets d'entrée. Leurs Majestés sont dans l'intérieur environnées de personnages habillés de noir ; tout cela, l'esprit humain peut se l'imaginer, ou le lire dans les anciens journaux et dans la chronique des cinquante jours du syndic Rœderer. Notre mai est planté, si ce n'est pas sur la terrasse des feuillants ni dans l'intérieur des grilles, c'est dans le jardin des capucins, aussi près que possible des Tuileries. L'Assemblée nationale a remis la séance pour le soir ; peut-être que ce lac resserré ne trouvant pas moyen de pénétrer, retournera à sa source et disparaîtra paisiblement. Hélas non ! Le derrière presse toujours, il ne connaît pas la souffrance du devant, on voudrait en tout cas, si c'était possible, avoir un mot d'entretien avec S. M. Les nuages s'amoncèlent vers le quartier de l'Est ; il est quatre heures, est-ce que S. M. ne se présentera pas ? Dans ce cas le commandant Santerre, le boucher Legendre, le patriote Huguenin, le cœur grondant, eux et d'autres autorités entreront. Pétitions et requêtes sur le renvoi d'une garde nationale douteuse, demandes sur demandes de plus en plus vives, appuyées par le bruit du canon ! Les grilles s'ouvrent, le sans-culottisme se précipite en foule dans les escaliers ; frappe aux portes des appartements privés ; les coups dans ce cas-là ne font qu'augmenter de force, jusqu'à tout briser ; les portes tombent en pièces. Et alors s'offre une scène sur laquelle le monde a bien longtemps gémi et non sans raison ; car le monde a rarement assisté à un plus déplorable spectacle de grossièretés sur grossièretés ; ce qu'ils savaient bien eux-mêmes, car ils se regardaient stupidement les uns les autres. Le roi Louis au coup frappé à sa porte, l'ouvre, se présente avec assurance et dit : que demandez-vous ? Les sans-culottes reculent, saisis de respect ; se rapprochent cependant, poussés par les derrières avec les cris de : Véto ! Ministres patriotes ! Retirez le véto ! A quoi le roi réplique courageusement ; le temps n'en est pas encore arrivé, et d'ailleurs ce n'est pas la manière de le demander. Chez l'homme l'honneur accompagne toujours la vertu, Louis ne manque pas de courage, il a même, à un haut point ce courage appelé courage moral, bien qu'il n'en ait montré qu'une partie dans cette circonstance. Quelques uns de ses grenadiers nationaux se retirèrent avec lui dans l'embrasure d'une fenêtre ; où il conserva la plus complète impassibilité au milieu des coups d'épaules et des hurlements. Quel spectacle pour les hommes ! On lui présente le bonnet rouge de la liberté, il le pose froidement sur sa tête, puis l'oublie ; il se plaint de la soif, un coquin à moitié ivre lui présente une bouteille, il boit : Sire, ne craignez-vous rien ? lui dit un de ses grenadiers ; craindre, répond Louis, sentez-donc ; et il pose la main du soldat sur son cœur. Ainsi se présente Sa Majesté avec le bonnet rouge. L'affreux sans-culotte se mouvant autour de tous côtés, sans but, avec des paroles inarticulées et des cris de véto ! ministère patriote ! Cette scène dura l'espace de trois heures et plus ! l'Assemblée nationale est ajournée ; les municipaux tricolores ne sont presque utiles à rien. Le maire Pétion est absent, il n'y a plus d'autorité. La reine avec ses enfants et sa sœur Elisabeth, pleurent et s'inquiètent, non pas pour elles seules, se tenant derrière des tables qui servent de barricades et des grenadiers, dans une chambre de l'intérieur. Les hommes en noir se sont tous prudemment évadés. Ce lac épais de sans-culottes séjourne au château environ trois heures. Pourtant tout à sa fin. Vergniaud arrive avec la députation législative, la session du soir étant maintenant ouverte. Le maire Pétion est également arrivé, il parle perché sur les épaules de deux grenadiers ; dans cette circonstance difficile et dans d'autres, en différents endroits, tant au dehors qu'au dedans, le maire parle ; beaucoup d'hommes parlent ; enfin le commandant Santerre défile, sort avec ses sans-culottes par le côté opposé du château. Il passa devant l'appartement où se tenait la reine, résignée, mais triste, au milieu des grenadiers. Une femme lui offre un bonnet rouge, elle le prend, le place, même sur la tête du petit prince royal ! Madame, dit Santerre, ce peuple vous aime plus que vous ne le pensez. Vers huit heures environ, les membres de la famille royale tombèrent dans les bras l'un de l'autre, en versant des torrents de larmes. infortunée famille ! qui ne pleurerait pas sur elle, n'y a-t-il pas un monde entier pour la pleurer. Le temps de la chevalerie est passé et celui de la faim venu. Alors le sans-culottisme dans le besoin fixe le visage de son roi, et trouve qu'il n'a rien à lui donner. Ainsi les deux partis se sont trouvés face à face après de longs siècles, en se regardant stupidement l'un l'autre, et se disant : Ceci c'est moi, mais, bon Dieu, cela est-il toi ? et se quittant sans savoir que faire. Les incongruités ayant été reconnues comme telles, il y a quelque chose à faire. Le destin sait quoi. Tel fut le fameux 20 juin connu de tout l'univers, jour qu'on peut appeler avec plus de raison la procession des culottes noires, qui, avec ce que nous avions à dire du premier parlement biennal, ses résultats et sa vigueur, se termina peut-être assez convenablement. |