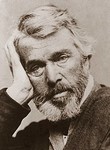HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
LA CONSTITUTION
LIVRE QUATRIÈME. — VARENNES.
I. — LES FÊTES DE PÂQUES À SAINT-CLOUD.La monarchie française peut être désormais, selon toutes les probabilités humaines, considérée comme perdue : elle se débattra quelque temps encore dans l'aveuglement et la faiblesse ; la dernière lueur de raison et de conduite s'est évanouie. Ce qu'il reste de ressources leurs pauvres Majestés vont le gaspiller de plus en plus dans les incertitudes, les délais et les hésitations. Mirabeau lui-même avait eu à se plaindre qu'elles ne lui accordaient qu'une demi-confiance, et qu'elles avaient toujours quelque plan à glisser dans le sien. Il y a longtemps qu'elles auraient pu fuir librement avec lui à Rouen ou ailleurs ! Aujourd'hui les chances de fuite sont énormément diminuées, et vont aller en diminuant pour se réduire à zéro. Décide, ô Reine, le pauvre Louis ne peut rien décider : exécute ce projet de fuite ou bien renonces-y. Assez comme cela de correspondance avec Bouillé ! A quoi bon les consultations et les hypothèses, quand tout, autour de vous, est dans l'ardente activité de la pratique ? Le paysan de la fable s'assied attendant que la rivière soit desséchée : hélas ! avec vous ce n'est pas d'une rivière ordinaire qu'il s'agit, mais d'une inondation du Nil, mais de neiges fondant sur d'invisibles montagnes, jusqu'à ce que tout, y compris vous-même, soit submergé. Bien des choses invitent à la fuite. La voix des journaux invite, les feuilles royalistes la suggérant fièrement comme une menace, les journaux patriotes la dénonçant avec fureur comme un épouvantail. La Société Mère y invite, devenant de plus en plus accentuée ; si accentuée que, comme on l'avait prévu, Lafayette et les patriotes modérés vont bientôt se séparer d'elle et se former en club des Feuillants, pour soutenir contre elle une lutte publique acharnée où la victoire, si douteux que cela paraisse, restera à la Société Mère. D'ailleurs, depuis le jour des poignards, nous avons toujours vu le patriotisme exagéré porter ouvertement des armes. Les citoyens auxquels est refusée l'activité, terme facétieux qui signifie un certain poids de bourse, ne pouvant pas acheter des uniformes bleus et être gardes-civiques ; mais l'homme est plus grand qu'un habit bleu ; l'homme peut combattre, s'il le faut, en habits multiformes ou même presque sans habits, comme sans culotte. Aussi, l'on continue à forger des piques, soit que ces dagues d'une forme nouvelle avec des barbes soient destinées au marché des Indes occidentales, ou qu'elles n'y soient pas destinées. Les hommes battent à l'envers leurs socs de charrue pour en faire des épées. N'y a-t-il pas ce que nous pouvons appeler un Comité autrichien siégeant jour et nuit dans les Tuileries ? Les patriotes, par vision ou par soupçon, le savent trop bien ! Si le roi s'enfuit, n'y aura-t-il pas une invasion aristocrato-autrichienne ; une boucherie, une restauration de la féodalité ; des guerres plus que civiles ? Les cœurs des hommes sont alarmés jusqu'à la folie. Les prêtres réfractaires donnent aussi assez d'embarras. Expulsés de leurs églises paroissiales où les ont remplacés les prêtres constitutionnels élus par le public, ces infortunés ecclésiastiques se retirent dans les couvents de femmes ou dans d'autres semblables asiles ; et là, le dimanche, réunissant des fidèles anti-constitutionnels dont la ferveur s'est soudainement révélée[1], ils officient ou prétendent officier suivant la rigueur des vieilles règles, au grand scandale des patriotes. Les prêtres réfractaires passent dans les rues avec leurs hosties consacrées destinées aux mourants, semblent aspirer à être massacrés, ce que les patriotes ne daignent pas leur accorder. Une plus légère palme de martyre, cependant, ne leur sera pas refusée : au lieu du martyre du massacre, le martyre du fouet. Dans leurs pieuses retraites apparaissent des patriotes et des patriotes femmes armées de baguettes de coudrier, qui se chargent de l'exécution. Ferme les yeux, ô lecteur ; ne regarde pas cette misère particulière à ces derniers temps, d'un martyre sans sincérité, seulement avec hypocrisie et entêtement. On ne permet pas à une église catholique morte de reposer dans son linceul ; non, on la galvanise pour lui rendre une détestable vie factice, et l'humanité ferme les yeux. Les femmes patriotes prennent leurs baguettes de coudrier et fustigent avec ardeur au milieu des rires de l'assistance, le large derrière des prêtres ; hélas ! les nonnes aussi sont renversées et leurs cotillons retroussés ! La garde nationale fait ce qu'elle peut ; la municipalité invoque les principes de tolérance, accorde aux prêtres dissidents l'église des Théatins, et promet de les protéger. Mais tout cela est sans effets. A la porte des Théatins apparaît un placard surmonté, en guise de faisceaux consulaires plébéiens, d'un faisceau de verges ! Les principes de tolérance font de leur mieux ; mais aucun dissident ne priera Dieu en dépit de la loi ; il y a un plébiscite à cet effet qui, quoique non exprimé, est comme les lois des Mèdes et des Perses. Il est défendu à qui que ce soit de donner asile aux prêtres réfractaires, même dans son intérieur ; et le club des Cordeliers dénonce ouvertement Sa Majesté elle-même comme les recueillant dans son palais[2]. Bien des choses invitent à la fuite ; mais par dessus tout, celle-ci : que la fuite est devenue impossible ! Le 15 avril, avis est donné que Sa Majesté qui, dans ces derniers temps, a beaucoup souffert d'un catarrhe, ira jouir pendant quelques jours, à Saint-Cloud, des premières heures du printemps. Pourquoi s'échapper à Saint-Cloud ? Pour faire ses Pâques, peut-être, avec des. prêtres réfractaires ? ou plutôt pour s'enfuir à Compiègne, et de là gagner la frontière ? C'était chose parfaitement faisable, après tout, cela eût pu se faire déjà, accompagnée seulement, comme vous l'êtes, de deux chasseurs faciles à corrompre ! C'est une agréable possibilité, qu'elle se réalise ou non. On dit qu'il y a trente mille chevaliers du poignard en embuscade dans les bois d'alentour. En embuscade dans les bois ! trente mille ! L'imagination populaire brode encore sur tout cela. Combien aisément pourraient-ils, se précipitant sur Lafayette, enlever le représentant héréditaire et s'enfuir avec lui, à la manière d'un tourbillon là où ils voudraient ! Assez, il vaut mieux que le roi ne s'en aille pas. Lafayette est prévenu, et sur ses gardes ; mais en vérité est-ce lui seulement qui est en danger ou bien toute la France avec lui ? Le lundi 18 avril est venu, le voyage de Pâques à Saint-Cloud s'effectuera. La garde nationale a reçu des ordres ; une première division, comme une garde avancée, est déjà partie, et probablement arrivée. On dit que la maison de bouche de Sa Majesté est plongée tout entière, à Saint-Cloud, dans l'étuvée et dans la friture ; le dîner du roi n'est pas loin d'être prêt. Vers une heure, le carrosse royal avec ses huit chevaux noirs s'avance pompeusement sur la place du Carrousel, et s'arrête pour recevoir son royal fardeau. Mais, écoutez ! De l'église avoisinante de Saint-Roch, le tocsin fait entendre son tintement. On dit que le roi est enlevé, qu'il va partir, qu'il est parti ? La multitude envahit le Carrousel : le carrosse royal est encore là, et, par le ciel ! il y restera. Lafayette accourt avec ses aides-de-camp et son éloquence ; il pénètre dans les groupes : — Taisez-vous ! répond la foule, le roi ne partira pas. Monsieur apparaît à une des fenêtres supérieures, dix mille voix crient et vocifèrent : Nous ne voulons pas que le roi parte. Leurs Majestés sont montées. Les fouets craquent. Mais déjà vingt bras de patriotes ont saisi les huit brides, l'attelage se cabre, la voiture se balance, le peuple vocifère ; nul moyen de s'ouvrir un chemin ! En vain, Lafayette se démène, indigné, pérore et lutte, les patriotes, dans leur folle terreur, hurlent autour de la voiture royale ; c'est une mer mugissante de patriotes ; la terreur tourne à la frénésie. La royauté s'enfuira-t-elle donc en Autriche, pour jeter de là sur la France les brandons de la guerre civile ? Arrêtez-la, ô patriotes, au nom du ciel ! De rudes voix apostrophent avec rage la royauté elle-même. Les ordres ne peuvent être ni suivis ni même entendus. Les gardes nationaux ne savent que faire. Les grenadiers du centre, du bataillon de l'Observatoire sont là presque mutinés, faisant entendre des paroles de désobéissance ; menaçant les gardes à cheval de tirer sur eux s'ils maltraitent le peuple. Lafayette monte à cheval, en descend ; il court de ci, de là, haranguant, haletant, presque désespéré. Et cette situation se prolonge durant une heure trois quarts, sept quarts d'heure, à l'horloge des Tuileries ! Le désespéré Lafayette ouvrira un passage, fût-ce par la bouche du canon, si Sa Majesté l'ordonne. Leurs Majestés, sur le conseil de leurs amis royalistes et de leurs ennemis patriotes, descendent et rentrent le cœur triste et indigné, abandonnent l'entreprise. La maison de bouche peut manger elle-même le dîner préparé : Sa Majesté ne verra pas Saint-Cloud ce jour-là, ni aucun autre jour[3]. La fable pathétique de l'emprisonnement du roi dans son propre palais est donc devenue une pénible réalité ! Sa Majesté se plaint à l'Assemblée ; la municipalité délibère, propose une adresse ou une pétition ; les sections répondent par le laconisme obstiné du refus. Lafayette jette sa commission de général en chef, et se montre vêtu du civique habit gris ; il ne peut être persuadé de reprendre son poste même à force de flatteries ; du moins pendant trois jours, au bout desquels les gardes nationaux nous donneront le spectacle de supplications incroyables, se précipitant à ses genoux, et déclarant, sans adulation, qu'ils viennent, eux hommes libres, s'agenouiller devant la statue de la Liberté. Du reste, les grenadiers du centre de l'Observatoire sont licenciés, puis réorganisés, à l'exception de quatorze d'entre eux, sous un nouveau nom, et dans de nouveaux quartiers. Le roi fera ses Pâques à Paris, méditant sur cette singulière situation des choses, et d'autant plus déterminé à y échapper, que le désir est aiguisé par la difficulté. II. — LES FÊTES DE PÂQUES À PARIS.Pendant plus d'une année, depuis mars 1790, nous voyons un vague projet de fuite voltiger devant le royal esprit, et de temps à autre, se condenser en quelque chose ressemblant à un dessein arrêté, que telle ou telle difficulté venait toujours faire évanouir. Cela semble si plein de risques, peut-être même de guerre civile ! Par dessus tout, ce ne peut pas être accompli sans effort. Une paresse somnolente ne sert pas en pareille circonstance : pour fuir, il faut se remuer. Ne serait-il pas préférable d'adopter leur Constitution, et de l'exécuter de manière à prouver à tout le monde qu'elle est inexécutable ? Préférable ou non, assurément c'est plus facile ; à toutes les difficultés vous n'avez qu'à dire : Il y a un lion sur le chemin. Voyez ! votre constitution ne marchera pas ! Pour une personne nonchalante il ne faut aucun effort pour faire le mort, selon l'expression de madame de Staël. Or, maintenant que le désir aiguillonné par la difficulté a fait mûrir le projet, et que le royal esprit n'hésite pas plus longtemps entre deux volontés, qu'arrivera-t-il ? Accordez que le pauvre Louis soit sauf avec Bouillé, que pourrait-il, en somme, aller chercher là-bas ? les billets d'entrée exaspérés répondent : beaucoup, tout. Mais la froide raison répond : peu, presque rien. La loyauté n'est-elle pas une loi de la nature ? demandent les billets d'entrée. L'amour de votre roi, le désir même de mourir pour lui, ne sont-ils pas la gloire de tous les Français, excepté de ces quelques démocrates exaltés ? Que les architectes de la Constitution voient donc ce qu'ils feront sans leur clef de voûte. La France s'arrachera les cheveux d'avoir perdu son représentant héréditaire. Ainsi Louis s'enfuira, mais on ne voit pas trop vers quel port, comme un gamin maltraité, dirons-nous, qui, ayant une belle-mère, se' précipite, boudeur, dans le vaste monde, au risque de déchirer le cœur de son père ? Le pauvre Louis s'échappe de maux connus insupportables vers un mélange inconnu de bien et de mal, coloré par l'espérance. Il va, comme le faisait Rabelais mourant, chercher un grand peut-être ! Ce que, comme l'enfant boudeur, l'homme devenu sage est obligé de faire si souvent dans les circonstances critiques. Du reste, les stimulants ne manquent pas, ni les mauvais traitements de la marâtre ; pour tenir sa résolution au diapason voulu, les agitations factieuses ne cessent pas ; comment, en vérité, cesseraient-elles, à moins que d'être énergiquement conjurées dans une révolte qui est de sa nature sans fond ? Si l'apaisement des factions était le prix de la somnolence du roi, il peut s'éveiller quand il voudra et prendre son vol. Quoi qu'il en soit, remarquez les contorsions et les soubresauts que fait un catholicisme mort, habilement galvanisé, hideux et même piteux à voir ! Assermentés et réfractaires, avec leurs tonsures, ils discutent de tous côtés en écumant ou cessent de discuter et se déshabillent pour la lutte. A Paris, on donnait le fouet quand le besoin continuait à s'en faire sentir : au contraire, dans le Morbihan, sans flagellations, les paysans se soulèvent, ils ne savent trop pourquoi, aux excitations de la chaire. Le général Dumouriez, envoyé là-bas en mission, trouve tout dans une âpre et obscure effervescence, et déclare que des explications et des paroles de conciliation peuvent encore beaucoup. Mais de plus, considérez ceci : que Sa Sainteté Pie VI a trouvé bon d'excommunier l'évêque Talleyrand. A coup sûr, nous pouvons dire en voyant cela, qu'il n'y a sur la terre aucune église vivante ou morte, qui n'ait le droit le plus indubitable d'excommunier Talleyrand. Le pape Pic en a le droit et le pouvoir à sa manière. Mais il faut reconnaître qu'à sa manière aussi, le père Adam, ci-devant marquis de Saint-Huruge, a le même droit et le même pouvoir. Voyez donc, le à mai, dans le Palais-Royal, une multitude bruyante au milieu de laquelle le père Adam, Saint-Huruge, à la voix de taureau, en chapeau blanc, s'élève comme une tour. Celui qui l'accompagne est, dit- on, le journaliste Gorsas ; autour d'eux se promènent des gens bien mis portant un Pie VI fait de gomme et de lattes ; avec son manteau et sa tiare, et le pouvoir de ses clefs, de grandeur naturelle. Ils portent aussi l'effigie de Royon, l'ami du roi, avec un paquet des numéros condamnés de son journal, combustible propice aux sacrifices. On prononce des discours, on rend un jugement, on proclame un arrêt qui peut être entendu des quatre points cardinaux. Et ainsi, au milieu de grands applaudissements, l'holocauste est consommé sous le ciel du printemps, et Notre Sainteté de lattes et de gomme, avec sa suite de victimes, s'élève en flammes et se réduit en cendres ; un pape décomposé, et son droit et son pouvoir, parmi toutes les parties, ont bien ou mal accompli leur tâche comme ils ont pu[4]. Mais, en somme, à partir de Martin Luther, sur la place du marché de Wittemberg, jusqu'au marquis de Saint-Huruge, dans ce Palais-Royal de Paris, quel voyage nous avons fait, dans quels étranges pays il nous a conduits ! Aucune autorité ne peut désormais intervenir : la religion elle-même, gémissant sur de telles scènes, peut, après tout, se demander : qu'ai-je à faire avec tout cela ? C'est de cette étrange manière qu'un catholicisme mort, habilement galvanisé, fait des sauts et des cabrioles. Le lecteur s'informera-t-il du sujet de controverse dont il s'agit ici, et de la différence qui peut exister entre l'orthodoxe ou Ma-doxie, et l'hétéradoxie ou Ta-doxie ? Ta-doxie est qu'une auguste Assemblée nationale peut égaliser les circonscriptions des évêchés ; qu'un évêque égalisé, son crédo et ses formulaires étant laissés aussi intacts qu'ils l'étaient, peut jurer fidélité au roi, à la Loi et à la nation, et devenir ainsi un évêque constitutionnel. Ta-doxie, si tu es dissident, est qu'il ne-le peut pas, mais qu'il lui faut devenir une chose maudite. Il ne faut, à la mauvaise nature humaine qu'un iota, ou même le prétexte d'un iota pour passer abondamment à travers le trou d'une aiguille ! Ainsi, les mortels iront toujours jargonnant et fumant, et comme les anciens stoïciens sous leurs portiques, par de violentes disputes conserveront leurs églises. L'auto-dafé de Saint-Huruge eut lieu le 4 mai 1791. La royauté le vit, mais ne dit rien. III. — LE COMTE DE FERSEN.A l'heure qu'il est, la royauté devrait être déjà bien avancée dans ses préparatifs. Malheureusement il en faut énormément de préparatifs ! Si le représentant héréditaire pouvait s'en aller dans une diligence, combien ce serait facile ! Mais il n'en est pas ainsi. Il faut de nouvelles toilettes, comme il est d'usage dans les poèmes épiques, même dans ceux des plus affreux âges de fer. Voyez la reine Chrimhilde avec ses soixante couturières, dans ce charmant chant des Niebelungen ! Aucune reine ne peut se remuer sans des toilettes neuves. Aussi, madame Campan voltige-t-elle, assidue, d'une couturière à l'autre ; on coupe incessamment des jupes et des robes, des vêtements de dessus et des vêtements de dessous, des grands et des petits : taillage et couture dont on aurait si bien pu se dispenser. En outre, la reine ne peut faire un pas nulle part sans son nécessaire ; cher nécessaire de bois de rose incrusté d'ivoire, habillement divisé, contenant des parfums, des articles de toilette, une infinité de petites fournitures royales indispensables à cette vie terrestre. Il ne faut pas moins de cinq cents louis, beaucoup de temps et de travail pour se procurer un pareil objet de première nécessité[5] ! Tout cela, vous le voyez, fait mal augurer du succès de l'entreprise. Mais les caprices des femmes et des reines veulent être obéis. Bouillé, de son côté, est en train d'établir un camp fortifié à Montmédy, réunissant là le royal allemand et toutes sortes d'autres troupes allemandes et de vraies troupes françaises, pour observer les Autrichiens. Sa Majesté ne passera pas la frontière à moins d'y être contrainte. Ni les émigrés ne seront plus employés, odieux comme ils le sont à tout le peuple[6] ; ni le vieux dieu de la guerre, Broglie ne mettra la main aux affaires ; mais seulement notre brave Bouillé, à qui un roi délivré donnera le bâton de maréchal de France, aux applaudissements de toutes les troupes. En attendant, Paris étant si soupçonneux, ne serait-il pas hors peut-être d'écrire à vos ambassadeurs étrangers une ostensible lettre constitutionnelle, afin que tous les rois et les peuples sachent bien que le roi Louis aime la Constitution, qu'il l'a volontairement jurée, qu'il est prêt à la jurer encore, à la maintenir, et qu'il considère comme ses ennemis personnels ceux qui affectent de dire le contraire ? Cette circulaire constitutionnelle est expédiée par des courriers, communiquée confidentiellement à l'Assemblée, et publiée dans les journaux avec grand fracas. La feinte et la dissimulation jouent un si grand rôle dans les affaires humaines ! Nous observons cependant que le comte de Fersen se sert souvent de son billet d'entrée, ce que, à la vérité, il a parfaitement le droit de faire. Brave soldat et Suédois dévoué à cette belle reine, comme lui est aujourd'hui dévoué le roi de Suède lui-même. Le roi Gustave, surnommé fièrement le Chevalier du Nord, ne s'est-il pas proclamé lui-même son chevalier ? Il viendra sur les ailes de feu de la mousqueterie suédoise et la délivrera de ces infâmes dragons, — si, hélas ! n'intervient pas le pistolet d'un assassin ! Mais, en fait, le comte de Fersen nous apparaît comme un très-jeune soldat de résolution et d'audace. Il circule beaucoup, vu ou non vu, et il a certainement quelque affaire en main. Il en est de même du colonel duc de Choiseul-le-Grand, de Choiseul qui est mort aujourd'hui. Lui et l'ingénieur Goguelat passent et repassent entre Metz et les Tuileries ; et les lettres chiffrées s'échangent, dont l'une des plus importantes est difficile à déchiffrer, Fersen l'ayant écrit à la hâte[7]. Quant au duc de Villequier, il est parti à tout jamais depuis le jour des poignards ; mais son appartement est utile à la reine. D'un autre côté, le pauvre Gouvion, commandeur en second de la garde nationale, de service aux Tuileries, voit plusieurs choses difficiles à interpréter. C'est le même Gouvion qui, de longs mois auparavant, à l'Hôtel de Ville, avait assisté impassible, impuissant à l'insurrection des femmes, sans plus bouger qu'un cheval dans une écurie incendiée, jusqu'à ce que l'huissier Maillard eût saisi son tambour. Il n'y a pas de plus sincère patriote, mais il y en a énormément de plus avisés. S'il faut ajouter foi aux commérages de madame Campan, il faisait un semblant de cour à certaine traîtresse femme de chambre du palais, qui révélait bien des choses. Le nécessaire, les toilettes, l'emballage des bijoux, il aurait dû comprendre tout cela, quand on le lui montrait[8] ? L'impuissant Gouvion voit tout cela avec des yeux naïfs et vitreux ; il recommande la vigilance à ses factionnaires ; il se promène sans repos, va et vient et s'imagine que tout est pour le mieux. Mais, en réalité, il se trouve que, dans la seconde semaine de juin, le colonel de Choiseul est secrètement à Paris où il est venu pour voir ses enfants. Il paraît aussi que Fersen a fait construire une nouvelle et prodigieuse voiture du genre appelé berline, sortie des ateliers des premiers artistes, d'après un nouveau modèle. Elle est transportée chez lui en présence de Choiseul ; les deux amis font une promenade d'essai dans les rues, d'un air méditatif ; puis ils l'envoient chez madame Sullivan, dans la rue de Clichy, bien loin, vers le nord de Paris, pour attendre là qu'on ait besoin de s'en servir. Il parait qu'une certaine dame russe, la baronne de Korff, avec une femme de chambre, un valet de pied et deux enfants, doit retourner dans son pays, et que ces deux gentilshommes militaires lui portent quelque intérêt. On lui a procuré un passeport, on s'est occupé activement d'une voiture et de ce qui s'ensuit, tout ces jeunes militaires sont à la fois polis et serviables. Fersen a pareillement acheté une chaise à deux places, sans doute pour deux suivantes, et de plus certains chevaux nécessaires. On dirait qu'il est prêt lui-même à quitter la France, et non sans grandes dépenses ? Nous observons enfin que Leurs Majestés — le ciel le veut ainsi, — assisteront à l'office du Saint-Sacrement, le jour de la Fête-Dieu, dans l'église de l'Assomption, ici, à Paris, pour le bonheur de tout le monde. En outre, pour le même jour, nous voyons que le brave Bouille, à Metz, a invité une société d'amis à dîner, tandis que pendant ce temps-là, il partait pour Montmédy. Ce sont là de ces phénomènes ou apparitions visuelles de ce vaste monde terrestre si agité, et qui n'est, après tout, qu'une série de phénomènes, ce que l'on appelle des spectres ; tout passe, rien ne subsiste à aucun moment ; et personne, à aucun moment, ne peut savoir pourquoi. Le lundi soir 20 juin 1791, vers onze heures, il y a bien des fiacres et des voitures de remise qui roulent ou sont au repos dans les rues de Paris. Mais parmi toutes les voitures de remise, nous vous recommandons, ô lecteur, celle-ci qui est arrêtée dans la rue de l'Échelle, tout près du Carrousel et du guichet des Tuileries ; dans la rue de l'Échelle qui, alors, était en face de la porte du sellier Roussin, comme si elle attendait des voyageurs. Elle n'attend pas longtemps ; une dame voilée, avec deux enfants également voilés, est sortie de la porte de Villequier où ne se promène aucune sentinelle, dans la cour des Princes, de là dans le Carrousel, puis dans la rue de l'Échelle, où le cocher les reçoit prestement et attend de nouveau très-peu de temps ; une autre dame, également voilée, s'appuyant sur un laquais, sort de la même manière ; elle dit : Bonne nuit au laquais, et de la même manière est reçue avec empressement par le cocher. Où donc vont tant de dames ? Le coucher du roi vient d'avoir lieu ; Sa Majesté s'est mise au lit, et tout le monde du palais se retire chez soi. Mais le cocher attend encore, son chargement est probablement incomplet. Notons, en passant, un individu trapu, en chapeau rond et en perruque, donnant le bras à une sorte de domestique, quelque courrier sans doute ; il sort aussi par la porte Villequier, au moment où il passe devant un factionnaire, il perd une boucle de ses souliers et se baisse pour la ramasser. Cependant il est reçu avec plus d'empressement encore par le cocher de la voiture de remise. Et maintenant son chargement est-il complet ? Pas encore, le cocher attend de nouveau. Hélas ! Et la fausse femme de chambre a averti Gouvion qu'elle pense que la famille royale doit fuir cette nuit même, et Gouvion se défiant de ses propres yeux, a envoyé un exprès à Lafayette ; et la voiture de Lafayette, avec ses lanternes allumées, traverse en ce moment le guichet du Carrousel, où une dame couverte d'un large chapeau à la Bohémienne, et s'appuyant sur le bras d'un domestique, ayant aussi l'apparence d'un courrier, se met de côté pour la laisser passer, et a même le caprice de toucher un des rayons de ses roues avec sa badine — légère petite baguette que portaient les belles d'alors. Les lumières du carrosse de Lafayette sont passées ; tout est calme dans la cour des Princes, les sentinelles sont à leur poste ; les appartements de Leurs Majestés fermés et plongés dans un doux repos. Votre pauvre femme de chambre s'est-elle donc trompée ? Veille bien, ô Gouvion, avec toute la prudence d'Argus ; car, en vérité, la trahison est dans ces murs. Mais où est la dame en chapeau de Bohémienne, qui s'était mise de côté et avait touché avec sa badine le rayon de la roue ? Ô lecteur, cette femme était la reine de France ! Elle était sortie heureusement par le guichet intérieur, dans le Carrousel même, mais non dans la rue de l'Échelle. Troublée par la rencontre et par le bruit de la voiture, elle prit la main droite au lieu de la gauche ; ni - elle, ni son courrier ne connaissaient Paris ; ce n'était pas un courrier, d'ailleurs, mais bien un loyal et stupide ci-devant garde du corps déguisé. Ils sont partis, par erreur, du côté de la rivière et du Pont royal ; ils errent désolés dans la rue du Bac, bien loin du cocher de remise qui attend toujours. Il attend l'angoisse au cœur, plein de préoccupations qu'il doit soigneusement cacher. Minuit sonne à tous les clochers de la ville, une heure précieuse a été perdue ainsi ; la plupart des mortels sont endormis. Le cocher de remise attend, — avec quelle inquiétude ! — Un confrère vient à rouler de son côté, entre en conversation, on lui répond gaiement dans le langage des cochers : les compagnons du fouet échangent une prise de tabac[9] ; on décline l'offre d'un verre de vin ; le nouveau venu part avec un bonsoir. Que le ciel soit béni ! Voici enfin la dame-reine en chapeau de Bohémienne, sauve de tous périls, et qui a été forcée de demander son chemin. Elle entre, son courrier monte lentement à cheval, comme l'avait fait l'autre qui est aussi un garde du corps déguisé, et maintenant, ô étrange cocher de remise, — comte de Fersen, car le lecteur t'a reconnu, — maintenant roule ! La poussière ne s'attachera pas aux doigts de Fersen : clic ! clac ! La voiture résonne et chacun respire plus librement. Mais Fersen est-il sur la bonne route ? Vers le nord-est, à la barrière Saint-Martin, nous serions sur notre chemin, et voyez, il se dirige droit au nord ! Le royal personnage en chapeau rond et en perruque s'étonne un peu, mais il n'y a pas de remède. Clic ! clac ! nous roulons incessamment à travers la ville endormie. Rarement, depuis que Paris est sorti de la boue ou depuis que les rois chevelus se promenaient dans une charrette traînée par des bœufs, rarement on vit un tel équipage. De chaque côté de votre route, les hommes sont renfermés étendus sur le flanc, endormis ; et nous sommes éveillés et tremblant ! Clic ! clac ! à travers la rue de Grammont, à travers le Boulevard ; on monte la rue de la Chaussée-d'Antin ; ces fenêtres silencieuses du n° 42 furent celles de Mirabeau ! Ce n'est pas vers la barrière Saint-Martin, mais vers celle de Clichy, à l'extrême nord ! Patience, ô royaux personnages ; Fersen sait bien ce qu'il fait. En montant la rue de Clichy, il descend un moment chez madame Sullivan : Le cocher du comte de Fersen est-il venu chercher la berline neuve de la baronne de Korff ? — Oui, il y a déjà une heure et demie, répond en murmurant le portier assoupi. — C'est bien, oui c'est bien, quoiqu'il eût mieux voulu ne pas perdre une heure et demie. En avant donc, ô Fersen ; vite à la barrière de Clichy, et de là vers l'est, le long du Boulevard extérieur, voyons ce que peuvent faire les chevaux et le fouet ! Ainsi Fersen roule par cette nuit embaumée. Paris endormi est maintenant tout entier à sa droite, silencieux, et ne faisant entendre que quelques ronflements sonores. Et maintenant le comte va vers l'est, jusqu'à la barrière Saint-Martin, cherchant avec anxiété la berline de la baronne de Korff ; il la découvre enfin, attelée de ses six chevaux, avec son cocher allemand attendant sur ce siège. Bien, ô bon Allemand : hâte-toi là où tu sais ! Hâtons-nous aussi, nous, de la voiture de remise ; hâtons-nous, bien du temps est déjà perdu ! L'auguste chargement de la voiture, les six voyageurs se précipitent vivement dans la nouvelle voiture : les deux courriers gardes du corps montent derrière. La voiture de remise est tournée du côté de la ville et mise à l'abandon pour errer où elle pourra ; et le lendemain matin, on la trouvera culbutée dans un fossé. Mais Fersen est sur ce nouveau siège orné de ses housses toutes neuves, il agite son fouet et s'élance dans la direction de Bondy. Là doit se trouver un troisième dernier courrier garde du corps, avec des chevaux de poste tout frais. Là aussi nous trouverons la chaise achetée par Fersen, avec les deux femmes de chambre et leurs nombreux cartons, sans lesquels ne pourrait pas voyager Sa Majesté. Vite, vite, cet habile Fersen, et puisse le ciel protéger tes pas ! Une fois de plus, par la grâce du Ciel, tout va bien. Voici le hameau endormi de Bondy, la chaise avec les femmes de service, les chevaux tout prêts et les postillons avec leurs grandes bottes, impatients dans la rosée du matin. Le harnachement se fait en hâte, les postillons avec leurs grandes bottes sautent sur leurs selles, brandissent de tous côté leurs petits fouets tapageurs. Fersen s'incline dans un humble et silencieux salut d'adieu, les mains royales envoient, sans un seul mot, une inexprimable réponse ; la berline de la baronne de Korff, avec la royauté de France, s'éloigne pour toujours, comme nous le verrons. L'habile Fersen se précipite obliquement vers le nord, à travers la campagne, gagne le Bourget, où il trouve son cocher allemand avec un chariot qui l'attendaient, il fait claquer son fouet et disparaît sans être découvert, dans l'espace inconnu. Un habile homme, en vérité, et bien actif : son entreprise a prestement et heureusement réussi. Et ainsi la royauté de France est-elle actuellement sauvée ? Dans cette précieuse nuit, la plus courte de l'année, elle fuit ! La baronne de Korff est, en réalité, madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France ; c'est elle qui était venue voilée avec les deux jeunes enfants : le petit dauphin, la petite Madame royale, connue longtemps après sous le nom de duchesse d'Angoulême. La femme de chambre de la baronne de Korff est la Reine à chapeau rond et en perruque, et valet pour le quart d'heure. Cette autre dame voilée qui passe pour une dame de compagnie, est la bonne sœur Élisabeth ; elle avait juré depuis bien longtemps, depuis l'insurrection des femmes, que la mort seule pourrait la séparer d'eux tous. Et c'est ainsi qu'ils se précipitent, pas trop vite, à travers la forêt de Bondy, et qu'ils passent un Rubicon dans leur propre histoire et dans celle de la France. Heure solennelle, quoique l'avenir soit bien vague ! Atteindrons-nous Bouillé ? Ne l'atteindrons-nous pas ? Ô Louis ! autour de toi voici toute la vaste terre endormie — et au-dessus de ta tête le gigantesque ciel qui veille — ; voici la dormante forêt de Bondy — où le chevelu Childéric le fainéant eut le sein percé par le fer, et vraisemblablement dans un monde comme le nôtre. Ces tours de pierre pointues, c'est le Raincy, ce sont les tours de l'odieux d'Orléans. Tout sommeille, sauf le roulement continu de notre nouvelle berline. Nous ne rencontrons pour toute créature, qu'un marchand de légumes avec son âne et ses herbes matinales, épouvantail inoffensif, à la démarche lourde et pesante. Mais droit devant nous le nord-est laisse voir de plus en plus son aurore gris, moucheté ; sur la branche chargée de rosée, les oiseaux, ici et là, saluent, par un gazouillement précipité, le lever du soleil. Les étoiles disparaissent et les constellations, et les lampes des rues de la cité de Dieu. L'univers, ô mes frères, ouvre ses portes grandes pour le lever du grand roi d'en haut. Toi, pauvre roi Louis, tu marches néanmoins comme le font les mortels, vers les terres orientales de l'espérance ; et les Tuileries avec leurs levers, et la France, et la terre elle-même n'est plus qu'un grand roi de chenil, — qui est en train de devenir enragé. IV. — ATTITUDE.Mais que se passe-t-il à Paris, à six heures du matin, quand certain député patriote, prévenu par un billet, éveilla Lafayette, et qu'ils allèrent ensemble aux Tuileries ? L'imagination peut peindre, mais les mots ne le peuvent pas, la surprise de Lafayette, ou rendre l'égarement avec lequel l'impuissant Gouvion roula ses yeux d'Argus, en reconnaissant que sa fausse femme de chambre avait dit vrai ! Cependant il faut rappeler que Paris, en ce terrible jour, grâce à une auguste Assemblée nationale, se surpassa lui-même. Jamais, selon des témoins oculaires, on ne vit une attitude aussi imposante[10]. Toutes les sections en permanence ; notre Commune aussi, ayant la première, vers dix heures, tiré trois solennels coups d'alarme et par-dessus tous notre Assemblée nationale. L'Assemblée nationale également en permanence, décrète tout ce qui est nécessaire, d'une voix unanime, car le côté droit siège dans un mutisme absolu, de peur de la lanterne. Elle délibère avec une promptitude et un calme qui touchent au sublime. On doit nécessairement voter, car il est évident, que Sa Majesté a été enlevée par quelques personnes inconnues ; et dans ce cas, qu'est-ce que la Constitution nous prescrit de faire ? Revenons aux premiers principes, comme nous le disons toujours ; revenons aux principes ! Les principes nous commandent d'abord une décision prompte. Les ministres sont appelés et invités à continuer leurs fonctions ; Lafayette est interrogé, ainsi que Gouvion qui s'excuse de son mieux et fait un rapport insignifiant. On trouve des lettres dont l'une, d'une immense étendue, écrite de la propre main de Sa Majesté, et évidemment de la composition de Sa Majesté, est adressée à l'Assemblée nationale. Elle raconte avec émotion, avec une simplicité presque enfantine, toutes les souffrances que Sa Majesté a endurées : souffrances grandes et petites, un Necker applaudi, une majesté qui ne l'était pas ; puis une insurrection ; le manque de meubles convenables dans le palais des Tuileries, le manque d'argent dans la caisse de la liste civile ; un manque général d'argent, de mobilier et d'ordre ; l'anarchie partout ; le déficit non encore comblé, pas même en minime partie : c'est pourquoi, en résumé, Sa Majesté s'est retirée en lieu libre et sûr, et abandonne à eux-mêmes les sanctions, la fédération et tous les serments possibles, il s'en réfère maintenant. — A quoi ? pense une auguste Assemblée, — à cette déclaration du 23 juin, avec son : il fera seul le bien de son peuple ; comme si cette déclaration n'avait pas été enterrée assez profondément sous deux irrévocables années, et sous les débris et les décombres d'un monde féodal tout entier ! L'Assemblée nationale décrète l'impression de cette étrange lettre, et son envoi aux quatre-vingt-trois départements, avec un commentaire exégétique, court mais énergique. Des commissaires seront envoyés sur tous les points ; le peuple sera exhorté ; les armées seront augmentées ; on prendra soin que la chose publique ne souffre aucun dommage. — Et alors, avec un air de calme sublime, presque d'indifférence, nous passons à l'ordre du jour ! Ce calme apaise la terreur du peuple. Ces étincelantes forêts de piques qui se hérissaient au lever du soleil disparaissent de nouveau ; les bruyants orateurs des rues se taisent ou déclament moins violemment. Nous devons avoir une guerre civile ; eh bien ! acceptons-la. Le roi est parti ; mais l'Assemblée nationale, mais la France, mais nous : tout cela reste. Le peuple, lui aussi, prend une fière attitude ; le peuple, lui aussi, est calme, sans mouvement, comme un lion au repos. Rien que quelques mugissements, quelques remuements de la queue pour leur montrer ce qu'il peut faire ! Cazalès, par exemple, était assailli par les groupes des rues et par des cris : A la lanterne ! mais les patrouilles nationales le délivrèrent aisément. Toutes les effigies et statues du roi, du moins celles en plâtre, furent renversées. Il en fut de même des noms du roi ; le mot roi disparut soudainement de toutes les enseignes. Le tigre royal du Bengale lui-même, sur le boulevard, devint le Tigre national du Bengale[11]. Combien est grand un peuple au repos ! Le lendemain les citoyens se disent l'un à l'autre : Nous n'avons pas de roi, et pourtant nous n'en avons pas moins profondément dormi. Le lendemain, le fervent Achille du Châtelet et Thomas Payne couvrent les murs de Paris de leurs placards où ils annoncent qu'il faut proclamer la république[12]. — Faut-il ajouter que Lafayette aussi, quoique menacé d'abord par les piques, a pris une noble attitude ou même la plus noble de toutes ? Des éclaireurs et des aides de camp s'élancent de tous côtés, au hasard, en quête et en poursuite ; le jeune Romœuf se précipite vers Valenciennes, quoique avec peu d'espoir. Ainsi Paris se calme d'une manière sublime dans son abandon. Mais par les Messageries royales, par toutes les malles-poste rayonne de toutes parts au loin la nouvelle électrique : Notre représentant héréditaire est parti ! Riez, royalistes noirs ; ne riez pourtant que dans votre barbe, de peur que les patriotes ne s'en aperçoivent et, devenant furieux, ne baissent la lanterne ! Paris seul a une sublime Assemblée nationale pour le calmer ; mais en vérité, que les autres villes prennent la chose comme elles pourront avec la bouche muette de stupéfaction et les yeux grands ouverts ; avec une terreur panique, avec fureur, avec doute. Quel sillon chacune de ces pesantes diligences de cuir, avec son sac de cuir et son : le roi s'est enfui, laisse-t-elle derrière elle en traversant la tranquille France ; dans la ville et dans le hameau, troublant l'es- prit public par une frissonnante agitation de terreur mortelle, puis continuant lentement sa route, comme si de rien n'était ! Le long de toutes les grandes routes, vers les frontières les plus reculées, jusqu'à ce que toute la France soit soulevée, — transformée — métaphoriquement parlant — en un énorme dindon, affolé, à la crête soulevée, au glouglou désespéré ! Par exemple, c'est sous les ombres de la nuit que le monstre de cuir atteint Nantes ; la ville est profondément plongée dans le sommeil. Le mot fatal prononcé réveille tous les patriotes : le général Dumouriez, enveloppé dans sa roquelaure, doit descendre de sa chambre à coucher ; il trouve la rue couverte de quatre ou cinq mille citoyens en chemise[13]. Çà et là une pauvre chandelle d'un liard est allumée à la hâte ; une multitude de visages hagards aux traits sombres, au bonnet de nuit rejeté en arrière ; des queues de chemises plus ou moins flottantes ; des bouches ouvertes, attendant que le général dise son mot. Et par-dessus tout cela, comme toujours, la Grande Ourse poursuit sa route, tranquille, ferme, indifférente comme la diligence de cuir elle-même. Prenez courage, ô citoyens de Nantes ! la fidèle Ourse continue de tourner ; l'ancien Atlantique envoie toujours ses flots salés, ses vagues bruyantes, jusqu'à votre Loire ; l'eau-de-vie sera chaude à l'estomac ; ce jour n'est pas le dernier des jours, mais l'avant-dernier. — Les insensés ! s'ils savaient ce qui se passait, à cette heure même, à la lumière d'une chandelle aussi, bien loin dans le nord-est ! Peut-être, nous pouvons le dire, l'homme le plus terrifié
de la France est-il — qu'en penses-tu, lecteur ? — le verdâtre Robespierre.
Une double pâleur, avec l'ombre des gibets et des cordes, se répand sur ses
traits vert de mer ; il est trop évident pour lui qu'il doit y avoir une Saint-Barthélemy de patriotes et que dans
vingt-quatre heures il ne sera pas en vie. Ces horribles appréhensions de
l'âme, on les lui entend exprimer chez Pétion, et c'est un témoin digne de
foi, c'est madame Roland elle-même, elle que nous avons vue, l'année
dernière, radieuse à la Fédération de Lyon, qui les raconte. Depuis quatre
mois les Roland sont venus à Paris, arranger avec les comités de l'Assemblée
les affaires municipales de Lyon, affaires toutes plongées dans le déficit,
se mettre en rapport en même temps, comme c'était tout naturel, avec les
meilleurs patriotes que l'on y peut trouver, avec nos Brissot, nos Pétion,
nos Buzot, nos Robespierre, qui avaient l'habitude
de venir chez nous, dit la belle hôtesse, quatre
fois par semaine. Eux tous, courant çà et là, plus affairés que jamais
ce jour-là, auraient volontiers réconforté l'homme vert-de-mer. On parle du
placard d'Achille du Châtelet ; d'un journal qui s'appellera le Républicain ;
de préparer à la république les esprits des hommes. — Une république ? — dit le Vert-de-Mer,
avec un de ses sourires secs, âpres, et pas du tout folâtres, qu'est-ce que c'est que ça ? Ô Vert-de-Mer, l'incorruptible, tu le verras ! V. — LA BERLINE NEUVE.Mais pendant ce temps-là, les estafettes et les aides de camp avaient marché plus vite que les diligences de cuir. Le jeune Romœuf, comme nous l'avons dit, était parti bien vite dans la direction de Valenciennes ; d'insensés villageois le saisissent comme un traître, qui avait un de ses doigts dans le complot, et le ramènent à l'hôtel de ville, puis à l'Assemblée nationale, qui lui accorde en hâte un nouveau passeport. Pourtant alors, ce même épouvantail d'un marchand de légumes avec son âne, l'a avisé de la grande berline neuve, vue dans la forêt de Bondy, et lui en a fourni la preuve[14]. Romœuf, muni d'un nouveau passeport, est expédié à bride abattue sur une piste plus heureuse : par Bondy, Claye et Châlons vers Metz, pour suivre à la trace la berline neuve, et il galope à franc étrier. Misérable berline neuve ! Pourquoi la royauté n'avait-elle pu s'en aller dans quelque vieille berline semblable à celle de tout le monde ? Quand on fuit pour sauver sa vie, on ne dispute pas sur le choix de son véhicule. Monsieur, dans un banal carrosse de voyage, s'est échappé vers le nord ; Madame, sa femme, dans une autre, sur une autre route : ils se croisent à un relais, sans faire semblant de se reconnaître, et ils atteignent la Flandre, sans que personne les interroge. Précisément de la même manière et à la même heure, la belle princesse de Lamballe se met en route, et elle arrivera saine et sauve en Angleterre. — Plût à Dieu qu'elle y fût restée ! La belle, la bonne, l'infortunée qu'attendait une si terrible fin ! Ainsi tout se sauve, vite, sans être inquiété, excepté la berline neuve : énorme véhicule de cuir, — énorme galère, dirons-nous, avec sa pesante chaloupe représentée par la chaise à deux chevaux qui suivait derrière ; avec ses trois canots de courriers, gardes du corps à cheval, se balançant sans utilité autour d'elle pour l'égard, plutôt que pour la guider ! Elle se traîne péniblement à pas de colimaçon, toujours aux aguets, remarquée de tout le monde. Les courriers gardes du corps, sous leurs livrées jaunes, vont caracolant et claquant ; loyaux mais stupides, ignorants de toutes choses. On s'arrête ; une roue se casse, que l'on doit réparer à Étoges. Le roi Louis aussi veut descendre, veut gravir à pied les collines et jouir d'un magnifique lever de soleil ! Avec onze chevaux, de doubles pourboire et tous les secours de la nature et de l'art, on trouvera que la royauté, fuyant pour sa vie, fait soixante-neuf milles en vingt-deux heures ! Paresseuse royauté ! Et pourtant il n'est pas une minute de ces heures-là qui ne soit précieuse : c'est à des minutes que tiennent maintenant les destinées de la royauté. Les lecteurs peuvent donc juger en quelle humeur le duc de Choiseul attendait d'heure en heure, au village de Pont-de-Sommeville, quelques lieues au delà de Châlons, alors que déjà le soleil penchait visiblement vers le couchant. Choiseul était parti de Paris, dix heures avant le temps fixé par Leurs Majestés ; ses hussards, commandés par l'ingénieur Goguelat, doivent se trouver ici, sous le prétexte d'escorter un trésor qui est attendu. Mais les heures se passent, et pas la moindre berline d'aucune baronne de Korff. En réalité, dans toute cette région nord-est sur la lisière de la Champagne et de la Lorraine, où court la grande route, l'agitation est considérable. Car depuis Pont-de-Sommeville, en remontant vers le nord-est, jusqu'à Montmédy, on voit à tous les relais, dans les villes et dans les villages, des escortes de hussards et de dragons planer dans l'attente ; c'est un véritable train ou une chaîne d'escortes militaires, à l'extrémité de laquelle se trouve notre brave Bouillé ; une chaîne de tonnerres électriques, que l'invisible Bouillé, comme un père Jupiter, tient dans sa main pour de sages desseins ! Le brave Bouillé a fait tout ce qu'un homme pouvait faire, il a développé sa chaîne électro-fulminante d'escortes militaires jusqu'aux portes de Châlons : elle n'attend que la berline neuve de Korff ; pour la recevoir, l'escorter, et s'il en est besoin, l'emporter dans le tourbillon du feu militaire. Comme nous l'avons dit, ils sont là, ces braves troupiers, flânant, attendant ; depuis Montmédy et Stenay, par Clermont et Sainte-Menehould jusqu'à Pont-de-Sommeville, dans tous les villages de poste, car on doit éviter Verdun et les grandes villes. Ils flânent impatients de voir arriver le trésor. Jugez quel jour c'est pour ce brave Bouillé : peut-être le premier jour d'une nouvelle et glorieuse vie ; assurément le dernier jour de l'ancienne ! Quel jour aussi et surtout, quel jour beau et terrible pour vos jeunes capitaines au sang chaud : votre Dandoins, votre comte de Damas, votre duc de Choiseul, votre ingénieur Goguelat et les autres dépositaires du secret ! Hélas ! le jour penche de plus en plus vers le couchant ; et aucune berline de Korff n'est en vue. Les capitaines royalistes errent dans les rues des villages, regardent souvent dans la direction de Paris, avec une apparente insouciance qui cache les plus sombres préoccupations. Les rigoureux quartiers-maîtres ont bien de la peine à interdire aux simples dragons les cafés et les cabarets[15]. Apparais, pour dissiper notre égarement, ô toi, berline neuve ; apparais sur nous, ô toi, chariot du soleil d'une berline neuve, qui porte les destinées de la France ! C'était Sa Majesté qui avait commandé cette série d'escortes ; l'imagination royale avait vu un gage de sécurité et de délivrance dans ce qui ne devait être, en réalité, qu'un sujet d'alarmes, et qu'une source de dangers sans fin là où il n'y avait d'ailleurs aucun danger. Chaque patriote, en effet, dans ces relais de poste, se demande naturellement : Ce tapage de cavalerie, ces allées et venues de troupes, qu'est-ce que cela signifie ? Pour escorter un trésor ? Pourquoi une escorte quand aucun patriote n'est capable de rien enlever à la nation ; et puis où est-il donc votre trésor ? Il y a eu tant de marches et de contre-marches ! car, par une autre fatalité, plusieurs de ces escortes étaient arrivées dès hier, le 19 du mois et non le 20, étant le jour primitivement fixé que Sa Majesté, par je ne sais quelle nécessité, avait trouvé bon de changer. Et maintenant considérez la nature soupçonneuse des patriotes qui se méfient, par-dessus tout, de Bouillé l'aristocrate, et comme cette humeur aigre et inquiète a eu le temps de s'accumuler et de s'irriter pendant vingt-quatre heures ! A Pont-de-Sommeville, ces quarante hussards étrangers de Goguelat et du duc de Choiseul deviennent pour tout le monde un inexplicable mystère. Ils ont flâné assez longtemps déjà à Sainte-Menehould ; assez flâné, assez musé pour que nos volontaires nationaux de l'endroit, surexcités au dernier point par l'inquiétude, aient demandé et obtenu trois cents fusils de leur hôtel de ville. Précisément à la même heure, le hasard voulut que notre capitaine Dandoins arrivât de Clermont avec sa troupe, à l'autre bout du village ; une troupe nouvelle assez alarmante, bien que ce ne fût heureusement que des dragons et des Français ! De sorte que Goguelat, avec ses hussards, n'eut qu'à décamper, et bien vite encore, jusqu'à ce qu'il trouvât ici, à Pont-de-Sommeville, où déjà attendait Choiseul, un lieu de repos. Lieu de repos comme sur un marbre brûlant. Car le bruit de son arrivée se répand au loin, et les citoyens courent çà et là, en frayeur et en colère : Châlons envoie en exploration de ce côté des piquets de volontaires nationaux qui rencontrent d'autres piquets explorateurs venant de Sainte-Menehould. Qu'est-ce donc, ô hussards à favoris, à l'accent guttural étranger ; au nom du ciel, qu'est-ce donc qui vous amène ? un trésor. — Les piquets explorateurs secouent la tête. Les paysans affamés cependant, savent trop bien de quel trésor il s'agit : c'est une saisie militaire pour les redevances féodales qu'aucun bailli ne pourrait nous faire payer ! Ils le savent bien ; et ils se mettent à faire tinter leur cloche paroissiale en guise de tocsin : avec quel rapide effet, Choiseul et Goguelat, s'ils ne veulent pas que le pays entier prenne feu, doivent forcément, qu'il y ait une berline ou pas de berline, seller et chevaucher. Ils montent à cheval, et ce tocsin de la paroisse cesse immédiatement. Ils marchent lentement vers l'est, vers Sainte-Menehould, espérant encore que le chariot du soleil d'une berline pourra les attendre. Hélas ! Pas de berline ! Et bien proche, maintenant, est cette Sainte-Menehould, qui nous a chassés ce matin avec ses trois cents fusils nationaux, et qui peut-être ne regarde pas avec une excessive tendresse le capitaine Dandoins et ses nouveaux dragons, bien qu'ils soient Français, et dans laquelle, en un mot, on n'ose pas entrer une seconde fois, sous peine d'explosion ! Le cœur assez triste, notre parti de hussards appuie sur la gauche, par les chemins détournés à travers les bois et les collines non-frayés, évitant Sainte-Menehould et toutes les localités qui les ont vus jusqu'ici, ils iront directement jusqu'au village éloigné de Varennes. Il est probable qu'ils auront à faire, cette nuit, une rude course. Ce premier poste militaire, dans la longue chaîne de tonnerres, s'en est donc allé sans résultat, ou plutôt avec un résultat déplorable, et votre chaîne menace de s'enchevêtrer elle-même ! La grande route, cependant, est redevenue silencieuse et dans une sorte de quiétude des plus éveillées. Aucun quartier-maître ne peut interdire aux indolents dragons le cabaret où les patriotes boivent et les font boire pour apprendre d'eux des nouvelles. Les capitaines, dans un état d'apparente distraction, battent la grande route poudreuse avec un visage indifférent, et aucun chariot du soleil n'apparaît. Pourquoi tarde-t-il ? Il est incroyable qu'avec onze chevaux, et de tels courriers jaunes, et tout ce qui s'ensuit, sa vitesse soit au-dessous de celle d'une charrette ordinaire ne faisant que trois milles par heure. Hélas ! on ne sait même pas à quelle heure elle a quitté Paris, et cependant on ne sait pas davantage pourquoi elle n'est pas encore au bout du village ! Les cœurs ont atteint le dernier degré de l'inquiétude la plus anxieuse. VI. — LE VIEUX DRAGON DROUET.Sur ces entrefaites, le jour a baissé. Les mortels, fatigués du travail des champs, se traînent vers leurs chaumières. L'artisan du village mange avec contentement sa soupe aux herbes, ou rôde dans la grande rue du bourg à la recherche d'un peu d'air et de nouvelles intéressantes. C'est une soirée d'été splendide ! Le soleil majestueux se suspend flamboyant à l'horizon, car c'est le plus long jour de l'année, et les sommets des collines voisines se colorent d'une teinte rougeâtre. Dans les sentiers fleuris, le long des buissons touffus, la grive lance à coups redoublés sa joyeuse sérénade qui lutte contre le murmure du ruisseau. Le silence plane sur la terre. Le moulin de Valmy, couvert de poussière comme tous les moulins du monde, arrête son travail et cesse de faire jaillir l'eau sous sa roue ; les ouvriers fatigués .remettent leur travail au lendemain et flânent en groupes, comme nous l'avons dit, dans le village, les uns debout, les autres assis sur des bancs de pierres[16], pendant que leurs enfants, petits lutins pleins de malice, folâtrent à leurs pieds. Un bourdonnement insaisissable de voix humaines s'élève du village de Sainte-Menehould, comme de tous les villages. Mais tous ces commérages sont ordinairement sans importance, car les dragons qui sont là en garnison sont Français et galants. Tout à coup la gaieté disparaît quand arrive la lourde diligence de Paris à Verdun, qui fond sur le village comme pour terrifier l'esprit des habitants. Nous devons maintenant parler d'un personnage habitant la dernière maison du bourg. Ce personnage, enveloppé d'une longue robe de chambre, est Drouet, le maître de poste, homme irascible et emporté, à l'aspect effrayant, encore dans la fleur de l'âge, quoiqu'il ait déjà servi dans les dragons de Condé. Ce jour-là, depuis le matin, Drouet ne dérageait pas. Le hussard Goguelas avait trouvé bon, par économie, de s'arranger, pour avoir un cheval de cabriolet, avec son aubergiste et non avec Drouet, maître de poste ordinaire, à propos de quoi Drouet, en colère, était venu trouver l'aubergiste et ne voulait pas entendre raison. Ce devait être un jour de mécontentement perpétuel, car Drouet était un féroce patriote qui avait assisté à Paris à la fête des Piques. Et que signitiait la présence de ces soldats de Bouille ? Les hussards et leur maudit cabriolet étaient partis immédiatement lorsque Dandoins et ses dragons étaient arrivés de Clermont ; dans quel but ? Et Drouet en se répétant ces choses allait et venait enveloppé de sa longue robe de chambre, lançant autour de lui des regards empreints de cette pénétration malveillante que la colère concentrée donne à l'homme. A l'autre extrémité de la rue était le capitaine Dandoins flânant avec un air de parfaite indifférence, tandis que son cœur était dévoré d'inquiétude et d'impatience, car aucune berline n'apparaissait à l'horizon. Il voyait le soleil s'enflammer de plus en plus avant de disparaître et son cœur était agité d'une crainte inexprimable. Grâce au ciel ! voilà enfin un garde du corps en livrée jaune qui apparaît dans la lueur rougeâtre du crépuscule, éperonnant vigoureusement son cheval. Reste calme, Dandoins, garde ton air de profonde indifférence, pendant que ce maladroit, tout fier de sa livrée jaune, met le village en émoi et s'informe de l'endroit où est la poste. Enfin la lourde berline avec sa montagne de bagages arrive pesamment, suivie d'une chaise de poste plus légère. Un des immenses vaisseaux d'Acapulco, suivi de ses petites barques, eût été plus prompt. Les villageois ouvraient des yeux émerveillés comme cela arrivait chaque fois qu'une voiture de voyage passait dans le pays. Les dragons, flânant dans la rue, mettaient tous la main à leur casque, tant cette belle livrée jaune leur inspirait de respect ; et du fond de la voiture, une dame coiffée d'un chapeau de bohémienne, leur rendait leurs saluts avec cette grâce qui lui était particulière[17]. Dandoins restait là les bras croisés avec cet air de dédaigneuse indifférence qu'affecte souvent un homme au moment même où son cœur bat à rompre sa poitrine. Il frisait dédaigneusement ses moustaches, et, d'un regard plein de nonchalance, il surveillait de près les groupes de villageois dont l'attitude lui déplaisait. Ses regards, dirigés vers le courrier, semblaient lui dire : Hâtez-vous ! hâtez-vous ! Mais le stupide postillon ne comprenait rien au langage des yeux ; et il avançait lentement, le village entier les regardait. De son côté, le maître de poste Drouet était fort attentif. Il allait et venait, toujours enveloppé de sa longue robe de chambre, et fourrait le nez partout. Quand, à un moment donné, les facultés d'un homme sont aiguisées par la colère, elles deviennent plus perspicaces. Cette dame, avec son chapeau de bohémienne rabattu sur les yeux, ne ressemble-t-elle pas, quoique assise dans cette voiture, à une autre dame qu'il a vue quelque part autrefois, à la fête des Piques ou ailleurs ? Et cette grosse tête en chapeau rond et en perruque qu'on voit de temps en temps au fond de la voiture, il lui semble la reconnaître. ? et vite, sieur Guillaume, clerc du Directoire, apportez-nous un nouvel assignat ! Drouet examine minutieusement cet assignat, il compare la figure gravée sur le papier monnaie à cette grosse tête en chapeau rond, qu'il voit dans la voiture. Par le jour et la nuit ! on jurerait que l'une est calquée sur l'autre ! et ces mouvements de troupes, ces flâneries et ces chuchotements... je vois ce que c'est ! Drouet, maître de poste de ce village, ardent patriote, vieux dragon de Condé, considère maintenant ce que tu as à faire. Et vivement, car, vois, la nouvelle berline est lestement attelée, le fouet claque et elle roule. Drouet n'ose pas, dans l'émotion du moment, saisir les brides dans ses deux mains, Dandoins les lui trancherait d'un coup d'épée. Les nationaux ne sont. pas tous là, ils ont trois cents fusils, mais pas de poudre, et d'ailleurs ils ne sont pas tous parfaitement sûrs. Drouet, en vieux dragon de Condé, fait ce qu'il y a de plus sage ; il parle en secret au clerc Guillaume, qui est, lui aussi, un ancien dragon de Condé, et pendant que Guillaume selle deux de leurs meilleurs chevaux, il se glisse furtivement jusqu'à la tour de la ville où il prévient tout bas de ce qu'il sait ; puis monte à cheval avec le clerc Guillaume et tous deux s'élancent sur la route. Ils dévorent l'espace au galop de leurs deux chevaux, pendant que de la tour la nouvelle se répand dans le village où tout le monde chuchote avec animation. Hélas l le capitaine Dandoins ordonne à ses dragons de monter à cheval, mais eux se plaignant d'un long jeûne, demandent d'abord du pain et du fromage. Avant que ce frugal repas soit terminé, le village entier sait l'événement. On ne chuchote plus, on crie, on vocifère. Les volontaires nationaux demandent à grands cris de la poudre. Les dragons hésitent entre le patriotisme et la consigne, entre le pain et le fromage et les baïonnettes qui les menacent. Dandoins donne secrètement au quartier-maître son portefeuille où sont les dépêches secrètes, pendant que les garçons d'écurie eux-mêmes s'arment avec des fourches et des fléaux. Le brave quartier-maître s'élance à cheval, et, le sabre à la main, se fraye une route au milieu des baïonnettes menaçantes, malgré les vociférations des patriotes et les coups de fourches et de fléaux[18]. Il éperonne son cheval avec frénésie et s'éloigne, suivi seulement de quelques-uns de ses soldats, les autres étant d'accord pour rester. Et pendant tout ce temps la berline poursuit sa route. Drouet et Guillaume galopent après elle et la troupe de Dandoins galope après ces derniers. Sainte-Menehould et plusieurs lieues de pays sur la route royale sont déjà en ébullition et toute la chaîne de troupes royales est dans une excitation qui fait craindre la plus terrible issue. VII. — LA NUIT DES ÉPERONS.Tout cela était le résultat de ces escortes mystérieuses et de cette berline à douze chevaux qui éveillait l'attention. Celui qui a un secret ne doit pas seulement le cacher, mais encore dissimuler qu'il a à le cacher. La division s'était mise dans la première escorte militaire, les autres l'avaient imitée, et tout le pays mis en éveil se révoltait avec un bruit comparable à celui du tonnerre. Comparable plutôt aux premiers symptômes d'une avalanche alpestre qui, une fois lancée, grossit, grossit toujours. De Sainte-Menehould à Stenai elle avançait bondissante et furieuse, semant la ruine sur son passage et entraînant à la fois dans l'abîme les patriotes, les paysans les escortes militaires, la fameuse berline et la royauté. Les ombres épaisses de la nuit enveloppent la terre. Les postillons font claquer leur fouet. La berline royale traverse Clermont, où le colonel, comte de Damas, lui jette en passant quelques mots à voix basse, et elle poursuit sa route vers Varennes avec toute la rapidité que peut donner la promesse d'un double pourboire. Tout à coup un inconnu à cheval jette précipitamment à la portière ouverte quelques mots inintelligibles, puis disparaît dans l'ombre de la nuit[19]. Les augustes voyageurs palpitent ; mais bientôt la nature épuisée reprend ses droits et ils s'abandonnent à un demi-sommeil. Hélas ! Drouet et le clerc Guillaume galopent toujours, prenant les chemins de traverse pour plus de sûreté et répandant partout la nouvelle, qui vole comme portée sur les ailes d'un oiseau ! Et l'énergique quartier-maître galope aussi, faisant sonner partout de la trompette, réveillant à Clermont les dragons endormis. Le brave colonel de Damas en a déjà fait monter plusieurs à cheval, le jeune cornette Rémy les entraîne avec lui ; mais les magistrats, patriotes zélés, sont prévenus aussi ; la garde nationale demande à grands cris des cartouches, le village s'illumine, les patriotes sautent à bas de leurs lits, hommes et femmes en chemise allument, les uns une chandelle d'un sou, les autres un sordide de lampion jusqu'à ce que tout soit en lumière, tant ils sont pressés. C'est une camisado, un tumulte en chemise. Le tocsin sonne à toute volée, les tambours de village battent la générale avec frénésie, les patriotes en démence crient et menacent. Le jeune et brave colonel de Damas, au milieu du vacarme de ce patriotisme insensé, adresse quelques paroles brûlantes aux troupes qu'il commande. On a insulté vos camarades à Sainte-Menehould, le roi et le pays en appellent aux braves ! Puis il donne l'ordre de tirer les sabres. Hélas ! les soldats, la main sur la poignée, refusent de s'en servir. Que ceux qui sont pour le roi me suivent ! crie Damas au désespoir, et il part au galop au milieu de l'obscurité, accompagné seulement de deux soldats subalternes[20]. Nuit sans exemple à Clermont, la plus courte de l'année, la plus remarquable du siècle ; nuit qui mérite le nom de nuit des éperons ! Le cornette Rémy et le peu d'hommes qui l'avaient suivi s'étaient trompés de route ; ils galopèrent des heures entières du côté de Verdun, à travers les haies, les bois et les villages, cherchant à atteindre Varennes. Malheureux cornette Rémy, plus malheureux colonel de Damas, que deux hommes désespérés avaient seuls accompagné. Le reste de l'escorte de Clermont avait refusé de le suivre, et dans les escortes des autres villes, il ne s'en était pas même trouvé deux qui prissent les armes pour le roi ; tous courbaient la tête et refusaient de marcher, retenus par le tocsin et par l'enthousiasme universel. Et Drouet galopait toujours et le clerc Guillaume aussi, et tout le pays après eux. Goguelas et le duc de Choiseul plongeaient dans les marécages, bondissaient par-dessus les rochers, les palissades et les pierres, dans les bois touffus du Clermontois, tous, perdant la route et la retrouvant tour à tour. Les hussards se culbutant dans un fossé et y restant enfouis pendant trois quarts d'heure sans que les autres voulussent consentir à marcher sans eux. Une nuit entière de cheval depuis Pont-de-Sommeville ! Il y a trente heures que le duc de Choiseul a quitté Paris, accompagné de Léonard, le valet de chambre de la reine ! L'inquiétude galope après eux ; ils vont, ils vont toujours, tombant et se relevant sans cesse, éveillant les oiseaux dans leurs nids de feuillage, mâchant des herbes odoriférantes, écrasant sous leurs pieds les calices humides de la reine des prés, troublant le sommeil de la nuit. Mais écoutez ! vers une certaine heure qui doit être minuit, puisque les étoiles même ont disparu du ciel, ils entendent le tocsin du côté de Varennes. Retenant son cheval, l'officier de hussards écoute : C'est un incendie sans doute, dit-il, et, doublement inquiets, ils repartent à fond de train, pour s'assurer de la vérité. Oui, généreux amis, redoublez d'efforts, car c'est un incendie, en effet, mais bien difficile à éteindre ! La berline de madame de Korff, devançant toujours cette avalanche de cavaliers, a atteint, heureusement vers onze heures, le misérable petit village de Varennes, en dépit de l'avertissement donné par cet inconnu à cheval. Maintenant toutes les villes sont dépassées, Verdun est évité sur la droite, Bouillé lui-même est tout près d'eux et la profonde obscurité d'une nuit d'été les favorise ! Ils s'arrêtent sur le sommet d'une colline à l'extrémité sud du village, attendant leurs relais, que le jeune Bouillé, le fils' même du général, à la tête d'une escorte de hussards, doit leur tenir prête, car il n'y a pas de poste dans le pays. L'effroi les saisit ! Il n'y a là ni chevaux ni hussards. Les chevaux, qui appartiennent au duc de Choiseul, sont sans doute à manger l'avoine, mais dans le haut du village, de l'autre côté du pont, et on ne sait où les trouver. Les hussards doivent attendre aussi, mais ils sont sans doute à boire dans les cabarets environnants. La vérité est que les voyageurs ont six heures de retard. Le jeune Bouillé, encore enfant et assez niais du reste, pensant que l'affaire ne doit pas avoir lieu cette nuit-là, est allé se coucher ; et voilà nos courriers jaunes, ne connaissant pas le pays, obligés de le parcourir en tous sens, s'informant, criant, éveillant tout le village endormi. Les postillons ne veulent à aucun prix continuer la route avec des chevaux fatigués, au moins pas avant de les avoir fait manger, et cela en dépit de tous les raisonnements du soi-disant valet de chambre en chapeau rond. Malheureux, il y a trente-cinq minutes à la montre du roi que la berline est arrêtée. L'inconnu en chapeau rond discute avec les postillons aux longues bottes, les chevaux fatigués dévorent leur avoine, les courriers s'informent. et pendant tout ce temps le jeune Bouillé dort profondément dans le haut du village, et le bel attelage du duc de Choiseul est à l'écurie dans la même maison. Aucun secours n'est à espérer, la fortune d'un roi n'y pourrait rien ; les chevaux dévorent, le chapeau rond discute, Bouillé dort. Et maintenant écoutez. Dans l'ombre de la nuit résonnent les pas de deux chevaux harassés ; leurs cavaliers les arrêtent un instant pour reconnaître l'immense berline qui encombre la route, puis, les éperonnant de nouveau, ils repartent, bride abattue, du côté du village. C'est Drouet et le clerc Guillaume ! Ils sont encore en avant de ce pêle-mêle de cavaliers qui les poursuivent, et sans blessures, quoiqu'on ait plusieurs fois tiré sur eux, car c'est une tâche périlleuse que celle de Drouet. Mais c'est un vieux dragon que sa présence d'esprit n'abandonne jamais. Varennes est sombre et silencieux. C'est un village accidenté bâti dans un ravin. Le sommeil est partout et le flot de la rivière d'Aire chante doucement comme pour bercer ce village endormi. Néanmoins, au cabaret du Bras-d'Or, en haut de ce talus qui est la place du marché, on aperçoit encore une lumière humaine ; on y entend les voix de quelques rudes conducteurs de bestiaux qui n'ont pas encore bu le coup de l'étrier ; Boniface Le- blanc, revêtu de son tablier blanc, et tout heureux de les regarder, leur sert à boire. Drouet entre dans le cabaret, puis, prenant Boniface à part et le regardant dans le blanc des yeux : Camarade, es-tu bon patriote ? lui dit-il. Si je le suis ! répond Boniface. En ce cas, lui dit vivement Drouet à l'oreille... et le reste de la phrase fut entendu de Boniface seulement[21]. Et maintenant voyez Boniface Leblanc se hâtant comme il ne l'a jamais fait pour les plus joyeux buveurs ; voyez Drouet et le clerc Guillaume, jetant en un clin d'œil en travers du pont une voiture de meubles qu'ils ont trouvée là. Ils entassent les chariots, les barils, les tombereaux, les brouettes, tout ce qui leur tombe sous la main, jusqu'à ce qu'il soit impossible à une voiture de passer. Puis, le pont barricadé, ils se placent en avant, sous une voûte qui y conduit, accompagnés de Leblanc, de son frère et de un ou deux autres patriotes zélés que Leblanc est allé réveiller. Puis, au nombre de six environ, armés de mousquets, ils attendent en silence que la berline arrive. Elle se montre enfin. Halte-là ! Des lanternes sortent de dessous les blouses, des poignets vigoureux saisissent la bride des chevaux, un mousquet apparaît à chaque portière de la voiture : Mesdames, vos passeports ? Hélas, hélas ! le sieur Sausse, procureur de la commune et en même temps fabricant de chandelles et épicier, est là, tout rempli d'une politesse officielle ; Drouet, avec sa farouche logique et sa présence d'esprit habituelle : Les respectables voyageurs, dit-il, que ce soit la baronne de Korff, ou des personnes de plus haute importance, seront peut-être bien aises de se reposer dans la maison de M. Sausse, jusqu'à ce que le jour se lève. Ô Louis ! ô infortunée Marie-Antoinette, condamnée à passer ta vie avec de tels hommes ! Impassible Louis ! Il n'y a donc en toi que de l'indolence et de la mollesse ? roi, général, souverain de France ! si jamais tu as eu un cœur, si jamais tu as senti bouillonner en toi un peu de courage et de fierté, c'est maintenant qu'il faut le montrer ou jamais. Infâmes brigands ! et quand ce seraient des voyageurs de haute importance, quand ce serait le roi lui-même, est-ce que le roi n'a pas le droit qu'ont tous les mendiants du royaume de voyager sans obstacle sur ses routes ? Oui, c'est le roi et tremblez de l'apprendre, car le roi vous menace, et en France comme partout ailleurs au-dessous du trône de Dieu, aucun pouvoir ne balance le sien ! le Roi ne restera pas vivant sous cette misérable voûte ; il passera ou vous le tuerez, et vous aurez à répondre de sa mort devant Dieu et devant les hommes ! A moi mes gardes du corps et mes postillons, en avant ! On peut s'imaginer ce qui aurait suivi. Les frères Leblanc eussent été paralysés, Drouet condamné au silence, et le procureur Sausse aurait disparu aussi promptement qu'une chandelle fond dans une fournaise ardente. Louis continuait son chemin, en quelques minutes il éveillait le jeune Bouillé, les relais, les hussards, faisait dans Montmédy une entrée triomphante au milieu de son escorte, le sabre au poing, et l'histoire entière de la France était changée. Hélas ! il n'était pas dans la nature de cet homme indolent d'agir ainsi, et si cela eût été dans sa nature, il ne serait pas venu jusque sous cette voûte de Varennes pour décider du sort de la France. Il sortit de la voiture, tout le monde le suivit. Le procureur Sausse offrit son bras d'épicier à la Reine et à madame Élisabeth, le roi prit ses deux enfants par la main, et ils traversèrent ainsi la place du Marché, pour aller chez Sausse, le procureur ; ils montèrent dans son petit logement et, à peine arrivés, le Roi demanda à manger. Je vous le dis comme cela est. Il mangea du pain et du fromage, but une bouteille de bourgogne, et remarqua que c'était le meilleur qu'il eût goûté de sa vie ! Pendant ce temps, les notables de Varennes et tous les autres habitants passaient leurs pantalons et revêtaient leurs uniformes de gardes nationaux. Des gens à demi habillés roulaient des tonneaux, abattaient des arbres, les autres allaient en éclaireurs sur les routes. Le tocsin sonnait, le village s'illuminait. Il est singulier de voir avec quelle entente et quelle promptitude tous ces petits villages agissaient lorsqu'ils étaient réveillés par le cri d'alarme. Ils se dressaient tout à coup semblables à des serpents à sonnette réveillés en sursaut. Les cloches sonnaient à toutes volées, les yeux des habitants étincelaient — à la lumière des chandelles — comme ceux du serpent dans un transport de rage ; le village tout entier était prêt à mordre. Le vieux dragon Drouet, vaillant comme un Ruy-Blas, était l'ordonnateur, le généralissime. — Soyez bons patriotes ! s'écrie-t-il, car une armée approche. Des Autrichiens, des aristocrates veulent vous massacrer ! C'est plus qu'une guerre civile, et le résultat dépend de vous ! Aussitôt les gardes nationaux, à peine boutonnés, se mettent en rang ; les autres, avons-nous dit, roulent des barriques, abattent des arbres, les hommes en pantalons, les femmes en jupons courts. En un clin d'œil le village est barricadé. La démocratie forcenée ne règne donc pas seulement à Paris ? Non, quoi qu'en disent les courtisans. Cela n'est que trop clair maintenant. Autrefois on mourait pour son roi, maintenant on meurt pour sa liberté, même en combattant contre le roi si cela est nécessaire. Et ainsi cette avalanche de cavaliers a atteint l'abîme. La berline royale y est précipitée la première et sans espoir d'en sortir jamais. Avons-nous besoin de dire que pendant les six heures qui suivirent, on n'entendit partout que le bruit du tocsin ? Un tumulte effroyable régnait dans tout le Clermontois et s'étendait à la ronde. Les dragons et les hussards galopaient sur les routes, et, à travers champs, les gardes nationaux s'armaient au milieu de la nuit, une cloche après l'autre transmettait l'alarme. Goguelas et Choiseul, à la tête de leurs hussards fatigués, atteignent enfin Varennes. Ah ! il n'y a pas d'incendie, ou du moins c'en est un bien difficile à éteindre ! Malgré les efforts de la garde nationale, ils franchissent les barricades formées d'arbres renversés, ils entrent dans le village. Choiseul harangue ses soldats, qui lui répondent, dans leur dialecte guttural, Der Konig ; die Koniginn ! et semblent résolus à se battre. Ils cernent la maison du procureur. C'était la première chose à faire ; mais Drouet, d'une voix tonnante, donne l'ordre contraire : Canonniers, à vos pièces ! s'écrie-t-il dans cette extrémité. Alors on voit s'avancer quelques vieilles pièces de campagne ne contenant autre chose que des toiles d'araignées. Leur bruit sourd et la contenance assurée des canonniers qui les amènent suffisent pour abattre l'ardeur des hussards et les faire reculer. Quelques cruches de vin qu'on fait circuler dans les rangs, car des bouches allemandes n'y sont pas insensibles, achèvent la conversion, et quand une heure après l'ingénieur Goguelas arriva, on l'accueillit par des cris avinés de : Vive la Nation ! Qu'arrive-t-il alors ? Goguelas, Choiseul, le comte de Damas et toutes les autorités de Varennes sont avec le roi ; mais le roi ne donne aucun ordre, n'émet même pas une opinion. Il reste là, assis tranquillement comme à son ordinaire, semblable à l'argile sur la roue du potier ; c'est peut-être la plus absurde de toutes les pitoyables figures qui font cercle autour de la maison au clair de lune. Avec la permission de Sausse, il doit prendre avec lui la garde nationale et continuer son chemin le lendemain matin. Malheureuse reine ! ses deux enfants dorment sur un misérable lit. La vieille mère Sausse, tout en larmes, supplie à haute voix le Seigneur de bénir la royale famille. La fière Marie-Antoinette est à genoux entre madame Sausse et son fils, au milieu des boîtes de chandelles et des barils de mélasse, mais c'est en vain qu'elle prie. Il y a trois mille gardes nationaux autour d'elle, et, avant peu, il y en aura dix mille. Car les sons du tocsin répandent l'alarme aussi vite que le feu dévore les herbes sèches, plus vite peut-être. Le jeune Bouillé, réveillé enfin par le tocsin de Varennes, avait pris un cheval... et s'était sauvé prévenir son père. Du même côté, était parti, bride abattue, un certain sieur Aubriot, officier d'ordonnance du duc de Choiseul, passant la rivière à la nage, le pont étant barricadé, et galopant comme s il avait eu tout l'enfer sur les talons[22]. Il traversa le village de Dun en répandant l'alarme. Là, le brave capitaine Deslons et son escorte composée de cent hommes sellèrent leurs chevaux et partirent. Deslons entre seul dans Varennes, laissant ses hommes en dehors de la première barricade. Il offrit d'enlever le roi, si celui-ci en voulait seulement donner l'ordre, mais malheureusement il ajouta que l'affaire serait chaude. Sur quoi Louis répondit qu'il n'avait pas d'ordre à donner[23]. Et le tocsin sonnait toujours, et cette course effrénée de dragons n'avait amené aucun résultat. Les gardes nationaux fondaient sur le village comme une nuée de corbeaux. La terrible nouvelle, l'avalanche bondissante, avaient atteint Stenai et était parvenue jusqu'à Bouillé. Le brave Bouillé, ce fils de la tempête, fait monter à cheval le régiment Royal-Allemand. Il adresse à ses soldats quelques paroles brûlantes qui enflamment leur courage, puis il leur fait distribuer 25 louis d'or par compagnie, et il part. Va, Royal-Allemand, si célèbre déjà ! Il ne s'agit plus de se rendre aux Tuileries ou de suivre en procession les bustes de Necker et du duc d'Orléans ! Un roi lui-même est captif, et le monde est en jeu ! Telle a été cette nuit qui mérite d'être appelée la nuit des éperons. A six heures, deux événements s'étaient produits. M. de Romeuf, aide de camp de Lafayette, galopant à franc étrier sur cette vieille route et se hâtant de plus en plus, était arrivé à Varennes, au moment où les dix mille gardes nationaux, dans le paroxysme d'une terreur panique, demandaient à grands cris que le roi retournât immédiatement à Paris pour éviter toute effusion de sang. Dans le même moment, Tom, le jockey anglais du duc de Choiseul, conduisant à fond de train les chevaux de relai du duc, rencontrait Bouillé sur les hauteurs de Dun. Tom répondit comme il put à cette brève question : Que se passe-t-il à Varennes ? Et en retour il demanda ce que, lui, Tom, devait faire des chevaux de M. de Choiseul et où il devait aller ? Au fond de cet étang, répondit Bouillé d'une voix tonnante. Puis, éperonnant son cheval, il fit mettre Royal-Allemand au galop, et disparut en jurant[24]. Ce fut le dernier effort de ce brave Bouillé. Arrivé devant Varennes, il arrêta son cheval et réunit ses officiers en conseil ; mais il était trop tard, ils virent que tout effort serait désormais inutile. Le roi Louis avait consenti à partir, au milieu des clameurs universelles, au milieu de dix mille hommes armés, pendant que soixante mille autres affluaient de tous côtés. Le brave Deslons même, sans avoir reçu d'ordre, s'était précipité dans la rivière, à la tête de ses hommes[25]. Ils avaient franchi un bras à hi nage, mais ils ne purent franchir l'autre, et ils restèrent là, fatigués et ruisselants. Sur l'autre rive, les dix mille gardes nationaux leur répondaient par des sarcasmes, et pendant ce temps la berline royale poursuivait lourdement sa route fatale vers Paris, sans espoir dans les hommes, ni même dans le ciel, car le temps des miracles n'est plus ! Cette nuit-là, le marquis de Bouillé et vingt et un des nôtres passèrent les frontières. Les Bernardins d'Orval, dans le Luxembourg, nous donnèrent à souper et nous logèrent pour la nuit[26]. Bouillé avançait sans rien dire, l'esprit trop occupé pour pouvoir parler. Il se dirigeait vers le nord, vers l'incertitude, vers les îles de l'océan Indien, car lui, le fils de la tempête, ne pouvait partager le délire des émigrés, ni agir de concert avec eux. Il se dirigeait vers l'Angleterre, vers une mort prématurée et héroïque ; mais il ne devait plus revoir la France. Honneur au brave qui, dans un parti ou dans l'autre, est la personnification de la valeur humaine et non pas un spectre fanfaron, une ombre criarde et inutile ! Bouillé est un des rares chefs royalistes de ce temps dont on puisse faire un pareil éloge. Le brave Bouillé disparaît donc de notre histoire, histoire qui est la reproduction si faible, si incolore de ce grand et miraculeux tissu d'événements, de cette tapisserie vivante qu'on nomme la Révolution française, laquelle s'est tissée elle-même sur le retentissant métier du Temps ! Les vieux braves s'en vont après bien des efforts, c'est au tour des terribles Drouet d'apparaître. VIII. — LE RETOUR.Ainsi finit le grand complot royaliste. La fuite de Metz. C'était là l'ultimatum des efforts royalistes, il n'aboutit à rien qu'à augmenter le danger et la terreur. Combien de complots royalistes, les uns après les autres, tous habilement conçus, devaient échouer ainsi, éclatant comme une mine de poudre ou comme un coup de tonnerre ! Pas un seul ne devait réussir. Il y avait eu la fameuse séance royale du 23 juin 1789 qui avait échoué, puis renouvelée par Broglie, elle avait amené la prise de la Bastille. Ensuite était venu ce grand repas dans la salle du théâtre à Versailles, où, le sabre à la main, on avait chanté avec enthousiasme : Ô Richard, ô mon roi ! lequel repas, aidé par la famine, avait occasionné l'insurrection des femmes et suscité cette Pallas athénienne, Théroigne de Méricourt. La valeur ne réussissait pas mieux que la fanfaronnade. L'armement de Bouillé finit comme celui de Broglie. Un homme après un autre se dévouait à cette cause, et ses efforts ne faisaient qu'en hâter la ruine ; il semble que ce fût une cause perdue, maudite de Dieu et des hommes. L'année d'avant, le 6 octobre, le roi Louis, escorté par Théroigne et par deux cent mille femmes, faisait dans Paris une entrée triomphale comme on n'en avait jamais vu. Un accueil semblable l'attendait à son retour de Varennes ; mais Théroigne ne devait pas l'accompagner cette' fois, ni Mirabeau non plus, assis dans une des voitures de la suite ; Mirabeau reposait dans les caveaux du Panthéon, et Théroigne languissait dans une sombre prison autrichienne, ayant été arrêtée à Liège. Séparée désormais du monde, elle perdra ce feu qu'elle déployait dans les banquets patriotiques. Elle causera face à face avec l'empereur, et reviendra en France, mais dans quel triste état ! Le Temps, aux longues ailes, renverse dans sa course les petits et les grands, et en deux ans il change bien des choses ! Mais, ainsi que nous l'avons dit, nous avons à parler d'une seconde et triste entrée du roi à Paris. Les sentiments du peuple sont bien changés, quoique des milliers d'hommes se pressent encore pour attendre le cortège royal. Patience, patriotes zélés, la berline royale est en route, mais elle ne sera pas de retour avant samedi, car elle voyage à petites journées, au milieu d'une mer de gardes nationaux, soixante mille hommes environ, et parmi des populations tumultueuses. L'Assemblée nationale avait envoyé trois commissaires au-devant du roi. C'étaient Barnave et Pétion, déjà célèbres tous les deux, et Latour-Maubourg, dont le caractère était généralement estimé. Barnave et Pétion montèrent dans la propre berline du roi ; Latour-Maubourg, homme respectable, dont tout le monde faisait l'éloge, voyagea dans la seconde voiture avec madame de Tourzel et les soubrettes. Donc, le samedi, vers sept heures du soir, tout Paris est sur pied, ne témoignant déjà plus la joie et l'espérance, n'exprimant pas encore la vengeance et la haine, mais en silence, avec une vague préoccupation de l'avenir et une curiosité inquiète. Un placard affiché le matin, dans le faubourg Saint-Antoine, portait ces mots : Quiconque insultera le roi sera battu ; quiconque l'acclamera sera pendu. Des milliers de gardes nationaux, les baïonnettes fixées aux fusils, affluent lentement, semblables au flot qui monte, au milieu de ces centaines de mille hommes silencieux. Là berline arrive. Trois courriers jaunes sont garrottés sur le siège ; Pétion, Barnave, le roi, la reine, Madame Élisabeth et les enfants de France sont dans l'intérieur. Un sourire d'embarras et l'expression d'une tristesse mécontente se peignaient sur le visage du roi, qui se bornait à dire aux autorités se succédant auprès de lui : Eh bien ! me voilà. Cela était bien évident ; mais, ce qui l'était moins, c'était cette autre assertion : Je vous assure que je n'avais pas l'intention de passer les frontières. C'étaient là les discours ordinaires de ce pauvre roi que, par convenance, l'histoire devrait voiler. La reine était silencieuse, son regard exprimait le chagrin et le mépris naturel à cette royale femme. Ainsi se traînait à travers les rues, au milieu d'une foule silencieuse et attentive, cet ignominieux cortège, semblable, dit Mercier[27], à la procession du roi de Basoche, ou roi Crispin, accompagné des ducs de la folie et de la noblesse de la Cordonnerie, excepté, toutefois, qu'il n'y avait là rien de comique. Oh non ! c'était au moins comico-tragique avec ces courriers garrottés sur le siège, et ce jugement fatal planant au-dessus des têtes ! C'était plus fantastique, mais bien plus triste ! le misérable flebile ludibrium d'une tragédie bouffonne. Après avoir ainsi parcouru lentement les rues, couverts de vêtements qui n'avaient rien de royal, au milieu de la poussière d'une soirée d'été, ils disparurent enfin dans le palais des Tuileries, pour y venir attendre un jugement terrible et y subir un long supplice peine forte et dure. La populace, s'emparant des trois courriers jaunes,
voulait les massacrer, mais l'auguste Assemblée qui siégeait en ce moment
envoya une députation pour les délivrer, et la foule s'éloigna en se
bousculant. Barnave, encore tout couvert de poussière, était déjà à
l'Assemblée nationale, - faisant un rapport, aussi bref que discret, de tout
ce qu'il avait vu. En vérité, tout le temps de ce voyage, Barnave avait été
on ne peut plus discret et affable. Il avait gagné la confiance de la reine,
dont les nobles instincts devinaient tout de suite ceux à qui l'on pouvaient
se fier. Très-différent en cela de ce lourd Pétion qui, si l'on en croit
madame Campan, mangeait et buvait tout à son aise dans la berline royale,
jetant sous le nez du roi ses os de volaille par la portière. Et comme, dans
la conversation, le roi lui disait : La France ne
peut pas être en république, il répondit : Non,
elle n'est pas assez mûre pour cela. Barnave fut dès lors le
conseiller de la reine, si toutefois un conseil était possible ; et Sa
Majesté étonna plusieurs fois madame Campan, en lui témoignant de la
considération pour Barnave, et ajoutant même que, le jour où la royauté
triompherait, Barnave serait épargné[28]. Le lundi soir, la famille royale était partie ; le samedi soir elle revint, et bien des choses s'étaient accomplies dans cette courte semaine. La bouffonne tragédie allait s'accomplir aux Tuileries, au milieu de terribles souffrances. La royauté était surveillée, enchaînée, humiliée comme jamais royauté ne l'a été ; surveillée même dans son sommeil et dans ses appartements les plus secrets. La reine ne pouvait dormir que la porte entrebâillée ; un argus en uniforme bleu veillait, les yeux fixés sur les rideaux. Une nuit même qu'elle ne pouvait dormir, il lui offrit de venir s'asseoir à son chevet, pour causer un peu avec elle[29] ! IX. — LE GRAND COUP.Une fois le roi ramené à Paris, une grande question s'éleva. Que va-t-on faire de lui ? Le déposer ! répondit résolument Robespierre et ses adhérents les plus avancés. Et vraiment que pouvait-on faire de mieux avec un roi qui se sauvait et avait besoin d'être surveillé, même dans sa chambre à coucher, lorsqu'il aurait dû rester et gouverner son peuple. Ah ! si Philippe d'Orléans n'avait pas été un caput mortuum ! Mais on le considérait comme mort, et personne ne voulait de lui. Ne déposez pas le roi, dites qu'il est inviolable ! Quoi qu'il vous en coûte de sophismes et de solécismes, affermissez-le ! Ainsi répondirent les royalistes constitutionnels, et naturellement les royalistes purs se joignirent à eux et répondirent de même, avec plus de passion sans doute, mais moins de véhémence, tant la colère était en eux comprimée par la crainte. Barnave et les Lameth furent bien plus encore du même avis ; ils étaient eux aussi terrifiés à l'aspect de cet abîme inconnu sur le bord duquel ils chancelaient, poussés par leurs propres forces et tout prêts à s'y voir précipiter bientôt. Cette lutte devait être définitive ; il fallait y triompher par la force du bras, si ce n'était par la clarté de la logique. En faisant le sacrifice de cette popularité, si dure à conquérir, ce célèbre triumvirat, dit Toulongeon, raffermit le trône qu'il s'était donné tant de peine à abattre, de même qu'on ferait tenir sur la pointe une pyramide renversée. Mais elle ne pourrait y rester qu'à la condition d'être soutenue. Malheureuse France ! malheureuse dans son roi, dans sa reine, dans sa constitution ! malheureuse en toutes choses. Tel fut le cours de cette glorieuse Révolution française. Quand les tromperies et les déceptions, après avoir longtemps tué les âmes, en vinrent à tuer les corps, quand tout cela conduisit à la banqueroute et à la famine, un grand peuple se leva, et, d'une seule voix, il dit au nom de Dieu : On ne nous trompera plus ! Tant de chagrins, tant de meurtres, tant d'horreurs sanglantes endurées déjà et tant d'autres à endurer encore, à travers les siècles à venir, ne furent-ils pas le prix terrible de ce décret du peuple : l'abolition totale du mensonge sur la terre ? Et maintenant, ô triumvirat de Barnave ! espérez-vous donc faire réussir vos efforts en distillant l'illusion au peuple, en rachetant un mensonge par un autre mensonge ? Messieurs du triumvirat, jamais ! — Mais, après tout, que pouvaient ces pauvres triumvirs populaires et ces augustes et faibles sénateurs ? Ils pourront seulement, quand la vérité sera par trop horrible, et que la déception sera tout près, abriter leurs têtes comme font les autruches et attendre là... à posteriori. Les lecteurs qui ont vu tout le Clermontois galoper dans la nuit des éperons, les diligences parcourir la France, la ville de Nantes réveillée en sursaut et debout en chemise, peuvent s'imaginer combien l'affaire fut difficile à arranger Robespierre à l'extrême gauche, avec Pétion et le pauvre vieux Goupil, car le premier triumvirat était remplacé, réclamaient violemment la déchéance, perdus qu'ils étaient dans les clameurs des constitutionnels. Mais les débats et les argumentations d'une nation tout entière, les beuglements des journaux pour ou contre, la voix vibrante de Danton, les traits acérés de Camille Desmoulins, les déclamations sanglantes de l'implacable Marat ; tâchez de concevoir tout cela. Les constitutionnels en corps, comme nous l'avons prédit, formèrent le club des Feuillants, se séparant de la Société mère qui mourut d'inanition, tout ce qu'il y avait de grand et de respectable en elle l'ayant quitté. Les pétitions envoyées par la poste ou portées par des députations se succédaient à l'Assemblée, demandant le jugement ou la déchéance, ou tout au moins qu'on en référât aux quatre-vingt-trois départements de la France. L'enthousiaste députation de Marseille déclara, entre autres choses, que les Phocéens, leurs ancêtres, ayant jeté une barre de fer dans le port à leur premier débarquement, cette barre reparaîtrait sur le flot de la Méditerranée avant que les Marseillais consentissent à devenir esclaves. Tout cela dura quatre semaines et plus, pendant lesquels la question resta dans le doute. L'émigration redoublait sa course vers les frontières[30]. La France bouillonnait dans l'agitation causée par cette grande question : Que doit-on faire du représentant fugitif de l'hérédité ? Enfin, le vendredi 15 juillet 1791, l'Assemblée nationale se décida pour la négative. A la nouvelle de cette décision, les théâtres fermèrent, les discours en plein vent, prononcés sur des bornes ou dans des chaires portatives, recommencèrent ; des placards officiels furent affichés sur les murs, et des brochures publiées à son de trompe invitèrent au repos ; mais ce fut en vain, et le dimanche 17 se passa un événement digne d'être raconté. Une pétition, rédigée par Brissot, Danton, des cordeliers et des jacobins, car tout le monde y avait mis la main, fut déposée sur l'autel de la Patrie pour recevoir des signatures. Tous les Parisiens, laissant le travail, s'y portèrent en foule, hommes et femmes, pour signer et pour voir, et l'histoire ne voit pas sans intérêt la belle madame Roland elle-même y aller dans la matinée[31]. Dans quelques semaines, la jolie patriote quittera Paris pour y revenir bientôt après. Mais le chagrin de voir leur patriotisme trompé, la fermeture des théâtres, les proclamations publiées à son de trompe, tout cela avait excité les esprits au plus haut degré. De plus, il se passa ce jcur-là un incident tragicomique qui acheva de monter toutes les têtes. Le matin de ce jour, un patriote — quelques-uns disent que c'était une patriote, mais la vérité est impossible à connaître — étant sur le plancher de bois de l'autel de la Patrie, tomba tout à coup en se tordant d'effroi, son soulier venait d'être traversé par la pointe d'une vrille enfoncée sur le plancher. La personne blessée retira violemment le pied, et on aperçut alors l'extrémité d'un poinçon ou d'une vrille qui traversait le plancher et qui fut retirée tout à coup. C'était un mystère, une trahison peut-être. La charpente de l'autel fut immédiatement mise en pièces, et l'on vit alors une chose inexplicable et qui restera un mystère jusqu'à la fin du monde. Deux hommes, d'aspect chétif, l'un d'eux ayant même une jambe de bois, étaient cachés sous l'autel, une vrille à la main. Ils devaient être venus pendant la nuit, et avaient un panier de provisions, mais pas de baril de poudre, au moins personne ne le vit. Ils faisaient semblant de dormir, et, tout confus, s'excusèrent d'une façon tout à fait insuffisante. C'était par pure curiosité ; ils faisaient un trou pour mieux voir, pour voir peut-être, poussés par un désir de lubricité, ce qui pourrait être admiré de ce point de vue d'un nouveau genre. Tout cela était peu édifiant, en vérité. Mais aussi quelle chose stupide que la sottise humaine, le désir, la lubricité, que le hasard et le diable soient allés au milieu d'un demi-million d'hommes en choisir deux pour les tenter de cette façon[32] ? Ce qu'il y a de bien certain, c'est que ces deux individus et leur vrille étaient là. Tous deux étaient nés sous une mauvaise étoile, car le résultat de tout ceci fut que les patriotes, excités encore dans leur état d'irritation nerveuse par des hypothèses, des soupçons, des rapports de toutes sortes, questionnèrent et réquisitionnèrent ces deux malheureux invalides, les enfermèrent au poste le plus voisin, les en retirèrent bientôt pour se les passer de groupe en groupe, jusqu'à ce qu'enfin arrivés au dernier degré de l'irritation, ils les pendirent comme espions du sieur Motier. Ils emportèrent pour toujours leur secret avec eux, pour toujours, hélas ! Et un jour viendra où ces deux invalides, qui étaient des hommes, ni plus ni moins ; deviendront une énigme historique, comme l'homme au masque de fer — qui lui aussi était un homme comme un autre —. On discutera beaucoup peut-être sur les intentions de ces deux malheureux ; mais, pour nous, une seule chose est certaine, c'est qu'ils avaient une vrille, des provisions et une jambe de bois, et qu'ils sont morts accrochés à la lanterne, comme de malheureux fous qu'ils étaient. Et ainsi on continuait à signer la pétition avec une irritation de plus en plus vive. Chaumette, car un musée d'antiquités possède encore ce papier célèbre[33], Chau- mette, disons-nous, la signa de son écriture légère, hardie, insolente, et Hébert, le détestable Père Duchesne la signa aussi comme aurait pu le faire une araignée trempée d'encre et venant s'égoutter sur le papier. On y voit aussi la signature de l'huissier Maillard et beaucoup de croix faites par ceux qui ne savaient pas signer. Et les mille rues de Paris, conduisant au Champ de Mars, étaient encombrées de monde, allant et venant avec agitation ; l'autel de la Patrie était englouti sous le nombre de patriotes, hommes et femmes, qui venaient pour signer. Les bancs, au nombre de trente, et tout l'espace intermédiaire, étaient couverts d'une foule curieuse ballottée sans relâche, on voyait un tourbillon d'hommes et de femmes en habit du dimanche. Un constitutionnel, le sieur Motier, regardait tout ce mouvement, et Bailly était là aussi, son grave visage devenant plus grave encore, car il n'augurait rien de bon de tout cela. Il pensait que la déchéance du roi en résulterait, peut-être ! Patriotes constitutionnels, empêchez ces démonstrations, le feu peut-il s'éteindre lui-même ? — Oui, mais seulement à son début. Empêcher cela, oui, mais comment ? Est-ce que le premier peuple libre de l'univers n'a pas le droit de faire des pétitions ? Heureusement, si ce n'est pas malheureusement, il y a ici une preuve de crime, ces deux individus pendus à une lanterne. Une preuve ! Ô traître, sieur Motier ! ces deux hommes n'ont-ils pas été envoyés là pour y être pendus ? pour fournir un prétexte à la levée sanglante du drapeau rouge ? — Cette question, plus d'un patriote se la fera plus tard, et répondra affirmativement à ce soupçon contre nature. Enfin, vers sept heures et demie du soir, on vit se re- produire un nouvel incident. Le sieur Motier, à la tête des officiers municipaux en écharpe, accompagné par des patrouilles de garde nationale en rangs serrés et tambours en tête, s'avança résolument vers le Champ de Mars. Bailly, le visage allongé, et comme lié par un triste devoir, portait le drapeau rouge. Des hurlements de colère et de dérision sortirent, en voix de basse ou de fausset, de plusieurs milliers de bouches, à la vue de ce déploiement de forces qui s'avançaient au son du tambour, en vertu de la loi martiale, le drapeau rouge en tête, venant du Gros-Caillou et se dirigeant vers l'autel de la Patrie. Les troupes avançaient au milieu des plus sauvages vociférations, des reproches, des supplications ; accueillies par une volée de pierres, saxa et fæces, et même par un coup de pistolet. Les patrouilles firent feu en l'air d'abord, mais, à la fin, les mousquets ajustèrent, et l'on entendit décharge sur décharge. C'est ainsi que fut inondée de sang français la place même où, un an et trois jours auparavant, avait eu lieu la fête sublime de la Fédération. Il n'y avait eu qu'une douzaine d'hommes de tués a dit Bailly, mais les patriotes élevèrent ce nombre à plusieurs centaines. Cette journée ne devait être ni pardonnée, ni oubliée. Les patriotes s'éloignèrent en jurant et en maudissant. Camille-Desmoulins n'écrivit pas ce jour-là dans son journal. Ainsi que le grand Danton et Fréron, il s'était éloigné pour sauver sa vie. Marat, lui, était silencieux. L'autorité avait triomphé, mais ce devait être pour la dernière fois. Tel est le récit de cette royale fuite à Varennes. C'est ainsi que le trône fut renversé, puis victorieusement relevé, mais en sens inverse, de façon à ne pouvoir rester debout qu'à la condition d'être soutenu. |