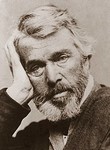HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
LA CONSTITUTION
LIVRE TROISIÈME. — LES TUILERIES.
I. — ÉPIMÉNIDE.Non, rien n'est mort dans l'univers ; ce que nous appelons mort n'est que changé ; ce sont des forces qui travaillent en sens inverse ! La feuille qui pourrit dans les vents humides, a dit quelqu'un, possède encore de la force ; sans cela comment pourrait-elle pourrir ? Notre univers entier n'est qu'un assemblage de forces ; de mille forces diverses ; depuis la gravitation jusqu'à la pensée et la volonté ; la liberté de l'homme entourée des nécessités de la nature : de tout cela rien ne sommeille jamais, tout est toujours éveillé et actif. La chose qui gît isolée et inactive, jamais tu ne la découvriras ; cherche partout, depuis la montagne de granit qui depuis la création se réduit lentement en poussière, jusqu'au nuage de vapeur fugitif, jusqu'à l'homme qui vit ; jusqu'à l'action de l'homme, jusqu'à la parole qu'il prononce. Nous le savons, la parole prononcée s'enfuit irrévocablement : de même aussi, mais plus vite encore, l'action accomplie. Les dieux eux-mêmes, dit Pindas, ne peuvent annuler l'action accomplie. Non : ce qui est fait reste toujours fait, lancé dans le temps infini ; qu'elle reste longtemps en vue ou qu'elle disparaisse très-vite, une action produit son effet et grandit, nouvel et indestructible élément, dans l'infinité des choses. Qu'est-ce donc que cette infinité de choses que nous appelons univers, sinon une action, une somme totale d'actions et d'activités ? La somme totale vivante et facile à faire, de trois choses, — que le calcul ne peut ni additionner, ni porter sur ses tablettes ; et cependant c'est la somme nettement tracée de : Tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait et tout ce qui se fera ! Comprends-le bien, la chose que tu considères, est une action, le produit et l'expression d'une force exercée : l'ensemble des choses est une conjugaison sans fin du verbe faire. Un vaste océan de force, de pouvoir faire ; océan et fontaine, la force y roule et y circule, s'enfle comme une vague et se divise en une multitude de courants ; un océan large comme l'immensité ; profond comme l'éternité ; harmonieux, beau, terrible et incompréhensible ; c'est là ce que l'homme appelle existence et univers. Cette image de flammes aux mille teintes, à la fois secret et révélation, est le reflet tel que son cœur et son pauvre cerveau peuvent le peindre, d'une demeure sans nom dans une lumière inaccessible ! Depuis la voie lactée, depuis l'origine des jours, tout tourne et tout roule autour de toi, toi-même tu tournes, dans ce point de l'espace dans lequel tu te trouves maintenant et dans le moment que marque ta montre. En dehors de tout transcendantalisme nous savons que toutes les choses humaines sont continuellement en mouvement ; c'est une série d actions et de réactions, un travail progressif, traversant un certain nombre de phases et suivant des lois invariables pour arriver à un but déterminé à l'avance ; n'est-ce pas là une simple vérité de perception qu'un esprit vulgaire pourrait appeler un truism ? Combien de fois ne nous arrive-t-il pas de dire, sans que nous en soyons bien convaincus : La graine que nous avons semée poussera ! Elle aura l'été pour fleurir, et après l'été vient toujours l'automne pour la faner. La graine n'est pas seule assujettie à suivre cet ordre ; les transactions, les arrangements, les philosophies, les sociétés, les révolutions françaises, en un mot, tout ce que l'homme fait en ce bas monde, suit le même ordre. Le commencement comprend la fin et tout ce qui y mène ; comme le gland contient le chêne et ses destinées. C'est bien solennel, pensons-nous, — malheureusement, heureusement aussi, nous n'allons pas au delà ! Toi, tu peux commencer ici ; le commencement t'appartient, il est ici : mais où sera la fin, comment sera-t-elle, pour qui sera-t-elle ? Tout croît, tout cherche, tout subit ses destinées : remarque combien de choses croissent comme croissent les arbres, que nous y pensions ou non. De sorte que quand votre Epiménide, votre somnolent Peter Klaus, appelé depuis Ripvan Winkle, s'éveille, il trouve un monde changé. Tant de choses ont changé pendant ses sept ans de sommeil ! Tout ce qui est en dehors de nous change sans que nous y pensions ; il en est de même de ce qui est en nous. La vérité qui hier encore était un problème indécis, est devenue aujourd'hui une conviction que nous brûlons d'énoncer ; demain la contradiction la transformera en une exaspération fanatique et enragée ; — les obstacles l'ont affaiblie, elle est tombée dans une inertie maladive ; la satisfaction ou la résignation l'ont réduite au silence. Aujourd'hui n'est pas hier, ni pour l'homme ni pour les choses. Hier nous avons vu le serment d'amour, aujourd'hui nous entendons les malédictions de la haine. La volonté n'y est pour rien : oh non, on ne pourrait en hâter l'arrivée. L'éclat doré de la jeunesse se serait-il terni de lui-même pour se changer en sombre vieillesse ? — Il est terrible, ce mystère du temps qui nous enveloppe et dans lequel nous sommes profondément enfoncés. Nous sommes les fils du temps, nous sommes façonnés et tissés de temps. Sur nous, sur tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons et tout ce que nous faisons se trouve écrit : Ne te repose pas, ne t'arrête pas ; en avant, accomplis ta destinée ! Les temps de révolutions se distinguent surtout par la rapidité avec laquelle ils s'écoulent ; aussi, en temps de révolution, notre dormeur miraculeux pourrait s'éveiller plus tôt, sans que le miracle en soit amoindri. Ce n'est pas cent ans, ni sept ans qu'il lui faut dormir ; souvent il ne faut même pas sept mois. Imaginez, par exemple, que quelque nouveau Peter Klaus, satisfait par le jubilé du jour de la Fédération, se-soit couché immédiatement après la bénédiction de Talleyrand. Persuadé que tout est sauvé maintenant, il s'endort tranquillement sous la charpente de l'autel de la patrie pour y dormir non pas vingt et un ans, mais un an et un jour. Les canonnades de Nancy sont si loin de lui qu'elles ne sauraient troubler son sommeil ; ni les noirs draps de mort, ni les requiem, ni les coups de fusil, ni la fumée de l'encens, ni les concours ; rien de tout ce qui se passe au-dessus de sa tête ne le trouble : Peter dort au milieu de tout cela. Il dort ainsi pendant une année entière ; depuis le 14 juillet 1790 jusqu'au 17 juillet 1791 : ce jour-là, ni Klaus, ni Epiménide, fussent-ils de plomb, ne pourraient continuer à dormir ; la mort seule le pourrait : ainsi donc notre miraculeux Peter Klaus s'éveille. Tu ouvres de grands yeux, ô Peter ! Le ciel et la terre ont toujours le joyeux aspect de juillet et le Champ de Mars est couvert par la foule : mais les cris de joie se sont changés en cris de folie, de terreur et de vengeance ; il n'y a plus de bénédiction de Talleyrand ni de bénédiction de n'importe qui ; on n'entend que malédictions, imprécations et lamentations ; nos canons sont prêts à faire feu ; l'encens ne brûle plus ; on ne voit plus flotter les bannières des quatre-vingt-trois départements ; on ne voit plus que le sanguinaire drapeau rouge. -' Pauvre fou ! L'un était contenu dans l'autre, l'un était l'autre moins le temps ; de même aussi le vinaigre dont se servait Hannibal pour dissoudre des rochers, était contenu dans le doux vin nouveau. L'année passée nous avions cette douce fédération ; cet amer déchirement en est la même substance, rendue plus vieille par les jours écoulés. De nos jours on ne voit plus dormir des Klaus ou des Epiménide miraculeux ; et cependant n'y a-t-il pas beaucoup d'hommes assez épais ou assez légers pour accomplir le même miracle naturellement, c'est-à-dire les yeux ouverts ? Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas plus loin que leur nez. Tel homme peut avoir l'œil pétillant de vivacité et paraître non-seulement voir, mais voir de part en part ; il est assidu à son cercle de personnages officiels ; s'il rêve, c'est pour croire que c'est là le monde entier. Comme si là où notre vision se termine ne commençait pas l'inanité ; comme si la fin du monde ne se révélait pas elle-même — à vous ? Lorsque votre personnage officiel, assidu, pétillant de vivacité — appelez-le par exemple Lafayette —, s'arrête brusquement, après un an et un jour, effrayé par le bruit du canon, il ne fait pas une mine moins effarée que le premier Peter Klaus venu. Lafayette peut faire un pareil miracle naturel ; et non-seulement lui, mais d'autres personnages, officiels ou non officiels ; en général tout le peuple français en est capable. De temps en temps il tressaille comme le dormeur miraculeux qui, après un sommeil de sept ans, se réveille avec stupeur au bruit que fait le peuple lui-même. La liberté est entourée de nécessités si étranges ; la vie de l'homme est un mélange si singulier de somnambulisme conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire ! Si quelqu'un dans le monde s'est étonné de voir le serment de la fédération dégénérer en mitraille, ce sont certes les Français eux-mêmes qui avaient prêté ce serment et qui maintenant se mitraillent. Hélas ! les injures devaient revenir. La sublime fête des Piques, avec son effusion d'amour fraternel inconnu depuis l'âge d'or, n'a rien changé. L'effervescence de ces vingt-cinq millions de cœurs n'est pas encore calmée ; elle est même plus vive. Aucun commandement n'exerce plus aucune pression sur ces millions de citoyens ; leur seule loi, c'est le serment mélodramatique de la Fédération, loi qu'ils se sont imposée eux-mêmes. Le Tu dois, faisait partie de l'ancien état social de l'homme, dont le bonheur et la fortune dépendaient alors de son obéissance à la loi. Malheur à lui si, poussé par la nécessité, il vit en révolte, dans un isolement déloyal et s'il ne prend plus pour loi que son simple je veux ! Mais l'évangile de Jean- Jacques est venu, et son premier sacrement a été célébré : Tout est en effervescence, tout fermente de plus en plus, les changements se succèdent, tour à tour obscurs et brillants. Chassés par le dégoût, les capitaines aux moustaches royalistes montent, l'un après l'autre, leur cheval de bataille ou leur bidet de guerre rossinante, et se dirigent d'un air menaçant, vers le Rhin, jusqu'à ce que tous soient partis. L'émigration civile ne cesse pas non plus ; un seigneur après l'autre, s'en va à cheval ou en voiture ; on l'y engage, on l'y force même. Car le paysan même le méprise s'il ne rejoint pas ses amis sur le champ de bataille. Peut-il souffrir qu'on lui envoie une quenouille : soit qu'on la lui expédie par la poste gravée sur une plaque de cuivre, soit qu'on la fixe réellement au-dessus de sa porte, comme s'il n'était qu'un Omphale et non un Hercule ? Voilà l'écusson que se hâtent de lui envoyer ses amis de l'autre côté du Rhin jusqu'à ce qu'il se lève à son tour pour partir ; alors un nouveau seigneur quitte ses terres sans pouvoir les emporter. Ajoutez ensemble une longue suite de mots irrités, et vous aurez les disputes ; ajoutez ensemble ces disputes avec les chagrins cuisants qu'ils produisent, et vous aurez les émeutes et les révoltes. Les choses les plus vénérables cessent l'une après l'autre d'être vénérées ; les flammes dévorent l'un après l'autre tous les châteaux en même temps qu'un incendie spirituel et invisible consume l'une après l'autre toutes les autorités. Tout un ancien système s'écroule pièce par pièce, tantôt avec bruit et fracas, tantôt sans bruit et sans éclat : demain tu ouvriras les yeux et tu ne le verras plus. II. — LE VIGILANT.S'endorme qui veut dans les bras de l'espérance pour jouir d'une courte vision, comme Lafayette, qui toujours regarde le danger auquel il vient d'échapper comme le dernier de ceux qui le menacent. — Il n'est pas l'heure de s'endormir, nous ne sommes pas là pour gaspiller notre temps. Le sacré collège des Hérauts d'une nouvelle dynastie, nous parlons des soixante et quelques afficheurs avec leur insigne en plomb, ne dort pas. Tous les jours, armés de de leur pot à colle et de leur pinceau, ils revêtent à neuf les murs de Paris en couleur d'arc-en-ciel. Collège autoritatif-héraldique, disons-nous, ou au moins magico-thaumaturgique, non pas à cause du journal qu'ils placardent, mais parce qu'ils porteront la conviction dans quelques âmes humaines. Les colporteurs criaillent, les chantres des rues se mettent à l'unisson ; le grand journalisme s'enfle et fait du fracas, véritable caverne d'Éole ; de tous ses gosiers sortent des cris qui vont se faire entendre dans tous les coins de la France et y entretenir toute espèce de feu. On compte[1] à peu près cent trente-trois de ces gosiers ou journaux. Il y en avait de tous les calibres : depuis vos Chénier, vos Gorsase, vos Camille jusqu'à votre Marat, jusqu'à votre Hébert qui commence son Père Duchêne ; ceux-ci combattent, tantôt avec des arguments solides, tantôt avec des plaisanteries vives et légères, pour les droits de l'homme. Les Durosoy, les Royan, les Peltier et les Galleau, variant aussi leur tactique et y faisant même entrer quelquefois des parodies trop profondes, combattent pour l'autel et le trône. Quant à Marat, l'ami du peuple, sa voix ressemble à celle de la grenouille taureau ou du butor sur les bords des étangs solitaires, invisibles pour les hommes ; il est toujours seul à tonner en coassant d'indignation, de soupçon et de chagrin incurable. Le peuple court à la ruine, la faim elle-même l'attendait : Mes chers amis, s'écrie-t-il, votre indigence n'est pas le fruit de vos vices ou de votre paresse ; vous avez le droit de vivre tout aussi bien que Louis XVI, ou le plus heureux du siècle. Quel est l'homme qui peut dire qu'il a le droit de dîner quand vous n'avez pas de pain ?[2] Regardez où vous voulez ; vous verrez d'un côté le peuple qui s'affaisse, de l'autre le triste sieur Motier, le traître Riquetti Mirabeau, des traîtres partout ou des ombres, des simulacres de charlatans dans toutes les places élevées ! On ne voit que des hommes à la démarche affectée, faisant des grimaces et des discours spécieux et portant des habits bien brossés ; au dedans ils sont creux. Il n'y a que charlatans politiques, charlatans scientifiques et académiques ; ils ont les uns pour les autres une tendresse de camarade et une espèce d'esprit public charlatan ! Le grand Lavoisier lui-même, ni aucun des quarante, ne peut échapper à cette rude langue, qui ne manque pas de sincérité fanatique et qui, chose singulière, possède un certain bon sens riche et caustique. Et les trois mille maisons de jeu qui sont à Paris ; bas-fonds où se réunissent tous les filous de l'univers ; véritables cloaques d'iniquité et de débauche, — tandis que sans bonnes mœurs la liberté est impossible ! Là, dans ces cavernes de Satan, quelqu'un le sait et le dénonce avec persévérance, les mouchards du sieur Motier se réunissent et s'associent pour s'engraisser comme des vampires du sang de ce peuple qui est sur le point de mourir de faim. Ô peuple ! s'écrie-t-il souvent avec un accent à déchirer le cœur. Trahison, tromperie, vampirisme, crétinisme, de Daniel à Beershebe ! L'âme de Marat souffre de ce spectacle : comment la guérir ? Ériger huit cents gibets, dans des rues convenables, et commencer par hisser Riquetti sur le premier ! C'est là la simple recette de Marat, l'ami du peuple. Tel est le bruit que font les cent trente-trois ; et on serait tenté de croire qu'ils ne suffisent pas ; il y a en France des coins obscurs où les journaux n'arrivent pas, et cependant il y a partout un appétit de nouvelles tel qu'on n'en avait jamais vu dans aucune contrée. L'expéditif Dampmartin profite-t-il d'un congé pour quitter Paris et s'en retourner chez lui[3], il ne peut dépasser les paysans qui l'arrêtent sur la route et l'accablent de questions ; le maître de poste ne sortira ses chevaux que quand vous vous serez pour ainsi dire disputé avec lui, mais il vous demandera toujours, quoi de neuf ? A Autun, en dépit de l'obscurité de la nuit et de la rigueur du froid, car nous sommes en janvier 1791, vous serez forcés de roidir vos membres fatigués par le voyage, de recueillir vos pensées et de parler à la multitude du haut d'une fenêtre s'ouvrant sur la place du marché. C'est la méthode la plus courte : Ceci, mes chers chrétiens, sont les actions qu'une auguste assemblée me paraît accomplir ; c'est là la grande nouvelle, il n'y en a point d'autres. Now my weary lips I close Leave me, leave me to repose ![4] Ce bon Dampmartin ! — Mais, en somme, les nations ne restent-elles pas d'une manière étonnante fidèles à leur caractère national, qui sans doute circulé dans leur sang ? Il y a environ dix-neuf siècles, Jules César remarqua déjà avec son coup d'œil vif et sûr comment les Gaulois guettaient les voyageurs. C'est une habitude chez eux, dit-il, d'arrêter les voyageurs, même par force, et de s'informer de ce que chacun d'eux peut avoir entendu ou vu sur n'importe quel sujet : dans leurs villes, le commun peuple obsède le négociant de passage et lui demande de quelles régions il arrive et ce qu'il y a appris. Sur la foi de ces rumeurs et de ces ouï-dire, ils décident les questions les plus importantes ; nécessairement ils se repentent, le moment d'après, d'avoir ajouté foi à ces bruits incertains, beaucoup de voyageurs ne leur répondant que par des fables pour leur faire plaisir et pour s'en débarrasser[5]. Dix-neuf siècles se sont écoulés, et le bon Dampmartin, harassé de fatigue, par un froid d'hiver, pérore de nouveau du haut d'une fenêtre d'auberge, probablement à la pâle lumière des étoiles ou d'une lampe à huile de poisson ! Ce peuple ne porte plus le nom de Gaulois ; il est devenu tout à fait braccatus, il a pris des culottes et supporté assez de changements : certains Francs, Germains farouches, se sont précipités sur lui et ont, pour ainsi dire, bâti une voûte sur son dos. Depuis ce temps-là les Germains ont toujours continué leur rôle d'une manière morose et tenace, ils ont dompté et bridé ce peuple gaulois, car Germain veut dire guerre-man, homme de guerre, homme qui fait la guerre. Ainsi donc le peuple gaulois s'appelle maintenant peuple français, ou descendant des Francs : cependant, le vieux celtisme gaulois et gaëlique, avec sa véhémence, sa promptitude effervescente, tout ce qu'il avait de bon et de mauvais en ceci, ne s'est-il pas conservé, sauf quelques petites altérations ? Inutile d'ailleurs de dire qu'au milieu de cette violente confusion le clubisme prospère et s'étend. Déjà la société mère du patriotisme, le club des Jacobins, paraît dominer tous les autres clubs ; elle a fait pâlir presque jusqu'à l'extinction finale la pauvre lumière lunaire du club monarchique. La société mère, disons-nous, semble souveraine ; elle est entourée de lumière solaire et ne brille pas encore d'un éclat infernal ; les autorités municipales la vénèrent, non sans la craindre ; elle compte dans son sein les Barnave, les Lameth, les Pétion, membres de l'Assemblée nationale, et surtout Robespierre, qu'elle préfère à tous les autres. Les Cordeliers avec leur Hébert, leur Vincent, leur bibliopoliste Momoro, gémissent hautement de voir un maire tyrannique et un sieur Motier les déchirer avec la tribula aiguë de la loi, apparemment dans le but de les supprimer à force de tribulations. J'ai déjà donné à entendre comment la société mère des Jacobins engendre d'un côté les Cordeliers, de l'autre les Feuillants : les Cordeliers sont un élixir ou une double distillation du patriotisme jacobin ; les Feuillants sont une dilution faible et très-étendue de ce même patriotisme : la société mère réabsorbera les premiers dans son sein maternel et plongera les derniers dans le néant après une lutte orageuse ; elle engendre et élève trois cents sociétés filles ; celles-ci grandissent, correspondent entre elles, font des essaims et travaillent continuellement : sous une vieille figure, le jacobinisme envoie des filaments organiques dans les coins les plus reculés de la France dissoute et en confusion ; elle l'organise à nouveau : c'est cette action du jacobinisme qui est, à proprement parler, le grand fait de l'époque. Le constitutionnalisme passionné, et plus encore le royalisme, voyant leurs propres clubs tomber et mourir, accuseront sans doute le clubisme d'être la racine de tout le mal, et cependant le clubisme n'est pas la mort, c'est une nouvelle organisation, c'est-à-dire la vie sortie de la mort : il détruit, il est vrai, les restes de l'ancien système, mais il est nécessaire, indispensable au nouveau. Que l'homme puisse coopérer et rester en communion avec l'homme, c'est en cela que consiste la force miraculeuse. Le patriotisme dans la cabane ou dans le hameau ne gémit pas comme une voix dans le désert ; il peut aller à la ville voisine ; et là, dans une des sociétés filles, il se manifeste par une harangue ou par une action quelconque mise en avant par la Mère du Patriotisme elle-même. Tous les clubs constitutionnels et autres semblables tombent les uns après les autres, comme on voit se tarir les sources trop peu profondes. Le jacobinisme seul est descendu à la profondeur des nappes d'eau souterraines ; il peut, toujours rempli, couler avec une abondance continue, comme un puits artésien. Jusqu'à ce que la nappe souterraine se soit elle-même desséchée, jusqu'à ce que tout soit inondé et submergé et que le déluge de Noé soit lui-même submergé ! De son côté, Claude Fauchet, dans le but de préparer le genre humain au nouvel âge d'or qui va sans doute s'ouvrir, a fondé son Cercle social, avec des clercs, des bureaux de correspondance et ainsi de suite, dans le ressort du Palais-Royal. C'est le Te Deum Fauchet ; le même qui fit un discours sur la mort de Franklin, dans la vaste rotonde de la Halle aux blés. Cet hiver, au moyen d'une presse d'imprimerie et de quelques discours mélodieux, il fait parler de lui jusqu'aux barrières les plus éloignées. Dix mille personnes respectables écoutent ce procureur général de la vérité — c'est la dignité qu'il s'est lui-même conférée —, et son sage Condorcet ou quelque autre coadjuteur éloquent.. Procureur général éloquent ! Il parle toujours, bien ou mal, disant des choses crues ou mûres telles qu'il les pense : tout cela ne manque pas de lui être utile, cela le conduit à un évêché ; peu importe que ce soit un évêché constitutionnel. Fauchet se montre comme un individu ayant la langue bien pendue, des poumons solides et un cœur vigoureux : il débite une foule de choses et des meilleures, sur le droit, la nature, la bienveillance, le progrès ; les idées qu'il ; émet sont-elles panthéistes ou non, en ce moment il nous suffit d'examiner son esprit vigoureux. L'affairé Brissot était depuis longtemps d'avis d'établir précisément quelque Cercle social analogue : il en a même fait l'essai Newmau-street Oxfort-street à Babylone-Brouillard ; il a abandonné l'idée, à ce qu'on dit., en mettant subrepticement l'argent dans sa poche. Fauchet, et non Brissot, était destiné à être l'homme heureux ; le généreux Brissot n'en chantera pas moins du fond de son cœur un Nunc, Domine, solidement entonné[6]. Mais dix mille hommes respectables : que de grosseur ont pourtant certaines choses par rapport à leur grandeur ! Ce cercle social, pour lequel Brissot chante si sincèrement son Nunc, Domine, qu'est-ce ? Malheureusement ce n'est que du vent et de l'ombre. La chose la plus réelle qu'on puisse y trouver maintenant est peut-être ceci : un procureur général de la vérité prit un jour la forme d'un corps pour vivre en fils d'Adam, pendant quelques mois ou quelques instants sur notre terre ; et les dix mille personnes respectables attendues sont encore dans le chaos et la nuit l'a réabsorbé lui-même. Cent trente-trois journaux de Paris ; le Cercle social régénérateur ; des discours dans la société mère et dans les sociétés filles, sur les balcons des fenêtres d'auberge, au coin de la cheminée ou à la table à manger ; — c'est en cela que consiste la polémique qui souvent se termine par un duel ! Ajoutez-y l'accompagnement constant des murmures d'une profonde discorde : la rareté du travail et la rareté des vivres. L'hiver est froid et rigoureux ; de temps en temps une foule déguenillée, semblable à un étendard de détresse, noir et déchiré, fait de sombres queues devant les boutiques des boulangers. Cette nouvelle année d'une république glorieuse est la troisième année de disette. Dans ces saisons de détresse, l'homme riche quand il est invité à dîner se sent obligé par la politesse d'apporter son pain dans sa poche : comment le pauvre dîne-t-il ? Et votre glorieuse révolution nous a valu cela, s'écrie l'un. Et notre glorieuse révolution est habilement pervertie par de noirs traîtres, dignes de la lanterne, s'écrie un autre. Qui peindra le gouffre profond dans lequel tourne la France, brisée en mille éclats incohérents ? Aucune langue humaine ne saurait raconter les disputes qui existaient sous tous les toits français, ni les paroles mordantes qu'on prononçait et dont la somme totale constitue la révolution française. Quelles lois dirigeaient l'action qui s'accomplissait invisible au milieu de cette incohérence aveugle ? Les hommes regardent l'incommensurable avec étonnement et non avec mesure ; ils n'en connaissent pas les lois, ils ne font que voir, selon les degrés différents de leur instruction, les nouvelles phases et les résultats des événements produits par ces lois. La France est une masse galvanique monstrueuse, dans laquelle agissent toutes sortes de forces et de substances plus étranges que les forces chimiques et galvaniques ou électriques ; ces substances s'électrisent l'une l'autre, positivement et négativement, elles remplissent d'électricité vos bouteilles de Leyde, — au nombre de vingt-cinq millions ! Quand les bouteilles deviennent pleines, il se produit de temps en temps- une explosion. III. — LE SABRE À LA MAIN.C'est cependant sur une base si merveilleuse, que la loi, la royauté, l'autorité, et tout ce qui existe encore en fait d'ordre visible, doivent se maintenir aussi longtemps que possible. Comme autrefois le vieil Anarch dans le conflit des quatre éléments, une auguste assemblée a étendu son pavillon sur tout ce désordre ; elle est entourée par les ténèbres sans bornes de la discorde ; elle repose sur l'incertitude sans fond de l'abîme et y entretient un vacarme continuel. Autour d'elle, le temps, l'éternité et le vide ; elle fait ce qu'elle peut, ce qu'il lui est donné de faire. Jetons une fois de plus un coup d'œil sur ce qu'elle fait ; nous voyons qu'elle se démène avec persévérance au milieu d'interruptions sans fin pour établir une théorie constitutionnelle des verbes défectifs[7]. Mirabeau du haut de la tribune avec tout le poids de son nom et de son génie en impose à la violence des Jacobins ; celle-ci par contre se fait jour dans le club des Jacobins où l'on fait contre Mirabeau des lectures violentes. Cet homme suit une voie mystérieuse, discutable ; une voie difficile et pourtant il n'a pas de compagnon. Le patriotisme pur ne le compte pas parmi ses élus ; le royalisme pur l'abhorre : et cependant il domine le monde. Laissons-le s'avancer seul, sans compagnon, d'un pas ferme et sûr vers son but, — le jour luit encore pour lui et la nuit n'est pas encore venue. Mais la bande élue des patriotes purs est petite ; elle compte à peine une trentaine de membres qui se tiennent à l'extrémité gauche, séparée de la foule. Un vertueux Pétion, un incorruptible Robespierre, le plus ferme et le plus incorruptible des hommes aigris et légers ; les triumvirs Barnave, Duport, Lameth, grands parleurs discours, par leurs pensées et par leurs actions, chacun à sa manière ; le vieux maigre Goupil de Prefeln : c'est de ceux-ci et de ceux qui les suivront que dépend le patriotisme pur. C'est parmi les trente aussi, qu'il faut placer Philippe d'Orléans, il s'y distingue, quoiqu'il se fasse rarement entendre, il est dans un triste et obscur embarras, après être, pour ainsi dire, arrivé au chaos ! On parle par moments de lieutenance et de régence ; dans l'assemblée elle-même se débat la question de la succession du trône dans le cas où la branche actuelle viendrait à faillir ; et Philippe, dit-on, se promenait silencieusement dans les corridors, attendant avec anxiété l'issue de ces débats : mais tout cela se réduisit à néant ; Mirabeau, perçant cet homme de son regard, a dit dans son rude langage : Ce j... f... ne vaut pas la peine qu'on se donne pour lui. Tout tomba dans le néant, et en attendant, dit-on, la monnaie de Philippe est partie ! Pouvait-il refuser un peu d'argent à ce patriote si bien doué de tout ce qui n'était pas de l'argent, lui qui manquait de tout excepté de monnaie ? Aucun pamphlet ne s'imprime sans argent, ou du moins, ne s'écrit sans la nourriture qu'on se procure avec l'argent. Sans argent l'homme le plus entreprenant ne peut bouger de place ; tout projet patriotique, individuel ou autre, exige de l'argent. Combien plus doit-il en falloir pour des intrigues qui s'étendent au loin et qui ne vivent et n'existent que par l'argent ; elles s'étendent au loin avec un appétit de dragon pour l'argent, elles sont capables d'engloutir des principautés ! C'est ainsi qu'a roulé le prince Philippe, au milieu de ses Sillery, Laclose et autres fils de la nuit : il était le centre des machinations les plus étranges et les plus sombres. Quelles trahisons spéciales, quels stratagèmes, quels essais de nuire, avec ou sans but, proposait-on dans ces réunions ? Personne — si ce n'est le génie qui les préside, le prince du pouvoir de l'air — n'a quelque chance de le savoir. La conjecture de Camille est la plus probable : ce pauvre Philippe se serait embarqué dans une spéculation traîtresse comme précédemment il s'était embarqué dans un des premiers ballons ; mais, épouvanté de la nouvelle position dans laquelle il venait d'entrer, il aurait bientôt rebroussé chemin et serait redescendu plus sot qu'avant ! Créer la suspicion surnaturelle, telle fut sa fonction dans l'époque révolutionnaire. Mais maintenant qu'il a perdu sa corne d'abondance, sa monnaie toute prête, que peut-il encore perdre ? Le malheureux sera obligé de se vautrer et de se débattre dans de profondes ténèbres, dans ce pitoyable élément de mort. Nous le verrons encore émerger une ou deux fois, s'efforçant de sortir de cet épais élément de mort : ce sera en vain. Pour un moment, pour la dernière fois il revient à la surface ou plutôt y est lancé, il acquiert même une espèce de célébrité, — pour s'enfoncer ensuite à tout jamais ! Le côté droit persévère aussi ; il montre même plus d'animation que jamais, quoique de ce côté l'espoir soit bien près de s'évanouir. Le coriace abbé Maury, lorsque les obscurs royalistes de province lui serrent la main avec des transports de gratitude, répond en secouant sa tête d'airain impassible : Hélas ! monsieur, tout ce que je fais ici est tout aussi bon que rien. Le brave Faussigny, qui ne paraît que cette fois-ci dans l'histoire, s'avance avec frénésie au milieu de la salle en s'écriant : Il n'y a qu'une manière d'en finir, c'est de tomber le sabre à la main sur ces gaillards-là[8], et il désigne nos trente élus de l'extrême gauche ! Là-dessus on fait du bruit, puis viennent les clameurs, les disputes, les regrets, — l'évaporation. Les choses mûrissent et deviennent franchement incompatibles, et on appelle cela une scission. Cette provocation farouche et théorique de Faussigny eut lieu en août 1790 ; nous ne serons pas encore au mois d'août de l'année suivante, que déjà les deux cent quatre-vingt-douze élus du royalisme feront leur scission finale d'une assemblée livrée aux factions et secoueront sur elle la poussière de leurs pieds. A propos de cette affaire du sabre à la main, il faut noter ici une autre chose qui s'y rattache. Nous avons déjà plusieurs fois parlé de duels : nous avons dit comment, dans toutes les parties de la France, d'innombrables duels eurent lieu. Des camarades en discussion renversent leur coupe de vin, rejettent les armes de la raison et de la repartie, pour aller se battre en champ clos ; ils se quitteront saignants, peut-être ils ne se quitteront pas et tomberont tous deux, traversés de part en part par l'épée, terminant à la fois leur vie et leur colère, — mourant comme meurent les fous. Cela a duré depuis longtemps et cela dure encore. Mais à présent il semblerait que dans le sein même d'une auguste assemblée ce traître royalisme ait choisi, dans son désespoir, un nouveau système de combattre le patriotisme : celui de le tuer par une série de duels systématiques ! Des spadassins de ce parti font des rodomontades, on peut les acheter pour quelques liards. L'œil jaune du journalisme avait vu douze spadassins arrivés récemment de la Suisse, ainsi qu'un nombre considérable d'assassins s'exerçant dans les salles d'escrime, s'appliquant au tir au pistolet. Tout député patriote distingué peut être provoqué, il échappera une fois ou dix fois ; il arrivera forcément un temps où il tombera, et la France pleurera. Combien Mirabeau n'a-t-il pas reçu de cartels ! surtout pendant qu'il était le champion du peuple. Des cartels par centaines ; comme la constitution doit être faite avant tout et que son temps est précieux, il répond toujours par une espèce de formule stéréotypée : Monsieur, je vous ai placé sur ma liste, mais je vous avertis qu'elle est longue et que je ne fais pas de préférence. N'avions-nous pas en automne le duel de Cazalès et de Barnave ; ces deux maîtres des joutes oratoires ne se sont-ils pas rencontrés pour échanger des coups de pistolet ? Cazalès, chef des royalistes, que nous appelons Noirs, avait dit dans un moment de passion : Les patriotes sont de simples brigands, et en parlant ainsi, il avait lancé ou paru lancer un coup d'œil étincelant du côté de Barnave ; celui-ci n'avait pu se contenter de répondre par un autre coup d'œil, il lui fallait un rendez-vous. Le deuxième coup de Barnave porta sur le chapeau de Cazalès. La pointe antérieure du feutre triangulaire, tel que les mortels le portaient alors, amortit le coup et sauva ce beau front de quelque chose de plus que d'une blessure passagère. Qu'il eût été facile au sort de se tourner en sens inverse et le chapeau de Barnave n'eût peut-être pas été aussi bon ! Le patriotisme fit alors sa grande protestation contre le duel en général ; des pétitions furent adressées à l'auguste assemblée pour la prier de mettre fin, par une loi, à ce barbarisme féodal. Barbarisme et solécisme ; car arrivera-t-on à convaincre quelqu'un en lui soufflant dans la tête une demie-once de plomb ? Certes que non. Barnave fut reçu à bras ouverts aux Jacobins, mais on lui fit des reproches. Se rappelant ce duel, et fort de la réputation qu'il s'était faite en Amérique, où il passait pour être d'une témérité exagérée et pour manquer plutôt de cervelle que de de cœur, Lameth refusa, sans grande émotion, d'aller se battre avec un jeune gentilhomme de l'Artois, arrivé exprès à Paris pour le provoquer ; il l'engagea d'abord froidement à attendre, ensuite il permit froidement à deux de ses amis de se battre à sa place et de donner une leçon au jeune gentilhomme ; ce qu'ils firent en effet. Procédé un peu froid ; il satisfit les deux amis, Lameth et le jeune gentilhomme bouillant. On aurait pu s'imaginer que la discussion en resterait là. Cependant il n'en fut pas ainsi. Lameth, en allant à la fin du jour reprendre ses occupations de député, rencontre dans les corridors de l'assemblée une foule de royalistes qui l'accueillent avec des brocards, des signes de mépris, des fanfaronnades et des insultes ouvertes. La patience humaine a ses limites : Monsieur, dit Lameth en s'adressant à un certain Lautrec, ayant une bosse ou une difformité naturelle quelconque ; monsieur, si vous étiez homme à vous battre ! — J'en suis un, moi ! s'écrie le jeune duc de Castries. Lameth, impétueux comme la foudre, répondit : Tout à l'heure. Aussi, quand les ombres du crépuscule s'épaissirent sur le bois de Boulogne, on vit deux hommes au regard de lion, au geste rapide, en garde ; le pied droit en avant, parant et poussant la botte ; coups d'épée, attaque en tierce et en quarte, appliqués à se transpercer l'un l'autre. Voyez : Lameth, plus ardent à toucher son adversaire, se lance à corps perdu et de tout le poids de son corps ; mais Castries se jette adroitement de côté : Lameth ne perce que l'air, et, fendu à fond, va embrocher son bras gauche dans l'épée que lui présente Castries. Sur quoi, à la vue du sang et de la pâleur du blessé, le duel- cesse, le chirurgien pose un appareil, et l'honneur est satisfait des deux côtés. Mais cela n'aura-t-il donc pas de fin ? Lameth le chéri est couché avec une blessure profonde : il n'est pas hors de danger. De noirs aristocrates tuent traîtreusement les défenseurs du peuple ; ils les combattent, non par des arguments, mais à coups de rapière. Et les douze spadassins venus de la Suisse, et le nombre considérable d'assassins s'exerçant au tir au pistolet ? Le patriotisme songe et médite le mal avec une ferveur toujours croissante, toujours s'étendant, pendant l'espace de trente-six heures. La trente-sixième heure écoulée, le samedi 13, on contemple un nouveau spectacle : la rue de Varennes et le boulevard des Invalides, qui en est proche, sont couverts d'une multitude mélangée. L'hôtel de Castries semble devenu fou, possédé du diable, et vomit par chacune de ses fenêtres des lits, des peintures, des images, des commodes, des chiffonnières, des poteries et des cloches, tout cela au milieu des acclamations continuelles du peuple et sans le moindre vol ; car de tous côtés retentit le cri de : Qu'il soit pendu celui qui volera un clou ! C'est là un Plebiscitum, ou un décret iconoclastique irrégulier du commun peuple qu'on n'aurait pas manqué d'exécuter. — La municipalité tremblote, délibère si elle doit sortir le drapeau rouge et proclamer la loi martiale. Dans l'Assemblée nationale, une partie des membres se lamente, une autre partie a peine à retenir ses applaudissements ; l'abbé Maury est incapable de décider si la populace iconoclastique monte à quarante mille ou à deux cent mille individus. Les députations, les messagers rapides se succèdent, car le peuple se trouve de l'autre côté de la Seine. Lafayette et ses gardes nationaux, sans drapeau rouge, se mettent en marche, apparemment sans trop se hâter. De plus, arrivé sur les lieux, Lafayette salue en ôtant son chapeau, avant de donner l'ordre de mettre les baïonnettes au bout des fusils. A quoi bon ? La cour de cassation plébéienne, comme Camille l'a justement appelée, a fait son œuvre ; le peuple s'avance, la veste déboutonnée, les poches retournées : il avait fait le sac de l'hôtel, un juste ravage, mais non un pillage ! Le héros des deux mondes, avec une patience inépuisable, fait des remontrances ; il dissipe la foule et la tranquillise en la persuadant par une espèce de douce contrainte, sans toutefois faire rentrer les baïonnettes. Le lendemain, tout avait repris son cours ordinaire. Le duc de Castries, en examinant ce qui venait de se passer, put écrire avec raison au président, se transporter lui-même vers les frontières pour y lever un corps d'armée, ou exécuter n'importe quel projet. Le royalisme abandonne complètement cette méthode de discuter, et les douze spadassins s'en retournent en Suisse — ou dans le pays des songes par la porte de corne, l'un ou l'autre de ces pays étant leur patrie. De plus, l'éditeur Prudhomme est autorisé à publier une chose curieuse : Nous sommes autorisé à publier, dit le stupide et bruyant éditeur, que M. Boyer, champion des bons patriotes, est à la tête de cinquante Spadassinicides. Son adresse est : passage du Bois de Boulogne, faubourg Saint-Denis[9]. Une des plus étranges institutions que celle du champion Boyer et de ses Spadassinicides ! Leurs services sont cependant inutiles, le royalisme ayant abandonné la méthode à la rapière comme complètement impraticable. IV. — FUIR OU NE PAS FUIR.Voici la vérité : la royauté sent que tous les jours elle approche de plus en plus de sa misérable fin. De l'autre côté du Rhin, il devient certain que le roi n'est plus libre dans les Tuileries. Ceci, le pauvre roi peut bien le nier de sa bouche officielle, mais au fond du cœur il sait bien que c'est la vérité. La constitution civile du clergé ; le décret de bannissement contre les dissidents ; il ne peut pas même s'opposer à ce dernier, bien que sa conscience le lui ordonne : après deux mois d'hésitation, il le signe aussi. Ce fut le 21 janvier 1791 qu'il le signa, et pourtant, pour le malheur de ce pauvre cœur, il y aura un autre 21 janvier ! Que deviennent les prêtres dissidents exilés ? D'invincibles martyrs suivant les uns, d'incorrigibles traîtres chicaneurs suivant les autres. Ainsi est arrivé ce que nous avions prédit : avec la religion, ou avec le jargon et l'écho de la religion, toute la France est séparée en deux parties par une nouvelle solution de continuité compliquant et envenimant toutes les anciennes blessures ; — pour les guérir, il faudra une cruelle opération dans la Vendée ! Malheureuse royauté, malheureuse majesté, Représentant Héréditaire — peu importe le nom que nous lui donnions —, dont on attend beaucoup et auquel peu est donné ! Les gardes nationaux bleus entourent les Tuileries : un Lafayette, petit pédant constitutionnel, simple, étroit, inflexible comme de l'eau changée en glace mince ; que le cœur d'une reine ne peut aimer. L'assemblée nationale, son drapeau déployé, nous savons où, se tient tout près, continuant son éternel vacarme. Au dehors, rien que les révoltes de Nancy, le sac de l'hôtel de Castries, des émeutes et des séditions, des émeutes au nord et au sud, à Aix, à Douai, à Béfort, à Usez, à Perpignan, à Nîmes, à Avignon, cette incurable ville des papes : un continuel craquement, un pétillement d'émeutes sur toute la surface de la France ; — preuve que l'émeute se propage avec une rapidité électrique. Et le dur hiver, les grèves affamées des ouvriers ; ce sourd grognement de la misère, son fondamental et base de toutes les autres discordes ! Le plan de la royauté, si toutefois on peut dire qu'elle ait un plan arrêté, est comme toujours, de fuir vers les frontières. En vérité, c'est le seul plan qui puisse lui laisser le moindre espoir ! Fuyez vers Bouillé ; entouré de canons et protégé par vos quarante mille Allemands fidèles, menacez, sommez l'Assemblée nationale de vous suivre, sommez la partie royaliste, la partie constitutionnelle et la partie vénale ; dispersez le reste par la mitraille s'il le faut. Laissez le jacobinisme et la révolte, avec un cruel désespoir, fuir dans l'espace infini, chassés par la mitraille. Tonnez sur la France par la bouche des canons ; ordonnez à la révolte de cesser et ne la suppliez pas. Régnez ensuite avec la plus large constitution possible ; rendez la justice, aimez la générosité ; soyez le pasteur de ce peuple indigent et non son tondeur ou un simulacre de pasteur. Faites cela si vous osez. Si vous n'osez pas, alors, au nom du ciel, allez vous coucher ; je ne connais pas d'autre alternative convenable. Je crois même que cela pourrait se faire : il suffirait d'un homme qui en soit capable. Car si un gouffre aussi indescriptible de confusions babyloniennes — tel que notre époque — ne peut être calmé par un seul homme, s'il faut pour cela du temps et des hommes, un seul homme peut modérer ses fureurs, peut les contre-balancer et les dominer et se tenir sur son bord sans être englouti, ainsi que plusieurs hommes et plusieurs rois l'ont fait dans ces jours. Un homme peut beaucoup ; les hommes obéissent à l'homme qui sait — Kens — et qui peut — Cans — et ils l'appellent respectueusement Kenning ou King, roi. Charlemagne ne commanda-t-il pas ? Voyez s'il a eu des temps bien doux pour commander ; il pendit quatre mille Saxons sur le pont du Weser, lors d'une redoutable attaque Qui sait, peut-être existe-t-il, l'homme capable, dans cette même France divisée et fanatique ? Un homme taciturne au teint olivâtre, en ce moment lieutenant d'artillerie, et qui a autrefois étudié les mathématiques à Brienne ? Le même qui se promenait le matin en corrigeant des épreuves à Dôle et partageait un déjeuner frugal avec M. Joly ? Oui, un tel homme est né dans le pays du célèbre général Paoli, son ami, pour voir de vieilles scènes dans sa Corse natale et pour essayer ce que la démocratie peut produire de bon. La royauté n'en finit pas d'exécuter son plan d'évasion,
et cependant elle ne l'abandonne pas ; son espoir est variable ; elle est
indécise en attendant que la fortune décide. On commence dans le plus grand
secret une correspondance active avec Bouillé ; il existe aussi un plan, qui
apparaît plus d'une fois, celui de conduire le roi à Rouen[10] : plan sur plan,
naissant et disparaissant comme les ignes fatui
en temps d'orage, tout cela ne conduit à rien. Vers
les dix heures du soir, le Représentant Héréditaire joue au whist, en
partie carrée, avec la reine, avec Monsieur son frère, et avec Madame.
L'écuyer Campan entre mystérieusement et apporte un message qu'il ne comprend
qu'à moitié : un certain comte d'Inisdal attend avec anxiété dans
l'antichambre ; le colonel national, capitaine de service cette nuit, est
gagné ; des chevaux de poste sont prêts tout le long de la route ; une partie
de la noblesse se tient sous les armes et est décidée à agir ; Sa Majesté
veut-elle consentir à partir avant minuit ? Silence profond ; Campan attend,
l'oreille tendue. Votre Majesté a-t-elle entendu ce
qu'a dit Campan ? demanda la reine. Qui, je
l'ai entendu, dit Sa Majesté en continuant à jouer. Campan vient de dire un joli couplet, ajouta
Monsieur qui de temps à autre faisait le plaisant. Sa Majesté continue toujours
à jouer sans répondre. Après tout, il faut dire
quelque chose à Campan, remarque la reine. Dites
à M. d'Inisdal, répondit le roi, et la reine appuya sur ces paroles, dites à M. d'Inisdal que le roi ne peut pas consentir à
être enlevé. — Je le vois ! dit
d'Inisdal, en s'en allant et en s'enflammant de colère : nous courons le risque et nous devons recevoir le blâme si
l'entreprise échoue[11]. Il disparaît,
son plan s'évanouit comme un feu de paille. La reine resta jusque tard dans
la nuit, à emballer ses joyaux. : mais ce fut inutile ; dans la pâle flamme
de la colère s'était éteint le feu de paille. Dans tout cela il y a fort peu d'espoir. Hélas ! avec qui fuir ? nos fidèles Gardes du corps sont dispersés depuis l'insurrection des femmes ; ils sont retournés chez eux ; plus d'un s'est dirigé du côté du Rhin vers Coblentz et les princes exilés : le brave Miomandre et le brave Tardinet, ces deux fidèles, ont reçu dans une entrevue nocturne avec les deux majestés, leur viatique en louis d'or et des - remercîments sincères des lèvres de la reine ; malheureusement Sa Majesté se tenait le dos au feu sans parler[12] ; maintenant ils traversent les provinces en dînant et en racontant minutieusement leur évasion et les horreurs insurrectionnelles. De grandes horreurs, mais qui disparaissent devant d'autres plus grandes encore. Mais en somme, quelle chute de l'ancienne splendeur de Versailles ! Ici dans ces pauvres Tuileries, un brasseur colonel national, le sonore Santerre, parade officiellement derrière la chaise de Sa Majesté. Nos hauts dignitaires se sont tous enfuis de l'autre côté du Rhin : il n'y a plus rien à gagner à présent à la cour ; il ne reste que des espérances pour lesquelles on risquerait sa vie. D'obscurs hommes d affaires fréquentent les escaliers dérobés ; avec leurs ouï-dire, leurs projets en l'air et leurs fanfaronnades inutiles. De jeunes royalistes, au théâtre du Vaudeville, chantent des couplets, comme si cela pouvait servir à quelque chose. On peut aussi rencontrer des capitaines en congé, des seigneurs incendiés, au café de Valois et chez Méat le restaurateur. Là ils s'excitent les uns les autres dans leur ardeur loyale ; ils boivent les vins qu'ils peuvent se procurer, à la confusion du sans-culottisme ; ils montrent des poignards perfectionnés et faits sur commande, et osant beaucoup, ils dînent[13]. C'est dans ces endroits et à l'époque dont nous parlons que l'épithète de sans-culotte fut appliquée pour la première fois au patriotisme indigent ; dans le siècle passé, nous avions Gilbert Sans-culotte le poète indigent[14]. Être privé de culotte : triste privation ; mais si vingt millions la supportent, elle devient plus efficace que la plupart des possessions ! Cependant, au milieu de ce vague et obscur tourbillon de fanfaronnades, de projets en l'air, de poignards faits sur commande, il se révéla un punctum saliens de vie et de possibilité : le doigt de Mirabeau ! Mirabeau et la reine de France se sont vus ; ils se sont séparés avec une confiance mutuelle ! C'est une chose étrange, secrète comme un mystère ; mais il n'y a pas à en douter. Mirabeau monte un soir à cheval ; il se dirige d'une manière tout à fait inattendue, vers l'ouest, pour voir son ami Clavière à sa maison de campagne ? Avant d'entrer chez son ami Clavière, le cavalier rêveur alla frapper à une porte de derrière du jardin de Saint-Cloud : un certain duc d'Aremberg ou quelque autre, était là pour l'introduire ; la reine n'était pas loin : c'est sur le rond-point le plus élevé du jardin de Saint-Cloud qu'il aperçut la figure de la reine ; il lui parla, seul avec elle sous le vide dôme de la nuit. Quelle entrevue ; après toutes nos recherches, elle reste pour nous un secret plein de mystères, comme le serait un colloque des dieux[15] ! Elle l'appelait Mirabeau, nous avons lu quelque part qu'elle en fut charmée, de ce sauvage Titan, maintenant soumis. Une des qualités les plus honorables de ce grand cœur, si malheureux, fut sans contredit de reconnaître, en dépit de tous les préjugés, toute espèce de talent en présence duquel elle se trouvait et de s'approcher avec confiance de Mirabeau, de Barnave et de Dumouriez. Noble cœur impérial, il éprouvait une attraction instinctive pour tout ce qui avait quelque élévation ! Vous ne connaissez pas la reine, dit un jour Mirabeau dans une confidence ; sa force d'âme est prodigieuse ; elle est homme par son courage[16]. Ainsi, dans le silence de la nuit, sur le sommet de ce petit monticule, la reine a parlé à Mirabeau ; celui-ci a baisé loyalement la main royale et dit avec enthousiasme : Madame, la monarchie est sauvée ! — Possible ? Les puissances étrangères, mystérieusement sondées, donnent des réponses favorables[17] ; Bouillé est à Metz et pourrait trouver quarante mille Allemands sûrs ; avec un Mirabeau comme tête, un Bouillé comme bras, on peut réellement faire quelque chose, si le destin n'intervient pas. Mais figurez-vous de quel voile aux mille plis, de quel manteau d'obscurité la royauté devait s'envelopper pour méditer ces choses. Il y avait des hommes avec des billets d'entrée ; il y avait des chevaliers consultants, de mystérieux conspirateurs. Songez si, enveloppée comme elle l'est, la royauté conspirante peut échapper à l'œil scrutateur du patriotisme, aux yeux de lynx, au nombre de dix mille, fixés sur elle et voyant dans les ténèbres ! Le patriotisme connaît la plupart de ces choses ; il connaît les poignards faits sur commande et peut désigner les boutiques où on les a pris ; il connaît les légions de mouchards du sieur Motier ; les billets d'entrée, les hommes noirs ; il sait comment un plan d'évasion succède à l'autre, ou semble lui succéder. Rappelez-vous aussi les couplets chantés au théâtre du Vaudeville ; ou ce qui est pire, les chuchotements et les mouvements de tête significatifs des traîtres en moustaches. Enfin, imaginez-vous les hauts cris d'alarme poussés par les cent trente-trois journaux de Paris et l'oreille de Denys des 48 sections veillant nuit et jour. Le patriotisme est patient, mais sa patience a une limite. Le café de Procope a envoyé, visiblement le long des rues de Paris, un députation de patriotes, pour adresser aux mauvais éditeurs des remontrances en paroles pleines de confiance ; c'était curieux à voir et à entendre. Les mauvais éditeurs promirent de s'amender, mais ne le firent point. Il y eut plusieurs députations chargées de demander le changement des ministres ; le maire Bailly se joignait même au cordelier Danton ; et ils ont réussi. A quoi cela servit-il ? Des charlatans par nature ou des charlatans forcés de l'être, la race est éternelle. Les ministres Duportail et Dutertre sont-ils plus à ménager que les ministres La Tour du Pin et Cicé. Ainsi roule le monde dans sa confusion. Qu'est-ce donc que le pauvre patriote français, dans ces jours malheureux, lui qui est poussé par les influences et les évidences les plus contradictoires ; que doit-il croire, qui doit-il suivre ? Tout est incertitude, excepté son malheur et son indigence ; une glorieuse révolution, merveille de l'univers, ne lui a procuré ni la paix ni du pain ; elle est corrompue par des traîtres difficiles à découvrir. Des traîtres qui habitent les ténèbres et qui sont invisibles, ou qu'on aperçoit par moments dans un crépuscule pâle et douteux, dans lequel ils s'évanouissent clandestinement. La suspicion surnaturelle remplit de nouveau l'esprit des hommes. Personne ici, écrit Carra, déjà au commencement de février, dans les Annales patriotiques, personne ne peut douter de l'existence des projets continuels que forment ces gens pour enlever le roi ni de la succession perpétuelle des manœuvres qu'ils emploient pour cela. Personne : la vigilante mère du patriotisme députa deux de ses membres à ses filles de Versailles, pour examiner où en étaient les choses. Bien, et là ? Le patriotique Carra continue : Le rapport de ces deux députés, nous l'avons tous entendu de nos propres oreilles samedi dernier. Ils sont allés, avec d'autres membres de Versailles, inspecter les étables des ci-devant Gardes du corps ; ils y ont trouvé de sept à huit cents- chevaux toujours sellés et bridés, prêts à marcher au premier avis. De plus, ces mêmes députés ont vu de leurs propres yeux plusieurs voitures royales sur lesquelles des hommes étaient occupés à charger des sacs à bagages bien garnis, des vaches de cuir, comme on les appelle ; les armes royales étaient à peu près complètement effacées des panneaux. Assez important ! De plus, le même jour toute la maréchaussée ou police à cheval devait s'assembler avec armes, chevaux et bagages, et se disperser de nouveau. On avait besoin du roi sur les frontières, afin que l'empereur Léopold et les princes allemands dont les troupes étaient prêtes eussent un prétexte pour commencer ; ceci, ajoute Carra, est le mot de l'énigme : c'est là la raison pour laquelle nos aristocrates fugitifs font des levées d'hommes sur les frontières ; espérant qu'un de ces matins, le magistrat chargé du pouvoir exécutif sera conduit au milieu d'eux et qu'ils pourront commencer la guerre civile[18]. Oui, si le magistrat chargé du pouvoir exécutif, emballé, c'est-à-dire enfermé dans une de ces vaches de cuir, était amené sain et sauf au milieu d'eux ! Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que le patriotisme, ou bien aboyant à l'aventure ou bien guidé par quelque instinct de sagacité surnaturelle, aboie à bon droit cette fois-ci ; pour quelque chose et non pour rien. La correspondance secrète de Bouillé, rendue publique depuis, le prouve. De plus, il est indubitable, visible pour tous, que Mesdames, les tantes du roi prennent des dispositions pour partir ; elles demandent des passeports au ministère, des sauf-conduits à la municipalité ; Marat engage tout le monde à les surveiller. Elles emporteront de l'or, ces vieilles béguines ; elles emporteront le petit Dauphin, elles ont élevé depuis quelque temps un enfant supposé pour le laisser à sa place ! D'ailleurs elles font l'office d'une substance légère qu'on lance en l'air pour voir de quel côté tourne le vent ; espèce de cerf-volant d'essai qu'on fait partir afin de constater, si le grand cerf-volant en papier, l'évasion du roi, peut s'élever ! Dans ces circonstances alarmantes, le patriotisme ne se fait pas défaut à lui-même. La municipalité députe vers le roi ; les sections envoient des députations à la municipalité ; l'Assemblée nationale va s'émouvoir. Mais voici que le 19 février 1791, Mesdames quittent Bellevue et Versailles en grand secret, et partent ! Pour aller à Rome, à ce qu'il paraît, ou pour aller on ne sait où. Elles n'étaient pas sans passeports du roi, contre-signés ; et qui plus est, elles sont accompagnées d'une escorte serviable. Le patriotique maire ou mairelet du village de Moret essaya de les arrêter ; mais le vif Louis de Narbonne, qui fait partie de l'escorte, poussa un petit galop et revint bientôt avec trente dragons, délivrer Mesdames. Et ainsi ces pauvres vieilles dames purent continuer leur route, au grand effroi de la France et de Paris dont l'excitabilité nerveuse a atteint son plus haut degré. Qui empêcherait sans cela ces pauvres Loque et Graille de partir ; elles sont devenues si vieilles et se trouvent dans des circonstances si inattendues, que l'idée même des terreurs et des horreurs afflige leur esprit ; elles ne peuvent même pas trouver un confesseur orthodoxe ; — et vous les empêcheriez d'aller là où les appelle l'espoir de quelque consolation ? Elles vont ces pauvres vieilles dames, dont le cœur était endurci au point de ne plus avoir pitié : elles vont ; avec des palpitations et des cris étouffés fort peu mélodieux ; toute la France crie et glousse, derrière elles et autour d'elles avec une terreur non étouffée : tant la suspicion mutuelle existe parmi les hommes. A Arnay-le-Duc, à peu près à mi-chemin de la frontière, une municipalité et une populace patriotiques ont de nouveau le courage de les arrêter. Louis de Narbonne est obligé de retourner à Paris consulter l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale répond, non sans difficultés, que Mesdames peuvent partir. Là-dessus Paris s'agite de nouveau, à moitié fou, en poussant des cris. Les Tuileries et leurs environs sont remplis d'hommes et de femmes, pendant que l'Assemblée nationale discute cette question des questions : Lafayette est obligé de les disperser vers la nuit, et les rues de Paris furent illuminées. Le commandant Berthier, Berthier devant qui de grandes choses sont inconnues, est bloqué dans Versailles. Aucune tactique ne lui avait réussi pour amener ici les bagages de Mesdames ; lès femmes frénétiques de Versailles vinrent l'entourer en criant ; ses propres troupes coupèrent les traits de la voiture ; lui se retira à l'intérieur en attendant des temps meilleurs[19]. Pendant que Mesdames, arrachées de Moret à coups de sabre, courent rapidement vers les frontières, avant d'être arrêtées à Arnay, leur auguste neveu, le pauvre Monsieur, descend à Paris dans ses caves du Luxembourg pour s'y cacher ; et d'après Montgaillard on peut difficilement lui persuader de remonter. Une multitude hurlante, attirée par le bruit de son départ, environne le Luxembourg ; mais à la vue de Monsieur, elle commence à chanter et escorte Madame et lui aux Tuileries en poussant des vivat[20]. C'est là un état de surexcitation nerveuse que peu de nations connaissent. V. — LE JOUR DES POIGNARDS.Mais que signifie donc la réparation ostensible du château de Vincennes ? Les autres prisons étant pleines de prisonniers, on vient chercher ici un nouvel espace : c'est là la raison que donne la municipalité. Car dans un pareil changement de judicature, les parlements ayant été abolis et de nouvelles cours venant d'être établies, les prisonniers s'étaient accumulés. Inutile de dire que dans ces temps de désordre où régnait la loi du plus fort, les délits et les arrestations étaient plus nombreuses à un certain point de vue. La raison donnée par la municipalité explique-t-elle suffisamment cette réparation ? Certes la réparation du château de Vincennes était de toutes les entreprises que pouvait faire une municipalité éclairée, la plus innocente. Cependant le faubourg Saint-Antoine n'est pas de cet avis : ces tourelles pointues et ces tristes donjons, étaient trop près de ses propres habitations obscures et le choquaient. Vincennes n'était-ce pas une petite Bastille ? Le grand Diderot et d'autres philosophes ont été emprisonnés à Vincennes ; le grand Mirabeau y a passé quarante-deux mois d'une éclipse désastreuse. Et maintenant que la vieille Bastille est devenue une place de danse — si quelqu'un a encore envie de danser — et que ses pierres ont servi à construire le pont Louis XVI, cette petite Bastille insignifiante en comparaison de l'autre, se flanque de tourelles fraîchement découpées et étend ses ailes tyranniques, en menaçant les patriotes ? Une nouvelle place pour des prisonniers ; et pour quels prisonniers ? D'Orléans avec les principaux patriotes de l'extrême gauche ? On le dit, un passage souterrain conduit des Tuileries jusqu'ici. Qui sait ? Paris miné par des carrières et par les catacombes, est merveilleusement suspendu au-dessus de l'abîme ; Paris pourrait sauter en l'air, quoique la poudre, si nous y regardons de près, ait été enlevée. Des Tuileries, vendues à l'Autriche, il y aurait un passage souterrain. Coblentz ou l'Autriche ne pourraient-elles pas sortir un beau matin de ces souterrains ; et avec des canons à longue portée, foudroyer le patriotique faubourg Saint-Antoine et le réduire en poussière et en ruines ! Telles sont les réflexions de l'âme assombrie de Saint-Antoine en voyant des hommes en tablier, travailler sur ces tours, dans les premiers jours du printemps. Une municipalité au langage officiel, un sieur Motier avec ses légions de mouchards n'inspirent pas du tout la confiance. Le patriote Santerre est commandant, c'est vrai ! Mais le sonore brasseur ne commande que nos propres bataillons : il ne peut éclaircir de pareils secrets, il n'a connaissance de rien, peut-être soupçonne-t-il beaucoup. Et le travail avançait, et Saint-Antoine, sombre et affligé, entend les coups de marteau et voit les pierres hissées en l'air[21]. Saint-Antoine a renversé la grande Bastille : hésitera-t-il devant ce simulacre insignifiant de Bastille ? Amis, si nous prenions des piques, des fusils et des marteaux ; si nous nous aidions nous-mêmes. — Plus tard il n'y aura plus de remède ; ou plus de remède aussi certain. Le 28 février, Saint-Antoine sort de son quartier comme il l'a déjà fait souvent ; il le fait apparemment avec un peu trop de tumulte, il se dirige vers l'est du côté de ce Vincennes qui afflige sa vue. Saint-Antoine, sans s'effrayer et sans pousser des cris de joie, signifie d'une voix pleine d'autorité, aux parties intéressées, que le but qu'on se propose est celui de voir cette inquiétante prison forte, rasée au niveau du sol de la contrée. Il se peut qu'on fasse des remontrances avec beaucoup de zèle ; mais cela ne sert à rien. Les portes extérieures s'ouvrent, les ponts-levis tombent, les barreaux de fer des fenêtres, enlevés à coups de marteaux, deviennent autant de leviers en fer ; il pleut une pluie d'outils, de masses de pierres, d'ardoises : la démolition fait tout tomber avec un fracas et un bruit chaotiques. Déjà des courriers traversent à la hâte les rues agitées de Paris, pour aller avertir Lafayette et les autorités municipales et départementales ; la rumeur publique avertit l'Assemblée nationale, les royales Tuileries et tous ceux qui prennent la peine d'écouter : que Saint-Antoine s'est levé ; que Vincennes et probablement la dernière institution de la contrée, va tomber[22]. Vite, donc ! que Lafayette fasse battre le tambour et qu'il se dirige vers l'est ; pour tous les patriotes constitutionnels ce sont là de mauvaises nouvelles. Et vous, amis de la royauté, saisissez vos poignards perfectionnés, faits sur commande, vos cannes à épée, vos armes secrètes et vos billets d'entrée ; vite, courez par les escaliers dérobés, entourer le fils de soixante rois. Il se produit sans doute une effervescence parmi les d'Orléans et compagnie, pour renverser le trône et l'autel : on parle de mettre Sa Majesté en prison, de la mettre de côté : que sera alors Sa Majesté ? De l'argile pour le potier sans-culotte ! Ou serait-il possible de fuir aujourd'hui ; une brave noblesse se ralliant soudainement ? Le danger menace, l'espoir convie : ducs de Villequier, de Duras, gentilshommes de la chambre, donnez des billets et des admissions ; une brave noblesse se rallie soudain. Maintenant ce serait le moment de tomber le sabre à la main sur ces gaillards, on pourrait le faire utilement. Le héros de deux mondes est sur son cheval blanc ; les gardes nationaux bleus, à cheval et à pied, se dirigent en toute hâte vers l'Est ; Santerre avec le bataillon de Saint-Antoine s'y trouve déjà ; apparemment incapable d'agir. Oh ! héros des deux mondes, lourdement chargé, quelle tâche que tu as là ! Les railleries, les gambades provocantes de ce faubourg patriotique, qui est tout entier dans les rues, sont difficiles à digérer ; des patriotes non lavés le raillent en termes bourrus ; un patriote non lavé saisit le général par la botte et essaie de le démonter. Santerre qui a reçu l'ordre de faire feu, répond d'une manière évasive : Ce sont les hommes qui ont pris la Bastille, et aucun coup de fusil ne partit. La magistrature de Vincennes n'osa donner aucun ordre d'arrestation ni le moindre appui : aussi le général prendra-t-il sur lui de faire des arrestations. De la promptitude, une habileté enjouée, une patience et un courage sans bornes, et l'émeute peut de nouveau être apaisée sans que le sang coule. Pendant ce temps, le reste de Paris peut considérer avec plus ou moins d'indifférence le reste de ses affaires : car qu'est-ce, sinon une effervescence telle qu'il y en a tant de nos jours ? L'Assemblée nationale dans une de ses séances orageuses discute une loi contre l'émigration ; Mirabeau déclare hautement : Je jure à l'avance que je ne lui obéirai pas. Mirabeau monte souvent à la tribune ce jour-là ; avec de continuels empêchements du dehors ; avec sa vieille énergie qui n'a pas baissé ! Que peuvent faire à cet homme les murmures et les clameurs de la gauche ou de la droite ? Il est impassible comme Ténériffe ou Atlas. Sa pensée est claire, sa forte voix de basse, quoique d'abord sourde et incertaine, force l'attention et domine les tempêtes des hommes ; peu à peu elle s'élève, elle s'adoucit, elle se transforme en une mélodie pleine de vigueur, qui triomphe, qui subjugue tous les cœurs ; sa figure aux traits rudes, ravagée par le feu, devient brillante de feu et rayonne : on comprend une fois de plus, dans ces temps malheureux, la puissance et l'omnipotence de la parole humaine sur les hommes. Je triompherai ou je serai brisé, dit-il une fois. Silence, s'écrie-t-il maintenant d'une voix de commandement énergique, dans la conscience impériale de sa force. Silence aux trente voix ! Et Robespierre et les trente voix cessèrent de murmurer ; et la loi fut une fois de plus telle que Mirabeau la voulait. Combien est différente au même instant, l'éloquence de rue du général Lafayette, discutant avec le sonore brasseur, avec un Saint-Antoine ingrammatical ! Plus différente encore, de toutes les deux, est l'éloquence du café de Valois et les fanfaronnades supprimées de cette multitude d'individus avec billets d'entrée, qui inondent les corridors des Tuileries. De pareilles choses peuvent se passer simultanément dans une cité ; plus souvent encore dans une contrée ; dans une planète avec ses contradictions, chaque jour une infinité de contradictions pétillantes, — qui produisent cependant un produit net, cohérent quoique infiniment petit. Quoi qu'il en soit, Lafayette a sauvé Vincennes et il s'en retourne avec une douzaine de démolitionistes arrêtés. La royauté n'est pas encore sauvée ; elle n'est certes pas particulièrement en danger. Mais la garde constitutionnelle du roi, ces anciennes gardes françaises ou grenadiers du centre comme on les appelle maintenant, comprennent de moins en moins ce que signifie cette affluence d'hommes avec des billets d'entrée. Sa Majesté doit-elle réellement se diriger sur Metz ; être enlevée par ces hommes mettant à profit les circonstances du moment ? Cette révolte de Saint-Antoine servirait-elle de prétexte à ces traîtres royalistes ? Grenadiers du centre, jetez un coup d'œil profond sur votre devoir : jamais le bien ne nous est venu des hommes noirs. De plus, ils ont des redingotes ; quelques-uns portent des culottes de cuir, des bottes, comme s'ils allaient se mettre à cheval ! Qu'est-ce qu'on aperçoit donc sous l'habit du chevalier de Cour[23] ? Cela ressemble beaucoup à la poignée d'un instrument tranchant ou d'un poignard ! Il glisse, il marche ; et toujours la petite dague s'aperçoit sur le côté gauche de son habit. Arrêtez, Monsieur ! Un grenadier du centre l'empoigne, empoigne la dague qui fait saillie, la sort en face du monde : Ciel, un véritable poignard, un couteau de chasse comme vous voudrez l'appeler, fait pour boire la vie du patriotisme ! C'est là ce qui arriva au chevalier de Cour, vers la fin du jour ; non sans cris, non sans commentaires. Et cette multitude qui va en croissant à la tombée de la nuit ? Ont-ils aussi des poignards ? Hélas ! eux aussi ; après des pourparlers irrités, on a commencé à les toucher, à les fouiller ; tous les hommes noirs, malgré leurs billets d'entrée sont saisis par le collet et fouillés. Quel scandale, quand on y songe : toujours on trouve, un poignard, une canne à épée, un pistolet, voire même de simples poinçons de tailleurs ; on les leur enlève avec grand mépris, et chaque fois on lance le malheureux un peu trop rapidement en bas des escaliers. Il est lancé, et descend ignominieusement, la tête la première ; on accélère sa descente par des coups ignominieux qu'on lui donne de sentinelle en sentinelle ; de plus on le frappe, on le tiraille, il reçoit des coups de pied à posteriori, en un endroit qu'on ne peut nommer. Par cette voie accélérée, hommes noirs sur hommes noirs tombent par toutes les issues dans le jardin des Tuileries sans trop savoir s'ils ont la tête en l'air. Ils tombent, hélas ! dans les bras d'une multitude indignée, rassemblée ou se rassemblant à l'heure de la brune pour voir ce qu'il y a et si le Représentant Héréditaire est enlevé ou non. Malheureux hommes noirs, convaincus enfin d'avoir des poignards faits sur commande, convaincus d'être des chevaliers du poignard ! A l'intérieur c'est un vaisseau en feu, à l'extérieur une nuit profonde. A l'intérieur, point de remède : Sa Majesté, regarda un instant hors de son sanctuaire intérieur, ordonna froidement à tous les visiteurs de rendre leurs armes et ferma de nouveau la porte. Les armes rendues forment un tas ; les chevaliers convaincus du poignard, descendent pêle-mêle avec une rapidité impétueuse ; au pied de tous les escaliers, une multitude mélangée les reçoit, les pousse, leur donne des coups de poing, les chasse et les disperse[24]. Tel fut le spectacle que trouva Lafayette en revenant, au crépuscule du soir, de Vincennes où il avait eu de la difficulté à vaincre : échappé à peine au sans-culotte Scylla, il trouve sur son chemin l'aristocrate Charybde ! Le patient héros de deux mondes en perd presque l'esprit. Il accélère, au lieu de les retarder, les chevaliers en fuite ; il délivre bien çà et là un royaliste de qualité, mais le gronde en termes amers, selon l'inspiration du moment ; jamais salon ne pourrait lui pardonner ces termes. Héros moitié bon, moitié mauvais ; se soutenant pour ainsi dire au milieu de l'air ; détesté par les riches divinités qui sont au-dessus de lui ; détesté par les mortels indigents qui sont au-dessous de lui. Le duc de Villequier, gentilhomme de la chambre, reçut des reproches si injurieux devant tout le peuple, qu'il trouva bon de se justifier dans les journaux ; ensuite, voyant qu'il ne réussissait guère, il se retira au delà des frontières et commença à comploter à Bruxelles[25]. Son appartement reste vacant ; nous verrons qu'il rendit plus de services que quand il était occupé. Ainsi fuient les chevaliers du poignard ; chassés par les patriotes, ils fuient honteusement pendant que le crépuscule s'épaissit. Quelle misérable et sombre affaire ; née dans les ténèbres, morte à la fin du crépuscule, dans l'obscurité. Au milieu de tout cela, le lecteur aperçoit nettement une figure courant pour sa vie : Crispin-Catiline-d'Esprémesnil, pour la dernière fois ou la dernière moins une. Il n'y a pas encore trois ans depuis que ces mêmes grenadiers du centre, alors gardes françaises, marchaient avec lui vers l'île de Calypso, à l'aurore d'une journée de mai ; et lui et eux sont allés si loin. Battu à coups de poings, renversé, délivré par le populaire Pétion, il peut bien répondre amèrement : Et moi aussi, monsieur, j'ai été porté par les épaules du peuple[26]. Heureusement, d'une manière ou d'une autre, la nuit tardive couvre ce jour ignominieux des poignards : et les chevaliers s'échappent, quoique maltraités, avec les basques de leurs habits déchirées et le cœur lourd, ils regagnent leurs habitations respectives. L'émeute est deux fois réprimée ; peu de sang a été versé, si ce n'est le sang indifférent des nez : Vincennes est debout, non démoli, réparable, et le Représentant Héréditaire n'a pas été volé, ni la reine escamotée en prison. Jour mémorable : commenté avec de bruyants ha ! ha ! et de profonds murmures, avec l'amer dédain du triomphe et l'amère rancune de la défaite. Le royalisme, comme d'habitude, en accuse d'Orléans et les anarchistes qui voulaient insulter Sa Majesté ; le patriotisme, comme d'habitude, accuse les royalistes et même les constitutionnels d'avoir voulu voler Sa Majesté pour la mener à Metz : nous, comme d'habitude aussi nous en accusons la suspicion surnaturelle et Phœbus Apollon l'ayant rendue noire comme la nuit. Ainsi le lecteur a vu, sur un champ de bataille imprévu, ce dernier jour de février 1791, les trois éléments longtemps contenus de la société française en venir à une collision singulière, comico-tragique ; agissant et réagissant ouvertement sous les yeux de tous. Le constitutionnalisme est grand ce jour-là et domine à la fois en domptant l'émeute sans-culottique de Vincennes et la trahison royaliste des Tuileries. Quant au pauvre royalisme, bousculé de côté et d'autre, forcé de mettre ses armes en un tas, que pensez-vous de lui ? Chaque chien, dit le proverbe, a son jour, l'a eu, ou l'aura. Pour le moment, Lafayette et la Constitution ont leur jour. Cependant la faim et le jacobinisme marchent rapidement vers le fanatisme, ils travaillent ; leur jour, quand ils seront fanatiques, viendra. Jusqu'ici, dans toutes les tempêtes, Lafayette, semblable à quelque divin gouverneur de la mer, relève sa tête sereine : les souffles les plus violents d'Éole retournent dans leurs cavernes, comme des vents fous qu'on n'a pas demandés : les vagues qu'ils ont soulevées s'adoucissent d'elles-mêmes et se changent en écume. Mais si, comme nous l'avons souvent dit, le pouvoir de feu, titanique sous-marin, vient en jeu, si le lit de l'Océan éclate par le bas ? S'ils lancent Neptune Lafayette et sa constitution hors de l'espace, et si dans la mêlée titanique, la mer est mélangée avec le ciel ? VI. — MIRABEAU.L'esprit de la France devient de jour en jour plus aigre et plus fiévreux ; tendant à un éclat final de dissolution et de délire. Le soupçon tient tous les esprits ; les partis en lutte ne peuvent plus désormais se rapprocher ; ils restent éloignés sans mélange, s'observant les uns les autres dans l'état le plus fiévreux de froide terreur ou de rage ardente. Contre-révolution, journée des poignards, duel de Castries, fuite de Mesdames, de Monsieur et de la royauté ! Le journalisme pousse toujours plus haut ses cris d'alarme. Combien elle devient fine l'oreille toujours ouverte, comme celle de Denys, des 48 sections ; ébranlée par des secousses qui bouleversent toute sa substance, elle est dans l'état d'une oreille malade ou toujours en éveil. Puisque les royalistes portent des poignards faits par ordre pour eux, et que le sieur Motier ne vaut pas mieux qu'un autre, pourquoi le patriotisme, malgré sa misère et dans sa promptitude à exagérer, ne se procurera-t-il pas de rencontre des piques et des fusils ? Durant le mois de mars, on entend retentir les enclumes, qui martèlent des piques. Une municipalité constitutionnelle a affiché des placards promulguant, que nul citoyen, excepté ceux en activité ou les citoyens payant, n'a le droit de porter des armes ; mais aussitôt surgit comme une tempête d'étonnement de la part du club et de la section ; un nouveau placard constitutionnel, édition improvisée, va dès le lendemain matin couvrir le premier et le réduire à néant. Le forgeage des armes continue, avec tout ce que les événements présagent. Remarquez, d'ailleurs, combien l'extrême gauche monte en faveur, sinon dans l'assemblée générale, du moins dans toute la nation et surtout à Paris. Car dans une telle indécision et une panique si générale, l'opinion qui est sûre d'elle-même, quelque faible du reste qu'elle soit, est la seule à laquelle tout le monde se rallie. Fût-elle plus faible que jamais, elle inspire alors une grande confiance et s'empare de tous les esprits indécis. L'incorruptible Robespierre a été élu accusateur public, dans la nouvelle cour de justice ; le vertueux Pétion, pense-t-on, peut se présenter pour être maire. Le cordelier Danton, élu aussi par de triomphantes majorités, s'assied à la table du conseil départemental, et devient le collègue de Mirabeau. Depuis longtemps on avait prédit que Robespierre irait loin, quelque maigre personnage qu'il fût : car le doute n'habitait pas en lui. En face de pareilles circonstances, la royauté ne devait-elle pas cesser ses hésitations, mais se décider et agir ? La royauté a de toute façon un atout sûr en main ; la fuite hors de Paris. Et cet atout si sûr, comme vous le voyez, la royauté de temps en temps le prend et tente de le faire avancer, mais jamais elle ne le pose sur table, toujours elle le fait reculer et le reprend. Joue-le donc, ô royauté. Si tu abandonnes, comme il semble, cette chance de salut, c'est vraiment la dernière et maintenant chaque heure la rend plus douteuse. Hélas ! on voudrait ainsi également fuir et ne pas fuir ; jouer son atout et l'avoir toujours en main. La royauté, d'après toutes les prévisions, ne veut jouer son atout qu'après avoir vu tomber toutes ses chances l'une après l'autre ; et alors quand elle le jouera, ce sera la fin soudaine du jeu. Ici naturellement se dresse toujours une question : que va-t-il arriver ? Elle ne peut être encore résolue. Supposez que Mirabeau, près duquel la royauté allait chercher d'importants conseils, comme auprès d'un premier ministre qu'elle ne pouvait encore avouer légalement, ait pris tous ses arrangements. Il les prend ses dispositions, développant des plans qui commencent à surgir par fragments, au milieu de la plus profonde obscurité. Trente départements sont prêts à signer de loyales adresses, dont la teneur est prescrite. Le roi sera mené hors de Paris, mais seulement à Compiègne ou à Rouen, tout au plus jusqu'à Metz, puisque, une fois pour toutes, ces canailles d'émigrants n'en auront pas la conduite ; l'Assemblée nationale consentant, à la suite de loyales adresses, par ménagement et à cause de la force de Bouillé, à entendre la raison et à la suivre. C'était ainsi, en ces termes, que le jacobinisme et Mirabeau étaient alors aux prises dans leur duel d'Hercule et de Typhon. La mort inévitable pour l'un ou pour l'autre. La lutte est ainsi devenue ouverte et sûre ; mais comment se fera-telle, ou bien plus encore, comment se terminera-t-elle ? nos conjectures sont vaines. Tout est doute et ténèbres ; que va-t-il arriver, que s'est-il déjà passé ? Le géant Mirabeau avance dans l'ombre, comme nous l'avons dit, sans compagnon sur une voie déserte. Quelles étaient ses pensées durant ces mois ? elles n'ont point été recueillies par le biographe ni par son douteux fils adoptif et maintenant elles ne seront jamais révélées ! Pour nous, qui nous efforçons de tirer son horoscope, ce moment de sa. carrière demeure doublement obscur. C'est là un homme herculéen ; dans ce duel meurtrier contre lui, c'est un monstre contre un monstre. La noblesse émigrante revient sur ses pas, l'épée sur la cuisse, se vantant que sa loyauté n'a jamais été tachée ; elle tombe du ciel, semblable à une nuée de harpies féroces et d'une avidité sans pudeur. En bas gronde la tempête de l'anarchie politique et religieuse ; s'étendant sur des centaines de têtes, que dis-je ? sur trente-cinq millions de têtes ; couvrant tout le sol français ; violente comme la fureur, forte de sa volonté. Aussi le serpent-dompteur se battra-t-il continuellement sans prendre de repos. Quant au roi, il a le caractère irrésolu du caméléon, changeant de couleur et de dessein avec la couleur des objets environnants, incapable pour l'état de roi. En une seule personne royale, la reine, Mirabeau peut placer sa confiance. Il est possible que la grandeur de cet homme, inhabile aux flatteries, aux flagorneries de courtisans, à l'adresse gracieuse, puisse, par un légitime sortilège, fasciner cette reine légère, et l'attacher à lui. Elle a le courage de toutes les nobles actions, un œil et un cœur ; l'âme de la sœur de Thérèse. Faut-il donc, écrit-elle avec passion à son frère, que moi, avec le sang que j'ai dans les veines, avec mes sentiments, je sois forcée de vivre et de mourir au milieu de pareilles gens. Hélas, oui, pauvre princesse ! Elle est, comme le fait observer Mirabeau, le seul homme que Sa Majesté ait autour d'elle. Mais d'un autre homme Mirabeau est encore plus sûr : de lui-même. Telles sont ses ressources, suffisantes ou insuffisantes. Sombre et vaste paraît l'avenir à l'œil de la prophétie. Bataille perpétuelle de vie et de mort ; confusion au-dessus, confusion au-dessous ; une simple obscurité confuse pour nous ; avec çà et là quelque lueur d'une lumière faible et olivâtre ; nous voyons un roi, mis peut-être de côté, non tonsuré, la tonsure est hors de mode maintenant ; disons plutôt, envoyé n'importe où avec un beau traitement annuel et un fonds d'outils de serrurier. Nous voyons une reine et un dauphin, une régente et un mineur ; une reine montée à cheval au milieu du bruit des batailles, avec le Moriamur pro rege nostro ! Un pareil jour viendra, écrit Mirabeau. Bruit de batailles, guerres plus que civiles, confusion en haut et en bas : c'est au milieu de tout cela que l'œil de la prophétie aperçoit le comte de Mirabeau, semblable à quelque cardinal de Retz, se maintenant lui-même, avec sa tête à tout projeter, son cœur à tout oser, sinon victorieux du moins invaincu, aussi longtemps que la vie est en lui. Comment cela se fera-t-il, quel en sera le résultat, l'œil de la prophétie ne peut le prévoir : c'est une nuit obscure et orageuse, nous le répétons ; et au milieu d'elle, tantôt visible, se lançant au loin, tantôt travaillant dans une éclipse, Mirabeau lutte indomptable pour chasser les ténèbres ! On peut dire que si Mirabeau avait vécu, l'histoire de la France et celle de l'univers eût été différente. De plus, cet homme aurait eu besoin dans toute son étendue, de cet Art d'oser, qu'il prisait tant ; lui seul, de tous les vivants, il l'aurait pratiqué et fait connaître. Finalement il aurait réalisé quelque chose de bien réel, et un certain simulacre de formule empruntée. Ce résultat vous l'auriez peut-être aimé, vous l'auriez peut-être haï ; en tout cas, ce résultat vous ne l'auriez pas rejeté sans mot dire, vous ne l'auriez pas relégué entièrement avec les choses oubliées. Si Mirabeau avait vécu une autre année ! VII. — MORT DE MIRABEAU.Mais Mirabeau ne put vivre une année de plus, pas plus qu'il n'aurait pu vivre encore pendant mille ans. Les années de l'homme sont comptées, et les années accordées à Mirabeau étaient écoulées. Un homme important ou non, destiné à vivre dans l'histoire pendant quelques siècles, ou à ne plus être nommé un ou deux jours après, peu importe au destin inexorable. Au milieu des occupations d'une vie rose et active, le pâle messager vient silencieusement vous faire signe : vastes intérêts, projets, salut de la monarchie française, n'importe ce qui nous occupe, il faut immédiatement tout quitter et partir. Fussiez-vous le sauveur de la monarchie française, fussiez-vous décrotteur sur le Pont-Neuf ! l'homme le plus important ne peut attendre ; si l'histoire du monde dépendait d'une heure, cette heure ne serait point accordée. Il en résulte que ces mêmes auraient été sont le plus souvent de la pure vanité ; et l'histoire du monde ne pourrait jamais être ce qu'elle voudrait, pourrait ou devrait être, par suite de telle ou telle possibilité, mais elle serait simplement et toujours ce qu'elle est. Les rudes frais d'entretien d'une telle existence ont usé la force de ce géant fort comme un chêne. Une agitation fiévreuse qui met en feu son cœur et son cerveau : des excès d'effort, d'excitations ; des excès de tout genre : travail incessant qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer ! Si je n'avais pas vécu avec lui, dit Dumont, je n'aurais jamais su ce qu'un homme peut faire en un seul jour ; combien de choses peuvent trouver leur place dans un intervalle de douze heures. Un jour était plus pour cet homme qu'une semaine ou un mois pour d'autres : la masse de choses qu'il menait de front était prodigieuse ; de la conception à l'exécution aucun moment n'était perdu. — Monsieur le comte, lui dit un jour son secrétaire, ce que vous demandez est impossible. — Impossible, répondit-il en se levant de sa chaise, ne me dites jamais ce bête de mot. Et les repas de société ; les dîners qu'il donnait comme commandant de la garde nationale, et qui coûtaient cinq cents livres ; hélas ! et les sirènes de l'Opéra ; et tout le gingembre qui brûle la bouche : dans quelle course cet homme est-il lancé ! Mirabeau ne peut-il s'arrêter, ne peut-il fuir et sauver sa vie ? Non ! Il y a une chemise de Nessus sur cet Hercule ; il doit tempêter et brûler, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il soit consumé. La force humaine, même herculéenne, a ses bornes. Les ombres avant-coureurs voltigent pâles à travers le cerveau brûlant de Mirabeau, hérauts du pâle repos. Pendant qu'il s'agite et tempête, forçant chacun de ses nerfs, dans cet océan d'ambition et de confusion, il lui arrive, sombre et silencieux, un avertissement : pour lui l'issue de tout cela doit être une mort rapide. En janvier dernier, vous pouviez le voir comme président de l'Assemblée nationale, son cou enveloppé de bandes de toile, à la session du soir : c'était une chaleur maladive du sang qui se traduisait par des éblouissements dans la vue ; il avait appliqué des sangsues après le travail du matin, et présidait avec ses bandages. En partant il m'embrassa, dit Dumont, avec une émotion que je ne lui avais jamais vue : Je suis mourant, mon ami, je suis consumé par un feu lent ; nous ne nous reverrons peut-être plus. Quand je serai parti, ils reconnaîtront ce que je valais. Les malheurs que j'ai retenus éclateront de tous côtés sur la France[27]. La maladie l'avertit hautement, mais il ne l'écoute point. Le 27 mars, en allant à l'Assemblée, il fut obligé d'aller se reposer et de demander des secours dans la maison de son ami Lamarck ; il y resta couché, à moitié évanoui, étendu pendant une heure sur un sofa. Il alla cependant à l'Assemblée comme en dépit du destin lui-même ; il parla d'une voix haute et violente à cinq reprises différentes ; ensuite il quitta la tribune — pour toujours. Il sortit, complètement épuisé, pour aller dans le jardin des Tuileries ; beaucoup de personnes se pressaient autour de lui, comme d'ordinaire, avec des rapports et des mémoires ; il dit à l'ami qui l'accompagnait : Fais-moi sortir de là ! Le dernier jour du mois de mars 1791, une foule anxieuse et sans fin assiège la rue de la Chaussée-d'Antin et s'informe de sa santé dans l'intérieur de la maison qui, de nos jours porte le numéro 42, et dans laquelle le géant épuisé était descendu pour mourir[28]. Une foule de personnes de tous les partis et de tout genre, de tous les rangs, depuis le roi jusqu'au plus humble citoyen ! Le roi envoyait deux fois par jour' demander publiquement de ses nouvelles, et d'autres fois sans démonstration officielle ; quant à la foule, elle ne cessait point de s'informer. Un bulletin écrit est communiqué toutes les trois heures, on le copie et on le fait circuler ; à la fin on l'imprime. Le peuple garde spontanément le silence ; aucune voiture n'ose faire entendre son bruit : il y a presse dans la foule ; mais on reconnaît la sœur de Mirabeau et on lui ouvre respectueusement un passage. Le peuple reste muet, le cœur opprimé ; il semble à tous qu'une grande calamité est proche ; comme si le dernier homme de la France qui aurait pu dominer les troubles futurs était couché là, aux prises avec une puissance non terrestre. Le silence de tout le peuple, les soins vigilants de Cabanis, son ami et son médecin, ne le sauvent pas : le samedi, deuxième jour du mois d'avril, Mirabeau sent que son dernier jour est venu, qu'il va mourir et ne plus être. Sa mort est celle d'un Titan, comme l'a été sa vie ! Rallumé une dernière fois, à la lueur de la dissolution qui est proche, l'esprit de l'homme est ardent et brûlant ; il se fait sentir par des paroles qui resteront longtemps gravées dans la mémoire des hommes. Il a envie de vivre et cependant il consent à mourir, il ne discute pas avec l'inexorable. Son langage est sauvage et merveilleux ; des fantômes qui n'ont rien de terrestre dansent maintenant leur danse au flambeau, autour de son âme ; l'âme elle-même, attentive, rayonnante de feu, sans mouvement, se prépare pour la grande heure ! De temps en temps un rayon de lumière lui arrive du monde qu'il va quitter. Je porte dans mon cœur le chant de mort de la monarchie française ; ses débris vont être la proie des factieux. Ou bien lorsqu'il entend tonner le canon, ce qui est aussi caractéristique : Sont-ce déjà les funérailles d'Achille ? De même aussi, pendant que son ami le soutient : Oui, supportez cette tête, je voudrais pouvoir vous la léguer ! car cet homme mourut comme il avait vécu, ayant conscience de lui-même, conscience du monde qui le regardait. Il regarde au dehors ce jeune printemps qui pour lui ne deviendra pas été. Le soleil s'est levé ; il dit : Si ce n'est pas là Dieu, c'est du moins son cousin germain[29]. La mort a dompté les dehors ; la faculté de parler lui est enlevée ; la citadelle du cœur tient encore : le moribond géant demande d'une manière passionnée, par signes, du papier et une plume ; il demande avec passion de l'opium pour terminer cette agonie. Le docteur affligé secoue la tête : Dormir, écrivit le malade en montrant avec emportement ce mot au médecin ! Ainsi mourut un athée et un titan gigantesque ; il entra en bronchant aveuglément, intrépide, dans son repos. A huit heures et demie du matin, le docteur Petit qui se tenait aux pieds du lit, prononça ces mots : Il ne souffre plus. Ses souffrances et ses travaux étaient terminés. Oui, multitude silencieuse de patriotes, et vous tous, hommes de la France, cet homme vous a été enlevé. Il est tombé soudain sans se courber avant de se briser, comme tombe une tour frappée par la foudre. Vous n'entendrez plus sa voix, vous ne marcherez plus sous ses auspices. La multitude s'en va, frappée au cœur ; elle répand la triste nouvelle. Comme elle est touchante cette fidélité des hommes envers leur homme souverain ! Tous les théâtres, tous les lieux d'amusement public sont fermés ; aucune réunion joyeuse ne peut se faire pendant ces nuits, la joie n'est pas pour eux : le peuple intervint dans des réunions dansantes privées et leur ordonna tristement de cesser. Il paraît que de ces réunions dansantes deux seulement furent connues, et elles furent dissoutes. Le chagrin est universel ; jamais dans cette cité il n'y eut tant de tristesse pour la mort d'un homme ; jamais depuis cette antique nuit où Louis XII mourut, et pendant laquelle les crieurs du corps allaient sonnant leurs cloches et criant le long des rues : Le bon roi Louis, père du peuple est mort ![30] Le roi Mirabeau est maintenant le roi perdu ; et on peut dire sans la moindre exagération que tout le peuple porte le deuil. Pendant trois jours on gémit à voix basse et tout haut ; on pleure à l'Assemblée nationale elle-même. Les rues sont toutes tristes, des orateurs montent sur les bornes pour faire, devant un vaste et silencieux auditoire, l'oraison funèbre du mort. Qu'aucun cocher ne se hasarde à traverser ces groupes sans faire attention, ou plutôt qu'il ne les traverse pas du tout ! Les traits de sa voiture peuvent être coupés, lui-même et ceux qu'il conduit peuvent être jetés dans le ruisseau comme aristocrates incurables. Les orateurs des bornes parlent comme il leur est donné de parler ; le peuple sans-culotte, à l'âme rude, écoute avec empressement un sermon, lorsque chaque mot signifie une chose et lorsque ce sermon n'est pas un babil sans aucune signification. Dans un restaurant du Palais-Royal, un garçon fait la remarque suivante : Il fait beau, Monsieur. — Oui, mon ami, répond le monsieur, ancien homme de lettres, il fait très-beau ; mais Mirabeau est mort. Des airs rauques et rythmés sortent des gosiers des chanteurs des rues ; on les vend imprimés sur du papier grisâtre[31]. Quant aux portraits gravés, peints, découpés et écrits, quant aux éloges, souvenirs, biographies, vaudevilles même, drames et mélodrames, il y en aura une récolte incommensurable, les mois suivants dans toutes les provinces de la France ; il y en aura en foule comme les feuilles du printemps. Pour qu'il y ait en tout cela une teinte de burlesque, le mandement de l'évêque Gobel ne fait pas défaut : cette oie de Gobel venait d'être fait évêque de Paris. Un mandement dans lequel le Ça ira alterne d'une manière vraiment étrange avec les Nomine Domini ; et vous êtes gravement invités à vous réjouir de posséder au milieu de vous un corps de prélats créé par Mirabeau, sectateurs zélés de sa doctrine, imitateurs fidèles de ses vertus. Ainsi parle et glousse la France affligée ; elle se plaint et sanglote comme elle peut, parce qu'on lui a arraché un homme supérieur. A l'Assemblée nationale, quand des questions difficiles sont sur le tapis, tous les yeux se tournent involontairement vers la place où siégeait Mirabeau, et Mirabeau est absent. Le troisième soir des lamentations, le 4 avril, eurent lieu des funérailles publiques et solennelles, telles que rarement un mortel décédé en a eu. Une procession d'une lieue de long, de cent mille personnes à ce qu'on prétend. Tous les toits étaient couverts de spectateurs, il y en avait à toutes les fenêtres, sur toutes les lanternes, sur toutes les branches d'arbres. La tristesse est peinte sur toutes les figures, beaucoup de personnes pleurent. Il y a une double haie de gardes nationaux ; on y voit l'Assemblée nationale en corps, la société des Jacobins et les autres sociétés, les ministres du roi, les municipaux et toutes les notabilités, patriotes et aristocrates. Bouillé s'y trouve avec son chapeau sur la tête, ou plutôt avec son chapeau ramené sur le front et cachant beaucoup de pensées ! Elle se déplace lentement et s'avance au milieu d'un silence religieux, éclairée par les rayons horizontaux du soleil, car il est cinq heures du soir ; elle-même avec ses panaches noirs est silencieuse ; par moments on entend les roulements étouffés des tambours, par moments les gémissements de la musique et d'étranges fanfares semblables à des chants métalliques au milieu des bourdonnements infinis de la foule. Dans l'église Saint-Eustache, une oraison funèbre est prononcée par Cerutti ; on fait une décharge d'armes à feu qui fait tomber des morceaux de plâtre. De là le cortège se dirige vers l'église Sainte-Geneviève qu'un décret suprême venait d'ériger en Panthéon des grands hommes : Aux grands hommes la Patrie reconnaissante. Les funérailles sont à peine terminées à minuit. Mirabeau est couché dans sa sombre demeure, premier locataire du Panthéon de la patrie. Locataire, hélas ! qui ne l'habite que pour le moment ; il en sera chassé. Car dans ces jours de convulsion et de consternation, la cendre des morts elle-même n'est pas laissée en repos. Les os de Voltaire vont tout à l'heure être enlevés de leur tombeau volé de l'abbaye de Seillières, pour être mis dans un tombeau plus volé encore, dans Paris, sa ville natale ; tous les mortels l'accompagnent en pérorant ; il est traîné par huit chevaux blancs, avec des conducteurs en costumes classiques, avec des bandeaux et des épis de froment, quoique le temps soit à la pluie[32]. L'évangéliste Jean-Jacques, lui aussi, ce qui est plus convenable, fut enlevé d'Ermenonville et conduit en procession, avec pompe, avec sensibilité au Panthéon de la patrie[33]. Lui et d'autres : tandis que Mirabeau, comme nous l'avons dit, en est expulsé, heureusement sans pouvoir y être replacé ; et maintenant il repose, méconnaissable, enseveli à la hâte, à la tombée de la nuit, dans la partie centrale du cimetière Sainte-Catherine dans le faubourg Saint-Marceau, pour ne plus être troublé. Ainsi s'éteignit la vie d'un homme ; il n'y a plus que des cendres et un caput mortuum ; elle s'éteignit dans ce bûcher de l'univers que nous appelons Révolution française : il ne fut pas le premier consumé, il ne fut pas le dernier à des milliers et à des millions près ! Un homme qui a avalé toutes les formules ; qui, dans ces temps et ces circonstances étranges, se sentit appelé à vivre comme un Titan et à mourir comme tel. Comme lui, de son côté, a épuisé toutes les formules, quelle formule trouverons-nous assez vaste pour exprimer le plus ou le moins de cet homme et pour nous donner l'expression exacte de son être ? Jusqu'ici il n'existe point de formule analogue. Les moralistes ne doivent pas pousser des cris et condamner Mirabeau ; là morale d'après laquelle Mirabeau pourrait être jugé n'a pas encore été écrite en langage humain. Nous dirons de nouveau de lui, qu'il est une réalité et non un simulacre, un fils vivant de la nature, notre mère à tous, et non un artifice vide, un mécanisme de conventions, fils ou frère de rien. Qu'il réfléchisse à la signification de ce petit mot, l'homme ardent qui marche, plein de douleurs, au milieu de ces individus toujours mis à la mode, jasant et grimaçant sans raison aucune et faisant horreur à une âme généreuse ! Le nombre des hommes qui vivent et voient par leurs propres yeux dans ce sens-là n'est guère grand : c'est beaucoup si, dans cette grande révolution française, on en trouve trois, malgré sa furie à tout développer. Nous voyons des mortels poussés avec frénésie, bredouillant la logique la plus âpre ; découvrant leur poitrine à la grêle des balles, leur cou à la guillotine ; il est si pénible de dire qu'eux aussi sont, en grande partie, des formalités manufacturées, non des faits, mais des ouï-dire ! Honneur à l'homme puissant, qui dans ces temps-ci, a a su rejeter tout moyen d'emprunt sans cesser d'être quelque chose. Car, pour devenir illustre, la première condition est sans contredit celle d'être quelqu'un. Que le langage hypocrite cesse, à tout risque et à tout péril : avant qu'il disparaisse, rien d'autre ne peut commencer. De tous les criminels humains de ces siècles, écrit le moraliste, je n'en trouve qu'un qui soit impardonnable : le Charlatan. Haïssable à Dieu, comme le chante le divin Dante, et aux ennemis de Dieu, A Dio spiacente ed a nemeci sui ! Mais quiconque peut, avec la sympathie qui est la première qualité essentielle pour cela, considérer de près ce Mirabeau si discutable, trouvera qu'il y a en lui, comme base de tout, de la sincérité, une ardeur grande et libre. Il appellera cela de la droiture, car cet homme voyait avant toutes choses, avec sa vision claire et brillante, ce qui était, ce qui existait comme fait ; et avec son cœur sauvage, il suivait cela et ne suivait rien d'autre. Quel que soit le chemin qu'il parcoure et sur lequel il se démène en tombant souvent, il est toujours un homme, frère. Ne le hais point ; tu ne peux le haïr ! La lumière du génie lui-même est dans cet homme ; elle brille malgré ses taches et ses flétrissures ; souvent la victoire la fait éclater, souvent aussi elle s'éclipse pendant la lutte. Jamais cet homme n'a été ni vil ni haïssable ; il a tout au plus été digne de compassion et de pitié. On dit qu'il était ambitieux, qu'il désirait devenir ministre. C'est très-vrai. Et n'était-il pas le seul homme en France qui eût pu faire un bon ministre ? Ce n'est pas la vanité seule, ni l'orgueil seul, loin de là ! De sauvages éclats d'affection étaient dans ce grand cœur ; des éclairs violents et une douce rosée de pitié. Il s'embourba dans les plus misérables défauts, on peut dire de lui comme de la Madeleine de l'antiquité, qu'il a beaucoup aimé ; son père, le plus rude des vieillards bourrus, il l'aimait avec chaleur et vénération. Ses chutes et ses folies ont été nombreuses, comme lui-même s'en plaint souvent en versant des larmes[34]. Hélas ! la vie d'un pareil homme n'est-elle pas toujours une tragédie poétique, faite de destin et de fautes volontaires, de Schicksal und eigene Schuld ; pleine de l'élément de pitié et de crainte ? Cet homme frère n'est pas pour nous un personnage épique, mais un personnage tragique ; s'il n'est pas grand, il est vaste ; vaste par ses qualités, vaste comme le monde par ses destinées. Les autres hommes, le reconnaissant tel peuvent, à travers de longs siècles, s'en souvenir et s'approcher de lui pour l'examiner et le considérer ; ceux-ci, dans leurs différents dialectes, parleront de lui en prose et en vers jusqu'à ce que la véritable chose soit dite ; et alors la formule qui peut le juger ne sera plus une formule inconnue. C'est ainsi que le sauvage Gabriel Honoré sort de la trame de notre histoire, non sans y laisser un adieu tragique. Il est parti : la fleur de la race des Riquetti ou Arrighetti ; celle-ci semble avoir fait un dernier effort pour lui donner ce qu'elle possède de mieux, pour expirer ensuite ou pour tomber au niveau ordinaire. Le vieux bourru marquis de Mirabeau, l'ami des hommes, dort profondément Le bailli Mirabeau, son digne oncle, va bientôt mourir abandonné seul. Mirabeau-Tonneau parti pour le Rhin, conduira comme un désespéré son régiment d'émigrants. Mirabeau-Tonneau, dit un de ses biographes, traversa indignement le Rhin et disciplina les régiments d'émigrants. Mais un matin, comme il était assis dans sa tente, aigri sans doute par l'estomac et par le cœur, réfléchissant dans son humeur tartaréenne sur la manière dont les affaires avaient l'air de tourner, un certain capitaine ou subalterne demande à être admis pour affaires. Ce capitaine subit un refus ; il demande de nouveau, on le refuse encore ; et puis encore une fois, jusqu'à ce que le colonel Mirabeau-Tonneau, éclatant comme un tonneau d'eau-de-vie brûlant, empoigne son épée et tombe sur cette canaille d'intrus, — hélas ! sur la pointe de l'épée d'une canaille d'intrus qui a tiré avec une grande dextérité ; et Mirabeau mourut, et les journaux parlèrent d'apoplexie et d'un accident alarmant. Ainsi moururent les Mirabeau. On n'entend plus parler de nouveaux Mirabeau : la race sauvage, ainsi que nous l'avons dit, s'est éteinte avec le plus grand des Mirabeau. Les familles et les races meurent souvent ainsi ; après une longue obscurité, elles produisent quelque quintessence vivante de toutes les qualités qu'elles possèdent, pour donner naissance à un homme connu du monde entier ; après lui, elles restent comme épuisées ; le sceptre passe à d'autres. Le dernier élu des Mirabeau est parti ; l'élu de la France est parti. C'est lui qui ébranlait la vieille France sur ses fondements ; et cependant elle ne tombait pas, comme si sa seule main avait pu l'empêcher de tomber. Que de choses dépendent d'un seul homme ! Il est semblable à un vaisseau qui se brise soudain sur des rochers enfoncés : beaucoup nagent sur les vastes eaux, loin de tout secours. |