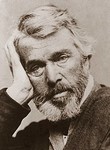HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
LA CONSTITUTION
LIVRE DEUXIÈME. — NANCY.
I. — BOUILLÉ.A Metz, sur la frontière nord-est, vivait un certain brave, nommé Bouillé, dernier refuge de la royauté dans ses difficultés et ses pensées de fuite, qui a, depuis quelques mois, passé par intervalles devant nos yeux, sinon lui, au moins son ombre. Que nos regards maintenant s'arrêtent sur lui d'une manière fixe, jusqu'à ce qu'il devienne pour nous une substance et une personnalité. L'homme lui-même en vaut la peine ; sa position et sa manière de procéder en ces jours solennels jetteront la lumière sur bien des choses. Car il en est de Bouillé comme de tous les autres officiers commandants, seulement à un degré plus prononcé. La grande fédération nationale n'a été qu'un vain bruit, ou pire, le dernier et le plus bruyant toast, à pleins verres, dans le repas de Lapithes, en l'honneur des faiseurs de constitution, comme un énergique défi aux choses existantes ; comme si, avec des acclamations, l'on pouvait fermer toute issue à l'inévitable qui déjà frappait aux portes. Ce dernier toast national, on peut le dire, ne fait qu'ajouter à l'ivresse ; de sorte que plus il proclame hautement la fraternité, plus promptement et plus sûrement il doit conduire au cannibalisme. Les fédérés militaires ont regagné leurs domiciles ; les plus inflammables, mourant sous l'influence des liqueurs et des tendresses, ne sont pas encore refroidis ; les scènes éclatantes sont à peine effacées des yeux et brillent encore dans la mémoire des hommes, que la discorde reparaît encore, plus sombre que jamais. Voyons comment, en tournant nos regards vers Bouillé. Bouillé, pour le moment, commande la garnison de Metz, et au loin, en long et en large, tout l'est et le nord, ayant été désigné récemment par un acte du gouvernement, avec la sanction de l'Assemblée nationale, comme un des quatre généraux supérieurs. Rochambeau et Mailly, hommes et maréchaux de renom dans ces jours, quoique bien effacés aujourd'hui, sont deux de ses collègues ; le vieux et austère radoteur Lückner, bien oublié maintenant, sera probablement le troisième. Le marquis de Bouillé est un zélé royaliste, nullement contraire à des réformes modérées, mais ennemi décidé des immodérées ; homme longtemps suspect au patriotisme, qui a plus d'une fois donné de l'embarras à l'auguste assemblée, parce qu'il ne voulait pas, par exemple, comme il était tenu de le faire, prêter le serment national, mais remettait toujours sous un prétexte ou l'autre jusqu'à ce qu'un autographe de Sa Majesté le lui demandât comme une faveur. Là, dans ce poste, sinon d'honneur, au moins d'éminence et de danger, il attend silencieux et concentré, très-incertain de l'avenir. Seul, comme il le dit, ou presque seul parmi les vieilles notabilités militaires, il n'a pas émigré, mais pense toujours, dans ses moments atrabilaires, que pour lui aussi il n'y aura rien à faire que de traverser les Marches. Il pourrait aller, par exemple, à Trèves ou à Coblentz, où seront un jour sous le drapeau les princes exilés, ou bien à Luxembourg, où le vieux de Broglie traîne une vie oisive et languissante ; ou bien n'y a-t-il pas ce grand abîme obscur de la diplomatie européenne, où les Calonne et les Breteuil commencent à errer dans un demi-jour ? Au milieu d'innombrables résolutions confuses, sans autre projet bien arrêté que celui d'essayer de rendre' service à Sa Majesté, Bouillé attend, luttant autant qu'il le peut pour maintenir son district fidèle, ses soldats obéissants, sa garnison complète. Il poursuit encore avec son cousin Lafayette, par lettres et messagers, une mince correspondance diplomatique ; d'un côté, des protestations chevaleresques et constitutionnelles, de l'autre, une gravité et une brièveté militaires. Cette mince correspondance devient de jour en jour plus mince et plus vide, jusqu'à ce qu'elle soit presque réduite à rien[1]. Homme vif, irascible, prompt à désarmer, décidé à entreprendre, avec d'énergiques résolutions comprimées, avec de la valeur et même de la téméraire audace ; homme qui était beaucoup mieux à sa place dans les îles de l'Inde occidentale, où il pouvait d'un bond de tigre enlever aux Anglais Nevis et Montserrat, que dans cette condition d'étouffement, muselé et enchaîné dans des filets diplomatiques, prévoyant une guerre civile qui peut ne jamais arriver. Il y a peu d'années, Bouillé devait conduire aux Indes une expédition française pour conquérir ou reconquérir Pondichéry et le royaume du soleil ; mais le monde est soudainement tout changé, et lui avec. La destinée ne voulut pas l'engager dans cette autre voie, mais dans celle-ci. II. — ARRIÉRÉ ET ARISTOCRATIE.Le fait est, quant à l'aspect général des choses, que Bouillé lui-même n'en augure rien de bon. L'armée française, depuis les anciens jours de la Bastille et même antérieurement, est universellement dans un état fort équivoque et empirant de jour en jour. La discipline, qui est de tout temps une sorte de miracle agissant par la foi, commence à se relâcher, et l'on n'a guère en perspective l'espoir de la voir renaître. Les gardes françaises avaient risqué un jeu désespéré, et tout le monde sait comment ils s'y prirent pour le gagner et en recueillir le prix. Dans ce bouleversement général, nous avons vu les combattants mercenaires refuser de combattre. Les suisses mêmes de Château-Vieux, qui sont une espèce de Suisses français de Genève et du pays de Vaud, se sont, dit-on, récusés. Des déserteurs se glissent du côté populaire ; le Royal-Allemand même, quoique ferme au poste, a l'air déconcerté. En un mot, on vit le règlement militaire, sous la forme de ce pauvre Besenval, avec ce camp agité ingouvernable après deux jours de martyre sur le terrain du Champ de Mars, se voiler pour ainsi dire des ombres de la nuit et partir par la rive gauche de la Seine pour chercher refuge ailleurs, la place étant devenue trop brûlante pour lui. Mais quel nouveau terrain chercher ? quel remède essayer ? Des quartiers qui ne sont pas infectés : cela, sans doute, avec une discipline sévère, était ce qu'il y avait de mieux à tenter. Hélas ! dans tous les coins, depuis Paris jusqu'au moindre hameau, gît l'infection. La contagion séditieuse est partout ; imbibée, propagée par le contact et par la parole, elle a gagné jusqu'au dernier des soldats. Il y a des propos entre hommes en uniforme et hommes sans uniforme ; des hommes en uniforme lisent les journaux, y écrivent même. Il y a des pétitions ou plutôt des remontrances publiques ; il y a des associations particulières et de secrets émissaires, du mécontentement, de la jalousie, de l'incertitude, une humeur hargneuse et soupçonneuse ; toute l'armée française fermente dans un foyer obscur qui jette de sinistres lueurs, ne présageant rien de bon pour personne. De sorte que, au milieu de la dissolution générale de la révolte, nous avons à subir la révolte la plus profonde, la plus effrayante de toutes, celle du soldat. Stérile et désolant à envisager sous tous ses aspects est l'esprit de révolte ; mais combien plus terrible sous la forme d'une mutinerie militaire ! L'instrument même de l'ordre et de la répression, par lequel tout est réprimé et maintenu, est devenu précisément le plus terrible instrument du désordre, semblable au feu, notre indispensable serviteur dans tous les besoins, quand il se fait notre maître en se faisant incendie. La discipline, nous l'appelons une sorte de miracle. En fait, n'est-ce pas miraculeux qu'un homme puisse en faire mouvoir des centaines de milliers, dont chaque unité peut-être ne l'aime pas et, individuellement, ne le craindrait pas, et qui pourtant doit lui obéir, aller et venir, marcher et s'arrêter, donner la mort et même la recevoir comme si le destin avait prononcé, le mot d'ordre devenant littéralement un mot magique. Lequel mot magique une fois oublié, le charme est rompu. Les légions d'esprits qui vous servaient humblement se dressent devant vous en furies menaçantes ; votre arène si bien ordonnée devient un lieu de tumulte infernal où le malheureux magicien est déchiré membre par membre. Les rassemblements militaires sont des rassemblements ayant des fusils en main, ayant de plus la mort suspendue sur leurs têtes ; car la mort est le châtiment de la désobéissance, et ils ont désobéi. Donc, si tous les rassemblements sont à proprement parler composés de frénétiques agissant avec frénésie, avec des accès intermittents de chaud et de froid, passant alternativement de la rage à la terreur,, considérez donc ce que doit être un rassemblement militaire avec un tel conflit de devoirs et de pénalités, tourbillonnant entre le remords et la fureur, et ayant à la main, lors des accès de fièvre chaude, un fusil chargé. Le la part du soldat individuellement, la révolte est. effrayante et tellement dangereuse qu'il faut, non la plaindre, mais la détester. C'est une classe de mortels bien anormale que ces pauvres tueurs à gages ! Avec une franchise qui, pour le moraliste de nos jours, semble surprenante, ils ont juré de devenir des machines, et néanmoins ils sont encore en partie des hommes. Qu'aucune autorité prudente ne leur rappelle ce dernier fait, mais que toujours la force, l'injustice surtout, s'arrête du côté sûr de ce point culminant ! Les soldats, comme nous le disons souvent, se révoltent ; s'il n'en était pas ainsi, plusieurs choses de ce monde qui sont transitoires deviendraient permanentes. Au-dessus de toutes les plaintes générales que tous les fils d'Adam articulent sur leur sort d'ici-bas, dominaient, chez les soldats français, deux griefs principaux. D'abord, leurs officiers étaient des aristocrates ; ensuite ils les frustraient de leur solde : deux griefs ou plutôt disons un grief capable de devenir une centaine ; car, dans ce premier fait, les officiers sont des aristocrates, quelle multitude de corollaires sont là à portée ! C'est un puits sans fond, une source de griefs coulant toujours ; c'est pour ainsi dire une matière première avec laquelle on peut individuellement donner un corps à des griefs sans fin. Péculat de solde ! le grief a pris corps, il est fait tangible, peut se dénoncer, s'exhaler, ne fût-ce qu'en paroles de colère. Et malheureusement cette grande source de griefs existe véritablement. Presque tous les officiers sont des aristocrates ; c'est dans leur sang, dans leur moelle. Par la force de la loi, nul homme ne peut prétendre même à un misérable emploi de lieutenant de milice s'il ne prouve à la satisfaction du blason quatre générations de noblesse ; non-seulement il faut être noble, il faut encore quatre générations ! Ceci est un progrès imaginé il y a peu d'années par un certain ministre de la guerre accablé de demandes de brevets : progrès qui fut, en effet, un soulagement pour le ministre de la guerre assailli, mais qui augmenta la brèche déjà béante entre la roture et la noblesse, et même entre la noblesse nouvelle et la noblesse ancienne ; comme si déjà, avec la nouvelle et l'ancienne, puis avec l'ancienne et la plus ancienne, il n'y avait pas assez d'éléments de lutte ; dans le choc général des hommes qui enfin voient et entendent, dans ce singulier gouffre où tous les contrastes sont allés ensemble au fond, ou vont y aller avec vacarme, sans retour, s'en allant partout. On peut se demander si ces nobles espèrent rester toujours en haut de l'échelle ; apparemment que non. Il est vrai qu'en temps de paix extérieure, où il n'y a pas de batailles, mais simplement des exercices, la question de l'avancement peut paraître quelque peu théorique ; mais, en regard des droits de l'homme, elle est continuellement pratique. Le soldat a juré fidélité, non uniquement au roi, mais aussi à la loi, il la nation. Nos commandants aiment-ils la révolution ? disent tous les soldats. Malheureusement non ; ils la détestent et aiment la contrerévolution. Les jeunes gens à épaulettes avec du sang noble dans les veines, empoisonnés de l'orgueil de leur noblesse, se moquent ouvertement, l'indignation déguisant mal le mépris, de nos droits de l'homme comme d'un nouveau genre de toile d'araignée qui doit tomber sous le balai. Les vieux officiers, plus prudents, gardent le silence ; leurs lèvres bien closes ne trahissent pas leurs sentiments. Mais on devine ce qui se passe en eux. Qui sait même si, sous le prétexte plausible du commandement, le mot d'ordre n'est pas la contre-révolution elle-même, la vente aux princes exilés ou au kaiser autrichien ; les traîtres aristocrates plaçant un bandeau sur le peu de clairvoyance de nous autres gens du peuple. C'est de cette manière que s'exerce la plainte générale, symptôme désastreux, produisant en place de la confiance et du respect la haine et le soupçon sans limite, l'impossibilité du commandement et de l'obéissance, et alors que ce second et plus tangible grief se présente universellement à l'esprit de l'homme du peuple. Péculat de solde ! péculat de la plus méprisable espèce, qui existe, et depuis longtemps ! Mais à moins que les droits de l'homme et tous les droits possibles ne soient des toiles d'araignée, il n'existera pas plus longtemps. Le système militaire en France semble mourir d'une sorte de suicide. De plus, naturellement, dans cette cause le citoyen est opposé au citoyen. Le soldat trouve des auditeurs sans nombre et une sympathie sans limite parmi les patriotes des basses classes, choses qui ne font pas défaut à l'officier dans les régions élevées. L'officier se pare, se parfume pour aller aux tristes soirées des non émigrants. Là il conte ses maux ; ne sont-ce pas les maux de la majesté et de la nature ? Il fait part en même temps de son gai défi, de sa ferme résolution. Les citoyens et surtout les citoyennes voient le bon et le mauvais ; ce n'est pas le système militaire seul qui mourra par le suicide, mais beaucoup d'autres choses avec lui. Il y aura, comme on disait, un renversement plus radical que tout ce que l'on a vu jusqu'ici, le complet renversement de cet enfer noir, brûlant et sulfureux, sur lequel tout repose et croît. Mais quelle action ces choses auront-elles sur l'esprit du rude soldat, avec ses pédanteries militaires, son ignorance de tout ce qui n'est pas champ de manœuvres, l'inexpérience de l'enfant avec la férocité de l'homme et la véhémence du Français ? Depuis longtemps, dans les cantines et les corps de garde, les commentaires sur les airs maussades, les mille et une tracasseries entre commandant et commandés défrayent les longues journées militaires. Demandez au capitaine Dampmartin, un officier de cavalerie intelligent et littéraire, qui aime à sa manière le règne de la liberté, dont le cœur a pourtant souvent été profondément froissé dans ces chaudes régions du sud-ouest et ailleurs ; il a vu les émeutes, les combats civils en plein jour et à la luèur des torches, et l'anarchie plus haïssable que la mort. Des troupiers insubordonnés et pleins de vin, — ayant rencontré le capitaine Dampmartin et un autre sur les remparts, où il n'y a ni moyen de l'esquiver ni moyen de l'éviter, — font ponctuellement le salut militaire, car nous les regardions en face avec calme, mais le font d'une manière hargneuse, presque insultante ; une autre fois, ils laissent toutes leurs chemises en chamois et leurs buffleteries superflues dont ils sont las en tas à la porte du capitaine, et nous rions comme rient les ânes en mangeant des orties. Une autre fois, ils lient ensemble deux grosses cordes à fourrage, vomissant des imprécations, avec l'intention bien arrêtée de pendre le quartier-maître. Toute cette récapitulation de souvenirs et de regrets est inscrite par le digne capitaine[2]. Les hommes murmurent de vagues mécontentements ; les officiers abandonnent leur poste et émigrent par dégoût. Ou bien consultons un autre officier littéraire, pas
encore capitaine, sous-lieutenant seulement dans le régiment d'artillerie de
La Fère, un jeune homme de vingt et un ans, ayant quelque droit de parler ;
le nom de celui-là est Napoléon Bonaparte. A quelle hauteur est parvenu ce
sous-lieutenant promu, il y a cinq ans, de l'école de Brienne comme ayant été
reconnu capable en mathématiques par La Place. Il est durant ces mois en
garnison dans l'ouest, à Auxerre, logé peu somptueusement chez un barbier à la femme duquel il ne rendit pas les
respects d'usage, ou bien au Pavillon, dans une chambre aux murs
dénudés, et pour tout mobilier, un lit médiocre sans rideaux, et dans
l'embrasure de la fenêtre, une table couverte de livres et papiers ; dans une
chambre à côté, sur un matelas grossier couchait son frère Louis. Pourtant il est en train d'écrire son premier
livre ou pamphlet, éloquent et véhément, Lettre à M. Matteo Buttafucico,
notre député de la Corse, peu patriote mais aristocrate, indigne de la
députation. Joly, de Dôle, est son éditeur. Le sous-lieutenant littéraire
corrige les épreuves, et tous les matins, à quatre heures, il part à pied
d'Auxonne à Dôle ; après avoir parcouru ses épreuves, il partage un
très-modeste déjeuner avec Joly et retourne de suite à sa garnison, où il
arrive avant midi, ayant marché l'espace de vingt milles dans la matinée. Ce sous-lieutenant peut remarquer que dans les salons, dans les rues, sur les grands chemins, dans les auberges, partout l'esprit des hommes est prêt à prendre feu ; que le patriote, dans un salon ou au milieu d'un groupe d'officiers, peut se sentir découragé de se trouver au centre d'une majorité hostile, mais dès qu'il arrive dans la rue ou parmi des soldats, il lui semble que toute la nation est avec lui ; qu'il y avait, après le fameux serment le roi, la nation, la loi, un grand changement. Auparavant, s'il en avait reçu l'ordre, il aurait tiré sur le peuple au nom du roi, mais maintenant au nom de la nation il s'y refuserait ; d'ailleurs les officiers patriotes, quoique plus nombreux dans l'artillerie et le génie, étaient encore en minorité, mais ayant le soldat avec eux, ils gouvernaient le régiment et avaient souvent à délivrer les officiers leurs camarades de périls et de mauvais pas. Un jour entre autres, un membre de notre ordinaire créa une émeute en chantant à la fenêtre de notre salle à manger : Ô Richard, ô mon roi ! et je fus obligé de le soustraire à la fureur de la populace[3]. Que le lecteur multiplie tout ceci par dizaines de mille et qu'il l'étende avec de légères variantes sur tous les camps et toutes les garnisons de la France ! L'armée paraît sur la pente d'une mutinerie universelle. Mutinerie universelle ! il y a de quoi faire frémir le constitutionnalisme et une auguste assemblée. Il serait urgent de faire quelque chose, mais quoi ? Nul homme ne peut l'indiquer ; Mirabeau propose même que puisqu'on en est arrivé à ce point, on licencie les 280.000 soldats pour réorganiser l'armée. Cela, cria-t-on de toutes parts, est impossible, surtout aussi brusquement. Et pourtant, répondons-nous, d'une manière ou d'une autre c'est inévitable ; une telle armée, avec ses quatre générations de nobles, son péculat de solde et ses hommes tressant des cordes pour pendre leur quartier-maître, ne peut subsister à côté d'une telle révolution. Vous n'avez d'alternative qu'une dissolution lente, chronique, ou une nouvelle organisation prompte et décisive, une agonie de plusieurs années ou concentrée dans une heure. Avec un Mirabeau pour ministre ou gouverneur, la dernière eût été choisie ; sans un Mirabeau, naturellement ce sera la première qui prévaudra. III. — BOUILLÉ À METZ.Pour Bouillé, dans son cercle au nord-est, ces choses-là ne sont pas tout à fait ignorées. A plusieurs reprises, la fuite au delà des frontières lui apparaît comme un moyen de sortir d'embarras ; néanmoins il reste ici et continue la lutte dans l'espérance d'une amélioration, espérant le mieux, non par une nouvelle organisation, mais par une heureuse contre-révolution et un retour vers le passé. Quant au reste, il lui est démontré que cette dite fédération nationale, ces serments continuels et cette fraternisation entre le soldat et le peuple ont fait un mal incalculable. Tant de choses qui fermentaient en cachette paraissent au grand jour et deviennent publiques. Des gardes nationaux et des soldats de ligne s'embrassent solennellement sur les champs de manœuvres, boivent ensemble, prêtent des serments patriotiques, se jettent dans le désordre des processions des rues, des acclamations constitutionnelles et antimilitaires et des ovations ; sur quoi, le régiment de Picardie, entre autres, est rangé en carré dans la cour de la caserne et est harangué sévèrement par le général lui-même, qui obtient ainsi une assurance de repentir. De loin comme de près, les rapports constatent que les murmures de l'insubordination deviennent de plus en plus bruyants. On a vu des officiers renfermés dans la salle de l'ordinaire, assaillis de demandes pressantes où perçaient même des menaces. Le meneur insubordonné est chassé avec un congé jaune, chose infâme que l'on appelle cartouche jaune ! Mais à sa place, dix nouveaux meneurs se présentent, et la cartouche jaune cesse d'être un déshonneur. Au bout de quinze jours au plus, un mois après la sublime fête de Pâques, toute l'armée française, réclamant ses arrérages, formant des clubs, fréquentant des sociétés populaires, est dans un état auquel Bouillé ne trouve d'autre nom que celui de mutinerie. Bouillé sait cela mieux que d'aucuns et en parle d'après une terrible expérience. Citons un exemple entre plusieurs. C'était dans les premiers jours d'août, impossible aujourd'hui de savoir la date précise, quand Bouillé, au moment de partir pour les eaux d'Aix-la-Chapelle, était encore une fois subitement appelé au quartier de Metz. Les soldats étaient en rang de bataille, les mousquets chargés, les officiers tous là par contrainte. Toutes les voix demandaient avec emphase le payement des arriérés. Le régiment de Picardie s'était repenti, mais nous le voyons en récidive ; l'immense espace est hérissé d'hommes armés qui mugissent la révolte. Le brave de Bouillé s'avance vers le premier régiment et ouvre la bouche pour faire entendre la voix du commandement, mais n'obtient que des plaintes discordantes, réclamant tant de milliers de livres qui sont légalement dus. Le moment est critique ; il y a environ 10.000 soldats dans la garnison de Metz, tous paraissant animés du même esprit. Bouillé est ferme comme un roc ; mais que faire ? Un régiment allemand, appelé de Salm, est peut-être, pense-t-on, de meilleure composition ; néanmoins, Salm aussi peut avoir entendu parler du précepte : Tu ne voleras pas ; Salm peut aussi savoir que l'argent est de l'argent. Bouillé s'avance confiant vers le régiment de Salm, prononce quelques paroles de conciliation ; mais, ici encore, on lui répond par le cri de quarante-quatre mille livres et quelques sols, le cri devenant de plus en plus menaçant à mesure que la colère de Salm monte. Et comme ce cri n'obtient ni numéraire ni promesse de numéraire, il finit par une volte-face simultanée et un pas de charge énergique, l'arme au bras, de la part de Salm, vers la maison du colonel, dans une rue adjacente, pour y prendre le drapeau et la caisse du régiment. Ainsi se comporte Salm, ferme dans la foi que meum n'est pas tuum, et que des discours mielleux ne sont pas quarante-quatre mille livres et quelques sols. L'indomptable Salm dévore l'espace au pas accéléré. Bouillé et les officiers, l'épée tirée, sont obligés de se précipiter au double pas de charge, ou plutôt de courir peu militairement, afin de prendre les devants, stationner sur l'escalier extérieur, et de s'y maintenir en défiant la mort avec ce qu'ils possèdent d'armes blanches, Salm avançant impitoyablement rang sur rang en face d'eux, animé de dispositions faciles à deviner, mais qui, heureusement, ne sont pas encore montées au diapason de l'assassinat. Là se tient Bouillé, certain de la résolution d'un homme au moins, avec un calme sévère, attendant le résultat. Ce que peut faire l'homme le plus intrépide, le général le plus vaillant, Bouillé le fait. Quoiqu'il y ait un piquet de barricades à chaque extrémité de la rue et que la mort soit devant ses yeux, Bouillé trouve moyen d'envoyer chercher un régiment de dragons, avec ordre de charger ; les officiers de. dragons montent à cheval, les hommes s'y refusent. De ce côté, il n'y a pas pour lui d'espoir ; la rue, comme nous l'avons dit, barricadée, toute voie terrestre fermée, et rien que la voûte indifférente du ciel au-dessus de sa tête, peut-être, par-ci, par-là, un propriétaire peureux met le nez à la fenêtre, faisant des vœux pour Bouillé, tandis que, sur le pavé, la nombreuse canaille fait des vœux pour Salm : comme deux chariots acculés dans une impasse ou comme deux lutteurs enlacés dans une lutte suprême. Pendant deux heures ils sont ainsi en présence : l'épée de Bouillé brillant dans sa main, une audacieuse résolution ombrageant son front, durant deux heures aux horloges de Metz. Bourru et silencieux est Salm, faisant pourtant entendre de loin en loin quelques vociférations ; mais il ne fait pas feu. Parfois, poussé par les clameurs de la populace, un grenadier lève son fusil sur le général, qui le regarde comme le ferait un général en bronze, et l'arme est de suite abattue par un caporal. Dans cette attitude extraordinaire nous apparaît le brave Bouillé pendant deux heures, d'abord comme une ombre ; puis cette ombre prend corps et se dessine. Au reste, comme Salm ne l'a pas .fusillé dans le premier moment, le danger diminue. Le maire, un homme infiniment respectable, avec ses municipaux et écharpes tricolores, réussit à obtenir accès, fait des remontrances, pérore, promet, et finalement persuade à Salm de rentrer au quartier. Le lendemain, notre respectable maire ayant prêté l'argent, les officiers payent comptant la moitié de la somme due ; avec cette liquidation, Salm se pacifie pour le moment, et tout rentre dans le calme[4]. Des scènes comme celles de Metz ou, du moins, des avant-coureurs de pareilles scènes, étaient universels en France. Dampmartin, avec ses cordes à fourrage nouées et ses piles de vestes chamois, est a Strasbourg, dans le sud-est ; dans ces mêmes jours ou plutôt dans ces nuits, Royal-Champagne vocifère : Vive la nation ! au diable les aristocrates ! avec une trentaine de chandelles allumées. A Heslin, dans le nord-ouest, le député Renbelle est fâché d'annoncer qu'à Bitche, la garnison est sortie de la ville, tambours en tète, a cassé ses officiers et est rentrée en ville le sabre en main. Une assemblée nationale ne devrait-elle pas s'occuper de cet état de choses ? La France militaire est toute possédée d'une humeur Acre, inflammatoire, qui s'exhale de toutes les manières ; c'est un continent entier de cendres qui fument, et qui, au premier coup de mauvais vent venant de n'importe quel côté, se transformerait en un vaste continent enflammé. Le patriotisme constitutionnel est naturellement alarmé de cet état de choses. L'auguste assemblée siège avec zèle, délibère, mais n'ose conclure avec Mirabeau sur une dissolution instantanée et sur la dispersion immédiate ; elle trouve naturellement les palliatifs plus faciles. Un grief pour le moins, celui des arrérages, sera redressé. Un décret qui, sous le nom du décret du 6 août, fit dans son temps beaucoup de bruit, fut élaboré à cet effet. Des inspecteurs visiteront avec des caporaux élus et des soldats sachant écrire, vérifieront les arrérages dus et les solderont. C'est bien si, par ce moyen, le brasier fumant peut être éteint ; sinon, comme nous le disions, un fort vent, une étincelle ou une collision pourrait tout faire sauter. IV. — ARRIÉRÉS À NANCY.Nous devons toutefois observer que de tous les districts celui de Bouillé paraît le plus inflammable. C'est toujours vers Bouillé et Metz que la royauté voudrait fuir : l'Autriche est tout près ; ici, plus que partout ailleurs, le peuple divisé regarde au delà de la frontière, dans cet océan troublé de la politique et de la diplomatie étrangères, les uns avec espoir, les autres avec crainte, mais tous avec une mutuelle exaspération. C'était en ce jour que parurent certaines troupes autrichiennes, paisiblement en marche sur l'angle d'une de ces régions. Alors se précipitèrent des quatre points cardinaux, le fusil sur l'épaule, vers Stenai, environ trente mille gardes nationaux pour voir de quoi il s'agissait. C'était simplement une affaire de diplomatie : l'empereur autrichien, pressé d'arriver en Belgique, avait obtenu le droit d'abréger ainsi la route. Le mouvement obscur de la politique européenne avait étendu un voile sur tout l'espace, passant sur sa route comme l'ombre fuyant du condor ; de là résulte le vol précipité des trente mille, croassant et gloussant. Mais, pour ajouter aux autres complications, comme nous le disions, le peuple est ici très-divisé ; les aristocrates abondent, et les patriotes ont à surveiller et les aristocrates et les Autrichiens. Cette région c'est la Lorraine ; pas si éclairée que la vieille France, elle se souvient de l'ancienne féodalité ; bien mieux, elle se souvient encore qu'elle avait un roi et une cour en propre, ou plutôt les splendeurs d'une cour et un roi sans en avoir les charges. Et puis, par contre, la société mère, qui siège dans les églises jacobines de Paris, a des filles dans ces villes, filles à langues perçantes, à l'humeur âcre ; jugez combien peu la mémoire du bon roi Stanislas et des siècles de féodalité impériale peuvent s'accorder avec le nouvel évangile, et quelle virulence de discorde doit en résulter. En tout ceci, les officiers prennent une part d'un côté et les soldats de l'autre, et même la part principale ; les soldats, d'ailleurs, d'autant plus excités qu'ils sont plus nombreux, une province frontière en nécessitant un plus grand rassemblement. Telle est la situation de la Lorraine, mais surtout de la capitale. La jolie cité de Nancy, aimée de la féodalité en décadence, où le bon roi Stanislas a vécu et brillé, possède une municipalité aristocratique, mais aussi une terrible fille de la société mère jacobine. Elle a envi- ron quarante mille âmes de population divisée, et trois forts régiments, entre autres le suisse Château-Vieux, cher aux patriotes depuis qu'il a refusé ou est censé avoir refusé de combattre aux jours de la Bastille. Ici malheureusement, plus que partout ailleurs, semblent concentrées toutes les mauvaises influences ; ici surtout la jalousie et la haine peuvent se donner carrière. En conséquence, depuis plusieurs mois l'homme a été excité contre l'homme, le débarbouillé contre le non débarbouillé, le soldat patriote contre le capitaine aristocratique, et avec d'autant plus d'amertume que s'est accumulée une longue liste de rancunes. Des rancunes sans nom et des rancunes avec nom, car la colère est d'une nature positive et journellement, ne fût-ce qu'un coup d'œil, un son de voix, les plus petites commissions ou omissions, tout est porté en compte sous la dénomination de divers, afin d'être additionné en un total formidable. Par exemple, au mois d'avril dernier, dans ce temps des préliminaires de la fédération, lorsque les gardes nationaux et les soldats partout jurèrent fraternité, et que partout la fédération se généralisa, se prépara à célébrer la grande fête nationale des Piques, on s'est aperçu que les officiers, à Nancy, jetèrent du froid sur cette grande affaire de fraternité, qu'ils hésitèrent à paraître à la fédération de Nancy, et que quand ils y furent, ce fut en redingote et en négligé, au point d'avoir à peine du linge propre ; que même au moment où les couleurs nationales passaient, un de ces officiers, sans nécessité apparente, prit occasion de cracher[5]. De bien petits articles que tout cela, pour un journal de compte courant, mais quand ils se multiplient à l'infini ! La municipalité aristocratique, se prétendant constitutionnelle, se tient assez tranquille. Mais il n'en est pas de même de la société jacobine ; de ses cinq milles adultes mâles, encore moins de ses cinq milles femmes ; il n'en est pas de même de la noblesse à quatre générations en épaulettes, à moustaches ou sans moustaches ; ni des patriotes renfrognés de Château-Vieux, ni du bouillant régiment d'infanterie du roi, ni des chauds troupiers du Mestre-de-Camp. Nancy, entouré de murailles, à l'aspect si gai et si coquet, avec ses rues droites et spacieuses, son architecture à la Stanislas, sa féconde alluvion de la Meurthe ; si brillant au milieu de ses champs de blé jaune, en ce mois de moisson, n'est intérieurement qu'un foyer de discorde, d'anxiété et d'effervescence, toujours prêt à faire explosion. Que Bouillé y fasse attention, si cette chaleur universelle militaire, que nous comparons à un vaste champ de chanvre fumant, prend feu de quelque côté, si c'est ici, à Nancy, en Lorraine, sa barbe pourrait en être roussie. De son côté, Bouillé est assez occupé, mais seulement d'une surveillance générale, faisant déguerpir de Metz son régiment pacifié de Salm, et d'autres régiments r tolérables, les dirigeant vers le sud, dans des cantonnements ruraux tels que Vie, Marsal et les environs, sur les bords d'eaux stagnantes ; où il y a abondance de fourrages et un terrain de manœuvres isolé, où les facultés spéculatives du soldat peuvent être comprimées par l'exercice. Salm, comme nous disions, n'avait reçu — naturellement sans murmurer — que la moitié de ses arriérés. Néanmoins, cette scène de l'épée tirée peut avoir élevé Bouillé dans l'esprit de Salm, car les hommes et les soldats aiment l'intrépidité et une prompte et inflexible décision, même quand ils en souffrent. Et de fait, n'est-ce pas là une qualité fondamentale pour tout homme, qualité qui n'est par elle-même presque rien, puisqu'on la trouve chez les animaux inférieurs, tels que les ânes, les chiens et même les mulets, mais qui, employée à propos, est la base indispensable de tout. De Nancy et de ses agitations, Bouillé, commandant en chef, ne sait rien de particulier, mais comprend qu'en général les troupes, dans cette cité, sont ce qu'il y a de plus mauvais. Les officiers, et cela depuis longtemps, font ce qu'ils veulent et malheureusement font mal. Cinquante congés jaunes, délivrés dans une seule journée, démontrent certes une position difficile. Mais que pense le patriotisme de certains fusiliers légers, envoyés ou supposés être envoyés pour insulter le club des grenadiers : songez à des grenadiers spéculatifs avec leur salon de lecture ; il s'ensuit des huées et des sifflets jusqu'à ce que le spéculatif grenadier tire l'épée, et surviennent alors des batteries et des duels ! Bien plus, n'a-t-on pas envoyé visiblement ou probablement des matamores du même calibre, déguisés en soldats, pour chercher querelle aux citoyens ; d'autres fois, déguisés en citoyens, pour chercher noise aux soldats. Car on a pris un certain Roussière, maître d'escrime, sur le fait, et quatre officiers assez jeunes, qui le poussaient en avant, s'enfuirent précipitamment. Le maître d'armes Roussière, conduit au corps de garde, fut condamné à trois mois de prison, mais les camarades demandèrent pour lui un congé jaune, pour lui surtout. De plus, on le fit venir à la parade, on le coiffa d'un casque en papier sur lequel était inscrit Iscariote, on le conduisit aux portes de la cité, et il lui fut solennellement ordonné de disparaître à tout jamais. Sur tous ces soupçons, ces accusations et cette bruyante procédure, se renouvelant continuellement, les officiers devaient naturellement jeter des regards d'indignation et de mépris, peut-être même se sont-ils laissés aller à exprimer leurs sentiments, et bientôt après ils s'enfuirent vers les Autrichiens. De sorte que quand, ici comme ailleurs, vint la question des arrérages, l'humeur et les procédés furent des plus envenimés ; le régiment Mestre-de-Camp obtint, au milieu des plus bruyantes réclamations, quelque trois louis par homme, empruntés, comme toujours, à la municipalité. Le suisse Château-Vieux veut en réclamer autant, et reçoit de suite à la place les étriviers, accompagnées des huées et des sifflets de la part des femmes et des enfants. Le régiment du Roi, las d'espérances différées, saisit la caisse militaire et la conduit au quartier ; mais le lendemain la ramène de même à travers les rues, ce dont les populations sont frappées de stupeur. Des parades non ordonnées ont lieu avec force clameurs, où les spiritueux entrent pour une part, des objurgations, de l'insubordination, la hiérarchie militaire allant à vau l'eau. Tel est l'état de Nancy dans les premiers jours d'août, la sublime fête des Piques n'étant pas encore âgée d'un mois. Le patriotisme constitutionnel, à Paris comme ailleurs, peut bien frémir en apprenant ces nouvelles. Le ministre" de la guerre, Latour du Pin, court essoufflé à l'Assemblée nationale avec un message écrit — qui dit — : Tout brûle, tout presse. L'Assemblée, sur l'impulsion du moment et d'après sa demande, rend un décret qui ordonne la soumission et le repentir, si tant est que cela puisse produire de l'effet. D'un autre côté, le journalisme jette de tous ses gosiers des cris enroués de condamnation et d'approbation élégiaque. Les quarante-huit sections élèvent la voix ; le brasseur retentissant, ou plutôt appelons-le le colonel Santerre, n'est pas muet dans le faubourg Saint-Antoine. Car, dans l'intervalle, les soldats de Nancy ont envoyé une députation de dix des leurs, munis de documents et de preuves, et qui viennent faire la contrepartie de Tout brûle, lesquels dix mandataires, avant d'arriver à l'Assemblée, sont jetés en prison par le vigilant La Tour du Pin sur un ordre du maire Bailly. Certes, c'était inconstitutionnel, car ces hommes avaient des congés délivrés par leurs officiers. Là-dessus, le faubourg, indigné et incertain, ferme ses boutiques. Bouillé est-il traître et vendu à l'Autriche ? en ce cas, ces pauvres soldats ne se sont révoltés que par patriotisme. De nouvelles députations, députations de gardes nationaux, partent de Nancy pour éclairer l'Assemblée. Ils rencontrent en chemin les dix premiers émissaires non pendus, et continuent dès lors avec une meilleure perspective, mais ne réussissent à rien. Des députations, des messagers, des ordonnances, lancés au grand galop des chevaux, des alarmes, des rumeurs à cent voix, s'entrechoquent dans un va-et-vient continuel, semant partout le vertige. Ce n'est que dans la dernière semaine d'août que M. de Malseigne, nommé inspecteur, se rend au siège de la révolte avec pleine autorité, avec du numéraire et le décret du 6 août. Il doit liquider les arrérages ; justice sera faite ou du moins le tumulte sera apaisé. V. — L'INSPECTEUR MALSEIGNE.Quant à l'inspecteur Malseigne, nous voyons qu'il est de stature herculéenne, et nous présumons qu'il a de formidables moustaches — les officiers royalistes ne rasent plus maintenant la lèvre supérieure — ; qu'il a un indomptable cœur de taureau ; et aussi, malheureusement, une épaisse tête de taureau. Le 24 août 1790, il ouvre la séance comme commissaire inspecteur, appelant à lui les caporaux élus et les soldats qui savent écrire. Il trouve que les comptes de Château-Vieux ne sont pas bien réglés ; il demande un délai et un examen, se met à haranguer, à réprimander, au milieu de murmures trop distincts. Le lendemain matin, il reprend la séance, non à l'hôtel de ville, comme le conseillaient de prudents municipaux, mais encore dans la caserne. Malheureusement Château-Vieux, qui a passé la nuit à murmurer, ne veut entendre parler ni de délai, ni d'examen ; Malseigne passe des reproches aux injures, auxquelles répondent des cris persévérants de : Jugez tout de suite ; sur quoi M. de Malseigne veut se retirer tout en colère. Mais Château-Vieux, remplissant toutes les cours, a placé des sentinelles à chaque porte. En vain M. de Malseigne veut obtenir passage ; on le lui refuse, quoiqu'il soit secondé par le commandant Denoue. A toutes ses instances on répond : Jugez tout de suite. Voilà une complication. L'intrépide M. de Malseigne tire son épée et veut forcer la sortie. Désordre et confusion. L'épée de M. de Malseigne se brise ; il empoigne celle du commandant Denoue : la sentinelle est blessée. Enfin, comme on répugne à le tuer, il force le passage, suivi de tout Château-Vieux en désarroi. Nouveau spectacle pour Nancy ! M. de Malseigne marche à pas précipités, mais sans courir, se retournant de temps en temps, et présentant la pointe de son épée. Il arrive ainsi, sans blessure, à la maison de Denoue, qui est aussitôt investie par les soldats, qui ne peuvent pénétrer, parce qu'ils sont arrêtés par une haie d'officiers formée sur l'escalier. M. de Malseigne fait sa retraite par une porte de derrière, et se rend à l'hôtel de ville, agité mais inébranlable ; des gardes nationaux lui servent d'escorte. Le lendemain, de l'hôtel de ville, il envoie de nouveaux ordres, de nouvelles propositions pour arranger les affaires avec Château-Vieux. Mais Château-Vieux ne veut rien écouter. Enfin, au milieu du tumulte, il ordonne que Château-Vieux se mette en marche le lendemain matin, pour prendre ses quartiers à Sarrelouis. Château-Vieux refuse nettement de marcher ; M. de Malseigne prend acte du refus, le fait constater par notaire, précaution qui pourra lui servir. On est à la fin du jeudi, à la fin même de l'inspection de M. de Malseigne, qui a duré environ cinquante heures. En cinquante heures, voilà où il en est arrivé. Le régiment du Roi, le Mestre-de-Camp, flottent incertains, Château-Vieux est debout, ainsi que nous l'avons vu. Vers le soir, un aide de camp de Lafayette, placé là pour parer aux difficultés, envoie des émissaires de tous côtés pour convoquer la garde nationale. Le sommeil des habitants est troublé par le galop des chevaux, par les appels faits aux citoyens : tout patriote constitutionnel doit endosser l'uniforme de combat et se diriger vers Nancy. Et c'est ainsi que l'inspecteur herculéen a passé tout le jeudi, au milieu des municipaux terrifiés et de bruyantes confusions ; puis le vendredi et le samedi. Château-Vieux, en dépit des actes notariés, ne veut pas marcher. Environ quatre mille gardes nationaux font leur entrée par divers côtés, incertains sur ce qu'on leur demande, encore plus incertains sur ce qu'ils peuvent obtenir. Car tout est incertitude, commotion, méfiance. Le bruit court que Bouillé, commençant à se remuer dans les cantonnements de l'est, n'est qu'un traître royaliste, que Château-Vieux et les patriotes exaltés sont vendus à l'Autriche, dont probablement M. de Malseigne est l'agent. Mestre-de-Camp et le régiment du Roi sont encore flottants. Château-Vieux, loin de se mettre en marche, promène dans les rues deux voitures avec des drapeaux rouges ; et le lendemain matin répond aux officiers : Payez-nous, et nous vous suivrons jusqu'au bout du monde. Dans ces circonstances, vers le soir du samedi, M. de Malseigne juge à propos d'inspecter les remparts, à cheval. Il se met en route avec une escorte de trois cavaliers. A la porte de la ville, il ordonne à deux des hommes d'attendre son retour. Avec le troisième, sur qui il peut compter, il galope vers Lunéville, où se trouve un certain régiment de carabiniers, pas encore à l'état de mutinerie. Les deux cavaliers laissés en arrière s'inquiètent bientôt, devinent ce qui se passe et donnent l'alarme. Des soldats de Mestre-de-Camp, au nombre de cent, sellent leurs chevaux avec une précipitation frénétique, comme s'ils étaient vendus à l'Autriche, et se mettent pêle-mêle au galop à la poursuite de leur inspecteur. Les voilà qui courent, et l'inspecteur court, remontant avec fracas et cliquetis la vallée de la Meurthe, pour gagner Lunéville, à travers un pays étonné, presque aussi étonnés eux-mêmes. Quelle chasse ! semblable à celle d'Actéon ; mais Actéon de Malseigne a de l'avance et gagne son but. Aux armes, carabiniers de Lunéville ! pour châtier des mutins, qui insultent votre officier général, qui insultent vos quartiers. Surtout faites feu tout de suite, de peur qu'avec des pourparlers vous ne refusiez de tirer. Les carabiniers font feu sur les premiers arrivés de Mestre-de-Camp, qui s'arrêtent stupéfaits et se retirent promptement sur Nancy, dans un état de folle fureur. Plus de doute : vendus à l'Autriche, tant par régiment ; on dit les sommes, et le traître Malseigne en fuite ! A l'aide, ô ciel ! terre, à l'aide ! Vous aussi, patriotes, on vous a vendus comme nous. Le régiment du Roi, surexcité, prépare ses armes ; Mestre-de-Camp se met tout entier en selle. Le commandant Denoue est saisi et jeté en prison avec un sarreau de toile. Château-Vieux enfonce les magasins, distribue aux patriotes trois mille fusils. L'Autriche aura fort à faire, Hélas ! les malheureux chiens de chasse ont chassé leur chasseur, et maintenant courent en aboyant, ayant perdu la piste, dans un état de rage. Alors se fait une marche tumultueuse à travers la nuit ; puis une halte sur les hauteurs de Flinval, en vue de Lunéville éclairée. Enfin, de longs pourparlers à quatre heures du matin. L'accord se fait ; les carabiniers cèdent ; Malseigne est livré. Après quelques heures de confusion, on le met en route, les gens de Lunéville, profitant des loisirs du dimanche, pour assister à son départ, pour regarder passer Mestre-de-Camp avec son inspecteur captif. Mestre-de-Camp se met donc en marche, les gens de Lunéville regardant. Mais voilà qu'au détour de la première rue, notre inspecteur au cœur de fer prend encore son essor : au milieu du cliquetis des sabres, du bruit de la mousqueterie, il s'échappe au grand galop, avec une seule balle logée dans son justaucorps en buffle. Homme herculéen ! Et cependant c'est une fuite sans succès. Car les carabiniers, auprès desquels le ramène une cavalcade effrénée, se tiennent tranquillement auprès de leurs feux nocturnes, délibérant sur l'Autriche, sur les traîtres et sur la colère de Mestre-de-Camp. De sorte qu'après cette course échevelée, de Malseigne est conduit le lendemain lundi, à travers les rues de Nancy, dans une voiture ouverte, ayant auprès de lui un soldat le sabre en main ; assailli de cris furieux, traversant une haie de gardes nationaux, au milieu d'une confusion de Babel ; conduit enfin à la prison, auprès du commandant Denoue. C'est le logement final de l'inspecteur Malseigne[6]. Assurément, il est temps pour Bouillé d'accourir. Tout le pays des environs, troublé par des feux d'alarme, par des villes illuminées, par les cris furieux des troupes errantes, a été sans sommeil pendant plusieurs nuits. Nancy, avec ses gardes nationaux incertains, ses distributions de fusils, ses soldats mutinés, avec ses colères et ses noires paniques, n'est pas une ville, mais un asile d'aliénés. VI. — BOUILLÉ À NANCY.Hâte-toi, brave Bouillé : si un prompt secours ne vient pas, tout est en feu, et l'étendue du feu ne peut se mesurer. Beaucoup de choses, aujourd'hui, dépendent de Bouillé : selon ce qui va se passer avec lui, l'avenir entier peut prendre des directions différentes. Si, par exemple, il hésitait et ne venait pas ; s'il venait pour échouer ; si tous les soldats de France tournaient à la mutinerie, la garde nationale tirant en sens contraire, le royalisme tirant sa rapière, le sans-culottisme saisissant la pique ; et si l'esprit du jacobinisme, encore jeune, environné de rayons solaires, parvenu subitement à la maturité, s'environnait des flammes d'enfer ; de même que certains mortels, dans une seule nuit de crise terrible, ont vu grisonner leurs cheveux. Le brave Bouillé s'avance rapidement avec sa vieille inflexibilité, et, se renforçant en route de soldats venus de l'est, de l'ouest et du nord ; et le mardi matin, dernier jour du mois, il s'arrête en concentrant ses forces, malheureusement peu nombreuses, au village de Frouard, à peu de distance de la ville. Il n'y a pas dans le monde un fils d'Adam chargé d'une tâche plus problématique. Mer inflammable de doute et de péril ! Bouillé n'est sûr que d'une chose : son inébranlable résolution, laquelle chose, il est vrai, en vaut beaucoup d'autres. Il y mit, du Teste, la plus grande fermeté : La soumission, ou un combat sans merci, et la destruction ; vingt-quatre heures pour faire votre choix. Tels furent les termes de sa proclamation. Trente copies ont été envoyées à Nancy, lesquelles furent interceptées et non distribuées par la poste[7]. Cependant, à onze heures et demie du matin, comme par mesure de réponse, arrive à Frouard une députation des régiments mutinés, et aussi des municipaux de Nancy. Bouillé les reçoit dans une vaste cour attenante à son logement, le fidèle régiment de Salm, invité à assister à l'entrevue. Les mutins se prononcent avec un ton décidé qui parait à Bouillé de l'insolence, et heureusement à Salm aussi. Salm, oublieux des incidents de Metz, demande que les scélérats soient pendus sur l'heure et sur place. Bouillé ne veut pas de la pendaison, et répond que les soldats mutins n'ont qu'une chose à faire, et une seule ; de délivrer avec contrition MM. Denoue et Malseigne, de s'apprêter à marcher du côté où on les enverra, de se soumettre et de se repentir suivant le décret de l'Assemblée nationale, et suivant les termes de sa proclamation Voilà ses conditions, inaltérables comme les décrets du destin. Si les députés mutins ne les acceptent pas, ils feront bien de s'en aller, et promptement ; car dans peu d'instants son mot doit être : En avant. Les députés mutins se retirent donc ; les municipaux, quelque peu inquiets sur leur propre sort, aiment mieux rester avec Bouillé. Le brave Bouillé, quoique ferme et résolu, ne se dissimule pas sa position. A Nancy, des soldats rebelles, des gardes nationaux incertains avec une nombreuse distribution de fusils, il peut rencontrer dix mille combattants, tandis qu'avec lui est à peine un tiers de ce nombre, se composant de gardes nationaux irrésolus et de régiments à peine pacifiés, régiments, à cette heure, pleins de zèle, mais qui peuvent changer d'un moment à l'autre. Bouillé doit s'abandonner h la fortune qui, parfois, favorise les braves. A midi et demi, les députés mutins ayant disparu, le tambour bat ; on se met en marche vers Nancy. Que Nancy se tienne bien, car Bouillé a de la vigueur et de la détermination. Or, comment Nancy peut-il prendre une détermination ? C'est moins une cité qu'un asile d'aliénés. Château-Vieux veut qu'on se défende à outrance, contraint la municipalité à inviter, au bruit du tambour, tous les citoyens au courant de l'artillerie à venir aider à la manœuvre du canon. D'un autre côté, le régiment du Roi est rassemblé dans sa caserne, se désolant d'apprendre que Salm marche avec l'adversaire, et criant de ses mille gosiers : La loi, la loi ! Mestre-de-Camp tempête avec des jurements profanes, s'agitant avec un mélange de terreur et de furie. Les gardes nationaux regardent de tous côtés, ne sachant que faire. Quelle cité confuse ! autant de plans que de têtes ; tout le monde ordonnant, personne n'obéissant ; nulle part du repos, excepté chez les morts qui dorment sous terre, ayant fini leur temps. Et voici Bouillé qui arrive, fidèle à sa parole. A deux heures et demie, les éclaireurs rapportent qu'il est à environ une demi-lieue des postes, s'avançant en ordre de bataille, traînant du canon et ne respirant que destruction. Une nouvelle députation, composée de municipaux, de mutins, d'officiers, va au-devant de lui, demande avec instance un délai d'une heure. Bouillé accorde une heure. Alors, au bout de ce temps, ne voyant paraître ni Denoue, ni Malseigne, il fait battre le tambour et se remet en marche. Vers quatre heures, les citadins, terri- fiés, peuvent le voir face à face. Ses canons roulent en avant ; son avant-garde à trente pas de la porte Stanislas. Il s'avance comme une planète, poussée par les lois de la nature. Mais qu'y a-t-il ? Un drapeau parlementaire ; prière de faire halte. Malseigne, Denoue, sont en route pour venir ; les soldats sont repentants, prêts à se soumettre et à marcher. Le dur regard de Bouillé ne s'altère pas. Cependant le mot de halte est prononcé. Jamais il ne vit de plus heureux moment. Joie des joies ! Malseigne et Denoue se présentent, escortés par des gardes nationaux, intacts ; ils saluent Bouillé. Bouillé fait quelques pas de côté pour leur parler, ainsi qu'à quelques chefs de la ville ; ayant déjà désigné les barrières par lesquelles chaque régiment mutin doit se mettre en route. Ce colloque avec les deux officiers généraux et les principaux de la ville était assez naturel ; néanmoins on eût - désiré que Bouillé l'eût ajourné, et ne se fût pas mis de côté. En présence de ces masses tumultueuses et inflammables, s'avançant l'une contre l'autre ; celle-ci d'oxyde nitrique, celle-là de feu grisou sulfureux, ne valait-il pas mieux se placer entre elles pour les tenir séparées jusqu'à ce que l'espace fût nettoyé ? De nombreux traînards de Château-Vieux n'ont pas suivi leurs colonnes, qui se retirent par les barrières désignées, et prennent position en plein champ. Les gardes nationaux sont dans un état de folle incertitude ; la populace, avec ou sans armes, seule dans le délire est persuadée qu'elle est trahie, vendue aux Autrichiens, vendue aux aristocrates. Elle a des canons chargés, avec la mèche allumée, et l'avant-garde de Bouillé est à trente pas de la barrière. Nul commandement dans cette masse inflammable, où le feu couve avec une épaisse fumée. Elle ne veut pas ouvrir la barrière, lorsqu'elle en est sommée, et déclare qu'elle préfère ouvrir le feu du canon. Ne tirez pas, ô mes amis, ou ce sera à travers mon corps ! s'écrie le jeune et héroïque Desilles, capitaine au régiment du Roi, et il enveloppe de ses bras l'instrument meurtrier. Château-Vieux, avec force menaces et jurements, arrache le jeune héros, qui, sans être ébranlé au milieu de jurements plus prononcés, s'asseoit sur la lumière. Les cris redoublent, les jurements retentissent plus fort, et puis, hélas ! l'éclat d'abord d'un, puis de deux ou de trois coups de fusil : le jeune officier roule sanglant dans la poussière. Alors, dans le délire du moment, la mèche est approchée du canon, et le tonneau de mitraille jette à terre environ cinquante hommes de l'avant-garde de Bouillé. Malheur ! Cet éclat du premier projectile devient un formidable signal de mort, une conflagration de Tophet. Avec une rage démoniaque, l'avant-garde de Bouillé se précipite à travers la porte Stanislas ; dans sa marche de feu, elle balaye les mutins, ou les force à chercher asile dans les caves, d'où ceux-ci continuent leur feu. Les régiments campés dans la plaine, entendant la mousqueterie, reviennent précipitamment par la plus proche barrière ; Bouillé s'élance au galop, furieux, ne pouvant faire entendre sa voix, et alors commence dans Nancy, comme dans le vestibule fatal du Niebelongues, un massacre hideux. Alors se produisent des scènes désolantes de fu- reur, comme la colère du ciel en permet rarement parmi les hommes. Des caves et des greniers de chaque coin de rue, Château-Vieux et le patriote ouvrent un feu meurtrier sur les meurtriers soldats de Bouillé. Un capitaine de la garde nationale, criblé de balles reçues dans on ne sait quels rangs, demande à être couché sur le drapeau pour mourir. Une femme patriotique, dont on ne f connaît pas le nom, crie à Château-Vieux de ne pas tirer le canon, et ses cris ne suffisant pas, jette un seau d'eau sur la lumière[8]. Il faut se battre — il ne faut pas se battre — avec qui veux-tu te battre ? Si le tumulte pouvait réveiller les vieux morts, le Bourguignon Charles le Téméraire pourrait se lever de sa rotonde ; jamais il ne fut entendu autant de bruit en cet endroit, depuis que lui, plein de rage, perdit dans les fossés son. diamant et sa vie. Trois mille hommes, au compte de quelques-uns, sont | là couchés, mutilés et sanglants. La moitié de Château-Vieux a été fusillé sans l'aide d'une cour martiale. La cavalerie est impuissante, aussi bien Mestre-de-Camp que ses adversaires. Le régiment du Roi est resté dans les casernes et s'y tient palpitant. Bouillé, armé des terreurs de la loi, et favorisé de la fortune, triomphe définitivement. En deux heures meurtrières, il a pénétré dans les deux grandes places indomptables, quoique avec perte de quarante officiers et de cinq cents hommes ; les débris dispersés de Château-Vieux cherchent un asile. Le régiment du Roi, désormais calmé, offre de prendre les armes et de se mettre en marche dans un quart d'heure. Bien mieux, les pauvres apaisés demandent une escorte et l'obtiennent, quoiqu'ils soient au nombre de mille, ayant chacun trente cartouches ! Le soleil n'est pas encore couché, quand est décidée la paix sanglante : les régiments mutinés s'en vont tristement par trois routes, et dans Nancy s'élèvent les lamentations des femmes et des hommes, la voix des pleurs et des désolations. La cité pleure ses morts qui ne se réveillent pas. Les rues vides ne sont occupées que par les patrouilles victorieuses. C'est ainsi que la fortune, favorisant les braves, a tiré Bouillé, comme il le dit lui-même, de cet effrayant péril, par les cheveux de la tête. Homme intrépide, homme de fer, que ce Bouillé ! S'il avait été à la place du vieux Broglie dans les jours de la Bastille, tout, peut-être, eût été différent. Il a éteint la mutinerie et une guerre civile acharnée ; non pas pour rien, comme nous le voyons, mais à un taux que lui et le patriotisme constitutionnel ne trouvent pas cher. Et même, Bouillé lui-même, dans des discussions qui suivirent, déclare froidement que c'est contre ses sentiments particuliers, et pour obéir au devoir militaire, qu'il a agi ; la guerre civile sans merci étant la seule chance. Des discussions, avons-nous dit, suivirent. La guerre civile est, à la vérité, un chaos, et dans tout chaos vital il se forme un nouvel ordre de choses ; mais comment croire que le nouvel ordre sortant de ce chaos puisse être Louis XVI avec une monarchie à deux chambres ? C'est comme si l'on jetait deux as cinq cents fois de suite, tout autre dé devant être fatal à Bouillé. Remercie plutôt la fortune et le ciel, ô intrépide Bouillé, et ne tiens pas compte des discussions. La guerre civile, éclatant en ce moment universellement en France, eût conduit à tel ou tel résultat ; mais l'arrêter à temps partout où elle se rencontre et partout où on le peut, c'est le devoir d'un homme et d'un officier général. A Paris, si agité, si divisé, jugez de l'effet produit quand les estafettes, en plein galop, apportent les nouvelles. Les félicitations sont bruyantes et l'indignation est profonde. Une auguste assemblée, à d'immenses majorités, adresse à Bouillé de chauds remercîments : une lettre autographe du roi, les voix des fidèles, celles des constitutionnels, tout cela est sur le même ton. Des funérailles nationales solennelles, pour les défenseurs de la loi tués à Nancy, sont célébrées au Champ de Mars ; Bailly, Lafayette et les gardes nationaux, excepté un petit nombre qui proteste, y assistent. Avec une pompe appropriée aux circonstances, avec le calicot épiscopal rehaussé par la ceinture tricolore, l'autel de la patrie est enfumé par les cassolettes d'encens ; le vaste Champ de Mars est tendu tout autour d'un drap mortuaire, tandis que Marat déclare que toutes ces dépenses de cérémonies et de drap mortuaire seraient beaucoup mieux employées en pain, qui, dans ces jours de famine, pourrait servir au patriote vivant. D'un autre côté, le patriotisme vivant du faubourg Saint-Antoine, fermant bruyamment les boutiques, se réunit au nombre de quarante mille, et avec de formidables cris, sous les fenêtres de l'Assemblée nationale qui votait ses remercîments, demandant vengeance pour les frères massacrés, la mise en jugement de Bouillé et la destitution immédiate du ministre de la guerre, La Tour du Pin. A la vue et au bruit de ces choses, ce n'est pas La Tour du Pin, mais c'est le ministre adoré, Necker, qui juge bon, le 3 septembre 1790, de se retirer doucement, presque secrètement, sous prétexte de rétablir sa santé. En route pour la Suisse natale, non comme il est venu' naguère, mais trop heureux de l'atteindre vivant, il y a quinze mois nous l'avons vu arrivant, avec escorte de cavalerie, au son des clairons et des trompettes ; et aujourd'hui, à Arcis-sur-Aube, tandis qu'il s'en va sans escorte et sans bruit, la populace et les principaux l'arrêtent comme fugitif, et sont sur le point de le massacrer comme traître. L'Assemblée nationale, consultée à ce sujet, lui permet de s'en aller comme une nullité. En dépit des quarante mille, l'Assemblée nationale persiste dans ses remercîments, et le royaliste La Tour du Pin reste ministre. Les quarante mille s'assemblent le lendemain, aussi bruyants que jamais, se précipitent vers l'hôtel de La Tour, trouvent sur le perron des canons avec mèche allumée, et sont contraints de se retirer ailleurs, de digérer leur fiel ou de se réabsorber dans le sang. Pendant ce temps, en Lorraine, les meneurs de Mestre-de-Camp, qui ont distribué les fusils, sont désignés pour être jugés, mais ne le seront jamais. Plus dur est le sort de Château-Vieux. Par la loi suisse, Château-Vieux est livré à une cour martiale composée de ses officiers. Laquelle cour martiale sommairement — en quelques heures — en a fait pendre vingt-trois, et envoyer une soixantaine enchaînés aux galères ; et ainsi, en apparence, finit l'affaire. Des hommes pendus disparaissent pour toujours de la terre ; mais après la chaîne et les galères, il peut y avoir une résurrection triomphale. Ré- surrection pour le héros enchaîné, et même pour le coquin ou le demi-coquin. L'Écossais John Knox, le héros que nous connaissons, fut un jour assis aux rames d'une galère française, et même jeta leur Vierge Marie pardessus le bord au lieu de l'embrasser, comme Vierge de bois qui, naturellement, pouvait surnager. Ainsi, hommes de Château-Vieux, ramez patiemment et non sans espérance. Mais voici qu'à Nancy, l'aristocratie se pavane triomphante, brutale. Bouillé est parti le second jour. Une municipalité aristocratique se montre aussi cruelle qu'elle avait été lâche. La société des Jacobins est supprimée ignominieusement comme la source de tout le mal ; les prisons sont pleines ; le patriotisme battu murmure, non tout haut, mais profondément. Ici et dans les villes voisines, des balles aplaties, ramassées dans les rues de Nancy, sont portées aux boutonnières ; des balles aplaties en tuant le patriotisme ! on les porte en souvenir de vengeance. Des mutins déserteurs errent dans les bois, et demandent l'aumône avec le mousquet au poing. Tout est dissolution, rancune mutuelle, douleur et désespoir, jusqu'à ce que viennent des commissaires de l'Assemblée nationale avec une légère teinte de constitutionnalisme dans leurs cœurs ; ils relèvent doucement les personnes à terre, et abaissent doucement ceux qui se placent trop haut ; réinstallent la société des Jacobins, rappellent les mutins déserteurs, nivelant graduellement toutes choses, et s'efforçant avec sagesse d'apaiser et de calmer. Avec ces nivellements et ces apaisements, d'une part, avec les services funéraires, les cassolettes, les cours martiales et les remercîments nationaux, de l'autre, le monde officiel a terminé sa besogne. Les balles aplaties tombent des boutonnières, et la terre, couverte de cendres noires, reverdit. C'est là l'affaire de Nancy, ou, comme quelques-uns l'appellent, le massacre de Nancy, à proprement parler, le revers de cette trois fois glorieuse fête des Piques, la face de la médaille ayant formé un spectacle digne des dieux. La face et le revers sont toujours près l'un de l'autre ; l'une se montrait en juillet, l'autre en août. Les théâtres, même à Londres, étalent en brillantes décorations la fédération du peuple français célébrée dans des drames. Le drame de Nancy, quoiqu'il ne soit représenté sur aucun théâtre, vit pendant plusieurs mois, d'une manière spectrale, dans le souvenir des Français. Car le bruit de cette mêlée vole à travers toute la France, pénétrant villes et villages, dans les clubs, dans les restaurants, et provoque en petit la répétition des combats, toujours avec ces assertions contraires : C'est bien fait ! ou bien : C'est odieux ! Delà des disputes, des duels, des hostilités, de vains jargons ; de là une préparation à de nouvelles explosions qui nous attendent. En attendant, n'importe à quel prix, la mutinerie est domptée. L'armée française ne s'est pas levée dans un universel délire, ni débandée d'un coup, anéantie pour être renouvelée. Elle doit mourir d'une manière chronique, et peu à peu avec des révoltes partielles comme celles des matelots de Brest et autres semblables, avec des hommes mécontents, insubordonnés, des officiers plus mécontents, à moustaches royalistes, chevauchant isolés ou en corps au delà du Rhin[9]. Un mécontentement morbide, un morbide dégoût de tous côtés ; l'armée moribonde, impuissante à tout service, jusqu'à ce que d'une manière inattendue, semblable au phénix, avec de longues agonies, elle meure et renaisse ; et puis s'élance forte, plus forte, très-forte. Voilà les actes que Bouillé était destiné à accomplir. Sur quoi, qu'il rentre dans l'obscurité, et dans les cantonnements de Metz, commandant assidûment l'exercice, et faisant de mystérieuses diplomaties, avec des plans qui se succèdent et s'annulent, devenu comme auparavant un vain fantôme, l'espoir de la royauté. |