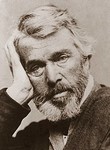HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
LA BASTILLE
LIVRE PREMIER. — MORT DE LOUIS XV.
I. — LOUIS LE BIEN-AIMÉ.Le président Hénault, remarquant, à propos des surnoms d'honneur donnés aux rois, combien il est difficile de déterminer, non-seulement pourquoi, mais encore quand ils ont été conférés, en prend occasion de faire, dans son style correctement officiel, une réflexion philosophique : Le surnom de Bien-Aimé, dit-il, que porte Louis XV, ne laissera pas la postérité dans le même doute. Ce prince, en l'année 1744, pendant qu'il se transportait d'une extrémité de son royaume à l'autre, et suspendait ses conquêtes en Flandre pour voler au secours de l'Alsace, fut arrêté à Metz par une maladie qui menaçait de trancher ses jours. A cette nouvelle, Paris, tout épouvanté, ressembla à une cité prise d'assaut : les églises retentirent de supplications et de gémissements ; les prières des prêtres et du peuple étaient interrompues par les larmes ; et c'est de cet intérêt si cher et si tendre que lui vient ce surnom de Bien-Aimé, titre plus élevé encore que tous les autres que ce grand prince a obtenus[1]. Ainsi est-il écrit, en mémoire durable de cette année 1744. Trente autres années sont venues et passées, et le grand prince est de nouveau malade ; mais combien maintenant les circonstances sont changées ! Les églises ne retentissent pas d'excessifs gémissements ; Paris est dans un calme stoïque ; les larmes n'interrompent aucune prière ; car en réalité il ne s'en fait pas ; excepté des litanies de prêtres, lues ou chantées à un taux fixé par heure, qui ne sont pas sujettes à interruption. Le pasteur du peuple a été transporté du petit Trianon, le cœur appesanti, et mis au lit dans son château de Versailles ; le troupeau le sait, et en a peu souci. Tout au plus, au milieu des flots de partage français, qui s'accumulent jour par jour, et ne sont refoulés que vers les courtes heures de la nuit, cette nouvelle de la maladie royale peut-elle se produire de temps à autre comme un article de conversation. Des paris sans doute sont en jeu ; quelques gens même s'expriment hautement dans les rues[2] ; mais pour le reste, dans les prés verts et dans les cités aux cent cloches, le soleil de mai se lève, le soleil de mai se couche, et les hommes suivent leur travail utile ou inutile, comme si aucun Louis n'était en danger. La Dubarry pourrait, il est vrai, prier, si elle en avait le talent ; le duc d'Aiguillon aussi, et Maupeou, et le parlement Maupeou : ceux-là assis dans leurs poster élevés, avec la France enchaînée sous leurs pieds, savent bien sur quelle base repose leur pouvoir. Regardes-y bien, d'Aiguillon, avec attention, comme lorsque tu surveillais au moulin de Saint-Cast, Quiberon et le débarquement des Anglais, toi, chargé sinon de gloire, au moins de viandes. La fortune a toujours été réputée inconstante, et chaque chien a son jour. Il y a quelques années, le duc d'Aiguillon languissait passablement abandonné, chargé, comme nous avons dit, de viandes, même de quelque chose de pire. Car la Chalotais, le parlementaire breton, l'accusa non-seulement de poltronnerie et de tyrannie, mais aussi de concussion ; accusations qu'il fut beaucoup plus facile d'étouffer par de secrètes influences, que de réfuter. D'ailleurs, les pensées des hommes, ou même leurs langues ne pouvaient être enchaînées. C'est ainsi que sous une funeste éclipse, le petit neveu du grand Richelieu errait à l'aventure, abandonné du monde : l'énergique Choiseul, homme orgueilleux et résolu, le dédaignant ou l'oubliant. Il n'avait guère d'autre perspective que de se retirer en Gascogne, pour y rebâtir des châteaux[3], et y mourir sans gloire en tuant le gibier. Cependant, en l'année 1771, un certain jeune officier, du nom de Dumouriez, revenant de la Corse, put voir avec chagrin, à Compiègne, le vieux roi de France, à pied, le chapeau à la main, en vue de son armée, auprès d'un magnifique phaéton, rendant hommage à la Dubarry[4]. Il y a là dedans beaucoup de choses ! Par là, en premier lieu, d'Aiguillon put ajourner la réédification de son château, pour réédifier d'abord sa fortune : car le robuste Choiseul ne voulait voir dans la Dubarry autre chose qu'une courtisane merveilleusement parée, et marchait son chemin comme si elle n'existait pas. Chose intolérable, source de soupirs, de larmes, de bouderies, d'humeurs, jusqu'à ce que la France — comme elle appelait son royal valet — prît assez de cœur pour voir Choiseul, et avec le tremblement de menton, naturel en un tel cas[5], lui balbutiât son congé : congé de son dernier ministre sérieux, mais pacification de sa courtisane. Ainsi s'éleva de nouveau d'Aiguillon, triomphant. Et avec lui surgit Maupeou, le bannisseur des parlements, qui vous plante un président réfractaire à Croe en Combrailles, au sommet de rochers escarpés, accessibles seulement aux litières pour s'y recueillir. En même temps surgit l'abbé Terray, effronté financier payant soixante pour cent, de sorte que dans une foule pressée à l'entrée du spectacle, un malin s'écrie : Où est donc l'abbé Terray pour nous réduire aux deux tiers ? Et ainsi ces individus — sans doute par magie — se sont bâti un domaine choisi, un réduit enchanté où règne Dubarry ; appelez-le un palais d'Armide, où ils passent agréablement la vie ; le chancelier Maupeou jouant à colin-maillard avec l'enchanteresse, ou lui faisant galamment cadeau de nègres nains ; et un roi très-chrétien jouit à l'intérieur d'une paix inaltérable quoi qu'il puisse se passer au dehors. Mon chancelier, dit-il, est un drôle ; mais je ne puis me passer de lui[6]. Beau palais d'Armide, dont les habitants mènent une vie enchantée, bercés avec la douce musique de l'adulation, servis par les splendeurs du monde ; et le tout cependant suspendu à un seul cheveu. Si le roi très-chrétien mourait, ou seulement était en danger de mort ! Car hélas, la belle et fière Château roux ne dut-elle pas s'enfuir, les joues humides, le cœur enflammé, lors de cette scène de fièvre à Metz, il y a longtemps ; .chassée par d'impitoyables tonsurés, et revenant avec peine, lorsque la fièvre et les tonsurés disparurent ? Pompadour aussi, lorsque Damien blessa la royauté, légèrement, sous la cinquième côte, et que notre course à Trianon fut suspendue au milieu des cris et des torches rudement secouées, Pompadour eut à faire ses malles et à être prête au départ ; mais cependant elle ne partit pas, la plaie n'étant pas empoisonnée. Car Sa Majesté a une foi religieuse, et croit au moins au diable. Et maintenant voici un troisième péril ; et qui sait ce qui s'y trouve ! Car les médecins prennent un air grave, demandent en secret si Sa Majesté n'a pas eu la petite vérole, et pensent qu'elle a pu être d'une fausse nature. Oui, Maupeou, contracte tes sourcils ténébreux et regarde bien avec tes malins yeux de rat ; c'est un cas problématique. La seule chose certaine, c'est que cet homme est mortel ; c'est qu'avec cette vie d'un seul mortel se brise irrévocablement le merveilleux talisman, et que tout le royaume Dubarry s'évanouit avec tumulte dans.les espaces infinis ; et vous autres, comme toute apparition souterraine, vous disparaîtrez complètement, ne laissant derrière vous qu'une odeur de soufre ! Ceux-ci et ceux qui leur tiennent peuvent faire leurs prières à Belzébuth ou à qui voudra les écouter. Mais dans le reste de la France, il n'y a, nous le disions, aucune prière, ou que des prières d'un caractère contraire, exprimées ouvertement dans les rues. Les châteaux et les hôtels où un philosophisme éclairé discute beaucoup de choses, ne sont pas livrés à la prière : et rien n'y excite, ni les victoires de Rosbach, ni les finances de Terray, ni les soixante mille lettres de cachet qui forment la part de Maupeou. Ô Hénault, des prières ? De cette France magiquement souillée de mille plaies, et courbée maintenant dans la honte et la douleur, sous le pied d'une prostituée, quelle prière peut-on attendre ? Ces maigres fantômes, errants, affamés sur toutes les routes, sur tous les sentiers de l'existence française, vont-ils prier ? Ces sombres millions, qui, dans la boutique ou le sillon, tournent accablés la meule du travail, comme le cheval encapuchonné à la roue du puits, et rendu aveugle pour qu'il soit paisible ? Ou ceux de l'hôpital de Bicêtre, huit dans un lit, attendant leur délivrance ? Leur tête n'est qu'obscurité, leur cœur que stagnation : pour eux le grand souverain n'est connu que comme le grand regrattier. S'ils entendent parler de sa maladie, ils répondront d'un air sombre : tant pis pour lui ; ou bien par cette question : va-t-il mourir ? Oui, va-t-il mourir ? C'est là maintenant pour la France la grande question, l'espoir ; c'est par là seulement que la maladie du roi offre quelque intérêt. II. — IDÉALITÉS RÉALISÉES.Quel changement dans la France, quel changement dans Louis ! changement plus grand que tu ne peux encore le voir. Pour l'œil de l'histoire, bien des choses, dans cette chambre de Louis malade, sont maintenant visibles, qui pour les courtisans là présents étaient invisibles. Car, en effet, il est dit avec raison : dans chaque objet il y a une inépuisable signification ; l'œil y voit ce que l'œil apporte de moyens de voir. Pour Newton, et pour Diamant, le chien de Newton, il y a deux univers différents ; tandis que l'image sur la rétine de chacun était probablement la même. Qu'ici donc, le lecteur, dans cette chambre de Louis, tâche de regarder aussi avec son esprit. Il fut un temps où les hommes pouvaient, pour ainsi parler, d'un homme donné, en le nourrissant et le décorant d'une manière convenue, et en l'élevant à la hauteur voulue, se faire un roi, à peu près comme font les abeilles ; et ce qui est encore plus dans la donnée, lui obéir loyalement après qu'il est fait. L'homme ainsi nourri et décoré, et nommé par suite royal, n'est en réalité qu'un être gouverné. Par exemple, si l'on dit de lui, ou même on pense de lui qu'il est allé entreprendre des conquêtes en Flandre, il n'y est vraiment transporté que comme un bagage ; bagage nullement léger, couvrant des lieues entières. Car il a près de lui son effrontée Châteauroux, avec ses cartons et ses pots de rouge, de sorte qu'à chaque station, il faut construire entre leurs logements une galerie de bois. Il a non-seulement sa maison de bouche et sa valetaille sans fin, mais sa troupe de comédiens, avec leurs coulisses de carton, leurs appareils de tonnerre, leurs tambours, leurs violons, leur garde-robe de théâtre, leurs garde-mangers portatifs — sans compter leurs disputes et leurs zizanies — ; tous montés dans des charrettes, des tombereaux, des voitures de hasard, et suffisant à triompher non de la Flandre, mais de la patience du monde. C'est avec un tel déluge de bruyants et discordants accompagnements qu'il se traîne pour entreprendre la conquête de la Flandre. Merveilleux à contempler ! C'est là cependant ce qui a été. Pour quelque penseur solitaire, ce pouvait sembler étrange : pour lui c'était naturel, inévitable. Car notre monde est très-fictif ; et de toutes les fictions, la plus plastique parmi les créatures, est l'homme. Un monde qui ne peut être fixé, qui ne peut être sondé ! Un insondable quelque chose, qui n'est pas nous ; avec quoi nous travaillons, au milieu de quoi nous vivons, que nous façonnons miraculeusement suivant notre être miraculeux, et que nous appelons monde ; mais si même les rochers et les rivières, comme la métaphysique renseigne, ne sont, en strict langage, faits que par nos sens extérieurs, à bien plus forte raison sont faits par notre sens intérieur tous les phénomènes de nature spirituelle : dignités, autorités, le sacré et le profane. Lequel sens interne, d'ailleurs, n'est pas permanent, comme les sens extérieurs, mais toujours changeant et se développant. Le nègre africain rassemble des bâtons et des vieux habits exportés peut-être de Londres, et les combinant adroitement ensemble, en fabrique un eidolon — idole, ou chose apparente —, le nomme mumbo-jumbo et en fait l'objet de son culte, qu'il adore et qu'il contemple avec des yeux terrifiés, non sans espérance. Le blanc Européen s'en moque ; mais il devrait plutôt réfléchir, et se demander si chez lui il ne pourrait pas faire la même chose, un peu plus sagement. Ainsi en était-il, disons-nous, dans ces conquêtes de la Flandre, il y a trente ans ; mais il n'en est plus ainsi. Hélas ! il y a ici autre chose malade que le pauvre Louis ; non-seulement le roi de France, mais la royauté française : voilà ce qui, après une longue lutte de tiraillements et de déchirures, s'en va en lambeaux. Le monde est profondément changé : tant de choses qui semblaient vigoureuses s'affaissent dans la décrépitude ; tant de choses qui n'étaient pas, commencent à être. Quels sont ces bruits qui à travers l'Atlantique viennent frapper les oreilles déjà presque fermées de Louis, roi par la grâce de Dieu ? Ils retentissent comme des présages, des nouveautés dans notre siècle. Le port de Boston est noir de thé que l'on n'attendait pas. Voici que s'assemble un congrès de Pennsylvanie ; et avant peu à Bunker Hill voici la démocratie qui annonce elle-même sa naissance, avec des volées de mousqueterie portant la mort, au son du yankee doodle, sous sa bannière étoilée, et qui comme un ouragan, enveloppera le monde. Les souverains meurent et aussi les souverainetés : tout meurt et n'est que pour un temps, n'est qu'un fantôme de temps, se croyant une réalité. Les rois mérovingiens, dans leurs charrettes à bœufs, lentement traînés à travers les rues de Paris, avec leurs longs cheveux flottants, sont aussi lentement descendus vers l'éternité. Charlemagne dort à Salzbourg, avec son sceptre vermoulu ; la fable seulement attendant son réveil. Et Charles le Marteau, et Pepin aux jambes torses, où sont maintenant les menaces de leurs yeux, les commandements de leur voix ? Rollon et ses sauvages enfants du Nord ne couvrent plus la Seine de leurs barques ; mais sont partis pour un plus long voyage. La chevelure de Tête d'étoupes n'a plus besoin de peigne ; Taille-fer ne pourrait tailler une toile d'araignée ; la cruelle Frédégonde, la fière Brunehilde ont eu leur ardente vie de disputes, et sont couchées silencieuses, les chaudes frénésies de leur vie toutes calmées. La noire tour de Nesle ne voit plus descendre dans un sac vers les eaux de la Seine le galant sacrifié, plongeant dans la nuit ; car la dame de Nesle ne se soucie plus des galanteries de ce monde, ne redoute plus les scandales de ce monde ; la dame de Nesle dort elle-même dans la nuit. Tous ont disparu, engloutis profondément avec les tumultes qu'ils ont soulevés ; et le piétinement et le roulis de générations toujours nouvelles leur passent dessus, sans même que le bruit en vienne jusqu'à eux. Et cependant, en somme, n'y a-t-il pas eu quelque chose de réalisé ? Considérez — pour ne rien dire de plus — ces beaux édifices de pierre et ce qu'ils contiennent. La ville de boue des bordagers — Lutetia Parisiorum ou Barisiorum — s'est pavée, s'est étendue sur les îles de la Seine, et en long et en large sur chaque rive, devenant la cité de Paris, qui se vante quelquefois d'être l'Athènes de l'Europe et même la capitale du monde. Des tours de pierre élèvent leurs fronts superbes, d'antique durée, noires des traces de mille années. Là, sont des cathédrales, et en elles une croyance ou le souvenir d'une croyance ; des palais, un État, une loi. Vois les flots de fumée, souffle inextinguible d'une chose vivante. Les mille marteaux du travail sonnent sur l'enclume ; et un autre travail plus miraculeux se poursuit sans bruit, non avec la main, mais avec la pensée. D'habiles ouvriers de tout état, avec leur habile tête et leur main droite, ont fait des quatre éléments leurs ministres ; attelant les vents à leurs chars maritimes, et faisant des étoiles mêmes leur horloge nautique ; écrivant et collectionnant une bibliothèque du roi : parmi ces livres est le livre hébreu ! merveilleuse race de créatures ! Voilà ce qui a été réalisé, et combien là se révèle de talent ! N'appelez donc pas le temps passé, même avec toute la confusion de ses misères, un temps perdu. Remarquons cependant que de toutes les possessions et acquisitions terrestres de l'homme, les plus nobles sans contredit sont les symboles, divins ou semblant divins, sous lesquels il marche et combat dans cette bataille de la vie, avec une victorieuse assurance : ce que nous appelons ses idéalités réalisées. De ces idéalités réalisées, omettant le reste, n'en considérons que deux : son église ou sa direction spirituelle ; sa royauté ou sa direction temporelle. L'église : quel mot ! plus riche que Golconde et les trésors du monde. Au cœur des montagnes les plus reculées s'élève le petit sanctuaire ; les morts dormant autour, sous leurs pierres blanches dans l'espoir d'une heureuse résurrection. Bien insensible serais-tu, ô lecteur, si jamais à quelque heure — supposons un lugubre minuit, lorsque l'église s'élève comme un spectre dans les cieux, et que l'existence est comme engloutie dans les ténèbres — elle ne te parle en accents inénarrables qui pénètrent jusqu'au fond de ton âme ! Il y avait de la force dans celui qui avait une église, ce que nous pouvons appeler une église. Par elle, il se tenait debout au centre des humanités, au confluent des éternités, debout, inébranlable en face de Dieu et des hommes : le vague univers sans rivages était devenu pour lui une solide cité, une habitation connue de lui. Telle était la vertu renfermée dans la croyance, dans ces mots bien accentués : je crois. A bon droit les hommes prisaient leur credo et lui élevaient des temples monumentaux, respectaient ses hiérarchies et leur donnaient la dîme pour leur subsistance : la foi méritait qu'on vécût et qu'on mourût pour elle. Ce n’était pas non plus un temps à dédaigner que celui où les hommes sauvages en armes élevaient leur plus fort sur le bouclier faisant trône ; et avec un retentissement d'armures et de cœurs, disaient solennellement : sois reconnu notre plus fort ! Dans ce plus fort — justement appelé roi, konning ou canning, l'homme qui peut beaucoup — quel symbole éclatait pour eux, significatif des destinées de leur monde ! symbole de véritable direction en retour d'une affectueuse obéissance, qui est véritablement, s'il le savait bien, le premier besoin de l'homme : symbole qui peut être dit sacré ; car n'y a-t-il pas dans le respect de ce qui vaut mieux que nous une indestructible sainteté 1 De ce point de vue, aussi, on peut bien dire qu'il y a dans l'homme fort reconnu, un droit divin ; car assurément dans cet homme fort, reconnu ou non, on peut se demander qui l'a fait fort. Et c'est ainsi qu'au milieu des confusions et des inexprimables désordres (car toute croissance est confuse) est née cette royauté avec la fidélité près d'elle ; et qu'elle a grandi mystérieusement, soumettant et assimilant ; car elle est un principe de vie : jusqu'à ce qu'elle aussi devînt grande comme un monde, et prit rang parmi les principaux faits de notre existence moderne. Fait si considérable, que Louis XIV, par exemple, put répondre à une magistrature raisonneuse : l'État, c'est moi ; sans autre réplique que le silence et des regards confus. C'est là qu'en était arrivée la royauté, aidée tantôt par le hasard, tantôt par des habiletés ; tantôt par des Louis XI avec sa Vierge de plomb au chapeau, ses roues à torture et ses oubliettes coniques, tantôt par les Henri IV avec ses prophéties de millénaire social, quand chaque paysan aura sa poule au pot, enfin et surtout par la fécondité de sa très-féconde existence — mélange de bien et de mal —. Merveilleux phénomène ! A propos duquel ne pouvons-nous pas encore dire que dans la masse immense du mal, à mesure qu'il marche et se développe, il se trouve renfermé quelque Dieu en travail, travail qui doit conduire à une triomphante délivrance. Comment ces choses idéales se réalisent-elles, comment se dégagent-elles merveilleusement du .milieu du chaos désordonné et toujours flottant de l'actuel ? C'est ce que l'histoire du monde, si elle enseigne quelque chose, doit nous enseigner. Comment les choses grandissent et, après une longue croissance orageuse, viennent à maturité et en floraison ; puis bientôt — car la fleur est peu durable — dépérissent, dégénèrent tristement, tombent lentement ou rapidement et disparaissent avec ou sans bruit. La fleur est si éphémère ! comme la fleur du cactus séculaire, qui, attendue pendant cent ans, brille pendant quelques heures. Ainsi depuis le jour où le rude Clovis, au champ de mars, en vue de son armée, fendit la tête du rude Franc d'un coup de hache d'armes, accompagné de ces mots farouches : C'est ainsi que tu as frappé le vase à Soissons — celui de saint Remi et le mien —, jusqu'à Louis le Grand et ces mots : l'Etat c'est moi, douze cents ans se sont écoulés, et voici que le Louis suivant se meurt et que tant de choses sont mourantes avec lui ! Ainsi encore, si le catholicisme, avec et sans la féodalité — mais non sans la nature et sa bonté — a donné à nous, Anglais, un Shakespeare et une ère de Shakespeare, ce n'est qu'après que le catholicisme lui-même a été aboli ici, autant qu'il pouvait être aboli par la loi. Mais quant à ces âges de décadence où aucun idéal ne croît ou fleurit, quand la croyance et la fidélité ont disparu et qu'il n'en reste que le jargon et le faux écho, quand toute solennité n'est qu'une parade, quand la foi dans l'autorité n'est devenue qu'une de ces deux choses : imbécillité ou hypocrisie ; hélas, en de tels âges, l'histoire n'a qu'à détourner ses regards ; ils ne valent pas qu'on s'y arrête ; il faut les résumer de plus en plus, et finalement les supprimer des annales de l'humanité, les effacer comme illégitimes, ce qu'ils sont en effet. Ages sans espoir où, plus qu'en tout autre, c'est un malheur d'être né. Être né pour apprendre seulement, par toute tradition ou tout exemple, que l'Univers de Dieu est un mensonge, un monde de Bélial, et que le suprême charlatanisme est le hiérarque des hommes 1 Et pourtant ne voyons-nous pas des générations entières (deux et quelquefois trois successivement) vivre, ce qu'ils appellent vivre, dans cette triste croyance, puis disparaître sans chance de reparaître ? C'est dans un tel âge de décadence, ou du moins se précipitant vers la décadence, que notre pauvre Louis était né. Il faut accorder aussi, que si, par suite du cours de la nature, la royauté n'avait pas longtemps à vivre, il était de tous les hommes le mieux fait pour accélérer la nature. La fleur de la royauté française avait, comme celle du cactus, fait de surprenants progrès. Dans les jours de Metz, elle était encore debout avec toutes ses pétales, quoique ternie par une régence d'Orléans et par des roués ministres ou cardinaux ; mais maintenant, en 1774, nous la voyons dénudée et presque entièrement dépouillée de toute vertu. Elle est désastreuse à contempler, non moins que tout le cortège de l'idéal réalisé qui l'accompagnait. L'Église qui dans sa saison florissante, il y a sept cents ans, pouvait faire attendre un empereur, en chemise de pénitent, trois jours dans la neige, s'est vue dépérir depuis des siècles, réduite à oublier les vieux projets et les vieilles animosités, et à lier ses intérêts à ceux de la royauté. Sur cette force plus jeune, il lui faut étayer sa décrépitude, et les deux désormais doivent vivre et mourir ensemble. Hélas ! la Sorbonne siège aussi là, dans sa vieille demeure, mais ne fait que murmurer un jargon sénile et ne dirige plus les consciences des hommes. Ce n'est plus la Sorbonne, c'est l'encyclopédie, la philosophie, et Dieu sait combien d'innombrables multitudes d'actifs écrivains, de profanes chanteurs, de romanciers, de comédiens, de disputeurs et de pamphlétaires qui forment maintenant les guides spirituels du monde. La direction pratique est également perdue ou dispersée dans toutes sortes de mains. Où sont ceux que guide le roi — l'homme pouvant beaucoup, le rex ou directeur — ? Il ne lui reste plus que ses veneurs et ses piqueurs. Quand il ne doit pas y avoir de chasse, on dit : Le roi ne fera rien aujourd'hui[7]. Là, il vit et languit, parce que là il demeure, et que personne n'a encore mis la main sur lui. De la même manière, les nobles ont peu à peu cessé de guider ou d'égarer ; et, ainsi que leur maître, ne sont plus guère que de simples figures d'ornement. Il y a longtemps qu'ils ont cessé de batailler entre eux ou avec leur roi ; les travailleurs, protégés, encouragés par les majestés, ont depuis longues années bâti des villes murées pour y poursuivre leurs travaux, ne permettant à aucun baron pillard de vivre par la selle, mais ayant galères pour l'en empêcher. Depuis la période de la Fronde, le noble a changé son sabre de combat contre une rapière de cour, et maintenant il suit fidèlement son roi comme un satellite servant, partage la proie, non plus par la violence et le meurtre, mais par les sollicitations et la ruse. Ces hommes s'appellent les soutiens du trône ; étranges caryatides de carton doré dans cet étrange édifice ! quant au reste, leurs privilèges sont de toutes manières singulièrement ébréchés. La loi qui autorisait le seigneur à son retour de la chasse ne tuer pas plus de deux serfs, et de rafraîchir ses pieds dans leur sang et leurs viscères chauds, est tombée en parfaite désuétude et même en doute ; car si le député Lapoule peut y croire et en réclamer l'abolition, nous ne sommes pas avec lui[8]. Aucun Charolais, depuis ces cinquante dernières années, quel que soit son goût pour tuer, n'a été dans l'habitude de descendre à coups de fusil des couvreurs et des plombiers pour les voir rouler du haut des toits, mais se contente des perdrix et des coqs de bruyère. Vus de près, leurs talents et leurs fonctions consistent à se vêtir gracieusement et à manger somptueusement. Quant à la débauche et à la dépravation, elles sont peut-être sans exemple depuis l'ère de Tibère et de Commode. On éprouve néanmoins un certain sentiment de partialité en faveur dB madame la maréchale, disant ces mots : Soyez sûr, Monsieur, que Dieu y regardera à deux fois avant de damner un homme de cette qualité[9]. Ce monde du vieux temps avait certainement ses vertus, son utilité, sans quoi il n'eût pas été. Et en effet, ils sont encore obligés d'avoir une vertu — car aucun homme mortel ne peut vivre sans une conscience — : la vertu d'être toujours prêts à se battre en duel. Voilà les pasteurs du peuple : maintenant comment se trouve le troupeau. Ainsi que c'est inévitable, le troupeau va mal, et de mal en pis. Il n'est pas soigné, il n'est que régulièrement tondu. On s'adresse à lui pour faire la corvée légale, pour payer les taxes légales, pour engraisser de ses corps les champs de bataille appelés champs d'honneur, dans des querelles qui ne le regardent pas. Ses mains et ses travaux sont à la discrétion de tout homme ; mais pour lui-même il n'a rien ou peu. Sans instruction, sans satisfaction, sans nourriture, condamné à languir immobile dans un épais obscurantisme, dans un sordide abandon et aveuglement : voilà le lot des masses ; peuple taillable et corvéable à merci et miséricorde. En Bretagne, ils se mirent une fois en insurrection à la première introduction des horloges publiques, croyant que ce fait avait quelque rapport avec la gabelle. Paris a besoin d'être purgé périodiquement par la police, et les hordes de vagabonds affamés sont renvoyées pour errer dans l'espace. Pendant un de ces nettoyages
périodiques, dit Lacretelle, en mai 1750, la
police imagina d'enlever les enfants de quelques gens honorables, dans
l'espoir d'en extorquer des rançons. Les mères remplissent les places publiques
de cris de désespoir ; la foule s'assemble, s'anime ; des femmes hors d'elles-mêmes
courent de côté et d'autre, exagérant les alarmes ; une fable absurde et horrible
se répand parmi le peuple : on dit que les médecins ont prescrit à un grand
personnage des bains de jeune sang pour régénérer
le sien, tout gâté par la débauche. Quelques-uns des émeutiers, dit
froidement Lacretelle, furent pendus les jours
suivants. La police poursuivit son œuvre[10]. Ô pauvres infortunés tout nus ! voilà donc votre cri inarticulé vers le ciel, comme celui d'un animal muet torturé, criant des plus profonds abîmes de la douleur et de l'avilissement. Ces cieux azurés ne font-ils donc que répercuter l'écho de vos voix, comme une insensible voûte cristalline ? ne font-ils qu'y répondre par une pendaison les jours suivants, ? Non, non ; il n'en sera pas ainsi pour toujours. Votre voix est entendue au ciel ; et la réponse aussi viendra, dans une horreur de profondes ténèbres, dans les secousses du monde et dans une coupe de terreur où toutes les nations vont s'abreuver. Remarquez, pendant ce temps, que du milieu des débris et de la poussière de cette universelle décadence, de nouveaux pouvoirs se façonnent, adaptés au temps nouveau et à ses destinées. A côté de la vieille noblesse, originellement de guerriers, il y a une nouvelle noblesse reconnue, de robe, dont le jour de gala et le fier jour de bataille est maintenant venu ; une noblesse de commerce, non reconnue, assez puissante, avec de l'argent en poche ; enfin, la plus puissante de toutes et la moins reconnue, la noblesse de littérature, sans épée au flanc, sans or dans sa bourse, mais avec la grande faculté thaumaturgique de la pensée [dans sa tête. Le philosophisme français a surgi, et dans ce petit mot que de choses sont contenues ! Mais ici se rencontre le symptôme cardinal de la maladie générale, régnant au loin. La foi est partie, le scepticisme est venu. Le mal abonde et s'accumule ; nul homme n'a la foi pour le guérir, pour se guérir lui-même ; il faut que le mal aille en s'accumulant. Tandis que la grandeur et le vide sont le lot des grands, le besoin et la stagnation celui des petits, et que la misère universelle est certaine, quelle autre chose est une certitude, si ce n'est qu'un mensonge ne peut obtenir croyance ? Le philosophisme ne sait que cela ; ses autres croyances consistent simplement à reconnaître que dans les matières spirituelles et super-sensuelles, aucune croyance n'est possible. Infortunés ! Et cependant, la contradiction même du mensonge est une certaine espèce de croyance, mais une fois le mensonge avec sa contradiction disparu, que restera-t-il ? Les cinq sens insatiables et un sixième sens également insatiable : la vanité ; et il restera toute la nature démoniaque de l'homme, se précipitant aveuglément pour dominer sans règle ni frein ; puissance sauvage, mais avec tous les instruments, toutes les armes de la civilisation : spectacle nouveau dans l'histoire. C'est dans une telle France, semblable à une poudrière auprès d'un feu couvant et fumant inextinguible, que Louis XV - est couché pour mourir. Avec le pompadourisme et le dubarrysme, ses fleurs de lis ont été honteusement flétries sur terre et sur mer ; la pauvreté s'est introduite au trésor royal, et la ferme des impôts ne peut plus rien pressurer. Il y a une querelle de vingt-cinq ans avec le parlement ; partout le besoin, la malhonnêteté, le scepticisme et pour médecins politiques des demi-savants, cerveaux brûlés ; l'heure est solennelle. Voilà les choses invisibles aux courtisans, et que voit l'œil de l'histoire dans cette chambre de malade. Il y a eu vingt ans à Noël que lord Chesterfield, résumant ce qu'il avait noté sur cette même France, écrivait et envoyait par la poste les mots suivants, devenus mémorables : Enfin, tous les symptômes que j'ai rencontrés dans l'histoire, antérieurs aux changements et aux révolutions de gouvernement, existent aujourd'hui et se développent journellement en France[11]. III. — LE VIATIQUE.Pour le présent, toutefois, la grande question chez les directeurs de la France est celle-ci : Faut-il administrer l'extrême-onction, ou tout autre viatique spirituel — à Louis, non à la France — ? C'est une grave question. Car si la chose se fait, si même on en parle, ne faut-il pas, qu'aux préparatifs mêmes de la cérémonie, l'enchanteresse Dubarry disparaisse ? risquant de ne pas revenir, même en cas de guérison. Avec elle disparaît d'Aiguillon et compagnie, et tout leur palais d'Armide. Le chaos engloutit le tout, et il n'en restera rien qu'une odeur de soufre. Mais, d'un autre côté, que diront les dauphinistes et les choiseulistes ? Et puis, que dirait le royal martyr lui-même, s'il se sentait mortellement atteint, sans perdre la raison ? Pour le moment, il baise encore la main de Dubarry ; c'est ce que nous pouvons voir de l'antichambre : mais après ? Les bulletins des médecins peuvent être rédigés selon les ordres donnés ; mais c'est une petite vérole confluente et l'on se dit tout bas que la fille si fraîche du concierge est atteinte de la même maladie : et Louis XV est homme à ne pas entendre raillerie sur son viatique. N'était-il pas sujet à catéchiser même ses petites filles dans le Parc-aux-cerfs, à prier avec elles et pour elles, afin qu'elles se maintinssent dans leur orthodoxie[12] ? Fait étrange, mais non sans exemple ; car il n'y a aucun animal si étrange que l'homme. Pour le moment, d'ailleurs, tout irait bien, si l'on pouvait obtenir de l'archevêque Beaumont seulement un clignotement d'œil. Hélas, Beaumont le ferait lui-même volontiers : car chose singulière à dire, l'Église aussi et tout l'espoir posthume du jésuitisme est accroché au tablier de cette femme sans nom. Mais la force de l'opinion publique ? Le rigide Christophe de Beaumont, qui a passé sa vie à persécuter des jansénistes hystériques et, des non-confesseurs incrédules, ou même, faute de mieux, leurs cadavres, comment ouvrira-t-il maintenant les portes du ciel et donnera-t-il l'absolution, avec le corpus delicti sous son nez ? Notre grand aumônier la Roche-Aymon pour sa part, ne marchandera pas sur le tour de clef avec un pécheur royal ; mais il y a d'autres ecclésiastiques ; il y a un confesseur du roi, le stupide abbé Moudon et le fanatisme et la décence ne sont pas encore morts. Au total, que faut-il faire ? Les portes peuvent être bien gardées, les bulletins médicaux bien arrangés, et l'on peut, comme d'habitude, espérer beaucoup du temps et du hasard. Les portes sont bien gardées ; aucun personnage suspect ne peut entrer. Après tout, peu de monde le désire ; car l'infection putride gagne même l'Œil-de-bœuf ; de sorte que plus de cinquante personnes tombent malades, et que dix en meurent. Mesdames les princesses approchent seules de la couche nauséabonde, conduites par la piété filiale. Les trois princesses, Graille, Chiffe, Coche — comme il avait coutume de les appeler — y veillent assidûment quand tout le monde a fui. La quatrième princesse Loque, est déjà dans un couvent, et ne peut donner que ses oraisons. La pauvre Graille et ses sœurs n'ont jamais connu de père ; telle est la dure condition faite par les grandeurs. A peine au débotté, pouvaient-elles rassembler leurs énormes paniers, ramasser autour de leur taille leurs queues traînantes, endosser à la hâte leurs manteaux de taffetas noir, croisés jusqu'au menton, et ainsi convenablement appareillées en grand costume, chaque soir à six heures, faire majestueusement leur entrée, recevoir sur le front un baiser royal, puis faire majestueusement leur sortie, pour reprendre leur broderie, leur parler frivole, leurs prières et leur vie d'inertie. Si la Majesté venait quelque matin, avec du café de sa façon, et l'avalait à la hâte avec elles, pendant qu'on découplait les chiens, c'était comme une grâce du ciel[13]. Pauvres vieilles femmes fanées ! dans les rudes secousses qui attendent encore votre frêle existence avant qu'elle ne soit écrasée et brisée ; pendant que vous fuyez à travers des contrées hostiles, sur les mers orageuses, sur le point d'être prises par les Turcs ; et que dans l'ouragan sans-culottique vous ne reconnaissez pas votre main droite de la gauche, que ces anecdotes passées conservent toujours une place dans vos souvenirs ; car elles ont un caractère bon et aimant ! Pour nous aussi c'est comme un petit rayon de soleil dans ce désert sombre et menaçant, où il ne s'en trouve guère d'autres. En attendant, que peut faire un prudent et impartial courtisan ? Dans les circonstances délicates où sont en question non-seulement la mort ou la vie, mais aussi le sacrement ou le non-sacrement, les plus habiles peuvent hésiter. Peu sont aussi heureux que le duc d'Orléans et le prince de Condé, qui peuvent, à l'aide de sels volatiles, rester eux-mêmes dans l'antichambre royal, et en même temps envoyer leurs fils — le duc de Chartres, qui doit devenir Egalité ; le duc de Bourbon, un jour Condé aussi, et fameux parmi les nullités — pour faire la cour au dauphin : avec quelques-uns en petit nombre, la résolution est prise ; jacta est alea. Quand l'archevêque de Beaumont, contraint par l'opinion publique, se décide enfin à pénétrer dans la chambre du malade, le vieux Richelieu et mène par son rochet dans un coin, et là, avec sa vieille figure de chien débauché, et avec la dernière véhémence, qui enjoint de ne pas tuer le roi avec une proposition de divinité ; et l'on peut juger par le changement de couleur de Beaumont que le vieux roué l'emporte. Le duc le Fronsac, fils de Richelieu, suit les traces de son père. Quand le curé de Versailles murmure quelque chose sur es sacrements, il le menace de le jeter par la fenêtre s'il dit un mot à ce sujet. Heureux ceux-là, pouvons-nous dire ; mais pour les autres qui balancent entre deux opinions, n'est-ce pas embarrassant ? Celui qui voudrait comprendre dans quelle )asse se trouvait alors le catholicisme avec beaucoup l'autres choses, et comment les symboles du très-saint étaient devenus les dés à jouer des très-vils, n'a qu'à ire le récit de ces incidents par Besenval, Soulavie et les autres nouvellistes du temps. Il verra la voie lactée de Versailles déchirée en lambeaux, groupée en nouvelle constellations toujours mobiles. Il y a des hochements de tête, des coups d'œil significatifs, des apartés, des douairières soyeuses se glissant avec mystère, avec des sourires pour telle constellation, des soupirs pour telle autre ; il y a des frémissements d'espoir ou de désespoir dans bien des cœurs. Il y a l'ombre pâle et grimaçante de la mort, cérémonieusement introduite par cette autre ombre grimaçante de l'étiquette : par intervalles, le murmure des orgues de la chapelle, comme une prière mécanique, proclamant, comme dans une espèce d'horrible rire diabolique : Vanité des vanités, tout est vanité ! IV. — LOUIS LE NON OUBLIÉ.Pauvre Louis ! pour ceux-là, c'est une fantasmagorie vide, lorsque comme des comédiens ils gémissent, rendant de faux sons pour un salaire ; mais pour toi c'est d'un sérieux effrayant. Pour tout homme, la mort est effrayante ; depuis longtemps on l'appelle la reine des épouvantes. Notre petite habitation compacte qui se nomme existence, où nous demeurons en tournoyant toutefois, comme dans une habitation, va, au milieu de noires agonies, se changer en un inconnu de séparation, de régions étrangères, d'éventualités sans nom. L'empereur païen demande à son âme : dans quel endroit vas-tu maintenant te rendre ? Le roi catholique doit répondre : devant le tribunal du Très-Haut. Oui, c'est un arrêté de compte de la vie, un règlement définitif qui donne la somme des actes accomplis par le corps : ils sont accomplis maintenant ; et restent là inaltérables, pour porter leurs fruits aussi longtemps que .durera l'Éternité. Louis XV avait toujours eu une royale horreur de la mort. Bien différent était ce duc d'Orléans, toujours priant (le grand-père d'Égalité), qui croyait honnêtement qu'il n'y avait pas de mort, car plusieurs d'entre eux eurent une touche de folie. Celui-là, s'il faut en croire un nouvelliste de la cour, bondit un jour indigné de sa chaise, en jetant des regards de furieux mépris sur son pauvre secrétaire qui avait laissé échapper ces mots : Le feu roi d'Espagne : — Feu roi, monsieur ! s'écria-t-il. — Monseigneur, répliqua aussitôt le tremblant mais rusé serviteur, c'est un titre qu'ils prennent[14]. Louis, disons-nous, n'était pas si heureux, mais il faisait ce qu'il pouvait. Il ne pouvait souffrir qu'on parlât de la mort, évitait la vue des cimetières, des monuments funéraires, et de tout ce qui pouvait en rappeler l'idée. C'est la ressource de l'autruche, qui chassée de près, enfonce sa sotte tête dans la terre, et oublie que son stupide corps qui ne voit pas, reste visible. Quelquefois cependant Louis, dans un accès de bravade spasmodique, qui signifiait la même chose, peut-être davantage, voulait voir ou savoir ; faisait arrêter ses voitures royales, et envoyait demander dans les cimetières : Combien de tombes nouvelles y a-t-il aujourd'hui ? quoique cela donnât à sa pauvre Pompadour les plus désagréables sensations. Nous pouvons nous figurer les réflexions de Louis, lorsqu'un certain jour, royalement caparaçonné pour la chasse, il rencontra à un brusque tournant de la forêt de Sénart, un paysan déguenillé portant un cercueil. — Pour qui cela ? — C'était pour un pauvre frère en esclavage, que la Majesté avait quelquefois vu dans ces parages faisant son métier d'esclave. — De quoi est-il mort ? — De faim. Le roi donna de l'éperon à son cheval[15]. Mais figurez-vous ses réflexions, quand la mort s'attache maintenant à ses propres entrailles ; inattendue, inexorable ! Oui, pauvre Louis, la mort t'a trouve. Ni les murs des palais, ni les gardes armées, ni les riches tapisseries ou les étoffes dorées d'un cérémonial empesé ne peuvent l'empêcher d'entrer : elle est ici, à la portée de ton haleine qu'elle va étouffer. Toi, dont toute l'existence a été jusqu'ici une chimère, un appareil scénique, tu deviens enfin une réalité : le somptueux Versailles éclate et se transforme en songe, en un vide immense. Le temps est fini, et tout l'échafaudage du temps tombe eu débris sur ton âme avec des bruits effrayants. Là, tu vas entrer, nu, découronné, pour attendre ce qui t'est réservé. Homme infortuné, quand dans une sombre agonie tu te retournes sur ton lit de fatigue, quelles doivent être tes pensées ! Le purgatoire et l'enfer, devenus maintenant trop possibles, sont en perspective devant toi : et derrière toi, dans le passé, hélas ! que de choses tu as faites qu'il vaudrait mieux n'avoir pas faites. Quel mortel as-tu généreusement secouru ? A quelle douleur as-tu compati ? Sont-ils maintenant rassemblés autour de toi les cinq cent mille fantômes tombés honteusement sur les champs de bataille depuis Rosbach jusqu'à Québec, pour que ta prostituée fût vengée d'une épigramme ! Et les souillures de ton harem ! les malédictions des mères, les larmes et l'infamie des filles ! Homme misérable ! tu as fais le mal autant que tu l'as pu ; ton existence entière semble un hideux avortement et une erreur de la nature ; on ne connaît encore ni ton utilité ni ta raison d'être. Étais-tu un griffon fabuleux, dévorant les œuvres des hommes, et traînant chaque jour les vierges dans ta caverne ; revêtu aussi d'écaillés qu'aucun trait ne pouvait percer ; aucun trait que celui de la mort ? Griffon non fabuleux mais réel ! Terribles moments pour toi, ô Louis ! — Nous ne voulons pas fouiller plus loin dans les horreurs du lit de mort d'un pécheur. Et cependant il ne faut pas que les plus humbles se flattent sur la blancheur de leur âme. Louis était souverain : mais n'es-tu pas aussi souverain dans ta sphère. Sa vaste France, regardée du haut des étoiles fixes (qui ne sont pas elles-mêmes un infini), ne sera pas plus vaste que ton étroit champ de travail, où tu as fait le bien ou le mal. Homme, symbole de l'Éternité emprisonnée dans le temps, ce ne sont pas tes travaux, tous mortels, infiniment petits, dont le plus grand n'est guère plus grand que le plus petit, mais c'est seulement l'esprit dans lequel tu travailles, qui peut avoir quelque valeur, quelque durée. Considérez, en tout cas, quel problème a dû être la vie de ce pauvre Louis, lorsqu'il se releva Bien-Aimé, de son lit fiévreux à Metz. Quel fils d'Adam aurait pu donner de la cohésion à ces incohérences ? Lui, le pouvait-il ? La plus aveugle fortune l'a seule placé au sommet d'un empire : il y surnage ; mais il n'est pas plus fait pour y dominer, qu'une bûche à la dérive pour dominer les flots de l'Atlantique soulevés par les vents sous la pression de la lune. Qu'ai-je fait pour être tant aimé ? disait-il alors. Et maintenant, il peut dire : Qu'ai-je fait pour être tant haï ! Tu n'as rien fait, pauvre Louis, et c'est là, à vrai dire, ta faute : n'avoir rien fait. Et que pouvait-il faire, le pauvre Louis ? Abdiquer, et s'en laver les mains, en faveur du premier qui voudrait accepter ! Toute autre voie de sagesse lui était interdite. Au lieu de cela, devenu le plus absurde des mortels existants — véritable solécisme incarné —, il s'en tient à regarder, dans le doute, le plus absurde des mondes en confusion, où finalement rien ne lui parut aussi certain que ceci : à savoir, que le solécisme incarné avait cinq sens ; qu'il y avait des tables volantes qui disparaissent dans le plancher pour reparaître regarnies, et avec cela un Parc-aux-cerfs. De la sorte nous avons au moins encore cette curiosité historique : un être humain dans une position originale, surnageant passivement sur les eaux sans fin d'un égout, vers des issues qu'il voyait en partie. Car Louis a en somme quelque clairvoyance en lui. Ainsi, quand un nouveau ministre de la marine, ou tout autre grand fonctionnaire, venait annoncer son ère nouvelle, la courtisane entendait à souper ces mots tomber des lèvres royales. Oui, il a étalé sa marchandise comme un autre ; a promis les plus belles choses du monde, dont aucune ne se réalisera ; il ne connaît pas ces régions ; il verra. Ou bien encore : C'est la vingtième fois que j'ai entendu tout çà ; la France, je crois, ne pourra jamais avoir une marine. Combien aussi étaient touchants ces mots : Si j'étais lieutenant de police, je supprimerais les cabriolets de Paris[16]. Mortel prédestiné ! car n'est-ce pas une prédestination que d'être un solécisme incarné. Nouveau roi fainéant, mais avec un étrange nouveau maire du palais : aucun Pépin à jambes torses pour maire, mais un spectre couronné de nuages, respirant le feu, le spectre de la DÉMOCRATIE, multiple, qui va envelopper le monde ! Louis, cependant, n'était pas plus coupable que tout autre particulier fainéant et mange-tout, que nous rencontrons assez souvent sous le nom d'homme de plaisir, encombrant pendant quelque temps la belle création de Dieu. Mais Louis était plus malheureux. Le solécisme de sa vie était vu et senti de tout un monde scandalisé ; pour lui, il n'y aura pas le tombeau de l'oubli pour l'ensevelir dans les profondeurs sans fin. Il faut que quelques générations passent. Quoi qu'il èn soit, nous remarquons, non sans intérêt, que dans la soirée du A mai, la Dubarry sort de la chambre du malade, avec les traces d'un trouble visible sur son visage. C'est la quatrième soirée de mai, en l'an de grâce 1774. Que de chuchotements dans l'Œil-de- bœuf ! Est-il donc mourant ? Qu'y a-t-il à dire si cette Dubarry semble faire ses paquets ; elle se promène tout en larmes dans ses boudoirs dorés, comme si elle leur disait adieu. D'Aiguillon et compagnie sont à leur dernière carte, néanmoins ils ne veulent pas quitter le jeu. Quant à la controverse sacramentelle, c'est une chose arrêtée, sans plus de discussion. Louis envoie chercher dans la nuit son abbé Moudon, se confesse pendant, dit-on, dix-sept minutes, et demande de lui-même le sacrement. Mais voici l'après-midi : n'est-ce pas la magicienne Dubarry avec le mouchoir aux yeux, qui monte dans le carrosse de d'Aiguillon ; celui-ci s'en va roulant dans les bras consolateurs de sa duchesse. Elle est partie : et sa demeure ne la connaît plus. Disparais, fausse magicienne, dans l'espace ! en vain tu planes dans le voisinage, à Rueil ; ton jour est passé. Pour toi, les royales grilles du palais sont fermées à jamais ; à peine pourras-tu, dans les années à venir, sous les ombres de la nuit, descendre une fois en domino noir, comme un oiseau de nuit, et troubler la fête musicale de la belle Antoinette dans le parc, tous les oiseaux de paradis fuyant loin de toi et les instruments se faisant muets[17]. Créature impure, mais sans malignité, et pour laquelle on ne doit pas être sans pitié ! Quelle destinée que la tienne ! Depuis ce premier lit souillé — dans la patrie de Jeanne d'Arc — où ta mère t'enfanta avec larmes, d'un père sans nom, jusqu'à cette guillotine où tu fus conduite, d'abord par les plus basses profondeurs souterraines, ensuite par les plus élevés et les plus resplendissants sommets de la prostitution et de l'effronterie. En vain tes gémissements implorent le bourreau, la hache fait sa besogne. Repose donc, exempte de malédictions, mais seulement enterrée dans l'effacement ; quelle autre chose te conviendrait ? Louis, pendant ce temps, attend avec impatience ses sacrements, et fait regarder plus d'une fois par la fenêtre pour savoir s'ils arrivent. Console-toi, Louis, autant que tu peux être consolé ; ils sont en route les sacrements. Vers six heures du matin ils arrivent. Le cardinal grand aumônier, la Roche-Aymon, est ici, en habits pontificaux, avec le ciboire et les autres appareils : il s'approcha de l'oreille royale, élève l'hostie, murmure ou semble murmurer quelque chose, et c'est ainsi que Louis — comme le dit l'abbé Georgel, en mots qu'on ne saurait oublier — a fait amende honorable à Dieu, selon le sens qu'y donne le jésuite. — Wa, wa, disait en gémissant le sauvage Clotaire, quand la vie l'abandonnait : Quel est donc ce grand Dieu qui abat la force des rois les plus forts ![18] Amende honorable ! Faites-en comme vous l'entendrez à Dieu, mais il ne s'en fera guère à l'homme, si d'Aiguillon peut l'empêcher. Dubarry est encore en attente chez lui à Rueil, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En conséquence, le grand aumônier la Roche-Aymon — car il semble être dans le secret — n'a pas plutôt vu emballer son ciboire et son attirail, qu'il se prépare à sortir majestueusement, comme si la besogne était finie. Mais le confesseur du roi, l'abbé Moudon, s'élance vers lui et le saisissant par la manche, d'un air aigre et troublé, lui souffle quelques mots à l'oreille. Sur quoi le pauvre cardinal fait volte face, et déclare à haute voix : Que Sa Majesté se repent de tous les sujets de scandale qu'elle a pu donner et s'engage, avec l'aide du ciel, à les éviter dans l'avenir. A ces mots, la figure canine du vieux Richelieu s'assombrit, et il y répond par une épithète que Besenval ne veut pas répéter. Vieux Richelieu, conquérant de Minorque, compagnon des tables volantes, perforateur de murs des chambres à coucher[19], ton jour est-il aussi venu ! Hélas ! les orgues de la chapelle peuvent gémir, la châsse de sainte Geneviève être descendue et remontée sans effet. Dans la soirée, toute la cour, avec dauphin et dauphine, assiste au service dans la chapelle ; les prêtres sont enroués à force de chanter les prières des quarante heures, et les tempêtes du ciel mugissent. Chose presque effrayante : le ciel noircit, des torrents de pluie s'abattent en sifflant, la voix du tonnerre étouffe les sons de l'orgue, et les sillonnements des éclairs font pâlir les flambeaux de l'autel, de sorte que la plupart des assistants, nous dit-on, se retirèrent, la cérémonie achevée, à pas précipités, dans un état de recueillement, et ne disant rien ou peu de chose[20]. Voilà plus de la moitié d'une quinzaine que cela dure ; Dubarry disparue depuis près d'une semaine. Besenval dit que tout le monde s'impatientait, désirant que cela finît, que le pauvre Louis en finît. Nous voici au 10 mai 1774. Maintenant il en aura bientôt fini. Le jour du 10 mai pénètre sur la couche nauséabonde, mais triste et à peine rayonnant, car ceux qui regardent par les fenêtres ont une figure sombre ; la roue de l'existence tourne péniblement sur son axe ; la vie, comme un coursier épuisé, cherche, haletante, le repos. Dans leurs appartements éloignés, le dauphin et la dauphine se tiennent prêts à partir ; tous les écuyers et postillons bottés et éperonnés, attendent quelque signal pour fuir la maison de pestilence[21]. Écoutez ! à travers l'Œil-de-bœuf quel bruit retentit ! terrible et semblable au tonnerre ! C'est le flot de tous les courtisans, s'élançant à l'envi pour saluer les nouveaux souverains : Salut à Vos Majestés ! Le dauphin et la dauphine sont roi et reine. Accablés d'émotions, tous deux se jettent ensemble à genoux et s'écrient en versant des larmes : Ô Dieu, guide-nous, protège-nous, nous sommes trop jeunes pour régner ! Trop jeunes, en effet. C'est ainsi néanmoins que l'horloge du temps a sonné avec un bruit semblable au tonnerre, et qu'une vieille ère est finie. Ce qui fut Louis, gît abandonné, masse d'argile abhorrée, laissée aux soins de quelques pauvres et des prêtres de la chapelle ardente, qui se hâtent de le placer dans deux cercueils de plomb en y versant des flots d'esprit-de-vin. Le nouveau Louis, avec sa cour, roule vers Choisy dans une après-midi d'été ; les larmes royales coulent encore, mais un mot prononcé par mon seigneur d'Artois provoque un rire général et l'on ne pleure plus. Mortels évaporés, comme vous conduisez légèrement le menuet de la vie, au-dessus d'abîmes sans fond dont vous n'êtes séparés que par une pellicule ! Quant au reste, les autorités comprirent que les funérailles n'exigeaient pas beaucoup de cérémonie. Besenval lui-même pense qu'on y mit assez de sans-façon. Deux carrosses contenant deux nobles avec le rang d'huissiers, et un ecclésiastique de Versailles, une vingtaine de pages à cheval, une cinquantaine de palefreniers, ceux-ci avec des torches, mais pas même vêtus en noir, partent de Versailles dans la seconde soirée avec leur cercueil de plomb. Ils partent au grand trot et maintiennent cette allure ; car les brocards de ces Parisiens, qui forment deux rangs sur la route de Saint-Denis, et donnent essor à leurs plaisanteries, fait caractéristique de la nation, ne les engagent guère à ralentir le pas. Vers minuit, les voûtes de Saint-Denis reçoivent leur dépôt, sans qu'il soit versé une larme, si ce n'est par la pauvre Loque, sa fille négligée, dont le couvent est dans le voisinage. Les voilà qui le précipitent et l'enfouissent sous terre d'une manière impatiente, lui et son ère de péché, de tyrannie et de honte ; car voici venir une ère nouvelle, et l'avenir semble d'autant plus brillant que le passé a été plus infâme. |