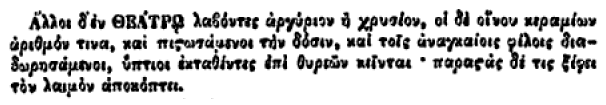LA CITÉ GAULOISE SELON L'HISTOIRE ET LES TRADITIONS
CHAPITRE HUITIÈME. — Le Dunum. - L’Ædificium. - Le Chef. - L’Hospitalité. - Les Festins. - La Guerre. - La Sépulture.
|
Le système défensif des Gaulois se complétait, comme nous l’avons dit dans un des chapitres précédents, par de petites citadelles qui, à raison de leur position et de leur nombre dans les pays de montagnes, ne laissaient pas de présenter un ensemble assez formidable. Elles litaient les postes avancés et comme les sentinelles de l’oppidum. Elles signalaient l’ennemi et opposaient à sa marche des obstacles souvent efficaces. Elles étaient aussi le lieu de ralliement des clans autour de leurs chefs. La féodalité gauloise, comme celle du moyen-âge, s’était installée sur les hauteurs et s’y était construit, comme elle, des demeures qui la faisaient respecter. C’est ce que César appelait des châteaux, et ce que nous appelons ici la Dunum. La raison de cette dénomination qui restitue à ces forteresses leur physionomie celtique est puisée dans les traditions qui nous en font aujourd’hui retrouver les ruines. On chercherait en vain, dans César et dans les documents postérieurs, des indications sur ces châteaux, malgré leur utilité pour la défense du territoire et bien qu’ils fussent le siège de la puissance des chefs. Trop faible pour arrêter une armée romaine, le dunum était cependant une protection à peu près inexpugnable contre un coup de main, et pourrait repousser les entreprises de bandes isolées. A cette distance de vingt siècles l’histoire a négligé ce détail, mais il s’est perpétué dans la légende[1]. Tout le pays gaulois était hérissé de ces dunum. Partout où la configuration du sol accentuait des reliefs, partout où s’élevaient des montagnes et des collines, le dunum se dressait sur la hauteur, commandait les passages et présentait un point de résistance avec lequel une force indisciplinée devait nécessairement compter. Ces groupes formaient la ceinture militaire de l’oppidum et tenaient l’ennemi à distance. Ils en rendaient les approches difficiles à un assaillant dépourvu de tactique, l’obligeaient à diviser ses forces, émoussaient ses attaques et donnaient aux populations le temps de pourvoir à leur sûreté. A ce point de vue, le dunum était le satellite de l’oppidum et son complément indispensable. On le reconnaît particulièrement sur les sommets qui conservent encore aujourd’hui le nom gaëlique de Dun. Il en couronne les plateaux et les points culminants, tantôt isolé des chaînes voisines par des escarpements ménagés avec une intention trop évidente et des combinaisons trop uniformes pour être l’œuvre purement fortuite de la nature, tantôt plongeant à pic sur des précipices. Des écroulements d’anciennes murailles où n’apparaît aucune trace de mortier, signe certain de leur haute antiquité et de leur origine barbare, dessinent la plupart de ces enceintes. Çà et là des solutions complètes de continuité indiquent les ouvertures et les accès. Ces amoncellements n’ont rien qui frappe à première vue le regard ; leurs dispositions principales l’accusent à peine sous l’herbe et les broussailles qui les confondent avec le sol, ou dans les massifs des végétations superposées. De légères saillies sur le talus de fossés peu profonds, parfois des blocs énormes, des vestiges d’anciennes chaussées en pierre sèche, soif tout ce qui resta en général de la forteresse du chef gaulois. C’était là cependant la demeure du Brenn, de l’homme au collier l’or, que les chants bardiques nous représentant si souvent dans la salle du festin au milieu de ses amis et de ses fidèles, de ce guerrier farouche et railleur qui portait l’épouvante dans le monde civilisé, de ce terrible visiteur que l’histoire entrevoit à différentes époques en Grèce, en Asie, en Égypte, qui saccageait l’Italie et venait insulter Rome au pied de son Capitole. Ces souvenirs, on le voit, donnent quelque intérêt à cette étude. Ces hautes solitudes, avec leurs vastes horizons, étaient merveilleusement adaptées aux besoins d’une stratégie rudimentaire qui devait emprunter à la nature ses principales ressources. L’assaut en était difficile et elles surveillaient les mouvements de l’ennemi, deux conditions excellentes contre les moyens d’attaque dont pouvaient disposer des barbares. Elles convenaient aussi aux habitudes guerrières et au tempérament politique des maîtres qui les occupaient, et chez lesquels un sentiment instinctif des beautés de la nature n’était pas complètement étouffé par la grossièreté des mœurs[2]. La grandeur du paysage, la majesté d’un site où, du haut des terrasses, le brenn pouvait, comme plus lard le seigneur féodal, embrasser l’étendus de ses domaines ; — les forêts qui croissaient à ses pieds ou s’étageaient sur les pentes ; — les cours d’eau dont le voisinage était si apprécié chez les Celtes, selon le témoignage de César[3], et qui, par une combinaison de la nature assez fréquente dans les terres granitiques, prennent leurs sources sur les plateaux des montagnes ou s’épanchent de leurs flancs ; — toutes ces conditions devaient plaire aux chefs des clans et les fixer de préférence sur le dunum. Dans les pays de plaine cependant, le chef suppléait à l’avantage de la position par des moyens qui n’étaient pas dépourvus d’efficacité. Les défenses dont il s’entourait le mettaient à l’abri de toute surprise. A un certain périmètre de son ædificium des talus bordés de haies couchées, de plessées, pour rappeler une vieille expression d’où dérive le nom de Plessis donné à tant de résidences féodales, opposaient à l’assaillant un premier obstacle assez difficile à franchir. Des palissades, des poutres aigues, la pointe en avant[4], formaient la seconde enceinte du hall[5] et ses cours. On tirait également parti des rivières et des marécages dont les constructeurs gaulois se faisaient d’utiles auxiliaires, comme nous le montre l’exemple de Besançon et d’Avaricum. L’importance de ces citadelles était toujours subordonnée à celle de la position à défendre ; le mode de construction, aux accidents du sol et aux matériaux qu’on avait sous la main. Chaque dunum, comme l’oppidum lui-même, était flanqué d’avant-postes ou guettes, en latin speculæ, destinés à lui donner l’alarme. On les reconnaît à l’existence de tartres nombreux que leurs reliefs et leurs dimensions ne permettent pas de confondre avec des tumulus funéraires. Ces vigies, disposées aux différents étages de la montagne, surveillaient les gorges et les passages dont la profondeur échappait à l’œil des sentinelles placées sur le dunum. On rencontre ces fortifications accessoires en assez grand nombre autour des retranchements du Beuvray. Elles sont munies d’un fossé qui détermine le caractère de ces ouvrages et en précise le but. Bien peu de ces tertres conservent des traces d’une maçonnerie quelconque ; mais il faut se rappeler que les édifices celtiques, comme d’ailleurs la plupart des châteaux pendant la première partie du moyen-âge, étaient généralement en bois. Quelquefois aussi des monceaux de pierres brutes y décèlent l’existence d’anciennes murailles à sec ou de bâtiments grossiers sans briques ni poteries. L’utilité de ces guettes était motivée par les habitudes d’un peuple, sans cesse sur le qui-vive, et chez lequel la guerre et le brigandage étaient des occupations régulières. Le chef de clan, ce sont les lois irlandaises qui nous l’apprennent, pouvait convoquer la tribu aux trois expéditions annuelles[6], et quiconque était propriétaire d’un héritage était tenu de le rendre à sa réquisition. Celui qui possédait un bouclier et savait s’en servir devait le suivre aux pillages, le resta du peuple être prêt à repousser toutes les attaques. Avec de pareilles mœurs, sanctionnées par de pareilles lois, il fallait se méfier de ses voisins et surtout se bien garder. Les guettes servaient aussi à percevoir les taxes prélevées sur les voyageurs et les marchandises qu’on arrêtait au passage. Le système est encore en vigueur chez diverses peuplades de la Syrie et du Liban. Sur les limites de chacun de ces petits États, des tours d’observation, placées sur les hauteurs voisines, surveillent tous les chemins. Des guetteurs en permanence signalent l’arrivée des caravanes et des voyageurs isolés. A leur premier appel, des cavaliers apostés dans ce but entourent les nouveaux venus, et les mettent à composition, s’ils ont eu l’imprudence de s’aventurer sur le territoire de la tribu sans avoir traité avec le chef. Il est à croire que les Gaulois employaient des procédés analogues, et que la féodalité, sous ce rapport, n’a fait que continuer leurs errements. Le brenn, chez les Gallois, avait seul le droit de protéger les routes, c’est-à-dire de détrousser les passants. La Vie de saint Patrice et celle de saint Mœdhog montrent des chefs riches et puissants, voleurs de grands chemins, pillant et blessant les voyageurs[7]. Tels étaient les points d’appui du dunum. On a maintenant l’idée d’un assez vaste système militaire, l’oppidum au centre et au sommet, tout autour les dunum échelonnés sur les montagnes, et les interstices de ces gigantesques barricades parsemés de nombreuses vigies. De telle sorte que tous les points du territoire étaient dominés et gardés, et que ce n’était pas une médiocre entreprise que de pénétrer jusqu’à l’oppidum. Ces conditions faisaient la force et assuraient la prépondérance des cités qui les réunissaient, comme celle des Éduens, à ut, degré supérieur. Un tel pays, défendu par des peuples aussi belliqueux, eût été invincible pour tout autre ennemi qu’une armée romaine commandée par un capitaine comme César, et encore ne put-il achever sa conquête qu’après dix ans d’efforts, et avec lu secours de la Gaule divisée contre elle-même. La plupart des lieux fortifiés que l’on rencontre dans le voisinage des oppidum, et que leurs aggérations rattachent évidemment à l’époque celtique, ont conservé leur nom primitif. Ce radical dun[8] avait une double acception. Il signifiait à la fois montagne et forteresse, parce que ces deux idées, dans l’esprit des Celtes, étaient inséparables. Par une de ces concessions que la force des habitudes impose ordinairement aux usages nouveaux, la vieille appellation de dunum prévalut encore quelque temps après la conquête, en altérant son sens propre. Elle apparut pour la dernière fois sous Auguste accolée à des noms romains, notamment dans Augusto-dunum, aujourd’hui Autun, le fort d’Auguste, malgré l’absence des conditions topographiques qui constituaient le dunum. Mais les autres dunum du pays éduen ont conservé dans toute leur rigueur le sens du radical celtique. Dône, Dun, Brancion[9], Sedunum, Suin, Dardon, près Toulon, etc. Sur la plupart de ces sommets se trouvent encore les pierres sacrées qui jouaient un rôle si important dans les cérémonies religieuses et dans les assemblées politiques de la Gaule. A Sedunum du Charollais, on montre une énorme pierre croulante dont la surface supérieure est creusée de nombreuses cuvettes qui recevaient, suivant la tradition populaire, le sang des victimes[10] ; à Dun-le-Roi, la pierre tournante ; à Brandon, un dol-men, et les men-hirs renversés d’Épogny ; au mont de Sune, la pierre croulante de Sampigny ; à Dône, des pierres à cuvettes ; près de l’Essertenue, la pierre qui croule d’Uchon ; à Dettey, la pierre du Diable. Des légendes où l’on reconnaît les restes de croyances antérieures au christianisme, et reléguées par lui au rang des superstitions, se sont perpétuées dans ces localités. Presque partout, c’est la vivre qui garde le trésor sacré, exposé aux regards de tous, auquel nul ne peut porter la main saris élire puni de mort ; à Dun, la pierre tournante s’entrouvre et engloutit le profanateur qui touche au trésor ; à Suin, les cuvettes de la pierre tournante sont devenues les pitres ou les pas du bon Dieu ; à Loll[11], Rome-Château, à l’Essertenue, coulent les fontaines des dames, des maires, des fées ; à Dettey, an Beuvray, où ces divinités ont été détrônées par le grand démolisseur du paganisme celtique, saint Martin, les génies hantent encore les carrefours des bois. On y montre la roche du Diable arrêtée dans sa chute, au lever de l’aurore, à l’apparition de Belen, et portant l’empreinte du dos et des griffes du génie malfaisant. Au pied du Rouvray, la fée blanche transporte dans son tablier le dolmen, récemment détruit, de Rozé ; à Maison-Dru, comme au Beuvray, la dame donne du lait aux nourrices ; à la Comelle, elle guérit les yeux ; à l’Fssertenue, elle enlève la fièvre et marie dans l’année las jeunes filles qui viennent accomplir certains rites près de ses sources[12]. Partout le culte des fontaines et des rochers où résidaient les génies gaulois. Ainsi, des circonstances dont l’enchaînement vous échappe ont fixé ces superstitions sur l’emplacement des dunum. Entre ces croyances et les forteresses des chefs gaulois, l’imagination des derniers représentants de la race celtique a établi une relation qui reste, pour nous, mystérieuse. L’histoire présente parfois de ces déviations, mais l’indication n’en est pas moins sûre. La pierre tournante marque la sépulture du dunum. Les paysans des hameaux où ces légendes subsistent, et où nous les avons recueillies, sont encore des colons de la vieille Gaule. Isolés dans leurs solitudes, ils ont traversé les siècles sans être mêlés à cette circulation d’idées qui a si profondément modifié les têtes humaines. Ils sont restés ce qu’étaient leurs pères natio admodum dedita religionibus[13]. Ils ont donc pu conserver, peu près intact, comme dans un sanctuaire grossier mais respecté, ces antiques sédiments de la religion druidique. Seuls, parmi les hommes de nos jours, ils trous parlant des déesses des eaux, des génies, ales dames araires, qui apparaissent la nuit sur les ratines des vieux châteaux et qui gardent encore la demeure du brenn resté pour eux la personnification héroïque du vieux temps. En dehors cependant de ces renseignements, nous devons à l’étymologie, sur la demeure du chef, quelques données qui sembleront peut-être un peu plus positives aux esprits qui repoussent systématiquement la tradition. Dans plusieurs localités du pays éduen, on retrouve au pied des dunum des villages qui conservant leurs noms celtiques, et, dans ces noms, le radical qui désigne la demeure du chef, du chevalier marc’ hek[14] ; ainsi Marchef, sous Rome-Château ; Marcheseuil, sous l’oppidum de Rême ; un autre Marcheseuil, sous l’oppidum de Bar. Ainsi encore, comme nous l’avons dit, Brann o dunum, Brancion, la demeure du brenn ; ces lieux pouvaient n’être que des tènements serviles placés sous sa dépendance immédiate. Les légendes bretonnes et irlandaises, écrites par des religieux qui n’emploient que des formes latines, donnent le nom de munitio à la demeure du chef : Hoc juxta Brudæi regis munitinuem accidit. Et ailleurs : In loco qui dicitur munitio magna[15]. Le dunum était une citadelle ; l’ædificium une habitation, la demeure particulière du chef, sa résidence préférée pendant les courts répits que lui laissait la guerre. Sans être dépourvu de certains mayens de défense, l’ædificium semble avoir eu plutôt le caractère d’une maison des champs. Situé dans le voisinage des forêts et des fleuves, il réunissait alors les conditions que recherchaient les riches Gaulois pour se liner aux plaisirs de la chasse et de la perche, pour élever et pacager des chevaux, pour exercer l’hospitalité. Dans un rayon suffisamment rapproché étaient disséminées les chaumières des colons, désignées par les Romains sous le même nom d’ædificium et qui ne différaient guère de la construction du chef que par des proportions plus restreintes. Ces bois silencieux et immenses dont la Gaule était couverte, ces tranquilles paysages adoucis encore par les teintes changeantes de son ciel et les molles sinuosités des rivières[16] où s’abreuvaient les grands troupeaux, ces vallées sauvages dont les torrents entretenaient la fraîcheur, ont été souvent célébrés par la poésie celtique. César lui-même semble en avoir apprécié le charme[17]. C’était là que le brenn venait se reposer des émotions d’une existence toute semée d’embûches et de périls. Encore souvent le péril venait-il l’y chercher. Ambiorix, surpris par la cavalerie de César dans sa maison de campagne située au milieu des bois, comme presque toutes les habitations gauloises[18], saute sur le cheval d’un de ses ambactes, qui se font tuer pour lui, et s’échappe dans l’épaisseur de la forêt : Fugientem silvæ texerunt. Le brewy du premier rang, disent les lois irlandaises, est celui qui vit dans une maison à quatre portes, à travers laquelle coule un ruisseau d’eau vive pour produire un courant d’air et chasser l’humidité, Il doit entretenir au moins deux cents ouvriers et posséder deux cents têtes de bétail de chaque espèce[19]. Le goût des Celtes pour la campagne semble avoir été l’un des instincts de leur race ; il se retrouve encore chez les peuples d’origine saxonne et irlandaise. Mille ans plus tard, au moyen-âge, l’influence romaine n’y avait rien changé ; le voisinage des villes qui commençaient à se peupler, et qui refoulait de plus en plus la limite des futaies incultes et des vastes territoires de chasse n’avait pas altéré, sous ce rapport, les mœurs de leurs descendants. Cette préférence héréditaire pour l’indépendance des champs, unie à la passion des aventures, semble avoir constitué le fond de la vie féodale. Le poème historique d’Ermold-le-Noir nous montre, au neuvième siècle, le chef breton Morvan, dans sa maison rustique, au milieu de ses hommes d’armes. Des haies vives forment l’enclos. Le lieu qu’il a choisi pour retraite confine à des forêts et à un fleuve, qui forment autour de l’habitation une double ceinture. C’est le séjour qu’il aime, un endroit sûr et commode. Nous citons le passage ; on croirait lire la description de l’ædificium d’un contemporain d’Ambiorix : Est locus hinc silvis, hinc
flumine cinctus amœno, Sepibus et sulcis, atque
palude situs. Intus opima domus, hinc inde
recurserat armis, Forte repleius erat milite seu
vario. Hæc loca præcipue semper Murmanus[20] amabat, Illi certa quies, et locus aptus erat[21]. Plus loin, le même Ermold décrit non plus la maison d’un simple chef, mais le palais d’un empereur, de Louis-le-Pieux, au-delà de la Loire. On va voir quelle est l’importance de la situation et de la nature des lieux : Trans fluvium Ligeris locus
est quippe uber et aptus ; Cingitur hinc silvis, hinc
quoque planitie, At medius placido fluviorum
gurgite vernat. Piscibus est babilis, est
locuplexque feris Quo Illudovicus ovans præcelsa palatia struxit[22]. Toujours les forêts : ce site plantureux et riche, cette île qui déploie sa verdure entre les deux bras du fleuve, le poisson et le gibier en abondance, tous ces traits rappellent les tableaux de César et de Posidonius. L’archéologie ne fournit aucun renseignement direct sur la disposition intérieure de l’ædificium. Mais si nous ne pouvons nous introduire, par le récit d’Ermold dans cette maison du chef intus opima dont il décrit si bien les alentours, nous comblerons aisément cette lacune à l’aida de documents celtiques d’une authenticité irrécusable. La demeure du brenn est très exactement détaillée, au moins dans ses parties principales, par la loi galloise. La persistance des usages de la vie domestique devait, au effet, maintenir les dernières forages de l’édifice dans un pays où les influences extérieures n’avaient encore que bien pou de prise sur les mœurs, où les nobles visaient au milieu de leurs domaines, à la mode de leurs ancêtres, Nous avons vu, pour notre part, la maison gauloise, dans quelques coins du Morvan, et dans toute la rudesse de son archaïsme. Au cinquième siècle, les Bretons, les Gallois, les Armoricains, étaient, au christianisme près, tels qu’au temps de César. Encore le christianisme, en renouvelant l’ordre moral, avait-il, dans plusieurs de ces contrées, respecté les coutumes populaires et laissé debout même les pierres druidiques. Les sorts étaient tenus, comme nous l’avons dit, de reconstruire et d’entretenir l’ædificium du chef. La loi d’Hoël rappelle cette obligation et la précise en énumérant les parties dont la demeure se compose. Il y a neuf édifices : le palais, la chambre, la cuisine, le grenier, le four, le chenil, l’atelier et la chapelle[23], — les Gallois étaient alors convertis. Ces dispositions étaient, dans l’origine, commandées par la nécessité. La dispersion des populations, l’éloignement des oppidum, la pou rte ressources qu’ils pouvaient offrir pour se procurer des ouvriers, obligeaient les chefs gaulois à pourvoir leur ædificium de tout ce qui était indispensable à l’entretien de la maison. Il fallait avoir sous la main la boulangerie, la forge ou maréchalerie, l’atelier des charpentiers, tout ce qui concernait le service de la vènerie ou de la pèche. Ces ateliers et les ouvriers qui y étaient attachés occupaient les dépendances de l’ædificium. Voilà ce qui se retrouve dans les coutumes galloises au cinquième siècle. Les vieux terrassements qui existent sur l’emplacement des dunum et des ædificium confirment d’ailleurs ces indications. On y remarque diverses enceintes désignées, dans les chartes, sous les noms de courts ou curtliz[24], défendues par des fossés et séparées de l’habitation principale ; le tout enfermé dans la grande enceinte fortifiée qat enveloppait tout l’ædificium. Les châteaux et les monastères, au moyen-âge, filaient exactement dans les mêmes conditions. Aussi sont-ils devenus le noyau des premiers groupes qui ont formé dans la Gaule la plupart des villages, des bourgs et même des agglomérations principales. Le document que nous citons nous introduit chez le brenn, dans l’intérieur de son palais rustique. Une miniature contemporaine d’Hoël et tirée de la bibliothèque barléienne, nous en donne l’aspect et la physionomie[25]. Nous sommes au neuvième siècle, c’est-à-dire à une époque où bien des changements se sont accomplis. Le brenn n’est plus tout à fait un chef barbare ; il s’est converti au christianisme. Il a changé son vieux titre celtique contre celui de marquis ou de comte. La croix surmonte l’on des bâtiments de son château dont il a fait la chapelle. Les diverses constructions ne sont plus faites de bois seulement ; la pierre, la brique y dessinent des assises régulières. Sur toutes, la toile a remplacé le chaume. Un peu d’imitation romaine est passée par là ; des ébauches de frontons, des intentions architecturales, des essais d’ornements, des visées d’élégance, des portes en draperies, des lampes aux vestibules ; le luxe enfin qui convient à un seigneur opulent. Cn même temps qua la demeure s’est embellie, le cœur du maître s’est adouci, ses sentiments se sont disciplinés, il n’est plus seulement généreux, hospitalier par nature ou par ostentation ; il est humain, charitable. Il distribue lui-même l’aumône aux pauvres gens, aux estropiés, aux infirmes. La châtelaine l’assiste dans cette œuvre. Tout à l’heure, un grand feu allumé dans la cour va réchauffer ces pauvres enfants nus. Tel est le sujet de ce petit dessin très curieux auquel nous renvoyons nos lecteurs. Si l’ancêtre du cinquième siècle, si le chef qui a combattu César, pouvaient un instant sortir de leurs tombes, ils seraient fart émerveillés de toutes ces transformations, mais ils reconnaîtraient encore, dans l’ensemble de ses dispositions, leur vieil ædificium. Le type celtique sep retrouve intact sous ces formes encore frustes, el, malgré les perfectionnements apportés, Vitruve n’est pour rien dans cette ordonnance qui procède directement de la tradition barbare. Dotons ici une observation importante. Il n’y a pas dans l’ædificium de distributions intérieures, à proprement parler, tout au plus des compartiments, des cloisons en planches formant à peine des cellules. Au centre, le hall, la grande salle qui sert aux festins, aux veillées, à la réception des étrangers, comme dans les chants bardiques et dans l’Odyssée. Sur les flancs, les dessertes, les chambres des femmes, les logis du personnel militaire attaché au service du seigneur. Les italiens, les Grecs construisaient un édifice unique, homogène, le divisaient par parties, par étages, pour la commodité des habitants et selon leurs besoins. Les Celles ignoraient cet art, ils l’ignoraient encore au neuvième siècle. Chaque chambre est une maison ayant ses murs et sa toiture, comme son affectation particulière. Ajoutons que chaque bâtiment n’avait pas plus d’étages que de parties ; à l’époque d’Hoël, les constructions superposées commençaient à peine à élire en usage dans les pays celtiques. Les Gaulois n’habitaient donc que des rez-de-chaussée, et le mot cabane tire son étymologie du celte. Il nous parait bien difficile de concilier un tel système de construction avec les exigences de l’architecture urbaine. Ce dessin, très intéressant en ce qu’il a permis d’interpréter certains passages du poème anglo-saxon de Beowulf, l’un des documents les plus importants qui existent sur l’histoire privée des Bretons à l’époque de la domination romaine, a cela de précieux pour nous qu’il ouvre une véritable échappée sur notre sujet. Remarquons surtout cette rotonde qui précède le hall. Cette partie de l’édifice, la plus apparente de toutes, reproduit la forme circulaire des antiques constructions gauloises observée par Strabon[26]. Le perron, largement ouvert dont les portes ne sont jamais fermées, comme nous le dit Nicolas de Damas, semble inviter fa voyageur à venir demander l’hospitalité[27]. Il n’y a point de portier à la porte d’honneur, et l’habitation est ouverte à tous les honnêtes gens, dit un poète gallois. — Ce vestibule où étaient cloués les crânes des ennemis que le chef avait tués de sa main, répond encore aux descriptions de Posidonius et de Diodore. Ces hideux ornements qui révoltaient Posidonius ont très probable ment disparu, mais on y voit encore, suspendues en trophées, les têtes monstrueuses des aurochs, celles des élans, des sangliers, des loups ; la tête d’un cerf ornée de ses longs bois est encore, comme du temps de Strabon, au sommet de celle rotonde. En arrière, au second plan, en aperçoit une tour qui donne à l’ensemble un aspect féodal. L’usage de suspendre les dépouilles des animaux tués à la chasse dans l’intérieur du vestibule et aux grands arbres qui entouraient la maison, s’était perpétué dans la Gaule chrétienne. Las patriciens gallo-romains attachaient encore aux arbres les têtes des bêtes fauves. Au milieu même de la ville d’Auxerre, s’élevait un magnifique poirier sur les branches duquel Germain, avant d’être évêque, exposait les hures et les têtes des animaux qu’il avait tués. Cet usage, lui disait saint Amator, est bon pour des païens, tuais indigne d’un chrétien ; c’est une couvre du culte des idoles. Le futur saint refusant de se rendre à cette raison, Amator coupa court au scandale et fit arracher l’arbre[28]. L’antiquité ne nous a laissé aucune indication précise sur l’ameublement du hall. Malgré l’or et l’argent qui pouvaient orner les coupes ou décorer le siége du chef, malgré les cornes de buffle suspendues aux parois des murailles, cet intérieur ne pouvait présenter, aux yeux d’un civilisé, ni variété ni intérêt. L’art y était complètement étranger. Les meubles proprement dits, les ustensiles même destinés aux usages domestiques, étaient sans doute rares et chers dans la Gaule, puisque les chaudières d’airain dans lesquelles on faisait bouillir pêle-mêle les quartiers des divers animaux, y constituaient des choses de prix. Saint Patrice fut vendu à un chef pour un chaudron. — Un autre lui offrit, comme un objet de valeur, une grande chaudière d’airain[29]. Si Posidonius mentionne, en passant, la riche vaisselle de certains chefs gaulois, nous ne devons pas perdre de vue que le voyageur n’a visité que la Gaule narbonnaise. Dans la Gaule du Nord, il y avait certainement des vases précieux, mais ils étaient rares et se conservaient dans les familles[30]. On sait d’ailleurs que les Gaulois convertissaient leur or plutôt en objets de luxe et de parure et en belles armes qu’en monnaie. Les cours intérieures, les enceintes du hall et de l’ædificium étaient réservées aux exercices et aux jeux des enfants, des jeunes otages, des fils de colons retenus pour le service du maître. Ils préludaient dès leur bas âge à l’apprentissage des armes ; les uns lançaient la dague contre un but, les autres s’habituaient au maniement de la fronde et de l’arc en if rouge, dont la corde était faite de fibres de cerf[31]. Leur adresse était telle, s’il faut en croire Strabon, qu’avec un simple javelot de bois, long de deux coudées à lancé sans courroie, ils atteignaient un oiseau de plus loin et aussi sûrement qu’avec la flèche[32]. Quelques-uns de leurs jeux ont une authenticité historique. On a trouvé un palet dans une des fouilles de Beuvray. Le Senchus Mor ne permet pas au créancier de saisir les jouets des enfants, leurs balles, leurs palets, leurs cerceaux ; il ne faut pas, ajoute la glose, que ces petits êtres soient privés un seul jour de leurs amusements accoutumés. Un trait de la vie de saint Colombkill se rapporte à l’un de ces jeux. Un enfant ayant tué un de ses compagnons dans une rixe survenue au jeu de balle, se réfugia auprès du saint. Le brenn furieux l’arracha de cet asile, et, sans pitié pour son âge, le fit mourir. Ce fut le tour du saint de réclamer vengeance ; il réunit son clan à celui de la victime, et la réparation fut, parait-il, complète[33]. Les ambactes, les gardes, les conducteurs de chars, les écuyers, les veneurs avec leurs chiens bretons dressés à la chasse et à la guerre[34], complétaient avec les charpentiers et les forgerons le personnel d’un grand dunum. Cette dernière profession était un des privilèges des hommes libres ; le fils d’un serf ne pouvait être forgeron[35]. Les femmes étaient confinées aux travaux domestiques le lissage et la préparation des vêtements, l’éducation des enfants, étaient leur principale occupation selon leur rang. Nous avons vu que chez certains peuples on décernait des récompenses à la meilleure fileuse[36] ; selon Diodore de Sicile, dans les châteaux gaulois, de très jeunes filles servaient l’étranger[37]. Les romans de la Table-Ronde, d’accord avec ce témoignage, placent fréquemment à l’entrée de ces habitations des enfants à la chevelure blonde retenue par un cercle d’or[38]. La vie du chef, dans l’intérieur du dunum, se partageait entre les devoirs de sa position et les distractions que pouvaient comporter ses mœurs rudes et incultes. Le principal attrait de ses amusements était le danger ; si par hasard il était en paix avec les clans voisins, si les querelles, les pillages, les entreprises au dehors lui laissaient un peu de repos, les chasses périlleuses, la chasse au sanglier, au loup, — celle-ci tous les sept jours[39], — le dédommageaient des émotions de la guerre. Les forêts de la Gaule étaient remplies de bêtes fauves. L’ours et l’aurochs, qui s’y voyaient encore, étaient des adversaires dignes de lui. Avec les armes dont il pouvait disposer, ces combats, dont sa vie ôtait l’enjeu, exigeaient une adresse consommée, un courage à toute épreuve. Il était rompu, dés sa jeunesse, à ces vaillants exercices[40]. Le chef avait de plus à surveiller ses colons, son territoire, à tenir ses plaids, entouré de ses druides qui étaient les justiciers de ses domaines et les interprètes des coutumes locales. Il passait la revue de son clan, tenait ses hommes en baleine, faisait de grandes chevauchées, organisait ses ressources, préparait ses prochaines expéditions. Son hospitalité était proverbiale. Il l’exerçait envers l’étranger d’une manière si cordiale et si délicate que celui-ci, vint-il de la Grèce ou de l’Orient, en emportait le souvenir dans sa lointaine patrie. Sa maison est ouverte à tous, nous dit Diodore, mais si un étranger passe, on le pressa d’entrer et ce n’est qu’après qu’il a terminé son repas qu’on lui demande son nom et le but de son voyage[41]. Ce trait singulier de courtoisie gauloise se reproduit avec d’autres détails de mœurs dans les romans de la Table-Ronde. Owen rencontre de jeunes enfants à la porte du château ; tout le monde est réuni dans la même salle. On fait asseoir l’étranger sur un tapis, non sur un siège. Jusqu’au milieu du repas, ni l’hôte ni aucune des jeunes filles ne lui adresse la parole. Mais quand son hôte voit qu’il lui serait plus agréable de causer que de manger il lui demande qui il est. — Nous t’aurions parlé plus tôt, lui dit le chef, si nous n’avions craint de te détourner de manger ; mais maintenant, causons. — Alors je lui appris qui j’étais et le but de mon voyage[42]. Les festins ont toujours un rôle important dans la vie barbare. Ils prenaient au chef une grande part de son temps. La profusion naturellement y régnait plus que la recherche et le luxe. Les mets consistaient en un peu de pain[43] et une grande quantité de viandes rôties, bouillies, grillées, tris proprement servies sur des plais d’argent et de enivre. Chez le colon et le pauvre, ces plats étaient on tarte cuite. Dans le voisinage des fleuves, sur le littoral de l’Océan et de la Méditerranée, ou faisait rôtir le poisson en l’assaisonnant de vinaigre, de sel, de Cumin. On n’employait pas l’huile à cause de sa rareté ; le midi de la Gaule était trop froid à cette époque pour la culture de l’olivier[44]. Les serviteurs faisaient circuler à la ronde de vastes coupes en argent en en terre, remplies, selon la fortune du maître, de vins d’Italie on de la contrée de Marseille, de bière et d’hydromel. Tout le monde buvait à la même coupe, peu à la fois, mais on y revenait souvent[45]. Dans les grandes circonstances in amplissimis epulis[46], les échansons distribuaient le vin dans des cornes d’aurochs garnies de cercles d’argent[47], et c’était le plus grand luxe que l’amphitryon pût déployer, à raison de la difficulté de se procurer ces dépouilles qui rappelaient de hauts faits de chasse. Dans la Gaule du Nord on le vin était plus rare, an tirait de l’orge fermenté une boisson appelée zyth. Mais le breuvage favori des Gaulois était le vin, ils en buvaient jusqu’à s’enivrer. Ce produit enrichissait les marchands italiens, et souvent on leur donnait en échange d’une amphore pleine le serviteur qui en versait le contenu[48]. Dans les banquets d’apparat, dit Posidonius, ils s’asseyent en rond, sur des sièges de foin, à une table peu élevée[49]. La table ronde des Gaulois a donné son nom à l’épopée d’Arthur. La place d’honneur est réservée au guerrier la plus illustre par sa vaillance, sa naissance ou ses richesses. A côté de lui s’assied le maître du logis, et successivement chaque convive d’après sa dignité personnelle et son rang. Derrière les patrons, les suivants d’armes forment un double cercle, le premier de ceux qui portent le bouclier ; le second, de ceux qui portent la lance. Tous sont traités comme leurs maîtres[50]. Au temps de Diodore, qui écrivait sous Auguste, les mœurs ne sont pas beaucoup plus raffinées ; les chefs dans les repas sont assis sur des peaux de loups ou, de chiens. Souvent ils couchent dans la salle du festin. Ils ont auprès d’eux des fourneaux ardents avec des chaudières et des broches chargées d’énormes quartiers de viande. Des jeunes garçons et des jeunes filles, à la dernière limite de l’enfance, font le service de la table et placent les plus beaux morceaux devant les principaux personnages pour faire honneur à leur rang[51]. Le récit de Diodore semble inspiré d’Homère, et à existe en effet d’incontestables analogies entre les mœurs qu’il décrit et celles des héros de l’Odyssée. Mais l’exactitude de cette peinture ne peut être mise en doute entre le témoignage antérieur de Posidonius et les légendes plus récentes empruntées aux poèmes bardiques. C’est dans l’intérieur de sa maison, quand il fête ses amis, sous l’influence de cette légère excitation que donne le plaisir d’une table hospitalière, que l’homme se montre le plus lui-même avec les qualités ou les défauts de sa nature et de son éducation. Cette observation peut s’appliquer aux peuples comme aux individus. La tenue d’un festin est l’un des indices les plus sûre de la culture sociale. Chez Posidonius, qui note avec son exactitude ordinaire celle particularité des viandes proprement servies, les convives saisissent des deux mains des quartiers d’animaux, et Ils y mordent comme des lions[52]. Si la chair résiste et qu’ils ne puissent la déchirer avec leurs dents, ils la dépècent avec un petit poignard suspendu à leur côté dans une gaine particulière. Dans Diodore, le festin gaulois n’offre pas des images plus attrayantes. Les longues moustaches des chefs s’embrouillent dans la nourriture, et ils boivent si avidement que le breuvage s’écarte des deux côtés de leur bouche et descend le long de leur cou[53]. Dans l’état de civilisation, la convenance, la modération, une certaine dignité, président à toutes les habitudes de la vie, et surtout aux repas. Le barbare, dune ses festins, s’abandonne aux instincts de la brute, se gorge de nourriture et de vin. Ainsi faisaient les Gaulois. Chez eux, le luxe des princes s’étalait par des prodigalités gigantesques et des bombances colossales, par des galas monstrueux offerts à tout un clan, et même à une cité entière ; témoin Luern, prince des Arvernes, cité par Posidonius, qui fit ouvrir une enceinte quadrangulaire de douze stades[54] où les boissons à pleines cuves, et d’immenses tables chargées de mets, furent, pendant nombre de jours, servies sans interruption à tous ceux qui venaient prendre part au festin. Ce Luern (le Renard) était certainement un type remarquable de la forfanterie gauloise. Pour se rendre populaire, il parcourait le pays jetant l’or et l’argent, par poignées, sur la route qui entourait son char ; digne successeur de son père Bituit, lequel, environ cent vingt ans avant notre ère, avait envoyé au consul Domitius un ambassadeur chamarré d’or, escorté d’une meute de chiens bretons, et accompagné d’un barde qui chantait les louanges des Arvernes. La jactance et le faste étaient, on le voit, des qualités de famille. De temps à autre, Luern assignait de pareils festins. Un barde, arrivé trop tard à l’une de ses fêtes, se mit à gambader autour de son char, exaltant sa prééminence sur tous les autres chefs, et pleurant de n’avoir pu profiter de ses largesses. Luern, sensible à la flatterie, se fait donner une bourse d’or et la jette au poète. Celui-ci la ramasse et se remet à chanter avec un redoublement d’hyperboles, disant que les ornières de son char sont des sillons où les hommes récoltent de l’or et des bienfaits[55]. Cet exemple avait des Imitateurs. Ariamn, l’un des personnages les plus riches de la Gaule, fait publier que pendant toute une année il tiendra table ouverte à tout venant. Dans une enceinte formée de pieux et de branchages étaient dressées des tentes qui pouvaient contenir trois cents hommes. Des serviteurs étaient apostés sur toutes les routes pour amener les voyageurs, les étrangers, tous les gens quels qu’ils fussent, que cette convocation attirait en foule. Des viandes de toute espèce cuisaient en permanence dans d’immenses chaudières de brome, fabriquées tout exprès par les artisans des oppidum voisins. Chaque jour, taureaux, moutons et brebis, étaient immolés par troupeaux. De vastes cuves étaient remplies de bière, de vin, d’hydromel. Les voyageurs étaient, bon gré, mal gré, contraints de s’arrêter, et on ne les laissait continuer leur route qu’après avoir fait honneur au banquet[56]. Les fictions de Rabelais semblent empruntées à des réalités gauloises. Ariamn et Luern avaient inventé l’abbaye de Thélème. Les noces du barde Hyvarnion avec la petite reine de la fontaine devancèrent de plusieurs siècles celles da Gamache. Elles furent célébrées, vers l’an 517, à la cour du chef qui gouvernait l’Armorike pour le roi Childebert. Les pauvres et les riches, les petits et les grands furent invités à la fête, dont la description retenue par la légende a conservé, comme le fait très bien observer l’écrivain d’après lequel nous reproduisons ce récit, quelque chose d’épique. La bière et le vin coulèrent à flots ; deux cents porcs, deux cents taureaux gras, autant de génisses, cent chevreuils, deux cents buffles, furent égorgés, et leurs peaux partagées entre les convives. Cent robes de laine blanche furent distribuées aux prêtres ; cent colliers d’or aux guerriers vaillants ; des manteaux bleus sans nombre aux dames. Les pauvres eurent aussi leur part ; il y eut pour eux cent habits neufs ; et, comme il convenait aux noces d’un barde, cent musiciens jouèrent, du haut de leurs sièges, dans la cour du comte, pendant quinze jours[57]. A ces festins primitifs, la poésie et la musique avaient leur place ; le barde y chantait les grands faits de guerre, la destruction des forteresses, les chefs tués au combat, les pillages de troupeaux, et quelquefois la dame aux génisses blanches, les pierres du dolmen, la danse de l’épée[58]. La puissance de ces poètes chanteurs, dit Diodore, est telle sur ces imaginations incultes, qu’amis et ennemis les écoutent. Les bardes s’avancent quelquefois entre les armées, quand le glaive est tiré, quand la lance est en arrêt, et, comme s’ils apprivoisaient des bêtes fauves, ils arrêtent le combat[59]. Les têtes échauffées par le vin et les chants guerriers s’exaltaient jusqu’au délire. Alors les convives se levaient, échangeaient des provocations, et souvent une réunion joyeuse finissait par des scènes de carnage. Au temps de Posidonius, les Celles avaient déjà l’habitude de terminer leurs repas par des duels simulés. Ce n’était d’abord qu’un jeu, trais dés que le sang avait coulé, le combat devenait terrible ; il fallait séparer les champions pour empêcher que l’un d’eux restât sur la place[60]. L’humeur batailleuse des Gaulois se donnait librement carrière au moindre prétexte. On se disputait surtout la préséance à table, et l’on vidait la querelle à coups d’épée. Une autre cause de duel était le défi du Jambon. Le plus brave saisissait un jambon par le manche, et si quelqu’un se levait pour le lui disputer, c’était un combat à mort. Cet usage du duel s’était généralisé chez les Ombres, tribu gauloise de l’Italie où il était devenu une sorte d’épreuve judiciaire. Les litiges se décidaient par le combat ; celui qui tuait son adversaire était censé avoir raison. C’était déjà l’idée du jugement de Dieu, et comme le germe de l’institution des ordalies, qui a couvert tout le moyen-âge. Aucun peuple n’a poussé aussi loin le mépris de la vie, l’insouciance de la mort. La perte de la vie leur est indifférente, dit Lucain, ils savent qu’ils renaîtront bientôt[61]. Ils se battaient pour de l’argent ; ils se faisaient tuer pour du vin. Le passage de Posidonius auquel nous empruntons cette particularité est doublement remarquable ; il nous apprend que les Gaulois avaient des spectacles, et que, comme les sauvages et les barbares, ils les prenaient fort au sérieux. Ces drames, ces mystères, ces danses guerrières, ces représentations, quelle qu’en fait la nature, se donnaient aux emporium, aux fêtes religieuses, sur des estrades en plein vent. Si l’action exigeait qua l’un des personnages M immolé, on se serait bien gardé de manquer à la vérité du fait et de tremper les spectateurs en feignant de tuer la victime. 4n égorgeait l’acteur pour fout de bon. Partout ailleurs que dans la Gaule il eût été impossible de maintenir longtemps cette exactitude de mise en scène faute d’acteurs de bonne volonté peur se charger d’un pareil rôle. Chez les Celtes en n’avait quo l’embarras du choix. Un homme sortait de la foule, faisait sa collecte parmi l’assistance, et se laissait tranquillement couper la gorge pour quelques pièces d’or et d’argent, pour quelques amphores de vin qu’il léguait à ses parents[62]. L’hospitalité, bien que prodiguée parfois jusqu’à l’extravagance, était, cependant une des obligations des chefs. Le brenn (noble) du premier rang doit, d’après le Sanchus Mor, avoir son chaudron toujours suspendu à la crémaillère et toujours plein de trois espèces de viande, bœuf, mouton et porc, avec une juste proportion de gras et de maigre, afin d’être toujours en mesure de faire honneur aux devoirs de son rang. Il faut que l’on puisse tirer du chaudron une nourriture suffisante pour tout venant et convenable pour chacun selon son rang ; la hanche pour le roi, pour l’évêque et pour le brehon, le gigot pour le jeune chef, et le filet pour la reine[63]. S’il en était ainsi à l’habitude, les grandes réjouissances et les festins donnés dans les occasions solennelles devaient assez facilement atteindre à des proportions qui nous paraissent insensées. Et, si l’on considère la nature des rapports gui existaient entre le chef et les personnes placées sous sa dépendance, cette libéralité n’était, à vrai dire, qu’une dette qu’il acquittait envers ses inférieurs. Maître et seigneur du patrimoine commun, d’après la constitution juridique du clan, c’était le moins qu’il eût, — ne fût-ce qu’en théorie, — la charge de nourrir les membres de sa famille. La coutume des banquets maintenait le droit et empêchait la désuétude. Cette indivision du clan, avec les principaux traits de son organisme, a survécu jusqu’à nos jours dans les communautés du Morvan et du Nivernais, curieuse épate des temps celtiques, préservée, par la ténacité des habitudes rurales, des atteintes du droit moderne[64]. D’autres circonstances d’ailleurs entretenaient la réciprocité de droits et d’obligations résultant de la charte primitive et du principe de la consanguinité qui en était le fondement. Les sujets du Brenn contribuaient à toutes les dépenses de sa maison par des dons volontaires[65] et par des redevances de tout genre ; ils étaient, en définitive, la source qui alimentait la munificence du chef. Leurs troupeaux, leurs récoltes fraisaient les frais de son hospitalité ; ils pourvoyaient sa table de gibier et de poisson, pas impositions en argent, payées par les manoirs libres et les terres serviles, formaient son revenu. Il prélevait en outre de nombreux tributs en nature. La Vie de saint Patrice mentionne l’arrivée d’un collecteur, dans un village, qui perçoit à titre d’impôt de la bière, du miel, de la viande et du pain[66]. Le colon ne pausait même disposer de sa récolte qu’après le passage des exacteurs, ce qui le mettait plus d’une fois dans la nécessite de payer leur empressement un de souffrir de leurs retards. Les largesses des princes celtes pesaient donc assez lourdement sur le travail et le pécule du colon. Mais souvent aussi l’abus de l’autorité, la tyrannie la plus capricieuse, venaient aggraver les charges de ce dernier et les rendre intolérables. Entouré de cavaliers, d’ambactes désœuvrés et pillards dont il fallait récompenser les services, le chef subissait à son tour des exigences qui épuisaient ses ressources. Sa manse et sa table ne suffisaient pas toujours à des prodigalités dont tout le poids retombait sur ses vassaux[67]. — Le prince germain est à la merci de son entourage ; l’un lui demande son cheval de guerre, l’autre sa framée sanglante et victorieuse. Sa table grossièrement mais abondamment servie leur tient lieu de solde ; la guerre et le pillage soutiennent la dépense[68]. Cette peinture de Tacite ne reproduit que trop fidèlement la cour du chef gaulois. Il en était de même chez les Bretons ; leurs chefs s’adonnaient librement au brigandage[69]. — Vos guerriers ont volé ma vache, dit un ermite à un chef cambrien, père de saint Cadok, et je la vois servie à ce banquet. Elle me nourrissait de son lait, ainsi que les enfants du voisinage que Dieu envoyait à mon école. Le vautour a enlevé mes ramiers qui jouaient sur le toit de ma cabane ; mais j’ai pardonné à l’oiseau de proie, je pardonne à l’homme de guerre[70]. — La féodalité hérita de ces mœurs ; le père de saint Hugues l’obligeait à enlever les bœufs des paysans[71]. Eudes de Roussillon léguait dix livres de restitution à un pauvre prêtre dont il avait voté les porcs pacageant plans ses bois[72]. Les plus riches seigneurs ne se faisaient aucun scrupule de continuer les pilleries des chefs gaulois. Saint Anselme se rendant à Cluny faillit être dévalisé, il en eut tout au moins la crainte, par le duc de Bourgogne en personne[73]. Tel était le fond de cet état social qui nous séduit encore par une sorte de prestige lointain, mais dont la dureté repousse nos sympathies. Cette hospitalité sans bornes tant célébrée par les vieux poèmes n’était que l’excuse de la violence, le déguisement théâtral de la barbarie. Cette générosité vivait d’extorsions et de rapines. Les foies d’un Luern, d’un Ariamn, aboutissent à des misères sans nom, à une oppression sans frein. César nous donne le dernier mot de la situation de la Gaule, lorsqu’il nous montre les populations écrasées par l’énormité des impôts et sous l’injustice des grands[74]. Si les documents à l’aide desquels nous avons essayé de reconstituer quelques-uns des caractères de l’aristocratie gauloise présentent de bien nombreuses lacunes ; si, en rassemblant quelques traits épars dans les historiens, nous avons pu donner une idée, très incomplète sans doute, du pouvoir des chefs, de leurs demeures, de leurs occupations habituelles, de leur hospitalité, de leurs festins, nous trouvons dans Diodore, en ce qui concerne leur personne, leurs vêtements et leurs armes, une abondance de descriptions et de détails que jamais les Romains et les Grecs n’ont songé à nous laisser sur eux-mêmes. Peut-être, parmi les renseignements fournie par cet historien, quoiqu’en général très exacts, quelques-uns sont-ils de nature à inspirer des doutes. Mais ces points éliminés, les Gaulois apparaissent, dans ces pages que nous n’avons qu’à transcrire, avec leur forte et vivante individualité, tels enfin qu’ils se sont montrés aux peuples dont ils étaient l’effroi. L’antiquité, en effet, nous l’avons dit au commencement de ce livre, connaissait très peu la Gaule intérieure, encore moins la Gaule du Nord. A l’époque d’Auguste, il se débitait encore, sur ce monde singulier, quoique déjà visité, des contes effrayants qu’exagérait la crédulité populaire. Si l’on en croit Diodore, les peuples de cette partie reculée de la Gaule, — qui, d’après sa géographie quelque peu fantastique, confinait, à la Scythie, — mangeaient de la chair humaine, ni plus ni moins, disait-on, que les Bretons de l’île d’Erin[75]. C’étaient eux qui, sous le nom de Cimmériens ou de Cimbres (Kimris), avaient dévasté l’Europe et l’Asie de leurs brigandages ; et, pour éviter toute méprise, Diodore prend soin de nous expliquer que ce sont les Gaulois du Nord qui ont saccagé Rome après la bataille d’Allia, bien que ce fussent des Sénonais, d’après Tite-Live mieux informé[76], pillé le temple de Delphes, écrasé de nombreuses et puissantes armées romaines[77]. César qui connaissait la pays, mais qui l’avait traversé en conquérant, ne donnait que les renseignements strictement nécessaires pour l’intelligence de ses campagnes ; — et il est probable que les récits des vétérans de la grande expédition, naturellement fers d’avoir vaincu d’aussi redoutables ennemis, n’étaient pas de nature à discréditer ces fables. En somme l’opinion publique du monde civilisé ne rosait guère dans la Gaule qu’une contrée presque sauvage, habitée par des hommes étranges, féroces de mœurs et d’aspect, et l’imagination qui grossit les choses à distance accueillait facilement tous ces bruits. Malgré les horribles sacrifices qu’ils offraient à leurs dieux, les Gaulois n’étaient pas cannibales, et c’est une accusation sur laquelle le témoignage d’ailleurs isolé de Diodore n’a pas un caractère suffisant de précision et de certitude. Mais à cela près, il faut bien le dire, les portraits que nous ont laissés d’eux les voyageurs et les historiens sont, au double point de vue physiologique et moral, d’une fidélité irrécusable. Leurs hautes statures, leurs grands corps blancs et lymphatiques, le luxe et le costume étincelant de leurs chefs, leurs couleurs, leurs armes, leur bouillante impétuosité dans les combats, leur insouciance du danger, sont autant de traits de ressemblance pris sur la réalité même. Les indications de César, de Tite-Live, de Strabon, de Diodore, sont unanimes. Les Gaulois avaient, en un mot, tous les instincts et tous les défauts des races jeunes et des peuples enfants, la turbulence, l’amour du faste et de la guerre, la passion de tout ce qui brille, de tout ce qui fait du bruit. Les étrangers exploitaient leur goût pour la toilette et leur inexpérience, en leur vendant au poids de l’or, du clinquant, des oripeaux, des bijoux grossiers, qu’ils achetaient sans discernement, comme la font aujourd’hui les sauvages. Laissons parler les témoins oculaires. Leur longue chevelure rousse[78], relevée en crinière, aussi rude et aussi épaisse que celle des chevaux, leur donne l’aspect de Satyres et de dieux Pans[79]. — Quelques-uns parmi les nobles se rasent les joues, d’autres écourtent leur barbe en laissant croître de longues moustaches qui leur cachent la bouche. Leurs enfants naissent avec des cheveux blancs qui, avec l’âge, tournent au blond ou au roux. Leurs femmes remarquablement belles les égalent en force, en vigueur et en férocité. Leurs vêtements, bariolés de couleurs éclatantes, se composent d’une tunique et d’une longue braie avec un semis de fleurs. Leurs saies, rayées de carreaux de toutes nuances, épaisses ou légères suivant la saison, s’agrafent à l’épaule. — Ils mettent surtout leur ostentation dans leurs armes. Leurs casques d’airain sont surmontés d’énormes cimiers, de cornes immenses, de figures d’animaux ou d’oiseaux à grandes ailes déployées, qui rehaussent encore leurs statures gigantesques[80]. Les uns portent des cuirasses en fer maillé ; d’autres, s’en tenant aux seuls avantages de la nature, poussent le mépris de la mort jusqu’à combattre nus. Leurs longs boucliers sont décorés d’emblèmes. Leur large sabre est suspendu obliquement sur leur cuisse droite par des chaînes de fer ou de cuivre, quelques-uns ceignent leur tunique de riches baudriers d’or ou d’argent. Leurs lances sont armées d’un fer long d’une coudée, large de deux palmes, partie droit et partie ondulé, qui, en le retirant de la blessure, déchire les chairs et fait des plaies horribles. Ils emploient aussi l’arc et la fronde. Leur aspect est terrible[81]. Celte expression de Diodore, à qui nous empruntons tous les détails qui précédent, donne à penser que les défaites des Gaulois n’avaient pas diminué leur prestige, à la crainte qu’ils inspiraient encore à leurs maîtres. Les chefs allaient au combat sur des chars à deux chevaux avec un conducteur et un soldat essédaire ; puis ils lançaient le javelot et sautaient à terre l’épée nue. Au moment d’en venir aux mains, et dans l’intervalle qui séparait les deux armées, ils aimaient à se choisir un adversaire, à le provoquer par des railleries et des insultes à un combat singulier. Le mugissement de leurs grandes troupes d’airain et de cornes d’aurochs avait quelque chose de sauvage qui jetait l’épouvante[82]. Ils engageaient la bataille sans ordre, pêle-mêle, sans aucun commandement, chacun ne prenant conseil que de lui-même[83]. Leur premier choc était presque toujours irrésistible. On cite d’eux des traits d’une bravoure insensée. Trente cavaliers gaulois du parti de César culbutèrent, en Afrique, deux mille cavaliers numides[84]. La force des Germains consistait dans l’infanterie[85] ; celle des Gaulois dans leur cavalerie. Quand elle pouvait se déployer sur un terrain propice, la légion même fléchissait sous ses charges furieuses. Ils avaient la passion des chevaux ; ils en appréciaient surtout la beauté[86], à la différence des Germains qui n’estimaient dans le cheval que l’endurcissement à la fatigue. La numismatique gauloise témoigne de cette prédilection pour les exercices hippiques. La plupart des médailles ont pour emblème l’animal favori des Gaulois, le cheval, tantôt libre, tantôt monté par un cavalier la lance en arrêt, tantôt couplé et traînant un char toujours au galop. Cette passion héréditaire fut exploitée par les Romains gui tirèrent de la Gante lotir meilleure cavalerie. La notice des dignités de l’empire désigne les premiers cavaliers sous le titre de equites Gallicani primi. Pourtant ces hommes si braves empoisonnaient leurs flèches, dressaient pour la bataille des dogues bretons ou les chiens de leur pays, usaient impitoyablement de la victoire. Ils coupaient la tête de leurs ennemis et la suspendaient au poitrail de leurs chevaux, comme le font encore aujourd’hui les Arabes, et abandonnant à leurs serviteurs le cadavre sanglant du vaincu, ils entonnaient un chant de victoire. Ils clouaient ces hideux trophées dans le vestibule de leurs maisons, comme des dépouilles de bêtes fauves, et, s’il s’agissait de guerriers en renom, ils les conservaient dans des cassettes soigneusement embaumées. Ces restes humains formaient le trésor historique de la famille et se transmettaient de père en fils ; le chef les montrait avec orgueil à l’hôte et à l’étranger, il se serait déshonoré s’il eût consenti à les échanger contre leur poids d’or[87]. Plusieurs historiens ont essayé de laver les Gaulois de cette barbarie qui révoltait si justement Posidonius et Diodore ; mais les médailles en portent le témoignage le plus authentique. Dubnorix, — ce financier qui devançait son siècle, le frère même de ce noble Divitiac qui fut l’ami de César, — est représenté dans l’une d’elles tenant d’une train l’étendard national, le sanglier, de l’autre, une tête coupée[88]. Cet abominable usage existait encore en Armorique au neuvième siècle[89]. il était général chez les peuples de la Gaule et de la Germanie dont nous avons établi la commune origine. On sait quel traitement subirent les légions de Varus : tous les soldats qui tombèrent au pouvoir de l’ennemi furent décapités, et leurs têtes attachées à des troncs d’arbres oit les retrouva, six ans après, l’armée conduite par Germanicus[90]. La désastre de l’Allia avait été suivi des mêmes horreurs : les Gaulois passeront tout un jour sur le champ de bataille a décapiter les cadavres, selon la coutume de leur pays, et cette circonstance, qui permit aux débris de l’armée de se réfugier dans le Capitole, fut le salut de Rome[91]. L’amour de la parure liait tellement répandu, que tout l’or recueilli dans les fleuves de la Gaule méridionale était employé à façonner des ornements non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Tous les chefs portaient des armilles (bracelets) aux articulations des poignais et aux bras, de gros colliers d’or fin au cou et des cercles d’or par-dessus leurs cuirasses. Les échantillons que possèdent les musées de cas divers objets, sont généralement massifs et accusent des procèdes de fabrication grossiers. Lotira formes n’ont ni grâce ni élégance invention ; elles consistent uniquement en cercles concentriques, losanges, spirales, stries, dents de loup gravées ou pointillées ; la matière, en un mot, faisait seule la prix du ces ornements. Ceux de ces débris qui accusent quelque habileté de main, un peu de caprice, un peu d’art, appartiennent à n’en pas douter, comme les beaux statères de la Gaule, à l’industrie phénicienne ou massaliote. La Grèce et l’orient envoyaient de grandes quantités d’orfèvrerie aux emporium de la Gaule, et leurs ouvrages ne peuvent être confondus avec les produits informes de l’art gaulois au temps même de César. Quant aux riches vêtements des nobles, on ignore le degré de perfection des tissus et leur mode de fabrication. Ils étaient d’ailleurs en usage chez tous les peuples barbares ; Priscus, admis dans le camp d’Attila, vit sous la tente de ce chef les femmes occupées à broder des manteaux d’or pour les guerriers. Ce qu’il y avait de particulier aux races celtiques, c’était la préférence pour les couleurs voyantes et bigarrées virgatæ, scutulatæ vestes, les étoffes à carreaux. Dans les légendes d’Arthur, Owen, fils d’Urien, est surnommé le guerrier aux harnais de diverses couleurs, comme un vrai descendant des Gaulois de Tite-Live. Le tartan écossais a la même origine. Chez les Irlandais et les Calédoniens, le roi avait le droit de porter sept couleurs, le druide six, le noble quatre[92]. — Leur passion pour les telles armes ne s’était pas modifiée dans la cours de quatre sicles, depuis le guerrier au collier d’or tué par Manlius, jusqu’au chef Virdumar dont l’armure d’or et d’argent ciselé, peinte de diverses couleurs, était, au dire de Plutarque, aussi étincelante que la foudre[93]. Polybe rapporte que les Gésates, peuples gaulois, ayant passé les Alpes, leurs premières cohortes portaient des chaises, des colliers et des bracelets d’or[94]. Au siège d’Alise, les soldats qui gardaient le retranchement intérieur faisant face à l’oppidum n’apprirent la victoire de César que par les cris des assiégés qui voyaient sur l’autre revers de la montagne les Romains emportant dans leur camp une immense quantité de boucliers garnis d’or et d’argent, des cuirasses souillées de sang, de la vaisselle et des tentes[95]. Les médailles gauloises figurent quelques spécimens d’armures assez curieux, notamment celte du chef Virolai, oit le bouclier de forme elliptique se divise en nombreux compartiments, en arête de poisson, séparés par le diamètre longitudinal et peints sans doute de ses couleurs. Le guerrier est armé de toutes pièces, casque, cuirasse, brassards et tunique de maille. Une ceinture flexible, nouée au-dessus de la hanche, dessine élégamment sa taille et accentue la vigueur de sa poitrine[96]. On vit, en quelques circonstances, les généraux romains se parer de ce costume qui faisait valoir sans doute leurs avantages personnels. Le jeune et brillant Cécina, ramenant en Italie les bandes vitelliennes, traversait les municipes revêtu du sagum rayé et des braies du chef gaulois ; Tacite ajoute : Il est vrai que la richesse de cet accoutrement barbare offusquait un poil les magistrats et les bourgeois, la gens togata des villes et des colonies[97]. Les funérailles du chef étaient magnifiques et somptueuses, mais dans la limite de leurs ressources, comme César prend soin de s’en expliquer[98]. Elles étaient le digne couronnement d’une existence aride d’éclat et de bruit. Son corps était déposé sur un bûcher, entouré de ses serviteurs et de ses clients qu’il avait le plus affectionnés, et l’on brûlait le tout ensemble. Cet usage venait d’être aboli à l’arrivée de César dans la Gaule. On se contentait alors de livrer aura flammes les animaux et les objets de sa prédilection, ses chevaux, ses chiens favoris[99]. On retrouve encore, sous les tumulus, des débris d’ossements de ces animaux mêlés à ceux du mort. Les amis du défaut jetaient dans le bûcher des lettres à l’adresse de leurs parents décédés, persuadés que ces messages ne pouvaient manquer de leur parvenir dans l’autre monde[100]. En Irlande, on pleurait pendant trois jours sur le cadavre, avant de l’ensevelir[101]. Les sépultures gauloises très rares dans certaines parties du territoire éduen, très nombreuses dans d’autres, ont généralement la forme de tertre et sont placées sur des lieux élevés. Quelques-unes des montagnes situées à l’est de ses limites portent sur leurs sommets de véritables nécropoles, où se sont entassées les tombes de ces anciens dominateurs de la contrée[102]. Sur toutes les chaînes qui forment le bassin de la Saône, depuis les Chaumes-d’Auvenay jusqu’à la Franche-Comté, on trouve en octobre immense les tombeaux d’une race qui n’a occupé que la partie calcaire du sol éduen, et différente de celle qui était cantonnée dans la partie granitique. Ces tombes se composent de fosses peu profondes, faites de pierres plates sur champ et recouvertes de dalles. Elles forment, à fleur du sol, un petit tertre de pierres qua surmonte parfois un bloc de rocher. On y trouve ordinairement des armes en silex, des objets de métal ; mais la plupart ont été visitées et dépouillées. Dans la partie granitique du pays éduen, au contraire, dans l’Autunois, dans le Morvan, les tumulus sont d’une rareté extrême. Un seul, et de petite dimension, a été ouvert au mont Beuvray. La population de cet oppidum pratiquait l’incinération, même avant l’arrivée des Romains, et recueillait dans des urnes les cendres des bûchers. Il en existe çà et là quelques autres, disséminés sur une vaste étendue de pays, usais ils n’ont pas été fouillas, bien que la tradition locale les signale comme des sépultures. Il semble quo cotte race ait conservé plus longtemps sa rudesse primitive dans son inhabileté même à creuser ou a construire des monuments funéraires. La Vie de saint Patrice nous apprend que les Irlandais enterraient leurs morts dans des fosses rondes sur lesquelles on amoncelait de la terre, des pierres, et que l’on couvrait quelquefois d’un quartier de roche. Le vieillard, dit l’une des légendes, étant mort en ce lieu, ses compagnons élevèrent un monceau de pierres que l’on aperçoit encore aujourd’hui des bords de la mer[103]. — Un jour, dit une autre légende, que le saint était parti en mission, il arriva dans un lieu appelé Feartha, où deux femmes mortes avaient été ensevelies dans la superficie d’une colline ronde[104]. L’épisode du guerrier noir, dans le poème de Pérédur, l’un des compagnons d’Arthur, décrit avec les mêmes particularités la sépulture d’un chef, au sommet d’une colline, dans l’isolement d’une forêt : Gravis cette montagne, dit une jeune fille à Pérédur, et tu trouveras un bois, et dans ce bois il y a un ler’h (dolmen) ; appelle trois fois au combat le guerrier qui dort sous ce ler’h, et tu regagneras mes bonnes grâces. Pérédur se mit en marche, et il arriva sur la lisière du bois ; il jeta un cri d’appel au combat. Et aussitôt un guerrier noir, monté sur un squelette de cheval, dont l’armure, comme celle de son cavalier, était toute rouillée, sortit de dessous le ler’h, et l’assaut commença[105]. La légende des tertres de l’Homme mort, de la Femme morte, subsiste encore dans le Morvan. Entre Château-Chinon et le Beuvray, on rencontre dans les bois un tertre de l’Homme mort, sur lequel les gens du pays ont la coutume de venir jeter une pierre chaque fois qu’ils passent prés de ce lieu. Une charte de 1269 signale un emplacement dit l’Homme-mort situé sur l’un des plateaux qui dominent Autun, ad locum qui dicitur Homo mortuus[106]. Le lieu indiqué par ce document est recouvert de blocs de pierres, et il se trouve à la lisière d’une forêt. Plusieurs de ces collines existent encore dans la Nièvre, et toutes ces traditions remontent certainement à la plus haute antiquité. A la fête des Morts, les Bretons remplissent d’eau bénite une cavité ménagée tout exprès clans la pierre des tombeaux. Les cuvettes que nous retrouvons creusées dans les dolmens funéraires n’avaient probablement pas d’autre destination. Chez les celtes, comme chez les Bretons, à certaines époques, on frottait de miel ou l’on arrosait de lait les pierres sacrées qui étaient, pour la plupart, des monuments élevés à la mémoire des chers. Les anciens plaçaient généralement leurs tombeaux sur le bord des chemins les plus fréquentés, à l’entrée des villes populeuses, ne pouvant, quoique morts, se séparer des vivants dont le souvenir était à peu près tout ce qu’ils savaient et tout ce qu’ils comprenaient des destinées immortelles de l’âme. Les Celtes, malgré leur barbarie, semblent avoir envisagé la mort au point de vue d’un spiritualisme plus profond. Ce qu’ils cherchaient pour leurs sépultures, c’était moins le regard des hommes, — eux cependant si amoureux de gloire et de renommée, — que celui des divinités qui résidaient, d’après leurs croyances, dans les forêts, sur les montagnes, à la source des fleuves. C’était à ces sanctuaires qu’ils venaient confier leurs cendres, aux génies des eaux, aux dames maires, amies et protectrices des morts. Ils pouvaient s’y croire à l’abri des vengeances et des profanations. S’il y avait quelque part un lieu sinistre et redouté, c’était celui qu’ils désignaient pour leur dolmen ; une vénération mêlée de crainte y protégeait au moins leurs restes. Le concile de Nantes, tenu en 658, défendit de déposer des offrandes sur ces pierres, situées dans des lieux funestes in locis ruinosis, auxquelles s’attachaient des illusions suggérées par les démons des bois[107]. Ils trouvaient dans ces solitudes un oubli plus absolu, une paix plus assurée, ce repos que dans le cours si tourmenté de leur existence ils demandaient, sans pouvoir l’obtenir, à l’isolement de leur ædifcium, — illic certa quies, — pour continuer la pensée d’Ermold. Par un autre contraste, ces hommes pleins de jactance et d’orgueil n’ont pas laissé un seul nom sur une seule de leurs tombes. Le sol où ils ont été ensevelis n’a retenu d’eux qu’un souvenir, celui de l’homme mort. Mais ce souvenir est une légende qui a traversé dix-huit siècles, et cette pierre que le fils du Celte jette en passant sur leur tertre inconnu est encore une marque de respect. |