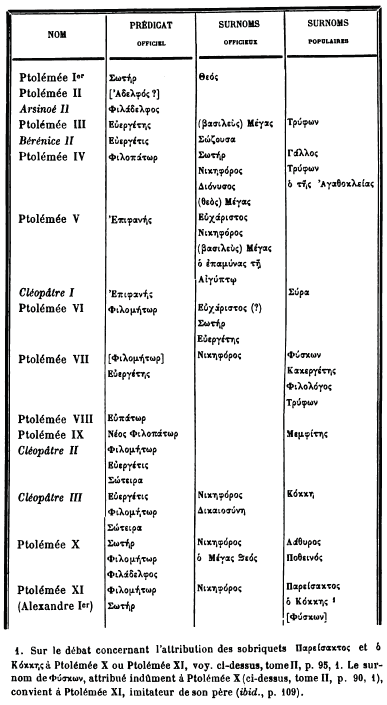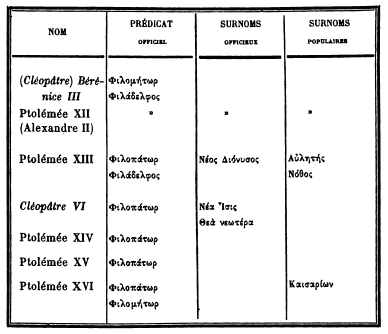HISTOIRE DES LAGIDES
TOME TROISIÈME. — LES INSTITUTIONS DE L'ÉGYPTE PTOLÉMAÏQUE. - PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE XX. — LE DROIT MONARCHIQUE SOUS LES LAGIDES.
|
§ I. — LES NOMS ET PRÉDICATS ROYAUX. Des titres divers accumulés dans le protocole égyptien les Lagides n’ont retenu, dans l’usage courant, que celui de βασιλεύς et celui de θεός, le premier placé devant leur nom, l’autre à la suite et joint à leur surnom. Ils ont jugé inutile de maintenir une distinction surannée en s’intitulant rois de la Haute et de la Basse-Égypte. A plus forte raison se sont-ils abstenus d’énumérer les pays hors d’Égypte sur lesquels ils avaient pu étendre leur domination, à la façon de certains souverains modernes, qui traînent à la suite de leur titre principal toute une chorographie analytique et parfois même des survivances de titres passés à l’état d’étiquettes vides. La monogamie ayant été maintenue, après avoir été en péril au temps des Diadoques, l’épouse du roi portait le titre de βασίλισσα et partageait avec son mari le prédicat divin, qui est le nom spécifique et caractéristique de chaque couple royal. Nous avons déjà signalé cette association du roi et de la reine comme un indice de l’influence des mœurs grecques, et le titre de sœur (άδελφή) donné à la reine comme une concession non moins visible faite aux coutumes égyptiennes. Toutefois, le titre de βασίλισσα n’est pas, comme celui de βασιλεύς, la définition de la souveraineté[1], car il est accordé aussi aux princesses de la famille royale. On le voit porté par Philotéra, sœur de Ptolémée Philadelphe, et par la fille, morte en bas âge, de Ptolémée III Évergète, cette Bérénice dont le décret de Canope célèbre l’apothéose à la mode égyptienne[2]. De même, le titre collectif de dieux, avec le prédicat des parents, paraît dévolu, dans des textes de basse époque, aux enfants royaux de l’un et de l’autre sexe. Il est probable que la collation de ces titres eut lieu d’abord par privilège spécial et finit par entrer dans l’habitude. A la différence des anciens Pharaons, qui ont tous un nom individuel, soit qu’ils l’eussent de naissance ou l’eussent pris à leur avènement, les Lagides ont tous porté le nom de Ptolémée. Il semble qu’ils aient voulu par là affirmer la solidarité des générations successives, autrement dit, l’idée dynastique, exprimée avec plus de force par le nom d’Horus dans la théorie égyptienne du droit divin. La même préoccupation se trahit par l’usage, qui persiste jusqu’à la fin, de frapper la monnaie à l’effigie du fondateur et éponyme de la dynastie. Seulement, la question se pose de savoir si ce nom royal était conféré avec la royauté, ou s’il était donné, dès leur naissance, aux héritiers présomptifs des rois. C’est une question qui ne peut être résolue que par des constatations de faits se prêtant à des interprétations passablement divergentes. A première vue, il semble que le nom royal ne devait être porté que par les rois, c’est-à-dire substitué à un autre nom individuel lors de l’avènement ; et c’est, en effet, l’opinion soutenue jadis par Lumbroso. Mais des textes épigraphiques, d’authenticité certaine, donnent au fils aîné des souverains, avant toute association au trône, le nom de Ptolémée[3]. Aussi, Lumbroso hésite entre les deux solutions, ou plutôt il finit par les accepter toutes deux à la fois[4]. Pour tenir compte de toutes les données, il faut, en effet, les combiner et dire, avec Strack[5], que le nom de Ptolémée désigne l’héritier présomptif, et que, si le trône échoit à un autre, celui-ci abandonne son nom particulier pour prendre le nom, autant dire le titre, de Ptolémée. Nous ignorons si Ptolémée Philadelphe porta ce nom royal avant que son aîné, Ptolémée Kéraunos, ne fût déshérité. La conjecture de Strack, à savoir que le jeune prince s’est appelé Philadelphe jusqu’à son avènement[6], parait bien aventurée quand on songe qu’il faut attendre un siècle avant de rencontrer ce nom dans des textes d’auteurs, qui ne sont pas des documents officiels[7]. Il me parait certain, sinon démontrable, que le prédicat de Philadelphe n’a jamais été un nom propre et qu’il a été tout d’abord le titre divin d’Arsinoé II, étendu à son conjoint dans l’usage courant, — et non dans le protocole officiel, — parce qu’il rappelait le fait le plus marquant du règne, l’inauguration du mariage royal et le caractère légal conféré à l’amour réciproque des deux époux[8]. Je ne crois pas davantage que Ptolémée Évergète II se soit appelé Évergète avant de monter sur le trône. Évergète est visiblement un prédicat ; il a été porté par deux souverains, et il ne fait figure de nom propre ni pour l’un ni pour l’autre. Mais, si nous n’avons aucun moyen de deviner le nom que portaient Philadelphe et Évergète II au temps où ils n’étaient que des cadets, nous savons que Ptolémée Philadelphe eut un fils puîné appelé Lysimaque ; qu’un fils, puîné également, de Ptolémée III Évergète I avait nom Magas ; que Ptolémée XI, rival de son frère aîné, fut distingué de celui-ci par le surnom d’Alexandre, qui devait être son nom antérieur ; tandis que, pour les fils aînés, héritiers présomptifs dès le berceau, nous ne leur connaissons de science certaine d’autre nom que celui de Ptolémée[9] Ce nom est donc bien, dans la famille royale, un titre réservé au roi et à son successeur désigné, le symbole choisi, comme l’aigle héraldique, pour représenter la permanence de l’autorité toujours semblable à elle-même au sein de la dynastie. Mais il n’est un titre que dans la famille royale. Les Lagides n’en ont pas fait un monopole ; ils ont laissé à leurs sujets le droit de prendre le même nom, et leurs homonymes ne sont pas rares parmi les Gréco-Égyptiens de l’époque ptolémaïque. D’après ce que nous avons dit plus haut en rejetant les hypothèses relatives à Philadelphe et Évergète II, il est hors de doute que les surnoms ou prédicats — ceux-ci toujours joints à la qualification de dieu — étaient des titres réservés au couple royal considéré comme objet de culte[10]. Il se peut que Ptolémée Ier ait porté le nom de Σωτήρ avant l’institution du culte dynastique, parce que ce prédicat avait une valeur intrinsèque et équivalait presque au titre de θεός ; mais la règle lui fut appliquée après coup. Il est qualifié dieu Sauveur à la fin du règne de Philadelphe[11]. Sa fille Arsinoé avait même pris l’initiative de cette apothéose, au temps où elle n’était pas encore reine, en l’appelant Σωτήρ καί θεός[12]. Les prédicats royaux ont un sens précis, qui en fait la définition d’une qualité morale, et il semblait naturel de les interpréter à la lettre, comme spécifiant un trait de caractère, surtout lorsque, sur la foi d’interprétations déjà faites par des auteurs anciens, on les croyait conférés par les prêtres égyptiens[13]. Sans doute, on s’était bien aperçu que ces étiquettes répondaient rarement à un trait de caractère historiquement constaté ; mais on peut toujours répondre que l’adulation est par nature ennemie de la vérité et ose même en prendre le contre-pied. Le débat n’est pas susceptible d’être vidé par des arguments péremptoires. Pourtant, les faits constatés infirment singulièrement les deux thèses connexes, à savoir, que le prédicat divin des rois était décerné par le sacerdoce égyptien, — soit lors du sacre, soit dans quelque autre synode, — et que ce prédicat était choisi à titre d’hommage, comme définition d’une vertu réelle ou supposée. La première thèse, couramment acceptée depuis Lepsius et que l’on ne songeait plus pour ainsi dire à contester, a été suffisamment réfutée, à mon sens, par Strack[14]. Le protocole égyptien donne au roi les cinq noms traditionnels[15], et il y ajoute — mais en dehors des cartouches, comme superfétation étrangère — la traduction du prédicat dont le mot grec est évidemment la forme originale. D’autre part, le desservant annuel des cultes dynastiques était un modeste fonctionnaire, qui n’a certainement pas eu qualité pour imposer un surnom au roi. Il est donc infiniment probable que le surnom ou prédicat divin était choisi par un acte de volonté royale, et cela, lors de l’avènement ou peu après[16], comme marque extérieure de la dignité et divinité royales, de la divinité surtout, on devrait même dire exclusivement. Strack pousse son argumentation à l’excès lorsque, récusant l’ingérence des prêtres égyptiens, il veut démontrer que le culte et le surnom ne sont pas indissolublement associés[17], sauf à constater comme usage général l’application de la règle déclarée par lui inopérante[18]. Sans doute, les particuliers dans leurs dédicaces et leurs papiers d’affaires, les historiens dans leurs récits, se servent le plus souvent du surnom — à défaut du numéro d’ordre, qui n’a jamais été d’usage courant — pour distinguer les divers Ptolémées, et ils accolent le surnom au nom du roi Ptolémée, sans la qualification de θεός. Il y a plus. Les monnaies et les édits royaux n’emploient d’ordinaire le surnom qu’avec la même ellipse, ou l’omettent complètement[19]. Mais, pour reconnaître dans le surnom un nom de culte, il suffit que la qualification de dieu ne se trouve jamais accolée au nom de Ptolémée et soit inséparable du surnom. On n’a jamais dit : le dieu Ptolémée, mais Ptolémée dieu Évergète, ou Philopator, ou Philométor, etc.[20] Du reste, l’usage ne s’est fixé qu’avec les règles du culte lui-même. Le roi que nous appelons Philadelphe a vécu sans prédicat jusqu’au jour où il est devenu l’éponyme du groupe des dieux Adelphes, et son fils parait avoir attendu quelque temps avant de réclamer sa place dans la liste des dieux-rois comme éponyme du groupe des dieux Évergètes. Reste maintenant à élucider la seconde question, qui est comme une autre face de la première ; à savoir, si le surnom a un sens approprié au caractère du roi, — à celui qu’il a ou prétend avoir, — s’il n’est pas destiné peut-être à commémorer un incident notable de sa vie, ou si c’est une étiquette purement distinctive et non susceptible d’interprétation historique. Il serait étonnant qu’une question aussi complexe ne comportât qu’une solution unique. Il faudrait pour cela que la règle eût précédé les applications, et nous sommes à même de constater que les Lagides ont procédé ici d’une façon tout à fait empirique. Le surnom de Σωτήρ avait bien un sens laudatif pour les Grecs — Insulaires ou Rhodiens — qui l’ont décerné au premier Ptolémée. On voit aussi à quel propos et dans quel but le deuxième Ptolémée, fondateur du culte dynastique, a pris pour lui et pour sa défunte épouse le titre de θεοί Άδελφοί. Le surnom choisi pour rappeler l’institution du mariage royal à la mode égyptienne n’était pas, tant s’en faut, vide de sens. Pour le troisième Ptolémée, il y a doute sur la date et l’interprétation du surnom d’Évergète. Il est bien certain qu’il n’a pas été décerné par le synode égyptien de 238 : les prêtres l’enregistrent, mais ne prétendent pas en avoir fait spontanément hommage au roi. Ptolémée III ayant commencé son règne par une campagne entreprise pour venger sa sœur, il semble que, s’il avait voulu donner à son surnom une valeur commémorative, il en eût choisi un autre. On peut donc admettre qu’il l’a pris en montant sur le trône, comme l’ont fait après lui ses successeurs, mais non pas qu’il l’ait choisi au hasard. Il est permis de voir là une allusion au bienfait qu’il apportait à l’Égypte en faisant cesser, par son mariage avec la fille de Magas, le dualisme qui séparait de l’Égypte la Cyrénaïque, et je ne serais pas éloigné de croire que telle fut aussi la raison pour laquelle Évergète II prit le même surnom en remontant sur le trône d’Égypte alors qu’il était déjà roi de Cyrène. A partir de Ptolémée IV, il n’y a aucune raison de douter que les surnoms aient été choisis par les rois lors de leur avènement ; mais l’interprétation en devient difficile et, par conséquent, arbitraire. Gutschmid croyait pouvoir affirmer que le surnom de Philopator convenait particulièrement au successeur associé ou tout au moins désigné par son père du vivant de celui-ci[21]. Une objection se présente aussitôt d’elle-même : c’est que le second Philopator, le bâtard dit Aulète, n’avait été nullement désigné par son père. Si l’on esquive celle-ci en supposant que le bâtard, payant d’audace, s’est arrogé précisément le titre qu’il ambitionnait le plus et méritait le moins, il en surgit une autre. Si, comme nous le pensons, l’association au trône est devenue, chez les Lagides comme chez les Pharaons et par suite chez les Césars, un mode de transmission du pouvoir prévu et recommandé par la coutume, beaucoup de rois, à commencer par Philadelphe, auraient mérité le surnom de Philopator. Il faut renoncer aussi à trouver autre chose que des convenances personnelles plus ou moins justifiées dans les surnoms qui visent également des relations de famille, comme Philométor et Eupator. Une coutume nouvelle, la multiplicité des surnoms, qui commence à Ptolémée V Épiphane et qui prit plus tard une extension abusive, nous oblige à revenir sur les résultats acquis. Épiphane porte aussi le surnom d’Εύχάριοστος, presque aussi officiel que le premier, car il se rencontre dans l’inscription de Rosette et dans les énumérations des noms de culte. Que ce soit là un signe de décadence et que la valeur des rois, en Égypte comme en Syrie et ailleurs, ait été en raison inverse du nombre de leurs titres[22], peu importe. Il s’agit de savoir si nous devons encore considérer le surnom supplémentaire comme contemporain de l’autre, choisi de même par le roi, ou comme une addition postérieure, motivée par quelque fait nouveau ou, à défaut d’autre raison, par l’initiative des courtisans. Le caractère adulateur de l’épithète n’est pas douteux : il serait vraiment étrange que le roi eût pris de lui-même le titre de Gracieux. Peut-être faut-il voir là une traduction du titre correspondant en égyptien, qui aurait été décerné au roi par les prêtres lors de son sacre, en reconnaissance de sa soumission gracieuse à l’antique rituel ; ou encore, un témoignage de l’accueil fait à l’enfant royal dont la naissance tardive venait assurer l’avenir de la dynastie[23]. Pour Épiphane, il nous faut renoncer à savoir si le titre d’Euchariste est postérieur à l’autre ; mais nous sommes un peu mieux renseignés sur d’autres cas. La concurrence de Ptolémée VI Philométor et de son cadet amena successivement le régime des deux, ou, en comptant la reine, des trois Philométors, et plus tard le régime des trois Évergètes, avec deux reines : c’est-à-dire que Ptolémée VII s’appela Philométor comme associé de son frère et abandonna ensuite ce prédicat pour en prendre un autre lorsqu’il fut seul roi[24]. Ptolémée X prit comme surnom personnel celui de Soter ; mais la concurrence de son frère paraît avoir déterminé l’adjonction du prédicat de Philométor, commun aux deux frères et qui précède l’autre dans l’inscription sacerdotale d’Assouan en l’honneur de Ptolémée X[25]. Enfin, le même Ptolémée X restauré et régnant avec sa fille emprunta à celle-ci le surnom de Philadelphe. Ici, nous constatons une succession chronologique dans l’accumulation des surnoms. Ptolémée XIII Aulète prit le surnom de Philopator et, peu après, probablement lors de son mariage et pour affirmer que son épouse Tryphæna était bien sa sœur, celui de Philadelphe[26]. On voit ensuite apparaître le titre de νέος Διόνυσος, qui, tout en restant officieux, figure à côté des titres officiels et peut même les remplacer[27]. Par contre, on a vu qu’un titre d’abord accepté pouvait être ensuite abandonné. Il est inutile d’entrer plus avant dans le détail de ces modifications qui ont dérouté même les scribes contemporains. Nous sommes en droit de conclure que, à partir du quatrième Ptolémée, le surnom ou nom de culte principal est assumé par le roi au moment où il devient dieu en devenant roi, et que les autres prédicats lui sont généralement adjoints par la suite, pour des motifs à déterminer. Quant aux sobriquets de caractère sarcastique, qui ont souvent pris dans l’histoire la place des surnoms officiels[28], il n’est pas douteux qu’ils ont été mis en circulation au cours du règne du souverain qui en est affublé et qu’ils sont de tous les plus caractéristiques, comme représentant la personnalité royale jugée par l’opinion populaire. En revanche, ceux qui, décernés sans doute par des adulateurs, avaient un sens honorifique figurent parfois à la suite des titres officiels dans des dédicaces et autres documents particuliers[29], mais ils ont été généralement délaissés par les historiens. Le résumé suivant, extrait du tableau plus complet dressé par Strack, nous dispensera de plus amples explications[30].
La répétition des mêmes surnoms risquait d’entraîner des confusions de personnes, et c’est là, sans aucun doute, une des raisons qui ont fait adjoindre au surnom principal répété d’autres qualificatifs, qui pouvaient n’être pas nouveaux mais formaient avec le premier des combinaisons nouvelles. On pouvait aussi obvier aux confusions en donnant un numéro d’ordre au surnom répété. C’est ce qu’ont fait notamment Strabon et les auteurs du Canon des Rois en appelant Ptolémée VII Εύεργέτης δεύτερος[31]. Nous trouvons aujourd’hui étonnant et fâcheux que les anciens aient eu si rarement l’idée plus simple de numéroter les règnes. Cependant, Polybe ne l’a pas fait. D’autres l’ont essayé, mais n’ont pas prolongé l’ordonnance au-delà de Ptolémée VII[32]. Strabon appelle Aulète le dernier des rois : au-delà, il n’y a plus que des fantoches noyés dans l’ombre de la grande Cléopâtre. Lepsius a le premier dressé une nomenclature complète des Ptolémées, dans laquelle il a fait entrer tous les Ptolémées pourvus de noms de culte et porté ainsi à seize le nombre des ayants-droit. C’est celle que nous avons suivie, tout en regrettant de déranger sans profit évident les habitudes prises, sauf à replacer à leur rang accoutumé Ptolémée VI Philométor et Ptolémée VII Évergète II et à modifier en conséquence les numéros qui vont de VI à IX[33]. Il a été dit plus haut que les noms de culte convenaient excellemment aux couples royaux. La reine partageait le prédicat de son époux, et, même lorsqu’elle était honorée d’un culte particulier, elle n’en portait pas d’autre[34]. Si Arsinoé Philadelphe fait exception[35], c’est que l’institution de son culte est antérieure à la règle qu’établit ensuite son époux. La communication du surnom se fait donc par le mariage et ne convient qu’à la femme légitime. Après avoir recensé les titres et prérogatives du roi considéré comme dieu, il est temps d’étudier le droit monarchique au point de vue humain et appliqué aux relations de famille. § II. — L’HÉRÉDITÉ CHEZ LES LAGIDES. La monarchie élective n’apparaît dans l’histoire qu’à l’état d’exception et presque de phénomène contre nature, qui tend toujours et aboutit généralement à reprendre son assiette naturelle dans l’hérédité[36]. Mais l’hérédité n’est pas un appareil dont le jeu mécanique puisse être livré à lui-même. Elle a besoin d’être réglée dans le détail par des conventions qui admettent ou prohibent le partage entre les enfants, qui fixent les droits de l’un et de l’autre sexe, qui prévoient les cas de déshérence en ligne directe et les moyens de transporter le droit de succession aux branches collatérales. Ces règles, qui sont en tout pays la partie essentielle du droit privé, sont plus indispensables encore lorsque la propriété à transmettre est la royauté et que cet héritage est déclaré indivisible. Les Lagides, succédant aux Pharaons, ont trouvé sur la matière un droit coutumier préexistant. Mais ils apportaient aussi du dehors des habitudes empruntées à une civilisation différente, à leurs yeux supérieure, habitudes qu’ils devaient être tentés de conserver. La question se pose donc de savoir s’ils ont accepté en bloc les coutumes égyptiennes ; s’ils sont, au contraire, restés fidèles aux coutumes gréco-macédoniennes ; ou s’ils ont composé, par choix fait entre les unes et les autres, un droit éclectique. Malheureusement, nous n’avons d’aucun côté aucun texte juridique concernant l’hérédité dans les familles royales soit de l’Égypte ancienne, soit des monarchies hellénistiques. C’est clans les faits qu’il faut chercher les théories, et les faits sont ou mal connus — ce qui est le cas pour l’Égypte pharaonique — ou contradictoires, de telle sorte qu’on ne sait le plus souvent où placer la règle ou l’exception[37]. La facilité, empressée et intéressée, avec laquelle les Lagides ont accepté le droit divin des Pharaons et ont voulu plier à cette doctrine l’esprit de leurs compatriotes ; le fait qu’ils ont, au grand scandale de ceux-ci, adopté le mariage entre frère et sœur, c’est-à-dire un usage qui touche de très près aux questions d’hérédité ; tout cela porterait à croire qu’ils se sont abstenus d’innover en matière d’hérédité. Ce fut tout d’abord l’opinion des égyptologues, qui, en vertu de leur compétence spéciale, l’imposèrent aux non initiés[38]. Le caractère spécifique de la coutume égyptienne, en droit public comme en droit privé, était, à leur sens, l’aptitude des femmes à hériter au même titre que les hommes. On sait qu’en Égypte, en dépit de la polygamie, dont les effets ordinaires étaient sans doute contrebalancés par des traditions matriarcales, le droit et les mœurs admettaient l’égalité à peu près complète de l’homme et de la femme. Les Grecs ont même cru que la supériorité était du côté de
la femme. Diodore, jugeant des ménages égyptiens par Isis et Osiris, est
persuadé que la reine a plus de puissance que le roi
et que l’homme, en se mariant, s’engage par contrat à obéir à la femme[39]. Les exemples de
reines qui ont porté la couronne ou tenu en tutelle soit leur fils, soit leur
mari ou leur frère, — comme Neit-aker (Nitocris),
sous la VIe dynastie, Nofrîtari au début de la XVIIIe dynastie ; Ramaka-Hâtshopsitou,
un demi-siècle plus tard ; Amen-art-us (Aménéritis)
sous la XXVe dynastie, — ces exemples, dis-je, venant à l’appui, on a cru
pouvoir affirmer que, sous les Pharaons, les filles de roi étaient en droit
de succéder comme leurs frères ; que les reines partageaient le pouvoir royal
sur le pied d’égalité avec les rois ; ou que, veuves, elles le détenaient
avec un droit supérieur même à celui de leurs fils, à qui elles imposaient
leur tutelle. On expliquait même par là, par le besoin de satisfaire ces droits
concurrents des deux sexes en les associant, le mariage entre frère et sœur.
Il serait plus juste de dire que l’exception confirme ici la règle, en ce
sens que les reines régnantes ont renié leur sexe et porté la barbe en même
temps que la couronne. Enfin, comme le mariage entre frère et sœur a été
aussi pratiqué par les Lagides, comme il n’a pas manqué chez eux non plus de
femmes qui ont ambitionné et exercé le pouvoir souverain, on a pu conclure
que les Lagides s’étaient ralliés sur ce point aux coutumes pharaoniques[40]. Cette thèse, fondée sur des faits isolés qui peuvent être des accidents, est fort mal assurée pour l’époque des Pharaons[41], et elle est facile à réfuter pour l’époque des Lagides. On a vu que le mariage entre frères et sœurs s’explique très suffisamment, aussi bien pour les Pharaons que pour les Lagides, par une doctrine qui n’a rien à faire avec le droit de succession des femmes, la même que l’on retrouve recommandée par les codes religieux chez les Achéménides et dans tout l’Iran avestique. Le principal argument de la thèse égyptologique se trouve ainsi écarté. D’autre part, le cas des princesses royales mariées à l’étranger fournit un argument contraire, que nous retournerons encore tout à l’heure contre un autre système. Pour ne parler que de la période avancée de la dynastie ptolémaïque, celle où grandit le rôle des femmes, les Lagides ont fourni un certain nombre de reines aux Séleucides. Or on ne voit pas qu’aucune de ces princesses ait jamais transmis à son époux des droits sur la couronne d’Égypte ou sur une parcelle quelconque du territoire, même lorsque, comme c’était vraisemblablement le cas pour Cléopâtre Théa, la princesse ainsi mariée était l’aînée des filles[42]. La même considération pèse d’un grand poids dans le débat transporté sur le terrain du droit hellénique. Ici, il y a lieu de demander de quel droit il s’agit, et s’il distingue entre le droit privé, qui, sans être partout uniforme, est connu dans ses principes généraux, et un droit monarchique dont les règles sont à chercher dans des faits disséminés en diverses régions. En droit privé, la femme est perpétuellement mineure : les femmes n’ont droit qu’à une dot et sont exclues de la succession au profit de leurs frères, qui se la partagent également entre eux, le droit d’aînesse restant purement honorifique. Une fille n’hérite que quand elle est έπίκληρος, c’est-à-dire seule héritière, et elle doit épouser son plus proche parent, afin de transmettre le bien de la famille à sa descendance. S’il est douteux que les princesses royales aient été aptes à succéder en droit égyptien, les idées grecques n’ont pu que rendre cette incapacité plus formelle. Le cas de la fille épicière ne s’est présenté qu’une fois dans l’histoire des Lagides, lorsque Ptolémée Soter II mourut sans laisser d’autre enfant légitime que sa fille Bérénice III. Il fut résolu à la mode grecque, par le mariage de Bérénice avec son plus proche parent, Ptolémée Alexandre II, héritier lui-même des prétentions de la branche cadette. Un cas analogue, et plus singulier, fut celui de la grande Cléopâtre Philopator, lorsque, débarrassée successivement de ses deux frères-époux, elle se trouva représenter seule — avec son fils le bâtard Césarion — la dynastie des Lagides. Elle eut recours à un expédient ingénieux, qui put lui être suggéré par quelque théologien de cour : elle se déclara épouse d’Amon et régnant avec lui ou par lui sur l’Égypte[43]. Mais le droit privé, qui partageait également la succession entre les héritiers mâles, n’était évidemment pas applicable aux successions royales, qui devaient transmettre la souveraineté intégralement à un seul ayant-droit[44]. Cette transmission est réglée par le droit monarchique. Ce droit spécial, on le voit appliqué dans une foule de
légendes héroïques et même théogoniques, et ces applications sont très
diverses, car on y trouve aussi bien la négation — par exemple, dans la
succession des Ouranides et des Kronides[45] — que
l’affirmation du droit d’aînesse. Au lieu de nous égarer dans ce labyrinthe,
nous avons à rechercher des exemples pris dans la réalité historique. En fait
de monarchie existant sur sol grec à l’époque historique, nous ne rencontrons
que la royauté spartiate. A Sparte, les filles étaient exclues absolument de
la succession ; la couronne est dévolue à l’aîné des fils nés durant le règne
de leur père. Du moins, c’est la théorie juridique que Démarate expose à
Darius afin d’engager le Grand-Roi à désigner Xerxès pour son successeur. A Sparte aussi, dit-il, s’il
y avait des fils nés avant que leur père fût roi, au cas où celui-ci aurait
un tardillon durant son règne, c’est le survenant qui succède à la royauté[46]. C’est sur ce
texte qu’est échafaudée la théorie du droit d’aînesse limité aux
porphyrogénètes, théorie récemment importée dans l’histoire des Lagides par
Mahaffy, acceptée par Strack, rejetée par Breccia, et sur laquelle il faut
prendre parti[47]. On n’a pas assez remarqué que l’historien ne prend pas à son compte l’affirmation de Démarate, avocat peu scrupuleux d’une cause douteuse, et que nous n’avons plus les moyens de la contrôler[48]. Au surplus, il n’y a pas apparence que les lois de Lycurgue, admirées surtout comme uniques en leur genre, aient fait autorité à Alexandrie. Le droit égyptien mérite plus d’attention, car les Lagides, qui lui ont emprunté le mariage royal, ont pu lui emprunter aussi la jurisprudence connexe sur le droit de succession. La doctrine théologique exposée plus haut ne considère comme dieu, fils authentique de Râ, que le Pharaon régnant. C’est donc comme roi, et non comme roi futur, à l’état de dieu éventuel, qu’il peut, lui ou Amonrâ sous sa forme, engendrer son successeur légitime. De plus, bien qu’ayant un harem peuplé de concubines, le roi n’avait officiellement qu’une femme légitime, seule qualifiée grande épouse royale ou reine, seule apte à transmettre sans mélange à ses enfants le sang divin dont elle était elle-même issue. Or il est évident que cette mère du futur souverain ne pouvait être grande épouse royale qu’avec un roi pour époux. La doctrine, strictement appliquée, n’admettait donc d’autre candidat au trône qu’un porphyrogénète. Nous n’avons pas à nous préoccuper de la pratique, qui fut le plus souvent conforme à la théorie. En général, dit Wiedemann[49], le successeur fut le fils aîné, c’est-à-dire non le premier fils que le roi engendra, mais le premier fils qui lui fut né par sa grande épouse royale, femme qui était regardée comme la seule souveraine légitime. Reste maintenant à savoir si les Lagides, en acceptant les prémisses de la théorie, en ont admis toutes les conséquences. Les partisans de l’affirmative ont écarté par avance toute objection en soutenant que les rois Lagides ne contractaient de mariage légitime qu’après leur avènement. C’est là une question de fait, à résoudre non par des raisonnements, mais par des constatations. Le fait principal invoqué à l’appui de leur opinion est devenu depuis peu un argument contraire. Ils expliquaient la façon dont Ptolémée Soter avait disposé de sa succession, excluant l’aîné de ses fils au profit du cadet, par le droit supérieur de ce dernier, que, pour les besoins de la cause, on supposait né après l’avènement de son père. Mais un nouveau fragment de la chronique de Paros ne permet plus de douter que Philadelphe soit né en 309, plusieurs années avant l’avènement officiel de son père[50]. Mais Ptolémée Soter appartient à une époque où la règle pouvait n’être pas encore établie. Il ne se souciait guère plus que les autres Diadoques des effets juridiques des mariages où la femme jouait le plus souvent le rôle d’appoint ou d’otage dans les combinaisons politiques. Voyons donc plus tard. Plus tard, on ne trouve rien, en Égypte ou ailleurs, qui confirme la thèse du porphyrogénétisme, et on est en droit de conclure que, échafaudée sur des réminiscences empruntées à Sparte ou à l’Égypte ancienne, elle s’est nourrie de sa propre substance. Il n’a pas été question jusqu’ici des enfants illégitimes. Il suffirait de dire qu’ils n’avaient aucun droit sur la succession de leur frère, si la dynastie des Lagides n’avait été prolongée par une greffe bâtarde à partir de Ptolémée XIII Aulète. C’est un fait historique motivé par des considérations tout à fait étrangères au droit public comme au droit privé, et qui n’a rien changé aux principes juridiques. On a vu combien Ptolémée Aulète eut de peine à faire oublier sa tare originelle, et à quel prix il acheta le droit de régner. Nous en dirons autant de l’apanage donné par Évergète II à son bâtard Ptolémée Apion. Ce fut un acte testamentaire, et le testament a pour fonction propre de déroger à l’application régulière de la loi commune. Nous pouvons donc résumer les résultats acquis dans les propositions suivantes, qui constituent les règles fondamentales du droit monarchique appliqué en Égypte sous les Lagides en matière de succession. I. Dans la famille des Lagides, la couronne était héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. II. Les filles n’ont aucun droit à la couronne, tant qu’il existe un représentant légitime de la descendance masculine, en ligne directe ou agnatique. Elles ne sont aptes à succéder qu’à défaut d’ayant-droit, et seulement pour transmettre la souveraineté à un roi associé par mariage, conformément aux principes du droit grec. III. Les enfants illégitimes sont exclus de la succession. § III. — L’AVÈNEMENT ET L’ASSOCIATION AU TRÔNE. Les règles concernant l’hérédité ne sont qu’une partie des précautions dont le droit monarchique entoure la transmission du pouvoir. En droit privé, le mort saisit le vif ; théoriquement, la propriété du défunt ne reste pas un instant sans maître. En pratique, l’héritier peut être incapable d’exercer son droit de propriété et placé sous tutelle. Même s’il est majeur et capable, sa prise de possession est entourée de formalités imaginées soit dans son intérêt, soit dans l’intérêt de la société. A plus forte raison, la prise de possession de la souveraineté. Nous ne connaissons pas du tout les formalités qui ont pu solenniser l’avènement des rois à Sparte, en Macédoine ou dans les monarchies hellénistiques. Les historiens qui nous renseignent si bien sur les funérailles des rois spartiates n’ont pas songé à nous décrire les rites de l’entrée en fonction. On peut supposer avec vraisemblance des sacrifices offerts par le roi aux dieux nationaux et l’hommage des acclamations populaires. En ce qui concerne les Lagides, ces Janus à deux visages, nous avons à distinguer la face tournée du côté de l’Égypte et celle que connaissent les Alexandrins. Du côté égyptien, nous savons que le roi affirmait sa souveraineté et sa divinité en exerçant ses fonctions sacerdotales, et avec une solennité particulière, devant des délégations des divers clergés, dans le temple de Memphis, le jour du sacre. A Alexandrie, on nous parle d’άνακλητήρια et de πρωτοκλήσια, solennités auxquelles on convoquait même des députations venues de l’étranger[51]. Mais le sacre, cérémonie que les premiers Lagides n’ont pas jugée indispensable, ne coïncidait pas avec l’avènement[52], et pas davantage les fêtes alexandrines que nous avons considérées comme la proclamation de la majorité de rois mineurs lors de leur avènement réel. Ce qui importe beaucoup plus, c’est d’étudier l’hérédité anticipée, sous forme d’association au trône. Les dynasties qui se fondent et qui n’ont pas encore acquis la légitimité conférée par le temps n’oublient pas, en général, que la transmission du pouvoir vacant par décès peut se heurter à des compétitions dangereuses. Dans les pays polygames, les compétitions nées des intrigues de harem menacent les dynasties les mieux assises. Le moyen le plus efficace d’y obvier est que le souverain mette son successeur désigné en état de braver la concurrence possible en l’associant à son pouvoir, en lui assurant d’ores et déjà l’obéissance et le respect de ses sujets. Les Pharaons n’y ont pas manqué : on nous cite comme ayant pratiqué ce genre de précaution tous ou presque tous les rois de la XIIe dynastie et même les rois puissants des XVIIIe et XIXe dynasties. Les exemples connus ne permettent pas d’affirmer que ce fût une coutume constante : mais ils suffisent à montrer qu’on l’avait trouvée souvent opportune[53]. L’usage une fois établi fut justifié, comme il convient, par l’exemple des dieux. C’est ainsi qu’Osiris avait été intronisé par son père et initié par lui aux devoirs de la royauté[54]. Que le premier Lagide l’ait empruntée aux vieilles traditions du pays ou qu’elle lui ait été suggérée par sa prudence bien connue, il est certain qu’il en a fait usage. Il s’est associé son fils cadet, et, pour prévenir un retour offensif de l’aîné, il a si complètement délégué ses pouvoirs à Ptolémée Philadelphe que historiens et chronographes ont interprété le fait comme une abdication. Ptolémée Philadelphe, pour des raisons que nous avons cherché à expliquer, s’est donné pour collègue, durant un certain temps, son fils aîné Ptolémée III Évergète[55]. On ne saurait affirmer que celui-ci ait investi son successeur ; mais il paraît bien qu’il prit cette précaution[56]. La succession de Ptolémée IV Philopator fut assurée à son fils encore en bas âge par le système de l’association, et nous avons cru devoir interpréter en ce sens l’expression du décret de Rosette affirmant que Ptolémée V Épiphane avait reçu de son père la royauté[57]. Il va sans dire que la royauté ainsi conférée laisse subsister la subordination naturelle entre le fils et le père et n’introduit pas un double comput dans la chronologie par années de règne. Avec le règne de Philométor commence une époque troublée et révolutionnaire où l’on voit se manifester, d’une part, la prétention des reines à exercer le pouvoir souverain au même titre que le détenteur légitime, d’autre part, des essais de collégialité ou association sur le pied d’égalité, et bientôt de partage de la royauté en fractions autonomes. Ce sont des faits que nous persistons à rejeter en dehors du droit et à considérer comme des usurpations dont le succès, toujours précaire, dépendait des circonstances, — parfois de l’intervention du peuple alexandrin insurgé[58], — et de la valeur personnelle des auteurs de ces conflits. Cléopâtre I régna comme tutrice de son fils mineur, dans des conditions qui légitimaient son pouvoir au regard des coutumes égyptiennes et que le droit grec lui-même aurait dû tolérer, c’est-à-dire à défaut de tout représentant mâle de la dynastie. Cléopâtre II, que l’on se plaît à représenter comme possédant en propre la royauté et la transportant d’un frère à l’autre, n’a tenté de régner seule que par la force et a finalement échoué dans cette entreprise révolutionnaire. C’est en dépit du droit, protégé contre elle de temps à autre par le peuple alexandrin, que Cléopâtre III voulut se perpétuer au pouvoir, tenir ses fils en tutelle et leur donner ou retirer à son gré la couronne. Ce qui s’est passé sous le règne de Ptolémée Aulète et après lui appartient à une période d’anarchie où il n’y avait plus d’autre droit que le bon plaisir des Romains. Cléopâtre VI Philopator est la seule reine qui ait régné non pas seule, mais en son propre nom, et dont les années soient inscrites au Canon des Rois ; mais on sait de qui elle tenait son pouvoir. Dans tous ces faits, il n’y a pas trace de droit héréditaire égalant la femme à l’homme ou d’association régulière lui communiquant, à titre de propriété personnelle, tous les droits de son époux et lui permettant d’entrer ensuite en concurrence avec son fils[59]. Nous en dirons autant, après y avoir regardé de plus près, de l’association sur le pied d’égalité entre des héritiers mâles, et, à plus forte raison, du partage de la royauté entre eux. Ce sont là des expédients transactionnels distingués à bon droit de l’association régulière, celle qui a pour but unique d’assurer à l’héritier présomptif, par une investiture anticipée, la possession de son héritage. Le premier exemple de collégialité ou exercice d’un pouvoir indivis possédé à titre égal par des collègues date de la révolution alexandrine qui, pour déjouer les calculs d’Antiochos IV Épiphane, mit le second Évergète sur le trône ; ou, pour parler plus exactement, de l’arrangement conclu en 168 a. Chr. entre le Ptolémée qui fut plus tard Évergète et son frère allié Philométor[60]. C’est le régime des trois Philométors, trio composé de deux rois et d’une reine. Le pouvoir est indivis, et cette indivision se marque par le prédicat divin commun aux deux frères, mais la personnalité du collègue associé ne s’efface plus comme dans l’association au trône ; il y a égalité dans la communauté, et la distinction des personnes est sauvegardée par l’institution d’un double comput, datant chaque série d’années de l’avènement et conforme à la vérité historique[61]. On a vu combien fut instable l’équilibre de ce système, qui, grâce à l’ingérence romaine, fut remplacé par le système du partage. Un nouvel essai d’association, peut-être sous forme de tutelle, entre Évergète II et son neveu Eupator fut mis à néant par la mort d’Eupator. A la fin du règne d’Évergète II, nous voyons fonctionner le régime des trois Évergètes avec un roi et deux reines, régime qui met les deux reines en perpétuelle rivalité sans accorder ni à l’une ni à l’autre une participation effective à l’exercice du pouvoir. Il n’y a pas là de collégialité proprement dite, à moins qu’on ne restreigne la collégialité aux deux reines[62]. Après le règne d’Évergète II, il n’y a plus d’association, mais des compétitions qui tendent à diviser et finissent par diviser effectivement la royauté et le royaume. La Cyrénaïque étant retranchée des domaines de la monarchie, c’est l’île de Cypre qui devient le fief de celui des deux concurrents qui, de gré ou de force, se contente de la seconde place. Au système de la royauté indivise se substitue, en fait le partage du pouvoir entre un suzerain et son vassal. Ces arrangements sont des expédients qui, précaires ou même permanents, conservent le caractère de mesures d’exception. C’est méconnaître ce caractère que de parler à ce propos d’un retour au droit privé grec, lequel aurait assuré désormais part égale aux héritiers mâles, et d’y ajouter encore, au nom du droit égyptien, une aptitude égale pour les femmes. En résumé, au point de vue du droit, il n’y a jamais eu, sous les Lagides, qu’une forme régulière de l’association au trône, celle de l’héritier présomptif qui, suivant l’expression consacrée, reçoit de son père la royauté. L’association ou le partage entre héritiers a été la négation du droit monarchique, fondé essentiellement sur le droit d’aînesse. Il faut convenir que ce droit a été souvent violé et que la responsabilité de la première dérogation remonte au premier Lagide ; mais des dispositions spéciales, testamentaires ou autres, ne modifient pas les principes dont elles suspendent l’application. |