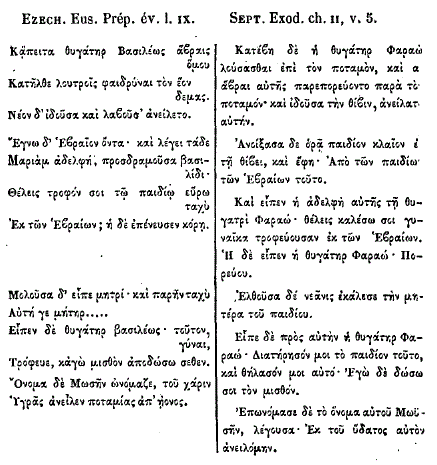ESSAI HISTORIQUE ET CRITIQUE SUR L'ÉCOLE JUIVE D'ALEXANDRIE
PREMIÈRE PARTIE. — OUVRAGES SORTIS DE L'ÉCOLE JUIVE D'ALEXANDRIE
CHAPITRE PREMIER. — TRAVAUX SUR L'ÉCRITURE SAINTE.
|
I. — Version des Septante. La traduction des livres de l'Ancien Testament, attribuée, par les uns à soixante-dix, par les autres à soixante-douze vieillards envoyés de Jérusalem à Alexandrie par le grand prêtre Eléazar, sur la demande de Ptolémée Philadelphe[1], eut pour véritables auteurs les Juifs établis dans la capitale des Lagides. La plupart des critiques de nos jours en conviennent après J.-L. Vivès[2], J. Scaliger[3], Hody[4] et Van-Dale[5], qui les premiers attaquèrent l'opinion contraire généralement acceptée avant le dix-septième siècle, sans doute parce qu'on ne l'avait pas examinée assez sérieusement. Quels sont, en effet, les fondements sur lesquels elle
repose ? L'histoire d'Aristéas, ouvrage apocryphe dont personne, malgré les
savants ouvrages d'Is. Vossius, de Whiston et de Valton, ne reconnaît
aujourd'hui l'autorité. Quelle peut être la valeur d'une narration remplie
des contradictions les plus évidentes[6], et composée plus
d'un siècle après le fils de Ptolémée Soter par un écrivain qui se dit contemporain
de Philadelphe et le capitaine de ses gardes[7] ? Aristobule,
également induit en erreur lorsqu'il a affirmé que la version complète de
tous les livres des Juifs fut composée sous le règne de Ptolémée II, et
confiée aux soins de Démétrius de Phalère[8], n'a pas fait la
moindre allusion aux prodiges qui, d'après Aristéas, ont accompagné la
merveilleuse traduction. La fable qui a égaré les Juifs d'Alexandrie et plus
tard les chrétiens, on ne peut en douter, est sortie entièrement de
l'imagination d'un faussaire qui ne s'est même pas soucié de la vraisemblance.
Pourquoi le roi d'Égypte, qui avait dans sa capitale des exemplaires de la
loi mosaïque, et une foule de Juifs versés dans la connaissance du grec pour
les interpréter, aurait-il envoyé chercher, à si grands frais, un livre et
des traducteurs en Palestine, où, très-probablement, l'on ignorait complètement
encore la langue des vainqueurs de l'Asie. Alexandre n'avait-il pas laissé
aux habitants de Jérusalem, à la prière-du grand prêtre Jaddus, le droit de
vivre selon les mœurs et les coutumes de leurs ancêtres[9] ? Il ne leur
avait imposé ni garnison, ni aucune des obligations qui maltent un peuple
dans la nécessité d'apprendre rapidement la langue de ses vainqueurs. Josèphe
ne dit point que Ptolémée Soter, à qui il reproche à tort sa perfidie dans
une expédition qu'il ne dirigeait pas, ait été plus exigeant que celui dont
il avait été le général, avant d'être roi[10]. Comment donc,
dans une cité qui cultiva plus tard, il est vrai, la langue grecque, les
livres du Nouveau Testament le prouvent, mais qui ne le fit que lentement et
comme à regret, aurait-on trouvé, vers la fin du règne de Soter,
soixante-douze vieillards habiles hellénistes ? Le faussaire n'a pas pensé
que ce qui était possible dans son siècle ne l'était pas dans un temps où la
haine des Israélites poursuivait les partisans de la science grecque, et n'était
point adoucie par l'habitude ou le prétexte dont se servaient ceux qui
négligeaient l'idiome paternel, d'obéir aux ordres despotiques d'un tyran. Car
il est probable que c'est Antiochus Épiphane[11], dont les édits
forcèrent Jérusalem à adopter pour un temps les lois, les mœurs, les
divinités de Les traditions talmudiques sont d'accord avec le faux
Démétrius de Phalère. Elles nous apprennent que l'on avait institué à
Jérusalem, le VIII du mois de Thebeth,
un jeûne solennel pour l'expiation de l'acte coupable qui avait fait passer
la loi dans une langue profane[16]. Elles ajoutent
que des ténèbres épaisses couvrirent la surface de la terre, lorsque les
Alexandrins eurent l'audace de consommer leur iniquité. La haine dont les
Juifs de Le dialecte de cette version indique des traducteurs
exercés depuis longtemps au langage de la capitale des Lagides. Je sais que
les Macédoniens qui envahirent l'Égypte et imposèrent peu à peu la langue
grecque à la population juive et égyptienne du pays conquis, furent aussi les
vainqueurs de Ils ajoutaient ace à la troisième personne plurielle de l'imparfait et de l'aoriste second[24]. Exemples : εΐχοσαν pour εΐχον ; ήλθοσαν pour ήλθον. Ils donnaient un redoublement à quelques verbes qui n'en prennent pas, ou changeaient la place de l'augment. Ils employaient τεθέληκα au lieu de ήθέληκα ; άνήγκακα au lieu de ήνάγκακά[25]. Enfin, les Alexandrins créèrent des expressions nouvelles[26]. Or, si nous prenons la traduction alexandrine, nous y trouverons les formes particulières que les grammairiens et les philologues assignent comme le caractère distinctif du dialecte alexandrin. Nous ne ferons ici aucune citation, pour y montrer les deux premiers caractères signalés par Sturz. Nous nous contenterons de renvoyer aux observations que rios présente une récente édition des Septante[27]. Nous insisterons davantage sur les mots nouveaux que le savant critique, notre guide en cette matière, a reconnus chez les Alexandrins. Il en est plusieurs dont les traducteurs grecs de l'Ancien Testament font usage, qui n'ont pu être connus et employés que par des habitants d'Alexandrie. Les soixante-douze vieillards, venus de Jérusalem, supposons qu'ils aient parlé la langue grecque, et que les Macédoniens leur eussent donné les autres formes dont j'ai parlé, ne pouvaient se servir de ces expressions toutes locales. Ainsi άχι, avec le sens de verdure naissant dans la prairie, est un mot particulier à l'Égypte[28], et cependant les Septante l'emploient très-souvent. Il en est de même de οίφι[29], de 'Ρεμφάν[30], de πάπειρος[31], de πυραμίς et de plusieurs autres. Les traducteurs appellent l'Urins et le Thummins άληθεία, cette image que le grand prêtre d'Égypte portait sur le dos. Un grand nombre d'écrivains ecclésiastiques, et parmi eux saint Jérôme, et dans les temps modernes Dom Calmet, ont remarqué des erreurs si nombreuses et si considérables dans cette traduction qu'il leur a été impossible de supposer dans ses auteurs une connaissance parfaite de l'hébreu. Souvent les Septante, dit
D. Calmet, ont lu dans le texte hébreu autrement que
nous n'y lisons aujourd'hui : quelquefois leur leçon est plus correcte que la
nôtre ; et quelquefois aussi elle est plus fautive. On peut consulter sur
cela le grand ouvrage de Louis Capelle, intitulé : CRITICA SACRA, où il montre, par une infinité d'exemples, que les
Septante s'éloignent très-souvent du texte hébreu. D'autres critiques, comme
Leclerc, remarquent que souvent ils traduisent au hasard, et par pure
conjecture ; qu'ils sont inconstants dans leur traduction du même mot hébreu
; que quelquefois ils ajoutent ou corrigent, ou retranchent quelque chose de
leur texte ; que d'autres fois ils omettent certains termes ; qu'ailleurs ils
en suppléent ; que souvent leur texte est corrompu et chargé de gloses
inutiles : défauts que saint Jérôme leur avait reprochés en quelques endroits. Dans plusieurs livres de
l'Écriture, les Septante ou leurs copistes, ont fait de si grandes
transpositions, que l'on ne sait à quoi en attribuer la cause. Il y a dans le
Pentateuque des endroits où ils sont plus remplis et plus étendus que le
texte hébreu des Juifs, et d'autres où ils semblent avoir plutôt suivi le
texte samaritain que l'hébreu ; ce qui a fait croire à quelques savants,
qu'ils pourraient bien avoir traduit sur le texte samaritain, et à d'autres,
que le samaritain avait été touché sur les Septante. D'autres ont trouvé tant
de différence entre le texte hébreu et leur version, qu'ils ont soupçonné
qu'ils avaient traduit sur le chaldéen ou sur le syriaque. Dans les livres de
Josué, ils ajoutent plusieurs villes qui ne sont plus dans l'hébreu. Il y a
de très-grandes transpositions et de grands changements dans les livres des
Rois, dans les Proverbes, dans l'Ecclésiastique, dans Job, dans les
Prophètes, et jusqu'ici il ne s'est trouvé personne qui ait donné de bonnes
raisons de ces renversements. L'ordre que les petits prophètes tiennent entre
eux dans l'hébreu n'est pas le même que celui qui leur est donné dans la
version des Septante. Toutes ces variétés sont très-anciennes, puisqu'elles
se trouvent dans les plus anciens manuscrits et dans l'édition romaine, qui
passe pour là plus parfaite de toutes, quoique les critiques y remarquent
encore des choses qui sont différentes de ce que les anciens Pères ont cité
des Septante. Les Juifs ont remarqué treize endroits qu'ils croient avoir été changés exprès par les Septante ; mais il s'en faut bien qu'ils aient compris dans ce nombre toutes les diversités de leur texte. Saint Jérôme avance une chose qui serait fort peu avantageuse à la réputation des Septante, si elle était prouvée ; c'est que ces interprètes ont souvent traduit d'une manière peu conforme à l'hébreu, de peur de découvrir aux pays certains mystères qu'ils n'étaient pas encore capables de bien entendre ; en sorte que, par exemple, quand ils rencontraient quelques passages où il était clairement fait mention du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de crainte que les gentils ne soupçonnassent les Juifs d'adorer plusieurs dieux, ou ils les mit ornés, ou ils les ont traduits dans un autre sens[32]. Le même saint Jérôme dit ailleurs
que les Septante ont quelquefois traduit peu fidèlement, pour ne pas
découvrir la honte et les infidélités du peuple juif : Dans un autre endroit,
il soutient qu'ils n'ont pas voulu découvrir à Ptolémée Philadelphe, qui
était dans les principes de Platon, les mystères des saintes Écritures, et surtout
ce qui regardait la naissance de Jésus-Christ, de peur que ce prince n'en
prît occasion de croire que les Juifs adoraient un second dieu[33]. Tout en convenant avec saint Jérôme qu'un grand nombre de ces erreurs sont des fraudes d'un prosélytisme peu éclairé, les meilleurs critiques de l'Église Catholique pensent, avec Dom Calmet, que la plupart sont dus à une connaissance insuffisante de l'hébreu, ce' qui les autorise encore à croire que les Septante ne sont pas venus de Jérusalem, mais étaient des Juifs Alexandrins. Ces Juifs qu'Alexandre et Ptolémée Soter avaient attirés en Égypte, Mêlés à la population macédonienne, dans un même quartier de la nouvelle ville, s'étaient vu obligés d'étudier la langue grecque[34]. Les exigences du commerce, les 'rapports de tous les jours, de tous les moments, leur en faisaient une impérieuse nécessité. Les rabbins et les plus instruits des émigrés ne négligeaient sans doute pas de cultiver l'idiome maternel ; mais le peuple et les ignorants l'oublièrent rapidement ; bientôt même ils ne le comprirent plus. Il fut donc nécessaire de traduire en grec les passages du Pentateuque qui devaient être lus dans les synagogues[35], tous les jours de sabbat. On fut ainsi naturellement amené à désirer une version complète des saintes Écritures. Ce qui prouve que le besoin des synagogues imposa aux Juifs d'Alexandrie la nécessité de traduire les livres sacrés en grec, c'est le témoignage du Pseudo-Aristéas lui-même[36], de Philon[37] et de saint Jérôme[38]. Ils s'accordent tous à dire que la version n'eut d'abord pour objet que les seuls livres de Moïse. Le Pentateuque était en effet le seul dont on fit d'abord lecture dans les assemblées des Juifs[39]. Lorsque Antiochus Épiphane interdit cet usage en Palestine, on éluda ses ordres tyranniques en remplaçant le Pentateuque par les prophètes[40]. Quand Jérusalem eut secoué le joug cruel des monarques de Syrie, on lut alternativement dans les synagogues les livres de Moïse et ceux des prophètes. Les Juifs hellénistes adoptèrent la même coutume. Ils auraient, sans nul doute, traduit immédiatement l'Ancien Testament tout entier, s'ils n'avaient fait qu'obéir à un désir ou à une injonction formelle de Ptolémée Philadelphe. Le fils de Ptolémée Soter devait tenir à la collection complète des ouvrages de la nation juive, si curieux par leur antiquité. Ce prince ne prit aucune part, même indirecte, à la version des Septante. Son rôle se borna sans doute à ne pas s'opposer aux travaux des traducteurs pendant son règne. Certains critiques ont même avancé que les livres saints ne furent point placés dans la fameuse bibliothèque d'Alexandrie[41]. Mais il ne paraît pas probable que les premiers Ptolémées, ces collecteurs avides qui faisaient déposer avec tant d'empressement, dans le Bruchium ou dans le Sérapéum, les traductions faites par Manéthon et Ératosthène, aient négligé celle des Israélites. On objecte contre cette pensée, dit M. Malter[42], que Tertullien ne trouva de son temps, au Sérapéum, qu'un exemplaire du texte hébraïque ; mais si le dépôt n'eut pas lieu au Sérapéum, et cela est possible, l'incendie de la première bibliothèque, dans la guerre de César, explique la remarque de Tertullien, et le fait d'une traduction déposée au Bruchium demeure probable. Quoi qu'il en soit, on peut assurer que les livres de Moïse n'en furent pas mieux connus dans la capitale de 1'Égypte. Ils restèrent ignorés, au milieu des ouvrages du paganisme, comme cette divinité inconnue à laquelle saint Paul fit plus tard allusion devant l'aréopage. Ils attendaient que d'autres que les Juifs vinssent les tirer de l'oubli dans lequel ils étaient ensevelis, pour en donner l'intelligence au monde entier. Tout ce que l'on raconte de Démétrius de Phalère, relativement à cette même traduction et aux conseils donnés par lui à Ptolémée Philadelphe[43], n'est qu'un roman[44]. Le célèbre Athénien n'a point paru à la cour du second Lagide. Nous savons par Hermippe de Smyrne, contemporain de Démétrius lui-même, et disciple de Callimaque, que l'hôte illustre de Ptolémée Lagus fut disgracié par le fils de Bérénice[45]. Il payait ainsi le conseil donné à Soter de choisir son successeur parmi les enfants d'Eurydice. Quand Philadelphe fut sur le trône, il fut forcé de sortir d'Alexandrie pour prendre le chemin de l'exil. Il y mourut peu de temps après de la morsure d'un aspic. Ce n'est même pas sous le règne de Ptolémée II, que l'on
commença les traductions de Les traductions des différents livres de l'Ancien Testament n'ont pas toutes le même mérite. Celle du Pentateuque est la plus estimée. Le traducteur des Proverbes paraît avoir été très-versé à la fois dans la connaissance du grec et de l'hébreu. Celui de Job ne manquait pas de génie poétique ; il possédait les poètes grecs, mais pas assez la langue et l'érudition hébraïque. Les Psaumes et les prophètes accusent en-général des traducteurs dépourvus du sentiment dé la poésie sacrée. Le moins habile est celui qui a travaillé sur le prophète Daniel. Aussi l'Église, qui reconnaissait autrefois l'autorité des Septante pour les autres livres, a-t-elle rejeté cette traduction, et l'a-t-elle remplacée par celle de Théodotion. Ces différences dans le talent et l'habileté des traducteurs, l'emploi fréquent d'expressions diverses pour rendre le même mot du texte hébreu, nous prouvent encore que les traductions n'ont pas toutes été faites à la même époque. Les livres de Moïse furent probablement traduits par les ordres et sous la direction du sanhédrin d'Alexandrie[47], composé, comme celui de Jérusalem, de soixante-dix ou de soixante-douze membres. Ceci nous explique en même temps, et le soin particulier apporté à la traduction du Pentateuque, et la fable des soixante-douze vieillards d'Aristéas, et le serment de ne rien changer à un ouvrage révisé par des personnages si éminents[48]. Les traductions des autres livres de l'Ancien Testament ont été faites successivement et dans différentes circonstances, peut-être même par de simples particuliers. Le livre de Josué ne peut, comme l'a remarqué H. Hody, avoir été traduit que plus de vingt ans après la mort du fils. de Lagus. Le traducteur se sert du mot γαισός[49], javelot gaulois, connu en Grèce seulement après l'irruption de ce peuple barbare, et en Égypte, environ vingt années après le premier Ptolémée, lorsque les rois prirent à leur solde des troupes mercenaires gauloises. Le livre d'Esther fut traduit sous Philométor ; la
dédicace faite à ce prince en est une preuve. On ne s'occupa des prophètes
que plus tard. Les Juifs de II. — IIIe et IVe livres des Macchabées. Ces deux livres, l'un et l'autre apocryphes, ont été composés par des Juifs hellénistes, habitants de l'Égypte. Le premier, fragment peut-être d'un livre plus considérable, comme semble l'indiquer le commencement de l'ouvrage, contient l'histoire de la persécution de Ptolémée Philopator contre les Juifs d'Alexandrie. Ce prince, après avoir vaincu Antiochus le Grand à Raphia, vint à Jérusalem offrir des sacrifices d'actions de grâces dans le temple du Dieu d'Israël[52]. Mais il avait ensuite voulu pénétrer dans le sanctuaire[53]. Les prêtres et le peuple s'y opposèrent. La curiosité du prince fut plus vivement excitée par les résistances ; il s'obstina à vouloir franchir les barrières du lieu saint, inaccessible aux profanes. Il fut saisi par une main >invisible, renversé par terre où il resta longtemps sans mouvement et sans voix, terrassé par la puissance de celui qu'il avait eu la témérité de venir braver[54]. De retour en Égypte, il fit éclater son ressentiment contre tous les Juifs de ses États[55]. Il les lit renfermer dans l'Hippodrome[56] et voulut les faire écraser sous les pieds des éléphants[57]. Mais Dieu les délivra d'une manière miraculeuse, et fit un protecteur de son peuple de ce furieux persécuteur[58]. Théodoret[59], Nicéphore de
Constantinople[60]
et Philostorge[61]
citent ce livre comme canonique ; mais l'auteur de Le titre donné à un livre où l'on ne fait mention ni des Macchabées, ni de leur temps, ni de la persécution des rois de Syrie, dans laquelle les fils de Mattathias acquirent tant de gloire, nous fait soupçonner que le véritable auteur est encore un Juif. J. Scaliger, dans ses observations sur la chronique d'Eusèbe[62], remarque avec raison que Judas reçut le premier le nom de Macchabée. Pourquoi donc le trouve-t-on sur l'inscription d'une histoire dont les faits sont antérieurs à l'époque où ce vaillant général combattit pour l'indépendance de son pays ? Le récit des événements contenus dans le livre apocryphe n'a donc pas été fait immédiatement après l'accomplissement des merveilles qu'il renferme. Nous ne croyons pas avec Grotius que l'histoire dont nous nous occupons fut composée peu après l'Ecclésiastique, peut-être vers la fin du règne de Ptolémée III[63]. Ce fut seulement a près les brillants exploits de Judas et de ses frères en Palestine que le mot Macchabée a pu devenir le synonyme du zèle et du courage d'un Juif fidèle à la loi luttant contre tous les efforts d'un tyran. Or, rien n'indique que l'on ait jamais fait usage à Jérusalem de cette expression figurée. Nous ne la trouvons ni dans Josèphe, qui fait cependant des allusions fréquentes à des martyrs de la religion juive, ni dans les historiens des deux livres canoniques sur la lutte des Hasmonéens contre les rois de Syrie. Nous le voyons, au contraire, sur un autre ouvrage, le IVe livre des Macchabées, sorti de la ville d'Alexandrie, comme nous le montrerons bientôt. Si J. Scaliger[64], Dom Cellier[65] et Dom Calmet[66] avaient fait
cette observation, ils auraient été moins étonnés de l'inscription singulière
des deux livres en question. Ils auraient compris que les Juifs d'Égypte
voulant mettre les héros d'Alexandrie en présence des glorieux guerriers de Nous ne nous arrêterons pas, avec Gfroerer[68], à rechercher dans
cette histoire les traces de la philosophie alexandrine. Nous pensons, comme
Dahne, qu'elles n'y sont pas nombreuses[69]. L'auteur de
l'ouvrage sur le christianisme primitif a été égaré sur ce point comme sur
plusieurs autres par l'esprit de système. Nous ne voyons rien, ni dans la
prière du grand prêtre Simon[70], ni dans
l'apparition des anges qui sauvèrent les Juifs de la fureur des éléphants de
Philométor, rien de nature à indiquer les croyances particulières de l'école
juive d'Égypte. Dans cette phrase : καί
παρεδόξασας
έν έπιφανεία
μεγαλοπρεπεΐ,
σύστασιν
ποιησάμενος
πρός δόξαν τοΰ
μέγάλου καί
έντίμου
όνόματος σου[71], le mot δόξα, employé par le grand
prêtre, n'indique pas le désir de substituer, comme l'ont fait souvent les
Septante[72]
et Philon[73],
à une image trop matérielle de Dieu, une expression plus conforme aux Idées
alexandrines. Il n'est point placé ici comme une espèce de correctif pour
adoucir l'idée d'une apparition substantielle de Nous ne comprenons pas que le même critique ait pu
s'appuyer sur ces paroles : τότε
ό μεγαλόδοξος
παντοκράτωρ
καί άληθινός
θέος έπιφάνας
τό άγιον αύτοΰ
πρόσωπον
ήνέωξε τάς ούρανίους
πύλας, έξ ών
δεδοξασμένοι
δύο
φοβεροειδεΐς
άγγελοι
κατέβησαν
φανεροί πάσι
πλήν τοΐς
Ίουδαίοις[74], pour prétendre
que l'historien voulait dire, avec les Alexandrins : ces anges étaient comme
des étincelles de Les mots ό τών άπάντων άπροσδέης[76], les épithètes μέγιστος et ϋψιστος[77] données à Dieu, seraient, à elles seules, de bien faibles indices pour décider du pays où un livre a été écrit. Nous les signalons cependant ici, sans nous dissimuler qu'elles ne peuvent être d'un grand poids dans la balance. Nous trouvons dans l'emploi des deux noms de mois, Pachon
et Epiphi, des traces plus manifestes de la patrie de l'auteur du IVe livre
des Macchabées. Un Juif de Loin de s'accorder sur l'auteur de ce IVe livre des Macchabées, les savants les plus versés dans la critique sacrée se sont partagés sur l'ouvrage même à qui appartient ce titre[83]. Sixte de Sienne[84] avait trouvé, dans une bibliothèque des dominicains de Lyon, un manuscrit grec renfermant l'histoire du pontificat de Jean Hircan. Il se persuada avoir entre les mains l'ouvrage appelé par les anciens, quatrième des Macchabées. Il fit partager ses convictions à la plupart de ses contemporains, et son opinion fut dans la suite généralement admise. Quand les flammes dévorèrent la bibliothèque des dominicains, on crut la découverte de Sixte de Sienne anéantie pour toujours avec le manuscrit que le feu n'avait pas respecté. Mais plus tard, on reconnut, dans la traduction d'un livre arabe faite par le Jeay dans la polyglotte de Paris, les caractères du manuscrit grec de Sixte de Sienne. Mais est-ce bien là véritablement le Ive livre des
Macchabées, auquel l'auteur de L'auteur, dans sa préface, nous apprend lui-même son but. Il s'est proposé, en écrivant, de nous montrer que la raison exerce son empire sur les passions[93]. Il le prouve par l'exemple de la fermeté d'Eléazar au milieu des supplices, et par le martyre des sept frères et de leur vertueuse mère. En répandant tous leur sang pour ne pas renier leurs croyances et n'apostasier la loi de Moïse, ils nous ont fait voir que la raison, soutenue par la vertu et la piété, est la maîtresse de toutes les passions[94]. C'est donc là un épisode tiré dès livres canoniques[95], qu'un historien philosophe a fait servir à la démonstration d'une idée arrêtée d'avance. On a quelquefois attribué cet ouvrage à Josèphe. On le place ordinairement à la suite de ses œuvres. Mais les nombreuses méprises dans lesquelles l'auteur anonyme est souvent tombé, le silence de l'historien des Antiquités juives qui ne cite nulle part ce travail, quoiqu'il fasse mention de tous les autres sortis de sa main ; le style enfin rempli d'enflure, de figures affectées, semées partout sans discernement et sans goût, ont fait conclure à D. Calmet que le favori de Vespasien et de Titus[96] n'en fut pas l'auteur. Les doctrines de ce livre nous en révèlent l'origine. Elles ont une grande affinité avec celles de Philon ; elles n'ont pu être connues que dans la ville où le Juif platonicien avait passé sa vie tout entière[97]. C'est très-probablement après la mort de l'illustre Alexandrin que parut le livre sur l'Empire de la raison. Philon, comme l'a remarqué F. Dahne[98], pensait que la
partie supérieure de l'âme humaine, le Λογισμός,
était une parcelle de L'auteur inconnu du IVe livre des Macchabées met dans la bouche de ses martyrs des expressions qui rappellent la raison divine du platonicien d'Alexandrie : ή τοΰ θείου λογισμοΰ παντοκράτεια[100], ό ίερός ήγεμών νοΰς. On peut tout avec le secours de la raison, elle, commande en reine à toutes les passions : ήγεμών τών παθών[101], παθών τυράννος[102]. Elle est la souveraine de toutes les vertus : κυριωτάτη πασών άρετών[103], et le partage exclusif du véritable philosophe[104]. Le plaisir est la source de tout péché[105]. Les fautes sont égales, car elles naissent toutes du mépris de la loi dont elles sont la transgression[106]. Gfroerer a cru découvrir dans quelques passages l'interprétation allégorique particulière aux Juifs d'Alexandrie[107]. Mais sa démonstration nous semble peu concluante, et nous la négligeons ici. Les habitants de Jérusalem n'auraient ils pas, en effet, pu dire avec Eléazar[108] que le législateur des Hébreux avait défendu de manger les viandes nuisibles à l'âme et permis l'usage de celles qui ne le sont pas ? En Palestine, comme en Égypte, on savait que les prescriptions de la législation mosaïque ne concernaient pas seulement le corps. Il n'était pas nécessaire de recourir à des arguments de cette nature pour montrer la véritable origine du IVe livre des Macchabées. III. — Poème sur Jérusalem. Alexandre Polyhistor, cité par Eusèbe dans L'auteur du poème sur Jérusalem est bien distinct des deux
personnages qui ont porté le même nom, dans des pays différents. Mais ce
n'est pas là que se trouve la difficulté. Josèphe[112] place le poète
dont je m'occupe auprès de Démétrius de Phalère et d'Eupolème. Il excuse les
erreurs dans lesquelles il est tombé, comme les deux autres écrivains du paganisme,
en faisant observer qu'il ne pouvait parfaitement saisir le sens des saintes
Écritures[113].
Il le croyait donc Grec d'origine. L'historien juif a, selon toute apparence,
confondu Démétrius, cité par le faux Polyhistor[114], avec
l'illustre Athénien, hôte de Ptolémée Soter. D'autre part, il a pris à tort
Eupolème pour un gentil : c'était un Juif d'Alexandrie[115]. Il n'est pas
étonnant qu'il tombe dans une méprise semblable à l'égard de Philon l'ancien.
Eusèbe nous indique ce que nous devons penser de ce dernier quand il nous dit
: Clément d'Alexandrie fait mention de Philon,
d'Aristobule, de Josèphe, de Démétrius et d'Eupolème, écrivains juifs[116]. Il rapproche
ainsi tous ces personnages comme appartenant à une même nation. Saint Jérôme,
en attribuant à Philon l'ancien le livre de Il est impossible de tirer des vers mêmes du poème sur Jérusalem quelque lumière sur celui qui en fut l'auteur. Viger, après avoir cherché à les expliquer et à les commenter, a avoué qu'il n'avait pu réussir[118]. Le traducteur latin, arrêté sans doute par les difficultés du texte, s'est contenté, dans un endroit, de déclarer par des points mis en regard du grec, qu'il trouvait sa tâche trop difficile pour oser l'entreprendre[119]. Les deux autres passages sont plus compréhensibles. Ils font voir que le poète avait voulu composer un poème épique sur la ville sainte. C'était sans doute une simple histoire de la nation juive mise en vers ; un éloge des hommes illustres parmi le peuple de Dieu, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph[120]. Le souvenir de la terre natale inspira quelquefois à l'auteur des descriptions qui montrent le Juif, en pays étranger, se reportant toujours avec complaisance vers la cité de Jérusalem : Un ruisseau, dit Philon, descend d'une cime élevée ; grossi par les pluies et les neiges, il bondit en jaillissant sous les tours élevées de la ville, rafraîchit la plaine desséchée, et fait admirer au peuple la beauté de son onde transparente[121]. On a cherché à déterminer le temps où vivait Philon l'ancien ; mais on n'a pu réussir, faute de renseignements positifs, à s'arrêter à une date certaine. L'historien auquel nous sommes redevables des extraits de son poème n'a pu exister qu'après Sylla, sous lequel le véritable Polyhistor écrivait[122] ; mais le poète alexandrin a vécu à une époque antérieure à l'imposteur qui a usurpé le nom du prisonnier et du dictateur romain. Les expressions singulières, inintelligibles, qui ont lassé la patience et rebuté l'érudition de son traducteur latin, nous portent à croire qu'il composa son poème dans un temps où la langue grecque n'était pas encore très-familière aux Juifs d'Alexandrie. Peut-être vécut-il à Alexandrie avant le règne de Ptolémée Philopator. IV. — Tragédie sur la sortie d'Égypte. Démétrius, auquel le faux Al. Polyhistor se réfère dans son histoire des Juifs[123], nous a transmis des fragments assez considérables d'une tragédie grecque sur la sortie des Hébreux de l'Égypte. Ézéchiel, l'auteur de ce drame, avait étudié les poètes de
Le songe du futur libérateur des Hébreux, dans la tragédie d'Ézéchiel[125], paraît n'être qu'une réminiscence de celui d'Atossa, dans les Perses d'Eschyle. Le messager échappé aux eaux de la mer Rouge, venant rapporter la nouvelle de la terrible catastrophe dont toute l'armée de Pharaon a été victime, ressemble trop à celui qui accourt annoncer à la mère de Darius la ruine des armées de son fils, pour n'en être pas une imitation. La connaissance des règles de la tragédie grecque d'une
part, de l'autre la fidélité à reproduire l'histoire sainte presque mot pour
mot, sont, à elles seules, des indices suffisants pour désigner à la fois et
le pays où l'on a composé la tragédie sur la sortie d'Égypte, et l'origine du
poète. On s'occupait à Alexandrie, dans le Musée et dans les écoles
particulières, à corriger, à expliquer et à commenter Eschyle, Sophocle et
Euripide, dont on avait acheté, à grands frais, les autographes[126]. Les travaux
des critiques et le désir de s'associer à des hommes dont le nom était dans
toutes les bouches et dont la statue ornait souvent les temples, ont
naturellement suscité, dans la capitale des Lagides, des poètes tragiques.
Ils copièrent la forme des drames composés dans les beaux siècles de
Il est inutile de pousser plus loin nos recherches : l'auteur se déclare ouvertement lui-même en suivant ainsi pas à pas le livre saint de l'école juive de l'Égypte. Il nous reste à chercher le temps où Ézéchiel écrivait sa
tragédie dans la capitale des Lagides. Huet[127], dans sa
Démonstration évangélique, avance que l'auteur du drame sur la sortie
d'Égypte était un des Sep. tante. Le faux Aristéas donne, il est vrai, le nom
d'Ézéchiel à l'un des vieillards envoyés à Ptolémée Philadelphe par le grand
prêtre Eléazar[128]. Mais on ne
peut nullement s'appuyer sur un pareil historien. Quand bien même dans le
grand Sanhédrin d'Alexandrie, qui révisa peut-être la version dite des
Septante, il y aurait eu réellement un membre appelé Ézéchiel, rien ne nous
autoriserait à en faire l'auteur de l'ouvrage dont nous nous occupons ici.
Cependant, le savant évêque d'Avranches remarque avec raison que le poète
tragique israélite fut antérieur, non-seulement à Eusèbe et à Clément
d'Alexandrie, mais aussi au Polyhistor de |