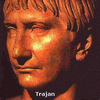ESSAI SUR LE RÈGNE DE TRAJAN
CHAPITRE XVIII — LES ARTS.
|
Voici encore un chapitre qui, faute de documents assez nombreux et assez positifs, sera nécessairement très-incomplet. Que dire, par exemple, de la MUSIQUE au deuxième siècle ? On sait combien l'histoire de cet art chez les anciens est obscure, même aux époques pour lesquelles le nombre des témoignages écrits est le plus abondant. Les auteurs où l'on pourrait puiser des connaissances à cet égard sont des philosophes qui dissertent à perte de vue sur les principes de la musique et sur l'influence qu'elle peut exercer sur les mœurs. Mais à l'égard de ce dernier point qui, traité avec précision et appuyé d'exemples, fournirait des éléments intéressants à l'histoire générale, on ne faisait au second siècle que répéter et commenter ce qu'avaient dit les anciens sages, attendu que, de l'aveu même de Plutarque[1], la musique d'éducation n'avait laissé aucun souvenir, et on ne concevait même pas ce qu'elle avait pu être au moment où elle florissait. Chaque addition de cordes à la lyre, chaque effort des musiciens pour donner à leurs auditeurs un plaisir plus intime et plus vif, avait provoqué les plaintes déclamatoires des philosophes contre la témérité des novateurs et la mollesse-des nouvelles générations qui dédaignaient la belle simplicité et la gravité majestueuse de la musique primitive, et se laissaient aller aux séductions d'un art plus riche et aux émotions produites par le génie plus hardi des artistes. Plutarque a repris, pour son compte, les antiques doléances, et fait consciencieusement l'éloge de cette musique que personne ne connaissait[2]. Depuis longtemps, les musiciens ne tenaient aucun compte de ces anathèmes rebattus cent fois. S'émancipant de la tutelle des mathématiciens comme de celle des pédagogues, ils écoutèrent enfin leurs inspirations, étudièrent par eux-mêmes les conditions et les ressources de leur art, et ne prirent pour guide que le public dont ils épièrent les impressions et dont ils suivirent docilement le goût. La musique grecque fit ainsi des progrès rapides, surtout dans la partie instrumentale, et elle était déjà bien riche et bien variée quand Rome et tout le cortège des peuples qu'elle avait vaincus et civilisés, auxquels elle avait fait partager son goût récent et passionné pour les arts, vinrent grossir les rangs du public grec. Pour émouvoir et ravir ces foules immenses, il fallut recourir à des moyens d'action plus puissants, et l'effort des compositeurs se concentra sur la production d'effets capables d'impressionner les masses. Plutarque nous apprend que de son temps, tous ceux qui s'occupaient de musique se tournèrent vers la musique de théâtre[3]. C'est la seule notion utile que renferme son livre, mais elle est précieuse à recueillir, et s'accorde bien avec ce que nous apprennent d'autres témoignages. Pylade se vantait de l'heureux complément qu'il avait apporté au jeu un peu froid de l'ancienne pantomime par l'addition de la musique instrumentale et chorale[4], et en effet le nombre des choristes du canticum s'était tellement accru qu'ils se répandaient jusque sur la cavea et qu'au dire de Sénèque on comptait, de son temps, plus de chanteurs que de spectateurs au temps passé[5]. Le nombre des instrumentistes augmenta nécessairement en même temps que celui des chanteurs, et il fallut même employer des instruments plus puissants et plus sonores. L'orgue, considéré jusque là comme une curiosité scientifique, devint un élément nécessaire de la nouvelle musique. Suétone[6] nous apprend que Néron en avait étudié les effets et qu'il projetait de le faire entendre au théâtre. Bien qu'il n'ait pas eu le temps d'exécuter son dessein, son nom resta associé dans le souvenir des Romains à l'histoire de cet instrument. Un orgue est figuré sur des médaillons contorniates à l'effigie de Néron, et la même représentation accompagne quelques contorniates de Trajan[7]. Bien que ces monuments n'aient été fabriqués que vers le règne de Valentinien III, on ne saurait leur refuser une certaine valeur historique eu ce qui concerne le détail des arts et des jeux sous le haut empire, et il n'est peut-être pas trop hardi d'interpréter ce double fait numismatique en supposant que le projet conçu par Néron trouva son exécution sous Trajan. Les concours de musique, inaugurés par Néron, furent systématisés par Domitien et devinrent partie intégrante des fêtes de Jupiter Capitolin et de Minerve. Domitien fonda un prix pour ceux qui chantaient en s'accompagnant de la cithare, un autre pour ceux qui accompagnaient les chœurs avec cet instrument et un troisième enfin pour ceux qui jouaient de la cithare sans chanter[8]. Des prix furent ajoutés dans la suite pour les joueurs de flûte[9]. L'audition des morceaux composés en vue du concours et exécutés par les concurrents avait lieu dans l'Odéon, théâtre circulaire contenant dix à onze mille places, que Domitien fit construire[10], mais qui probablement ne fut terminé que sous Trajan puisqu'on lui a rapporté l'honneur de l'avoir fondé[11]. Les progrès de la musique dramatique et instrumentale caractérisent donc particulièrement cette phase de l'histoire de l'art. la musique religieuse ne dut subir aucune modification, car le nombre et l'emploi des instruments et des voix était soumis depuis longtemps à des règles dont on n'aurait pas cru pouvoir s'affranchir sans impiété[12]. Quant à la musique de chambre, sa vogue, au commencement du second siècle, devint plus grande que jamais. A défaut de témoignages directe, l'activité littéraire des poètes lyriques pourrait être invoquée pour montrer à quel point ce genre de musique était en faveur, car il est reconnu aujourd'hui que les Odes d'Horace, aussi bien que celles de ses imitateurs, furent composées en vue du chant, et effectivement mises en musique et chantées[13]. Mais Pline lui-même nous parle d'accompagnements de cithare pour ses hendécasyllabes[14]. En Grèce[15] comme en Italie[16] la musique était désormais une partie essentielle de tout banquet et du repas même le plus simple. A l'époque dont nous nous occupons, cet art devint, pour les femmes de condition libre et de mœurs honnêtes, un passe-temps permis : elles purent donner, par leur talent, un nouvel attrait aux réunions de famille et de société. Il semble qu'au temps d'Auguste les bienséances ne l'auraient pas souffert : les maîtresses d'Horace qui chantaient ses poèmes en s'accompagnant de la lyre ou de la cithare, Lydie, Chloé[17], sont des courtisanes habiles à saisir un moyen d'attirer, par l'attrait d'un plaisir plus délicat et plus raffiné, des oisifs et des artistes. Mais cent ans plus tard, la musique entre dans l'éducation des jeunes filles[18] ; la femme de Pline chantait les vers de son mari en s'accompagnant de la lyre[19]. Il n'y a pas à s'étonner de ce changement de mœurs qui se lie d'une façon toute naturelle à l'établissement des salons où nous avons vu les femmes prendre part à des discussions littéraires et philosophiques ; le droit, pour elles, de manifester leur talent musical n'est après tout qu'un effet et un signe de l'indépendance qu'elles acquéraient dans les mœurs et dans la loi. Sur la PEINTURE au second siècle, nous avons encore moins de renseignements que sur la musique. Toutes les œuvres de cette époque ont péri ; quelques noms propres conservés par hasard ne nous apprennent que bien peu de chose. On peut croire que si un artiste eût manifesté quelques éclairs de génie, ou donné les preuves d'un talent véritable, les écrivains contemporains ou postérieurs ne l'auraient pas absolument passé sous silence. Mais il semble qu'en ce moment la peinture fût devenue un passe-temps de dilettanti ou un gagne-pain pour des barbouilleurs de métier. Parmi les amateurs il faut ranger Hadrien qui du reste avait des prétentions de connaisseur en tous les genres, et discutant un jour avec Apollodore, en présence de Trajan, une question d'architecture, reçut de son interlocuteur l'avis, peu charitable et peu ménagé d'aller peindre ses citrouilles[20], paroles dures, et probablement méritées, qu'Apollodore paya de sa vie quand le méchant peintre fut devenu le maître du monde. Cette anecdote nous apprend qu'Hadrien, si on veut à toute force le considérer comme artiste, doit être classé au nombre des Rhopographes. Un autre amateur, Publius, possesseur de la chienne Issa, fit de cette bête un portrait qui décelait un talent véritable, si les éloges de Martial sont sincères[21] ; mais la chienne, en cette même pièce, est louée avec une effusion telle que le petit poème est visiblement un appel, finement tourné d'ailleurs, à la générosité de Publius flatté dans ses deux passions : il n'y a rien ici pour l'histoire de l'art. Dans le même temps, Artémidore abordait la grande peinture[22], mais il manquait le succès en choisissant des sujets peu appropriés à son tempérament. Après ces trois personnages, vient la foule innombrable des faiseurs de portraits à la douzaine[23], des brosseurs de naufrages pour tableaux votifs[24]. Ils pouvaient aussi gagner quelqu'argent en faisant des copies, par exemple pour les libraires qui vendaient, enrichi du portrait de l'auteur, tout exemplaire soigné d'un classique[25]. D'autres fois ils travaillaient pour d'opulents amis des lettres qui voulaient décorer leurs bibliothèques avec les portraits des écrivains célèbres. Ainsi Pline écrit à un habitant de Pavie de faire copier, pour un amateur de ses amis, les portraits de Cornelius Nepos et de Titius Severus sur les originaux conservés dans la ville, en exigeant du peintre chargé de ces copies une exactitude scrupuleuse : qu'il se garde bien de rien changer à son modèle, même pour l'embellir[26]. On poussait loin, en effet, le respect de la peinture ancienne, jusqu'à ne plus aimer que l'archaïque, comme il arrive à toutes les époques où la force d'invention et d'exécution diminue. On se passionnait pour les écoles primitives ; quelques amateurs ne faisaient cas que des monochromes de Polygnote et d'Aglaophon[27]. Comme preuve du goût très-général alors pour cette branche de l'art, et pour montrer à quel point était répandue la connaissance des diverses écoles, on peut invoquer les nombreuses comparaisons que Quintilien y va chercher pour caractériser les génies oratoires et les œuvres d'éloquence. On sent que la langue de la critique d'art est faite, et que ses jugements sont familiers à tous les esprits[28]. Le goût du public pour les descriptions et les critiques de tableaux alla même si loin qu'on vit naître, vers ce temps-là, un nouveau genre littéraire : des catalogues raisonnés de galeries réelles ou fictives, dont les Imagines de Philostrate sont un spécimen bien connu[29]. Pour L'ARCHITECTURE, le règne de Trajan fut une époque de puissance et d'éclat. Bien que presque tous les monuments alors édifiés soient détruits, l'étude de ceux qui restent, et la distribution intérieure de ceux dont les fondations subsistent, distribution facile à reconnaître, en plusieurs cas, quand on fouille le sol à une faible profondeur, permettent de porter un jugement sur le goût général de l'époque et les principes qui dirigèrent les artistes contemporains. On l'a dit[30] avec une part de vérité : ce qu'on appelle l'architecture romaine n'est que de l'architecture grecque de décadence. Mais ce sévère arrêt n'est applicable qu'aux édifices élevés en vue d'un usage commun aux deux peuples, ou empruntés par Rome à la Grèce : temples, théâtres ou gymnases, édifices dont la forme, l'aménagement intérieur, le caractère, l'ornementation étaient depuis longtemps réglés dans les moindres détails, et dont les types nombreux, tant de fois étudiés, ne laissaient plus d'issue à l'originalité créatrice, et ne pouvaient plus être modifiés que par des combinaisons nouvelles d'éléments traditionnels, combinaisons presque fatalement malheureuses puisque les meilleures, et les meilleures après celles-ci, déjà moins bonnes, avaient été réalisées. Mais à Rome, où les architectes grecs et asiatiques se trouvèrent en face de besoins nouveaux et d'idées particulières pour la satisfaction et l'expression desquelles leur tradition était muette et leur doctrine insuffisante, ils retrouvèrent les facultés créatrices dont le développement était étouffé ou paralysé sur le sol natal : ils dépouillèrent le faux goût, le sentiment maniéré et mesquin qui déparaient les monuments élevés par eux dans leur pays, et ils donnèrent à l'arc de triomphe et à la basilique la solidité, la hardiesse et l'harmonie sévère qui caractérisent le génie littéraire du peuple pour lequel ils travaillaient. Au service de la pensée romaine, ils se sont montrés virils, austères et forts comme les Romains pour qui et chez qui ils ont bâti. Ainsi l'architecture du règne de Trajan est grecque, si l'on n'a égard qu'à la patrie des maîtres : l'empereur lui-même nous apprend qu'il faisait venir de l'Orient les artistes auxquels il devait confier le plan et l'exécution des travaux immenses qu'il projetait[31]. Mais elle est romaine si, comme il est juste, on ne s'attache pour la définir qu'à son esprit général, à l'espèce des monuments qu'elle a laissés sur le sol italique, au caractère des sculptures conçues en vue de la décorer. Depuis Néron, l'architecture romaine offrait deux particularités caractéristiques : l'énormité des proportions et l'emploi de substances rares et précieuses. Cet emploi fut continué sous Trajan, quand il ne devenait pas une prodigalité ruineuse. Ainsi Pline charge l'architecte Mustius de se procurer des marbres pour le revêtement des parois du temple qu'il veut agrandir[32] ; les colonnes intérieures de la basilique Ulpienne sont en granit dur d'Egypte, et celles qui formaient le portique du côté du Forum étaient en marbre jaune de Numidie. Mais par un retour au bon goût, les proportions colossales furent abandonnées, au moins pour les édifices d'Italie. Leurs dimensions n'excèdent pas les limites de l'utile et du beau. La longueur considérable du pont du Danube, la hauteur extraordinaire du pont d'Alcantara furent commandées par des conditions topographiques. En Orient seulement, je retrouve un de ces édifices immenses qu'affectionnait la génération précédente : c'est le tombeau célèbre de Pétra, dont la construction, à en juger par la perfection du travail, remonte au commencement du deuxième siècle, et dès lors dut suivre presque immédiatement la conquête de l'Arabie par Cornelius Palma. Ce monument gigantesque, dont les dimensions le cèdent à peine à celles de l'Arc de l'Etoile à Paris, offre deux étages : le premier, consacré proprement à la sépulture, présente l'aspect d'un temple hexastyle ; au-dessus s'élève un édifice semi-circulaire, sorte de temple monoptère flanqué de colonnes qui supportent l'entablement général. L'histoire de l'art n'offre rien d'analogue à cette combinaison hardie de deux temples superposés, jusqu'au XVIe siècle où Bramante suspendit une coupole au-dessus de l'immense basilique de Saint-Pierre[33]. Trajan fit peu construire au début de son règne. Les profusions monumentales de Néron, celles des Flaviens, de Domitien surtout, avaient épuisé le trésor public. En l'an 100, Pline loue chez l'empereur sa réserve à entreprendre des bâtiments nouveaux, et sa diligence à conserver les anciens[34]. Douze ans plus tard, Trajan ne méritait plus les mêmes éloges, mais comme nous l'avons fait remarquer, les grandes constructions du Forum ne furent entreprises que quand plusieurs années de bon gouvernement avaient constitué de bonnes finances, et que la guerre heureuse faite aux Daces avait fait affluer dans le trésor public des ressources considérables. La même remarque s'applique à l'arc d'Ancône, contemporain de la guerre des Parthes, et aux deux arcs, placés sur la Via Appia, l'un à Rome[35], l'autre à Bénévent, à la même époque et après que le pavage de la route, partie utile du travail, était terminé. Parmi les architectes de ce temps dont les noms nous ont été conservés, on cite C. Julius Lacer, l'auteur du pont d'Alcantara et du temple voisin[36] ; Rabirius, à qui étaient dues la plupart des grandes constructions du règne de Domitien[37] ; Mustius, dont Pline loue la science et le goût, et qu'il chargea de reconstruire et d'agrandir un temple de Cérès dans l'une de ses terres[38]. C'est peut-être ce même Mustius qui avait donné les plans des belles villas du Laurentin et de la Toscane dont nous aurons à parler tout à l'heure. Mais le plus grand de tous ces artistes est Apollodore de Damas qui, après s'être montré dans la guerre Dacique un ingénieur militaire habile et résolu, révéla les facultés puissantes et les dons brillants du génie architectonique dans le plan du Forum Trajanum, dans les immenses travaux préparatoires que ce plan rendit nécessaires, dans le dessin correct, l'exécution soignée, l'achèvement rapide des monuments projetés. Nous avons déjà indiqué ces monuments : Arc de triomphe à l'entrée du Forum, — Bibliothèques, — Basilique, — Colonne Trajane, — Temple que Trajan voulait sans doute consacrer à Nerva, mais qui fut dédié par Hadrien à Trajan lui-même. Les témoignages anciens ne laissent aucun doute sur le sentiment d'admiration que produisait ce bel ensemble, et la longue existence du Forum Trajani atteste la solidité des édifices qui l'entouraient et l'embellissaient[39]. Tout a disparu sauf la colonne, dépouillée de la statue du vainqueur des Daces[40], et quelques piliers tronqués d'une des cinq nefs de la basilique. Des médailles d'un dessin excellent et très-exact comme l'ont démontré les fouilles, ces fouilles elles-mêmes heureusement exécutées, ont permis néanmoins de reconstituer l'œuvre d'Apollodore d'une manière à peu près certaine. Nous en avons décrit plus haut les parties subsistantes, et nous n'avons pas à revenir sur ce sujet. D'après une opinion récemment émise par M. Frœhner[41], le Forum d'Apollodore aurait été conçu sur le plan des grandes constructions égyptiennes, et rappellerait notamment le tombeau d'Osymandias qu'a décrit Diodore[42]. Je ne saurais partager cette manière de voir. En premier lieu la comparaison, telle qu'elle a été présentée, implique l'existence de ce tombeau extraordinaire. Or on n'a aucun motif pour abandonner les arguments que Letronne a si bien fait valoir[43] en vue d'établir la nature fabuleuse du récit débité par les ciceroni thébains. Il est vrai que la disposition générale commune à tous les temples de la Haute-Egypte, et qui a servi de canevas au conte fait à Diodore, offre de lointaines ressemblances avec le Forum : par exemple, dans l'un des temples récemment explorés d'Edfou[44], on rencontre une salle hypostyle placée entre une grande cour carrée et un sanctuaire comme ici la basilique est entre le temple du fond et l'area Trajani. Il ne serait pas impossible non plus, d'une manière absolue, que le goût égyptien qui devint à la mode sous Hadrien, eût commencé à se répandre vingt ou vingt-cinq ans plus tût qu'on ne l'avait cru jusqu'ici. Mais en quoi son influence se fait-elle sentir ici, dans ce groupe de monuments dont chacun, pris à part, est romain, et dont l'assemblage n'offre rien de nouveau ni d'extraordinaire ? Vitruve avait construit à Fano[45] une basilique à double entrée située, comme la basilique Ulpienne, entre un forum et un temple ; si on ne veut pas qu'Apollodore ait imaginé la disposition des édifices dont il dirigea la construction, n'est-ce pas dans le traité classique de son art, plutôt que dans la vallée du Nil, qu'il sera allé chercher l'inspiration qui lui manquait ? II avait tout près de lui, et sur le sol et dans les livres, des modèles d'arcs de triomphe, de temples, de basiliques, de bibliothèques : la colonne au contraire est en son genre le premier monument connu, et paraît bien de l'invention d'Apollodore. M. Frœhner croit y reconnaître une imitation du Panium d'Alexandrie[46] et ici encore je me sépare de son opinion. Le Panium était-il pourvu d'un escalier intérieur et décoré de bas-reliefs sur sa surface extérieure ? Rien n'autorise à le croire et l'on ne trouve rien de tel dans la description que Strabon nous en a laissée[47]. L'art grec offrait déjà des exemples de statues posées sur des colonnes[48] et c'est là, peut-être, qu'Apollodore prit l'idée du monument à élever en l'honneur de Trajan ; quant à l'invention de l'escalier intérieur, il lui appartient bien légitimement. Nous pouvons étudier d'autres édifices de la même époque, tels que les arcs de Bénévent et d'Ancône, et le tombeau des rois de la Commagène, à Athènes[49]. Ils offrent un caractère commun de simplicité et de sévère élégance, un peu altéré pourtant à Bénévent, où la construction prend déjà quelque chose de lourd dans son aspect. Les surfaces extérieures y sont couvertes de sculptures, ce qui est aussi un symptôme de décadence : offusqué, égaré par l'abondance des détails, l'œil du spectateur ne saisit pas nettement l'idée première de l'architecte, qui a laissé envahir son domaine par les décorateurs. Les grandes villas que possédait Pline, et dont il a si complaisamment développé les descriptions, nous fournissent d'excellents types de l'architecture civile sous le règne de Trajan. Elles appartiennent à la classe de bâtiments que Vitruve appelle ædificia pseudo-urbana[50], qui ne différaient des habitations urbaines sur aucun point essentiel. Félibien[51] a fait remarquer[52] que dans l'une de ces lettres[53] considérée plutôt comme une pièce d'éloquence que comme une description régulière, le Laurentin est pourtant décrit si exactement que les mesures mêmes de chaque partie principale des bâtiments s'y trouvent en quelque sorte déterminées par la comparaison de chacune de ces parties les unes aux autres, et par la nécessité d'y conserver toutes les vues, les expositions et les commodités que Pline leur attribue. Il fait[54] la même observation pour la lettre relative à la villa de Toscane[55]. Mais l'habile historien des arts s'est mépris sur les facilités que pourraient offrir ces pages célèbres aux architectes qui voudraient entreprendre la restauration d'es villas. Les plans qu'il en a dressés avec leur secours sont fort discutables : d'autres artistes en ont proposé de tout différents[56] en s'appuyant sur les mêmes textes. Ces divergences ne doivent pas surprendre : qui ne sait combien l'interprétation du vie livre de Vitruve est restée conjecturale jusqu'à ce que le déblaiement de Pompéi eût mis les architectes en présence d'édifices analogues à ceux dont Vitruve avait parlé ? Et pourtant on avait entre les mains un ouvrage écrit par un homme du métier, habitué à la précision scientifique et fidèle à la rigueur du langage technique, tandis que Pline, en maint endroit, sacrifie cette précision à l'élégance. Ainsi la découverte des ruines de ses villas pourrait seule rendre tout à fait intelligibles les descriptions qu'il en a données, et on ne peut guère compter sur une pareille découverte[57]. Mais les lettres en question n'en sont pas moins des documents extrêmement précieux pour l'histoire de l'architecture : si l'ordonnance et la distribution des bâtiments ne sont pas connues avec une entière certitude, nous sommes du moins assez bien instruits de leur composition, et nous possédons des éléments d'étude plus décisifs peut-être que ceux que fournirait la description d'une maison bâtie dans Rome, l'architecte ayant pu, en Toscane comme dans le Laurentin, réaliser ses plans sans être gêné par les obstacles que lui opposaient un sol partout bâti et des règlements multipliés de voirie et de police. C'est en effet au point de vue de la vie urbaine, de ses besoins et de ses plaisirs, qu'il faut se placer pour juger les plans de l'architecte qui a construit les villas de Pline : ils nous paraîtraient mal conçus si nous songions à la vie de campagne telle que nous l'entendons aujourd'hui. Il faut dire ici quelques mots du sentiment de la nature qu'éprouvaient les anciens et qui différait absolument du nôtre. En quittant la ville, nous cherchons une diversion à la civilisation raffinée qui nous entoure et qui a pénétré et déterminé toutes nos habitudes : nous voulons trouver à la campagne un contraste aussi net, aussi tranché que possible avec ce que nous avons abandonné. En conséquence, nous donnons à nos habitations rustiques un aspect modeste et simple, et tout ce qui en dépend comme ameublement ou comme décoration porte l'empreinte du même goût. Si l'importance de l'habitation exige un certain développement monumental, on adoptera une architecture ancienne, et le château semblera une création et un témoin du passé, oublié au milieu du mouvement général de l'industrie et de la transformation des mœurs. Son air de vétusté produira l'illusion cherchée du lointain, et appellera notre imagination hors du cercle de la vie quotidienne. Cette même lassitude, un peu affectée, de la civilisation, nous a donné le goût des beautés pittoresques et romantiques de la nature, et nous fait trouver du charme à ses aspects les plus sévères et les plus désolés. On veut retrouver un ordre d'émotions pareil dans les parcs ou les jardins qui entourent les maisons de campagne et les efforts de l'art tendent à y faire disparaître toute symétrie. On respecte les inégalités du terrain, on conserve ou on crée des massifs qui seront des forêts en miniature, traversées par des allées étroites et sinueuses qui doivent rappeler les sentiers à peine frayés au milieu des bois. Que nous sommes loin des anciens, et surtout des Romains du second siècle ! Ils ne pensaient nullement comme nous à cet égard et ils n'avaient pas la moindre idée du plaisir que peut faire naître un tel contraste. Ils aimaient, au contraire, à se sentir près de l'homme, à retrouver toujours près d'eux les traces de son activité et de ses passions. Les Géorgiques sont pleines de nos joies et de nos douleurs : le héros du poème est la race humaine, laborieuse et persévérante, qui a dompté les forces naturelles et appris à prévenir ou à réparer les ravages de leur élan funeste et désordonné. Les animaux y deviennent sympathiques, non par leurs qualités propres, mais par la quasi-humanité que leur confère Virgile, et à laquelle ils se sont élevés en s'associant à nos travaux et en se mêlant à notre existence. Le seul Horace, parmi les poètes latins, semble avoir aimé la nature pour elle-même, et encore n'a-t-il guère été séduit que par ses côtés gracieux. Il s'est amusé des accidents de lumière et de lignes que lui offrait la campagne romaine, il a connu les rêveries et la mélancolie douce où l'aspect des champs et des bois nous fait tomber. Mais c'est un sentiment délicat et passager qui n'envahit jamais son âme tout entière, qui ne s'exalte pas au point de la tourmenter et de la troubler, et qui n'influe même pas sur le tour habituel de sa pensée. En somme, les forêts ne produisaient sur l'esprit des j Romains qu'une impression de mystérieuse terreur, les montagnes leur semblaient des obstacles permanents aux relations des peuples, et ils n'y voyaient que des repaires de brigands ou des déserts jetés entre les nations policées ; la mer seule, avec sa physionomie changeante et son langage retentissant qui semblent les manifestations d'une vie intense et puissante, la mer qui réunit les hommes plutôt qu'elle ne les sépare, a inspiré à leurs poètes et leurs artistes des sentiments analogues à ceux qu'elle nous fait éprouver. D'autre part, les contemporains de Trajan n'étaient nullement fatigués de leur civilisation. Ce n'est pas pour l'oublier, mais bien au contraire pour en jouir à l'aise, qu'ils quittaient Rome. Ce qu'ils fuyaient c'était la vie forcément collective, et cette promiscuité perpétuelle et fatigante de la capitale à laquelle les empereurs seuls, avec dix ou douze possesseurs de grands jardins, pouvaient se soustraire sans quitter l'enceinte des sept collines. Dans les logements étroits qu'on louait à grand prix dans Rome, la vie semblait comprimée, les réunions un peu nombreuses étaient gênées, le recueillement nécessaire à l'étude était impossible à obtenir[58]. Quant aux besoins essentiels de la vie antique, les bains, les exercices gymnastiques, es jeux, les promenades, on ne trouvait à les satisfaire que dans des établissements somptueux sans doute, et incessamment agrandis pour donner place à une population croissante, mais toujours encombrés néanmoins par une foule bruyante et tracassière. On conçoit maintenant ce que Pline aimait tant dans ces maisons de campagne ; on s'explique le bonheur mêlé de vanité qu'il éprouve à décrire à ses correspondants ces bains si bien installés et si agréables quand on les compare aux piscines publiques de Rome, et ces longues allées de platanes et de vignes où le maitre, promené en litière, entend à peine le bruit des pas de ses porteurs, et ce jeu de paume que personne ne vous dispute, où l'on entre et que l'on quitte au gré de sa fantaisie, et ces bibliothèques, et ces cabinets d'étude où l'on se recueille en silence, et ces triclinia d'où la vue s'étend sur la campagne, et ces salons spacieux où, loin de la présence importune des esclaves, on donne aux épanchements de l'amitié un libre cours, où une société nombreuse peut prendre place commodément pour s'entretenir d'art et de lettres, et pour entendre la lecture du nouvel ouvrage. Nous sommes bien ici dans une maison de ville, plus grande, plus confortable et plus ornée que celles de Rome. Rien n'est trop beau, ni trop rare, ni trop cher pour la décorer : les mosaïques, les marbres précieux revêtent les planchers et les murs. On prend une haute idée du talent des architectes qui avaient su aménager si ingénieusement la distribution de ces grandes villas, donnant à chaque pièce l'exposition la plus convenable et le jour le mieux approprié à sa destination, et faisant servir au bien-être de la vie quotidienne les découvertes les plus récentes de l'industrie[59]. Ces efforts de l'art pour introduire l'agrément et la magnificence dans les habitations particulières, jettent un jour instructif sur l'état des mœurs et sur les habitudes domestiques au deuxième siècle, chez un personnage de la classe moyenne, jouissant d'une fortune ordinaire. Ils sont aussi les témoignages intéressants de l'activité créatrice que la vie romaine avait éveillée chez les artistes, car la simplicité de la vie grecque ne comportait pas un tel développement de l'architecture civile, et ne l'aurait jamais suscité. Des maisons de campagne semblables à celles de Pline se multiplièrent dans l'Occident ; au cinquième siècle on en trouve le type à peine altéré sur le sol des Gaules[60] et, à la Renaissance, elles ont servi de modèles aux villas italiennes quand Scamozzi et San Gallo se mirent à l'école des anciens. Le peu de goût des Romains pour les beautés pittoresques de la nature se fait sentir dans le dessin des jardins de Pline, tracés au cordeau et au compas. Simple auxiliaire de l'architecte, le topiarius avait, sous sa direction, aplani le sol et mutilé les arbres. Le buis, par sa docilité à garder les formes que lui a données la taille, était l'essence préférée pour ces jardins : il y formait des lignes droites ou courbes, il encadrait des parterres contournés en figures d'animaux ou bien dessinait sur le terrain des lettres composant le nom de Pline ou celui de Mustius[61]. A chaque pas, d'ailleurs, on rencontrait une statue, ou une colonnade, ou des eaux jaillissantes. Nous voyons déjà régner ce goût puéril de symétrie et de décoration monumentale qui caractérise les jardins dits italiens ou français[62]. Il n'est pas jusqu'à certains enfantillages des villas romaines ou génoises qu'on ne retrouve dans celles de Pline ; ainsi, au moment où on s'asseyait sur le banc semi-circulaire du stibadium, on faisait jaillir un jet d'eau sur la table de marbre[63]. Les descriptions laissées par Pline ont, en effet, servi longtemps de préceptes aux dessinateurs de jardins. Les rapports étroits qui lient l'architecture à la SCULPTURE ne se manifestent jamais avec une clarté plus grande qu'aux époques où elles se transforment, car les transformations des deux arts sont constamment corrélatives. Au temps de Périclès comme au siècle d'Alexandre, au Moyen Age aussi bien qu'à la Renaissance, leurs progrès, leurs ralentissements, leurs retours en arrière, leurs changements de tendances, sont toujours simultanés et décidés par un seul et même ordre d'idées ou de sentiments. Nous ne serons donc pas surpris de trouver une école de sculpture florissante à côté de l'école d'architecture dont nous avons indiqué l'esprit général et dont nous avons énuméré les créations principales. Comme celle-ci, elle modifie la tradition grecque pour l'accommoder au génie romain. Au huitième siècle de Rome, trois grandes écoles se partagent le domaine de la statuaire, savoir : l'école d'Athènes, celle d'Asie-Mineure et celle à qui nous donnerons le nom de romaine pour spécifier le caractère des œuvres qui en sont sorties. La nouvelle école Attique qui a produit tant de monuments célèbres et signés, parmi lesquels il suffit de citer le Torse, la Vénus de Médicis, l'Hercule Farnèse, le Germanicus, est caractérisée par sa prédilection pour les sujets religieux et pour les grands personnages de la mythologie. Par là, au moins autant que par le lieu de naissance des artistes qui l'illustrèrent pendant deux siècles, elle se rattache directement à l'ancienne école d'Athènes. La nature des sujets traités comportait une certaine tendance à l'idéal : aussi tant que les sculptures de Phidias n'ont pas été accessibles à l'étude, les Apollonius, les Cléomène, les Glycon ont été placés à la tête des maîtres anciens. Mais les marbres du Parthénon ont fait descendre au second rang ces productions si admirées il y a moins d'un siècle. Malgré d'éminentes qualités, on reconnaît aujourd'hui que l'invention y manque et que la plupart de ces œuvres rappellent des types déjà consacrés par l'art[64]. On constate chez les artistes de cette école des tendances modérées à l'archaïsme ou à des essais de combinaison entre les principes posés par diverses écoles ; mais ces tentatives de restauration et de rajeunissement du passé, témoignages honorables des aptitudes d'un peuple admirablement doué pour les arts, ne pouvaient se prolonger longtemps. Cette école disparaît à peu près au milieu du premier siècle de notre ère. L'école d'Asie-Mineure procède de l'école Rhodienne qui a déployé dans le Laocoon, dans le Taureau Farnèse, un réalisme puissant et une grande habileté dramatique. Mais quand la force d'invention commença à s'épuiser, les qualités des Asiatiques se réduisirent de plus en plus à l'habileté technique. Elle est admirable dans le Gladiateur où une science anatomique irréprochable fait ressortir tous les muscles ; elle n'est plus que surprenante dans les Centaures de la villa Hadriana, où l'effet est poursuivi jusque dans les détails les plus délicats. Probablement exécutés pour Hadrien, c'est-à-dire peu de temps après la mort de Trajan, les Centaures nous donnent une idée exacte de ce qu'était sous ce dernier prince l'école d'Asie-Mineure. La dextérité avec laquelle les artistes modelaient les matières les plus rebelles dut leur valoir de nombreuses commandes des amateurs curieux, mais elle n'était pas de mise dans la sculpture monumentale[65]. Celle-ci trouva de dignes interprètes dans la troisième école, qu'on peut faire remonter à Pasitelès[66], artiste d'une activité surprenante, doué d'une merveilleuse variété d'aptitudes, prêt, comme les maîtres de la Renaissance, à traiter toute matière et à essayer ses forces sur tous les points et dans toutes les directions. De Pasitelès à Stéphanos, de Stéphanos à Ménélas, l'art resta à la même hauteur, et on vit se déployer chez ces artistes des qualités communes aux deux écoles dont nous avons parlé plus haut : retour aux bons modèles, respect et imitation intelligente des œuvres anciennes comme dans l'école Attique ; efforts pour saisir la réalité vivante et soins scrupuleux de la forme comme dans l'école Asiatique, sans pourtant que cette poursuite dégénère jamais en tours de force et en manifestations inopportunes d'habileté. A cette école appartiennent certaines créations tout à fait inspirées par Rome, telles que les quatorze statues de peuples vaincus que Coponius exécuta pour le théâtre de Pompée[67] et qui servirent de types à ces représentations de ces prisonniers barbares si nombreuses au second siècle ; c'est à elle aussi que nous devons tant de belles statues d'empereurs et d'impératrices, où la réalité de la physionomie et du costume s'allie si heureusement à la noblesse du maintien et à la vérité de l'attitude ; tant de bustes où l'on trouve à la fois le caractère individuel et l'élévation idéale, admirables commentaires des historiens et des moralistes contemporains, éloquents démentis à la prédiction que Virgile avait mise dans la bouche d'Anchise[68]. On voit se développer sous l'empire une branche encore plus importante de la sculpture. Nous voulons parler du bas-relief, conçu à Rome tout autrement que dans la Grèce. Là, les superficies monumentales décorées par ce procédé n'offrent que des silhouettes de personnages placés à la suite les uns des autres dans une procession ou une cérémonie religieuse, ou bien prenant part à un banquet funèbre, scène si calme qu'on a pu se demander si on était en présence d'un sujet allégorique ou d'une représentation de la vie réelle[69]. A Rome, au contraire, nous trouvons de véritables scènes historiques, dont la complication est rendue sans embarras : les groupes de personnages sont formés naturellement, les mouvements sont rendus avec franchise, toute la composition offre un caractère à la fois exact et pittoresque, et l'artiste sait y jeter la variété, le mouvement et la vie. Cette branche toute romaine de la sculpture commence vers Auguste, et au temps même où s'élevèrent les premiers arcs de triomphe. Dans le bas-relief de Ravenne qui représente l'apothéose de la famille Julia, on saisit déjà le germe des qualités qui vont se développer rapidement ; bientôt, sur les fragments conservés de l'arc de Claude, l'art s'enhardit : il touche à la perfection dans les deux grandes compositions qui décorent les parois intérieures de l'arc de Titus et enfin, sous Trajan, il atteint le plus haut point où la sculpture historique soit parvenue. Laissant aux historiens de l'art la tâche intéressante de faire ressortir, par une étude approfondie[70], l'habileté d'agencement dont les sculpteurs inconnus de cette époque ont fait preuve en imaginant de ranger, sur des plans situés à différentes profondeurs, les personnages qui prennent part à l'action — artifice de perspective grâce auquel chacun, comme dans la peinture, prend son rôle et sa place —, qu'il nous suffise de rappeler ici les bas-reliefs, récemment découverts sur le Forum[71], qui représentent la fondation par Trajan des institutions alimentaires, et la remise qu'il fait au peuple des impôts arriérés dont les créances sont brûlées sous ses yeux, puis la magnifique bataille des Romains et des Daces, coupée d'une manière inintelligente et barbare pour décorer l'arc de Constantin, et enfin la spirale sculptée qui décore du haut en bas la colonne Trajane. Malgré quelques détails oiseux, et d'assez fréquentes négligences, on ne saurait y méconnaître un art réel pour reproduire les scènes militaires : marches, campements, allocutions, batailles, ambulances, convois de prisonniers, scènes de pillage ou de triomphe, tout est rendu avec une précision surprenante et un talent de composition incontestable. Le spectateur ne pouvait manquer de s'intéresser à ces représentations de faits auxquels il avait pris part, ou dont il avait entendu le récit, et que la littérature contemporaine était loin de retracer avec une aussi pittoresque vivacité[72]. Après Trajan, la sculpture en bas-relief resta florissante jusqu'à la mort de Marc Aurèle ; puis elle tomba rapidement, comme on s'en assure par un simple coup-d'œil jeté sur l'arc de Septime Sévère. Bientôt, à mesure que l'architecture périclitait, la sculpture déclina, et quand le sénat voulut élever un arc de triomphe au vainqueur du Pont Milvius, on l'orna de reliefs arrachés à l'arc construit sous Trajan à l'entrée de la Via Appia, restaurée par lui. A l'époque de cette sauvage destruction l'art du bas-relief n'était cependant pas perdu absolument, mais il ne s'appliquait plus qu'à la décoration des sarcophages : d'ingénieux motifs de composition, et une habileté persistante s'y retrouvent, jusqu'à la fin, comme pour témoigner de la puissance de l'école romaine à son origine. Puis on cessa d'orner les monuments funéraires, païens ou chrétiens, et ceux qu'avait embellis le ciseau des derniers sculpteurs furent brisés ou négligés jusqu'au jour où Nicolas de Pise y vint chercher des modèles et puiser l'inspiration qui devait renouveler l'art moderne. |