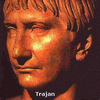ESSAI SUR LE RÈGNE DE TRAJAN
CHAPITRE XVI. — LES LETTRES[1].
|
Une appréciation complète des manifestations de l'esprit humain sous le règne de Trajan est étrangère au plan de cet Essai et dépasserait les limites de ma compétence. C'est un chapitre de l'histoire littéraire qu'on ne saurait isoler sans lui faire perdre la plus grande partie de son intérêt. Les auteurs de cette époque ont été d'ailleurs soumis plus d'une fois à un examen scientifique approfondi[2] et ont servi d'objet à des critiques pleines de finesse qu'il me serait impossible de surpasser et qu'il est inutile de reproduire. Je me bornerai donc à de rapides indications propres à faire sentir comment le caractère des lettres, des sciences et des arts à cette époque se rattache à l'état, esquissé plus haut, des institutions et des mœurs. Au commencement du second siècle, les deux littératures qui servent d'expression à la pensée du monde civilisé présentent un frappant contraste. Celle des Grecs est vivante et riche : dans tous les genres, elle est représentée par des Œuvres qu'on ne peut assurément placer au premier rang, mais qui offrent encore un sérieux intérêt à l'étude et qui témoignent d'une grande activité et d'une émulation singulière dans le domaine entier de nos connaissances. Celle de Rome, à la même époque, est artificielle et mesquine, et porte les signes d'une irrémédiable et prochaine décadence. Elle est, en effet, bien voisine de sa fin, puisqu'après Trajan on ne compte guère comme écrivains, à peu près dignes de ce nom, que Fronton et Apulée. Le contraste s'explique aisément : la littérature grecque s'adresse à un peuple entier au sein duquel elle puise sa substance et sa force, et dont elle exprime les sentiments collectifs, tandis que l'autre n'est plus que l'œuvre de beaux esprits et le passe-temps de quelques oisifs. Le monde hellénique conservait presque tous les traits de sa physionomie primitive, moins saillants sans doute et moins caractérisés qu'à la belle époque de son histoire, mais très-reconnaissables encore. Ce fut une bonne fortune pour la Grèce d'être arrachée par Rome au joug macédonien avant que les successeurs d'Alexandre n'eussent fait disparaître sous le niveau de leur lourd despotisme l'originale variété de ses mœurs, de ses institutions et de ses souvenirs. Chaque ville, rendue libre aux termes du fameux décret de Flaminius, put reprendre sa marche dans la voie d'une tradition non encore effacée et se rattacher à son passé d'une manière étroite. Le don octroyé par les Romains à leurs nouveaux sujets ne me paraît donc pas si insignifiant qu'on le dit communément, et la joie manifestée par les Grecs n'était pas sans motifs. La vie politique n'eut plus et ne pouvait plus avoir la même intensité qu'au temps de Périclès ou de Démosthène, et les intérêts n'ayant plus la même importance, le jeu des institutions devint, en quelque façon, moins dramatique : mais aucun élément de cet admirable organisme respecté par les Romains n'avait péri, et dans ses manifestations plus calmes il gardait son harmonieux caractère. On ne discutait plus sur l'Agora la paix ou la guerre, les lois qu'on y proposait n'avaient pas grande importance, et la comptabilité dont le peuple y prenait connaissance était réduite à la mesure de sa puissance. Mais enfin, chaque cité possédant son autonomie et sa vie propre, il y surgissait fréquemment, à propos de l'élection des magistrats et de l'administration de la fortune publique, des questions qui, après tout, ne se tranchaient que par le vote des citoyens assemblés, et autour desquelles se soulevaient et grondaient les passions d'un peuple mobile : comme autrefois, la foule tumultueuse entourait, interrompait, menaçait l'orateur qui devait faire appel à toutes les ressources de son art et souvent à son courage personnel et à son sang-froid pour la convaincre et pour la calmer[3]. Les relations d'Etat à Etat étaient restées les mêmes, avec leurs formes solennelles, et si les guerres entre Grecs n'étaient plus possibles (ce dont plusieurs se réjouissaient ouvertement, et avec raison), on s'envoyait encore des ambassades, on concluait des traités d'alliance ou d'amitié, on conférait à des étrangers le droit de cité ou la proxénie, tous motifs à discussions et à déploiements d'éloquence[4]. Les habitudes communes à tous les Hellènes, les goûts qui, leur étant exclusivement propres, ont constitué par leur ensemble une sorte de nationalité pour cette race si peu disposée d'ailleurs à former un groupe compacte, ces habitudes et ces goûts ne souffraient sous l'empire aucune atteinte. Les fêtes religieuses les plus anciennes étaient toujours célébrées, avec le rituel consacré, dans les temples restés debout, entourés d'une vénération universelle et enrichis par des donations incessantes[5]. Les combats gymnastiques, si chers aux Grecs, s'étaient multipliés dans toutes les parties du monde où Alexandre avait fondé des établissements, et ils commençaient à se répandre dans les provinces romaines[6], sans que les quatre grands jeux de l'âge héroïque eussent rien perdu de leur vogue et de leur éclat. La gloire de l'athlète vainqueur était aussi enviée et aussi magnifique que par le passé. Les souvenirs patriotiques qui intéressaient chaque république, ou bien la Grèce entière, étaient, les uns comme les autres, perpétués par des cérémonies de l'ancien temps, pieusement maintenues[7]. Sur la monnaie enfin, signe visible d'une souveraineté locale dont les Romains n'éprouvaient nul ombrage, chaque petit Etat reproduisait avec orgueil les monuments célèbres qui le décoraient, les divinités qui le protégeaient, les portraits des grands hommes qu'il avait vus naître. Ainsi, pour un Grec, la patrie était, à peu de chose près, la même sous Trajan que quatre ou cinq siècles avant Jésus-Christ. Dans de telles conditions, l'orgueil national restait entier, et comme si rien de nouveau ne s'était passé dans le monde depuis tant d'années, les Grecs continuaient à ne s'intéresser qu'à leur histoire et à ne s'occuper que d'eux-mêmes. Ils jetaient à peine les yeux sur la littérature latine, et ignoraient même ou feignaient d'ignorer la langue de leurs vainqueurs[8]. Trouvant dans leur propre pays les satisfactions de l'intelligence et celles du cœur, ils ne l'abandonnaient pas volontiers ; quand ils quittaient le bassin de la mer Egée, ce n'était jamais sans esprit de retour. Ainsi nous voyons Plutarque, bien accueilli à Rome, lié avec les personnages les plus considérables, rentrer dans sa petite ville de Chéronée pour s'y marier et y passer la deuxième moitié de sa vie. Les Hellènes qui se fixaient en Italie étaient en général la partie la plus misérable et la moins estimée de chaque nation. Leurs compatriotes les plaignaient si cet exil était forcé, et les accablaient de leur mépris quand il était volontaire[9]. De tout ceci résultait que les Grecs restaient dans leur pays, que les grandes familles, les gens aisés y vivaient à côté du peuple et se mêlaient à lui, et que dès lors la littérature demeura vraiment et profondément nationale, n'ayant à changer ni de sujets ni de formes pour être comprise et goûtée du grand public. Les genres secondaires alors cultivés se rattachent, en effet, à des types consacrés par le temps et par la gloire. Les divertissements laborieux de la pléiade Alexandrine avaient cessé ; on ne versifiait plus guère que de petites pièces, qui venaient prendre naturellement leur place dans cette immense Anthologie dont la formation remonte au plus ancien âge de la littérature grecque et qui a marché d'un mouvement parallèle à celui de cette littérature, se ralentissant et se développant aux mêmes époques, et reflétant fidèlement les variations de la langue et du goût. C'était bien la forme de poésie la mieux appropriée aux esprits contemporains de Trajan[10] et d'Hadrien, raffinés, instruits et sceptiques, mais en même temps elle pouvait être universellement goûtée et amuser toutes les classes de la société grecque, mérite qui manqua toujours aux poèmes savants et tourmentés d'Apollonius, de Callimaque, de Lycophron et autres oiseaux de la volière des Muses[11]. Dans la prose, les sophistes d'Athènes, de Laodicée et de Smyrne, les Hérode, les Polémon, les Ælius Aristide sont les héritiers directs de ces λομοδάίδαλοι qui avaient charmé les contemporains de Thucydide et dont Platon s'était moqué tout en prenant la grâce de leur langage et quelquefois le tour subtil de leur esprit. Les défauts mêmes de la littérature du second siècle sont des défauts grecs. Ainsi les tours de force du genre épidictique, les paradoxes historiques ou philosophiques, si multipliés en ce temps, ont leurs modèles au berceau même de l'art oratoire et leurs règles tracées dans les plus anciens enseignements de l'école[12]. Mais, remarquons-le, en traitant ces sujets puérils, les sophistes dont Philostrate a écrit les biographies ne sortent jamais du domaine grec : c'est dans la mythologie, dans l'histoire des guerres médiques, dans le répertoire tragique ou comique d'Athènes, en un mot dans le fonds familier à tous les hommes de leur race qu'ils puisent leurs inspirations et leurs idées, qu'ils vont chercher les souvenirs et les images propres à enrichir leur matière et leur style. Les détails mêmes des voyages de ces virtuoses de la parole, le cortège de disciples enthousiastes qui les accompagne en tous lieux, les villes mises en rumeur par l'annonce de leur arrivée prochaine, l'appareil théâtral au milieu duquel ils déploient leur éloquence, les défis qu'ils proposent à tout venant, l'admiration mêlée de discussions qu'ils excitent, sont des traits qui ne conviennent pas mieux au siècle de Trajan qu'à celui de Socrate, au bel âge de la philosophie, quand le fils d'Apollodore venait dès l'aube éveiller son ami pour lui annoncer d'une voix coupée par l'émotion que Protagoras était dans Athènes, et le pressait avec tant de zèle et d'ingénuité d'aller, sans perdre un instant, demander à l'étranger des leçons de haute sagesse[13]. On le voit, le goût des choses de l'esprit a gardé, après un si long intervalle, toute sa vivacité, toute sa fièvre, et il court aux mêmes objets pour se satisfaire. Mais cette analogie entre les époques n'est pas le résultat d'une imitation de parti-pris ; c'est l'effet et le signe d'une activité littéraire paisiblement prolongée à travers les siècles. Et comme pour prouver que la force d'invention n'est pas épuisée après ce long parcours, voici quelques genres nouveaux qui surgissent : une dernière floraison nous donne le roman d'amour que Dion encadre dans un récit touchant et simple, puis le roman d'aventures, mêlé à une intrigue mouvementée et complexe dans les Babylonica de ce Jamblique que les conquêtes de Trajan amènent dans le monde occidental. Bientôt le dialogue sera créé et porté à la perfection par Lucien. Enfin, l'esprit de liberté qui ennoblit les productions classiques du génie grec, anime encore celles du temps qui nous occupe ; les compatriotes de ces malheureux dont Juvénal censure si amèrement la servilité font entendre à la cour même du prince des vérités hardies et des paroles généreuses[14], et opposent la majesté de la loi et l'idée de la justice au caprice de César et à son arbitraire si aisément acceptés des Romains. Tandis que la Grèce restait ainsi fidèle à elle-même, l'Occident avait été bouleversé. La civilisation italique et romaine avait disparu pour faire place à la civilisation européenne. D'autres besoins, d'autres sentiments étaient nés et avaient créé d'autres mœurs. C'était un peuple absolument nouveau qui couvrait l'Espagne, la Gaule, la Bretagne, l'Italie et l'Afrique, les Romains d'alors ne ressemblant pas plus aux contemporains de Scipion et du vieux Caton que les Espagnols et les Gaulois civilisés du second siècle aux soldats de Viriathe et de Brennus. Pour cette nouvelle société, il fallait une nouvelle littérature, et celle-ci ne naquit point, ou du moins avorta. Ici se marque bien l'infériorité du génie littéraire de Rome vis-à-vis de son génie politique. Il s'est trouvé, pour défendre et organiser le monde nouveau, des Trajan et des Papinien ; il n'y eut ni un historien pour le raconter, ni un poète pour le chanter et le faire vivre dans le souvenir des hommes, et on chercherait vainement dans la littérature contemporaine l'expression animée ou le tableau fidèle d'une société dont l'érudition seule peut reconstituer péniblement quelques traits. Au stoïcisme, pourtant, revient l'honneur d'avoir essayé la réforme littéraire qu'appelait le nouvel état du monde. A une époque de civilisation avancée et de fusion des peuples, en face de l'indifférence qui gagnait toutes les parties du polythéisme, on attendait une littérature plus dégagée des traditions mythologiques et nationales, qui manifestât, dans le choix des sujets et dans la manière de les traiter, des qualités d'universalité plus grandes, qui fit au monde historique et réel une plus large place. Sénèque et Lucain comprirent les besoins de leur temps et donnèrent à leurs écrits ce caractère d'universalité. Lucain, en écartant la mythologie de son poème, en n'y faisant intervenir le merveilleux que sous la forme toujours acceptable de songes, de pressentiments, de superstitions populaires que le poète rapporte sans les partager, en substituant à la lutte des Dieux le conflit des passions humaines et des intérêts politiques, en analysant plus profondément que ses devanciers le caractère des personnages qu'il met en scène, Lucain innovait dans la voie de la raison et de l'avenir. Sénèque, dans ses tragédies, avec un mérite littéraire infiniment moindre, laisse voir des préoccupations analogues et se tient dans le même ordre d'idées. On ne conçoit donc pas comment ces deux écrivains, chargés de l'épithète de poètes de la décadence, ont été rapprochés de Stace, de Silius Italicus, de Valerius Flaccus, et enveloppés dans le même dédain et la même réprobation, comme s'ils étaient coupables des mêmes fautes. Leurs vues cependant diffèrent absolument de celles qui dirigeaient les versificateurs de la période flavienne. Ceux-ci, sous une inspiration réactionnaire, imitent Virgile et les classiques et se renferment à dessein dans les limites anciennes de l'art, tandis que les premiers se lancent hardiment dans le nouveau et dans l'inconnu. La diffusion et le style tourmenté de Stace sont le produit de ses efforts pour couvrir sous un certain éclat de forme la pauvreté irrémédiable du fond, mais l'enflure et la subtilité des contemporains de Néron trahissent les tâtonnements inévitables des créateurs qui rompent décidément avec le passé. Ces derniers défauts pouvaient disparaître comme l'extravagance et 1& mauvais goût de Hardy et de Mairet, qui ont fait place à la grandeur naturelle et simple du siècle de Louis XIV. Mais laissons cette discussion littéraire et revenons aux faits. Quand la tentative stoïcienne eut avorté sous l'action de causes qui ne me paraissent pas être encore bien définies, et dont la recherche serait intéressante, la littérature latine prit une direction qui devait la mener rapidement à la décadence. En renonçant à se faire l'écho des mœurs, des passions et des idées contemporaines, les écrivains pseudo-classiques de l'époque flavienne et du règne de Trajan se plaçaient du premier coup sur un terrain où le grand et vrai public ne devait pas les suivre. Tout donne lieu de penser qu'ils se résignèrent aisément à cette séparation, et qu'ils envisagèrent sans déplaisir l'idée de faire des lettres et de leur culture le privilège de quelques esprits, dont le petit nombre assurerait d'autant mieux la communauté d'action et l'énergie réformatrice. Il s'agissait de ramener l'âge d'or des lettres romaines en ne prenant de sujets que dans le domaine exploré par les grands maîtres et en glanant après eux, en copiant leurs procédés et leur style et, comme on disait alors, en marchant avec respect et adoration sur leurs traces. On croyait ainsi les continuer, et cette tentative, aussi vaine dans son objet que dans ses moyens d'exécution, se produisait dans un temps où les écrivains du siècle d'Auguste étaient eux-mêmes devenus une autre antiquité qui avait besoin de commentateurs et de scholiastes. Les travaux de Valerius Probus, de Terentius Scaurus étaient déjà indispensables pour assurer le texte et le sens de Virgile et d'Horace, et l'on ne voit que trop, en lisant dans Aulu-Gelle les doutes des plus savants hommes sur les antiquités et sur la langue, quels progrès rapides faisait l'ignorance du passé. Ainsi, sous Trajan, les auteurs latins écrivaient, pour ainsi dire, dans une langue morte. Ce sont des érudits, travaillant pour d'autres érudits. Au reste, leur science n'était pas d'une nature bien relevée ni d'une acquisition fort difficile. Quiconque avait reçu l'éducation générale de l'époque en était suffisamment pourvu : tout homme considérable était lettré, et tout lettré était poète[15]. Mais qui pouvait s'intéresser aux œuvres plus ou moins correctes, toujours prétentieuses et complètement dénuées d'inspiration, que composaient ces pédants ? Personne, excepté les amis de l'auteur, le plus souvent auteurs eux-mêmes et formant tous ensemble une petite coterie. Chacun à tour de rôle, clans des réunions concertées longtemps à l'avance, formées d'un public de choix sur les bonnes dispositions duquel on pouvait compter, écoutait et lisait[16]. Grâce à cet arrangement, le plus mince écrivain était sûr d'obtenir des applaudissements. Les complaisances de son auditoire surexcitaient sa vanité. Mais le talent véritable et original, soustrait au contrôle périlleux et salutaire du vrai public, se déshabituait de tout effort et se contentait d'une certaine habileté technique acquise sur les bancs de l'école et entretenue par un continuel exercice. Ce que deviennent dans de pareilles conditions les hommes de lettres et les lettres elles-mêmes, Sainte-Beuve l'a dit avec sa finesse incomparable, et son étude sur les Soirées littéraires[17], où il visait un autre temps et d'autres périls, se trouve être le meilleur tableau de la littérature latine au second siècle. Les esprits médiocres se complurent dans les succès faciles et les créations banales du dilettantisme ; les mieux doués se gâtèrent vite sous cette influence énervante, et le niveau général des productions de l'esprit baissa avec une effrayante rapidité. Au milieu des compliments qu'ils échangeaient, les auteurs ne laissaient pas que de s'apercevoir du déclin général[18] et ils en cherchaient la cause avec une certaine anxiété. On agitait la question des anciens et modernes. Pline s'en montre fort préoccupé[19]. Quintilien l'avait traitée en se bornant à ce qui regardait l'éloquence[20], et nous possédons la plus grande partie du Dialogue que Tacite a composé sur ce sujet[21]. Plusieurs contestaient la supériorité des anciens, mais, à ce qu'il semble, plus pour faire briller les ressources de leur esprit en soutenant une cause visiblement perdue que par l'effet d'une conviction réfléchie et profonde. Ceux qui reconnaissaient l'infériorité des modernes en cherchaient l'explication dans la transformation des mœurs, le plan d'études imposé à la jeunesse ou le régime politique ; personne n'accusait les lettrés qui ne songeaient qu'à bien écrire au lieu de se mêler à leurs contemporains pour se faire les interprètes de leurs idées et de leurs passions, et donner aux Œuvres d'imagination un but intéressant et un fond solide. Telle est, suivant nous, la cause décisive et profonde de la décadence des lettres latines, déjà visible dès le commencement du second siècle. Comme cette décadence apparaît au moment même où la chute des institutions républicaines est tout à fait consommée, beaucoup de critiques ont considéré le premier fait comme une conséquence du deuxième et imputé le déclin des lettres au régime du principat. C'est ce qu'on appelle juger l'arbre par ses fruits : il est sous-entendu que la littérature est un fruit, un produit direct du gouvernement. Les gens de lettres ont trop souvent avancé la même thèse et même elle est, pour le cas qui nous occupe, en partie soutenue par Tacite[22]. Mais l'histoire montre assez clairement que dans tous les temps et chez toutes les nations, les révolutions de l'art et du goût sont indépendantes des révolutions politiques pour que nous ayons nul besoin de réfuter longuement une opinion trop facilement accréditée. Pendant la période Antonine, les empereurs ne firent sentir leur action sur les lettres que par leurs efforts pour les protéger. L'intention était bonne, le résultat fut insignifiant et devait l'être à l'égard des œuvres produites ; les auteurs, du moins, en retirèrent quelques avantages. Loin de contribuer à leur fortune privée, le régime des cénacles leur imposait certaines dépenses. Pour chaque lecture publique, ils devaient emprunter une maison, faire arranger une salle, louer des banquettes, distribuer des annonces[23]. Ces obligations onéreuses, dont Hadrien les affranchit[24], ajoutaient à la situation déplorablement précaire de ceux qui ne possédaient point de patrimoine, car l'usage ne permettait pas à l'écrivain de tirer profit de ses ouvrages[25], et son existence dépendait absolument d'un patron dont il fallait payer en flatteries les cadeaux et les pensions. Aussi vit-on le protectorat littéraire, et l'adulation qui en est inséparable, prendre au second siècle un développement prodigieux. Sous la République, quand un Fulvius, un Scipion admettaient dans leur intimité Ennius ou Térence, la faveur de ces grands personnages se bornait à une sympathie affectueuse : ils ne subvenaient pas aux besoins de ces protégés illustres plus largement qu'à ceux de leurs autres clients. Mais alors la vie était simple et peu coûteuse à Rome. Nævius et Plaute se passèrent fort bien du patronage patricien ; le théâtre, d'ailleurs, offrait aux poètes une source de revenus assez élevés et, en même temps, un moyen toujours prêt de sauver leur indépendance. Quand l'art dramatique fut délaissé, les nécessités de la vie pesèrent plus durement sur les écrivains pauvres ; or, à ce moment même, Auguste voyait se consolider sa puissance. On sait comment il modifia le patronage des gens de lettres, comment il les rapprocha de lui et se les attacha par des liens plus solides qu'on n'avait fait jusqu'alors. Le système qu'il avait ébauché se développa après lui. A mesure que les grandes fortunes patriciennes disparurent, que Rome se peupla d'étrangers plus indifférents à la littérature latine et moins capables de la goûter, les protecteurs des lettres et des lettrés devinrent plus rares. D'ailleurs ils se mêlèrent aussi d'écrire, et la jalousie de métier vint aigrir les relations entre patrons et clients[26]. Les écrivains se tournèrent donc vers le prince et réclamèrent instamment son appui. Les Flaviens se rendirent à ces vœux pressants ; la dynastie qui donna à l'instruction publique une dotation régulière est aussi celle qui systématisa les subventions aux gens de lettres. Les encouragements donnés à la littérature étaient de deux sortes : tantôt personnels et accordés à l'auteur, par exemple l'exemption de certaines charges ou un don pécuniaire ; tantôt ils s'adressaient aux productions mêmes de l'esprit : c'était alors une récompense décernée au meilleur des ouvrages composés sur un sujet mis au concours. Ces concours littéraires dont on saisit déjà la trace sous Auguste[27], et que Néron voulait développer, prirent sous Domitien une forme plus arrêtée. A l'époque de Trajan, ils étaient dans leur période la plus active. L'institution éveilla plus d'ambitions impuissantes qu'elle ne suscita de talents réels. Certes on ne manquait pas d'esprits médiocres prêts à traiter le sujet banal perpétuellement offert à leur zèle, et trouvant à leur service, au moment voulu, l'inspiration nécessaire à une œuvre telle que l'éloge du prince ou celui de Jupiter Capitolin[28]. Mais il est à croire que l'émotion et la conviction manquaient souvent aux ouvrages couronnés : un poète, un orateur, dignes de ces noms, eussent-ils répondu à l'appel de l'empereur ou aux instructions de son secrétaire ? Le fait qu'un enfant de quatorze ans pouvait obtenir la couronne poétique dans ces joutes quinquennales[29] montre assez qu'on n'y requérait que l'habitude de l'amplification et un certain talent de versificateur. Toutefois aucune œuvre récompensée dans le concours capitolin n'est venue jusqu'à nous : gardons-nous de porter sur ces pièces perdues un jugement absolument défavorable, et rappelons-nous que plus d'un nom célèbre des lettres anglaises figure sur la liste des poètes lauréats. Maladroite imitation des classiques, développement des coteries littéraires, institution des concours, tels sont donc les trois grands faits qui dominent la littérature latine au second siècle et qui ont rendu plus rapide la décadence à laquelle la séparation des lettrés et du public la vouait infailliblement. Mais les mêmes faits, envisagés au point de vue de l'histoire générale, prennent un autre caractère et deviennent d'heureux événements pour l'avenir des lettres. Les cénacles ont eu pour conserver une puissance qui leur manquait pour créer : les défauts que nous avons relevés dans leurs tendances, le souci exagéré du détail, la préoccupation du style, la manie de l'érudition, la vénération superstitieuse ou puérile pour les œuvres et les procédés des anciens maîtres, se trouvèrent d'excellentes qualités pour maintenir en son intégrité le trésor des lettres latines ; le pédantisme de ces petites sociétés a sauvé les ouvrages écrits en de meilleurs temps, en a perpétué l'admiration et l'étude, en a assuré la transmission à la postérité au milieu des invasions du quatrième et du cinquième siècle. Les amis de Pline forment le premier noyau d'une aristocratie que l'on retrouve autour de Symmaque et d'Ausone, aristocratie un peu dédaigneuse, à vues étroites, mais ayant voué un respect inaltérable au passé lorsque tout changeait et chancelait autour d'elle, et donnant ainsi un utile exemple moral en même temps qu'elle rendait à la civilisation de vrais et mémorables services. La protection des empereurs fut également profitable et même nécessaire à la cause des lettres. Assurément le pouvoir était incapable de faire éclore le génie ou de susciter de grandes Œuvres d'art : alors, comme en d'autres temps, il n'a guère inspiré que des vers médiocres et de fades panégyriques. Mais après que la littérature eût été classée parmi les affaires d'Etat, elle devint inséparable de l'idée qu'on s'était formée d'un grand établissement politique. Même dans les temps de misère générale et d'ignorance publique, nulle puissance, privée de l'ornement des lettres, n'eût été pleinement acceptée des peuples : on eût jugé que quelque chose manquait à sa constitution définitive et à sa complète consécration. C'est pour obéir à ce vœu de l'opinion, mal défini mais réel, que les rois goths de Toulouse et de Ravenne eurent des poètes attachés à leurs personnes, et Sighebert, en commandant un épithalame à Fortunat, se piquait de reproduire le cérémonial usité à la cour des empereurs de l'Occident. Ce n'est pas le lieu de poursuivre dans l'histoire cette destinée singulière de la littérature, encore protégée quand personne n'en sentait plus l'utilité ni le charme, et prolongeant son existence par la seule vertu de la tradition romaine et du caractère administratif qu'elle avait pris sous les Césars. Qu'importe la médiocrité des Œuvres écloses à la cour, aux frais de princes ignorants, dirigés par une bienveillance aveugle ou une vanité prétentieuse ? Au milieu de l'abandon universel des arts et des sciences, les lettres, ne périrent pas : on continua d'écrire quand on avait cessé de sculpter et de peindre. Voilà ce qui était utile et nécessaire, pour que, jusqu'à des temps meilleurs, les droits de l'intelligence fussent maintenus au sein de systèmes établis par la conquête et la violence et que, même vide ou mal remplie, leur place y demeurât marquée. Nous ne devons pas perdre de vue ce côté de la question, au moment d'aborder l'étude individuelle des auteurs, où nous aurons à faire à la critique une large part. C'est dans la poésie dramatique de ce temps que se marque le mieux la séparation des lettrés et du grand public. On y distingue deux genres bien tranchés les pièces réellement destinées à la scène, et celles qui n'étaient faites que pour la lecture. La tragédie scénique était réduite tantôt à un monologue lyrique écrit en langue grecque, chanté par un personnage qui ne rappelait plus que par son costume les habitudes de l'ancien théâtre, tantôt à un ballet ou pantomime où les poses et les gestes d'un seul acteur devaient rendre visibles et faire suivre les péripéties d'un épisode emprunté le plus souvent à la mythologie grecque[30]. La musique faisait le plus grand intérêt de la tragédie chantée. Quant à la pantomime, le témoignage des auteurs, particulièrement de Suétone et de Macrobe, et plusieurs anecdotes qu'ils nous ont rapportées, montrent jusqu'à quel degré de finesse et de précision Bathylle et Pylade, puis leurs successeurs, avaient poussé ce genre d'interprétation, quels efforts continuels exigeait leur art, quelle science même était nécessaire à ceux qui l'exerçaient pour exprimer, sans le secours de la parole, des idées de tout ordre et de toute nature. Sous aucune de ces deux formes la tragédie ne produisait l'émotion dramatique ; mais depuis longtemps le public était devenu indifférent à cette émotion[31]. Les deux formes de pantomime que Pylade et Bathylle avaient spécialement cultivées et développées en deux branches distinctes étaient encore en honneur sous Trajan, puisque Plutarque les mentionne et les apprécie l'une et l'autre[32]. Mais la pantomime comique disparut bientôt, car Lucien ne parle que de la pantomime tragique. Les Romains aimaient passionnément la saltatio qui, comme les combats de gladiateurs, avait en Etrurie sa lointaine origine, et qui prit sous Auguste un caractère nouveau, et un développement qui ne devait plus s'arrêter jusqu'à la chute de l'empire. Les mauvaises mœurs des histrions et les désordres de tout genre qu'ils provoquaient éveillaient de temps à autre la sévérité du pouvoir, mais l'expulsion de ces favoris du public n'était jamais bien longue. Domitien les ayant renvoyés, Nerva les rappela, un peu par politique d'opposition[33]. Trajan, qui les avait chassés au commencement de son règne[34], ne tarda pas à les faire revenir, car il partageait à leur égard le goût général et très-vif des Romains[35]. Les pièces de Sénèque nous donnent une idée des tragédies de cabinet, qui furent composées sous Trajan. Ce n'était, comme on le sait, qu'un étalage de sentiments déclamatoires et d'invectives politiques. Après Sénèque, on ne sait guère des auteurs tragiques que leurs noms, sauf pour Curiatius Maternus dont plusieurs tragédies nous sont, grâce à Tacite, connues au moins par leurs titres ; dans Médée, dans Thyeste, et aussi dans quelques sujets romains : Domitius, Caton, Néron il fit tenir à ses personnages un langage hardi qu'il paya de sa tête[36]. Après lui on trouve cités dans Martial un Canins Rufus, un Varron, un Scæva Memor, frère de Turnus le Satirique[37], auxquels l'histoire littéraire ne donne pas de successeurs. Quand on songe à ce qu'était cette tragédie, on conçoit que la satisfaction générale qui régna pendant la période Antonine ait mis fin à cette forme d'opposition politique et enlevé toute raison d'être à ces pamphlets versifiés. La comédie offre également deux groupes de pièces composées les unes en Vue de la scène, les autres pour la lecture. A la scène règne presqu'exclusivement et régnera jusqu'à la fin de l'empire la mime qui conserve son caractère agressif et offre toujours aux Romains un vif attrait par son mélange de grossièreté et d'élégance. Latinus, Panniculus et Thymele étaient alors les meilleurs interprètes de ce genre dramatique[38]. Un passage de la vie chi Domitien, dans Suétone[39], donne lieu de croire que les atellanes étaient encore représentées à la fin du Ier siècle. Pour les lettrés, Virginius Romanus continuait à écrire des comédies imitées de Ménandre[40] et des autres auteurs de la nouvelle comédie athénienne, des palliatiæ, qui ne pouvaient plus être, comme on l'a très-bien senti, que d'ingénieuses et élégantes redites[41] ; toutefois cet exercice littéraire se prolongea jusqu'au siècle suivant comme en témoigne l'inscription tumulaire de Pomponius Bassulus, lequel mit fin à ses jours sous le règne d'Elagabale[42]. Virginius, dans sa lutte contre les modèles grecs, prit aussi pour modèle Aristophane, c'est-à-dire que dans les compositions qu'il lisait à un petit cercle d'intimes, il eut l'audace de nommer des personnages vivants. On peut affirmer que la satire, tempérée d'éloges, que Pline entendit avec tant de plaisir, ne touchait pas à la politique et ne rappelait que de très-loin les libertés du théâtre athénien. Le temps n'a pas épargné les œuvres lyriques composées par les successeurs d'Horace. Quintilien en a fait un bel éloge[43], mais il a dit aussi que les lettres romaines avaient beaucoup perdu à la mort de Valerius Flaccus[44], et un tel jugement, sur un tel poète, décèle une bienveillance qui s'étendait probablement à tous les contemporains et qui est bien propre à modérer les regrets que pourrait exciter la perte de leurs ouvrages. D'ailleurs, deux Silves de Stace[45] nous donnent une idée sans doute assez exacte des compositions disparues de Saturninus, de Spurina, d'Augurinus, de Paulus, de Serenus, de Stella[46]. Ces silves ressemblent plutôt à des exercices de versification sur les mètres alcaïque et sapphique qu'à des œuvres réellement inspirées par des sentiments dont ces formes eussent été l'expression naturelle et nécessaire. Le Pervigiliurn Veneris, ce petit poème composé dans le même temps et dont P. Annæus Florus est vraisemblablement l'auteur, offre une profusion de couleurs qui éblouit à la première lecture et qui passait sans doute au ne siècle pour le produit d'une imagination riche et puissante ; nous n'y voyons aujourd'hui qu'une œuvre froide et laborieusement composée. Les Silves, qu'on peut ranger dans la classe des Œuvres lyriques, puisque plusieurs offrent une évidente imitation d'Horace, fatiguent et ennuient par l'abus de la mythologie et l'emploi, naïvement étalé, de toutes les ressources éprouvées et connues de l'industrie poétique. Ici encore rien d'inspiré ni de vivant : tout sent l'artifice et la manière. Seuls les hendécasyllabes de l'époque montrent une verve facile, et ont pu distraire et intéresser des lecteurs de toutes les classes ; comme Sidoine Apollinaire range sur la même ligne les petits vers de Martial, ceux de Serenus et ceux de Stella[47], on peut admettre que ces trois poètes avaient un mérite à peu près égal, ou du moins que les anciens les tenaient tous les trois en même estime. Nous arrivons aux poèmes épiques dont les deux espèces[48], épopées mythologiques, épopées historiques, sont largement représentées dans la période qui nous occupe. Ces froides imitations d'une poésie plus solide et plus brillante ne sont guère lues et citées aujourd'hui que comme des témoignages de décadence. Pourtant les mythologues, en les compulsant, peuvent y puiser la connaissance de quelques traits des fables grecques dont les récits plus anciens ont péri ; par exemple on ne trouve que dans l'Achilléide les traditions relatives à l'enfance du fils de Pélée et à son séjour au milieu des filles de Lycomède. Une des meilleures preuves qu'on puisse apporter du goût déplorable de l'époque est ce fait, que le plus mauvais poème de Stace est aussi celui qu'il avait le plus assidûment travaillé et que ses contemporains prisèrent davantage. Les Silves qu'il a publiées sans rien changer à son improvisation, l'Achilléide, ébauche inachevée et interrompue par la mort, valent mieux que la Thébaïde. Il n'avait pas fallu moins de douze années pour élaborer ce plan médiocre, accumuler et combiner ces images et ces épithètes sonores, recoudre ces lambeaux du répertoire épique. Dans la masse considérable d'hexamètres que nous ont laissés Valerius Flaccus, Stace et Silius Italicus, on ne rencontre jamais ni l'intervention personnelle du poète, avec ses illusions, ses chagrins ou ses souvenirs, ni une description touchante de la nature, ni une peinture des détails familiers de la vie, ni un trait propre à l'époque et au pays de l'auteur. L'histoire générale n'a rien à y recueillir. Au même moment, lorsqu'il s'agit de célébrer des domestica facta, des guerres qui avaient ému les contemporains, et des victoires qui rappelaient les beaux siècles de Rome, c'est à l'idiome grec qu'a recours un Caninius Rufus[49], donnant par là, et à son insu, une preuve bien manifeste de la déchéance des lettres latines. La seule poésie puissante encore au IIe siècle parce qu'elle a sa raison d'être et son intérêt dans tous les temps, la seule aussi où l'on trouve les traces d'une inspiration libre et personnelle, appartient au genre que les Romains revendiquaient comme national et auquel, en effet, ils avaient toujours apporté une aptitude bien marquée depuis les antiques dialogues fescennins, premiers essais de leur littérature, jusqu'au règne de Néron. II s'agit de la poésie satirique, traitée sous Trajan, par Turnus et Juvénal, dans la forme trois fois consacrée par le génie de Lucile, d'Horace, de Perse. Ce qu'avait écrit Turnus est perdu. Quant à Juvénal, on s'aperçoit trop, en le lisant, qu'il s'était assis sur les bancs des écoles de déclamation et que lui-même déclama la moitié de sa vie. L'exagération de ses doléances et son indignation à froid nous rebutent fréquemment. Les divisions si nettement accusées de chacune des Satires décèlent une composition laborieuse et montrent la trace de procédés appris : nous sommes loin de cet enjouement avec lequel Horace, planant au-dessus du sujet qu'il traite, quitte et reprend sa thèse, et touche mille objets dans son vol capricieux et toujours sûr. Juvénal s'enferme rigoureusement dans son sujet et l'expose d'après un plan très-arrêté : chaque idée est développée jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, chaque type est dessiné jusqu'à l'achèvement complet ; rien n'est laissé à la sagacité ni à l'imagination du lecteur. Bref, un des esprits les plus originaux et les plus vigoureux du siècle ne pouvait ou n'osait se dégager des préceptes de la rhétorique. Mais, par une heureuse compensation, ces mêmes divisions permettent de suivre sans efforts la pensée de l'auteur ; chacun des morceaux est composé avec art, et bien qu'on puisse reprocher à Juvénal plus d'une longueur, il faut reconnaître qu'il tombe rarement dans la banalité ou le lieu commun. Il exprime les idées morales avec une précision incomparable et une rare énergie. La langue, correcte et pleine, est digne des meilleurs temps. Enfin on a affaire à un vrai poète qui anime tout ce qu'il touche et dessine chaque passion, basse ou noble, chaque sentiment, profond ou fugitif, en traits qui se gravent d'une manière ineffaçable dans le souvenir. Ses vues générales sont ordinairement empruntées au stoïcisme, et le vers prend alors une tournure fière et puissante comme la doctrine dont le poète s'inspire. En appréciant, avec une amertume voisine de l'injustice, le changement moral qui s'opérait au sein du paganisme, il a bien reconnu et montré les symptômes de ce changement : invasion des cultes étrangers, déchéance du patriciat, rôle plus considérable pris par les femmes, déplacement de la richesse, en un mot la disparition du monde latin et italique. Tacite n'a pas fait ressortir ce grand fait avec la même netteté et ne l'a peut-être pas aussi bien senti que Juvénal, car à côté de Home il ne voit que les Barbares et ne paraît pas soupçonner ce qui reste de vivace dans la Grèce et dans l'Orient ; c'est justement là ce qui frappe et importune le poète satirique. On a dit que Juvénal avait contribué, par quelques détails obscènes de ses peintures et de son langage, à propager la corruption dont il se plaint. Mais il ne donne ces détails que pour être complètement vrai et produire chez le lecteur une impression forte ; il ne se propose évidemment aucun but excitant ou voluptueux. Echo fidèle de ce temps où il vit et dont il médit, il en découvre, à son insu, quelques beaux côtés : il se laisse aller, par moments, à la pitié et à la tendresse qui gagnaient ses contemporains et il trouve alors, en touchant les fibres les plus secrètes du cœur, des accents dignes de Sophocle et de Térence. N'eût-on conservé de son œuvre que le vers où il dit que le don des larmes est ce qu'il y a de meilleur en l'homme[50], il ferait honneur à son siècle et à son pays. En quittant Juvénal pour Martial, on descend dans la littérature de deuxième ordre, et pourtant Martial fut l'interprète le plus fidèle et le peintre le plus exact de la société polie sous Domitien et sous Trajan. La Rome des Césars semblait vraiment faite pour le tempérament et les mœurs de ce poète, pour sa curiosité malicieuse, ses penchants communicatifs et moqueurs ; là seulement son talent pouvait naître et grandir, et se faire pleinement goûter. Favorablement accueillies dès leur apparition, les Epigrammes ne paraissent avoir procuré à leur auteur ni la richesse ni même l'aisance, mais elles lui donnèrent, dès son vivant, une gloire que l'envie, disait-il, ne cesse ordinairement de contester aux poètes qu'après leur mort[51]. Tant qu'il vécut à Rome, Martial put entendre et savourer les éloges décernés à son talent et assister à l'insuccès de ses imitateurs. Dans un moment de fatigue et d'humeur il quitta la grande ville où l'intérêt de sa réputation, autant que la reconnaissance, aurait dû le retenir ; grâce à la générosité de Pline, il put regagner Bilbilis sa patrie ; au bout de quelques années, il y mourut de nostalgie et d'inaction[52]. La faiblesse des pièces qu'il y composa, et qu'il envoya dans la capitale pour ne pas s'y laisser oublier, montre à quel point la vie romaine soutenait son inspiration et combien elle lui était nécessaire Tour exciter sa verve, et renouveler ses sujets. En effet, Martial ne tire presque rien de lui-même, ni d'une étude profonde de l'homme ; il ne peint que ce qu'il voit et n'aspire qu'à rendre la réalité sensible, mais il la reproduit avec un dessin si net et un relief si puissant que ses petits tableaux intéresseront dans tous les temps par le mérite du style et par les applications particulières qu'ils suggèrent[53]. Il fut le créateur d'un genre nouveau de poésie, car c'est vraiment créer qu'agrandir et régulariser, comme il le fit, le cadre ancien des petites pièces latines plus on moins analogues à son épigramme. Il nomme avec respect ses prédécesseurs : Catulle, Pédon, Marsus et Gætulicus ; mais, ainsi que l'a remarqué Lessing[54], Martial est le premier qui se soit fait de l'épigramme une idée bien nette et bien circonscrite, qui l'ait considérée comme un genre littéraire particulier, méritant qu'un écrivain s'y adonnât exclusivement. Il est donc le premier en date des épigrammatistes, et grâce à cette priorité, il put travailler librement sans que rien vînt contrarier son génie ou limiter son caprice dans ces productions dont la forme n'était réglée ni par la tradition ni par les théories littéraires. La matière des Épigrammes est toujours prise dans la vie quotidienne et réelle. L'heureuse précision du détail, attrait principal de ces poésies, en rend parfois l'intelligence assez difficile, mais leur donne une grande valeur comme documents historiques. Tout ce que dit Martial de la topographie de Rome, des costumes, des repas, de mille petits faits de la vie privée, offre à l'archéologie des éléments précieux d'étude ou des problèmes bien définis à résoudre. En outre on trouve ici, comme dans l'œuvre d'Horace, les éléments épars d'une biographie du poète assez complète[55]. Martial éprouvait un mépris profond pour ces ennuyeux poèmes mythologiques dont les bons esprits étaient déjà las sous Auguste et que des écrivains impuissants ou maladroits offraient sans relâche à un public indifférent[56]. Il dédaignait aussi les nugæ difficiles[57] ; tours de force littéraires très-goûtés alors, et auxquels ses confrères de la schola poetarum[58] consacraient leurs veilles laborieuses. Désireux de se rendre intelligible au savant comme à l'ignorant[59], il fuyait avec un soin extrême le pédantisme et tout ce qui peut lui ressembler. Lessing a remarqué qu'il n'est pas de poète latin des œuvres duquel on puisse extraire un aussi petit nombre de maximes générales. Mais les faits particuliers y abondent, aussi bien que les peintures de mœurs et de caractères. Toute la société du temps vit et s'agite dans ces petits poèmes courts et bien tournés, toutes les conditions y figurent, toutes les passions s'y expriment. Bref cette poésie, peu idéale, est toujours humaine[60]. Les sentiments les plus délicats[61] s'y font jour à côté des manifestations les plus grossières ; parfois même une note mélancolique résonne au milieu des propos joyeux ou libres, et entre deux plaisanteries on rencontre une inscription composée pour être gravée sur un tombeau. La variété des mètres est heureusement appropriée aux sujets, et la langue familière et simple de Martial leur convient aussi beaucoup mieux que le ton magnifique et tendu de Juvénal, prenant sa grande voix pour attaquer des gens et des choses qui ne méritaient qu'un bon mot. Cette recherche du vrai dans les sujets et dans le style, cet abandon calculé des thèmes habituels et des formes savantes révèlent chez Martial des vues bien différentes de celles qui dirigeaient les écrivains contemporains, et sont les traits caractéristiques de son originalité. Le contraste frappant qu'offraient les épigrammes avec les poèmes du même temps ne contribua pas moins à leur succès que les observations piquantes et les mots heureux dont elles fourmillent. Elles remplacèrent l'ancien théâtre comique, les togatæ, les trabeatæ, les tabernariæ[62], peintures de toutes les classes du peuple romain, qu'on applaudissait cent ans plus tôt. Avant de quitter Rome, le proconsul que ses devoirs appelaient pour trois ans au fond d'une province, l'officier qui allait s'enfermer dans un camp sur les bords du Danube ou dans les montagnes de l'Ecosse[63], ne manquaient pas d'emporter le petit volume, et au loin, quand ils le rouvraient, la ville, à regret quittée, apparaissait à leur imagination et se dessinait à leur souvenir, animée et vivante, avec ses aspects pittoresques, ses palais, ses temples, ses rues immenses, sa population cosmopolite et affairée et tout le pêle-mêle de ses habitudes journalières et de ses bruyants plaisirs. A Rome, aussi bien que dans les grandes cités qui se modelaient sur la capitale, Martial était dans toutes les mains[64]. Un succès aussi éclatant et aussi rapide ne s'expliquerait pas si le génie de l'auteur et l'esprit général de son œuvre n'eussent répondu, dans une certaine mesure, au goût de ses contemporains, ou du moins au goût de cette partie du public qui lit beaucoup et qui détermine le ton habituel et les tendances de la littérature courante[65]. En demandant à la lecture préférée de la société d'alors quelques révélations sur son caractère et sa vie intime, on ne sort donc pas des limites d'une induction permise. Mais si nous apportions dans cet examen la sévérité et la délicatesse modernes, il faudrait reconnaître que la société du IIe siècle, envisagée par ce côté, mérite un jugement rigoureux, et peu compatible avec celui que nous avons émis plus haut en nous appuyant sur un autre ordre de faits. Quatre ou cinq défauts énormes nous froissent péniblement dans son livre favori et ont empêché qu'il ne prît place au nombre de ceux qu'on relit sans cesse. L'obscénité des sujets et du langage[66] y dépasse tout ce qu'a osé la littérature antique, pourtant si peu scrupuleuse à cet égard, et décèle des mœurs restées étrangement grossières au milieu des élégances d'une civilisation très-avancée. Par des affinités que le moraliste explique aisément cette grossièreté touche à la cruauté, et Martial ne prend pas la peine de se cacher à cet égard ; la compassion qu'a ressentie Juvénal, et qui lui a dicté des vers si touchants sur le sort des pauvres et celui des esclaves, semble étrangère à l'auteur des Épigrammes : les supplices lents et raffinés, que subissent les criminels condamnés à jouer dans l'amphithéâtre des rôles mythologiques ou historiques entraînant la mort, ne lui inspirent que des propos agréables et des traits d'esprit[67]. La bassesse et l'indécence des flatteries qu'il adresse à l'empereur[68], et les adulations dont il accable ses patrons, ne sont pas moins choquantes que les violentes invectives qu'il lance à ses adversaires[69]. Que dire enfin de ses perpétuelles et impudentes demandes d'argent[70], de sa mauvaise humeur quand il ne reçoit pas ce qu'il espérait, des menaces qu'il fait entendre à ses amis lorsqu'ils ne s'exécutent pas assez vite[71] ? Certes la littérature française n'a pas toujours reculé devant les sujets scabreux, et nos grands poètes se sont montrés assidus courtisans et intrépides solliciteurs, mais chez eux, au moins, le tour ingénieux de la pensée, la finesse et la grâce du langage déguisent ce qu'il y a de répréhensible ou de blâmable au fond, et forcent presque à pardonner ces attaques aux bienséances et à la dignité humaine. Si Martial n'a pas soulevé chez ses contemporains de répugnances pareilles à celles qu'il nous fait éprouver, on en doit conclure que les défauts dont son livre témoigne étaient fort communs dans la société au milieu de laquelle il a vécu. Cependant il ne faut pas oublier que chez les anciens, à Athènes comme à Rome, la littérature fut habituellement plus immodeste que les mœurs ; pour ne pas sortir du temps dont nous nous occupons et de la société que fréquentait Martial, nous savons que Pline (lui-même nous l'apprend) composait par passe-temps des vers assez licencieux sans se compromettre aux yeux de ses amis ni aux siens propres[72] : on se référait à la distinction que Catulle avait nettement posée entre le caractère de l'auteur et les allures de l'écrivain[73], et l'honneur était sauf[74]. Extrêmement éloignés de notre politesse, les anciens ignoraient d'ailleurs les ménagements à garder vis-à-vis d'un adversaire quand on prend le public pour juge d'un désaccord : en ce cas, ils s'exprimaient avec une sincérité et une passion qui nous révoltent, mais qui ne produisaient pas alors un aussi grand effet. Martial fut même vanté pour la douceur de son commerce : c'était, dit Pline, un homme de talent fin et passionné, qui écrivait d'un style piquant et amer, mais sans méchanceté[75]. Ainsi la violence de son langage n'implique nullement les habitudes grossières qu'elle caractériserait aujourd'hui. Quant aux formes adulatrices qui nous blessent, elles ne dépassent guère, il faut aussi le reconnaître, celles que le style officiel de ce temps-là avait rendues obligatoires et banales, et qu'on rencontre en maint passage du Panégyrique et de la correspondance de Pline. En somme, Martial n'est pas une exception parmi les hommes de son époque, ni ceux-ci ne sont une exception dans la société antique. Le livre où nous les voyons peints sous le jour le moins favorable est un témoignage précieux, auquel son mérite littéraire assigne un place très en vue parmi les documents contemporains ; mais l'histoire ne doit pas le consulter à l'exclusion de tous les autres témoignages, et l'équité exige d'ailleurs qu'on se place, pour le juger, au point de vue où se plaçaient les Anciens. L'époque dont nous nous occupons est pour la philosophie une période d'amoindrissement et de langueur. Chaque école avait épuisé son principe et cessé de chercher la vérité ou de combattre méthodiquement les écoles rivales : celle d'Aenésidème demeurait seule active au milieu des ruines amoncelées de toutes les autres. Le célèbre sceptique était mort dans le courant du e siècle, et ses disciples perfectionnaient les objections qu'il avait imaginées contre le dogmatisme, objections que Sextus Empiricus devait systématiser cent ans plus tard et que Lucien a revêtues de formes si mordantes et si ingénieuses. Toutefois le discrédit jeté par le scepticisme sur tous les essais spéculatifs provoquait, par une réaction naturelle, un courant de mysticisme déjà sensible. Les parties les plus téméraires de la philosophie de Platon étaient en faveur, et la vogue était surtout au Pythagorisme. Les progrès des sciences mathématiques et de l'astronomie, le goût chaque jour plus répandu de la musique ramenaient à cette école de nombreux disciples ; le régime bizarre qu'elle leur imposait, le mystère et les formes symboliques dont elle enveloppait son enseignement, exerçaient une séduction facile à concevoir sur les esprits curieux et inquiets de la génération contemporaine de Trajan. On comprend quelle influence exerça dans cet état particulier des âmes Apollonius de Tyane dont la vie, à peine éteinte, prit immédiatement une couleur légendaire[76]. Si l'on voulait rattacher Plutarque à une école déterminée, il faudrait le ranger au nombre des platoniciens ; mais on ne saurait, en vérité, voir de la philosophie dans ce déploiement d'une érudition abondante et diffuse, où les contradictions fourmillent, où aucune doctrine ne domine les faits. Le recueil des Œuvres Morales du philosophe de Chéronée, précieux par les milliers de renseignements, de traditions, de citations qu'il fournit, offre, dans son désordre même et dans son incohérence, une représentation fidèle de la crise que traversait la philosophie et laisse deviner à quel résultat cette crise devait aboutir : la curiosité universelle et mal réglée de l'auteur, l'interprétation allégorique des mythes, l'addition au fond grec de notions égyptiennes et orientales, les détails fabuleux mêlés à l'histoire des anciens philosophes, nous montrent dans quel sens seront dirigés les efforts des fondateurs de l'éclectisme, sur quel terrain sera semée la nouvelle doctrine et quelle physionomie elle revêtira. Mais au moment où nous sommes, l'étude des grandes questions était abandonnée. L'école du Portique, la mieux goûtée à Rome et dans les grands centres, repoussait de plus en plus cette étude pour borner la philosophie à l'amour et à la pratique de la vertu, et réduire le rôle des philosophes à celui de prédicateurs populaires de morale[77]. S'adressant à des hommes qu'avaient lassés les argumentations subtiles des philosophes spéculatifs, ainsi que leurs disputes stériles et scandaleuses, les stoïciens proclamaient, avec trop de zèle peut-être, l'inutilité des discussions approfondies et des lectures étendues. Epictète dissuade ses auditeurs de passer trop de temps et de donner trop d'attention à la méditation et à l'intelligence des Œuvres de Chrysippe. Dion[78] déclare que c'est la raison naturelle, et non le savoir, qui constitue le philosophe. Euphrate, au grand étonnement et presqu'au déplaisir de ceux qui l'écoutent et aimeraient à trouver dans la philosophie un prétexte à de nobles et studieux loisirs, enseigne que la plus belle partie de la vertu est de travailler à l'intérêt public, et de réaliser dans toutes les branches de l'activité humaine ce que l'on croit juste et vrai[79]. Plusieurs de ces sages refusaient de publier leur doctrine, et nous ne connaissons leur enseignement que grâce au zèle de leurs disciples. Encore les traités dogmatiques avaient-ils fait place aux Άπομνημονεύματα[80]. Le goût de la prédication populaire devint si vif que Plutarque composa un traité pour rappeler aux philosophes que les princes et les grands ne méritaient pas, après tout, d'être absolument délaissés[81]. En rendant leur doctrine humble et aisément accessible, en élaguant toute matière sujette à controverse, les stoïciens pouvaient agir sur un grand nombre d'âmes. Ils frappèrent, en effet, les imaginations par le tour hardi de leur parole, par leur vie errante, par leur costume pittoresque ; ils s'ouvrirent les cœurs par leur éloquence familière. Ils remuèrent dans toutes ses profondeurs le monde civilisé et firent passer dans les idées courantes, dans les institutions et dans les lois un esprit nouveau et des vues fécondes[82]. Malheureusement leurs allures avaient ainsi revêtu un air de charlatanisme qui empêchait de distinguer les jongleurs impudents et paresseux des amis de la vérité : le paphlagonien Alexandre est contemporain de Démonax. Le mépris que les premiers inspiraient à tout homme de bon sens et d'honneur finit par atteindre injustement les autres : Lucien les confondit dans ses attaques, et s'efforça de les discréditer tous à la fois. . Les discours de Dion Chrysostome sont, pour une bonne moitié, œuvre de philosophe plus que d'orateur ; il y faut voir des essais sur divers sujets de morale et de goût traités sous la forme d'allocution fictive[83]. Mais plusieurs furent réellement prononcés sur des places publiques et dans des théâtres, en présence d'auditeurs nombreux et attentifs. La réputation immense de Dion, attestée par ses biographes, et le surnom même que l'admiration publique lui avait décerné, nous autorisent à le regarder comme le premier orateur grec du deuxième siècle. Au reste nous pouvons contrôler les éloges que Philostrate[84] et Synesius[85] ont faits de lui : ses harangues aux habitants d'Alexandrie, de Tarse, de Nicomédie, aussi bien que les discours apologétiques qu'il prononça devant les Prusiens, ses compatriotes, pour justifier divers actes de son administration et de sa vie publique, nous offrent des accents d'émotion vraie, des mouvements passionnés et une dialectique pressante qui assignent à Dion la première place au-dessous des orateurs d'Athènes. Mais on se tromperait en étendant aux œuvres perdues de ses contemporains l'impression favorable que l'on emporte de cette lecture, car les circonstances avaient singulièrement contribué à la formation du talent de Dion, et furent ses vrais maîtres d'éloquence. A l'école des sophistes, il avait appris à discourir élégamment sur toutes choses, et il était devenu le premier d'entr'eux par le tour ingénieux qu'il donnait à ses éloges fictifs et à ses paradoxes[86], lorsque la philosophie, s'emparant de lui, vint donner à sa vie et à sa pensée une direction plus sérieuse et un but plus noble. Bientôt la persécution de Domitien le jeta hors de l'Italie, les fortunes diverses de l'exil le conduisirent chez les nations les plus éloignées, le mirent en contact avec toutes les classes sociales, le réduisirent à gagner sa vie par le travail de ses mains. Puis l'amitié de Nerva et Trajan le rappela à Rome : il fut admis dans l'intimité de ces princes passionnés pour le bien public, il entra dans leurs conseils et il y prit l'habitude et le goût des grandes affaires. Enfin il retourna dans sa patrie : là, il lui fallut combattre l'ingratitude de ses concitoyens, la haine d'ennemis acharnés et puissants, et répondre chaque jour à la calomnie par des faits précis et des exposés exacts. Sous le sentiment de ces nécessités impérieuses, son éloquence se dégagea naturellement de l'emphase et du mauvais goût et prit quelque chose de plus mâle et de plus serré. Mais dans les cas où il a abordé un sujet ne comportant qu'un intérêt littéraire et philosophique, il n'a pas su, ni peut-être voulu, s'affranchir complètement des défauts de son temps, bien qu'ici encore il joignit à l'habileté oratoire et à la facilité de parole qu'il devait à son éducation première, un fonds d'expérience personnelle et de connaissances positives' qui manquaient nécessairement à Isée et à Nicétès[87]. Sauf le Panégyrique dont nous parlerons plus loin, les monuments de l'éloquence latine sous le principat de Trajan ont péri. Nous ne pouvons donc nous rendre un compte bien clair de cette décadence qu'ont déplorée les contemporains. L'intéressant Dialogue où Tacite en décrit les effets et en recherche les causes est lui-même mutilé ; ainsi les pièces du procès nous manquent et l'acte d'accusation est incomplet. Tacite[88] explique avec autant d'élévation que de justesse comment les nouvelles conditions de la vie sociale et du régime politique rendant le talent de la parole moins nécessaire à quelques égards, sa puissance fut par là même amoindrie. J'oserai dire, pourtant, que dans le résumé de la question fait par Maternus, les différences entre les temps anciens et celui où il vit me semblent un peu exagérées. Par exemple ce droit d'accuser les hommes les plus puissants[89] qui, au septième siècle de Rome, stimulait l'orateur et enflammait son génie, n'était pas perdu cent cinquante ans plus tard : on connaît assez l'effroyable usage qu'en ont fait les délateurs. Ceux-ci, à leur tour, n'avaient souvent pour arme défensive que leur parole quand, à l'avènement d'un nouveau prince, chacun se mettait en mesure de venger ses amis[90]. Les procès politiques avaient autant de retentissement que par le passé ; malgré les réformes apportées dans le gouvernement des provinces, Cicéron aurait encore trouvé l'occasion de prononcer des Verrines sous les Césars, et Pline compte quatre beaux procès de concussion parmi ses triomphes[91]. Ainsi, les grands sujets ne manquaient pas à l'éloquence, et sa décadence n'est pas imputable à la pauvreté du fond. Mais, ce que Maternus ne dit pas, elle était énervée et dénaturée par l'effet de cette séparation entre les lettres et le peuple qui stérilise alors toutes les branches de la littérature latine. Cicéron s'adressant à des auditeurs de toutes conditions et de tous métiers, à des esprits très-inégalement cultivés, ne pouvait agir sur une pareille foule, la saisir et l'entraîner, que par la lucidité de son plan, la clarté de ses récits, l'ordre logique de ses preuves, l'appel réitéré aux grandes passions, en un mot par l'emploi de tout ce qui fait la véritable et solide éloquence. Quel que fût son penchant naturel à faire valoir sa science et son esprit, l'orateur devait rester dans les hautes régions de l'art ; les longues études préparatoires auxquelles il s'était livré ne tendaient qu'à le rendre maître de moyens puissants et simples pour convaincre et pour toucher. Quand ces grandes luttes oratoires furent portées dans la curie, il semble que les cinq ou six cents sénateurs[92] spectateurs et juges du combat, formaient encore un public assez imposant pour donner du prix au succès : les orateurs modernes ont rarement un plus nombreux auditoire. Mais si leur voix s'arrête matériellement à l'enceinte du parlement et du tribunal, elle finit, au moyen de la presse, et grâce au développement de l'instruction générale, par arriver jusqu'au peuple, et ils se retrouvent ainsi, comme l'orateur antique, placés au milieu de conditions difficiles, mais salutaires, où leur talent, soumis aux jugements les plus divers et contraint à de perpétuels efforts pour ne pas déchoir, va grandissant et se fortifiant. Au contraire, les discours prononcés dans le Sénat par Pline ou Tacite passaient ensuite sous les yeux des lettrés : tous, orateurs, auditeurs et lecteurs, avaient fait les mêmes études sous les mêmes maîtres et vivaient ensemble, dans une communauté complète d'habitudes, de goûts et de préjugés. L'orateur était donc dispensé de tout effort pour amener ceux qui l'écoutaient ou le lisaient à partager ses sentiments ou ses idées : il n'avait plus de principes à développer, de grandes passions à soulever, de convictions rebelles à forcer, et il ne pouvait atteindre le succès auquel il aspirait qu'en flattant le goût du jour, en multipliant les pensées ingénieuses, les tours de phrase élégants, ces fleurs, ces beautés de langage[93] qu'admiraient et que demandaient les connaisseurs. Messalla, dans le Dialogue, assigne d'autres causes au déclin de son art. Il incrimine la paresse des jeunes gens, la négligence des parents, l'ignorance des maîtres, l'oubli des anciennes mœurs. Ici, j'oserais encore dire que ces accusations un peu vagues, et développées d'une manière inégale, ne me paraissent pas suffisamment prouvées. Que les mères aient cessé d'allaiter leurs enfants, ce fait est étranger aux diverses formes d'éloquence. Ces enfants songeaient aux courses de chevaux, aux gladiateurs, aux pantomimes plus volontiers qu'à leurs études : il n'y a là rien de bien extraordinaire et je cherche comment une disposition si naturelle put exercer une influence décisive et funeste sur les destinées de l'art. Leurs études manquaient de solidité : ici nous touchons au point essentiel et nous nous trouvons en présence d'un fait important ; Suétone[94] se plaint aussi de l'abaissement ou plutôt de la disparition des études de grammaire, c'est-à-dire des études littéraires méthodiques et approfondies : le temps qui leur était judicieusement réservé dans l'ancien système d'éducation était maintenant consacré à l'exercice abusif et prématuré de la déclamation. Cette substitution n'est pas le fait des élèves, mais celui des parents et des maîtres, et elle est imputable plutôt à la vanité de ceux-là et à la condescendance de ceux-ci au goût du jour, qu'à leur négligence ou à leur ignorance[95]. La déclamation, d'ailleurs, n'entraînait pas toutes les conséquences funestes dont se plaignent habituellement les historiens de la littérature. Ils ne sont, dans ce cas, que les échos des anciens ; mais le témoignage de ceux-ci ne doit pas être accepté sans réserves. Les sujets des suasoriæ et des controversiæ n'étaient pas toujours ridicules comme ceux qu'allèguent à l'appui de leurs plaintes Pétrone et Tacite. Les questions débattues n'étaient pas nécessairement fictives, et les discussions relatives au dessèchement des marais Pontins, à la création d'un port à Ostie, au percement de l'isthme de Corinthe pouvaient éveiller des idées justes et provoquer d'utiles recherches ; elles répandaient dans le public des notions utiles sur l'opportunité et sur les difficultés de ces entreprises, et l'on doit croire qu'elles furent prises en, considération dans les mesures prises sur ces divers sujets, par le Sénat ou l'Empereur. Dans les Controversiæ se présentaient souvent, comme on l'a remarqué[96], des points de droit où il devenait nécessaire de remonter à l'esprit d'une loi, d'en peser les termes ou d'en provoquer la réforme : les déclamateurs ont pu travailler ainsi à la diffusion des doctrines philosophiques et déterminer ce courant d'opinion publique sous la pression duquel les jurisconsultes des deuxième et troisième siècles commencèrent à tempérer la rigueur et l'âpreté de l'ancien droit. Enfin, il y a de l'exagération à soutenir, comme l'ont fait les anciens, qu'un jeune homme, pour avoir traité des sujets fictifs sous la direction d'un maître, sera, plus tard, incapable d'aborder et de traiter des sujets réels. C'est un apprentissage auquel tous les orateurs de' l'époque républicaine s'étaient soumis sans compromettre leur talent ni leur gloire[97]. Seulement, la déclamation était l'essai et non l'emploi & leur force. A qui imputer le changement survenu à cet égard dans l'opinion et dans les habitudes ? sinon aux lettrés, qui se donnaient pour les imitateurs des anciens, et pourtant osaient dire que ces exercices d'école constituaient un usage de la parole plus noble et plus raffiné que son emploi à la défense des intérêts privés et publics. C'est Pline qui loue Isée de ce qu'à l'âge de soixante ans il n'avait pas quitté les bancs de l'école : on le félicitait de n'avoir pas défloré sa délicatesse au contact des réalités[98]. Qu'on s'étonne, après cela, de l'importance que les parents et les maîtres attachaient à faire acquérir aux enfants une élocution brillante et un débit facile, seules qualités prisées des amateurs d'éloquence. Tout conspirait à dégoûter les jeunes gens des études solides et à leur faire perdre de vue les règles et le but de l'art qu'ils cultivaient. Pline déclare que l'éloquence judiciaire est perdue et anéantie[99]. Il nous dévoile les manœuvres de certains parleurs du barreau : on entendait là des jeunes gens qui venaient plaider sans préparation, sans connaissances juridiques, ne se souciant point, d'ailleurs, de l'intérêt de leur client et ne mettant au service d'aucune conviction leur faconde retentissante. Ils ne cherchaient qu'un succès bruyant, et cela par des moyens étrangers à l'art oratoire. Ils achetaient, à beaux deniers comptants, des auditeurs qu'un entrepreneur se chargeait de recruter par la ville et de réunir dans la basilique où se jugeait le procès. A son signal, les approbateurs enrôlés faisaient retentir les voûtes de leurs applaudissements et de leurs cris. Leur enthousiasme troublait tout un quartier et empêchait l'audition des affaires dans les tribunaux du voisinage. Assurément, ce charlatanisme perdait l'art : mais étaient-ils bien propres à le maintenir dans sa voie véritable, ceux qui, pour s'accommoder au goût du jour, mettaient de la poésie dans leurs plaidoyers et y enchâssaient des morceaux brillants et des pensées ingénieuses que l'auditeur pouvait retenir et citer[100] ? Certes, ils ne le compromettaient pas moins gravement. De cette époque, il ne reste aucun morceau du genre que les anciens appelaient délibératif. Pline, dans sa correspondance, n'apprécie littérairement aucun discours prononcé dans le Sénat sur les questions administratives et politiques : il est donc à supposer que les orateurs qui traitaient alors les affaires publiques ne se préoccupaient pas, autant que les avocats, des recherches du style, et qu'ils avaient conservé ce tour de parole naturel et simple, ce minor apparatus qui, au temps de Cicéron, caractérisait l'éloquence sénatoriale[101], et que l'on retrouve encore dans le discours de l'empereur Claude[102]. Dans le genre épidictique, les éloges funèbres avaient
gardé leur physionomie antique, cette brièveté excessive qui leur donne un
cachet incomparable et tout romain de sévère grandeur[103]. Mais le Panégyrique,
qui occupe une si grande place dans la vie littéraire et politique de Pline,
et qui, lu devant les meilleurs juges du temps, fut refondu et travaillé avec
tant de persévérance, offre un tout autre caractère. Il y faut distinguer la
forme et le fond. On croirait difficilement, si l'auteur ne nous l'attestait,
que nous devons y chercher les marques d'une tentative faite en vue de
ramener l'éloquence au bon goût et à la simplicité. Il paraît que les
endroits traités avec le style le plus sévère sont ceux qui furent aussi le
plus approuvés des connaisseurs[104] : Pline est à
la fois étonné et fier de son succès. Nous avons peine à retrouver ces
beautés sévères et nous sommes choqués, au contraire, des flagorneries
énormes, des louanges monotones, du style artificiel et maniéré. Il ne faut
pas oublier, toutefois, que le discours prononcé au Sénat devant Trajan
n'était qu'un remerciement fort court : ce que nous lisons est une
amplification de l'original, qui fait peu d'honneur au goût de Pline et aux
habitudes littéraires du temps, mais qui du moins laisse intactes la dignité
de l'auteur et celle de l'empereur. Il faut reconnaître aussi que l'intention
de l'orateur était bonne : il met presque toujours un conseil sous la louange
et tempère les flatteries par des leçons. La manière dont il parle de
Domitien faisait comprendre à Trajan comment il serait lui-même traité, le
lendemain de sa mort, s'il gouvernait despotiquement. Il fallait assurément
une certaine hardiesse pour dire à un prince tout puissant : Souviens-toi de ce que tu pensais, de ce que tu disais
quand tu étais comme nous, sujet d'un maître absolu, et vivant dans les
alarmes. Car Pline ne cache pas à Trajan qu'il prétend lui donner des
conseils[105]
et que l'audition par le prince de son propre éloge constitue, entre lui et
le Sénat au nom duquel parle l'orateur, une espèce de contrat. Le
panégyrique, compris de cette façon, devenait donc une sorte d'Adresse,
souvent renouvelée[106], dans laquelle,
en gardant les ménagements nécessaires, on pouvait faire entendre à
l'empereur des réclamations et des remontrances. Les flatteries prodiguées
par l'orateur devaient ainsi faire passer des vérités importantes, et
consolider une utile institution politique. Par ces ingénieux détours, un
prince libéral et un bon citoyen faisaient tourner à l'avantage public un
usage fondé par l'esprit de courtisanerie et perpétué par la servilité. On
peut facilement croire que jusqu'à la mort de Marc-Aurèle, l'actio gratiarum de chaque nouveau consul servit
ainsi d'expression au vœu public. Mais, depuis Commode, les progrès du
despotisme s'unirent à ceux du faux goût pour dénaturer le caractère et la
forme de ces discours. Les empereurs n'acceptèrent du panégyrique
traditionnel que le tribut d'éloges invariablement décerné au prince régnant,
et ils n'auraient pas souffert les leçons discrètes et les vœux respectueux
qui s'y joignaient dans les temps de liberté publique : les auteurs du IVe
siècle n'imitèrent, de Pline, que les éloges hyperboliques et le style
ampoulé, et se gardèrent de lui prendre la hardiesse civique et les
courageuses inspirations. Les Lettres de Pline offrent, il en convient lui-même, moins d'intérêt que la correspondance de Cicéron[107]. Celui-ci, nous dit-il, indépendamment des ressources de son génie, trouvait dans la diversité des événements et dans leur importance une matière abondante. Il n'a pas relevé une autre différence, encore à l'avantage de Cicéron et qui consiste en ce que les lettres de celui-ci, non destinées à la publicité, ont un cachet de franchise et une saveur de sincérité que la moindre préoccupation littéraire eût fait disparaître. Au contraire, les préoccupations de cette espèce dominent entièrement Pline quand il écrit à ses amis. Il avait formé le dessein de réunir et de publier sa correspondance[108] ; et l'on sait à quelles révisions scrupuleuses et répétées il soumettait ses moindres ouvrages avant de les abandonner à leur destinée. Nous pouvons donc affirmer que chacune des lettres fut copiée en autant d'exemplaires que Pline comptait d'amis parmi les gens de goût, que chaque copie lui fut renvoyée avec des observations critiques, et que la forme définitive sous laquelle nous la lisons ne fut adoptée qu'après de longs et consciencieux débats[109]. Quoi qu'il en soit, la Correspondance est, dans la pénurie des témoignages historiques contemporains, un document de grande importance et un type intéressant de la prose latine. Elle jette peu de jour sur les affaires du temps, mais elle fait très-bien connaître Pline, qui s'y dévoile ingénument. L'homme s'y montre bien supérieur à l'auteur. Sa vanité est souvent ridicule : il ne nous laisse ignorer ni ses succès littéraires, ni les bontés que l'empereur a pour lui, ni les bienfaits dont il comble ses amis et ses compatriotes ; mais il est aussi heureux des succès d'autrui que des siens propres, il loue les autres aussi volontiers qu'il se loue lui-même, il n'épargne pour les obliger ni son argent, ni son temps, ni sa peine, ne voulant pour récompense que le droit et le plaisir de s'en vanter. Personne ne s'est jamais intéressé plus vivement aux lettres et à ceux qui les cultivent, et pour les maintenir florissantes il a déployé tous les moyens, malheureusement peu efficaces, que son temps comportait. Dans l'expression des sentiments intimes, il montre d'ailleurs une délicatesse étudiée qui a souvent bien du charme, et son style même devient quelquefois rapide et simple, à force d'étude. Nous arrivons enfin, pour épuiser cette revue des genres littéraires, à l'histoire, qui fut sous Trajan l'occupation favorite de maint écrivain, à Rome et dans la Grèce. Mais aucun d'eux n'y apporta la méthode sévère et les précautions scrupuleuses qu'on y requiert aujourd'hui. Les anciens concevaient l'histoire autrement que nous, et ils y cherchaient un autre plaisir. Quintilien[110] trouve qu'elle présente des rapports étroits avec la poésie : il assimile les compositions historiques à des poèmes en prose où l'écrivain doit s'efforcer, par la recherche des mots et la hardiesse des figures, de prévenir l'ennui inséparable de longs récits. Une telle manière de voir nous explique immédiatement le caractère de bien des livres de ce temps ; les pauvres auteurs que Lucien a raillés d'une façon si mordante, et qui offraient au public des récits romanesques où ils rivalisaient d'exagérations, de mensonges et de mauvais style[111], n'avaient fait que suivre à la lettre les conseils donnés par le plus célèbre des critiques contemporains, pour exciter et entretenir la curiosité du lecteur. Sous l'empire de cette théorie littéraire, ceux mêmes qui traitèrent l'histoire avec un esprit plus droit et plus ferme et un goût plus pur, ne laissèrent pas que de poursuivre l'agrément aux dépens de la vérité. Ni Tacite ni les historiens contemporains[112] ne songèrent à abandonner l'usage ancien et consacré des harangues fictives qui, en interrompant le cours de la narration, y jetaient une variété alors agréable à des lecteurs peu soucieux de l'exactitude scrupuleuse et de la couleur locale. Tacite soignait beaucoup ces morceaux d'apparat : il mettait dans la bouche de Galgacus des maximes politiques et des phrases brillantes qui durent ravir les amateurs de beau style et qu'assurément les collecteurs de Conciones insérèrent de suite dans leurs recueils[113]. Il changeait aussi, pour les accommoder au goût du jour, les discours officiels tels que celui de Claude en faveur des Eduens, discours dont le texte vrai diffère tellement de la harangue insérée au XIe livre des Annales qu'on a pu se demander si ces deux morceaux se rapportaient bien à un seul et même sujet. Obéissant à la même tendance, l'historien, en racontant des guerres malheureuses, taisait le nombre des Romains tombés sur les champs de bataille[114], pour ne pas produire chez son lecteur une émotion pénible, et ne voulant pas, sans doute, heurter les préjugés dominants, il ne se donnait pas la peine de prendre sur les juifs et sur les chrétiens des informations plus précises que les propos moqueurs des cercles lettrés de Rome, ou les récits malveillants de la populace. Il est vrai que parfois, avec une apparente indépendance, il rejette, aussi bien que Suétone, des fables chères au patriotisme et dont Tite-Live s'était fait le garant, mais cette élimination n'est pas le résultat d'une étude approfondie des sources, ni un aveu arraché à l'impartialité scientifique ; il n'y faut voir que le symptôme d'un scepticisme croissant qui s'étend au passé de Rome aussi bien qu'à son avenir[115]. Quant à Plutarque, il raille ceux qui cherchent l'exactitude dans la chronologie[116], et il se montre si peu soucieux d'indications géographiques un peu précises qu'il ne nomme pas les lieux où se sont livrées des batailles dont il raconte les péripéties[117]. Cependant il serait injuste de ne voir dans les historiens du second siècle que des rhéteurs ou des artistes. Ils prirent de l'histoire une idée plus élevée que celle qu'en avait donnée Quintilien, et ils la regardèrent comme le mode le plus efficace de l'enseignement moral[118] et comme une sanction définitive des gloires ou des flétrissures prononcées par les contemporains[119]. Thucydide et Polybe, qui l'ont considérée comme la science sociale par excellence, chargée de recueillir les faits pour fournir à la politique une base expérimentale, s'en faisaient sans doute une idée plus haute et plus juste. Notre siècle, qui n'assigne plus à l'histoire d'autre but que l'histoire elle-même, ni d'autre tâche que de faire revivre aussi fidèlement que possible les hommes qui furent avant nous, et auxquels nous relie une solidarité chaque jour mieux sentie, notre siècle s'est placé à un point de vue plus large encore, et duquel la théorie de Plutarque et de Tacite nous paraît insuffisante et mesquine. Mais qui ne sent combien cette théorie dépasse celle de Quintilien ? Sa conception seule est déjà un retour aux vraies conditions du genre historique. En dressant un tribunal du haut duquel il jugerait les faits et les personnages qu'il évoque, l'historien s'engageait, en effet, à se montrer strictement impartial, et la recherche de la vérité devenait le premier de ses devoirs. Tacite le comprit : s'il se mit à l'œuvre, ce fut pour rétablir la vérité que l'adulation ou la haine avaient altérée[120], et il la poursuivit avec une entière bonne foi[121]. Nous avons relevé plusieurs fautes où l'entraînèrent des défauts de méthode et des préjugés littéraires communs à tous les écrivains de l'époque, et dont le génie le plus puissant et le plus original ne pouvait complètement s'affranchir. Mais ces faiblesses de l'esprit n'ont pas gagné son cœur ; la passion qui a coloré son style n'a jamais dicté ses jugements, et il n'a prononcé aucune condamnation sans avoir fait, quand il y avait lieu, la part du bien et du mal. L'histoire cessant d'être un art d'agrément, la question de style, qui primait si mal à propos toutes les autres, perdit son importance et fut résolue aussitôt d'une manière conforme au bon goût. Rien n'est plus démonstratif à cet égard que la lettre de Pline à Capiton où sont comparées la langue de l'historien et celle de l'orateur. Les qualités qu'il assigne à l'une sont précisément, et dans les deux cas, celles que Quintilien recommandait pour l'autre[122]. On ne peut imaginer deux doctrines plus directement opposées, et on mesure avec surprise quel étonnant progrès avait fait en quinze ans l'esprit critique[123]. Ainsi, du règne de Trajan, date un changement capital dans la conception de l'histoire, mais la décadence des bonnes études fit bientôt avorter les fruits de cette heureuse révolution. Cette époque offre trois genres de compositions historiques : l'histoire générale, que l'œuvre de Tacite représente seule aujourd'hui[124], puis les biographies morales[125] dont l'Agricola et les Vies de Plutarque fournissent les types caractéristiques, et enfin les compilations anecdotiques dont Suétone a donné les premiers modèles[126]. Dans aucune de ces catégories on ne trouve le récit de faits appartenant au règne de Trajan : nous devons donc nous borner à une appréciation très-sommaire[127]. Contentons-nous de marquer un trait commun aux historiens que nous avons nommés. Tous les trois sont des psychologues : les individus tiennent plus de place dans leurs œuvres que la société, et l'étude des passions y est développée à l'exclusion et aux dépens des événements historiques un peu complexes et à grande portée. L'idée d'une histoire pragmatique était définitivement abandonnée : d'une part les hommes politiques s'exagéraient l'impuissance des gouvernés à prendre part à la direction des affaires publiques, et les gouvernés, comme nous l'avons dit, s'étaient paisiblement désistés de toute participation à ces affaires ; de l'autre côté, les historiens exagéraient les difficultés qu'ils devaient rencontrer dans leurs investigations[128]. Les archives impériales n'étaient pas aussi impénétrables qu'ils l'ont dit, ni le secret des délibérations prises dans le conseil des princes n'était aussi bien gardé ; quand même quelques documents leur eussent été refusés, la succession et la nature des faits suffit dans bien des cas pour éclairer leurs causes[129]. De plus les écrivains du second siècle, entraînés dans une évolution dont ils ne connaissaient ni la marche ni l'importance, ne pouvaient émettre des vues d'ensemble comme le firent Tite-Live, quand se fermait une période nettement définie de l'histoire, ou Paul Orose, au moment où la civilisation antique allait disparaître en laissant la place à un ordre de choses tout nouveau. L'histoire devenait donc nécessairement psychologique et dès lors se trouvait amenée à recueillir les petits faits et les détails familiers dans lesquels se dévoilent les passions et les caractères. Plutarque les a ramassés avec bonheur et racontés sans scrupules, attendu qu'il n'écrivait ses biographies des hommes célèbres que pour son plaisir et celui de quelques amis ; mais Tacite ne se consolait pas de traiter des sujets que ses prédécesseurs auraient trouvés mesquins ; il exprime plusieurs fois à ce propos son embarras et ses craintes[130]. Vaines en ce qui concerne la gloire de Tacite lui-même, ces craintes n'étaient pas sans fondement à l'égard des destinées de l'art qu'il avait porté si haut, car Suétone allait montrer bientôt à quoi se réduit l'histoire psychologique traitée par un esprit ordinaire et laborieux, recueillant les petits faits sans les choisir ni les ordonner. |