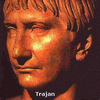ESSAI SUR LE RÈGNE DE TRAJAN
CHAPITRE XIV. — LA SOCIÉTÉ ROMAINE SOUS TRAJAN.
|
Dès le commencement du deuxième siècle l'empereur a pris et va garder, dans le monde romain, une si grande place que l'histoire entière paraît se réduire au récit de sa vie et à l'exposé de son système de gouvernement. Tacite n'aura pas de continuateur. Les biographies composées par Suétone et Marius Maximus ou, pour mieux dire, les anecdotes et les menus détails qu'ils ont compilés suffiront, aussi bien que les maigres notices postérieures de Spartien et de Lampride, à satisfaire la curiosité de sujets de plus en plus dévoués à leurs maîtres et habitués à voir en eux les arbitres tout puissants de leur destinée[1]. Mais nous ne saurions nous contenter de ce point de vue auquel les anciens, par le peu de répugnance qu'ils témoignent à l'adopter, semblent nous inviter à nous placer avec eux. A toute période, l'historien doit s'enquérir de la condition et de la vie morale des gouvernés, et les aller chercher à l'arrière-plan où les ont relégués les malheurs des révolutions ou leur propre indifférence sur leurs intérêts véritables. Nous ne pouvons donc nous dispenser de jeter un rapide coup d'œil sur la société au temps de Trajan. Malheureusement, les documents où l'on puise l'intelligence de cette époque sont fort rares, et leur emploi ne laisse pas que d'offrir quelque danger. C'est chez Pline, chez Juvénal, chez Martial qu'il faut aller chercher les traits caractéristiques des mœurs et de l'esprit du temps. Or Pline, qui ne vécut guère que pour les lettres, aborde rarement un autre sujet avec ses correspondants. Juvénal et Martial ont peint exclusivement, et avec complaisance, les travers et les vices de Rome : la loi même du genre de poésie qu'ils cultivent les oblige presque à laisser de côté tout ce qui n'est pas débauché, escroc ou poète ridicule, et par conséquent ils ne nous offrent qu'un tableau fort incomplet, et nécessairement inexact, de la société au milieu de laquelle ils ont vécu. Les inscriptions qui jettent tant de lumière sur l'histoire politique nous aident peu à connaître les mœurs, la classe des sepulcralia ne renfermant à peu près que des épitaphes où les vertus des défunts et les regrets des survivants sont exprimés avec l'emphase banale que la langue épigraphique offre sur ce chapitre, en tout temps et en tout pays. Ainsi réduit aux témoignages que fournissent les Œuvres littéraires, et surtout les satires et les épigrammes, l'historien qui essaie de dessiner le tableau du deuxième siècle, en n'omettant aucun des détails et des faits transmis par les auteurs, ne peut répandre également la lumière sur tous les points de ce tableau. II n'en éclaire qu'un côté qui est précisément le côté blâmable et fait à la critique une part trop belle. C'est ainsi que la lecture du bel ouvrage de M. Friedlænder, si attachant et si complet[2], donne parfois une impression fâcheuse de l'époque Antonine, malgré les réserves que stipule l'auteur en se servant de documents d'un emploi si délicat et si difficile. Il faut nécessairement consulter Juvénal et Martial avec beaucoup de circonspection et de défiance. En éliminant tout ce qui, dans leurs vers, est sensiblement exagéré ou déclamatoire, en les contrôlant, là où ce contrôle est possible, par les écrits de Dion, de Pline et de Plutarque, on se fait de leur époque une idée meilleure et, je crois, plus exacte que celle qu'ils ont voulu en donner. Il est vrai qu'elle présente un caractère frappant de décomposition où l'on verra, si l'on se reporte aux anciens principes et aux anciennes mœurs, un commencement de décadence. Mais sommes-nous en présence d'un mal contre lequel il faut s'indigner avec Juvénal, ou bien devons-nous reconnaître ici la condition inévitable du progrès, les symptômes et le commencement d'un ordre nouveau et meilleur ? C'est assurément la dernière manière de voir que l'on adopte si on étudie le sens et la nature des altérations que subissait chacun des éléments de la vie sociale. Bien que la religion gardât encore les apparences de la solidité, que les cérémonies du culte fussent aussi magnifiques et aussi fréquentes que par le passé[3] et que le langage officiel ne laissât apercevoir aucun affaiblissement des croyances[4], il est certain que le polythéisme grec et romain avait déjà perdu toute influence sur les esprits éclairés, et qu'il ne conservait quelque crédit sur les autres qu'en se rajeunissant par l'admission de dogmes égyptiens ou asiatiques, et en se dénaturant de plus en plus par ce mélange. Cette introduction de dieux et de rites étrangers, systématisée plus tard, était alors absolument spontanée et se développait au gré de l'instinct populaire, car les philosophes essayaient à peine de soumettre à leurs interprétations savantes et à leurs combinaisons ingénieuses la masse incohérente des traditions de toute provenance répandues dans l'ancien monde, et les politiques ne songeaient pas encore à sauver, par ce rajeunissement artificiel et par un appel désespéré aux vieilles croyances, des cérémonies et des dogmes dont la fin devait coïncider avec celle de la civilisation antique. A cette époque, les uns et les autres n'éprouvaient guère que du mépris pour les religions venues d'Orient et applaudissaient aux mesures prises de temps en temps par les empereurs pour en arrêter la diffusion. En dépit de toutes les entraves, elles recrutaient des adhérents chaque jour plus nombreux, tant les âmes étaient à ce moment emplies d'aspirations religieuses et tourmentées de l'infini. Peu de périodes de l'histoire offrent, au même degré que le second siècle, les ardeurs et les inquiétudes de la piété ; jamais peut-être l'homme n'a ressenti des élans plus vifs vers la conquête d'un nouvel idéal et ne s'est cru plus près du succès. Le sentiment religieux débordait avec violence, emportant les digues qu'on lui opposait et bouleversant le lit dans lequel on voulait enfermer et régler son cours. Plutarque, qui cherche, en bon prêtre d'Apollon, à maintenir l'intégrité des croyances anciennes, se montre plus préoccupé de la superstition qui les envahit chaque jour, que du scepticisme[5], de même que, dans un autre domaine, les pères apostoliques s'inquiètent moins du rationalisme que de l'hérésie. Lucien et Celse n'apparaîtront que dans un demi-siècle ; actuellement le danger n'est pas là. Le polythéisme ancien, et surtout la religion étroite et formaliste de Rome, ne pouvait suffire aux besoins nouveaux de la conscience et du cœur. Les Eleusinies, demeurant exclusivement athéniennes, restèrent fermées à un grand nombre d'âmes avides de consolations et d'espérances ; celles-ci se rejetèrent vers les cultes mystérieux de l'Asie et de l'Egypte, et apaisèrent leur soif aux eaux de l'Oronte et du Nil. Je ne puis me jeter incidemment dans une question aussi vaste[6]. Je rappelle seulement que Juvénal trouve une source inépuisable de lamentations ou de plaisanteries dans les détails de ces cultes dont le savant auteur de la Mythologie romaine a dit sévèrement qu'ils n'avaient apporté ni enseignement ni consolation[7]. On peut, je crois, répondre au satirique que la chiromancie n'est pas plus ridicule que les sorts de Préneste, et que les astrologues chaldéens ne le cèdent en rien aux haruspices toscans et aux augures dont Ennius et Cicéron avaient fait rire depuis longtemps. Quant au reproche de sécheresse et d'absurdité adressé aux religions qui prirent dans le monde romain un développement si puissant et si rapide, il tombe devant le fait même de ce développement dont, sans doute, on ne voudra pas faire honneur à la sotte crédulité des adeptes ou au charlatanisme audacieux des prêtres, et qui demeurerait inexplicable si l'on n'admettait que ces religions ouvraient quelques vues larges et élevées à ceux qui les embrassaient avec tant d'ardeur. Et, en effet, si nous mettons à part le culte bizarre et peu connu de la Déesse phrygienne et celui de Sabazius qui s'y rattachait[8], il est certain que les religions monothéistes de Sérapis et de Mithra, qui comptent alors le plus grand nombre d'adhérents, sont fort supérieures à l'ancien polythéisme, au point de vue logique. Au point de vue moral, la première nous donne dans le 125e chapitre du Rituel Funéraire[9] les préceptes les plus élevés et les plus purs qu'ait jamais enseignés aucune école philosophique, et la deuxième, au témoignage même des Pères, offrait dans ses dogmes et dans ses cérémonies plusieurs points communs avec le christianisme. Que cette coïncidence soit fortuite ou vienne d'un emprunt fait par les sectateurs de Mithra, peu importe ici ; ce qu'il faut reconnaître, et ce qui n'est guère contestable, c'est qu'une doctrine qui enseignait la rémission des péchés, la purification de l'âme par les épreuves et le repentir, l'intervention d'un médiateur entre l'homme et la Divinité, dut avoir une heureuse influence sur ceux qui ne pouvaient connaître les livres juifs ou la prédication chrétienne. Nous voyons donc un progrès dans la diffusion de ces cultes, qui coïncide avec la déchéance des religions de la Grèce et de Rome[10]. A la même époque la famille se modifie ; les relations rigoureuses que la loi romaine établissait jadis entre ses membres commencent à se détendre et à s'adoucir. En ce qui concerne le pouvoir paternel, nous avons vu poindre ce progrès dans une loi édictée sous Trajan, et la littérature contemporaine en fournirait d'autres témoignages. Par exemple, l'admirable lettre que Pline adresse à un père trop sévère pour son fils[11] nous fait sentir quels changements s'opéraient dans des esprits ouverts à des idées plus généreuses et plus humaines. La façon dont cet écrivain traitait ses affranchis et ses esclaves n'est pas moins remarquable. Ni la négligence de ses serviteurs, ni les vengeances cruelles dont quelques mauvais maîtres étaient les victimes, et qui excitaient un sentiment d'effroi universel, n'altéraient ses dispositions bienveillantes. La douceur qu'il portait dans l'exercice de son autorité, les soins qu'il prenait de ses gens dans leurs maladies, le chagrin qu'il ressentait à leur mort nous touchent profondément ; mais la ponctualité avec laquelle il exécutait leurs volontés dernières et les ménagements dont il entourait leur dignité révèlent une délicatesse plus surprenante encore que la bonté, eu égard à l'époque où vivait Pline[12]. Plutarque à la même époque recommandait et pratiquait la bonté envers les esclaves ; Pline et lui se montrent ici, par le cœur, fort supérieurs aux philosophes contemporains ; car on a fait honneur au stoïcisme entier de la fameuse lettre de Sénèque, mais cet honneur est immérité. La lettre de Sénèque est une exception dans la littérature des deux premiers siècles[13] : Epictète et Dion parlent très-philosophiquement de l'esclavage et de la liberté et ils émettent à ce sujet des théories fort belles, mais peu propres à déterminer un changement dans les lois si dures établies au profit des maîtres. Ces lois vont être bientôt modifiées en faveur des esclaves, sous Hadrien et ses successeurs, mais cette amélioration est due bien plus à l'influence de quelques maîtres semblables à Pline qu'aux remontrances du Portique[14]. La condition des femmes s'élève dans les lois comme dans les mœurs. Depuis plus d'un siècle, elles avaient montré dans les troubles civils autant de prudence, de courage et de fermeté que les hommes, et fait voir que le temps de leur émancipation était venu. Avant que les incapacités légales qui les frappaient disparussent peu à peu des codes (ce qui n'eut lieu qu'après le règne de Trajan), on leur vit prendre dans la société une place de plus en plus considérable. Que des inconvénients graves fussent mêlés à ce progrès aussi incontestable que nécessaire, nul ne songe à le nier. Moins surveillées dans leur intérieur, moins contenues au dehors par l'esprit public, les femmes abusèrent plus d'une fois de cette liberté et se dédommagèrent bruyamment de la sévérité des anciennes mœurs. Elles reçurent plus d'instruction, et quelques-unes ne surent pas se garantir du pédantisme[15]. Elles disposèrent de leurs biens et n'en firent pas toujours un usage irréprochable ; plusieurs se montrèrent odieusement avares ou scandaleusement prodigues. Ces maux et ces travers sont inséparables de toute société où la femme n'est pas complètement subordonnée et parquée dans l'enceinte de la maison conjugale ; aussi plus d'un trait de la satire de Juvénal trouve-t-il son application dans les temps modernes, mais il faut remarquer en même temps que beaucoup de ses plaintes ne sont que des redites ; depuis les premiers essais de la littérature latine, la femme dotée est un thème à doléances. Il n'y a donc pas là de vices propres au ne siècle. En revanche, ce qu'on y trouve pour la première fois, c'est un ménage comme celui de Pline et de Calpurnie, type accompli de profonde et vraie tendresse. Calpurnie fut véritablement la compagne de Pline, associée à tous les événements petits ou grands de son existence. Son inquiétude quand Pline devait parler, son anxiété pendant que, loin d'elle, il prononçait le plaidoyer dont elle avait vu la composition laborieuse et suivi les ébauches successives, sa joie dès qu'elle recevait les premières nouvelles du succès, allaient vivement au cœur de son mari. Elle lisait tous ses ouvrages, en apprenait quelques-uns par cœur, chantait en s'accompagnant de la lyre des vers composés par celui dont elle partageait le sort et la gloire. Pline lui portait l'affection la plus vive, et ne pouvait supporter sans chagrin les courtes séparations que le hasard leur imposait. On ne saurait croire, dit-il, à quel point je souffre de votre absence, d'abord parce que je vous aime et ensuite parce que nous n'avons pas l'habitude d'être séparés. Aussi, je passe une grande partie des nuits à penser à vous ; le jour, aux heures où j'avais l'habitude de vous voir, mes pieds me portent d'eux-mêmes à votre chambre vide, et j'en reviens chagrin et abattu comme si la porte m'eût été refusée[16]. — Votre absence, dit-il, dans une autre lettre, votre maladie me jettent dans l'anxiété. Je crains tout, je me figure tout, et comme tous ceux qui ont peur je me figure surtout ce que je redoute le plus. Je vous le demande en grâce, calmez mes craintes en m'écrivant une fois, deux fois même par jour. Je serai plus tranquille pendant que je lirai, et je recommencerai à trembler quand j'aurai lu[17]. Nous voilà loin du fameux billet de Cicéron à Terentia[18] et des scènes de Quintus avec sa femme. Dans le monde grec on aperçoit en parcourant les opuscules de Plutarque un progrès semblable. Tandis que Thucydide pose en principe que la femme la meilleure est celle dont on n'a jamais parlé, que Xénophon resserre le cercle de la vie conjugale dans la direction matérielle du ménage, Plutarque écrit un livre sur les actions éclatantes des femmes, dans l'intention avouée de venger leur sexe d'un mépris injuste et il révèle, dans les écrits qu'il adresse à son épouse, les habitudes d'une communauté morale de tous les instants. Ainsi, dès le début du IIe siècle, nous trouvons réalisé le type du mariage tel que le définiront si heureusement les jurisconsultes[19]. Toute inégalité réelle avait, on peut le dire, disparu de la société antique le jour où la puissance politique passa tout entière aux mains du prince, qui pouvait élever aux positions les plus élevées et les plus considérables ceux qui avaient conquis sa faveur ou sa confiance. On était arrivé à l'égalité par une voie regrettable, mais elle était atteinte. Il ne servait plus de rien, comme le remarque mélancoliquement le poète, d'avoir respiré l'air de l'Aventin et mangé l'olive de la Sabine[20]. L'ancienneté de la famille, l'origine romaine ou italique perdaient beaucoup de leur prestige sous le règne de Trajan, homme nouveau, né dans une province assez éloignée, et parvenu au rang suprême en franchissant successivement tous les échelons de la hiérarchie sociale. Cette hiérarchie, sans doute, consacrait encore plusieurs classes dans l'état, mais ces classes ne sont plus rigoureusement fermées comme autrefois : elles ne sont constituées que par des différences dans la richesse, et les fortunes se faisaient et se défaisaient alors avec une rapidité que plusieurs trouvaient scandaleuse, mais qui facilitait le nivellement de toutes les conditions et le mélange de toutes les couches sociales. Quelques différences dans le costume, et des places marquées au théâtre, voilà ce qui reste à l'ordre sénatorial et à l'ordre équestre de leurs antiques privilèges. Entre les riches et les pauvres il n'y a plus, comme jadis, un abîme infranchissable et un contraste démoralisateur : une grande aisance régnait dans la classe moyenne, active et éclairée, grandissant en nombre sous l'influence des progrès successifs de l'industrie et de la richesse. Elle s'augmentait de tout ce que perdait l'esclavage, car le travail commençait à devenir libre. Sur plusieurs points, les sources de l'esclavage étaient directement atteintes ; la pacification générale fermait la source la plus abondante du recrutement servile, une police plus active restreignait la piraterie et la traite à l'intérieur, enfin la loi diminuait le nombre des malheureux condamnés à la servitude par leur naissance même. D'autre part, les affranchissements inspirés tantôt par la vanité, tantôt par l'intérêt bien entendu, devenaient plus fréquents et la jurisprudence, réagissant contre la politique d'Auguste, tendait comme nous l'avons vu à les faciliter. Aussi voit-on, dès le commencement du ne siècle, le nombre des travailleurs libres gagner sur celui des travailleurs esclaves dans toutes les branches de l'activité productrice, à la ville comme à la campagne, au service de l'État comme dans les maisons particulières[21]. Chaque jour le mouvement se dessinait davantage et se régularisait en s'accélérant : il semblait que l'abolition de l'esclavage, réservée à un temps bien éloigné, allait s'effectuer sous l'action des causes profondes et puissantes qui transformaient l'ancien monde. Malheureusement, avant que cette évolution fût terminée, le travailleur, affranchi d'hier, devint esclave de l'État qui l'enchaîna à sa profession, et par l'impôt lui extorqua son salaire avec des raffinements de sévérité et de rigueur que n'avaient pas imaginés les maîtres au temps de leur plus complète puissance : l'infortuné ne put même plus se former un pécule. Mais gardons-nous de confondre l'état du travail à la fin du IIIe siècle, au milieu du plus effroyable désordre que le monde ait connu, quand l'empire menacé aux frontières, déchiré à l'intérieur, s'effondre sous les calamités de l'anarchie et de la guerre ; quand le prince, ne sachant où trouver les ressources nécessaires pour parer aux besoins les plus pressants, essaie à la fois ou tour à tour du maximum, de l'altération des monnaies, des corporations, du privilège, multiplie le nombre des fonctionnaires pour assurer le recouvrement des impôts et compromet encore plus ses finances par ces créations d'emplois parasites ; gardons-nous de confondre ces temps déplorables avec la période Antonine, avec ce siècle heureux et trop court où la richesse croissait au sein de la paix, sous le double stimulant de l'intérêt privé et de la concurrence, sous la protection d'un gouvernement solide et facile. Ce fut l'âge le plus brillant de l'industrie antique ; elle multiplia ses chefs-d’œuvre pour satisfaire les fantaisies exaltées par le sentiment de la puissance. En même temps que l'architecture civile prenait, ainsi que nous le verrons, le plus remarquable développement, les fabricants de meubles, de voitures, d'ustensiles de toute sorte s'ingéniaient à donner à leurs produits des formes élégantes, à les relever par l'emploi de matières rares et précieuses. Les contemporains nous parlent d'argenterie ciselée du plus beau travail, de meubles tirés des bois étrangers les plus renommés par leur odeur ou le dessin gracieux de leurs veines, d'objets incrustés d'ivoire, de métaux précieux, d'écailles. Ces belles choses, avidement recherchées, ne restaient pas toujours dans les mains de leurs premiers possesseurs[22]. A Rome comme dans toutes les grandes villes — et la civilisation antique est surtout une civilisation urbaine, où le progrès se fait au sein des villes et pour leurs habitants —, le développement de l'industrie et du commerce était la condition d'existence d'une population immense et toujours croissante[23]. De maigres sportules, péniblement arrachées à des parvenus tiraillés entre la vanité et l'avarice, de chiches soupers, continuation risible et vraie parodie du patronage antique, alimentaient quelques parasites éhontés, de plats bouffons et de pauvres poètes. Mais la grande masse gagnait courageusement le pain de chaque jour, et passait sa vie au travail. Car les largesses du prince et celle des magistrats municipaux dans les provinces pouvaient bien permettre de passer dans l'oisiveté un ou deux jours de fêtes, mais ne dispensaient pas sans doute des millions d'hommes de tout effort pendant toute l'année. Tous les pays connus alors envoyaient à Rome, à Carthage, à Antioche, à Alexandrie, à Corinthe, à Cordoue, à Lyon les produits de leur industrie et de leur sol, et là, ces produits dont la recherche ou la création avait fait vivre une quantité de travailleurs, dont le transport avait occupé nombre de voituriers, de bateliers, de négociants, d'armateurs, recevaient de nouvelles formes[24]. L'admirable réseau de grandes routes qui reliait toutes les parties du monde romain était le théâtre d'une circulation incessante d'hommes et de marchandises. Les fleuves et les voies navigables artificielles facilitaient les échanges, et les voyages sur mer, sans danger depuis que l'établissement de flottes permanentes empêchait le développement de la piraterie, rapprochaient et mêlaient les peuples de tout l'univers. Le bien-être croissant dans toutes les classes avait multiplié les goûts de luxe et les loisirs, et les professions que nous nommons libérales avaient pris un essor considérable. Laissons Juvénal et Martial plaindre tant d'avocats qui ne trouvent pas à plaider et concluons que si ces malheureux ont embrassé cette carrière c'est qu'ils y ont vu des exemples tentants et des chances de fortune. Et en effet Tacite nous apprend que les honneurs, comme l'opulence, affluent aux mains de ceux qui se sont voués au barreau[25]. Non-seulement les avocats trouvaient une profession lucrative dans l'exercice de leur art, mais les praticiens eux-mêmes[26], à défaut d'une parole exercée et éloquente, se créaient des ressources en appliquant leur sagacité et leur expérience à des questions de droit devenues très-complexes dans une société aussi avancée que celle du lie siècle, où la vie présentait des rapports si multipliés et si délicats. Au milieu des agglomérations considérables des villes, les médecins trouvaient une clientèle nombreuse et productive. Le goût de l'instruction se répandait chaque jour, sa nécessité était mieux sentie, les parents à qui elle avait manqué faisaient tous les sacrifices' possibles pour que leurs enfants en profitassent, les personnages influents de chaque petite ville y fondaient des écoles, et les professeurs gagnaient facilement de l'argent et de la gloire[27]. Enfin les artistes étaient constamment occupés, non-seulement aux monuments publics que Trajan et Hadrien multiplièrent, et que toutes les villes de l'empire élevaient avec profusion, mais aussi par les particuliers qui voulaient des demeures somptueuses dignes de leur fortune acquise ou héréditaire, et ornées avec une magnifique élégance. Ainsi ceux qui embrassaient les professions que nous appelons libérales étaient presque sûrs d'arriver à la fortune ou à l'aisance, et nous devons ajouter, à l'honneur des classes riches, qu'elles faisaient les plus louables efforts pour améliorer la condition de ceux que n'avait pas favorisés le hasard de la naissance. La correspondance de Pline, aussi bien que les nombreuses inscriptions du temps, témoignent de l'emploi le plus noble de la richesse[28]. Aussi ne voit-on plus, pendant la durée de l'empire, la moindre trace de ces luttes de classes qui avaient désolé Rome sous le régime républicain. Ce fut une compensation, insuffisante à quelques égards, heureuse à beaucoup d'autres, du changement de régime inauguré par Auguste. Trajan ne changea rien aux conditions essentielles de ce régime, mais pourquoi l'eût-il modifié ? Tout le monde, on peut le dire hardiment, était satisfait d'une forme de gouvernement qui lui donnait l'ordre et la paix. Ce qu'on demandait, au IIe siècle, c'était un système politique basé sur l'égalité du citoyen devant la loi, une royauté plaçant le respect de la liberté des gouvernés au premier rang de ses devoirs[29]. Cette idée, il faut bien le reconnaître, fait le fond de toute la philosophie politique des anciens. Xénophon et Platon, Socrate et Dion Chrysostome, appellent de leurs vœux une forme politique où le prince conquerra le dévouement de ses sujets par l'ascendant de sa vertu : Cicéron avait présenté plus d'une fois la même idée aux esprits de ses compatriotes. Le principat des Antonins ne fut pas autre chose. Peut-on citer une circonstance dans laquelle les empereurs du siècle aient refusé de réaliser une amélioration demandée par l'opinion, ou méconnu volontairement le vœu public ? On n'en trouvera pas. Dès lors il serait puéril et injuste de leur reprocher de n'avoir pas fondé un Etat reposant sur les bases politiques que nous jugeons essentielles aujourd'hui. L'histoire n'offre plus qu'une suite de non-sens dès que l'on ne veut pas admettre que les principes de l'ordre politique ne se découvrent qu'un à un, et que la science politique, à cause de la complication propre à son objet, est condamnée à une marche moins assurée et à des progrès plus lents que toutes les autres. Faire un crime, à Trajan et à Marc Aurèle, de n'avoir pas inauguré le régime représentatif est aussi absurde que de reprocher à Ptolémée d'avoir mis la terre au centre du système planétaire, et à Galien d'avoir ignoré la circulation du sang. |