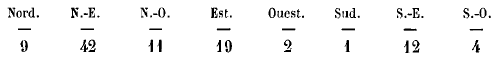LES PHÉNICIENS ET L'ODYSSÉE
LIVRE SEPTIÈME. — LES LOTOPHAGES ET LES KYKLOPES.
CHAPITRE PREMIER. — LES LOTOPHAGES.
|
Après la coursière chez les Kikones, Ulysse reprend sa navigation : De là nous naviguons au plus tôt, le cœur, navré, contents d'échapper à la mort, nais pleurant les camarades perdus. Les vaisseaux ne démarrent pourtant pas avant que nous ayons par trois fois bêlé chacun de ces infortunés, qui venaient de périr dans la plaine, sous les coups des Kikones. Mais, sur nos vaisseaux, Zeus l'assembleur de nuages précipite le vent Bora avec de terribles hurlements. La brume couvre la terre et la mer tout ensemble ; du ciel tombe la nuit, et, donnant à la bande, nos vaisseaux se mettent à fuir sous le vent. La rafale déchire en trois ou quatre endroits les voiles. Il faut descendre la mâture sous peine de sombrer, puis tirer sur les rames pour gagner la terre. Là, deux jours et deux nuits, sans désemparer, nous restons étendus, digérant nos fatigues et notre chagrin. Quand l'Aurore bouclée ramène le troisième jour, nous partons et, mât dressé, voiles déployées, nous voilà tranquillement assis, laissant faire les vents et le pilote. Nous allons sans avarie regagner la terre de la patrie. Mais la houle, le courant et le Bora nous jettent hors de la route, au détour du Malée, et nous font encore manquer Kythère[1]. Il me semble inutile d'insister encore une fois sur les détails de cette navigation et sur l'exactitude de ces vues de mer. Les Instructions nautiques nous ont longuement parlé de ces coups de Bora qui dominent pendant la belle saison, soufflant quelquefois frais avec un horizon embrumé qui obscurcit la terre à grande distance.... ils soufflent d'ordinaire avec beaucoup de force ; ils sont le plus souvent froids et obscurcissent l'horizon.... Il est prudent d'avoir toujours un port à l'abri duquel on puisse se réfugier si un coup de vent se lève brusquement. L'atmosphère dans ce cas devient si obscure, [Cf. notre vers odysséen : . . . . . . . . . . . . . . . .
. . σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ᾽ οὐρανόθεν νύξ[2].] qu'au milieu de ce labyrinthe d'îles, il est souvent impossible d'éviter la terre avant de s'en trouver à distance dangereuse[3]. Nous savons aussi que, d'ordinaire, ces tempêtes de Bora durent trois jours et couchent, culbutent, déchirent tout. Il faut ou se réfugier dans un port et tirer les barques à sec, ou d'abandonner en pleine mer à la bonne volonté du sort. Sur les deux façades orientale et occidentale du Péloponnèse, ces tempêtes sévissent durant l'été, toutes pareilles. Parmi vingt ou trente récits des voyageurs modernes, je prendrai seulement celui qui se rapproche le plus de notre texte odysséen : Le jour d'après, raconte Du Fresne-Canaye[4], le mistral fraîchit si bien que toute l'habileté nautique était trop faible contre la rage de la tempête. Nous retournâmes donc en arrière et nous jetâmes l'ancre (5 août) dans le port de Modon.... Nous restâmes à Modon attendant le vent favorable.... Enfin fatigués de ce long séjour et voyant la persistance obstinée de cet impitoyable mistral, dans l'espoir de trouver un autre vent dans la haute mer, nous haussâmes les voiles le 20 août et nous courûmes des bordées avec grands efforts et tempêtes jusqu'au 25 que nous arrivâmes à Prodano, île déserte à 20 milles de Modon, appelée par les Anciens Protè. Le lendemain, nous levâmes l'ancre par un assez bon vent. Mais tout à coup le ciel se brouilla ; d'épouvantables tourbillons et des nuages épais sautèrent à l'ouest, de manière que nous courûmes quatre jours et quatre nuits avant d'ancrer à Zante. Le 7 septembre nous levâmes l'ancre avec une brise en poupe. Mais au milieu du canal de Céphalonie, le vent se changea et nous courûmes des bordées trois jours de suite dans ce canal.... Après bien des peines nous sortîmes du canal. Nous eûmes le vent favorable si bien que nous arrivâmes en peu d'heures à l'île de Paxo, voisine de Corfou.... Mais voici qu'en un moment s'éleva une tempête avec des bourrasques si sombres qu'à peine la vue pouvait-elle porter de la poupe à la proue et la pluie tombait d'une telle furie que les mariniers perdirent absolument le gouvernement du navire. On cargua toutes les voiles ; on amarra la barre au bordage et on laissa le navire aller à la merci des flots. Enfin en moins d'une demi-heure cessa la pluie, mais le vent s'était tourné à l'ouest de telle sorte que, malgré nous, nous revînmes jusqu'aux îles Nicolas. Sur chaque face du Péloponnèse, ces tempêtes sévissent. Elles sont particulièrement redoutables aux approches des pointes avancées, pour les bateaux qui contournent au Sud la presqu'île et passent du golfe de Venise, comme disent les marins francs (leur golfe de Venise va jusqu'aux pointes extrêmes du Péloponnèse), dans l'Archipel, ou inversement. Au Sud du Malée, le détroit de Kythère, qui est la grand'route des voiliers, est le plus souvent obstrué par ces rafales de Bora. Venus du golfe de Venise, les navigateurs occidentaux rencontrent brusquement, lorsqu'ils enfilent ce détroit de Kythère, un violent courant d'air qui leur ferme la route : il leur faut alors rebrousser chemin et venir attendre une accalmie dans quelque mouillage des golfes de Laconie ou de Messénie, à Port-aux-Cailles dans le Sud du Taygète, à Coton ou à Modon dans le Sud de l'Ithome. Venus de l'Archipel, les navigateurs orientaux rencontrent en ce passage plus de difficultés encore : le Bora, qui les chasse en poupe, est parfois si violent qu'il leur est impossible de ne pas fuir tout droit devant lui ; la moindre manœuvre qui mettrait le navire par le travers, le moindre coup de barre, à droite ou à gauche, pourrait coucher la mâture ou faire capoter le bateau. Le même Du Fresne-Canaye rentre, comme Ulysse, vers la terre de la patrie ; il descend l'Archipel pour atteindre le détroit de Kythère : Violemment poussés par la force incroyable de la tramontane, nous laissâmes Macronisi, Héléna, Sérifo et Sifano. Nous parcourûmes le golfe de Napoli et vers le soir nous eûmes à notre gauche Antimilo et Milo. Nous découvrîmes Cérigo d'assez près. Mais comme le pilote n'était pas trop expérimenté, le patron et le timonier résolurent de ne pas aller plus loin cette nuit-là. Nous restâmes à courir des bordées jusqu'au matin vers Bellopoulo. Le jour suivant, comme le vent ne cessait pas, nous fûmes à Malvoisie. Puis nous accostâmes au cap Saint Ange... Nous eûmes fort à faire au-dessus de cette pointe, car, voulant entrer dans le golfe de Venise, nous n'avions plus le vent en poupe ; mais il poussait le navire tellement de côté que souvent la grande vergue était à plus de 4 palmes sous l'eau et l'eau entrait sous la couverte[5]. [Cf. le vers odysséen : les vaisseaux fuyaient en donnant à la bande] A l'entrée orientale du détroit de Kythère, les thalassocrates levantins trouvaient au long du Péloponnèse quelques refuges que nous avons longuement étudiés. Zarax, Minoa, Sidè, etc., nous avons reconnu des souvenirs phéniciens sur ces côtes à pourpre. Mais, outre ces pêcheries, des mouillages de refuge étaient indispensables à la navigation : sur cette façade orientale du Péloponnèse, ces mouillages étaient pour les Phéniciens ce que, pour les Vénitiens et les Francs, Coron et Modon furent sur l'autre façade. Au Sud du Malée et du détroit, nous avons étudié aussi les haies et ports de Kythère. Ulysse, ayant manqué le détroit, pourrait encore se réfugier en ces ports insulaires. Mais il faudrait qu'il pût tourner à l'Ouest, et le vent du Nord est si violent que toute manœuvre devient impossible. Ulysse manque donc aussi l'entrée de Kythère, et le voilà jeté, par le vent et par le courant, vers la grande mer Occidentale : Le courant dans le voisinage du cap Malée, disent les Instructions, porte en général à l'Ouest avec la vitesse d'un mille à l'heure[6]. Au delà du Malée et de Kythère, s'ouvre la mer sans îles. Les voiliers peuvent encore gagner la Crète, quand le Zéphyre, le vent du N.-O., se met à souffler. Mais le Bora, le vent du N.-E., ne les mène que vers Malte ou vers l'Afrique, et c'est vers l'Afrique que le courant les porte aussi : Les courants dans l'Archipel sont irréguliers en force et en direction. En général, ils portent au Sud. Mais ils sont grandement influencés par les vents, surtout dans la partie Ouest de cette mer. Comme règle générale, les courants sont toujours plus forts pendant et après les vents de N.-E. qu'avec les vents du Sud. Lorsque les vents sont entre le N.-E. et l'Est, le rapide courant du Bosphore passe aux deux côtés de l'île de Lemnos et s'avance dans la partie Ouest de l'Archipel, en prenant une vitesse considérable dans les canaux des îles. On ne peut donner une loi exacte de la marche de ces courants, surtout pour la partie Sud de l'Archipel et pour les canaux qui bordent l'île de Candie. Le courant porte presque continuellement au Sud. Mais il est quelquefois irrégulier et dépend beaucoup (comme partout ailleurs) de la force et de la direction des vents, qu'ils soient locaux ou qu'ils soufflent au loin avec violence. Dans les parages de la Crète, le courant qui descend des Dardanelles et celui qui, venant de la côte d'Égypte, passe le long des côtes de Syrie et de Caramanie, se réunissent en absorbant les influences locales et donnent ainsi naissance à un courant Sud, prédominant dans l'Archipel, ou Sud-Ouest un peu plus bas, avec une vitesse de ½ mille à 1 mille ½ à l'heure[7]. Par le vent qui vient du N.-E., et par le courant qui porte au S.-O., Ulysse est entraîné loin des mers grecques, loin de la Crète même, à travers le désert sans des qui s'étend depuis les côtes crétoises jusqu'aux rives africaines. Dans cette partie de la Méditerranée, le régime des vents est des plus incertains : Sur les côtes d'Afrique, les brises de terre et du large sont irrégulières, depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Cependant on y ressent les violentes brises du Nord et du N.-E., qui rendent la mer très grosse. Dans le golfe de la Syrte, les vents dominants sont le N.-O. et le N.-E., hâlant le Nord dans le fond du golfe. Les brises du Nord pénètrent rarement jusqu'au fond du golfe ; mais elles soulèvent une grosse houle qui vient se briser sur les plages basses et sablonneuses[8]. C'est à ces plages qu'Ulysse est entraîné par des vents funestes : Pendant neuf jours, les vents pernicieux nous entraînent sur la mer poissonneuse ; nous abordons le dixième jour à la terre des Lotophages, qui se nourrissent du mets fleuri. Pour retrouver cette terre des Lotophages, faut-il tenir grand compte de la distance donnée par le poète ? On dira que neuf ou dix jours de navigation peuvent n'être en sa bouche qu'une expression courante, indiquant seulement une période assez longue : une dizaine de jours, dirions-nous. Nous savons que les Hellènes comptaient leurs jours par dizaines : nous avons ici une dizaine hellénique, comme ailleurs nous avons la semaine sémitique (de l'île d'Aiolos à la terre des Lestrygons, Ulysse navigue six jours et arrive le septième), et comme ailleurs encore nous avons la dizaine hellénique et la semaine sémitique combinées (de l'île de Kalypso à la terre des Phéaciens, Ulysse navigue dix-sept jours). Pourtant cette distance de neuf journées correspondrait assez bien aux douze ou treize cents kilomètres qui séparent le Malée du pays des Lotophages, le Péloponnèse des côtes tunisiennes. C'est dans le Sud de la Tunisie actuelle, près de l'île Djerba, que les Anciens situaient, en effet, ce peuple des Mangeurs de Lotos. Il semble que de bonne heure les coups de vent avaient jeté les barques péloponnésiennes sur ce rivage africain. Au temps d'Hérodote, on racontait de Jason ce que le poète odysséen nous raconte ici d'Ulysse. Jason voulait contourner le Péloponnèse pour aller offrir un trépied d'airain au dieu de Delphes. Mais sous le Malée, un coup de Bora le jette en Libye, dans les parages du lac Triton, tout près des Lotophages. Grâce aux vents du Nord, cette terre libyenne apparaissait déjà aux contemporains d'Hérodote comme une future dépendance du Péloponnèse, au même titre et pour la même raison que Cyrène était devenue une dépendance des insulaires crétois ou égéens : l'oracle, disait-on, avait ordonné aux Lacédémoniens d'aller coloniser l'île Phla, dans le voisinage de nos Mangeurs de Lotos[9]. Ce peuple des Lotophages a réellement existé. Nous savons comment le navigateur antique distingue les peuples, suivant leur nourriture habituelle, en Ichthyophages, Éléphantophages, Pithékophages, etc. Cette classification nous fait sourire, parce que nous n'en voulons voir ni la prof onde philosophie ni la réelle utilité. Mais pour les Anciens, dans l'état de leurs connaissances, c'était la seule manière commode et rationnelle de classer en différents groupes les humanités de même couleur. Réfléchissons un instant à ce que nous faisons nous-mêmes. Quand nous avons partagé l'espèce humaine en blancs, noirs, jaunes, etc. , suivant la couleur de la peau, il nous faut un autre moyen de classification : nous prenons la différence de langage. Nos connaissances en grammaire générale et en philologie comparée nous ont fait reconnaître des familles de langues : nous en avons conclu a l'existence de familles de peuples, et nous partageons l'humanité blanche en phones, Slavophones, Grécophones, Latinophones, etc. Les Anciens la partageaient en phages. Les géographes de l'avenir trouveront peut-être que, des deux procédés, le nôtre n'est pas le moins plaisant ni le moins faux. Au Sud de l'Égypte, sur la Mer Érythrée, dit le Périple d'Agatharchide[10], il y a quatre grandes races. La première, voisine des fleuves, sème le sésame et le millet. La seconde, voisine des lagunes, moissonne les roseaux et autres pousses tendres. La troisième, nomade, vit de lait et de viandes. La quatrième, maritime, vit de poissons. Celle-ci est de beaucoup la plus nombreuse, car du fond du golfe Arabique, elle s'étend jusqu'à l'Inde, à la Gédrosie, la Caramanie et la Perse. Cet immense peuple des Ichthyophages a été découvert par les Hellènes quand, d'une part, ils ont navigué sur la Mer Rouge et quand, d'autre part, Alexandre a conquis la plaine de l'Indus. En ces deux points, les explorateurs trouvèrent des Mangeurs de Poissons[11]. Les géographes postérieurs réunirent tous ces Mangeurs de Poissons en une seule race, en une Plus Grande Ichthyophagie[12], en un Pan-Ichthyophagisme, que, pour ma part, je trouve moins ridicule que nos pan-latinisme, pan-slavisme, pan-germanisme, pan-brittonisme, etc. : la communauté de nourriture crée entre les hommes autant et plus de ressemblances que la communauté de langage. Sur la Mer Érythrée, auprès des Ichthyophages, habitent les Hylophages, les Spermatophages, les Éléphantophages, etc. Chaque navigateur notait soigneusement le genre de nourriture des peuples découverts par lui. En arrivant sur une côte nouvelle, le premier soin d'Ulysse, une fois les équipages reposés, est de s'enquérir quels sont les Mangeurs de Pain qui l'habitent[13]. Les indigènes, raconte Diodore dans sa description de la Corse, se nourrissent de lait, de miel et de viandes, et, en parlant de la Sardaigne, le même Diodore nous dit que les Sardes vivent de lait, de fromage et de viandes[14]. Diodore résume ici quelque vieux géographe, qui lui-même avait copié quelque vieux périple. Hérodote a dû mettre à pareil profit quelque périple des côtes libyennes : Après l'Égypte, viennent les Adurmachides, qui vivent à la mode égyptienne, puis les Giligames..., puis les Asbystes..., puis les Nasamons qui vivent, l'hiver, de leurs troupeaux et, l'été, montent de la mer vers l'intérieur faire la récolte des dattes, et qui mangent aussi les sauterelles..., puis les Lotophages, qui ne vivent que du fruit du lotos, puis les Machlyes qui vivent aussi du lotos, mais qui ont d'autres provisions[15], etc. Plus loin, Hérodote nous parlera, des Gyzantes Mangeurs de Singes, Pithékophages. Les Lotophages, on le voit, ne sont pas un peuple légendaire. La littérature postérieure s'en empara et les fit entrer dans le cycle des héros et des demi-dieux[16]. En réalité, pour les premiers navigateurs, c'étaient des hommes ordinaires, d'honnêtes Berbères installés sur le bord de la Méditerranée et vivant de leurs plantations. S'ils ne vivaient que de leurs fruits, c'est qu'à vrai dire leur île ne fournit pas autre chose. Son terrain sablonneux ou trop sec ne porte ni moissons abondantes ni pâturages verdoyants ; Les grains et les troupeaux ne sauraient y prospérer. Les indigènes ne seront donc ni des Mangeurs de Pain ni des Mangeurs de Viande : Gerba est une île prochaine de la terre ferme, toute plaine et sablonneuse, au reste garnie d'une infinité de possessions de vignes, dattes, figues, olives et autres fruits. En chacune de ces possessions est bâtie une maison, et là habite une famille à part, tellement qu'il se trouve force hameaux, mais peu qui ayent plusieurs maisons ensemble. Le terroir est maigre, voire qu'avec si grand labeur et soin qu'on puisse mettre à l'arrouser avec l'eau de quelques purs profonds, à grande difficulté y saurait-on faire croître un peu d'orge, ce qui cause tousjours une grande cherté en ces lieux-là quant au grain, dont le setier se vend ordinairement six ducats, et quelquefois plus, et la chair encore n'y est à guère meilleur prix[17]. Faute de moissons et faute de pâturages, les insulaires ne peuvent se nourrir que de fruits. Cette Djerba des navigateurs modernes semble bien être la Lotophagie des anciens. Les Anciens savaient que le véritable nom de ce peuple lotophage était Machlyes ou Érébides[18]. Il avait son domicile dans la Grande Syrte, suivant les uns, dans la Petite, suivant les autres[19]. Il habitait une péninsule, dit Hérodote, άκτὴν προέχουσαν ἐς τὸν πόντον[20], une île, suivant d'autres : Djerba, rattachée à la côte par des roches et des bas-fonds, est une île, mais aussi une presqu'île toute semblable aux péninsules voisines de Zarzis et de Tarf-el-Djorf : L'île de Djerba, disent les Instructions nautiques, est l'insula Meninx ou île des Lotophages des Anciens. Elle est assez plate. Relativement très peuplée, elle compte 45.000 habitants. Les maisons, entourées de jardins, sont groupées en un grand nombre de petits centres portant en général le nom de huait. Les jardins sont bien cultivés et approvisionnés d'eau par des citernes ou par des puits. Les habitants de Djerba passent pour être d'une race particulière, d'origine berbère ; ils sont très hospitaliers ; de nombreux marabouts et des minarets se détachent de la verdure des palmiers et des oliviers qui couvrent l'île[21]. C'est bien ainsi que on imagine le rivage ou vient atterrir Ulysse. Nos Achéens débarquent à la plage, puisent de l'eau et préparent le repas ; puis on envoie une escouade aux vivres vers ces jardins qui ferment l'horizon. Il n'est pas question de ville : les Lotophages habitent sans doute κατά κώμας, en hameaux, en humts séparés. Le lotos, pour les plus vieux périples grecs, est un arbre et un fruit de cette côte. Skylax nous décrit une des oasis berbères : C'est un jardin ombragé d'arbres enchevêtrés et denses : ces arbres sont le lotos, les pommiers de toute espèce, les grenadiers, les poiriers, les mûriers, les vignes, les lauriers[22], etc. — Sur la côte N.-E. de l'île Djerba, disent les Instructions, s'ouvre une petite crique où l'on peut débarquer par tous les temps, à ce que les pêcheurs assurent. Ce point d'accostage est appelé par les habitants Marsa el-Tiffa, le Port des Pommes[23]. Qu'était exactement le lotos ? Hérodote, qui copie sans doute quelque vieux périple, et Polybe, qui de ses yeux a vu le lotos, comparent ce fruit aux figues et aux dattes, mais lui attribuent un goût plus fin, un meilleur parfum[24]. Pline, qui copie Théophraste, y reconnaît le jujubier : L'Afrique produit un arbre remarquable, le lotus, qu'on nomme celtis et qu'on a acclimaté en Italie. Les plus beaux lotiers sont autour des Syrtes et chez les Nasamons. Il est de la taille du poirier. Sa feuille est très découpée comme celle de l'yeuse. Il y a plusieurs espèces de lotus, discernables par leurs fruits. Le fruit est gros comme une fève, de couleur safranée, mais variant de teinte, comme le raisin, entre la première pousse et la maturité : il vient en grappes comme les baies des myrtes, et, là-bas, c'est un mets si doux qu'une nation et une contrée en ont mis leur nom.... Les armées qui traversaient l'Afrique s'en sont nourries[25]. Skylax savait que les indigènes tirent du lotos, comme des dattes, un mets et une boisson[26]. En tout ceci, il ne saurait être douteux que lotos fut le nom d'un arbre et d'un fruit réels qui faisaient la célébrité de cette côte au temps des premières navigations, comme le mastic a fait la célébrité de Chios durant toutes les navigations italiennes et franques, jusqu'à nos jours. Quand la mode levantine de mâcher la gomme de mastic et de boire l'eau-de-vie de mastic aura disparu, les géographes et botanistes de l'avenir seraient fort en peine de déterminer exactement l'arbre ou l'arbuste dont il s'agit, si les voyageurs des quatre derniers siècles ne nous en avaient laissé quelque vingtaine de minutieuses descriptions. Le nom même du lotos ne semble pas grec : le mot λωτός, pour les Hellènes, désigne une herbe de prairie, une sorte de trèfle, dont se régalent les chevaux : Tu peux avoir des chevaux, dit Télémaque à Ménélas, car tu règnes sur une vaste plaine où le lotos abonde[27]. Il est évident que ce mot grec n'a pas pu s'appliquer au fruit d'un arbre : les géographes helléniques ont connu d'autres Lotophages, qui réellement se nourrissent du lotos grec, c'est-à-dire d'une certaine herbe et de ses racines ; ces Lotophages habitent sur le rivage atlantique, dans le désert[28]. Mais ces Lotophages n'ont rien de commun avec nos mangeurs de fruits ; leur lotos n'est pas le lotos homérique. On a voulu reconnaître dans le nom du lotos (fruit) un mot sémitique lot, dont λωτός serait en effet l'exacte transcription : parfum de ce fruit — βοτάνη εΰοδμος, dit le scholiaste ; εύωδία, dit Polybe, — l'a fait ranger par Théophraste parmi les épices et aromates[29] ; dans l'Écriture lot désigne une espèce de parfum, qui nous est fort mal connu. Le poète odysséen a fait sur ce mot étranger un de ces calembours populaires auxquels nous sommes habitués dans la langue et l'onomastique des peuples navigateurs : le lotos pour lui est devenu le fruit de l'oubli, comme le Léthè était le fleuve de l'oubli dans la mythologie grecque ; le lotos fait tout oublier à ceux qui le mangent : et de ce calembour, lotos, léthé, létho, λήθω, λανθάνω, est sortie toute l'aventure des marins déserteurs, qui oublient vaisseau, devoirs et patrie afin de manger toujours ce fruit délicieux. Nous verrons les autres aventures du Nostos sortir pareillement du texte même et des mots du périple : dans l'épisode des Phéaciens, c'est l'écueil de la Roche du Croiseur qui fait imaginer par le poète la pétrification du vaisseau phéacien. Ici le périple ne devait pas fournir grand'chose à notre auteur, et sa description de la Lotophagie s'en ressent un peu. Cette description est remarquable même par son manque de précision. En cela, elle est en frappant contraste avec toutes les autres descriptions odysséennes ; elle fait tache dans le poème. On se souvient, en effet, de quelle minutieuse exactitude étaient les descriptions de la Phéacie ou de l'île de Kalypso. Nous allons retrouver la même abondance et la même précision de détails quand il s'agira de l'île des Kyklopes ou de la terre des Lestrygons : pour tous les rivages continentaux ou insulaires que le Nostos va longer, vues de eûtes et conseils de pilotage, nos Instructions nautiques ne sont pas plus complètes que le poème odysséen. En Lotophagie, rien de pareil : aucun détail caractéristique ; aucune silhouette précise de montagnes ni de plages. Et pourtant ce sont les Instructions elles-mêmes, qui peut-être nous donneraient la raison de cette surprenante anomalie. Les Instructions nous disent : Les côtes de la Tripolitaine s'étendent sur près de 1000 milles. On ne trouve nulle part au monde une telle longueur de côtes aussi dépourvues de points remarquables ou d'accidents de terrain pouvant servir de repère au navigateur. A l'exception des environs de Tripoli qui sont fertiles et cultivés, la plus grande partie de ce territoire. n'est qu'un vaste et improductif désert. Il n'y existe que très peu de cours d'eau et la côte est basse partout, sauf au promontoire montagneux de Derads, aux environs de Khoms et en certaines parties du golfe de la Serte où se montrent quelques collines[30]. [Tous les mouillages se ressemblent ; la vue de côtes est partout la même.] On mouille devant Zouara et l'on débarque facilement par beau temps. Il y a un village au milieu des dattiers de l'oasis.... Les environs de Tripoli sont plats ; dans l'intérieur et dans l'Est, on trouve beaucoup de palmiers et de jardins ; mais ; dans l'Ouest de la ville, le pays est inculte et sablonneux. La côte se creuse en une baie de 4 milles de profondeur environ. Un ruisseau, appelé Oued-el-Romel, se déverse vers le milieu. A son embouchure on remarque un bouquet de verdure, le premier qu'on rencontre en venant de Tadjoura.... A partir de Ras-el-Hamrah, le pays est bien cultivé et peuplé de nombreux villages entourés de bouquets d'oliviers et de dattiers ; il est arrosé par plusieurs cours d'eau, dont quelques-uns ne sont que des torrents descendant des montagnes pendant la saison des pluies[31].... etc. Au long de cette côte africaine, entre les falaises de Cyrénaïque et les falaises de Tunisie, c'est la même monotonie, les mêmes sables alternant avec les mêmes bouquets d'arbres, les mêmes ravins desséchés alternant avec les mêmes maigres ouadis. Au-devant d'une terre sans relief, sans grandes ondulations, les mouillages ne se peuvent distinguer les uns des autres que par leurs différents noms. Les Grecs leur donnaient à tous le nom générique de Emporion ; les Arabes leur donnent le nom générique de Marsa : dans les deux langues, ces deux mots signifient simplement mouillage. Pour les Grecs, la côte s'appelait les Emporia, τά Έμπόρια, et chacun de ces mouillages avait sans doute son qualificatif grec, comme il a aujourd'hui son qualificatif arabe : Marsa Talfan, Marsa Djida (Port Neuf), Marsa Sousah, Marsa Tebrou, Marsa-el-Tiga (Port des Pommes). Ce dernier mouillage est sur l'île même de Djerba : son nom peut nous expliquer, je crois, le Port du Lotos que fréquentaient nos premiers navigateurs. Entre ces mouillages, pourtant, les marins de tous les temps ont fait quelques différences. Certains mouillages ont de l'eau douce : Aghir est un gros village. On y trouve des provisions, de l'eau douce fournie par un puits et des citernes.... On trouve à Adjim des ressources en vivres. On peut s'y procurer aussi de bonne eau. Une citerne voisine du bordj en contient toujours trente à quarante tonnes.... Guallala, sur la côte Sud de Djerba, est un centre important où l'on trouve de l'eau de citerne et quelques ressources en vivres : il est fréquenté par les mahonnes qui viennent y charger des poteries, etc. Les autres mouillages n'ont pas d'eau : On trouve à Sfax d'abondantes ressources en vivres frais. L'eau potable était autrefois rare. Elle était fournie par des citernes, des puits ou des feskias, réservoirs aménagés pour capter l'eau des oueds pendant la saison d'hiver. Les puits de Shabuny étaient réservés à la garnison française. Aujourd'hui une conduite amène jusqu'aux quais l'eau captée dans les montagnes voisines.... La S'rira est un important entrepôt d'alfa. Mais le pays n'offre aucune ressource ; l'eau potable est peu abondante et de mauvaise qualité.... L'îlot est habité par quelques pêcheurs. Il y aurait de l'eau douce si les citernes du fort n'étaient pas complètement délabrées[32]... etc. Notre Marsa du Lotos a une aiguade : ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ᾽ ὕδωρ[33] Mais, pour les premiers navigateurs, ces divers mouillages ont entre eux d'autres différences encore : les vieux périples n'oublient jamais de spécifier quelle est l'attitude ordinaire des indigènes en face du commerce étranger. Ces indigènes sont-ils accueillants ou hostiles, amis ou ennemis de l'étranger ? respectent-ils les contrats et le droit humain, sont-ils justes ? sont-ils, au contraire, des sauvages sans lois ni police ? respectent-ils les serments et le droit divin, ont-ils l'esprit religieux ? ne respectent-ils, au contraire, aucune loi divine ni humaine ? Telles sont les premières questions que se posent les capitaines marchands ou corsaires, débarqués sur une côte inconnue : Attendez-moi là, dit Ulysse à ses compagnons ; je m'en vais voir ce que sont ces peuples, violents ou pacifiques, sauvages et sans respect du droit ou hospitaliers et religieux. La formule revient deux ou trois fois dans l'Odyssée :
ἐλθὼν τῶνδ᾽
ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵ τινές εἰσιν,
ἤ
ῥ᾽ οἵ γ᾽
ὑβρισταί τε καὶ
ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής[34]. Les vieux périples ne manquent jamais de répondre, par avance, à ces graves questions : Les Corses, parmi tous les Barbares, se distinguent par leur rapports d'équité et de douceur ; les rayons de cire (la Corse en produit beaucoup) appartiennent au premier qui les trouve ; les troupeaux paissent sans gardiens et la seule marque de leurs propriétaires suffit à les protéger ; dans tous les autres détails de la vie corse, c'est le même souci et le même respect du droit[35]. Ainsi parle Diodore qui doit, ici encore, résumer en les copiant, les appréciations des périples antérieurs. Nous voyons comment, dans sa description du golfe Arabique, il copie le périple d'Agatharchide[36] : Les nègres Ichthyophages ne prêtent aucune attention au débarquement ni aux actes de l'étranger ; ils regardent et se taisent ; les coups ni les injures ne peuvent même les faire sortir de cette apathie.... Gens heureux ! ajoute l'auteur du périple — il vit à une époque philosophique où il est de mode de vanter les vertus de la vie sauvage et le bonheur de l'homme à l'état de nature —. Ils ne se torturent ni par la recherche des honneurs ni par les soucis des procès. Ils n'ont pas de lois ni de tribunaux. Ils vivent dans l'heureuse ignorance des décrets et de la lettre écrite. Ils ne naviguent pas : ils savent préférer la vie aux affaires. Bref, ayant peu de besoins, ils ont aussi peu de chagrins[37]. On voit que notre auteur a fait ses classes et que, vingt siècles avant J.-J. Rousseau, il sait apprécier les malheurs de la civilisation et la félicité des anthropoïdes qui vivent sans tribunaux, sans lois, sans commerce, sans villes, sans provinces, sans classifications artificielles, sans aucune notion du bien ni du mal[38]. Le périple odysséen, qui n'est pas d'un rhéteur de métier, mais d'un navigateur et d'un homme pratique, ne partage pas cette admiration pour les brutes humaines. Il va bientôt nous décrire sans enthousiasme la vie des sauvages de Campanie, qui, eux aussi, ignorent le droit, les tribunaux, les assemblées, qui vivent en clans ou en familles isolées, chacun disposant â son gré de ses enfants et de ses femmes, qui ne naviguent ni ne cabotent, et qui, faute de vaisseaux, ne savent ni faire de leur Petite Ile une grande place de commerce, une ville bien bâtie, ni amener chez eux les produits du monde, . . . . . . . . . . . . . . οἷά τε
πολλὰ ἄνδρες ἐπ᾽
ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι θάλασσαν οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐυκτιμένην ἐκάμοντο[39]. Du rhéteur au poète, le ton est différent ; mais la matière est la même. De part et d'autre, ce sont des renseignements de navigateurs, des Instructions nautiques, qui ont fourni le thème. Si le rhéteur en a tiré une ridicule déclamation, le poète ici comme toujours a respecté et copié fidèlement ses modèles ; il n'a fait qu'une description exacte, nullement légendaire, nullement embellie, de la vie sauvage dans les mers italiennes de son temps. Les Lotophages sont justement l'opposé des Kyklopes. Ce ne sont pas des civilisés, à coup sûr, des Mangeurs de Pain. Mais ce sont des hommes justes, hospitaliers, qui n'attentent jamais à la vie ni aux biens des navigateurs. Leur nourriture fleurie leur fait une âme douce et une vie :si heureuse qu'ils n'ont aucune haine au cœur. Ils donnent le lotos aux marins qui les visitent ; ils les traitent si bien que, chez eux, les équipages désertent : οὐδ᾽
ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ᾽ ἑτάροισιν
ὄλεθρον
ἡμετέροις, ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι[40]. Jusqu'à nos jours, les navigateurs se sont transmis ce renseignement ; en nous décrivant l'île des Lotophages philoxènes, nos Instructions nautiques nous disent encore : les habitants de Djerba sont très hospitaliers. Pour les premiers navigateurs, pour les Phéniciens surtout, cette hospitalité devait avoir un grand prix. Considérez en effet quelle place tenait cette île sur les grandes routes du commerce phénicien. Soit qu'il ait caboté tout au long des côtes libyques ; soit qu'il ait coupé droit, suivant le chemin d'Europè et de son taureau, suivant aussi le chemin d'Ulysse en son conte crétois, et qu'après avoir gagné les côtes de Crète, il ait, au gré des vents du Nord-Est, vogué vers ces côtes africaines : le commerce phénicien trouve en ce pays des Lotophages son premier reposoir absolument sûr, la seule station d'hivernage où les vaisseaux et les équipages puissent, sans danger, passer la mauvaise saison. Car les côtes libyques ne lui ont offert jusque-là que de mauvais abris temporaires, avec des roches aiguës fatiguant les carènes, et de brusques rafales exténuant les équipages. Sur les deux mille kilomètres de ces côtes libyques, Tripoli et Tobrouk sont les seuls ports où un bâtiment d'un tonnage quelque peu élevé puisse trouver un sûr abri. Le second de ces points est le seul pouvant recevoir un cuirassé et lui offrir un mouillage assuré par tous les temps[41]. Le commerce primitif connaissait aussi deux ou trois points de relâche temporaire, des refuges sous des îlots. Mais depuis l'Égypte, depuis Pharos, Djerba était en réalité la première île, qui offrit entre elle et le continent libyque un véritable abri contre la mer sauvage. L'île de Djerba, disent les Instructions nautiques[42], est séparée du continent par un vaste bassin, de près de 500 kilomètres carrés de superficie, dont les bords sont presque partout encombrés de hauts-fonds, mais qui présente en son milieu une belle rade intérieure, admirablement abritée : c'est la mer de Bou-Grara, appelée par les Arabes Bahiret (Petite Mer) de Bou-Grara. Ce bassin communique avec la haute mer par l'Ouest et par l'Est.... La mer de Bou-Grava est très riche en poissons et en éponges. On évalue à 500 le nombre des bateaux employés aux diverses sortes de pêche. Les ruines importantes que l'on trouve sur le pourtour de ce bassin montrent combien il était fréquenté à l'époque romaine. L'entrée Ouest du Bahiret vers la haute mer porte le nom de canal d'Adjim : on peut mouiller devant cette côte par tous les vents, sauf les vents violents du N.E. et de l'Ouest ; si, après avoir mouillé, on était surpris par des vents de cette partie et gêné par la mer, on aurait un refuge assuré devant Humt-Suk. Le canal de l'Est du Bahiret n'est praticable que pour les barques d'un faible tirant d'eau. [Mais, de ce côté], le mouillage d'Aghir est peut-être le meilleur qu'offre la côte de Djerba. Il est abrité par l'île des vents de l'Ouest et du Nord ; avec les vents de la partie Est, la houle s'amortit sur les hauts-fonds et les herbes. Le mouillage est en outre protégé par un banc de 8 à 9 mètres, qui s'étend parallèlement au rivage à 4 milles de distance. On mouille aussi près d'Aghir que le tirant d'eau le permet. Aghir est un gros village. On y trouve des provisions, de l'eau douce fournie par un puits et des citernes. Une route carrossable de 19 kilomètres de long relie ce port à Humt-Suk. En regard de ces Instructions, mettez le récit d'Ulysse et voyez si l'aventure odysséenne ne se passe pas en un lieu tout semblable à ce mouillage d'Aghir, en un débarcadère pourvu d'eau douce, mais éloigné du bourg principal qu'habitent les Lotophages. Ulysse, installé au mouillage, envoie deux hommes et un héraut sur la route de ce marché. Comme ils ne rentrent pas à bord, il va les chercher et les ramène de force : Nous abordons au pays des Lotophages. Nous descendons à terre, nous faisons de l'eau et, sans retard, mes équipages prennent leur repas auprès des croiseurs. Puis, quand on eut satisfait à sa faim et à sa soif, j'envoyai deux hommes, avec un héraut pour les escorter, à la découverte sur les mœurs des indigènes, afin de voir quels étaient ces Mangeurs de Pain. Mes hommes étant partis se mêlèrent bientôt à un peuple Mangeur de Lotos. Les Lotophages furent sans pensées meurtrières à l'égard de mes compagnons. Ils leur donnèrent un plat de lotos et sitôt que mes hommes eurent goûté de ce fruit doux comme le miel, pas un ne songea plus à nous donner des nouvelles ni à revenir : ils ne voulaient plus que rester parmi ces Lotophages, se gorger de lotos et ne pas songer au retour. Je dus en personne les ramener aux vaisseaux, de force, malgré leurs larmes. Je les fis coucher et lier au fond des croiseurs, sous les bancs, et, en toute hâte, je fis embarquer aussi le reste de mes équipages, de peur que, mangeant du lotos, quelqu'un voulût encore ne plus songer au retour. En toute cette histoire, les Lotophages usent envers les navigateurs d'une hospitalité et d'une tolérance sans bornes : Ulysse ramène de force ses déserteurs, sans que les indigènes interviennent. Entre ces Lotophages et les Peuples de la mer, il semblerait vraiment qu'il existât des conventions, des traités de police et d'extradition, ou, tout au moins, des précédents de bonne entente et de parfaite harmonie. Le commerce seul et ses bénéfices ont pu donner aux Lotophages une pareille bienveillance envers les étrangers, et nous voyons, en effet, soit par les habitudes actuelles, soit par les récits des Plus Anciens, que le commerce primitif dut trouver en cette île de Djerba un important marché de ravitaillement et de transit. Maîtres des sources insulaires et propriétaires de florissants jardins, les Lotophages devaient vendre des provisions aux étrangers. En outre, cette île se prête à l'industrie : Les industries locales, disent les Instructions nautiques, sont la fabrication des tissus de laine et des poteries. Les collines fournissent une argile plastique, qui sert à fabriquer des vases communs ; de nombreux fours sont signalés de loin par leur fumée.... Guallala, sur la côte Sud de Djerba, est un centre important où l'on trouve de l'eau de citerne et quelques ressources en vivres ; il est fréquenté par les mahonnes, qui viennent y charger des poteries[43]. Je livre ce texte à la réflexion des archéologues, qui ont signalé de curieuses ressemblances entre les poteries berbères et les poteries dites mycéniennes. Mais c'est le transit surtout qui devait enrichir cette Lotophagie. La côte des Syrtes a toujours été le point d'aboutissement des grandes routes continentales qui, à travers le Sahara, unissent le Pays des Nègres, — Éthiopie, disaient les Anciens ; Soudan ou Nigritie, disons-nous aujourd'hui, — aux ports méditerranéens. Cyrène, durant l'antiquité classique, et Tripoli, durant les temps modernes, ont été les grands ports du Soudan vers l'Europe, et réciproquement[44]. Mais Cyrène et Tripoli supposent un commerce installé sur le continent, et des étrangers, Grecs ou Arabes, conquérants ou colons de la terre ferme. Nous savons qu'aux emporia continentaux, nos thalassocrates de la Méditerranée primitive préféraient les mouillages insulaires et qu'ils n'avaient pas de colonies, à proprement parler, mais des stations temporaires ou permanentes sur un îlot ou sur un promontoire. En cet état de navigation, la Lotophagie était pour eux le siège le plus favorable du commerce vers le Soudan, et, de fait, les plus vieux périples, copiés par Hérodote[45], signalent l'arrivée en ce point de l'une des grandes routes soudanaises. Hérodote nous énumère, en effet, les trois grandes routes qui viennent du Soudan : l'une, par l'oasis d'Ammon, conduit à l'Égypte ; la seconde, par Augila et le pays des Nasamons, aboutit au fond de la Grande Syrte (les caravanes du Soudan oriental empruntent encore aujourd'hui cette route d'Aoudjila vers Benghazi) ; la troisième enfin, par l'intermédiaire des Garamantes, arrive en Lotophagie. Cette troisième route aujourd'hui s'est un peu détournée de Djerba : depuis le pays des Garamantes, que nous appelons aujourd'hui l'oasis de Ghadamès, elle s'infléchit à l'Est et vient, par un plus long parcours aboutir à Tripoli où les Arabes, puis les Turcs, ont, de force, amené tous les échanges[46]. Mais, en droite ligne, cette route de Ghadamès devrait arriver à Djerba, et Hérodote a raison de dire que la Lotophagie en est l'aboutissement le plus direct. Les Garamantes, au temps d'Hérodote déjà et de toute éternité sans doute, se livrent contre les Soudanais, contre les Nègres des Cavernes, les Éthiopiens troglodytes, à ces razzias et chasses à l'homme qui ont duré jusqu'à nos jours. Les Garamantes fournissent donc d'esclaves les marchés de Lotophagie. Ils y vendent aussi les produits que le Soudan n'a jamais cessé de fournir au monde méditerranéen, l'ivoire, les cuirs, le natron, le sel, surtout la poudre d'or et les plumes ou les œufs d'autruche[47]. C'est ici que les Peuples de la mer viennent s'approvisionner de ces denrées soudanaises et c'est ici qu'ils viennent décharger leurs tissus et manufactures à destination de l'Éthiopie : la Lotophagie est un de leurs grands marchés. Il semble en outre qu'aux temps homériques, les thalassocrates sidoniens ou tyriens n'avaient pas encore jalonné la côte africaine de ces Bourgs-Neufs, Macom-Hades, et Villes-Neuves, Karth-Hadast, qui plus tard joueront un si grand rôle et deviendront le siège d'un nouvel empire maritime autour de la plus grande de ces Villes-Neuves, Carthage. Les auteurs de l'antiquité sont, en général, d'accord pour reporter à l'an 813-814 av. J.-C. la fondation de Carthage[48] : je crois que notre Méditerranée odysséenne est antérieure d'un ou deux siècles, peut-être, à cette fondation. Avant l'établissement de ces colonies puniques, c'est parmi les indigènes que les Phéniciens avaient leurs correspondants et commissionnaires. Aux temps odysséens, les Lotophages tiennent le rôle et les bénéfices qui plus tard écherront à Carthage. Les Lotophages ont, parmi les marins, la renommée dont Carthage jouira dans toute la Méditerranée postérieure. Chez les thalassocrates, les récits, légendes et populaires représentations du monde maritime doivent imaginer cette Lotophagie comme la véritable porte des grandes mers occidentales. Et de fait, toutes différences gardées, les Lotophages sont alors en une situation analogue à celle des Phéaciens : ils ouvrent, eux aussi, l'entrée d'un détroit vers les mers lointaines. Les flottes venues de l'Orient ont jusque-là navigué vers le Couchant avec les vents d'Est ou de Nord. A partir de la Lotophagie, elles doivent tourner à angle droit pour longer le rivage tunisien et enfiler le détroit entre la Sicile et l'Afrique (c'est la route qu'Ulysse va prendre tout à l'heure). Pour ce changement de route, les marins trouvent une aide précieuse dans les courants du golfe : C'est dans le golfe de Gabès, disent les Instructions nautiques[49], que les marées présentent la plus grande amplitude observée dans la Méditerranée. Le flot, venant de l'Est, longe la côte Nord de Djerba, avec une vitesse qui dépasse un nœud. Puis, en pénétrant dans le golfe, le flot s'épanouit. Devant Gabès même, le flot parait courir au Nord ; la marche du jusant serait contraire. Les marins, qui veulent aller vers le Nord, peuvent donc profiter de ce courant du flot. Mais le régime des vents leur est moins favorable. Les vents du large sont ici tout à fait prépondérants. Pour la navigation, il n'y a d'intéressant que les vents ayant une certaine force. Si l'on ne tient compte que des brises cotées 4 et au-dessus (suivant l'échelle de 0 à 10), on trouve pour 100 de ces vents :
En ce régime, les vents de la partie Nord forment, on le voit, 62 pour 100 ; les vents de la partie Sud, au contraire, dont auraient besoin nos navigateurs vers le détroit sicilien, ne forment que 17 pour 100. La Lotophagie devient ainsi une halte forcée, un séjour d'attente où les capitaines peuvent désirer, durant de longues semaines, les brises favorables du Sud. Comme Ménélas dans l'île de Pharos, les thalassocrates primitifs ont dû séjourner ici. Mais Pharos, déserte et rocheuse, était sans agrément et sans ressources. Djerba, populeuse et fertile, offre aux équipages tous les plaisirs de la table et de l'hospitalité. Ces Libyens ont pour les rapports entre hommes et femmes une affectueuse tolérance[50]. Les périples primitifs devaient déjà vanter cette Libye hospitalière, comme ils décriaient la férocité de certaines autres peuplades : τούτων δέ καθύπερθεν Αίθίοπες ώκουν άξενοι dit le périple d'Hannon[51]. Les équipages ne demandaient donc qu'à séjourner interminablement ici et à oublier le retour. Nous connaissons ces îles de l'Archipel franc, où les marins trouvent aussi des plaisirs, qui les retiennent trop longtemps dans la rade et leur font oublier leur devoir ainsi que l'intérêt de leurs armateurs[52]. Hannon ayant trouvé des amis sur la côte occidentale, y séjourne pareillement[53]. |