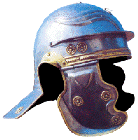HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME II
CONCLUSION.
|
Lorsque l'on parcourt l'histoire du dernier siècle de Mais pourtant cette apparence de fatalité est trompeuse. Une étude attentive des causes des événements dissipe cette illusion. Non-seulement les hommes peuvent retarder même les effets inévitables du mouvement général des choses, mais ce mouvement lui-même est toujours imprimé aux choses par un concours de volontés libres. Cette crise, où un peuple décide librement de sa destinée, ce moment de l'effort volontaire, qui produit plus tard ses conséquences logiques, arriva pour les Romains aussitôt après le triomphe du premier Africain, 200 av. J.-C. Les Romains, victorieux de Carthage, se contenteraient-ils de l'Italie ou en sortiraient-ils pour s'élancer à la conquête du monde, telle était la question décisive soumise aux délibérations du Sénat et du peuple[1]. Tout dépendait, pour bien des siècles, du choix à faire entre ces deux partis. Voyons donc ce que Rome avait le droit d'espérer si les conseils de la modération et de la justice l'avaient emporté, et à quoi elle devait s'attendre si elle ne s'inspirait que de son ambition et du pressentiment de sa grandeur. Après la création des premières tribus rustiques et du
tribunat de la plèbe, il était certain que Rome ne serait pas une petite cité
comme celles de Si Rome contenait sa puissance en Italie, elle pouvait y fonder, en tempérant l'autorité de la noblesse sénatoriale par celle de l'aristocratie des chevaliers, un gouvernement à la fois libre et national. Elle n'avait à redouter aucune des menaces que ses voisins pouvaient lui faire. Le consul P. Sulpicius qui, en l'an 200 av. J.-C., conseillait au peuple la guerre contre le roi de Macédoine, prétendait que, si les Romains ne passaient pas en Grèce, Philippe allait descendre en Italie : sophisme de l'ambition conquérante, qui prête toujours des plans agressifs à ceux qu'elle veut attaquer. Philippe eût-il réussi où Pyrrhus et Annibal avaient échoué ? Il ne songeait même pas à les imiter[2]. Annibal lui-même eût-il recommencé son entreprise, n'ayant plus ni son armée d'Espagne, ni sa jeunesse, ni l'espérance ni le prestige de ses victoires ? Rome pouvait sans danger rester sur la défensive. A l'intérieur, sa situation n'était pas moins belle. Quelques petites guerres du côté des Alpes l'exerçaient sans l'inquiéter. Ayant déjà 9470,000 citoyens en état de porter les armes, elle pouvait en augmenter le nombre en communiquant peu à peu le droit de cité aux peuples italiens. Elle eût ainsi agrandi la première classe des citoyens. L'ordre équestre, étant à la fois aristocratie vis-à-vis des Italiens et plèbe vis-à-vis des nobles de Rome, eût allié la dignité et la sagesse des anciennes familles à la largeur d'esprit, à l'ambition novatrice des hommes nouveaux. Il eût été, dans les municipes, le gardien des traditions, à Rome, le gardien de la liberté. Dans un état d'une grandeur modérée, le cens de 400.000 sesterces (86.000 fr.), qui séparait les chevaliers du reste de la plèbe ; était assez élevé pour empêcher la confusion des classes et les bouleversements sociaux. Il ne l'était pas assez pour décourager l'ambition honnête des familles laborieuses. Au-dessous des chevaliers, les classes moyennes, encore puissantes en l'an 200 av. J-C., étaient habituées aux occupations sérieuses de l'agriculture. Les esclaves, peu nombreux, presque tous de la forte race italienne, avaient les mêmes goûts que leurs maîtres et ne pouvaient pas les corrompre. Le gouvernement libre était aussi facile à constituer que la société à maintenir. En devenant une nation, les Romains avaient déjà tous les éléments du gouvernement représentatif. Qu'était-ce que le Sénat, où l'on arrivait par les magistratures curules, c'est-à-dire par les suffrages du peuple des centuries, sinon l'élite des hommes politiques des 35 tribus, la représentation des cantons de l'Italie romaine ? Cent cinquante ans après, Cicéron disait encore aux sénateurs : Combien y en a-t-il parmi nous qui ne soient pas des municipes ?[3] Ainsi, en laissant arriver aux honneurs les hommes nouveaux des familles équestres, on était sûr de faire du Sénat une véritable représentation, une chambre haute avec pouvoir électif et viager. Les dix tribuns de la plèbe, dont le collège prenait souvent ses résolutions à la majorité des voix, étaient élus par les tribus, où tous les citoyens votaient sans distinction de fortune. Il suffisait d'augmenter leur nombre et leurs attributions collectives, pour en faire une chambre basse renouvelée tous les ans. L'Assemblée centuriate, Où les trois premières classes décidaient tout, n'avait rien de tumultueux. L'Assemblée des tribus, plus accessible aux passions démagogiques, était contenue par les lois religieuses restreignant le nombre ou la durée des réunions. Rome, en l'an 900 av. J.-C., n'avait donc rien à craindre ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Elle pouvait perfectionner à loisir cette constitution qu'admiraient encore plus tard Polybe et Cicéron. Aucune puissance au monde n'avait intérêt à la provoquer, et si elle se décidait à la guerre de conquête, c'était avec la liberté de la toute-puissance. Aussi la responsabilité de la décision devait peser longtemps sur la nation romaine. Les sénateurs venaient de voir défiler sous leurs yeux le
magnifique triomphe du vainqueur d'Annibal. Beaucoup d'entre eux voulaient
triompher à leur tour. Le cens équestre de 400.000 sesterces resta toujours le même, tandis que les richesses du monde s'entassaient en Italie. Des affranchis et des indignes y parvenaient en grand nombre. La soumission de l'Egypte par Octave, les victoires de Vespasien, de Titus, de Trajan, en jetant dans la circulation de l'Italie des masses de numéraire, firent hausser le prix des propriétés et confondirent les classes. L'ordre équestre perdit toute dignité et finit, au temps d'Adrien, par s'effacer comme classe de la société, pour ne subsister que comme institution politique. Si donc l'on se demande pourquoi les chevaliers romains, c'est-à-dire cette élite des classes moyennes qui est partout la meilleure F die de la nation, n'a pas su à Rome fonder un gouvernement libre ; ni établir entre les pouvoirs une sage pondération, on arrive à se l'expliquer ainsi : c'est qu'à Rome, tout équilibre, non-seulement entre les pouvoirs, niais entre les classes de la société, était sans cesse rompu par le mouvement de la guerre perpétuelle ; c'est qu'en l'an 200 av. J.-C., quand il pouvait se contenter de l'Italie, le peuple romain avait prémédité, délibéré et voté la conquête du monde, et que, pour son malheur, il réussit à la faire. Le Sénat, du reste, en prenant cette résolution n'était pas guidé seulement par les pensées d'une ambition vulgaire. Il sentait Rome appelée par une pensée divine, par une providence qu'il nommait aussi destin, à donner dès lois au monde. L'orgueil de cette mission fit marcher la noblesse de Rome vers un avenir de grandeur extraordinaire avec la constance des hommes qui mettent leur passion à faire leur devoir. Ils firent, les uns par égoïsme, les autres par élan réfléchi vers le but qu'ils croyaient marqué par le destin, le plus grand de tous les sacrifices. Rome pensait conquérir le monde. Elle se donnait à lui. Sous la main de Dieu, elle travailla à l'avenir de l'humanité et elle perdit le sien. Elle montra à tous les peuples le type de la discipline et du gouvernement régulier, de l'unité nationale et de l'égalité civile, type qu'elle ne put réaliser pour elle-même d'une façon durable. Ce n'est pas à nous de nous en plaindre, puisque nous avons hérité de ses lois ; de sa littérature et de sa langue. Mais l'Italie a expié par des siècles de servitude politique les conquêtes des Romains. Rome, en répandant partout ses armées et ses lois, avait fini par attirer sur l'Italie les regards et les forces du monde entier. Ce pays eût donc été moins grand, mais plus heureux, si Rome, se bornant à son domaine propre, n'eut rêvé rien au-delà de cette liberté tempérée et de cette unité nationale de l'Italie, dont la gardienne naturelle était la bourgeoisie italienne, la classe des chevaliers romains. FIN DU DEUXIÈME ET DERNIER TOME |