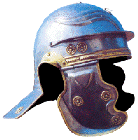HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME II
LIVRE PREMIER. LES CHEVALIERS ROMAINS DEPUIS LE TRIBUNAT DES GRACQUES
JUSQU'À LA DICTATURE DE
CÉSAR.
CHAPITRE IV. LES PUBLICAINS.
|
Les révolutions politiques ont souvent pour cause le déplacement graduel de la fortune privée, qui fait passer l'influence d'une classe aristocratique à une classe plus intelligente, plus active et plus économe. Dans un des premiers parlements du règne de Charles Ier, dit M. Guizot, on remarquait avec surprise que la chambre des Communes était trois fois plus riche que la chambre des Lords. La haute aristocratie ne possédait plus et n'apportait plus à la royauté, qu'elle continuait d'entourer, la même prépondérance dans la nation. Les simples gentilshommes, les francs-tenanciers, les bourgeois, uniquement occupés de faire valoir leurs terres, leurs capitaux, croissaient en richesse, en crédit, s'unissaient chaque jour plus étroitement, attiraient le peuple entier sous leur influence, et, sans éclat, sans dessein politique, s'emparaient en commun de toutes les forces sociales, vraies sources du pouvoir[1]. Les chevaliers romains, occupés aussi à faire valoir leurs
terres et leurs capitaux, avaient conçu une ambition proportionnée à leur
fortune. Pour comprendre comment ils parvinrent à dominer Les occupations financières n'étaient pas, pour une catégorie de chevaliers, une spécialité exclusive. Les mêmes hommes étaient, selon les circonstances, militaires, banquiers, publicains ou juges[2]. Ti. Pomponius Veientanus, ancien publicain, fut préfet des alliés latins et livra un combat à Hannon, dans le Brutium[3]. En 214 av. J.-C., les publicains, en prenant une adjudication de l'état, se firent dispenser du service militaire pour tout le temps où ils seraient occupés de cette entreprise[4]. La variété des affaires où nous allons voir les chevaliers romains engagés, ne doit pas nous faire perdre de vue l'unité de l'ordre équestre. Banquiers, entrepreneurs de fournitures ou de transports, fermiers des douanes, des pâturages, des terres publiques, décimateurs, tous avaient été ou pouvaient être appelés au service de la cavalerie légionnaire, et après l'an 123 av. J.-C., aux fonctions de la judicature. Leurs occupations n'avaient donc aucun caractère professionnel. 1° Les banquiers (negotiatores). Les chevaliers qui faisaient le métier de banquiers suivaient un des plus anciens usages de la vie romaine[5]. La banque avait été, à Rome, le moyen le plus souvent employé pour s'enrichir, et la plus grande révolution qui suivit l'expulsion des rois, eut pour cause l'avidité des créanciers qui dépouillaient leurs débiteurs de leurs biens et de la liberté[6]. Le taux de l'intérêt était arbitraire jusqu'au temps des décemvirs. La loi des Douze Tables le fixa à 1 p. 100 par mois, intérêt qui fut appelé usur centesim ou encore, parce qu'on payait l'intérêt annuel, comme nos impôts, par douzièmes, fenus unciarium. Ce taux légal resta toujours le même chez les Romains[7]. Mais les usuriers éludèrent la loi, et les misères qui avaient amené l'établissement du tribunat de la plèbe, se renouvelèrent plus d'un siècle après[8]. Il fallut une loi des tribuns de la plèbe, Mænius et Duilius (354 av. J.-C.), pour ramener l'intérêt au taux légal de 1 p. 100 par mois[9]. Dix ans plus tard, d'autres tribuns firent voter que l'intérêt ne serait plus que d'un demi p. 100 par mois (semunciarium fenus)[10]. Enfin, en 339 av. J.-C., le tribun L. Genucius imagina, pour détruire la tyrannie des capitalistes, cet expédient, toujours aussi impuissant et aussi absurde qu'il semble radical : c'était de supprimer complètement l'intérêt de l'argent[11]. Toutes ces lois furent inutiles. Seulement quelques procès furent intentés aux usuriers devant le peuple, par les édiles curules, qui, avec le prix des amendes, présentèrent au peuple des jeux plus brillants, aux dieux quelques offrandes dorées[12]. La seule loi efficace en faveur des débiteurs, fut celle des consuls de l'an 323 av. J.-C., qui ordonna qu'à l'avenir on ne mit aux fers ou dans les liens que les criminels, et que le bien du débiteur et non son corps fût le gage de sa dette[13]. Dès le temps de Tarquin, s'étaient élevées autour du Forum
des boutiques où les changeurs établirent leurs comptoirs[14]. Aux opérations
du change (collybus),
ils joignirent le commerce des bijoux[15] et les fonctions
de greffiers ou de commissaires des ventes publiques prêtant de l'argent aux
adjudicataires. Enfin ils tenaient les comptes-courants des particuliers, qui
déposaient à leur caisse les fonds que ces banquiers faisaient valoir[16]. Leurs registres
faisaient foi en justice et ils avaient ainsi une partie des profits du
commerce de l'argent et quelques-unes des attributions du notariat[17]. En province,
les publicains tinrent de même des banques de comptes-courants. Cicéron,
quittant Si ces banquiers (argentarii) avaient de bonne heure donné plus de régularité aux opérations du prêt, les crises monétaires n'en étaient pas moins fréquentes à Rome. Alors l'Etat se chargeait lui-même de la banque, en nommant trois ou cinq commissaires (triumviri, quinqueviri mensarii), pour tenir un comptoir public. Ces commissaires avançaient aux débiteurs de quoi payer leurs dettes en prenant, pour le trésor, des garanties sur les biens[19] des emprunteurs, ou ils forçaient les créanciers à recevoir les biens des débiteurs en paiement pour le prix où ils étaient évalués sur les dernières listes du cens. C'est ce que fit César dans son second consulat, en 48 av. J.-C. Une liquidation semblable eut lieu dès l'an 349 av. J.-C. Cette mesure fit changer de main tant de propriétés que l'année suivante, 348 av. J.-C., les censeurs durent renouveler les opérations du cens[20]. Si le régime hypothécaire[21] n'était pas encore régulièrement constitué, on trouvait le moyen d'en faire de très larges et très nombreuses applications. La garantie exigée par l'Etat, pour les avances en argent qu'il faisait aux débiteurs par cette sorte de crédit foncier, était, en général, une valeur en biens double de la somme prêtée[22]. Tant de lois ou de mesures restrictives de l'usure
engagèrent enfin les capitalistes à se servir, pour y échapper, de
l'intermédiaire des Latins que les lois romaines n'obligeaient pas. Mais une
loi de l'an 193 av. J.-C. força les Latins à faire déclaration de toutes les
créances où ils avaient figuré comme prête-noms, -et assujettit désormais à
la loi romaine le règlement de toutes les dettes contractées entre les
citoyens romains et les alliés[23]. Dès lors, pour
exiger impunément des intérêts usuraires, il fallut placer son argent dans
les provinces. La force des choses agissait ici dans le même sens que la loi.
Les conquêtes, en accumulant le numéraire dans l'Italie centrale, en avaient
dans ce pays diminué le loyer. Au temps de Cicéron, le vieux banquier
Cæcilius, qui exigeait l'intérêt légal d'un pour cent par mois, ne trouvait
plus guère d'emprunteurs[24]. L'on avait de
l'argent dans Rome à 4 p. cent par an, en temps ordinaire, à 8 p. cent par
an, quand la brigue électorale et la dépense des candidats rendaient la
demande plus forte[25]. Voici donc le
commerce que faisaient depuis les guerres puniques, les banquiers, presque
tous sortis de l'ordre équestre[26]. Ils
empruntaient à Rome à un taux modéré, et ils prêtaient en province à un taux
exorbitant. Ils gagnaient la différence des intérêts. C'est ainsi que P.
Sittius avait, à Rome, contracté des dettes, mais, en province, il avait de
nombreux débiteurs, parmi lesquels Hiempsal, roi de Mauritanie[27]. Aussi il
suffisait de la révolte d'un pays lointain comme l'Asie, cet Eldorado des
publicains, pour faire suspendre les paiements dans les comptoirs des
banquiers du Forum. La guerre de Mithridate, 88 av. J.-C., eut pour
contrecoup, sur la place de Rome, une crise monétaire, et la ruine du crédit[28]. Les
proscriptions de Sylla, dirigées surtout contre les publicains ou
capitalistes, renouvelèrent cette crise et épuisèrent le trésor.
L'exploitation financière étendait son réseau sur toutes les provinces. En Gaule, nous dit Cicéron, il ne se déplace pas un écu qui ne soit porté sur les registres des
citoyens romains[29]. Le Romain était
dans l'antiquité ce que fut le juif au moyen âge, avec cette différence, que
le Romain exerçait la persécution, au lieu de la subir. Mais les débiteurs se
vengeaient quelquefois. La révolte des Gaules sous Vercingétorix commence par
le massacre des banquiers romains de Genabum, dont l'un nous est connu par
son nom : c'était le chevalier romain C. Fusius Cita[30]. Plus tard,
Florus et Sacrovir excitaient encore les Gaulois à la révolte, en leur
parlant de l'usure qui les écrasait[31]. Mais rien
n'égalait les souffrances infligées à la province la plus riche de la terre,
à l'Asie, par ses rapaces dominateurs. Là, le banquier se faisait le complice
des passions du magistrat qui portait l'épée, et celui-ci, en échange, lui
prêtait main-forte contre ses débiteurs. Verrès, lieutenant du proconsul
Dolabella, pour se venger de Philodamos de Lampsaque, qui avait défendu
contre lui l'honneur de sa famille, lui suscitait des accusateurs parmi les
créanciers romains. Ceux-ci comptaient sur les licteurs de Verrès pour se
faire rembourser des Grecs[32]. Le questeur C.
Malleolus, partant de Rome pour Ossa vides regum vacuis exsucta medullis. Trente-trois talents (71.500 francs) ne suffisaient pas à payer les intérêts mensuels des sommes que l'infortuné roi de Cappadoce avait empruntées à son protecteur[36]. L'usure de Brutus était encore plus monstrueuse. Le grand avocat des publicains, Cicéron, avoue qu'elle lui faisait dresser les cheveux. Brutus disputait à Pompée le malheureux Ariobarzane comme une proie à dévorer. En six mois il tira de lui cent talents (550.000 francs), pour un prêt plus de moitié moindre que celui pour lequel Pompée en exigea deux cents[37] (1.100.000 francs). M. Scaptius et Gavius étaient les deux limiers que Brutus lançait contre le roi de Cappadoce, et Cicéron, à la demande du chevalier Atticus, son ami, sans doute intéressé là-dedans, avait donné à ces deux tyrans subalternes le titre de préfets, mais hors de sa province de Cilicie. Il se montra plus ferme dans l'affaire de Brutus et des habitants de Salamine dans l'île de Chypre. En l'an 56 av. J.-C., sous le consulat de Lentulus et de
Philippe, les habitants de Salamine, écrasés d'impôts et de contributions,
envoyèrent des fondés de pouvoirs à Rome, pour tacher d'y contracter un
emprunt. L'argent était rare dans les provinces. Cicéron consul n'avait
permis, dans le port de Pouzzoles, que le commerce de troc pour empêcher
l'exportation de l'or et de l'argent vers la Grèce[38]. Plusieurs
sénatus-consultes avaient défendu aux juifs, répandus, dès cette époque, dans
tout l'empire romain, de faire des envois de numéraire à Jérusalem[39]. Les Salaminiens
venaient donc chercher l'argent à Rome, parce que là seulement il était à bon
marché. Mais une loi, destinée à réserver aux spéculateurs romains les
bénéfices du commerce de l'argent entre Rome et les provinces, avait été
faite en 67 av. J.-C., par le tribun A. Gabinius, l'ami de Pompée et des
chevaliers romains. Défense était faite aux provinciaux d'emprunter à Rome,
et tout billet, signé par eux dans cette métropole de la banque, était nul
devant les tribunaux. Brutus, songea à exploiter la loi en la violant. Il
avait des fonds à placer et de l'influence au Sénat. Il fit offrir de
l'argent à 4 p. 100 par mois, 48 p. 100 par an (quaternis centesimis), aux malheureux
Grecs de Salamine qui acceptèrent. Le billet fut fait aux noms de Vatinius et
de Scaptius, deux prête-noms de Brutus. Les prêteurs ne songèrent d'abord
qu'à se dérober à l'application de la loi des Douze Tables, qui, à Rome,
fixait à un p. 100 par mois, le taux légal, sous peine d'une amende quadruple
des intérêts usuraires. Un sénatus-consulte, obtenu par les amis de Brutus,
ordonna que cet emprunt ne fît tort ni à ceux qui avaient prêté l'argent, ni
à ceux qui l'avaient emprunté ! Mais ce sénatus-consulte n'était pas
suffisant contre la loi Gabinia, puisque celle-ci défendait à un
gouverneur de province d'accepter comme pièces d'un procès, les billets
signés à Rome par les provinciaux. Un nouveau sénatus-consulte, ordonna que
le billet des Salaminiens fût valable comme les autres et pût servir de base
à un jugement du proconsul de Cilicie, de la province duquel Chypre
dépendait. Brutus n'avait plus à s'inquiéter des lois, mais les Salaminiens
ne payèrent pas. Appius Claudius, le prédécesseur de Cicéron dans le
gouvernement de Cilicie, vrai Sangrado politique, saignait à blanc ce
malheureux pays, et plus tard, il trouva mauvais que Cicéron, nouveau
médecin, eût changé le traitement du malade[40]. Scaptius n'eut
pas de peine à obtenir d'Appius le titre de préfet[41], et quelques
escadrons de cavaliers pour contraindre les Salaminiens. Le sénat de
Salamine, fut assiégé pendant plusieurs jours par Scaptius, dans la salle où
il délibérait. C'était une ville mise à rançon par une bande de brigands
italiens. Mais les assiégés n'avaient rien à donner, ni même rien à manger.
Cinq sénateurs moururent de faim. Le blocus fut levé. A ce moment, Cicéron
arrivait en Asie pour remplacer Appius. Les députés de Salamine allèrent
au-devant de lui jusqu'à Ephèse, et lui racontèrent en pleurant leurs
malheurs. Le proconsul ordonna aussitôt aux cavaliers de sortir de Chypre et
il fit grâce aux pauvres Salaminiens de l'impôt prétorien (vectigal prtorium)
sorte de don de joyeux avènement de plus de Le proconsul ordonna que les Salaminiens payassent les six
ans d'intérêts échus à 12 p. 100 par an avec les intérêts composés d'année en
année. Les Salaminiens étaient prêts à obéir. Scaptius se récria. Le billet
ne portait-il pas intérêt à 48 p. 100 ? Le sénat n'avait-il pas ordonné qu'il
pût servir de base à une action judiciaire ? Cicéron mit sa subtilité
d'avocat au service de l'équité. Le sénatus-consulte, répondit-il à Scaptius,
a dispensé votre billet de l'application de la loi Gabinia, en vertu
de laquelle il serait nul. En vous admettant à produire ce billet, j'obéis au
sénatus-consulte. Mais en vertu de mon édit prétorien qui a étendu à ma
province la loi commune de Rome, je retranche des sommes qui vous sont dues
les intérêts usuraires ; Scaptius employa son dernier argument : Mais c'est donc Brutus qui va perdre, et cela par votre
faute. Car c'est Brutus qui a prêté. Je suis son représentant.
Déconcerté par cet aveu cynique, qui ne lui permettait plus de paraître ne
pas comprendre, le proconsul trop faible n'osa terminer le procès et ne
voulut pas recevoir des Salaminiens, même à titre de consignation, la somme
dont il les avait jugés débiteurs. Il quitta Avec les banquiers de l'ordre équestre, on savait du moins à qui l'on avait affaire. S'ils avaient, au temps de Marius, vendu comme esclaves une bonne partie de la jeunesse Bithynienne[42], il y avait encore parmi eux d'honnêtes gens, comme Cicéron ou comme le grand-père de Vespasien. Ce furent les banquiers de Syracuse qui osèrent mettre en cause Verrès, préteur encore tout-puissant de Sicile. Le chevalier romain P. Scandilius s'engageait à perdre cinq mille sesterces, s'il ne prouvait judiciairement la complicité de Verrès dans les rapines du prétendu publicain Apronius. Mais, en province, le choix des juges nommés récupérateurs n'était fixé par aucun loi, et restait à la discrétion du préteur. En vain Scandilius demanda qu'ils fussent choisis parmi les citoyens romains du conventus de Syracuse, qui presque tous, comme C. Minucius[43], étaient banquiers et chevaliers romains[44]. Verrès annonça qu'il choisirait des récupérateurs parmi les gens de sa maison. Scandilius, de son côté, récusa un tribunal où pourrait figurer le médecin grec Cornelius Artemidoros. Verrès condamna Scandilius à payer à Apronius les cinq mille sesterces, enjeu du procès. Quoique le mot negotiari désigne le commerce de l'argent[45], la banque n'était pas la seule occupation des negotiatores. Ils se chargeaient aussi du transport des blés par terre et par mer[46]. Le commerce, peu estimé des Romains, prenait à leurs yeux un caractère de grandeur et d'utilité générale, lorsqu'il se faisait par mer, soit que le commerçant, sans naviguer lui-même, devint propriétaire et armateur d'un navire, soit qu'il allât chercher dans les pays de production les blés et les autres produits de l'agriculture. Nous voyons en 56 av. J.-C., le chevalier Furius Flaccus exclu, pour cause d'indignité, des corporations de marchands du Capitole et du temple de Mercure[47]. Le chevalier L. Pretius, ancien compagnon d'armes du malheureux Gavius de Cosa, avait établi le centre de ses affaires à Palerme[48]. P. Granius, sorti d'une famille de Pouzzoles, se plaignait que Verrès eût saisi, au retour d'Orient, son vaisseau chargé de marchandises, et frappé de la hache les hommes de l'équipage, qui étaient ses affranchis, en les accusant d'être complices de Sertorius[49]. Quelquefois des chevaliers eux-mêmes, comme L. Herennius de Leptis, étaient mis â mort. Ainsi la grande querelle de la noblesse de Rome et de la plèbe, de l'aristocratie de la grande ville et de l'aristocratie des autres villes italiennes, se poursuivait au-delà des mers, comme, au temps de l'invasion arabe, les tribus conquérantes de l'Espagne gardaient, sur le sol de l'Europe, les haines héréditaires apportées d'Afrique ou de Syrie. Les publicains comme les negotiatores appartenaient généralement â la classe des chevaliers romains[50]. Leur puissance avait commencé lorsque les guerres faites hors de l'Italie attirèrent à Rome d'immenses capitaux, et exigèrent la réunion et le transport de grands approvisionnements. Plusieurs fois les blés de Sicile furent envoyés en Grèce, pour nourrir les armées qui allaient combattre Antiochus et les Etoliens[51]. Les lois qui, vers le même temps, avaient exclu les sénateurs et leurs fils de tout trafic et le tout métier lucratif[52], avaient réservé ces fructueuses entreprises à la noblesse riche des municipes, c'est-à-dire aux chevaliers romains. Ces lois, il est vrai, étaient souvent violées[53]. Mais ordinairement les nobles, arrivés aux magistratures curules trouvaient moyen de les éluder. Ils entraient dans les entreprises commerciales, qui leur étaient interdites, à titre de garants ou de commanditaires. C'est ainsi que le vieux Caton, après avoir prêté de l'argent à une cinquantaine de personnes, leur faisait construire, à frais communs, plusieurs vaisseaux, entre lesquels il partageait les risques de l'argent avancé. Puis, de cette société maritime, en commandite, il tirait comme principal actionnaire des intérêts énormes, que prélevait pour lui son affranchi Quintion[54]. Ceux qui se chargeaient d'une entreprise que l'État leur confiait (publicum) s'appelaient publicani. Quoique chacun d'eux fût ordinairement intéressé dans des entreprises diverses, on peut distinguer parmi eux les entrepreneurs de transports, de travaux publics ou de fournitures (mancipes)[55], des fermiers des impôts (redemptores vectigalium). Mancipes. Les entreprises de transports, de travaux publics ou de fournitures étaient adjugées sur le Forum par les censeurs aux publicains, ou à la compagnie qui s'eu chargeait pour le moindre prix. Les entrepreneurs faisaient pour l'Etat les avances de fonds (ultro tributa)[56]. Comme il fallait que la livraison des objets à fournir ou des travaux exécutés, d'après le cahier des charges[57], fût acceptée par les censeurs ou par le magistrat chargé de contrôler l'exécution de l'entreprise, à côté des entrepreneurs étaient les garants (prdes), qui s'obligeaient à payer les travaux nouveaux ou à dédommager l'Etat, si la livraison était mal faite ou le premier travail manqué. Les biens de l'entrepreneur (prdia) étaient engagés à l'Etat par une sorte d'hypothèque (subsignabantur apud censorem) et servaient, soit au remboursement des garants, s'ils avaient été obligés à un paiement, soit à dédommager l'Etat, si les garants ne remplissaient pas leurs obligations[58]. Quelques compagnies d'entrepreneurs furent généreuses, par exemple celles qui ajournèrent, du temps de la guerre d'Annibal, le paiement de leurs fournitures[59]. D'autres publicains se signalèrent, dès cette époque, par leur cupidité, et après avoir fait garantir les cargaisons de leurs navires par l'Etat contre les risques de la mer, les firent volontairement échouer pour se les faire payer plus cher qu'elles ne valaient (212 av. J.-C.[60]). Les fermiers des impôts (vectigalium redemptores). Outre les tributs fixes en argent (stipendia) auxquels étaient soumis les Espagnols et la plupart des peuples qui avaient obéi à Carthage, Asconius[61] distingue trois sortes d'impôts ou indirects ou payables en nature (vectigalia), dont la perception donnait lieu à la formation de trois sortes de compagnies de publicains. C'étaient les douanes et péages (portoria), le revenu des pâturages publics (scriptura) et les dîmes du blé, du vin, de l'huile et des menus grains (decuam). Les dîmes se levaient, soit sur les terres appartenant à l'Etat, soit sur les terres restituées ou conservées aux peuples vaincus à titre de propriétés. Dans les provinces, les cultivateurs des terres publiques (aratores) et les possesseurs des pâturages de l'Etat (qui pascebant) étaient souvent des citoyens et des chevaliers romains, établis sur la terre de conquête[62]. La loi financière, étant territoriale, s'appliquait à leurs possessions comme à celles des sujets de Rome, et ils avaient à payer aux décimateurs la dîme en nature du produit de leurs champs, et aux publicains, appelés pecuarii, les droits de pâture. L'adjudication de ces impôts était faite tous les cinq ans par les censeurs, sur le Forum romain[63]. Le bail durait pendant un lustre, et si les compagnies adjudicataires, par suite d'une diminution accidentelle des produits de leurs fermes, se trouvaient avoir fait un mauvais marché, elles demandaient quelquefois la résiliation des baux. C'est ainsi que les publicains d'Asie, ayant acheté à trop haut prix, en 61 av. J.-C., la ferme des impôts de cette province, demandèrent, dès le mois de décembre de cette année, une nouvelle adjudication[64]. Après deux ans de sollicitations[65], ils obtinrent de Jules César, consul, une remise d'un tiers sur le prix de leurs fermes[66]. Par privilège, les dîmes du blé de Sicile étaient adjugées tous les ans sur le marché de Syracuse, en vertu de la loi d'Hiéron. Les propriétaires grecs et romains pouvaient se disputer ces enchères[67]. En l'année 75 av. J.-C., les consuls C. Aurelius et C. Cotta, pour complaire aux propriétaires de vignobles et de plants d'oliviers, en Italie, firent transporter, par exception, à Rome, l'adjudication des dîmes de l'huile, du vin et des légumes secs de Sicile[68]. Mais pour les dîmes du blé sicilien, l'adjudication se fit toujours par le questeur à Syracuse, et la loi d'Hiéron fixait les rapports entre le publicain et le producteur. Chaque compagnie de publicains avait à Rome un directeur (magister), qui tenait les comptes, faisait la correspondance et gardait les doubles des lettres envoyées ou reçues. Le directeur était renouvelé tous les ans. La compagnie était représentée, dans la province qu'elle exploitait, par un sous-directeur (promagister), qui avait à son service, soit des commis (coactores) ayant de petits intérêts dans les affaires de la compagnie (partes, particulas)[69], soit des employés libres (operas) recevant des salaires journaliers (capturas), ou enfin, pour les services matériels, des esclaves appartenant à la compagnie. Les emplois secondaires de la finance et les petits intérêts, que les publicains pouvaient accorder à leur clientèle dans leurs entreprises, étaient au nombre des moyens d'influence de l'ordre équestre. Voici le portrait que fait Cicéron, de deux publicains généreux[70] : Quand nous étions enfants, le père de Rabirius, C. Curius, était un des chefs de l'ordre équestre, un très-brave et très-riche publicain. On n'eût pas tant apprécié sa générosité dans le monde des affaires, s'il n'avait été doué d'une bonté' extraordinaire, qui donnait à croire, que l'augmentation de sa fortune était pour lui, moins une satisfaction intéressée, qu'un moyen de rendre service aux autres. Fils de C. Curius, Rabirius imita sa conduite. Il traita beaucoup d'affaires, prit de grands engagements, eut de grands intérêts dans les fermes générales. Il prêta à des villes, plaça ses fonds dans plus d'une province. Il devint même le banquier des rois, et avança de grandes sommes à celui d'Égypte. Pendant ce temps-là, il ne cessa d'enrichir ses amis, de les faire entrer dans les affaires, de leur donner des actions, de leur fournir des fonds, de les soutenir de son crédit. Portoria (Douanes et péages). Les douanes établies par les rois furent supprimées pour le peuple romain au commencement de la République[71], et il n'en est plus question dans l'histoire romaine, jusqu'au temps des guerres puniques. En 198 av. J.-C., les censeurs P. Cornélius Scipio et Ælius Pattus afferment aux publicains les douanes de Capoue, de Pouzzoles et de Castra[72]. En 179 av. J.-C., Æmilius Lepidus et M. Fulvius, dont la censure fut remarquable par de grands travaux publics, établissent des douanes nouvelles[73]. C. Gracchus imite leur exemple, pour subvenir aux frais des distributions de blé à prix réduit, qu'il avait établies[74]. La principale douane de l'Italie, semble avoir été celle de Pouzzoles, vaste entrepôt où arrivaient les marchandises de l'Egypte et de l'Orient[75]. Les Romains y avaient institué une magistrature spéciale, la questure maritime, destinée à empêcher la trop grande exportation des matières d'or et d'argent vers les contrées orientales[76]. Beaucoup vendre et acheter le moins possible, afin d'accaparer le numéraire par le trafic et par la banque, telle fut longtemps la seule économie politique des Romains. Les vexations exercées, soit par la questure maritime, soit par les esclaves douaniers, devinrent si intolérables, qu'en l'an 60 av. J.-C., le préteur Q. Cæcilius Metellus Nepos fit abroger les péages et les douanes de Rome et de l'Italie[77]. César rétablit les douanes sur les marchandises étrangères[78]. Sous l'empire, elles donnèrent encore lieu à tant de réclamations contre les publicains, qu'il fut question, sous le règne de Néron, de les abolir toutes. La nécessité de maintenir l'équilibre entre les recettes et les dépenses, obligea le gouvernement à renoncer à ce projet, et il se contenta de supprimer les taxes du cinquantième et du quarantième, dont il est pourtant question encore dans une des déclamations attribuées à Quintilien[79]. Si les exactions des publicains adjudicataires des douanes étaient intolérables même en Italie, on peut deviner ce qu'elles devaient être dans les provinces. Cicéron écrivait à son frère Quintus, gouverneur de la province d'Asie, qu'il faut une vertu divine pour accorder là-dessus les exigences des publicains avec les intérêts des provinciaux[80]. Quintus en effet y renonça. Les publicains ayant établi une taxe de circumnavigation, probablement sur le commerce de cabotage qui se faisait sur la côte d'Asie, il n'osa se prononcer contre cette exaction injuste et il en référa au Sénat[81]. Il fallait, pour arrêter la cupidité des douaniers[82], l'inflexible justice d'un Rutilius[83]. Les Romains étaient dispensés du paiement de toutes les douanes établies au profit des gouvernements locaux. C'est ainsi qu'en 187 av. J.-C., ils se firent exempter eux et les alliés latins de tous les péages de terre et de mer dans le golfe d'Ambracie[84]. En 72 av. J.-C., le plébiscite en faveur de la ville libre de Termessus en Pisidie, réserve une exemption semblable, aux dîmes que les publicains feraient transporter par le territoire de cette ville[85]. Les Romains n'en établissaient pas moins pour leurs sujets des douanes dans tous les pays où ils devenaient les maîtres. Il y en avait une à Aquilée[86]. Fonteius frappa d'un droit de passage les vins qui circulaient de Narbonne à Toulouse[87]. Pison soumit à un droit pareil toutes les marchandises vendues en Macédoine[88]. Enfin les publicains avaient une taxe d'un vingtième de la valeur vénale sur toutes les marchandises exportées du port de Syracuse et des autres ports de Sicile, même par des citoyens romains[89]. Pascua publica. Scriptura. Dans tous les pays conquis, hors de l'Italie, des forêts et des pâturages étaient devenus domaines publics. Dans la Gaule Transalpine[90], en Espagne, en Afrique, en Asie[91] Mineure, en Sicile[92], des citoyens romains nourrissaient des troupeaux sur les terres de l'Etat appelées ager scripturarius. Les publicains entretenaient dans tous les pays des familles d'affranchis ou d'esclaves, pour percevoir la taxe des pâturages. Tantôt les adjudicataires de ce revenu (scripturarii, pecuarii) se contentaient de l'exploitation financière du droit qu'ils sous-louaient à des éleveurs (pastores). Tantôt ils élevaient eux-mêmes les troupeaux, et faisaient ainsi un double bénéfice. Les dîmes dans les provinces. Les terres publiques les plus productives pour l'Etat étaient celles où on levait la dîme. Les décimateurs étaient les plus riches capitalistes, les chefs de l'ordre équestre, et, pour ainsi dire, le Sénat des publicains[93]. On les a souvent comparés aux fermiers généraux de l'ancienne France. Mais les dîmes se payaient en nature, et les décimateurs devaient, aux termes de leur marché, fournir un certain nombre de médimnes de blé ou d'amphores de miel, d'huile ou de vin, qu'ils faisaient transporter, ou à Rome ou en tout autre lieu désigné par les magistrats. Ils ressemblaient donc moins à des traitants qu'à des fournisseurs chargés de faire une recette en nature. Le marché des dîmes était une sorte de contrat aléatoire sur les espérances de la récolte. Si elle était bonne, le publicain gagnait beaucoup. Si elle était très-mauvaise, il pouvait perdre. En principe, le cultivateur n'avait pas à se préoccuper des engagements pris par les décimateurs à l'égard de l'Etat, puisqu'il devait toujours la dixième partie du produit annuel de son champ[94]. Il n'avait, pour être en règle, qu'à faire la déclaration (professionem) de l'étendue de terre qu'il cultivait, et, en Sicile, ce cadastre était renouvelé tous les cinq ans par les soins des censeurs des villes siciliennes[95]. Mais le publicain, en danger de perdre, savait bien forcer le cultivateur à prendre la perte pour lui. Il exigeait qu'on lui donnât la mesure comble[96], et cette exaction semblait autorisée par l'usage. Le publicain demandait souvent des surplus (accessiones) d'un centième ou d'un cinquantième par mesure, ou des cadeaux en argent[97], ou même, quoique la loi[98] le défendît, le prix du blé qui lui était dû, que, dans ce cas, il estimait fort cher. Des chevaliers romains, comme Q. Septitius, cultivateur en Sicile, avaient grand peine à se mettre à l'abri de semblables pillages. Qu'était-ce donc dans les provinces éloignées, lorsque des Grecs ou des Syriens étaient livrés à l'arbitraire du publicain ? Là, ce n'était plus seulement la mesure comble que l'on demandait. Le surplus du centième était exigé en vertu de l'usage[99]. En Béotie, les publicains firent, malgré la loi des censeurs, payer la dîme des blés cueillis sur les terres consacrées aux dieux, sous prétexte que ces dieux avaient été des hommes[100]. C'était une application de l'évhémérisme. La règle étant violée à chaque instant, le décimateur ou le fermier de l'impôt des pâturages passait, le premier, avec le cultivateur, le second, avec l'herbager, des conventions particulières (pactiones), où le gouverneur de la province intervenait au risque de blesser ou la justice ou les publicains[101]. Ces conventions fixaient le mode, le jour et le lieu du paiement, la quantité de blé ou la somme d'argent qui était due. Elles amenaient, le plus souvent, les débiteurs à signer des billets portant intérêt à plus de 12 pour 100[102]. C'est alors que la fermeté et l'équité du gouverneur de la province étaient mises à l'épreuve. J'observerai les conventions entre les publicains et les provinciaux, avait écrit Bibulus dans son édit, lorsqu'il n'y aura eu ni violence ni fraude employée pour les conclure. Atticus trouvait que ces expressions établissaient un préjugé fâcheux contre l'ordre équestre. Cicéron, par égard pour les scrupules de son ami, transcrivit, dans son édit proconsulaire, une phrase de celui de Q. Mucius, qui disait la même chose, mais à mots couverts : Je validerai les conventions excepté celles qui auraient été faites de manière à ce qu'il fût impossible, équitablement, de les exécuter. Cicéron tâcha de concilier la politique avec la justice. Il fit dire aux provinciaux que, s'ils payaient au jour marqué, il ne souffrirait pas qu'on exigeât d'eux plus de 12 pour 100 par an ; mais que, s'ils n'étaient pas exacts, il jugerait d'après les conventions. Les Asiatiques se hâtèrent de payer, et Cicéron prétend que les publicains aussi furent contents, et qu'il leur fit comprendre qu'un remboursement certain valait mieux que l'espérance de plus gros intérêts[103]. Organisation d'une compagnie provinciale. Compagnie de
Sicile. Il ne se formait pas pour chaque province autant de compagnies
qu'il y avait de recettes différentes à faire. Chaque publicain avait des
intérêts dans plusieurs entreprises. Pour exploiter une province comme l'Asie[104], la Bithynie[105], l'Afrique[106], L'État avait alloué à Verrès pour l'achat des secondes dîmes 9 millions de sesterces (1.935.000 fr.) qu'il devait distribuer aux cultivateurs de Sicile, en échange de trois millions de mesures de blé (258.952 hectolitres). Pour éviter des déplacements de numéraire, le trésor romain payait souvent par un transfert de créance, soit qu'il fît passer les sommes qu'il devait recevoir et dépenser au même endroit par les mains d'un magistrat, soit qu'il avertît son débiteur comme par une lettre de change, de solder son créancier ; dans l'un et l'autre cas, le débiteur du trésor chargé de fournir les fonds exigés pour une dépense publique, était désigné par une affectation spéciale de sa dette (adtributus) à celui qui devait le faire payer (cui adtributus erat). C'est ainsi que l'impôt des veuves était affecté à la nourriture des chevaux des chevaliers equo publico[113], et que l'entrepreneur chargé de la réparation d'une rue ou d'une route bordée de maisons, était remboursé par l'État au moyen d'un ordre envoyé aux propriétaires de lui payer une partie des frais, proportionnée à l'étendue de leurs façades[114]. De même l'allocation faite à Verrès pour l'achat des secondes dîmes devait être prise sur les fonds de la compagnie des pâturages de Sicile. Verrès laissa l'argent dans les caisses de la compagnie, ce qui n'avait rien d'inusité, le trésor permettant souvent aux compagnies de profiter de l'intérêt des sommes qui lui étaient dues. Telle n'était pas l'intention de Verrès. Il réclama 2 pour cent d'intérêt par mois de retard, et, d'un autre côté, il prit le blé des cultivateurs sans leur payer ni intérêt, ni capital. La compagnie des pâturages réclama. Les directeurs résidant à Rome, qui étaient les chevaliers romains L. Vettius Chilo beau-frère de Verrès, L. Servilius et C. Antistius écrivirent au sous-directeur Carpinatius résidant à Syracuse d'informer Verrès qu'on le soupçonnait de n'avoir retardé la demande de son argent que parce qu'il ne payait pas les cultivateurs de Sicile ; qu'on surveillerait sa reddition de comptes et que, s'il ne justifiait pas de l'emploi des sommes versées par la compagnie, il aurait à les restituer. On transmit des menaces semblables au secrétaire de Verrès. Mais ni le maître ni le valet n'en tinrent compte. La compagnie des pâturages avait aussi l'adjudication des douanes de Syracuse, et formait comme l'administration des droits réunis de Sicile. Le commis principal de la douane, Canuleius. était un de ces honnêtes employés, à qui la protection d'un chevalier romain donnait un petit intérêt dans une grande affaire. Il s'aperçut que Verrés faisait sortir en fraude, du port de Syracuse, une foule d'objets précieux. Il prévint le sous-directeur Carpinatius qui en écrivit à Rome. Pour mieux couvrir sa responsabilité, Canuleius tint registre de tout ce que Verrès faisait passer en fraude. C'étaient des tissus de Malte, des candélabres, quatre cents amphores de miel, des lits pour cinquante salles à manger. D'après ses comptes, Verrès, en quelques mois, aurait fait tort à la compagnie de 60.000 sesterces (12.930 fr.) sur le droit du vingtième, c'est-à-dire qu'il aurait exporté du seul port de Syracuse, des objets évalués 258.600 francs. Mais Carpinatius s'aperçut qu'avec un tel voleur on pourrait cesser d'être victime en devenant complice. Il se mit à accompagner Verrès à travers les villes siciliennes, trafiquant de son pouvoir et vendant fort cher les décrets injustes qu'il sollicitait de lui. Les produits de ce trafic étaient versés dans les caisses de la compagnie comme des sommes prêtées par le banquier Verrutius, et le sous-directeur, à son tour, les prêtait aux Siciliens au nom de la compagnie, qui en partageait avec Verrès les intérêts usuraires. Bientôt les profits de ces opérations scandaleuses couvrirent les pertes que Verrès avait fait subir à la compagnie. Carpinatius écrivit à Rome pour demander qu'on supprimât de la correspondance toutes les lettres compromettantes pour Verrès. A la tête de la compagnie des pâturages et des douanes de Sicile étaient des publicains assez riches pour s'intéresser à la levée des dîmes. Ces décimateurs, comme principaux actionnaires, tinrent un conseil d'où ils exclurent les associés de moindre importance qui auraient pu former une majorité honnête. Ils décidèrent la suppression de la correspondance gênante pour les nouveaux amis de Verrès. Ils allèrent même, sur la demande de Carpinatius, jusqu'à voter des remercîments pour le préteur de Sicile. Cicéron eut bien de la peine à se procurer les pièces accusatrices que la complaisance intéressée de la compagnie avait cru faire disparaître. Mais les Romains avaient des habitudes de comptabilité prudente. La plupart des directeurs faisaient faire pour eux-mêmes un double de toutes les pièces relatives à leur administration. Cicéron mit les scellés sur les papiers de L. Vibius, chevalier romain, qui avait été directeur de la compagnie sicilienne. Il y trouva un cahier transcrit de la correspondance du commis Canuleius. A Syracuse, il ne put employer le même moyen. Une loi défendait de sceller les registres des compagnies et de les transporter de la province à Rome. Il se les fit montrer et cita Carpinatius en justice, pour lui faire dire ce que c'était que le banquier inconnu Verrutius. Il confondit le publicain devant les juges et le força d'avouer qu'il s'était fait l'agent de Verrès. L'esclave secrétaire de la compagnie, croyant toute feinte inutile après le départ de Verrès, avait raturé partout les cinq dernières lettres du nom de Verrutius. Cicéron fit faire un fac-simile authentique des pages où était ce nom tronqué, et il l'inséra dans son pamphlet des Verrines. Qu'est-ce que les cinq lettres effacées, disait - il ? C'est la queue du verrat qui traîne dans la boue de la rature[115]. Si les publicains étaient quelquefois de connivence avec
les gouverneurs de province, le plus souvent ils étaient en lutte avec eux.
Tite-Live, l'ami de l'aristocratie, fait dire aux sénateurs du temps de
Paul-Émile, qu'on n'affermera pas les mines d'or et d'argent de Sylla manqua de prévoyance et de logique. Ce fut lui-même qui, sans le vouloir, livra l'Asie à l'avidité des publicains. Pour subjuguer l'Italie, il lui fallait acheter la conscience de ses soldats. Il exigea des Asiatiques l'impôt de cinq années, vingt mille talents ou à peu près cent millions de francs. Les malheureux Grecs devaient ou contribuer ou emprunter. Or ils n'avaient pas parmi eux de chefs capables d'opérer une pareille recette. Il leur fallut donc recourir aux seuls grands capitalistes d'alors, aux publicains. Ainsi l'on peut dire de Sylla ce que Tacite a dit de Pompée, qu'il fut le destructeur de ses propres lois[119]. Douze ans après (71 av. J.-C.), Lucullus, l'ami de Sylla, trouva l'Asie obérée. Le capital de la dette s'était élevé par les intérêts composés, de 20 à 120 mille talents. Pour mettre un frein à la rapacité des publicains et des banquiers, Lucullus fit des règlements fort sages[120]. Il réduisit pour l'avenir les intérêts au taux légal de 1 p. cent par mois. Il annula tous les intérêts échus, qui dépassaient le capital primitif, c'est-à-dire qu'il réduisit la dette de 120 à 4.0 mille talents. Il défendit, sous peine de déchéance pour le créancier, d'exiger les intérêts composés, et de saisir plus du quart du revenu du débiteur. En moins de quatre ans, ces règlements firent rentrer les Asiatiques dans leurs biens. Mais peut-on oublier que c'était Lucullus lui-même que Sylla avait chargé de lever l'impôt de 20 mille talents, cause première de tant de maux ? Les chevaliers romains ne pardonnèrent pas à Lucullus d'avoir contrarié leurs intérêts. Les compagnies de publicains confièrent le soin de leur vengeance au tribun Manilius et à Cicéron. Le commandement de la guerre contre Mithridate fut enlevé à Lucullus et confié à Pompée (67 av. J.-C.)[121]. Les publicains en Italie. Polybe[122] nous dit que
presque tous les plébéiens étaient engagés dans les entreprises de travaux
publics, ou dans l'exploitation des mines, des douanes, des péages, des
terrains et . des vergers, affermés par les censeurs, et qu'ainsi ils
dépendaient du sénat qui pouvait ou alléger leurs charges, ou leur accorder
des délais, ou accepter la résiliation d'un bail devenu inexécutable. A cette
dépendance, la possession des domaines publics de l'Italie ajouta un lien
nouveau. Les chevaliers des municipes, comme les nobles de Rome et tous les
riches des villes italiennes et des villes romaines, étaient détenteurs et
usurpateurs des terres de l'État. Chaque fois qu'une loi agraire était
proposée, on voyait se rapprocher, pour la défense d'un intérêt commun, les
deux aristocraties rivales, l'ordre équestre et le sénat[123]. Cette
coalition avait plus d'un rapport avec celle de Rome et des aristocraties des
villes italiennes, qui avait soutenu Les Romains, lorsqu'ils avaient soumis un peuple italien,
confisquaient une partie de son territoire. Les Herniques et les Privernates
perdirent les deux tiers de leurs champs[125]. Les Boïens en
perdirent la moitié[126], les habitants
de Frusino, le tiers[127]. Les Marses
durent en abandonner une partie que Tite-Live ne détermine pas[128], les Sabins,
dix mille jugères ( Les empiétements des propriétaires riches de l'Italie sur les pâturages et sur les forêts du domaine public furent encore bien plus considérables. Les pâturages formaient la plus grande partie du domaine, si bien que le domaine entier était placé, sur les registres des censeurs, sous le titre général de Pascua[137]. De tout temps, cette sorte de terre a été la plus facile à envahir. Au moyen-âge, les seigneurs féodaux s'emparaient des prairies et des forêts communales, et aux XVIe et XVIIe siècles, les riches bourgeois et les magistrats les imitèrent, et, après avoir ruiné les communes, s'en firent adjuger les biens à vil prix[138]. De même en Italie, le buf du laboureur et la chèvre du pauvre, durent quitter les prairies communes devant les grands troupeaux du publicain ou du riche éleveur. Le petit propriétaire, investi de tous côtés par les domaines d'un riche voisin, dut lui céder son droit de pâture avec son héritage. Il n'eut pas même la ressource de servir comme berger. Les éleveurs préféraient les pâtres esclaves qui ne demandaient pas de salaires et n'étaient pas sujets au service militaire[139]. Le tableau de la ruine de l'agriculture italienne, par la substitution de la grande à la petite propriété, et des pâtres esclaves aux cultivateurs libres, a été trop largement tracé pour qu'on essaie de le refaire[140]. Un trait mériterait pourtant d'y être ajouté, c'est que les pâtres esclaves ont composé les plus anciennes bandes de brigands italiens. Cette plaie de l'Italie moderne est le fléau légué au pays des conquérants du monde, par les vaincus qu'on y amenait enchaînés[141]. Dès l'an 198 av. J.-C., il y eut à Setia une conjuration d'esclaves récemment amenés d'Afrique[142]. Deux ans après, les esclaves révoltés t'en Etrurie, livrèrent bataille au préteur Acilius[143]. En 185 av. J.-C., le préteur Postumius eut à réprimer en Apulie une véritable guerre servile. Les esclaves réunis par bandes infestaient les routes et les pâturages de l'État. Sept mille d'entre eux furent mis à mort[144]. C'est vers la même époque que Scipion l'Africain, retiré à sa maison de campagne de Literne, reçut la visite inattendue de plusieurs chefs de bandes, qui lui présentèrent des offrandes comme celles qu'on dépose sur l'autel d'un Dieu[145]. Le brigand italien était déjà dévot. La révolte des esclaves recommença en Sicile quarante ans
après. Diodore nous apprend que la plupart des possesseurs de pâturages
étaient alors des chevaliers romains[146]. Comme ils
nourrissaient mal et traitaient cruellement leurs pâtres, ces malheureux
cherchaient dans le brigandage un gagne-pain et une vengeance. Entourés de
meutes de chiens féroces, couverts de peaux de loups et de sangliers,
habitués à passer les nuits en plein air, vivant de lait et de viande, armés
de massues, de lances et d'épieux, ces esclaves, demi-sauvages comme les
Gauchos de l'Amérique du Sud, se préparaient à la guerre par des exploits de
voleurs de grand chemin. Leurs maîtres fermaient les yeux sur leurs crimes
parce qu'ils ne voulaient pas les nourrir, et les préteurs de Sicile, parce
qu'ils n'avaient pas la force de les réprimer. C'est parmi ces routiers
qu'Eunus recruta des armées capables de vaincre les légions romaines. Dans le
même temps, les esclaves de Le vainqueur d'Athénion, M'. Aquilius, proconsul en l'an
100 av. J.-C., pour mieux assurer la sécurité du pays, traça une route de
Capoue à Rhegium, rendit les esclaves fugitifs à leurs maîtres, et, le
premier, réussit à mettre des laboureurs à la place des bergers dans les
terres de l'Etat employées, jusque là, au pâturage[150]. Pourtant
Spartacus recruta, dans l'Italie méridionale, des armées d'esclaves qui
vainquirent les légions. Depuis ce temps là, tout ambitieux sans scrupule,
chercha dans les révoltes serviles un point d'appui ou un moyen de vengeance[151]. C. Antonius,
le collègue de Cicéron dans le consulat, partisan secret de Catilina, avait,
pendant sa candidature, vendu ses pâturages et ses troupeaux, en se réservant
la propriété de ses pâtres, et il menaçait de les armer contre Rome, si le
consulat lui était refusé[152]. Le patricien
Catilina mit â exécution ce projet coupable. Il excita à la révolte, contre
les chevaliers romains leurs maîtres, les esclaves de Les chevaliers, publicains et possesseurs de pâturages
publics, avaient autant d'intérêt à combattre les lois agraires que les
révoltes d'esclaves. La loi de Licinius
Stolon défendait à tout citoyen de posséder plus de cinq cents jugères
( Les Gracques furent les derniers qui essayèrent de rétablir les règlements de Licinius Stolon[161]. Mais leur loi agraire fut éludée ou abolie. Malgré une disposition très-prudente de la loi de Ti. Gracchus, on permit aux nouveaux colons de revendre les lots de terres publiques qui leur ; avaient été distribués[162]. Cette faculté fit rentrer une partie des anciens domaines dans les mains des premiers possesseurs à titre de propriétés privées. D'un autre côté les triumvirs, chargés de l'application de la loi agraire, se trouvèrent aux prises avec des difficultés inextricables. Après un remaniement de la propriété italienne, qui troubla toutes les situations, il fallut en venir à fixer l'état de possession de toutes les terres italiennes. C'est à ce besoin social de stabilité, qui après chaque révolution devient le plus impérieux de tous, que répond la loi agraire du tribun Sp. Thorius[163], 111 av. J.-C. L'analyse que nous ferons de cette loi suffira pour montrer comment les lois agraires contrariaient l'intérêt des publicains, et pourquoi Cicéron, avocat de l'ordre équestre, les a presque toujours combattues[164]. La loi Thoria était divisée en trois parties : la première concernait les terres publiques de l'Italie ; la seconde, celles de l'Afrique ; la troisième, celles du territoire de Corinthe. Nous n'analyserons que la première partie, qui seule se rattache étroitement à notre sujet. I. Des terres qui restent domaines publics. La loi Thoria ne change rien à la condition des terres publiques de l'Italie expressément mises en dehors de tout partage par une loi ou par le plébiscite de C. Gracchus. Quarante-huit ans après, à l'Etat appartenaient encore le territoire de Capoue, celui de Stellate, le mont Gaurus, les saulaies de Minturnes, la forêt Scantia, les champs voisins de la route d'Herculanum, et d'autres terres que Cicéron n'a pas énumérées[165]. II. Des terres publiques qui deviennent propriétés privées. Une partie des terres italiennes, qui appartenaient au domaine public sous le consulat de P. Mucius et de L. Calpurnius, c'est-à-dire au temps du tribunat de Tiberius Gracchus, 133 av. J.-C., sont converties en propriétés privées. Ce sont : 1° Les terres publiques ou possessions qu'un ancien
possesseur ou quelqu'un de ses héritiers ou ayant-cause a prises pour
lui-même, ou laissées à un successeur, et qui n'excèdent pas l'étendue de ce
qu'une loi ou un plébiscite permet de prendre pour soi ou de transmettre. Or,
la loi de Licinius Stolon avait autorisé chaque ancien possesseur à garder
pour lui jusqu'à cinq cents jugères, c'est-à-dire 2° Les terres publiques dont les lots tirés au sort, en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, ont été assignés à des citoyens romains, réserve faite des terres attribuées aux anciens possesseurs dans l'article précédent. Cette disposition confirmait la loi agraire[167]. 3° Les terres publiques qui ont été vendues à l'ancien possesseur, à ses héritiers ou ayant-cause. C'était là une restriction de l'article précédent, par laquelle une partie des effets de la loi agraire se trouvait détruite. Dans les dix ans qui avaient suivi la mort de C. Gracchus (121-111 av. J.-C.), la faculté accordée à ceux qui avaient reçu des lots de terre, de les revendre, les avait exposés aux violences et aux menaces des anciens possesseurs. Ceux-ci avaient racheté à bon marché, ou même repris gratuitement, une partie de leurs anciennes possessions, dépréciées alors, comme l'étaient en 1815, en France, les propriétés provenant des biens nationaux[168]. 4° Toute terre publique, place ou possession, si- tuée à l'intérieur de Rome ou hors de Rome, mais dans une ville ou dans un bourg, et qui aura été assignée à quelqu'un par un triumvir. Comme il n'est pas question ici de restitutions, il est clair que les menaces des anciens possesseurs avaient produit, moins d'effet sur les habitants des villes, que sur les habitants des cantons ruraux[169]. 5° Toute terre publique accordée ou laissée par un triumvir à un citoyen romain, ou à mi allié latin, sur le territoire d'une colonie ou d'une place forte[170]. 6° Toute terre publique ou tout édifice accordé à un citoyen romain ou à un allié, en échange d'un terrain dont il était possesseur sur le domaine public loué par les censeurs L. Cæcilius et Cn. Domitius (115 av. J.-C.), terrain que ce possesseur aurait cédé pour l'établissement d'une colonie ou d'une place forte[171]. 7° Toute terre publique donnée en échange d'une propriété privée devenue terre publique[172]. 8° Toute terre publique ne dépassant pas l'étendue de
trente jugères ( Ces huit sortes de terres ayant appartenu au domaine public italien, en 133 av. J.-C., sont déclarées propriétés privées. Défense est faite de formuler aucune proposition, de prendre aucune mesure tendant à les' faire rentrer dans le domaine public. Les propriétés privées des citoyens romains, en Italie, étaient soumises au tribut, sorte d'impôt foncier établi sur le capital de la fortune des citoyens estimée par les censeurs. Elles étaient inscrites sur les registres du cens (in censum), et pouvaient être engagées au peuple romain par ceux qui se chargeaient d'une entreprise publique ou devenaient débiteurs du trésor. Quelquefois les citoyens faisaient inscrire sur le registre du cens (in censum) une partie de leurs propriétés provinciales, qui étaient assimilées alors aux propriétés quiritaires d'Italie par le jus Italicus[174], c'est-à-dire soumises au tribut et dispensées des impôts appelés vectigalia. Au contraire les terres publiques n'étaient pas soumises au tribut ; elles ne pouvaient pas être données en gage au peuple romain (subsignari populo romano apud censorem). Elles payaient les impôts dits vectigalia établis non sur le fonds, mais sur le revenu ou la jouissance annuelle, comme les dîmes en nature et l'impôt des pâturages (scriptura). Elles étaient inscrites sur un registre particulier, appelé tables des censeurs (tabulæ censoriæ). La loi Thoria, en soumettant au tribut les terres- qui devenaient propriétés privées des citoyens, les dispensait du payement des vectigalia. C'en était assez pour mécontenter les sociétés de publicains habituées à lever ces impôts. La loi Thoria donnait encore à l'ordre équestre d'autres sujets de plainte. III. Des domaines publics de l'Italie qui continuent à être propriétés de l'État, sans avoir été réservés ni par une loi ni par le plébiscite de C. Gracchus. 1° Les parties non réservées de l'ancien domaine public italien de l'an 133 av. J.-C., et qui ne sont pas expressément transformées en propriétés privées par la loi Thoria, restent propriétés de l'État[175]. 2° Les terres, emplacements, édifices, attribués par les décemvirs nommés en vertu de la loi Livia, à ceux qui sont chargés de la voirie rurale, resteront à leurs possesseurs primitifs, à moins d'aliénations déjà faites par les possesseurs ou par leurs héritiers. Ces terres emplacements, édifices, resteront domaines publics[176]. 3° Des décemvirs nommés en vertu de la loi Thoria l'établiront les routes dans l'état où elles étaient sous le consulat de P. Mucius et de L. Calpurnius, 133 av. J.-C.[177] IV. De la jouissance et de la possession des domaines publics en Italie. 1° La possession ou la jouissance de terres publiques attribuée par une loi ou par un sénatus-consulte à un citoyen, à un allié latin, ou à ceux qui représentent soit les municipes, soit les colonies romaines on latines, est confirmée par la loi Thoria[178]. 2° Défense est faite d'y gêner la pâture commune, sous peine d'amende à payer aux publicains adjudicataires de l'impôt que rapporte cette pâture[179]. 3° Chacun aura le droit d'envoyer aux pâturages publics dix animaux de gros bétail, avec leurs petits de moins d'un an, ou cinquante animaux de petit bétail avec leurs petits de moins d'un an, sans rien payer pour cela ni à l'État ni au publicain[180]. 4° Ce qui est permis à un citoyen romain dans les terres de l'État, est permis aussi à un Latin, ou à un étranger, pourvu qu'il ait eu, au temps des consuls M. Livius et L. Calpurnius (112 av. J.-C.), en vertu d'une loi, d'un plébiscite ou d'un traité, le droit de posséder un domaine de l'État romain[181]. 5° On pourra faire paître autant de bétail qu'on voudra le long des routes et des sentiers sans avoir rien à payer ni au peuple ni au publicain[182]. 6° Lorsqu'en vertu de la présente loi, on devra de l'argent à un publicain, aucun magistrat ne donnera une formule de jugement, d'après laquelle on devrait an publicain plus ou autrement qu'il n'est dit dans la présente loi. Si les publicains sont demandeurs, que le consul, le préteur ou le propréteur, dans les dix jours de la demande, choisisse onze récupérateurs parmi cinquante citoyens de la première classe. Chacune des deux parties en récusera alternativement deux, et les juges ainsi choisis, décideront sur la quotité de la somme due au publicain[183]. Appien a fort bien saisi le caractère principal de cette loi, en disant qu'elle arrêta les distributions de terres, et que la terre appartint à ceux qui la possédaient[184]. Le but du législateur était en effet de consacrer l'état de possession de l'année 111 av. J.-C., et de mettre un terme au bouleversement des propriétés causé par les lois agraires. Ce qu'Appien n'a pas pu dire en si peu de mots, c'est que, parmi les possesseurs des terres publiques, les uns en acquirent la propriété complète, les autres n'en gardèrent que l'usufruit. L'historien grec ajoute que les redevances payées par les possesseurs des terres publiques, devaient être versées au trésor pour être distribuées au peuple. On a cru que ces paroles contredisaient celles de Cicéron, qui nous apprend que Sp. Thorius, par une loi vicieuse et nuisible, avait dispensé de redevances les terres publiques[185]. Mais Cicéron, l'avocat des publicains, s'est fait l'écho de leurs rancunes. Il n'a envisagé la loi Thoria que sous le point de vue de l'intérêt des compagnies financières. L'analyse de la loi montre qu'un grand nombre de redevances des terres publiques étaient supprimées, sans qu'elles le fussent toutes[186]. Rien ne serait plus contraire à la critique, que de chercher à opposer deux phrases de deux écrivains si différents, qui ont fait allusion à deux parties différentes de cette grande loi Thoria. Elle réglait trop d'intérêts divers pour qu'il fût possible de la caractériser en quelques mots. Si la loi agraire de Thorius laissa un mauvais souvenir aux chevaliers romains, on peut comprendre quelles colères avait excitées chez eux la loi agraire de Ti. Gracchus, qui ne leur avait causé que des pertes sans compensation. Pour la détruire, ils avaient, d'un côté, soutenu le patriciat, et de l'autre, appelé à leur secours les plus riches familles des peuples alliés, originaires comme eux de villes italiennes, et liées avec l'aristocratie municipale par la communauté des intérêts, avant de l'être par celle du nom romain. Un ancien sénatus-consulte, publié en Italie, avait promis la jouissance des landes et des terres vagues à quiconque voudrait les défricher[187]. Les plus riches citoyens des villes italiennes en avaient profité pour agrandir leurs domaines ; ils avaient même empiété sur les autres terres publiques. Acquisitions légitimes, usurpations, héritages, tout s'était confondu sous l'aspect uniforme des cultures nouvelles ou des grands pâturages. Enfin quelques articles de la loi Thoria[188] montrent que la jouissance de certaines parties du domaine public de Rome avaient été attribuées à des villes alliées par des sénatus-consultes, des plébiscites ou des traités. Tibérius et Caius Gracchus, en proposant de partager le domaine public, que Rome avait en Italie, aux pauvres des tribus rustiques[189], blessaient donc les chefs italiens comme l'aristocratie équestre des municipes, et la noblesse du Sénat romain. Aussi Salluste[190], Tite-Live[191], Appien[192], s'accordent à dire que ce fut la coalition de toutes les aristocraties de Rome et de l'Italie, qui fit échouer la loi agraire. Comment dissoudre cette coalition ? Comment séparer les sénateurs de Rome des chevaliers romains et des nobles des villes alliées ? Caius Gracchus en trouva le moyen, mais en excitant des passions redoutables, qui devaient survivre à la loi agraire. Aux Italiens, il offrit le droit de cité romaine comme compensation de la perte des terres publiques[193]. Aux chevaliers, surtout aux publicains, il donna la judicature. |