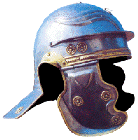HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME II
LIVRE PREMIER. LES CHEVALIERS ROMAINS DEPUIS LE TRIBUNAT DES GRACQUES
JUSQU'À LA DICTATURE DE
CÉSAR.
CHAPITRE II. LA
NOBLESSE URBAINE DU PATRICIAT.
|
La vraie nature du patriciat romain est encore aujourd'hui
mal comprise. Les théories abstraites des modernes, les anecdotes morales des
anciens ont également contribué à la faire méconnaître. Celui qui a répandu
le plus grand nombre d'idées fausses sur le patriciat, c'est le philosophe
Vico, génie vaste mais confus, chez qui l'on trouve plutôt l'instinct
divinatoire d'un oracle, que les connaissances précises d'un critique. Le
caractère du patriciat, d'après l'auteur de Pour que cette théorie de Vico eût au moins quelque vraisemblance, il faudrait que la loi des Douze Tables fût demeurée inconnue ou qu'elle n'eût pas été comprise au temps de Cicéron. Or, cette loi défendait expressément les mariages entre familles plébéiennes et patriciennes, et ce sont ces mariages que la loi Canuleia[7] permit. Un de nos savants historiens du droit romain[8] a démontré qu'il y avait à l'origine de Rome des gentes plébéiennes comme des gentes patriciennes. Il est vrai que M. Laferrière s'est trompé en attribuant à Niebuhr l'opinion que le droit de gentilité ne s'appliquait pas aux familles plébéiennes. Niebuhr dit seulement que les plébéiens n'avaient pas dans l'assemblée curiate les droits religieux des gentes patriciennes. Mais la réfutation de M. Laferrière renverse la théorie de Vico sur la gens héroïque. Dans la loi des Douze Tables, les droits de succession sont réglés sans distinction de plébéiens ni de patriciens, et aucun jurisconsulte n'a jamais imaginé que la législation des Décemvirs ait été faite pour une petite caste privilégiée. Or, cette loi voulait qu'à défaut d'héritiers siens, le père de famille eût pour héritiers légitimes ses agnats, et, à défaut d'agnats, ses gentiles[9]. La tutelle et la curatelle légitimes étaient déférées d'après les mêmes règles que l'hérédité légitime[10]. Les droits civils de l'agnation et de la gentilité appartenaient donc aux plébéiens comme aux patriciens, dès l'an 450 av. J.-C. Rien ne fait supposer que sur ce point la loi des Douze Tables ait innové, et elle n'a dû être, comme les plus anciennes lois écrites, que la consécration d'une vieille coutume[11]. Cicéron, dans les Topiques, définit le mot Gentiles, avec l'intention de donner un modèle de définition complète, et il emprunte cette définition au pontife Scævola : Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quorum majorum nemo servitutem servivit, qui capite non sunt deminuti[12]. La qualité de patricien n'est pas énumérée parmi les quatre conditions dont la réunion constitue le droit légal et complet de gentilité. On ne pourrait donc réserver ce droit aux patriciens qu'en supposant que la qualité d'ingénus dont les ancêtres ont tous été libres, n'aurait convenu primitivement qu'aux hommes du patriciat. C'est ce que semble admettre un instant M. Ortolan[13]. Après avoir établi que l'ingénuité était une condition pour exercer tous les droits de la gentilité, il identifie les patriciens avec les patrons, la plèbe avec les clients. Or, comme les clients descendaient des affranchis, il en résulterait que les patriciens seuls auraient eu à l'origine l'ingénuité, et que les plébéiens n'auraient pas eu le droit de gens. Cette théorie serait complètement erronée si on
l'appliquait à l'histoire des trente-et-une tribus rustiques. Celles-ci se
composaient de plébéiens ingénus qui formèrent, dès les premiers temps de En ne considérant que la plèbe urbaine, M. Ortolan admet l'opinion que nous combattons avec des restrictions qui en diminuent l'importance et la rapprochent beaucoup de la vérité. Par suite de l'accroissement incessant de la plèbe, à mesure que Rome étendait sa puissance et augmentait sa population, il arriva un temps où les plébéiens, attachés aux maisons patriciennes par les liens de la clientèle, ne formèrent qu'un petit nombre comparés à la grande foule restée en dehors de cette clientèle[15]... Plusieurs des nouveaux venus introduits dans la cité par Tarquin l'ancien avaient appartenu, dans leur ville, à la classe supérieure, et cependant, à l'exception d'un très-petit nombre, auquel le patriciat avait été accordé en même temps que le droit de cité, ils avaient dû prendre rang à Rome dans la plèbe, où ils avaient été en position, à cause de la franchise perpétuelle de leur lignage, de former la souche de gentes plébéiennes, contrairement à l'état antérieur d'après lequel les patriciens seuls pouvaient former une gens[16]. Ainsi M. Ortolan fait remonter au règne de Tarquin l'ancien l'établissement de gentes plébéiennes dans la plèbe urbaine. Mais son raisonnement, qui est fort juste, peut s'appliquer tout aussi bien au règne d'Ancus Marcius, ou à celui de Tullus Hostilius, car Ancus accrut la plèbe romaine de toute la population des villes latines de Politorium, de Tellène et de Ficana, qu'il établit sur l'Aventin. Tullus transporta sur le Clius la population d'Albe, et n'admit dans le sénat que cent Albains et dans le patriciat que cent gentes albaines. Enfin, ceux qui croient à l'arrivée de Titus Tatius à Rome et à l'établissement des Sabins de Cures sur le Capitole doivent admettre aussi que ces nouveaux Quirites ne fournirent que cent membres au sénat romain, et cent gentes nouvelles au patriciat, et que tous les autres chefs de familles libres, venus de Cures, devinrent la souche de gentes plébéiennes. En suivant le raisonnement de M. Ortolan, on arrive donc à reculer l'époque où les patriciens seuls auraient possédé l'ingénuité et le privilège exclusif de former des gentes, jusqu'aux premières années du règne mythologique de Romulus, jusqu'à un temps où les Romains, n'ayant pas encore enlevé les Sabines, n'étaient pas même parvenus à se marier. Réduite à ces proportions, la théorie qui réserve aux patriciens tous les droits primitifs de la gentilité, ne mérite plus qu'une bien faible place dans l'histoire. S'il est vrai qu'il y eût à Rome, dès le temps des rois, des gentes plébéiennes, peut-on dire que cette partie de la plèbe urbaine, qui se composait d'affranchis et de clients, fût complètement exclue de tout droit dans les gentes de ses patrons ? Ces clients qui, dès le temps de Servius Tullius, votèrent dans les curies avec les patriciens[17], qui, aux premiers temps du tribunat de la plèbe, mettaient leurs suffrages dans l'assemblée curiate à la disposition de leurs patrons pour faire réussir la candidature des tribuns agréables au patriciat[18]. Ces clients n'étaient-ils pas, dans une mesure restreinte, il est vrai, les gentiles de la grande race dont ils portaient le nom[19] ? Dans le tombeau des Scipions on a trouvé des affranchis de la famille. Ils appartenaient à la gens Cornelia comme les serviteurs à un clan. En 186 av. J.-C., une affranchie, Hispala Fecenia, reçoit du sénat un privilège ainsi formulé : Gentis enuptio... utique ei ingenuo nubere liceret[20]. Il y avait donc à Rome sur les affranchis une loi qui les empêchait d'épouser une personne de race libre, et de se marier en dehors de leur gens, comme au moyen âge le droit de formariage empêchait une femme serve d'épouser un homme libre ou étranger à sa seigneurie. Enfin, le client du décemvir Appius Claudius, qui réclame Virginie comme son esclave, s'appelle M. Claudius[21]. Il appartient au nomen Clandium ou à la gens Claudia. Ces clients, ces affranchis des gentes ne jouissaient pas de tous les droits de la gentilité. C'est pourquoi Scævola par la définition que nous avons citée, les exclut du nombre des véritables gentiles. Ainsi le client, ou l'affranchi, n'hérite pas de son patron si celui-ci meurt sans héritiers siens et sans agnats, tandis que dans un cas semblable, le patron hérite de son client ou de son affranchi. Il nous reste un exemple curieux de l'application de cette règle. Les Claudii patriciens et les Marcelli plébéiens, appartenaient à la même gens Claudia. Les Marcelli comme le M. Claudius de l'époque des décemvirs, descendaient d'une famille de clients parvenus aux honneurs. Le fils d'un affranchi des Claudii meurt sans héritiers. Les Marcelli étaient parents du mort. Ils réclament l'héritage en vertu de la parenté (stirpe). Les Claudii n'étaient pas du même sang que le mort, mais ils étaient de la même gens et du même nom. Ils réclament l'héritage par droit de gentilité (gente)[22]. On a cherché vainement à expliquer par une adoption ou par une adrogation, la coexistence dans une même gens de familles patriciennes et de familles plébéiennes. Si les Marcelli étaient entrés dans la gens Claudia par adoption ou adrogation, ils auraient été patriciens[23]. S'ils étaient devenus Marcelli et plébéiens par le même moyen, ils auraient été des Marcelli Clodiani, et non des Claudii Marcelli. Ils auraient renoncé à leur gens. Il ne reste donc pour expliquer la présence de ces plébéiens dans la gens Claudia, qu'à recourir à l'hypothèse de Drumann qui rencontre la même anomalie dans la gens Cassia et dans la gens Antonia[24], c'est-à-dire à les faire descendre d'un client de la gens ; à moins qu'on ne leur donne pour ancêtre, un Claudius établi dans la vetus tribus Claudia au bord de l'Anio, ou un chef d'une branche cadette assez éloignée des Claudii qui deviennent patriciens en s'établissant à Rome en 503 av. J.-C. Quelque hypothèse que l'on admette pour les expliquer, de pareils faits prouvent l'aptitude des plébéiens à entrer dans les cadres des gentes et même la présence dans les gentes des affranchis et des clients, qui y formaient une classe sans droits complets, et en quelque sorte les gentiles du second degré. Les passages qu'on a quelquefois allégués pour soutenir sur ce point la théorie de Vico, signifient le contraire de ce qu'on a voulu leur faire dire. Ainsi Aulu-Gelle emploie l'expression de gentes patrici[25], qui, loin de réserver la gentilité aux patriciens, suppose l'expression corrélative de gentes plebei ; autrement elle formerait pléonasme. Dans la discussion de la loi Ogulnia, relative au partage de l'augurat 300 av. J.-C., Tite-Live fait dire aux patriciens, qu'eux seuls ont une gens[26]. Mais il n'introduit ces paroles dans le discours du plébéien Decius Mus que pour les réfuter. Il ne s'agit point là des droits civils des gentes, qui étaient communs aux plébéiens et aux patriciens, mais des droits politiques et religieux des gentes patriciennes dans l'assemblée curiate, de l'augurat public que les patriciens s'étaient jusque-là réservé. C'est relativement à la religion des auspices publics, que ces gentes avaient jusque-là seules été comptées. Mais n'est-il pas bien étonnant qu'on ait pu croire qu'à cette époque de. l'an 300 av. J.-C., les plébéiens étaient une caste de parias sans droits civils, sans culte, sans famille reconnue, lorsque déjà ils étaient parvenus à partager le consulat, la censure, la préture, la dictature, le proconsulat et la noblesse sénatoriale, comme Decius Mus s'en vante dans ce même discours ? A propos de la loi Canuleia, Tite-Live prête aux consuls patriciens des expressions comme celles-ci : Les mariages mixtes entre familles patriciennes et plébéiennes seraient la confusion des gentes, des cultes privés et publics, une sorte de promiscuité bestiale. Mais il détruit plus loin d'un seul mot ces vaines hyperboles oratoires[27] : les mariages mixtes, répond Canuleius, ne changent rien au droit. Les enfants suivent la condition du père. En effet, d'après la loi romaine, les liens de la famille, de l'agnation, de la gentilité se formaient et se continuaient exclusivement par les personnes du sexe masculin. La femme en se mariant sortait entièrement de sa première famille[28] et elle était considérée comme la fille de son mari (loco fili), et la cohéritière de ses propres enfants. Le mariage d'un plébéien avec une patricienne, d'un patricien avec une plébéienne, ne pouvait donc porter aucune atteinte au droit, ni à la religion des gentes. Tels sont les principes de droit romain par lesquels on réfute les théories de Vico, qui refuse aux plébéiens la gens et les droits civils de la gentilité. Cette théorie moderne était inconnue des anciens dont aucun n'hésite à qualifier de gentes les races plébéiennes[29]. Caton l'ancien, originaire de Tusculum, était plébéien[30]. Pline nous dit qu'il fut le premier de la gens Porcia qui arriva aux honneurs[31]. Les Octavii étaient plébéiens de l'aveu même d'Auguste[32]. Suétone nous apprend que la gens Octavia était autrefois une des principales de Velitres[33]. Cicéron emploie l'expression de gens Fonteia, en parlant de la race plébéienne issue de Tusculum dont un membre avait adopté le patricien Clodius, pour le rendre apte à devenir tribun de la plèbe[34]. Les Tremellii étaient tous plébéiens[35]. Varron fait dire à l'un d'eux, surnommé Scrofa qu'il était le septième préteur de sa gens[36]. Le même auteur range C. Licinius Crassus, qui fut tribun de la plèbe en 145 av. J.-C.[37], dans la même gens que le grand tribun de l'an 376 av. J.-C. C. Licinius Stolo[38]. Un homme de la même famille, P. Licinius Crassus, s'excuse en 176 av. J.-C. de ne pouvoir se rendre comme préteur dans l'Espagne ultérieure, en jurant que des sacrifices solennels le retiennent à Rome[39]. Ces sacrifices étaient les sacra gentilicia, qui s'accomplissaient sur le tombeau commun des ancêtres transformés en dieux mânes. Il n'y avait pas dans l'ancienne République de plébéien de la campagne si pauvre qui n'eût dans son champ héréditaire de deux jugères (hredium)[40], son tombeau à côté de sa cabane[41]. Le plébéien Cicéron nous dit qu'il retrouvait à Arpinum sa race, le culte de sa race, et tous les souvenirs de ses ancêtres[42]. Enfin le passage le plus célèbre sur le culte des tombeaux dans l'antiquité, se rapporte précisément à la sépulture d'une gens plébéienne. C'est celui du de legibus II, 22 : Les tombeaux, dit Cicéron, sont
tellement respectés, que le droit religieux défend d'y enterrer un mort qui
ne soit pas de la gens et qui soit en dehors de son culte. C'est ce qu'a
jugé, au temps de nos ancêtres, A. Torquatus, à propos de la gens Popillia.
Or, les Popillii ont tous été plébéiens. On n'en trouve pas un seul patricien
dans les fastes de la République[43]. Tantôt un
Popillius est collègue d'un patricien dans le consulat[44], tantôt il est
tribun de la plèbe[45]. Le droit de
propriété (dominium)
et d'héritage appartient aux plébéiens dès les premiers temps, comme les
droits de la famille et du culte domestique. Tite-Live nous montre, en 493
av. J.-C., un plébéien dépouillé du champ de son père et de son aïeul[46]. Il appelle dominus un propriétaire plébéien de l'an 450
av. J.-C.[47]
Denys, de son côté, fait dire au roi Servius Tullius qu'il va distribuer aux
plébéiens pauvres des terres de l'Etat, pour que désormais ils travaillent
dans leur propriété et non sur les terres
d'autrui[48].
C'est précisément à propos de ce passage que Vico a imaginé la concession
bonitaire, faite aux journaliers plébéiens, des terres qu'ils cultivaient. On
ne peut fausser plus complètement le sens naturel des mots par esprit de
système. Dans les lois agraires, depuis Servius Tullius jusqu'aux Gracques et
à César, le but des législateurs fut de créer des propriétés individuelles
prises sur le domaine public. La possession bonitaire, opposée à la propriété
(dominium),
doit son origine, non aux lois de Servius, mais aux interdits des préteurs du
sixième siècle de Rome[49]. Elle
s'appliquait, non aux lots de terre distribués aux Colons plébéiens, lesquels
constituaient des héritages[50] (heredia),
mais surtout aux parties du domaine public, dont l'usage était laissé
provisoirement aux possesseurs, pour la plupart patriciens[51]. Ainsi, les
plébéiens eurent, dès l'origine, comme les patriciens, leurs cultes
domestiques, leurs sacra gentilicia,
leurs propriétés héréditaires, leurs droits de famille et toutes les
conséquences qu'on a tirées de l'hypothèse de Vico, d'après laquelle
l'organisation et le culte de la gens appartiennent exclusivement aux
patriciens, sont aussi fausses que l'hypothèse elle-même. S'il est une vérité générale aujourd'hui acquise à la
science, c'est que toutes les tribus de la race indo-européenne eurent, à
l'origine, même religion, même constitution domestique. Ne serait-ce pas une
inconséquence de montrer d'abord le feu sacré de Vesta allumé au foyer de
chaque père de famille, depuis l'Inde jusqu'à Mais le patriciat, considéré comme ayant formé un corps
politique, une cité particulière, eut, à l'origine de Rome, une religion locale
qui lui fut propre. Les gentes patriciennes étaient groupées en trente
curies, associations religieuses qui adoraient Il n'y avait pas dans le monde ancien d'organisation plus générale que celle des gentes. Chaque bourgeoisie était ainsi partagée : les habitants de Gephyræ et de Salamine, comme ceux d'Athènes ; ceux de Tusculum, comme ceux de Rome. Lorsque les uns et les autres[57] furent reçus dans la commune[58] des villes dominantes, leurs gentes ne disparurent pas pour cela. Dans les constitutions intérieures des municipes, qui, primitivement, ne furent pas modifiées par la concession du droit de cité romaine, les gentes, aussi longtemps qu'elles eurent une signification réelle, durent conserver aussi une existence politique, et, lorsque le temps et les circonstances eurent modifié leurs droits politiques, elles restèrent certainement en possession complète de leurs droits civils et religieux. Mais la cité de Rome, la plus grande des deux patries[59], ne reconnaissait pas ces gentes comme liées d'un rapport politique avec elle. Les gentes, desquelles se composaient les trois tribus anciennes[60], étaient seules des parties intégrantes de l'Etat romain, et c'est en ce sens que les patriciens pouvaient se vanter d'avoir seuls une gens[61], quoiqu'il existât à Rome et dans les municipes des milliers de gentes plébéiennes, exerçant les droits des gentiles[62]... La religion locale des gentes patriciennes, celle des curies, quoique les patriciens s'en fassent longtemps réservé le privilège, avec une ambition jalouse, n'était pas pour cela l'essence du patriciat. Car les plébéiens arrivèrent an consulat en 366 av. J.-C., à l'augurat en 300[63], au grand pontificat en 250[64], à la charge de grand turion en 209[65], et la conquête de tous les droits religieux ne leur procura pas le titre de patriciens. Les consuls, les préteurs, les édiles, les augures, les pontifes, les curions nés plébéiens, restèrent plébéiens, et formèrent une noblesse plébéienne distincte du patriciat, quoiqu'elle partageât avec lui toutes les fonctions sacrées. C'est ainsi que la gens Domitia, d'où sortirent un consul dès l'an 329 av. J.-C.[66], et deux pontifes[67] fut plébéienne jusqu'au règne de l'empereur Claude[68]. Le patriciat était donc une aristocratie politique, et non une aristocratie religieuse, et la qualité d'un patricien tenait, non à un caractère sacerdotal, mais à l'origine, à l'antiquité de sa famille, ou de sa gens arrivée de très-bonne heure à siéger dans le sénat romain. Tite-Live nous dit que les patriciens furent les
descendants des premiers sénateurs (Patres)[69]. Nous voyons en
effet, que les sénateurs nommés par Romulus, par Tullus Hostilius, par
Tarquin l'ancien, entrent dans le patriciat en même temps que dans le sénat[70]. M. Mommsen, à
l'opinion duquel nous nous rattachons ici presque complètement, affirme que[71], depuis la fondation du gouvernement républicain, jusqu'à
sa chute, c'est-à-dire de 509 à 45 av. J.-C., le patriciat qui sous les rois
avait admis les minores gentes dans ses rangs, demeura fermé désormais
à toute intrusion ; mais que, sous César et sous les empereurs, comme il
avait fait sous les rois, il s'ouvrit de temps à autre, à certaines familles
nobles nouvelles. Cette assertion est la traduction presque fidèle
d'un passage célèbre de Tacite[72] sur l'histoire
du patriciat. Mais, si l'on suit l'autorité de cet écrivain sur ce qui
concerne la clôture des listes du patriciat, depuis Junius Brutus jusqu'à la
dictature de César, on ne peut oublier que, dans le même endroit, Tacite
attribue à Junius Brutus, la création des Patres
minorum gentium. Denys[73] place
l'institution de ce patriciat plus jeune que le premier sous le consulat de
Valerius Publicola et de Junius Brutus (milieu
de l'année 509 av. J.-C.). Il dit qu'ils choisirent les chefs de la
plèbe, qu'ils en firent des patriciens, et complétèrent avec eux, le nombre
de trois cents sénateurs. Plutarque retarde jusqu'après la bataille du lac
Régille (496 av. J.-C.) la nomination
par Valerius Publicola de cent soixante-quatre sénateurs des gentes nouvelles. Enfin Tite-Live[74] dans le discours
de Canuleius, rappelle que, même après l'expulsion des rois (503 av. J.-C.), la gens Claudia fut admise non seulement dans la
cité romaine, mais dans le patriciat, et cela sur un ordre du peuple[75]. Tous ces
témoignages, différents par des détails de chronologie, concordent sur un
point, c'est que les listes du patriciat n'étaient pas closes, dans les
premières années de Le patriciat romain se composa
de toutes les familles de race libre (ingenu) établies dans la ville de Rome
avant l'institution du tribunat de la plèbe (493
av. J.-C.) et dont Tous les éléments de cette définition, à l'exception d'un seul, sont tirés des textes des auteurs anciens ou des faits les mieux connus de l'histoire romaine, et, pour l'établir complètement, il nous reste à montrer que le patriciat appartenait tout entier aux quatre tribus de la ville, et qu'il eut toujours le domicile, la législation, les habitudes, les goûts d'une aristocratie urbaine. En 493 av. Jésus-Christ, à l'époque où le livre d'or du
patriciat romain se trouva fermé pour quatre siècles et demi, le territoire
de Rome avait à peu près trente kilomètres de l'est à l'ouest et quarante du
nord au sud[81].
Il n'était guère plus étendu que le département de On peut déterminer le quartier de Rome, et souvent même
l'emplacement qu'occupèrent les principales maisons patriciennes. Romulus, ou
le fondateur, quel qu'il ait été de Le Capitole est bloqué par les
Gaulois. Un Fabius en sort et traverse les lignes ennemies vêtu du costume
religieux et portant à la main les objets sacrés. Il va offrir un sacrifice
sur l'autel de la gens qui est situé sur le Quirinal... Que prescrit cette religion primitive ? Que l'ancêtre,
c'est-à-dire l'homme qui a été enseveli le premier dans le tom, beau, soit
honoré perpétuellement comme un dieu ; que ses descendants, réunis chaque
année prés du lieu sacré où il repose, lui offrent le repas funèbre. Ce foyer
toujours allumé, ce tombeau toujours honoré d'un culte, voilà le centre
autour duquel toutes les générations viennent vivre, et par lequel toutes les
branches de la famille, quelque nombreuses qu'elles puissent être, restent
groupées en un seul faisceau.... Cette
famille indivisible, qui se développe à travers les âges, perpétuant de
siècle en siècle son culte et son nom, c'est véritablement la gens
antique[87].
Ainsi la gens patricienne des Fabii
avait son autel, son tombeau, son point de ralliement, son séjour dans Rome
sur la colline du Quirinal. C'est en effet du Quirinal que venait le clan des
trois cents six Fabii lorsqu'ils partirent avec leurs quatre mille clients
pour le poste de la rivière Crémère. Car ils passèrent devant le Capitole et
la citadelle pour aller sortir par le battant droit de la porte Carmentale[88]. C'est sur le
Quirinal que s'élevait le temple de la déesse Salus
qui fut orné de peintures en l'an 303 av. J.-C. par Fabius Pictor[89]. L'artiste
patricien avait décoré sa paroisse. Il avait même écrit son nom au bas de sa
fresque. Valère Maxime qui tient par le sang à la gens
Fabia se montre tout confus d'avoir un peintre dans sa famille[90]. Quoi ! un
Fabius a-t-il pu afficher un goût aussi bas ? se faire gloire d'une uvre
aussi méprisable ? Le noble écrivain qui parle en ces termes du talent d'un
de ses ancêtres se serait peut-être cru dispensé d'en rougir, s'il eût
remarqué que le dédain pour les arts n'était pas encore de mode à Rome aux
deux premiers siècles de Sur la même colline du Quirinal, un peu au sud du temple de Salus et de la porte salutaire, à l'endroit où commençait l'alta semita était le vicus Corneliorum[91]. Il ne fallait pas moins d'une grande rue ou d'un quartier, dit M. Ampère[92], pour loger toute une gens. La rue ou le quartier des Cornélins était sur la pente du Quirinal. Il y a eu près de Monte Cavallo une église du Saint-Sauveur qui était appelée des Cornelius. Ce qu'étaient les Cornelius dans les Colonna le furent au moyen-âge et non loin du lieu appelé autrefois vicus Cornelius est une petite rue qui porte encore le nom de vico dei Colonnesi. Dans la vallée étroite qui s'étendait entre l'Esquilin et le Viminal, était le quartier appelé vicus patricius[93]. La tradition voulait que le roi Servius Tullius eût forcé les patriciens à y venir habiter, afin de surveiller leurs complots[94] du haut de son palais, établi au mont Cispius, sommet septentrional de l'Esquilin, non loin de l'emplacement actuel de Sainte-Marie Majeure[95]. Quelle que soit la valeur historique de cette tradition, les anciens n'auraient même pas songé à l'imaginer, s'ils n'avaient cru que les patriciens étaient dès le temps des rois, fixés à demeure dans Rome. Au centre de la ville, dans la partie septentrionale de la
tribu Palatine, Valerius Publicola fut enterré au pied de la colline Velia à
l'endroit où il avait bâti son palais. Pendant cinquante ans, les Valerii
allèrent porter leurs morts à la sépulture sacrée où reposait le chef de la gens. Mais lorsque la loi des Douze Tables eût
défendu de brûler ni d'enterrer les morts dans la ville[96], ils allaient
toujours, en souvenir de l'ancien usage, déposer le corps quelques instants
auprès des mânes des ancêtres, au pied de Atta Clausus en se transportant à Rome obtint aussi avec
le titre de patricien, un lieu de sépulture pour sa gens au pied du Capitole[98]. C'est
l'établissement d'une partie de la gens Claudia
autour de ce tombeau, et son entrée dans la tribu sacrée des Tities qui a donné lieu à la fable de
l'occupation du Capitole par les Sabins de Titus Tatius. Les Claudii
patriciens ne se contentèrent pas d'être citoyens de Sans doute les patriciens possédaient autour de Rome des
maisons de campagne et des fermes comme la bourgeoisie noble du vieux Paris
en avait dans la banlieue de cette capitale ; mais les habitudes de la
villégiature ou la surveillance exercée par un propriétaire de la ville sur
un fermier, diffèrent beaucoup de la vie agricole. Lorsqu'à l'instigation
d'Appius Claudius, les décemvirs se furent prorogés eux-mêmes dans leur
pouvoir, les sénateurs irrités ou découragés se retirèrent dans leurs maisons
des champs. Les dix tyrans inquiets de la solitude qui se faisait autour
d'eux essayèrent de convoquer le sénat. Les appariteurs, après avoir
inutilement fait le tour des grandes maisons de Rome, revinrent annoncer que
les sénateurs étaient à la campagne. Les décemvirs les envoyèrent hors de
Rome porter des ordres de convocation pour le lendemain[101]. Si la vie des
patriciens s'était passée habituellement à la campagne, leur retraite hors de
la ville n'aurait pu avoir le caractère d'un deuil politique, ni la portée
d'une protestation. Denys ajoute à ce récit un trait original qui rappelle la
vieille Rome du moyen-âge, et il n'était pas capable d'imaginer un fait aussi
conforme au génie superbe d'une aristocratie républicaine, aussi éloigné des
habitudes de soumission de Ce qui frappe tout d'abord à
Florence, c'est l'aspect sombre et menaçant de ses palais, véritables
forteresses du moyen-âge. Rien ne peut mieux donner l'idée de l'époque où
chacun était forcé de se garder soi-même que ces grands édifices formés de
gros blocs de pierre noircis par le temps, avec leurs crénelures et leurs
anneaux de fer pendants le long des murs. La rareté des croisées ajoute à
leur tristesse. Une porte massive de chêne défend le passage qui donne accès
dans ces formidables demeures, théâtre des guerres civiles qui ont si souvent
déchiré les États florentins.... Le vieux château est lui-même un des
monuments les plus intéressants de Florence. Dans le principe, ce n'était
qu'une forteresse élevée par la démocratie de 1298 ; mais Côme de Médicis la
choisit pour sa résidence, et bientôt l'austère demeure des chefs de Telle était aussi La législation fortifiait encore cette passion naturelle des patriciens pour leur séjour ordinaire. Denys les compare aux Eupatrides, qui eurent dès l'origine le gouvernement d'Athènes, et il assimile les plébéiens aux paysans de l'Attique, qui n'obtinrent les droits politiques qu'après longtemps. Romulus, dit-il, assigna à chaque classe ses occupations : les patriciens devaient être prêtres, magistrats et juges, et administrer avec lui les affaires publiques, en restant attachés aux fonctions qu'on remplit à la ville ; les plébéiens, dispensés de ces soins, devaient cultiver la terre, élever des troupeaux, enfin s'occuper des métiers lucratifs[114]. Si les patriciens étaient fixés à la ville par leurs occupations politiques[115], les intérêts de leur liberté les empêchaient de résider dans les premiers temps à plus d'un mille de ses murs. C'est ce que nous fait comprendre la curieuse législation
relative à la reciperatio et aux judicia legitima. La reciperatio passa du droit des gens dans le droit civil[117]. La raison de ce fait c'est que la plèbe rustique, qui était d'abord à Rome un peuple politiquement étranger, devint partie intégrante de la cité en 240 av. J.-C. Cette révolution politique que nous avons décrite, fut accompagnée d'une révolution dans la procédure que M. Ortolan place entre les années 246 et 186 av. J.-C.[118] On distingua toutes les procédures en deux catégories, celles qui se fondaient sur le droit civil proprement dit (legitima judicia) et celles qui se fondaient sur l'ordonnance d'un chef militaire et dont l'effet durait autant que son pouvoir (judicia que imperio continentur). Les procédures de droit civil (legitima judicia) étaient celles qui étaient réglées dans la ville de Rome ou en deçà du premier mille entre citoyens tous romains et où la cause était soumise à un seul juge. Les procédures de droit militaire étaient celles des causes plaidées devant les récupérateurs[119], celles des causes où il y avait, il est vrai, un seul juge, mais où intervenait la personne d'un juge ou d'un plaideur étranger, enfin celles qui étaient réglées soit entre Romains soit entre étrangers, mais au delà du premier mille de Rome[120]. En un mot tout élément étranger à la cité romaine dans un procès, qu'il vînt de la forme du tribunal, des personnes, ou du territoire, empêchait la procédure de s'appuyer sur le droit civil et d'être légitime. Il résulte de là que le territoire civil était primitivement limité à un mille des murs de Rome. Au delà de cette zone commençait le territoire étranger, celui de la plèbe rustique. C'est à un mille des murs que les chefs romains mettaient les haches sur les faisceaux et exerçaient l'imperium sans droit d'appel. C'est pour la même raison que l'inviolabilité tribunitienne cessait à un mille de Rome[121]. La toute puissance des tribuns de la plèbe leur veto aurait été, au delà de cette limite, incompatible avec l'imperium des consuls. Les patriciens ne pouvaient donc pas quitter Rome où ils étaient tout-puissants, pour aller résider à la campagne où ils auraient été soumis aux verges et à la hache des chefs militaires[122]. Comment donc a pu se former dès l'antiquité l'idée d'un patriciat agricole ou pastoral ? Il n'y a pas trace de cette idée dans le de re rustica du vieux Caton. Varron, pour suivre la mode, s'arrête quelque temps à l'histoire du berger Faustulus dont il se moque un peu[123]. Columelle, contemporain de Néron, insiste d'un ton convaincu sur l'éloge des agriculteurs nobles des anciens temps[124]. A mesure que le luxe grandit dans Rome, le goût de l'idylle et le besoin de moraliser transfigurent l'ancien patriciat dans l'esprit des écrivains. Mais l'image qu'ils se sont plu à en tracer, au lieu de représenter la vie réelle des temps primitifs, n'est qu'un reflet des préoccupations morales, politiques ou littéraires du siècle où ils écrivaient. La plupart des historiens à Rome ont vécu sous l'empire à une époque de raffinement où l'imagination se plaisait à opposer le toit de chaume du bon Evandre aux palais dorés des Césars. Les âmes affadies par la civilisation malsaine de la ville cherchaient des contrastes piquants dans les rêves de l'âge d'or. Prosateurs et poètes transformaient à l'envi la vieille histoire de Rome en une grande pastorale[125]. On aimait à décrire les cabanes des bergers du Mont Palatin, et les bufs mugissant au milieu du quartier élégant des Carènes. Virgile[126], Tibulle[127], Properce[128], prêtaient à ces exercices d'école[129] les grâces de la poésie élégiaque ou la majesté de la tradition épique. Déjà, depuis leur triomphe politique de l'an 240 av. J.-C., les plébéiens avaient introduit dans l'histoire de Rome nombre d'anecdotes destinées à ennoblir les occupations agricoles auxquelles ils se livraient ; mais, au siècle de Cicéron et d'Auguste, on finit par ne plus distinguer parmi les anciens Romains les chefs du patriciat des chefs de la plèbe. Leur physionomie propre s'effaça dans un idéal commun de pauvreté et de simplicité rustiques. Tite-Live[130], Valère Maxime[131], Florus[132], Pline[133] et, à leur suite, Plutarque et Juvénal moralisent ou déclament à propos de la charrue de Marius et de la charrue de Cincinnatus. Dans les images qu'ils nous tracent de ces deux héros, le rude plébéien d'Arpinum et le chef de la race patricienne des Qninctii se ressemblent comme deux frères jumeaux. Sur la foi de pareilles anecdotes, on a figuré un patriciat composé de campagnards quittant leur labour pour venir délibérer au sénat, et déposant les faisceaux de la dictature pour aller terminer leur sillon. Pour achever cette confusion entre le patriciat et la plèbe, les étymologistes latins ont cherché à faire dériver les noms des patriciens de ceux des légumes qu'on supposait avoir été cultivés par leurs mains victorieuses. La fève, faba, aurait eu l'honneur de donner son nom à la grande race des Fabii, et les Lentuli devaient s'être appelés ainsi parce que leurs ancêtres avaient planté des lentilles[134]. Une des familles des Valerii aurait porté le surnom de Lactucini pour avoir, à peu près comme Dioclétien dans son palais de Salone, arrosé des laitues[135]. Nous ne parlerons pas d'Atilius surnommé, dit-on, Serranus parce que les envoyés du sénat l'auraient trouvé occupé à faire ses semences[136]. Le nom d'une famille des Atilii était Saranus et non Serranus[137]. On avait altéré le nom de cette famille, de même que l'histoire d'Atilius Regulus[138], à seule fin d'inscrire les Atilii parmi les illustrations agricoles de l'ancienne Rome. Mais quand la pauvreté des Alibi n'eût pas été une page édifiante de la morale en action des vieux Romains[139], elle ne prouverait pas plus que le plat de bois de Curius, ou le désintéressement de Fabricius, les goûts rustiques du patricial de la ville. Car les Atilii[140], les Curii[141] et les Fabricii[142] étaient plébéiens. Quant aux patriciens enterrés comme Menenius Agrippa ou les Valerii aux frais de leurs concitoyens, cet honneur fait à leur mémoire n'était nullement pour leur famille un certificat d'indigence[143]. Mais les Grecs inventeurs de tous les beaux mensonges ayant vanté la pauvreté de leurs plus grands citoyens, les Romains jaloux de toutes les gloires enveloppaient leurs vieux héros dans le linceul d'Aristide ou dans le manteau usé de Phocion. Lorsqu'on étudie le caractère des patriciens dans leurs paroles et dans leurs actions, on est tout étonné de les trouver si peu semblables à leurs portraits. Mon ami, est-ce que vous marchez sur les mains ? disait le patricien Scipion Nasica à un électeur de la campagne dont il avait touché la main calleuse[144]. Toutes les tribus rustiques, indignées de cette plaisanterie, refusèrent au citadin insolent l'édilité curule qu'il demandait. Pourtant Nasica n'avait eu d'autre tort que de dire tout haut et mal à propos ce que les autres patriciens pensaient et disaient tout bas. Comme nos gentilshommes d'autrefois, ils étaient fiers de leurs mains blanches et laissaient volontiers les plébéiens, les Marius, les Caton se vanter d'être bons laboureurs. Une passion tout aristocratique pour les arts, une curiosité intellectuelle qui leur fit rechercher de bonne heure la société des Grecs, une élégance ennemie de toute vulgarité, s'alliaient chez les patriciens à ce dédain railleur pour tous les travaux manuels. Depuis le temps de Flamininus jusqu'à celui de César, savoir parler grec était un signe d'urbanité et d'éducation patricienne. Le vieux Caton, un provincial de Tusculum[145] protestait inutilement contre cette mode de la grande ville. P. et L. Scipion, loin d'afficher, comme le fit quarante ans après le plébéien Mummius, un dédain grossier pour les uvres et les usages du peuple savant et artiste, s'étaient souvent montrés en public avec les pantoufles grecques et la chlamyde. C'est avec ce costume qu'ils étaient représentés dans leurs statues placées au Capitole[146]. Sylla, le patron des Chrysogonos, après s'être plongé dans le sang des plébéiens et des chevaliers romains, abdiqua la dictature pour aller dans une somptueuse retraite lire les uvres d'Aristote, de Théophraste et tous ces beaux volumes, rapportés d'Athènes ou de Pergame, dont il avait composé sa bibliothèque de Cumes. L'élégant patricien n'était pas changé. Tous ceux qu'il avait tués ne méritaient pas à ses yeux l'honneur de lui laisser un remords ni même un souvenir. Il se reposait comme un chasseur heureux qui revenant de la curée s'assied tranquillement à une table chargée des mets les plus recherchés. Blasé sur tous les plaisirs du luxe et de la grandeur, il se donnait le plaisir suprême de tout dédaigner et de se jouer de cette puissance qu'il conservait encore après en avoir déposé les insignes[147]. On voyait l'ancien dictateur, le rival de Marius, le
vainqueur de Mithridate, couvert d'un manteau grec, se promener près de la
baie de Naples en compagnie de plusieurs comédiens, parmi lesquels on
distinguait Q. Roscius de Lanuvium qu'il avait décoré de l'anneau d'or[148]. Jusqu'à sa
dernière heure, il continua de célébrer sa félicité, mêlant de temps en temps
la débauche et la vengeance aux jouissances plus délicates de l'esprit. Deux
jours avant sa mort, il travaillait au vingt-deuxième livre de ses mémoires
et, la veille, il faisait étrangler au pied de son lit[149] le chevalier
romain Granius[150], magistrat de
la ville de Pouzzoles, qui attendait sa mort pour se dispenser de rendre ses
comptes. Que l'on remonte jusqu'au siècle des guerres puniques, où un Fabius
écrivait en grec les annales du peuple romain, même jusqu'à celui des guerres
du Samnium où L. Papirius Cursor se faisait peindre monté sur son char de
triomphe dans le temple de Consus[151], et l'on
cherchera vainement où s'est réalisé l'idéal du patricien laboureur ou du
sénateur portant la houlette. Cet être chimérique n'a pas existé davantage au
premier siècle de C'est dans le traité de Cicéron sur la vieillesse intitulé
Caton l'ancien[158] qu'on trouve le
plus beau passage classique où l'éloge de l'agriculture appelle le souvenir
de l'illustre laboureur. Dans ce morceau de littérature, le plébéien Caton refait
l'ancien patriciat à son image. Cicéron colore le langage du vieux Caton
d'une teinte de poésie champêtre tout â fait étrangère à l'esprit de l'âpre
paysan. Il appuie la tradition fausse d'un patriciat agricole sur une
explication étymologique sans aucune valeur. Il fait dériver le nom des
viateurs de via route, parce que leur
fonction aurait consisté à porter dans les champs des avis de convocation aux
sénateurs occupés de leurs labours et de leurs récoltes. On trouve les
viateurs employés tout autrement par les censeurs[159], par les
consuls[160],
par les édiles[161] et surtout par
les tribuns de la plèbe[162]. Si le nom des
viateurs leur était venu d'un service analogue à celui de nos facteurs
ruraux, comment des appariteurs de ce nom auraient-ils été attachés à la
personne des tribuns de la plèbe qui n'avaient même pas le droit d'aller à la
campagne[163].
Les rues de Rome s'appelaient vi
comme les voies qui les prolongeaient hors des murs. On pouvait être viateur
sans sortir de la ville. Cicéron a donc imaginé pour le besoin de sa thèse de
moraliste une explication étymologique aussi arbitraire que la plupart de
celles de Varron. L'occasion la plus remarquable où l'on voit, au premier
siècle de Le patriciat était donc une aristocratie urbaine par son séjour et par ses goûts, et c'est seulement au troisième siècle av. J.-C. que les écrivains commencèrent à l'assimiler à la noblesse plébéienne des tribus rustiques. Le génie de la vieille Rome se retrouve jusqu'à la fin des temps anciens dans les villes faites à son image[164]. Ses colonies, quoiqu'elles aient été longtemps comme nos petites villes de province des centres de réunion pour les populations agricoles, n'en essayaient pas moins de ressembler, comme autant de rejetons, à la grande cité d'où elles s'étaient séparées. Or voici la différence profonde que M. Guizot reconnaît entre la société romaine du IVe siècle ap. J.-C. et la société féodale[165]. Les villes, avant l'invasion des Barbares, étaient le centre de la population supérieure. Les maîtres du monde romain, tous les hommes considérables habitaient dans les villes ou auprès des villes. Les campagnes n'étaient occupées que par une population inférieure, esclaves ou colons entretenus dans une demi-servitude. Au sein des villes résidait le pouvoir politique. Le spectacle contraire nous est offert par l'époque féodale. C'est dans les campagnes qu'habitent les seigneurs, les maîtres du territoire et du pouvoir. Les villes sont abandonnées à une population inférieure qui lutte à grand'peine pour s'abriter, se défendre et enfin s'affranchir un peu derrière ses murs. Ainsi, comme l'ont si bien marqué Niebuhr et M. Guizot, les hommes de noble race sont au moyen âge établis dans la campagne, tandis que dans l'antiquité ils avaient leur château dans la ville. Les patriciens de la vieille Rome étaient jaloux de leur droit de cité, tandis que les Gibelins du Contado subirent le droit de cité que leur imposa la commune Florentine comme un aveu de leur défaite. Être exilé de Rome était le dernier châtiment du patricien. Au contraire il fallait un article de traité pour obliger les Corvoli, seigneurs de Frignano, à venir habiter deux mois de l'année la ville de Modène[166] (1156). Rome appelait à elle les chefs de la plèbe des campagnes, et Florence chassa plusieurs fois les chefs de la plèbe urbaine vers les châteaux du Contado. A Rome, ce fut la campagne qui l'emporta sur la ville, et les murs militaires prévalurent. Dans les communes du moyen-âge, la population urbaine triompha et les habitudes mercantiles effacèrent les vertus guerrières. Les rivaux des seigneurs italiens, ce furent les chefs de l'aristocratie bourgeoise que le commerce et l'industrie plaçaient à la tête des villes guelfes. Les rivaux des patriciens, les chefs de la plèbe rustique, ce furent les chevaliers romains, une aristocratie municipale et agricole. Le bourgeois d'une ville de commune qui s'était enrichi achetait un fief à la campagne. Le chevalier romain sorti d'une tribu rustique, dès qu'il parvenait à la fortune et aux honneurs achetait une maison à Rome. On cite même un homme nouveau d'une famille équestre de Velitres, M. Octavius, qui, le premier de sa race, obtint le consulat (165 av. J.-C.), à cause de la beauté de la maison qu'il avait bâtie sur le Palatin[167]. Le patriciat étant la plus vieille bourgeoisie[168] de Rome constituée dans la ville en corps politique avant l'institution des tribuns de la plèbe, ne pouvait voir qu'avec jalousie s'établir dans la ville les hommes nouveaux, la plupart chevaliers romains, qui venaient des municipes ruraux pour lui disputer les suffrages du peuple. Aussi les patriciens qualifiaient-ils dédaigneusement ces nouveaux-venus de locataires admis dans la ville aux privilèges de l'incolat, inquilini. Cette épithète s'opposait à la qualité de domini[169] maîtres de maison ou propriétaires que les patriciens semblaient se réserver, comme si eux seuls avaient eu dans Rome pignon sur rue. Velleius appelle inquilinus le vieux Caton venu de Tusculum, qu'il range avec Coruncanius et avec Sp. Carvilius né d'une famille équestre parmi les hommes nouveaux qui arrivèrent au faîte des honneurs[170]. Le patricien Catilina répète cette qualification d'inquilinus comme une injure â l'adresse de Cicéron d'Arpinum[171]. La définition que nous avons donnée du patriciat était donc nécessaire pour faire comprendre sa lutte séculaire contre l'ordre équestre, et l'antagonisme de la noblesse urbaine contre la noblesse municipale des chevaliers romains. |