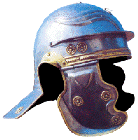HISTOIRE DES CHEVALIERS ROMAINS
TOME II
LIVRE PREMIER. LES CHEVALIERS ROMAINS DEPUIS LE TRIBUNAT DES GRACQUES
JUSQU'À LA DICTATURE DE
CÉSAR.
CHAPITRE PREMIER. ANTAGONISME DE LA NOBLESSE URBAINE
DU PATRICIAT ET DE L'ARISTOCRATIE MUNICIPALE DES CHEVALIERS ROMAINS.
|
L'antagonisme, qui peu à peu s'accentue entre deux classes politiques, ne devient très-sensible que lorsqu'elles se sont fortifiées, et nettement séparées par leur opposition même. Le germe de leur division existe en elles dès le principe. Mais l'on ne peut étudier cette cause intime des révolutions que dans les faits extérieurs qui en sont les conséquences tardives. Voilà pourquoi, en abordant l'histoire de la lutte des chevaliers et de la noblesse romaine, à l'époque où cette lutte devient le fait dominant de la politique intérieure de Rome, nous sommes amenés à remonter à l'origine même de ces deux aristocraties, que les lois des Gracques mirent aux prises et qui se combattirent jusqu'à la ruine de la liberté. Placée plus tôt, cette étude eût été prématurée et, au lieu de nous présenter des contrastes frappants et des luttes ouvertes, elle ne nous eût révélé que les indices d'une profonde, mais sourde inimitié. Mais ce que présenta d'original le développement de la
cité romaine, c'est qu'elle arriva à comprendre plusieurs peuples,
c'est-à-dire plusieurs villes avec leurs territoires. Elle élargit ainsi
l'horizon des vaincus adoptés comme citoyens ; elle leur donna une patrie
commune, et, les élevant au-dessus des mesquines rivalités de leurs petites
villes, les initia, autour de la tribune du forum, aux grandes luttes de la
vie nationale. Cicéron, arrivant à son domaine de la rivière Fibrène, près
d'Arpinum, disait à Atticus[10] : C'est ici ma vraie patrie et celle de mon frère ; c'est
ici que nous sommes nés d'une famille très-ancienne. Ici se trouvent nos
autels domestiques, notre race et de nombreux souvenirs de nos ancêtres.
Que voulez-vous dire, lui demandait
Atticus, en appelant cet endroit, c'est-à-dire, je
pense, tout le pays d'Arpinum, votre véritable patrie ? Est-ce que vous avez
deux patries ? ou n'en avez-vous qu'une seule, la grande patrie commune ?
Direz-vous que le sage Caton ait eu pour patrie, non pas Rome, mais Tusculum
? Pour moi, reprenait Cicéron, je pense que Caton, et tous les citoyens des municipes,
ont deux patries : l'une naturelle, l'autre civile. Ainsi Caton, né à Tusculum, fut admis dans la cité du peuple romain. Tusculan par l'origine, Romain par le droit de cité, il eut pour première patrie son lieu de naissance, pour seconde patrie, celle que la loi lui donna... Nous devons aimer avant tout celle qui porte le nom de la grande cité. C'est pour elle que nous devons mourir. C'est à elle que nous devons nous dévouer tout entiers. Mais celle qui fut notre berceau, n'est pas moins douce pour nous que celle dont nous sommes les enfants d'adoption. Aussi je reconnaîtrai toujours ici ma patrie, pourvu que l'autre soit la plus grande et que celle-ci y soi comprise. Ce dernier mot, dit M. Michelet[11], est d'une grande profondeur. Le municipe est contenu dans la cité. Rome n'était pas seulement une ville de pierres, mais surtout une ville de lois. Si Rome conserva le titre de ville par excellence, Urbs et réduisit les autres villes de son empire à n'être vis-à-vis d'elle que des bourgs de la campagne[12], elle n'en dut pas moins sa force à la plèbe rustique qu'elle laissa se former autour d'elle. Le patriciat, le peuple primitif, ne reçut aucun accroissement depuis l'époque de Junius Brutus et de Valerius Publicola jusqu'à celle de César[13]. Au contraire, tous les citoyens introduits dans la cité romaine depuis l'an 493 av. J.-C. jusqu'à l'an 45 av. J.-C. furent sans exception des plébéiens, même quand ils prétendaient descendre des rois ou des dieux de leur pays. A la plèbe romaine appartiennent les Otacilii de Malevent dont une fille épousa un des Fabii, et introduisit dans cette famille patricienne le prénom plébéien de Numérius[14], les Ælii Lamiæ de Formies qui se donnaient pour aïeul Lamus roi des Læstrygons, les Cæcilii Metelli de Préneste, qui faisaient remonter leur origine jusqu'à Cæculus, fils de Vulcain, et les Mamilii, issus des dictateurs de Tusculum, descendus, disait-on, d'Ulysse et de Circé. Tusculum devint le centre de la tribu rustique Papiria[15]. Les plébéiens habitèrent en général autour de Rome les petites villes admises au droit de cité. C'étaient les periques de Rome ; mais à la différence de ceux de Sparte, ils étaient de même race que les habitants de la ville dominante et ils devinrent leurs égaux. Tacite, pour distinguer le plébéien Sulpicius Quirinus de la famille patricienne des Sulpicii, dit qu'il était né près du municipe de Lanuvium[16]. Cicéron range toujours les citoyens romains des municipes avec ceux des campagnes en un seul parti rival du patriciat et de la vieille noblesse[17]. Nous avons indiqué dans le tome premier de cette histoire, les principaux traits de cette lutte séculaire des tribus rustiques contre la ville de Rome. C'est d'abord la retraite au mont Sacré et la création du tribunat de la plèbe, qui met à la tête du parti des campagnes des magistrats inviolables et tout puissants dans Rome. Un siècle après, l'annexion successive à la cité romaine
des quatorze dernières tribus rustiques fait passer la prépondérance de la
ville à la campagne, et amène le partage de tous les honneurs entre le
patriciat et la plèbe et les lois populaires de Publilius Philo, de Mnius et
d'Hortensius. La loi la plus curieuse par laquelle le patriciat essaya
d'arrêter ce mouvement irrésistible fut la loi Ptelia de Ambitu. Elle
était dirigée par les patriciens contre les hommes nouveaux qui allaient dans
les petites villes de la campagne, et dans les bourgades pour briguer les
suffrages des tribus rustiques dont ils étaient les candidats naturels[18]. Elle est de
l'an 355 av. J.-C., précisément de l'année où furent formées les tribus du
pays Volsque, Malgré ces résistances, la plèbe rustique devenant de jour en jour plus nombreuse par la diffusion du droit de cité, fit consacrer sa supériorité politique dans la constitution nouvelle de l'an 240 av. J.-C. où ses chefs, les chevaliers romains, acquirent les moyens de diriger les votes de l'assemblée centuriate. Un siècle après, au temps des Gracques, les chevaliers des municipes recommencent la lutte contre la noblesse de la ville enrichie et enorgueillie par la conquête du monde. Bientôt après la guerre des alliés de 89 à 83 av. J.-C., la plèbe obtient son plus décisif et son dernier triomphe par l'extension du droit de cité et du territoire des tribus rustiques, depuis la rive droite du Pô jusqu'au détroit de Sicile. Une belle tradition populaire, dont la valeur historique n'a pas échappé à M. Michelet[19], montre qu'aux yeux des Romains eux-mêmes, l'époque où les Italiens envahirent en foule le droit de cité, fut celle de la victoire définitive de la plèbe et de la décadence irrémédiable du patriciat. Parmi les plus vieilles enceintes consacrées aux dieux, on compte celle de Quirinus, c'est-à-dire de Romulus lui-même. Dans cette enceinte et devant le temple il y eut longtemps deux myrtes sacrés appelés l'un le Plébéien, l'autre le Patricien. Pendant bien des années le myrte patricien fut le plus beau ; son feuillage était abondant et vert. Tout le temps que la puissance du sénat resta florissante, il garda sa force ; le myrte plébéien au contraire était triste et chétif. Mais dès que le Plébéien prit de la vigueur (c'était pendant la guerre des Muses) le Patricien se mit à jaunir. Alors l'autorité de la noblesse sénatoriale devint aussi languissante et elle perdit peu à peu son éclat et sa sève[20]. Les pressentiments qui agitaient le peuple romain après la grande guerre de l'Italie contre Rome en révèlent clairement le caractère. En l'an 88 av. J.-C. au moment où Sulpicius voulait enlever à Sylla le commandement de la guerre contre Mithridate, le Sénat était rassemblé dans le temple de Bellone pour délibérer sur des prodiges menaçants. Un passereau traversa la salle tenant dans son bec une cigale qu'il partagea en deux. Il en laissa tomber une partie dans le temple et s'envola avec l'autre. Les devins dirent que ce prodige leur faisait craindre une sédition entre le peuple des champs et celui de la ville et du forum. Car le peuple de la ville crie toujours comme la cigale, tandis que les gens de la campagne vivent tranquilles dans leurs terres[21]. Les campagnes italiennes l'emportèrent décidément sur le patriciat et sur la bruyante populace de Rome. En l'absence de Sylla, Cinna répandit dans les trente-cinq tribus anciennes tous les Italiens, tous les citoyens nouveaux. En vain à son retour, Sylla avec l'orgueil désespéré et la colère réfléchie des aristocraties vaincues, essaya de restreindre autant que possible le droit de cité à la population de Rome, et des environs de Rome et de rejeter en dehors tous les parvenus de l'Italie[22]. Il eut beau massacrer avec un égal dédain les Samnites, compagnons de Pontius Telesinus et cette aristocratie municipale des chevaliers romains si odieuse au patriciat de Rome. Lorsqu'il voulut enlever le droit de cité à des municipes tout entiers, la puissance de la tradition plébéienne prévalut contre la volonté du tyran patricien. De son vivant même, Arretium, patrie de la grande famille équestre des Mécènes[23], Volaterra, d'où étaient sortis les Cæcina, également chevaliers romains[24], conservèrent malgré lui le droit de cité. Il ne parvint qu'à retarder l'avancement des hommes nouveaux dans la carrière des charges curules. Mais il n'était pas au pouvoir de Sylla de réduire sa
patrie à n'être plus qu'une ville dominatrice, exerçant sur l'Italie le droit
de conquête comme sur un pays étranger et séparée d'elle, comme Sparte du
reste de |