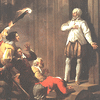L'ART MILITAIRE PENDANT LES GUERRES DE RELIGION (1562-1598)

PAR ÉDOUARD DE LA BARRE DUPARCQ
MÉMOIRE LU A L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.
PARIS - CH. TANERA - 1864.
|
Les guerres de religion commencent en France en l'an 1562 et offrent trois périodes distinctes qui se terminent, la première par la paix de Saint-Germain (1570), la deuxième par la paix de Beaulieu (1576), la troisième par l'édit de Nantes. Elles embrassent cinq règnes, une partie de celui de Henri II, ceux de ses trois fils, et une partie de celui de Henri IV. Pendant leur longue durée, elles ont donné lieu une foule d'actions militaires qui en font une mine instructive, moins en ce qui concerne la gronde guerre, qu'au point de vue de la petite guerre, de la guerre d'aventures. Elles se passent dans la seconde moitié du XVIe siècle, au seuil de ce fameux siècle de Gustave Adolphe et de Louis XIV qui ouvre la période moderne, et à la fin de ces temps qui tenaient encore de la féodalité et des autres coutumes du moyen âge. Sous ces divers rapports, leur histoire présente un intérêt spécial que nous allons chercher à dégager, surtout au point de vue militaire. Examinons donc les armées de ces temps, ce qu'elles accomplirent, les progrès qu'elles réalisèrent. § Ier. — RECRUTEMENT. Dès que les troubles religieux éclatent, chaque parti obtient des renforts le roi par les Suisses et pu divers souverains étrangers, les protestants par l'Angleterre. a. — Suisses. — Depuis Charles VII, nos monarques avaient employé des soldats suisses. Louis XI, par une convention, s'était réservé de pouvoir lever des troupes dans l'Helvétie : Charles VIII en avait eu plus de 8.000 à son service, et François Ier le double. Henri II continua cette tradition et y trouva des secours pour combattre et restreindre les troubles religieux. Une convention conclue en 1567, entre lui et les cantons, assura des soldats suisses à la couronne de France jusqu'en 1671. Ce traité promet 16.000 combattants au maximum ; le roi doit en enrôler au moins 6.000 ; l'engagement dure quatre années pour chaque régiment. Les fils et successeurs de Henri II entretinrent les mêmes troupes suisses, dont l'effectif pendant les guerres de religion ne parait pas, en présents sous les armes, avoir dépassé 6.000 hommes. Si des suisses ne se faisaient pas scrupule de venir dans les rangs protestants lutter contre ceux de leurs compatriotes officiellement classés sous la bannière royale, c'étaient, il faut le dire, des suisses pris individuellement, car les dernières capitulations, passées avec le conseil fédéral, stipulaient dispense de combattre les armées où figuraient déjà des régiments suisses. Les suisses qui consentaient à combattre contre la bannière royale de France, le faisaient donc pendant les guerres civiles sans l'aveu[1] des cantons e)[2]. Quant à supposer que les suisses au service du roi professaient tous la religion catholique, je n'en ai rencontré aucune preuve certaine, et ce serait faire un grand honneur à la conscience du soldat[3] ; n'oublions pas qu'un contemporain, Claude Haton[4], a écrit ; c'est grand'pitié que la guerre : je crois que si les saints du paradis y allaient, en peu de temps ils deviendraient diables. Parmi les privilèges dont jouissaient alors les troupes suisses en France, figure celui d'obtenir un certain nombre de soldats français pour les garder, Ire conduire à l'intérieur du pays, et aussi sans doute pou ; leur faciliter les relations avec les habitants. En octobre 1581, je trouve 8 soldats français assistant de la sorte un corps de 800 suisses. b. — Renforts offerts au Roi par les Souverains étrangers. — Au début des guerres de religion, plusieurs souverains craignent qu'elles ne menacent l'existence de la royauté autant que la religion catholique, et se proposent de soutenir le gouvernement français ils offrent des troupes ; ce sont en 1563, outre le Pape[5], le roi d'Espagne[6], les ducs de Savoie, de Ferrare et de Florence[7]. Plus tard, le duc Jean Guillaume de Saxe, le margrave de Bade, envoient également des renforts au parti royal[8]. L'Empereur lui-même en promet en 1564 pour le maintien de la religion catholique dans taule la France[9]. c. — Secours fournis par l'Angleterre min Protestants. — L'Angleterre se fit l'alliée des protestants par aile religieux. Le manifeste même d'Elisabeth à ce sujet en fournit la preuve : loin de déclarer la guerre au roi de France, elle y annonce prendre les armes uniquement pour sauver de l'oppression et du massacre les sujets dei. bon frère. Outre les suisses et les alliés, il existait encore, pour les armées françaises de cette période, cinq modes de recrutement qu'il impose de mettre en relief. Ce sont l'arrière-ban, les volontaires gentilshommes, les enrôlés volontaires à prix d'argent, les troupes de bourgeois, les mercenaires autres que les suisses, c'est-à-dire levés sans capitulation Consentie de gouvernement à gouvernement. 1° L'arrière-ban. — L'arrière-ban formait déjà un rouage militaire fort usé[10], sans doute en raison de ce qu'il était d'origine et de constitution féodales depuis l'ordonnance du 9 février 1547, il se composait exclusivement de cavalerie. Son existence pendant les guerres de religion ne fait pourtant aucun doute, moins parce que Louis XIV s'en servit plus tard[11], que par le motif de sa mention officielle répétée alors au moins trots fois : la 1re en 1579, dans l'édit de Blois qui parle du commandement du ban et de l'arrière-ban[12] ; la 2e en 1590, quand le duc de Mayenne, dénué de soldats, convoque le ban et l'arrière-ban[13] ; la 3e quand Henri IV contraint l'arrière-ban de se rendre mi siège d'Amiens (1597). En quoi consistait le service de l'arrière-ban ? Sous Henri IV, il se réduisait à six jours. Avant ce monarque il montait à deux mois, au moins d'après les ordonnances, mais ceux qui s'y trouvaient astreints, montraient de médiocres dispositions, et semblaient tenir à l'honneur d'en faire partie uniquement pour l'exemption de taille qu'il procurait[14]. Ceux qui sont, écrit à ce sujet Jean de Tavannes dans la Vie[15] de son père, qui sont semonds (convoqués) par leur devoir et contrainte de l'arrière-ban de servir deux mois, iceux passez ; croient en avoir trop feint ; et il dit ailleurs : les gentilshommes ne doivent être forcés de demeurer aux armées par qui ne veut pas en être mal servi... Les compagnies composées de soldats se maintiennent mieux que celles de gentilshommes. 2° Les volontaire, gentilshommes. — Depuis Français Ier, on appelait exclusivement volontaires les hommes de qualité qui, dénués de grade ou d'emploi, et n'ayant ni solde, ni prestation quelconque accordée (à la troupe, se réfugiaient sous lé drapeau -par désir de gloire ou d'instruction dans le métier des armes. lis accouraient en général la veille d'une bataille ou d'un assaut, et on leur réservait un poste périlleux, plutôt. d'officier que de soldat r leur exemple stimulait l'année, mais leur élan irréfléchi et indomptable suscitait souvent plus d'un embarras. Il en avait paru beaucoup à la bataille de Cérisoles ; en 1552 sous les murs de Metz, l'armée de Henri II en contenait 500 à cheval avec leur suite[16] ; les guerres de religion en offrent encore un grand nombre. Ainsi, en 1569, Montluc vient rejoindre à Toulouse le maréchal d'Amville, escorté de 60 gentilshommes[17] ; ce maréchal en compta bientôt plus de 300 sous sa cornette. L'année 1574 Matignon, marchant contre Montgommery, est joint, dit Davila par plusieurs gentilshommes et volontaires, lesquels excités par les commandements du roi et de la reine, qui avaient grandement à cœur cette entreprise, s'étaient offert à servir sans paye[18]. Au début de 1589, lorsqu'il commence la guerre en Bourgogne pour le roi, Guillaume de Tavannes assemble jusqu'à 50 gentilshommes de ses amis, qui lui forment un petit corps de cavalerie cuirassée. L'assassin du duc de Guise, Poltrot de Méré, était un volontaire ; Castelnau dit de lui : un jeune soldat ; le qualitatif jeune est de trop, car Poltrot avait alors 38 ans et l'on prenait les armes dès 17 ans[19], mais le mot soldat demeure. Ces volontaires avaient des places d'honneur, au moins dans l'infanterie, quand ils venaient aux armées, savoir une place d'anspessade[20] à 30 livres par mois, ou une paye royale à 4 livres par mois, lesdites places données non par les capitaines de compagnie, mais par les lieutenants de roi des villes frontières[21] se jetaient dans l'infanterie ceux qui n'avaient pas moyen de se mettre à cheval. On comptait beaucoup de volontaires dans les troupes protestantes, ce qui obligeait souvent leurs chefs à des ménagements envers elles[22]. 3° Les enrôlés volontaires à prix d'argent. — Cette sorte d'enrôlés subsista et alimenta principalement les armées françaises jusqu'au tirage à la milice institué par Louis XIV, ou plutôt, car ce tirage produisit peu de recrues, jusqu'à l'établissement de la conscription. Le roi seul avait le droit de lever des troupes[23], mais s'enrôlait qui voulait : l'appât, pour le faire, consistait dans une prime d'argent accordée au moment de l'enrôlement. Un capitaine, ayant reçu commission à cet effet, faisait sonner le tambourin par les villes[24] et villages, puis recevait par lui-même ou par des sergents les engagements de ceux qui se présentaient : ce capitaine était en général un officier connu, déjà initié aux secrets de la guerre, et comme tel capable d'inspirer la confiance aux soldats qu'il levait, car c'était ensuite lui qui les commandait et les menait en campagne, organisés en bande ou en régiment. Dans les moments de prame on recourait quelquefois à des capitaines nouveaux, et le recrutement s'effectuait à la bête, d'où l'expression de gens ramassés[25] que l'on rencontre chez les historiens. Les levées s'opéraient à la fois pour gens de pied et gens de cheval, mais, sauf peut-être pour les corps mixtes, par des officiers différents. Elles s'effectuaient pour compléter les compagnies existantes pendent que ces compagnies tenaient garnison[26]. On s'enrôlait alors pour On temps fort court, trois mois par exemple, ce qui indique combien l'armée était loin d'être permanente dans le sens que nous attachons aujourd'hui à ce mot : il dut y avoir pendant les guerres civiles des enrôlements encore plus courts, mais plutôt dans les troupes protestantes ou de la ligue que dans les troupes royales[27] sous le drapeau du roi en effet les gens d'ordonnance et même les gens de pied ont plus le caractère d'être entretenus ; du côté des protestants et des ligueurs ce sont plus des volontaires, non pas gentilshommes (nous venons de parler de ceux-ci), mais bourgeois ou artisans[28]. Existait-il un acte d'engagement signé par l'enrôlé et le chef qui l'enrôlait ? aucune trace précise ne nous a mis même de répondre a cette question d'une manière satisfaisante. Dans les temps réguliers, nul doute qu'il n'y eût une espèce de procès-verbal dressé de concert entre l'enrôlé et le recruteur, et probablement ratifié par le commissaire des guerres, mais pendant les troubles religieux, le fait semble moins certain. Il parait que l'on avait le droit de quitter la maison paternelle pour se faire soldat : En 1552, écrit Vincent Carloix, toute la jeunesse des villes se desroboit de père et mère pour se taire enrôler, et la plupart des boutiques devenaient vuldes de tous artisans, tant était grande l'ardeur[29]. Ce droit, ne l'oublions pas, a toujours subsisté en France[30], et aujourd'hui encore il ne se trouve limité qu'au-dessous de 20 ans[31]. Les enrôlés volontaires font partie de ces bandes françaises, dont deux on trois furent réunies à partir de Henri II, puis définitivement sous Charles IX[32] pour former un régiment, mais qui se prolongèrent longtemps encore dans cet état, parce que la bande, moins nombreuse, multipliait les commandements isolés et restait plus Maniable, deux circonstance qui convenaient à ces temps de lutte civile. Les capitaines de ces bandes ont des noms d'emprunt qui souvent les assimilent aux condottieri italiens. L'un s'appelle Main-ferme et n'aime pas en effet à capituler avec l'ennemi[33] : l'antre se nomme le capitaine Fainéant[34] ; un troisième, fils d'un hôtelier de Nogent, au lieu de porter son nom patronymique de Virelois, adopte celui de capitaine Beaulieu, seigneur de Fay[35]. 4° Les troupes de bourgeois. — Les villes entretenaient des troupes pour leur défense : elles furent obligées, en ces temps de trouble, de les augmenter et de les mieux armer ; Rouen et les grandes cités pouvaient mettre sur pied un nombre d'hommes considérable, qui allait en 1563, pour la première de ces villes, à 30.000[36]. Quelques-unes de ces milices bourgeoises figurèrent dans les armées, témoins les 800 escaliers la plupart gens de ville et marchands, et les 1.200 hommes de pieds pour la plupart artisans, avec lesquels le prince de Condé appareil sous Paris pour l'assiéger en 1562[37], témoins également les compagnies bourgeoises de Dieppe qui combattirent dans la journée d'orques pour Henri IV ; mais ce fut un fait rare, ces milices combattaient plutôt pour la défense de leur cité, pro aris et focis. Ainsi le parlement de Paris, par ordonnance du mai 1562, prescrivit aux catholiques de la capitale de se mettre en armes par quartiers. Ainsi, en 1568, Cursol, organisant la garde du passage d'une rivière par ordre du roi, rompit les ponts et les gués, puis ordonna aux communes mêmes de chaque bourgade de s'assembler au son du tocsin, en cas que les protestants s'ingérassent de passer outre[38]. Un motif, tout autre que la nécessité de leur présence au milieu de la ville qui les formait et les soldats, peut expliquer la rareté de l'appel des bourgeois aux armées c'étaient de mauvaises troupes, se composant de la monte façon que les compagnies d'aventuriers, mais ne possédant pas le même esprit militaire. Qu'on se figure par exemple la ville de Pons ayant en 1567, pour lieutenant de sa milice à pied, un teinturier nommé Prieur, dit le capitaine Boitout, d'abord protestant, puis catholique, lequel en 1578 voulut se faire capitaine indépendant, ramassa 50 pendards, en fut promptement abandonné, s'enrôla alors dans une compagnie de gens de cheval, et finalement succomba sous les coups de mauvais garnements qui l'assommèrent. Pour rendre les compagnies de bourgeois meilleures, on les mêlait avec d'autres soldats : d'Andelot par exemple, assiégé dans Orléans (février 1563) par le duc de Guise, fusionne les compagnies des habitants de la ville avec les soldats forains qui étaient mieux aguerris[39]. 5° Les mercenaires. — Nous entendrons parler ici des soldats étrangers, autres que les suisses, de ces soldats dont un auteur allemand a écrit : Les étrangers furent nombreux en France pendant les guerres de religion, mais ils nuisirent autant qu'ils servirent[40]. On les recrutait un peu partout, dans le Brabant, en Allemagne surtout, ce pays dont les habitants réclamaient comme un droit la faculté d'aller se mettre à la solde de qui bon leur semblait[41], et que Coligny déclare une perpétuelle et inépuisable minière de gens de guerre. A leur arrivée en France, il fallait ordinairement aller les chercher sur la frontière et les accompagner jusqu'a l'armée qui les attendait, sinon ils ne voulaient point entrer. Il y eut des deux côtés des mercenaires allemands reîtres et lansquenets[42] et ces auxiliaires se maintinrent dans celte double position durant tous les troubles. Ce fut en effet presque[43] toujours en vain[44] que le roi écrivit aux princes de l'empire qui affectionnaient les protestants, de ne les secourir parce qu'ils étaient rebelles[45]. En vain également proposa-t-il (1568) aux protestants de renvoyer leurs reîtres et de n'en plus employer, promettant d'en faire autant de son côté[46]. En vain aussi Charles IX épousa (nov. 1570) Elisabeth d'Autriche, espérant que son beau pire s'opposerait aux levées de reîtres[47]. Les reîtres exigeaient la solde entière du mois commence au service de qui les louait : on le vit en 1568, après la trêve et l'édit de Longjumeau, alors que Castelnau eut tant de peine à faire sortir de France ceux du prince Casimir. Quand on les retenait pour servir plus tard, mais sans les lever encore, ou leur donnait habituellement une avance de solde, dit aufgeld[48] en leur langue, et que nous appelons des arrhes. Ces retires, et en général tous les mercenaires allemands ou plutôt leurs capitaines, exigeaient aussi qu'on leur payât jusqu'à la fin de la guerre le nombre exact d'hommes enrôlés et a menés par eux, et cela quelles que fussent les pertes éprouvées par leur corps de troupes deus les hasards de la lutte. Les suisses et les allemands ne furent pas les seuls étrangers combattant à cette époque dans les rangs français, puisque l'on parlait en 1569 cinq ou six langues dans l'armée royale[49]. On blâmait déjà à cette époque l'emploi des mercenaires ; la fortune remise entre leurs mains, disent plusieurs contemporains, est périlleuse ; pourquoi donc y recourait-on si abondamment ? Le motif pour lequel on entretenait, des deux côtés, des mercenaires étrangers, c'est que le mode de recrutement qui devait fournir le plus, celui des volontaires enrôlés avec prime était loin de suffire ; non-seulement il ne procurait pas assez de soldats durant les guerres civiles, où il y avait deux camps à alimenter, mais il n'en donnait pas assez de temps de calme politique au gouvernement royal. Ce fait, la société du temps ne l'apercevait pas, et il rasta voilé pour la France jusqu'a la révolution chacun se contentait de voir, dans les rousses, les Nitres ou les lansquenets des suppôts du pouvoir, et disait volontiers avec Cyrano de Bergerac : Nous sommes la proie de ces nations barbares ; et sans doute on les emploie, afin que, nous ôtant le moyen de nous faire entendre, nous ne puissions émouvoir leur compassion[50]. C'était pourtant un grand fait social que cette insuffisance des enrôlés à prix d'argent, car en forçant à l'emploi des mercenaires, elle faisait sortir de l'argent[51] de France, puisque ces mercenaires emportaient leur solde chez eux, tandis que les soldats français l'eussent dépensé dès sa réception et fait circuler rapidement[52]. Elle en faisait également sortir plusieurs jeunes gentilshommes que leurs parents envoyaient en Allemagne, espérant que leur connaissance de l'allemand les ferait employer aux levées des mitres qui semblaient se perpétuer au service des partis pendant les guerres civiles de France[53]. Jamais, du reste, pendant les guerres de religion, les armées ne se recrutent en France par des milices ou levées forcées : chaque chef est donnée commission de lever tous gens de guerre qu'il trouverait[54]. On peut invoquer comme preuve d'autres témoignages. Jean de Tavannes dit par exemple, dans la vie de son père : Il faudrait lever, tant de la noblesse que des villes, une grande quantité d'hommes non volontaires, mais forcés, contraints d'aller, à la guerre, avec punition exemplaire s'ils retournaient dans leur pays[55]. Il faut donc appliquer uniquement au ban et à l'arrière-ban, en un mot à la noblesse et à ses serviteurs, presque tous cavaliers, l'assertion commune que chacun en France pouvait, pour quelques deniers, acheter son exemption du service[56]. Pour eux le propos semble vrai, car Michel de L'Hospital se plaint de ce que la nation française abandonne les armes pour se tourner vers les sciences, les arts, les travaux agricoles : il faut bien, dit-il, chercher des auxiliaires au-delà du Rhin et de l'Elbe, sans quoi notre patrie abandonnée deviendrait la proie des Espagnols. Cet aveu implique et peu d'esprit militaire et peu d'empressement pour le service. § II. — EFFECTIF DES ARMÉES. L'effectif total de l'armée française est assez difficile à déduire, alors que cette armée se divisait en deux camps, et que sa composition, de part et d'autre, n'offrait rien de fixe. L'armée royale, qui pourrait le mieux servir de type, comme étant la plus forte et constamment sur pied, reste elle-même sujette à de grandes fluctuations, preuves des misères du temps, preuves aussi de l'état peu avancé de la science gouvernementale et de la concentration politique qui lui. permet de s'exercer fructueusement. Est-il au moins un chiffre que l'on puisse mettre en avant à son sujet ? Au-dessus de cent mille hommes l'on tombe dans une exagération évidente[57]. A ce chiffre même, l'on resterait au-dessus de la vérité ; Jean de Tavannes dit bien : cent mille hommes se peuvent lever en France, et en demeurera dix fois autant[58] ; mais il évalue et croit possible d'arriver à ce résultat, sans affirmer qu'il ait été atteint de son temps. Suivant un auteur compétent, ce chiffre appartiendrait seulement au règne de Louis XIII[59]. D'après une lettre du sieur de Tavelles au prince d'Orange, dans laquelle l'envoyé du maréchal de Cossé cherche à intimider Guillaume de Nassau et à l'empêcher d'entrer en Picardie, la France royale aurait eu à sa disposition en décembre 1568 au minimum 55.000 soldats nationaux et 14.000 étrangers : dans me chiffres ne se trouve pas comprise la grande quantité d'infanterie (évaluation un peu vague) qui stationne près du roi[60]. A défaut de l'effectif de l'armée royale considérée dans son ensemble, portons notre attention sur les principales armées actives qui furent alors mises sur pied ce sera toujours une portion du tableau dont nous aurions voulu pouvoir remplir le cadre. En 1562, au moment de la bataille de Dreux, les protestants disposent de 4.500 chevaux et 7.000 fantassins ; les catholiques d'environ 2.000 chevaux, 15.000 fantassins, 22 pièces d'artillerie[61]. Des l'année suivante les protestants reçoivent de l'Angleterre 2 régiments d'infanterie, soit 3.000 hommes[62] environ et 14 canons de gros calibre leurs forces croissent donc, mais elles n'atteindront jamais au même chiffre que les armées royales. En 1567, à la bataille de Saint-Ports, le connétable de Montmorency dispose de 10.000 fantassins, 2.000 cavaliers et d'un grand nombre de canons ; le parti opposé met seulement en ligne 4 canons, 1.000 chevaux, 2.000 arquebusiers. L'année qui suit, dès la nouvelle guerre amenée par le retrait de l'édit de Longjumeau, le duc de Montpensier rassemble, outre les Provençaux, 4.000 chevaux avec 8.000 hommes de pied, et reste aux environs de Poitiers sur la défensive comme étant trop faible[63]. Ainsi, 15.000 hommes environ ne paraissent pas suffire en ce moment aux royalistes pour s'aventurer : cela indique combien les protestants ont grandi, cela montre qu'ils obtiendront bientôt un traité de paix, leur garantissant certains avantages[64]. Les royalistes le sentent et font de grands efforts, puisque nous voyons le duc de Nevers amener du Piémont cette meure année 1568, au duc d'Anjou (depuis Henri III) 7.000 chevaux et 18.000 fantassins[65]. En 1569, ce dernier prince commande à Moncontour 24.000 hommes aidés de 15 canons, contre 23.000 hommes qui disposent de 11 canons. En 1574, Matignon marche contre Montgommery avec 1.200 chevaux, 5.000 fantassins français et 14 pièces d'artillerie du château de Caen. En 1587, le roi de France possède 8.000 Suisses et 14.000 fantassins français. En 1589, l'armée du roi compte jusqu'a 42.000 hommes d'aies Davila ; jusqu'à 25.000 hommes seulement (dont 7.000 cavaliers), suivant Castelnau. En 1590, sur le champ de bataille d'Ivry, Henri IV déploie 8.000 fantassins, 3.000 chevaux et six bouches à feu en face des 12.000 fantassins, 4.000 chevaux et quatre bouches à feu de Mayenne[66]. Ainsi, durant les guerres de religion, l'on guerroie avec de petites armées, et comme, de part et d'autre l'on se trouve faiblement pourvu d'argent, les accessoires manquent le plus souvent : de là un ordre, une mobilité due à la simplification de plusieurs des rouages, et par suite l'essor que prend l'art de la guerre vers sa voie moderne[67]. § III. — ORGANISATION DES ARMÉES. Il est difficile de préciser le mode d'organisation des armées de ce temps. Les historiens citent bien un avant-garde, une bataille et parfois une réserve[68], mais c'est plutôt un ordre pour la marche qu'une organisation réelle. L'avant-garde est presque aussi forte que la bataille : on le voit dans la journée de Dreux. L'armée protestante comprend alors, d'après l'avis de Gaspard de Tavannes, une des meilleures sources historiques de l'époque, 900 combattants de moins à l'avant-garde qu'à la bataille, c'est-à-dire ¹/₇ environ ; ce septième manque en cavalerie, surtout en mitres, comme en fait foi le tableau suivant.
Quant à l'armée royale, on y retrouve le même caractère mais à un degré outré, au moins d'après nos idées actuelles : non-seulement l'avant-garde, comme effectif, s'approche de la bataille, mais elle la dépasse ; on peut s'en convaincre par ce détail :
L'avant-garde, remarquons-le, se compose ici de cavalerie et d'infanterie[69], et comme sa force atteint celle de le bataille, c'est au total un corps de 'lierne espèce que cette der-nitre l'armée se trouve partagée en deux. Quelquefois elle contient en outre un corps à part, une espèce de petite réserve : à Dreux, ce corps était très-faible et comportait 500 chevaux. Cette troisième, partie d'une armée manquait au moyen âge, sauf chez les Suisses qui plaçaient leurs trois bataillons carrés en échelons, mais elle apparaît et prend aile place fixe dans les habitudes militaires pendant les guerres de religion : Moncontour nous la montre existant des deux parts. L'organisation d'une armée en commandements distincts, se déduit ainsi des chroniqueurs 1 commandant d'armée, ordinairement chef de l'avant-garde ou de la bataille ; 1 commandant spécial de la bataille ou de l'avant-garde ; 1 commandant de la réserve, habituellement maréchal de camp[70], c'est-à-dire chef d'état-major de l'armée. Ainsi trois chefs suffisaient : quand le chef de l'armée était un prince, comme le duc d'Anjou, il prenait souvent le titre de généralissime, et avait sous ses ordres un commandant spécial pour chacune des fractions de l'armée. Au-dessous de ces commandants supérieurs viennent les commandants de chaque arme ; il en existe au moins un pour les gens de pied, sous le titre de colonel-général de l'infanterie. Coligny, son frère d'Andelot, Montluc occupent successivement cet emploi. Cc colonel-général est le chef des capitaines de bandes, et centralise tout le pouvoir exercé sur les gens de pied. La hiérarchie semble donc fort simple : un capitaine de bande, un colonel-général, un commandant d'avant-garde ou de bataille. Dans la cavalerie, le capitaine commande une compagnie ou un escadron. Ceci nous amène à parler de l'organisation constitutive de chaque arme. La cavalerie, encore plus nombreuse que ne le veulent les règles saines de l'art moderne, se constitue par compagnie dans la gendarmerie, et par escadron dans les reîtres et autres cavaliers. La compagnie de gendarmes ne dépasse guères 100 hommes, l'escadron de reîtres atteint 5 à 600 hommes. L'infanterie se forme en bandes de 5 à 600 hommes également, puis en compagnies de 500 hommes[71]. En moyenne, dans une armée, on peut, vers le milieu des guerres de religion, évaluer la cornette (cavalerie), comme l'enseigne (infanterie) à cent hommes[72]. Un chroniqueur du temps, dit en effet que les protestants comptèrent à Pamprou (1568) 94 cornettes, et plus de 240 enseignes, le tout en Français, sans aucun étranger ; cent pour drapeau, le fort portant le faible[73]. Les trois armes ne se combinent pas encore entre elles d'une manière entendue et fixe. Remarquons qu'il y eut des deux côtés, pendant les guerres de religion, diverses alternatives dans l'état des armées, à cause du plus ou moins de puissance que l'on possédait, à cause de la mauvaise situation des finances et des dispositions variables des alliés. Mais en général on peut établir que les armées actives, au début, ne valaient pas nos anciennes armées à l'extérieur, ce qui ne doit pas étonner, puisqu'elles représentaient ensemble la force militaire de la France, et que de leur séparation même et des désordres qui en étaient la suite, naissait un affaiblissement pour le pays. 1° Comme effectif, aucune d'elles, pas même l'armée royale, n'atteignit durant les troubles religieux, comme le montre le précédent paragraphe, le chiffre de 40.000 hommes qui est celui de l'armée passée en revue sous les murs de Mets en 1552, par Henri II, et que l'auteur[74] des Mémoires du maréchal de Vieilleville appelle une grande armée[75]. 2° Comme constitution, elles contenaient un grand nombre de corps improvisés, soit d'étrangers levés à la lutte, soit de bourgeois mis momentanément sur pied par nécessité... De là l'inexpérience des combattants : Voila encore un autre malheur que nous amena cette paix, écrit Montluc[76], au sujet de la pacification de 1562, d'avoir demeuré longtemps sans pouvoir dresser de bons soldats. De là aussi une certaine confusion sentie par l'ambassadeur vénitien Durham quand il écrit en 1563 : Il faut à la France un peu plus d'ordre dans ses armées[77]. Les troubles eux-mêmes étaient peu favorables pour la formation des combattants ; ils ôtaient aux officiers le temps d'apprendre la guerre et multipliaient les petites actions ; toutefois, dans la continuité des luttes civiles, de bons soldats surgirent, et si Henri IV, échappant au poignard de Ravaillac, avait exécuté son expédition contre la maison d'Autriche, ces vieux soldats dirigés pat ses talents et son expérience militaires, lui eussent sans doute donné la victoire. Malgré l'ignorance des officiers, les armées françaises réalisèrent des progrès pendant les guerres de religion, principalement à partir de Moncontour (1560), grâce au génie de certains chefs dont nous parlerons plus loin[78], et, — chez les royalistes, parce que l'on agissait dans un but constant, que l'on faisait une succession d'efforts, ayant une tendance déterminée, unique, — chez les protestants, parer que leur parti était plus compact, plus formé. § IV. — INFANTERIE. L'infanterie des guerres de religion ne jouit pas d'une réputation brillante pour ses relations avec les habitants de la France. Ecoutez plutôt Claude Haton, disant : La bande du capitaine Michery, au nombre de 600 hommes et quasi autant de femmes[79] et goujeats... Ces 600 pendards étaient tous bannis, vagabonds, voleurs, meurtriers, renieurs de Dieu et de vieilles dettes, remenants[80] de guerre, reste de gibet, massacreurs... gens mourans de faim. Ce triste portrait s'applique aussi à la cavalerie du temps, mais à un degré moindre ; nous y reviendrons en traitant de la discipline[81] ; il nous faut dire toutefois, des à présent, que cette situation déplorable éloigna beaucoup de gentilshommes du service des gens de pied, et nuisit ainsi à la bonne composition et jusqu'à un certain point aux progrès de cette arme. Cette infanterie se formait en bandes : la bande ou compagnie était la même chose ; vers cette époque elle se réduisit à 300 hommes[82], se trouvant auparavant beaucoup plus forte. L'enseigne parait avoir été ordinairement la moitié de la bande. Quant au régissent il groupait plusieurs bandes. cinq par exemple, sous un même chef. Ces indications s'accordent avec un propos de Montlac, qui se rapporte à l'année 1568 : J'avais départy en trois régiments nos trente enseignes[83]. On rencontre pourtant en 1569 un régiment de dix-sept enseignes levé par le baron des Adrets : il s'agit alors d'enseignes ou de compagnies beaucoup moins fortes, telles par exemple la compagnie de gens de pied français existant au début de janvier 1575 à Sainte-Enimie dans le Gévaudan, et qui comptait un capitaine, deux caporaux et 27 soldats, soit un effectif total de 30 hommes, effectif qui se retrouve plusieurs fois à cette date[84]. La bande se formait en carré ; mais si précédemment les rangs comme les files étaient à la distance d'un pas, il parait que pendant les guerres de religion la distance devint variable pour les rangs et les files, et en même temps s'accrut. Le carré de terrain et le carré d'hommes sont différents, articule Jean de Tavannes[85], en ce qu'en file il y doit avoir sept pas entre les rangs, et, en front, suffit de trois[86] entre chaque soldat : tellement que pour faire le bataillon carré de terrain à 60 de front, il ne faut que trente de file. La largeur du front, pour n'être enclos[87], est nécessaire, et l'extraordinaire épaisseur des bataillons, qui adviendrait si on les voulait faire carrés d'hommes, ferait inutile. Cet accroissement dans les distances offre ceci de singulier qu'il fait rétrograder au sujet de la formation tactique, et surtout vise-vis de la bataille de Cérisoles (1543) où Montluc mena ses fantassins au choc à distance serrée, en masse compacte ; mais d'un autre côté, il est difficile de le nier, puisque sous Louis XIV, en 1703, nous rencontrons encore la distance de 4 m. entre les rangs, laquelle se réduit à 1 m. pour le combat. Comme arme, l'infanterie continuait à gagner en importance. On s'en aperçoit quand, dans la journée de Dreux, le prince de Condé s'acharne principalement sur les Suisses, croyant ainsi obtenir la victoire. On s'en aperçoit mieux encore à cette opinion du moraliste Charron[88], dont la vie s'écoule pendant la période qui nous occupe les piétons tout simplement et absolument sont meilleurs : car ils servent et tout du long de la guerre et en tous lieux et en tous affaires ; là où aux lieux montueux, scabreux et estrois et à assiéger places, la cavalerie est presque inutile. Ils sont aussi plus-tost prets et constant beaucoup moins ; et s'ils sont bien conduits et bien armés, comme il faut, ils soutiennent le choc de la cavalerie. Aussi sont-ils préférés par ceux qui sont docteurs en cette besogne. On peut dire que la cavalerie est meilleure au combat et pour avoir plus tost fait, car les piétons n'ont pas si tost fait mais ils agissent bien plus sûrement. Ce plaidoyer en faveur de l'infanterie est d'autant plus remarquable que la cavalerie convenait aux opérations hardies et rapides qui ont signalé les guerres de religion, surtout depuis qu'elle réunissait l'emploi de quelques feux à une formation solide, circonstance qui lui rendit momentanément à cette époque un peu de sa prééminence passée[89]. Les fantassins ne marchaient pas encore très-promptement[90], si nous en croyons le témoignage de Jean de Tavannes les grandes troupes de gens de pied en chemins étroits mettront, dit-il, une nuit à faire trois lieues ; il est juste d'ajouter que les chemins ne valaient pas ceux d'aujourd'hui. Leur armement ne cause plus cette lenteur. En effet pendant les guerres civiles le corcelet est abandonné, le soldat plus libre, indiscipliné même, n'en voulant plus, et, malgré le vœu de La Noue, il n'est pas repris. Quant à la pique, elle disparate peu à peu, et l'arquebuse la remplace, non-seulement parce que les armes à feu tendent à se multiplier en se perfectionnant, mais aussi parce qu'elle est plus légère et plus propre à l'escarmouche, au combat de tirailleurs l'arquebuse et l'épée, voilà les deux armes principales du fantassin de ce temps. Quand nous disons l'arquebuse, nous ferions mieux de dire l'arme à feu, car le mousquet donné aux soldats les plus signalés, commence à détrôner l'arquebuse. Mousquet ou arquebuse présentent du reste le même 'inconvénient ; leurs mèches s'éteignent en cas de pluie et l'arme devint impuissante, comme cela arriva en 1569 Coligny au combat de La Roche-Abeille. Le mousquet succéda à l'arquebuse[91] et s'introduisit en France à l'imitation des Espagnols[92]. Il était encore lourd, et on ne pouvait le tirer qu'en l'appuyant sur une fourchette : cette fourchette portait son poids total à près de 8 kilogrammes[93]. On comprend combien avec un tel accessoire et chargé d'un tel poids, l'homme de pied deuil être empêché dans ses mouvements, et il suffit de voir sur une gravure du temps[94] les nombreuses charges pendues à la bandoulière, la provision de mèche attachée à sa ceinture, l'épée en verrou[95] qui termine son baudrier, la salade qui le coiffe, pour deviner et la complication et l'Incommodité d'un semblable armement par rapport à celui de nos jours. Effectuer le tir du mousquet offrait une difficulté réelle dans la série de ses opérations : il fallait d'abord écarter la mèche[96] allumée pendant que l'on chargeait, et cela à peine de danger pour soi et pour ses voisins, puis une fois la charge achevée, raviver le feu de l'extrémité de cette mèche, enfin compasser se longueur de façon qu'elle put atteindre en s'abaissant le bassinet, et cela seulement à l'instant où l'on voulait faire feu. Au début beaucoup de piétons s'acquittaient mal du maniement de leur arme, tournant en effroi et sursaut, dit Blaise de Vigenère, le visage d'un autre côté en arrière : action que reproduisent près d'un siècle plus tard les janissaires (bien dégénérés il est vrai) quand ils approchent la mèche de l'amorce du mousquet[97], et qui montre à quel degré ce genre de tir était véritablement malaisé. Ajoutons qu'il devait s'opérer avec une grande lenteur, puisque Mauvillon nous montre, pendant la guerre de Trente ans, les impériaux mettant encore quatre-vingt-quatorze temps dans la marge du mousquet, ce qui présuppose une dizaine de minutes au moins pour charger et un quart-d'heure par coup tiré[98]. Les compositions ci-dessous de deux bandes font nettement voir comment tarie la proportion des armes dans l'infanterie.
Dépourvue de piques, alors gue la baïonnette n'était pas inventée, l'infanterie devenait impropre le produire ou à supporter un choc, ce qui l'exposait beaucoup, en plaine, aux coups de le cavalerie. En somme, a dit dans ce sens La Noue, au 13e de ses Discours, l'arquebuserie sans piques, ce sont des bras et des jambes sans corps, ce qui est difforme. Les combats en éparpillement convenaient à cette époque de guerre civile, et il en résulte un amincissement dans la formation de l'infanterie t le nombre des rangs diminue de 33[102] à 21[103] et 20[104], au moins théoriquement, car nous empruntons ce dernières profondeurs à des écrivains auteurs de projets ; mais il est probable qu'elles passèrent dans la pratique. L'infanterie protestante était la moins bien armée. Manquant au début d'arquebuses, elle porta dans certain contrées[105] les armes que le paysan trouve sous la main, le béton, la fourche, la faux : plus tard même elle resta armée à la légère, maniant des arquebuses défectueuses, et quelquefois l'arme du combat extrême, le poignard. Au début des guerres de religion, le bouclier apparaît encore comme un dernier vestige des précédents usages suivant Brantôme, en 1562, pendant le siège de Rouen, occupé par les Huguenots, le capitaine Monneins, qui commandait la garnison du fort de Sainte-Catherine, était reconnaissable, dans les sorties qu'il effectuait, à sa rondache, on bouclier garni de velours vert[106] ; mais la rareté d'une semblable mention montre que l'emploi du bouclier à cette époque constitue presque une exception, au moins pour les officiers. On rencontre aussi des rondachiers au siège de La Rochelle, en 1573, et il en figura dans quelques autres actions de guerre. Il existait des compagnies formées de fantassins et de cavaliers, compagnies d'élite chargées de veiller à la sûreté d'un chef de guerre. Telle était la compagnie de M. de Sainctorens, d'arquebusiers à cheval et à pied, que Montluc tenait toujours prés de lui pour sa garde[107]. Le plus souvent ces compagnies étaient entièrement à cheval (Voyez le paragraphe suivant). § V. — CAVALERIE. La gendarmerie, créée par Charles VII, ne conservait pas son antique splendeur. A l'origine des guerres de religion, le nombre des suivants par cavalier se réduisait à deux ou un et demi, et chaque compagnie ne comprenait plus en général que 50 maitres[108], celles de 100 maîtres appartenaient aux Princes et grands dignitaires. Le nombre des compagnies montait à 60 environ[109]. Ces 50 maîtres n'étaient plus gentilshommes[110] : cessa-ci s'éloignaient du service dans le rang, au fur et à mesure qu'il cessait de constituer une position suffisamment brillante, et d'ailleurs ils ne convenaient plus nu poste de simple soldat ; Jean de Tavannes le recousait quand il dit[111] : je conseillerais aux capitaines de se contenter de quinze gentilshommes dans le nombre de cinquante cavaliers. Ajoutons qu'un grade militaire quelconque, celui pur exemple de sergent dans les gens de pied, dispensait des preuves de noblesse quand elles étaient nécessaires pour s'enrôler, ou, suivant l'opinion des francs-archers, conférait un commencement de noblesse[112]. La cavalerie marchait vers con caractère moderne a de féodale, c'est-à-dire composée de combattants ayant un lest individuel, elle allait devenir populaire[113] et ne comprendre que des soldats agissant suivant un but commun. Cette transformation décidait l'adoption de l'ordre en escadron. Tous les contemporains émettent cet avis, confirment de la sorte le progrès réalisé par la cavalerie allemande qui, depuis des années déjà[114], possède des escadrons de reîtres : ils ont vu, en 1562, à Dreux, le maréchal d'Amville se faire battre en chargeant les escadrons massifs de mitres anse 300 chevaux rangés en haie[115], ou sur un seul rang, et cet exemple les a convaincus : La raison naturelle, dit La Noue en son XVe discours, veut que le fort emporte le faible, et que six ou sept rangs de cavalerie joints ensemble en renversent un seul. Aussi propose-t-il d'admettre sept rangs de profondeur, ce qui donnera, remarque-t-il, un front de 15 lances pour une compagnie de 50 hommes d'armes. On voit par la que la lance ne comportait plus guère que deux hommes, l'homme d'armes et son valet comme nous l'indiquions aux premières lignes de ce paragraphe. En adoptant les escadrons profonds sur 12 rangs au moins[116], la cavalerie royale commence à charger au trot et le fait assez souvent. Quant à la cavalerie protestante, elle demeure plus longtemps en baie, faute de nombre[117]. Nous parlons de la grosse cavalerie ; la cavalerie légère fut fréquemment sur 16 rangs. Henri IV réduisit à dix rangs la profondeur de la gendarmerie française et la plaça ordinairement sur 20 de front[118] : plus tard il se contenta de six rangs et on le vit à Ivry combattre à la tête d'un escadron formé sur cinq rangs[119]. Puisque 50 maîtres constituaient le chiffre le plus habituel[120] d'une compagne ou cornette[121] de cavalerie, quelle était l'organisation d'une compagnie de cet effectif ? Voici le tableau que nous avons pu dresser.
Nous possédons un exemple Complet de compagnies plus nombreuses, sinon comme effectif, au moins en cavaliers réels ou maîtres. Il se rapporte à la compagnie commandée dans les Pays-Bas, pour le compte des États généraux par La Noue Bras-de-Fer, et je le cite[123], parce que l'on peut supposer que ce chef renommé maintint quelques-uns des usages français dans son organisation, tout en adoptant les coutumes de la cavalerie espagnole plus perfectionnée comme organisation.
Ces deux compositions tirées de la même source différent très-peu. Elles montrent que les cavaliers et aussi les appointés gentilshommes attachée à la personne du capitaine sont à un seul cheval, car nulle part on ne cite le nombre de leurs montures tandis qu'on le fait pour lus officiers[125] : ainsi la lance ne comportait plus dans les Pays-Bas aucune suite, point essentiel à établir et chacun soignait son cheval, ce qui trente ans plus tôt ne se présentait que dans les arquebusiers à cheval et les chevau-légers[126], en un mot dans la cavalerie légère, dans celle qui ne portait pas la lance. Ces compositions montrent également que les cavaliers pourvus d'armes à feu avaient encore besoin d'être soutenus, puisqu'on maintenait à leur côté des lanciers en nombre à peu près égal, malgré les progrès des effets et de l'influence de la poudre. Les compagnies de cavalerie commençaient déjà, comme celles d'infanterie, à se grouper pour constituer des régiments ; elles st groupaient sous ce rapport par nombre variable, et bien entendu, beaucoup de ces compagnies restaient isolées. L'organisation par régiment se trouve antérieure, quant à ses débuts, ana guerres de religion on la fine ordinairement à 1561 pour l'infanterie et pour la cavalerie, mais c'est par rapport à la France[127] : je croirais assez qu'on peut avancer cette date de quelques années, car on trouve des régiments dans l'armée de Charles-Quint dès 1554, et il me semble peu probable que la Franco n'ait pas aussitôt imité cette organisation très-commode comme simplification administrative[128]. La comparaison des deux compositions citées pour la compagnie flamande de La Noue, montre qu'on oscillait tantôt vers la lance, tantôt vers les armes à feu comme arme définitive du cavalier. La question se trouvait pourtant à peu près vidée, puisqu'il existait déjà des compagnies de cavalerie entièrement formées d'arquebusiers, compagnies de choix, il est vrai, et constituant souvent la garde d'un maréchal de France telle était celle du capitaine La Barre, cédée en 1563 par le maréchal de Vieilleville au maréchal de Brissac[129]. La transformation à ce sujet ne devint entière et les cavaliers n'eurent tous des armes à feu que vers la fin du règne de Henri IV[130]. Auparavant, les valets des gentilshommes avaient déjà des arquebuses et procuraient quelques feux aux compagnies de gendarmes. L'usage de la lance décroit par un autre motif que la multiplication des armes à feu, par l'adoption précitée de l'allure du trot pour la charge, allure qui diminue son efficacité, en même temps que la disparition des chevaux de grande taille, par de longues luttes, rend son maniement moins assuré. Ainsi, dans les guerres civiles on charge au trot jusqu'à 25 pas environ de l'ennemi, et, quoique le cavalier fasse feu, — ce qui est contraire à sa destination, mais alors effrayait l'adversaire, — c'est un progrès réel : on allait même parfois au-delà, on galopait, La Noue l'affirme. Pour soutenir ces allures, ou achetait des chevaux à l'étranger, la France n'offrant pas une bonne race de chevaux de guerre : on tenait beaucoup aux chevaux dont on était propriétaire, et il y avait pour les gens d'armes défense de les prêter. La cavalerie de cette époque faisait encore les fonctions de l'infanterie en attaquant, par exemple, les barricades : ainsi, en 1589, à l'attaque du château de Cressey, en Bourgogne, Guillaume de Tavannes fait charger l'une des barricades par dix cavaliers. La cavalerie française jouissait alors d'une excellente réputation[131]. En revanche elle possédait des privilèges ; ainsi les bas officiers, les officiers même, recevaient chacun, outre la solde de leur grade, celle d'homme d'armes, comme en fait foi cette quittance datée du 20 novembre 1560 : ... Confessons avoir reçu du... conseiller du roi, trésorier ordinaire de ses guerres... la somme de cent livres tournois à moi ordonnée pour mondit état d'enseigne, outre et par-dessus ma place et solde d'homme d'armes[132]. § VI. — ARTILLERIE. Pendant les guerres civiles, dit un auteur moderne, les armées belligérantes, royales, protestantes, ou de la ligue, s'efforçaient d'avoir autant d'artillerie que leurs ressources le leur permettaient ; ces ressources variaient suivant la fortune de la guerre, et l'importance des villes qui leur servaient d'arsenal[133]. Nous ajouterons que ces ressources routèrent toujours faibles. Carrion-Nisas l'a déjà remarqué[134] au sujet des huit canons qui précédaient l'armée royale à Moncontour, et composaient, dit-il, tout son avoir ici au lieu de M'a canons, l'armée du duc d'Anjou en possédait quinze, comme nous l'avons précédemment indiqué au § II, mais c'est encore fort peu, surtout quand on compare ce nombre au chiffre de 140 bouches à feu que Charles VIII, le petit roi, menait jusqu'à Naples, trois quarts de siècle auparavant[135], et au chiffre de 60 pièces de tous calibres, que Henri II fait ronfler, suivant une expression contemporaine, quinze ans plus tard, sous les murs de Metz, avant de faire son entrée dans cette importante cité[136]. La faiblesse respective en artillerie tient sans doute à la pénurie d'argent même en réunissant les pièces d'artillerie des deux partis, ou n'aurait jamais sous ce rapport qu'une idée amoindrie de la puissance française. Cette faiblesse est en général plus grande chez les protestants : car encore, dit La Noue, que les catholiques estiment les Huguenots entre gens à feu, si sont-ils toujours mal pourvus de tels instruments[137]. L'emploi de calibres assez faibles procure à l'artillerie la mobilité déjà signalée comme acquise dans cette période par les autres armes : mais en compensation l'artillerie des guerres de religion ne peut agir puissamment contre les obstacles matériels. En cas d'un combat de nuit, on cherche à éclairer le champ à battre par l'artillerie au moyen d'un amas de fagots et de paille[138], qui sans doute ne produisait pas l'effet de nos balles à feu actuelles. Il n'existe pas encore de troupes d'artillerie[139], et les Suisses gardent ordinairement les pièces, privilège conne, à leur défaut, à la meilleure infanterie de l'armée. Un alinéa de Glande Halos nous le rappelle, au sujet du passage à Provins, le 23 juillet 1581, du duc d'Anjou se portant rapidement, depuis Montereau, au secours de Cambrai, vivement pressée par les Espagnols : l'artillerie du camp, rapporte-t-il, arriva à Provins vers les neuf à dix heures du matin, qui fut logée en la rue du Culoison ; elle était de 4 pièces moyennes, qui ne portaient boulets que de la grosseur du poing, de 4 charettes, qui portaient chacune 6 canons de la grosseur des harquebuses à croc, posés en icelles comme tuyaux d'orgue, et d'une grande charrette chargée de grosses arquebuses à croc, jusques au nombre d'une douzaine. Quatre-vingt Suisses furent commis à la garde de ladite artillerie avec les cononiers, et furent logés, tant les uns que les autres, ès-rues de Troyes et de Culoison. Les canonniers dont il est ici question, avaient évidemment pour mission la manœuvre des pièces, tandis que les Suisses formaient une troupe d'appui et de soutien on voit donc que les pionniers n'ont pas toujours au XVIe siècle le rôle de manœuvrer l'artillerie, comme on l'indique parfois[140]. Claude Haton le marque en ajoutant au passage précité : Les poudres et boulets furent logés dedans la grange du prieur de Saint-Ayoul, Il n'y avait que six ou huit pionniers la suite de ladite artillerie, qui menaient plus de 40 beaux et gros chevaux. D'après son dire, les pionniers semblent ici se borner à la conduite de chevaux de rechange, destinés sans doute à augmenter, dans les chemins difficiles, les attelages de l'artillerie, car s'ils eussent été les véritables conducteurs des pièces, Claude Haton ne les dirait pas à la suite de l'artillerie. Partout à cette époque on voit les canonniers aidés, assistés. Ainsi M. Henne, dans son Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, nous en montre deux par pièce, appuyés de quelques fantassins chargés de demeurer dons un but spécial de protection près de l'artillerie, assistés par des aides canonniers destinés à effectuer les manœuvres de force[141], et aussi par des pionniers qui, outre leur participation accidentelle an service des pièces, exécutent les travaux de fascinage et de terrassement indispensables pour mettre les bouches à feu en batterie, ou leur ouvrir un accès facile au milieu de certaines positions. Dès 1544 ces pionniers belges r jouissaient d'une organisation assez complète, et prêtaient serment comme les autres soldats. La pesanteur de l'artillerie fait la plus grande difficulté de son transport aussi son charriage par eau rend-il de grands services quand il s'agit des calibres les plus gros, de ceux que l'on conduit devant une ville pour en faire le siège. Nous rencontrons ce mode de transport dans l'époque qui nous occupe : en 1568, Gaspard de Tavannes propose à Orléans de séparer partie de l'artillerie, qui reviendrait facilement après par eau atteindre l'armée pour assiéger Sancerre. L'artillerie se trouvait, comme aujourd'hui, chargée de la construction des ponts improvisés. On le voit en 1569, lorsqu'il s'agit de jeter un pont sur la Charente, dans le but de doubler le pont de la ville de Châteauneuf, insuffisant pour laisser passer l'armée : ce pont, composé mi-partie de bateaux de pêcheurs, ramassés dans le pays, mi-partie de tréteaux ou chevalets[142], est préparé, exécuté par des charpentiers fournis par le grand maitre de l'artillerie M. de La Bordaisière, qui surveille une partie du travail confié aux soins du comte de Gayasse : l'entrée de ce pont, c'est-à-dira ses rampes et abords se trouvent établis arec promptitude et habileté. On construisait également des ponts improvisés avec des voitures placées sur le lit de la rivière ; les mestres de camp qui combattent sous les ordres de Montluc, ou coopèrent avec lui, traversent par ce procédé la Dordogne en 1562 : Le capitaine Cherry, raconte Montluc[143], se mit devant selon sa coutume avec les gens de pied sur la rivière, et promptement fit un pont de charrettes et passa à la hâte. Le passage des rivières sur des radeaux était connu les habitants d'Auxerre, quand ils vont en août 1568 assiéger le château de Regennes, traversent l'Yonne sur des trains de bois flotté, et approchent ainsi assez du château pour y pouvoir mettre le feu[144]. Au besoin quelques arbres coupés et jetés à l'eau, suffisaient[145], comme le fait voir la surprise d'Etampes en juin 1589, par l'armée royale, coup de main où d'Aubigné fut l'un des principaux acteurs. § VII. — MARCHES. Les armées marchent suivant l'ordre de leur organisation, dont nous avons déjà parlé (V. le § III) : en tête une avant-garde le plus souvent mixte, puis le bataille ou corps principal, et en arrière, pour fermer la formation, un peu de cavalerie, ordinairement de la cavalerie légère[146]. Quelquefois le fractionnement de l'armée augmente : l'armée royale par exempte, qui marche sur Rouen au mois de septembre 1562 pour mettre le siège devant cette ville, est divisée en quatorze quartiers[147]. Les armées cheminent sur une seule colonne, les chariots de bagages rangée sur les cédés[148]. On se croit protégé par ces files de chariots, les Espagnols surtout, ce qui montre qu'on avait en marche fort peu à craindre de l'artillerie. Souvent l'avant-garde compensa deux portions, ou du moins était suivie par une force destinée à la protéger. Un exemple de cette disposition se rencontre dans la marche exécutée on 1590, dans la Bourgogne, depuis Marcigny, contre le gouverneur de liteau qui .approchait, par Guillaume de Tavannes : Ledit sieur de Tavannes, raconte lui-même, dans ses propres mémoires, ce fils ainé du maréchal de Tavannes, s'achemina au-devant des ennemis, ayant lissé ses gens de pied À Martigny, avec l'ordre suivant le marquis de Mirebeau[149] avec sa troupe de cavalerie menait les coureurs, une compagnie d'arquebusiers à cheval à sa droite ; après, pour le soutenir, le sieur de Cipierre avec sa compagnie de cavalerie et une d'arquebusiers à cheval ; le sieur de Tavannes suivant menait le gros des troupes. André de Bourdeilles recommande que la bataille suive de près dans la marche l'avant-garde pour se garder, dit-il, de tomber en des inconvénients où l'on s'est autrefois trouvé pour être si loin que l'une était défaite sans le sçu de l'autre[150]. La bataille de Saint-Quentin (1557) récemment livrée quand il écrivait, fournit un exemple de ce fait, assez frappant pour que nous le rappelions, quoiqu'il soit antérieur aux guerres de religion[151]. Coligny parait avoir eu l'habitude d'effectuer ses marches en donnant rendez-vous à toutes ses troupes, à une certaine heure, au lieu qu'on jugeait le plus commode pour la distribution des logis[152]. Les protestants allaient ainsi par divers chemins, ce qui pouvait être commode et permettait sans doute de gagner du temps, mais multipliait les alarmes et donnait lieu à des surprises. Ce système adopté par Coligny de diviser, pour la marche, l'armée précédemment réunie, devient même pour les catholiques qui disposent de plus de ressources, devient pour eux presque une nécessité, en raison de l'allure plus décidée des opérations et du besoin de faire subsister dans chaque contrée occupée, des armées dénuées de transports et d'approvisionnements réguliers[153]. Cependant les marches acquièrent seulement une rapidité
relative, puisque réunis à Limoges en 1569, les capitaines de l'armée de Monsieur (le duc
d'Anjou) demandent exceptionnellement
à ce que leurs soldats soient pourvus dé pain pour un jour, afin de ne pas être
obligés de s'arrêter brusquement pour vivre, si les circonstances souriaient
aux opérations[154]. Ne nous
étonnons pas du reste de cette sujétion de la guerre aux exigences des
approvisionnements vers la fin du XVIe siècle, car, au siècle suivant,
Turenne et les autres généraux de Louis XIV voient encore leurs projets
paralysés par les nécessités de la boulangerie[155]. Si, dans une poursuite, l'on se trouvait serré de trop près, on cherchait d'abord à retarder l'ennemi au moyen d'un détachement de chevau-légers qui escarmouchait avec lui et eu besoin se sacrifiait pour lui barrer le passage, puis l'on recourait à diverses ruses, comme de laisser dans les haies et buissons des bouts de corde allumés pour faire croire à un campement, alors que l'on était déjà parti et que l'on cherchait à gagner de vitesse[156]. On se dirigeait dans les marchas ad moyeu de guides, mais ceux-ci, sises comme aujourd'hui, étaient sujets s'écarter du chemin, à se fourvoyer, comme ce fut le cas, au commencement des premiers troubles, quand le prince de Condé voulut essayer de surprendre Farinée royale à proximité de Lorges. Comment se ralliait-on tine fois en marche, si quelque événement écartait ou éparpillait les troupes ? Quels étaient les signaux adoptés ? J'avoue n'avoir rien trouvé de précis ce sujet, excepté dans Claude Haton, qui raconte qu'en 1575 ès environs de Vertus, en tirant vers Sezanne, les ennemis se rallièrent ainsi qu'ils purent polir se remettre ci troupe, et pour se mieux reconnaitre, mirent le feu en trois ou quatre villages de nuit, qui était le signe donné entre eux pour se rassembler ; à la clarté desquels feux plus hardiment s'approchèrent les égarés, et se rallièrent bien le nombre de 3.000 hommes[157]. Il s'agit d'un ralliement après dé faite, lequel excuse plus le moyen employé, et d'ailleurs ceux qui l'emploient sont principalement des mitres de mauvaise renommée : le procédé d'incendier des villages pour s'éclairer peut donc rester exceptionnel malgré la dureté habituelle des guerres civiles. Outre les marches ordinaires ou en colonne, on effectuait également des marches sur un front étendu c'est ainsi que le due de 5layenno se rendit d'Eu à Arques en 1589 pour combattre dans la deuxième journée, c'est-à-dire en la bataille d'Arques. Parti d'Eu, rapporte le duc de La Force dans ses Mémoires, il avait à traverser un pays de grandes plaines unies, et marcha en bataille, faisant deux têtes, sans néanmoins beaucoup de séparation, l'une vers Dieppe, l'autre vers Arques. Son front était si grand qu'il paraissait y avoir cent mille hommes. Relativement aux retraites, des idées saines commencent à prévaloir ; en général on les opérait en contenant l'adversaire par de légères escarmouches, par de fausses charges, mais le prince de Condé estimait enjeu dangereux, disant qu'il était plus malaisé de s'en démêler que d'une vraie bataille, que la meilleure façon de battre en retraite, surtout en pays couvert, consistait à se retirer de position en position, en tiraillant, sans engager le gros de l'infanterie. Une manœuvre du maréchal de Saint-André, se retirant avec une arrière-garde de 2.000 chevaux contre 6.000 cavaliers du duc de Savoie, peut être considérée comme une retraite en échiquier on l'y voit en effet faire dérober devant et derrière lui ses troupes, dit Brantôme, les unes après les autres tout bellement, à celle On que l'ennemi ne s'aperçût qu'il y eût aucune place vide, ni désemparée. et à mesure que les unes déplaçaient, les autres reliaient prendre leur place et faisaient tête..... et ainsi se déplaçant et remplaçant les unes les autres, jamais les ennemis ne s'en purent apercevoir[158]. § VIII. — RECONNAISSANCES. Une reconnaissance doit précéder toute action de guerre ce principe a toujours été suivi, car seul il fournit, avant d'agir, les renseignements du moment dont on a besoin pour baser son action avec quelque chance de succès. Il faut surtout en effectuer quand il s'agit du départ d'une armée : André de Bourdeille, frère aine de Brantôme, recommande de joindre alors au personnage entendu qui en est chargée un commissaire d'artillerie et des pionniers pour faire accommoder les chemins[159]. A cette époque, les détachements chargés des reconnais-saucés ne sont pas nombreux. Ils demeurent à ce sujet, ce qu'ils étaient en 1552, alors que cheminant sous le due d'Aumale, le long du chemin de Chambéry au Mont-Cenis, M. de Vieilleville envoyait le maréchal-des-logis de sa compagnie, Moysandière, avec 6 hommes d'armes et 10 archers, traverser la montagne et reconnaitre qui était au-delà, et dire, s'ils trouvaient des peuples, qu'ils apportassent leurs denrées, et les assurassent qu'ils seraient payés à leur mot[160]. En effet, nous voyons en 1560, le même Vieilleville, envoyé à Orléans, après la conjuration d'Amboise, faire exécuter, à gauche et à droite de la Loire, deux reconnais-sauces, chacune de vingt soldats et un capitaine[161]. C'est là le chiffre moyen des reconnaissances, et sous ce rapport il n'y a pas grande différence avec ce que nous faisons aujourd'hui. Les plus faibles détachements envoyés en reconnaissance sont de 4, 6 et 8 chevaux[162] : ils opèrent jusqu'a quatre lieues de distance. On trouve pourtant une fois un seul gendarme chargé d'une mission pareille[163]. Les plus considérables[164] atteignent l'effectif de 400 chevaux tel est celui confié au vicomte d'Auchy, en 1568, près Châtellerault, par le duc de Montpensier, qui recommande a cet officier de remplir sa mission sans toutefois attaquer, tant ce nombre de soldats paraissait imposant. II s'agit cette fois d'une reconnaissance précédant une action (le combat de Pamprou). Souvent la reconnaissance s'effectuait avec une compagnie entière, forte de 30 à 60 maitres ; ainsi fit le duc de La Force en 1589, la veille de la bataille d'Arques. Arrivé sur le haut d'une montagne vers le quartier des ennemis, il y demeura toute la nuit, fit approcher les écoutes le plus près de leur quartier que se pouvoit ; tous oyoient un grand bruit dans leur camp, et jugeoient bien qu'ils se préparaient à marcher ; mais il ne passa personne du côté où ils étaient, ce qui l'en fit retourner, même voyant que le jour commençait à paraitre. Les maréchaux de camp et quelquefois le chef d'armée lui-même[165] effectuaient des reconnaissances. On envoyait également, pour observer l'adversaire, des coureurs ou batteurs d'estrade : ces derniers, pris de préférence dans la cavalerie légère, à défaut dans l'infanterie, s'éparpillaient pour fouiller le terrain et avertissaient de l'approche de l'ennemi. Leur nombre dépassait rarement 40. Ils étaient d'autant plus utiles qu'un jour sombre et obscur pouvait empocher de distinguer l'infanterie ennemie, comme cela arriva en 1572 aux soldats de Genlis[166]. Les dévastations, suite des guerres civiles, poussèrent tee paysans à cacher leurs approvisionnements, et il fallut dès lors de lointaines reconnaissances pour trouver des vivres et des fourrages : Castelnau[167] signale ce fait dès 1563. L'espionnage se rattache comme service militaire aux et-connaissances. Le mode de paiement des espions parait alors avoir consisté en gages fixes, au moins pour ceux qui érigeaient en métier leurs tristes occupations e ce sont, on le sait, les espions ordinaires, vulgaires, ceux dont un général rencontre partout la vile engeance[168]. Quand on arrêtait quelqu'un on le fouillait. En 1589, à Toulouse, peu avant lu mort du président Duranti, on saisit un porteur de lettres qui les cachait dans la fourrure de son chapeau[169]. On trouve dans ce siècle des espions brûlés vifs[170]. § IX. — STRATÉGIE ET TACTIQUE. Luttes à petite échelle, les guerres de religion offrent peu de stratégie. Après la bataille de Moncontour, l'armée protestante
accomplit en œuf mois presque son tour de France, mais c'est moins un
mouvement stratégique qu'une visite successive à tous les lieux d'où elle
pouvait tirer des renforts et des ressources de toute espèce, et ce long
voyage se put exécuter, j'emprunte les paroles de La Noue : à cause de l'imprudence des catholiques, lesquels laissant
rouler, sans nul empêchement, cette petite pelote de neige, en peu de temps elle
se fit grosse comme une maison[171]. Les royalistes agirent de même plus tard envers la ligue, la
laissant grandir au lieu de l'étouffer au début. Cette imprudence se joint chez les royalistes à une grande candeur dans les mouvements qu'ils opèrent. Ainsi, antérieurement au voyage dont nous parlons, en 1568, lorsque le duc d'Anjou s'achemine, avec les faibles forces trouvées par lui à Orléans, s'achemine, disons-nous, vers Blois, Amboise et Tours, avec réserve, en vue d'une action, et qu'il apprend le mouvement en arrière du duc de Montpensier, courant à 40 lieues vers les Provençaux, mouvement qui isole les deux armées royales, l'entourage du duc d'Anjou veut qu'il marche néanmoins à l'ennemi, avec son peu de troupes, au lieu de rester couvert par la Creuse, jusqu'au retour de M. de Montpensier, mandé en diligence comme le voulait Tavannes : celui-ci finit par l'emporter, et le duc d'Anjou remet son départ à quatre jours, de façon à n'arrher b Châtellerault que suffisamment redoutable il fit bien, car le jour où il atteignit cette ville, rejoint peu d'heures après par le duc de Montpensier, l'ennemi passa la Vienne à Chaumigny, et vint se poster en face de lui à une lieue de Châtellerault[172]. On comprend, à cette époque, l'utilité d'une villa comme
base, car c'est sur la possession de la cité de Flavigny en Auxois, forte d'assiette pour y faim une bonne retraite afin
d'assembler des forces et y jeter un fondement et principe du progrès de ses
desseins, que Guillaume de Tavannes prend (1589)
le pari de combattre Mayenne en Bourgogne sans
deniers royaux, sans troupes royales, n'ayant de Sa Majesté qu'un pouvoir en
parchemin[173]. En revanche on s'acharne aux siégea, lesquels, tentés le plus souvent avec ;les équipages trop faibles, ne réussissent pas et ruinent les armées, surtout l'armée protestante[174] : il eût mieux valu tenir la campagne, mais on voulait posséder des cités, les royalistes, afin de maintenir partout leur autorité, les protestants, pour faire acte de gouvernement et les garder à titre de garantie ; ce n'est plus seulement comme dans les journées de Saint-Quentin et de Gravelines, pour arrêter l'ennemi devant elles et l'y épuiser dans une quasi inaction, qu'on les occupe. Ajoutons que Henri IV, une fois roi et débarrassé par cela mal dos difficultés qui entravaient les précédents chefs, tient mieux In campagne : il recourt volontiers au combat, celte solution décisive des marelles et de toutes les opérations, mais il la prépare par des escarmouches[175] et des affaires d'avant poste que livrent ses lieutenants, et n'apparait lui-même que pour frapper un grand coup[176]. Le duc de Parme quand il vient en France (1590), se borne lui-même à escarmoucher de façon à occuper les Français et à pouvoir lancer sur la Marne, à Lagny, dont il vient de s'emparer, la flottille destinée à ravitailler Paris. Ces escarmouches exigent de la part des troupes une grande mobilité. Le système de guerre devient si l'on veut plus rapide, mais il n'est pas encore très-hardi comme opérations ; il ne pouvait pas l'être avec le faibles ressourcés, dont chacun disposait, surtout avec les variations brusques qui se produisent d'un parti à l'autre en temps de guerres civiles et qui obligent les chefs à une circonspection continuelle. Les diversions ont également cours. En 1573, le maréchal de Tavannes donne l'avis, et il en émet une justification, de tenter quatre entreprises à la fois, la première contre La Rochelle, les deux autres en Guienne et en Languedoc, la quatrième contre la ville de Sancerre, pour empêcher les protestants de se mettre en campagne, se secourir l'un l'autre, et à défaut, favoriser leurs négoces et affaires d'avec les étrangers ; il préfère ces entreprises en tant de lieux à une bonne et grosse armée dont la concentration eut imposé la où elle est agi, mais n'aurait pas atteint le même but conseillé par la politique. Si les royalistes pouvaient s'éparpiller dans un but spécial, les protestants moins nombreux devaient chercher à grouper leurs forces, et à ne pas se laisser attaquer en détail Condé perdit cette nécessité de vue quand, après la reddition de Rouen à ses adversaires (1562), au lieu de marcher rapidement sers la Normandie, pour s'appuyer sur la ville du Havre[177], il vint faire sous Paris une apparition peu utile, puis, en vue peut-être d'entraver le transport des blés de la Beauce à Paris, but secondaire, courut assiéger Chartres et Dreux[178], prolongeant ainsi son écart de sa ligne d'opérations la plus profitable. Ce qui a pu paralyser les dispositions stratégiques des généraux de l'époque, c'est l'indécision de la cour et de son conseil, auquel il arrive de répondre : Ceux qui ont les armes en main ne doivent demander conseil ni commandement de la cour, qu'ils fassent ce qu'ils jugeront le plus à propos[179]. Joignez à cette indécision du gouvernement les divergences d'opinion qui signalent les temps de troubles et dont les conseils de guerre reflétaient l'image. On y décidait à la pluralité des voix on commençant par le moins âgé, sans tenir compte de l'influence et du talent, ce qui mit souvent Tavannes hors de lui, et le porta même au projet de quitter le service militaire. Il semble que l'on conservait une certaine répulsion pour les campagnes d'hiver, qui ne permettaient, disait-on, ni de tenir les soldats ensemble, ni de camper, et nuisaient plus à l'assaillant qu'à celui qui était assailli : le roi de Suède, Gustave-Adolphe, devait, en effet, être le premier à les remettre en honneur. On rencontre dans les guerres de religion plus de tactique que de stratégie. Ainsi, l'idée que les terrains plats, 'unis, conviennent à l'arme de la cavalerie, était générale : il était nécessaire de faire l'assiette du camp à la plaine le plus que l'on pourrait, pour être faibles d'arquebuserie et forts de gens de cheval, écrit Tavannes, en 1569. On commit l'avantage de charger sur le flanc d'une troupe débandée ; le combat de Pampres (1568) en offre un exemple dans l'arquebuserie chargée vivement par le sieur de La Valette, père du futur duc d'Epernon, à la tête de sa compagnie[180]. L'art d'échelonner les carrés, afin qu'ils s'entre-favorisent l'un l'autre, comme dit La Noue, cet art se pratique. Il s'agit évidemment de carrés d'infanterie. La Noue les veut de 2.000 hommes (dont 750 armes à feu) chacun, distants l'un de l'autre de 80 pas (60 mètres), et placés en échelons ou demi-échiquiers[181]. On renonce aux lourdes masses de Crécy et d'Azincourt pour adopter des fractions plus légères et plus vives d'allures dès Dreux, par exemple, la bataille ne combat plus unie en bloc, le maréchal de Saint-André la partage en cinq groupes. On se rallie bien et souvent, l'action qui vient d'être rappelée le prouve, et comme l'a remarqué avec raison un auteur militaire, pour quiconque' veut y réfléchir, cela seul révèle la présence de l'art. La combinaison intelligente des armes se rencontre. En 1589, aux environs d'Arques, après la première journée de ce nom, le maréchal de Biron fait placer deux couleuvrines à couvert, le long d'une colline, les masque par un rideau de cavalerie, à la faveur duquel elles gagnent les plateaux, attend l'instant propice, fait une trouée dans son rideau équestre, et tire si à propos au milieu de le cavalerie de Mayenne qu'il la met en désordre c'est ce qu'il appelait mener du canon à l'escarmouche[182]. Déjà, sous les murs de Senlis, au mois de mai de cette même année, La Noue avait dû le succès au soin de cacher au milieu de ses fantassins les deux seuls canons ce son pouvoir, de sorte que l'ennemi le crut sans artillerie, et vint comme à un simple engagement, tandis que, une fois à petite portée, il fut reçu à coups de canon. Dans les manœuvres de détail on retrouve des points de repaire. La Noue parle des tours et retours faits par les soldats nouveaux à qui on apprend des limaçons, c'est-à-dire des contre-marches. § X. — BATAILLES. Pendant les guerres civiles, les protestants sont constamment défaits en bataille rangée ; cela tient à la supériorité de deux chefs des catholiques[183], à la meilleure et plus puissante organisation de cos derniers, peut-être même à leur moins mauvaise discipline. Afin de mieux exposer l'art de livrer bataille à cette époque, en ce qui concerne nos luttes civiles, nous allons décrire les principales actions de ces guerres. I. — Combat de Ver, près Saint-André de Cubzac[184] (1562). — Au début des troubles, rassemblant sa compagnie et mi levant six nouvelles, d'après l'ordre du roi[185], Montluc commence à s'opposer dans la Gascogne à la réunion des protestants, tire deux canons et une couleuvrine de Toulouse, gagne Montauban, et, après des courses diverses, prend Lectoure. Il se réunit à M. de Burie et lui propose de combattre ; celui-ci, préférant attendre l'arrivée de M. de Montpensier, discute sa proposition, mais finit par l'accepter. Tous deux s'avancent alors vers l'ennemi, dont la cavalerie occupait Saint-André et les gens de pied le gros bourg de Ver. Montluc s'approche tellement de leur camp que les siens font prisonniers deux capitaines il reste sur le qui vive toute la nuit, les soldats en armes, les chevaux sellés, puis au matin marche sur Saint-André. M. de Duras s'était concentré à Ver, ne se doutant que l'ennemi bit si près de lui. L'action commença par une petite escarmouche occasionnée par la trop grande précipitation des premières compagnies royalistes l'échauffourée passée et chacun ayant repris sa place, Montluc, accompagné du capitaine de Montferrand, fit lui-même la reconnaissance de l'adversaire. Ce dernier appuyait ses deux ailes par des arquebusiers ; ceux de sa droite, arquebusiers à pied, occupaient un bois ; ceux de sa gauche, arquebusiers à pied et à cheval, s'étendaient en potence[186] dans la plaine. Montluc fit avancer les quatre pièces d'artillerie amenées par M. de Dulie, sur le bord d'un fossé, et les pointa sur la potence il mit de ce enté, c'est-à-dire à sa gauche, sa compagnie et celle du roi de Navarre, lesquelles de la sorte tirèrent aussi sur la potence ; au centre il plaça trois compagnies et à sa droite, du coté d'une petite éminence, les troupes du capitaine Masses. M. de Burin prit la tête du centre ou de la bataille, pendant que les quatre pièces de l'aile commençaient à tirer. Averti enfin[187] du corps auquel il avait affaire, l'ennemi doubla le pas pour venir attaquer. M. de Burie et Montluc poussèrent droit à eux au grand trot, afin de les prévenir et de ne leur pas laisser gagner la montagne d'où ils auraient combattu avec avantage[188] ; les gens de pied catholiques suivaient en toute diligence. A cette vue les protestants rappelèrent 1.200 vieux soldats de leur arrière-coin et renforcèrent ainsi leur bataille : Charge, cria Montluc, et une mêlée succéda de près au choc. La furie du chef donna la victoire aux royalistes, mais le sang-froid du capitaine Masses y contribua. Voyant une troupe intacte postée prés de la montagne, il évita de charger avec le restant des siens, marcha vers elle, et une fois à bout portant, la culbuta : ainsi disparut un danger latéral qui pouvait tout compromettre. Les fuyards furent poursuivis durant deux lieues et faillirent tomber dans les troupes de M. de Montpensier, prêt à atteindre Mucidan. Tel est ce combat de Ver, où le succès appartient au plus
vigilant, à celui qui sut Joindre à la rudesse des coupe l'intelligence de ne
laisser l'ennemi ni prendre une position dominante, ni exécuter une attaque
de flanc. Je l'ai narré, d'après le récit atténué du bouillant Montluc,
n'ayant pu en saisir une trace dans Davila. La Noue lui-même en parle laconiquement
disant[189] :
Peu de temps après M. le prince de Condé entendit la
route d'une petite armée de Gascons que le sieur de Duras lui amenait, où il
n'y avait pas moins de 5.000 hommes, qui fut défaite par le sieur de Montluc.
Cette évaluation de 5.000 hommes correspond aux 23 enseignes d'infanterie et
13 cornettes de cavalerie indiquées par Montluc, qui porte la perte des
vaincus dans cette journée à 2.000 tués. II. Bataille de Dreux (19 déc. 1562). — Les protestants effectuaient leur retraite vers la Normandie, après avoir échoué sous Paris, quand les catholiques qui les poursuivaient, les atteignirent en suivant un chemin plus monade et plus court[190], passèrent l'Eure près de Dreux, au clair de la lune et sans opposition aucune, et les forcèrent à livrer bataille. Commandés par le prince de Condé et Coligny, les protestants comptaient dans leur armée 7.000 fantassins, 4.500 chevaux, et seulement 5 canons, le surplus de leur artillerie ayant pris l'avance. Les royalistes, dirigés par trois chefs, le duc de Guise, le connétable de Montmorency, le maréchal de Saint-André, arrivaient an nombre de 15.000 fantassins, 2.000 chevaux et 22 canons. Ils prirent position, leur droite à Epinay, leur gauche à Blainville, sur une seule ligne légèrement concave, divisés comme pour la marche en deux corps, l'avant-garde et la bataille proprement dite, la première à droite, la deuxième à gauche[191]. Leur droite se trouvait renforcée par l'infanterie espagnole formant un gros bataillon de 2.000 hommes sur 55 rangs de profondeur et par les chariots de bagage destinés à former remparts parce qu'ils appréhendaient que les ennemis, dont la cavalerie était plus forte que la leur, ne les investissent tout-à-coup[192]. Entre les gros bataillons d'infanterie, se tenaient des escadrons soit de gendarmes, soit de cavalerie légère. Une batterie sur la droite, une en avant du centre, et 400 arquebusiers devant le front des bataillons, complétaient l'ordre de bataille. Lee protestants remuaient la bataille : surpris ainsi au moment où ils prêtaient le flanc, ils se rangèrent à la hâte, leur infanterie en deux bataillons, ayant à leur gauche une batterie de 4 pièces, leur cavalerie en trois escadrons de prés de 1.500 chevaux chacun. Les armées se contemplèrent pendant plus de deux heures, étant à une portée de canon, sans une seule escarmouche, ce dont La Noue s'étonne[193], car il y en avait eu à Cerisolles, à Sienne, à Gravelines : on eût dit qu'au moment de livrer la première bataille de ces luttes fratricides, chacun réfléchissait sur les malheurs des temps. L'artillerie catholique engagea l'action : dès ses premières décharges, Condé et Coligny, pour les faire cesser, s'élancèrent à la tête de leur cavalerie, mais ramenés par les boulets ennemis, ils choquèrent contre les Suisses de l'aile gauche qui, rompus d'abord, Se réformèrent rapidement et reprirent la formation carrée. Le connétable, accouru à leur secours et aidé par deux régiments de l'aile droite, vit ses troupes culbutées, et renversé lui-même, fut fait prisonnier. La cavalerie protestante, victorieuse, tourne l'armée royale, pille ses bagages, fait mine de prendre à revers la droite catholique, renonce à ce projet en voyant sa fière et forte contenance, et revient contre les Suisses, qui résistent avec la même intrépidité. Ces Suisses, reste de leur aile gauche, et l'aile droite, affaiblie tes deux régiments vaincus, voilà les forces catholiques qui tiennent encore le champ de bataille, pendant que Condé rallie ses cavaliers épars et que Coligny rassemble, autant de ses fantassins français qui n'ont pas donné, les lansquenets repoussés par les Suisses. Les catholiques semblent donc vaincus, d'autant plus que le Connétable leur manque comme les troupes de leur aile gauche. Quel acte les arrache donc à cette mauvaise situation et leur procure le succès : la longue patience du duc de Guise qui, regardant la victoire en gros, suivant l'expression de Montaigne[194], attend l'occasion et se tient coi jusqu'à ce qu'elle se produise, accusé de couardise par son entourage, mais deviné par l'amiral[195]. Cette occasion venue, il reforme un ordre de bataille de concert avec le maréchal de Saint-André, et leur cavalerie au milieu, leur infanterie aux deux extrémités, précédés d'enfants perdus et de 4 canons, tous deux marchent à l'adversaire arrivés à petite distance, ils exécutent une décharge contre l'infanterie protestante, la culbutent avec leur cavalerie, s'emparent du prince de Condé qui reparaissait accompagné de 200 cavaliers seulement. Dès lors, les soldats catholiques dispersés au début de l'action, rejoignent la cornette du duc de Guise, et augmentent l'élan donné : le succès n'est plus douteux, mais Coligny le fuit acheter aber en chargeant à la tête de 1.600 chevaux et en prenant le maréchal de Saint-André. Au résumé, dans la journée de Dreux, la victoire couronne le chef réfléchi qui déploie le plus de formolé et de talents : le duc de Guise n'avait agi en effet que le plus tard possible, quand il avait vu clair dans l'échiquier, suivant l'expression de Napoléon, et il avait groupé ses troupes de façon à les fortifier l'une par l'autre, tandis que les protestants, lançant trop tôt leur artillerie, livraient sans appui leur infanterie et rendaient leur artillerie inutile. III. — Combat de Saint-Denis (1567). — La disproportion des forces et l'importance du tir de l'arquebuserie signalent ce combat. Du côté des catholiques, prés de 16.000 fantassins, 2.000 chevaux et de l'artillerie : du côté des protestants 2.000 gens de pied et 1.000 cavaliers. Les gens de pied protestants portaient tons une arquebuse ; leur résistance tint à un judicieux emploi de cette arme, la seule dont ils pussent disposer de pied ferme, n'ayant ni piques, ni canons. Coligny fit tirer ses arquebusiers à petite portée, à 50 pas[196], contre la cavalerie de ses adversaires ; par là il compensa un peu l'infériorité du nombre, et la nuit aidant[197], parvint à n'échapper non sans quelque désordre. En somme, dit La Noue, les catholiques eurent l'honneur de la bataille, en ce que le champ et la possession des morts leur demeura, mais ce fut un mince résultat avec une pareille supériorité de forces. Si le connétable montra par là qu'il ne calait pas comme général, le duc de Guise, ce fut pourtant lui qui, averti de la faiblesse de l'armée d. protestants, — lesquels venaient de commettre la faute d'envoyer, pour surprendre Poissy, un détachement de 500 chevaux et 800 arquebusiers, alors que plusieurs indications devaient leur faire présager une action prochaine, — fit constater cette faiblesse par une reconnaissance et décida la bataille pour le lendemain. IV. — Escarmouche de Pamprou (1568). — En 1568, le duc d'Anjou se trouvait à Jaseneuil, village sur In route de Poitiers, et le prince de Condé à Colombière, petite ville sise à dix kilomètres de Lusignan. Les deux généraux jetèrent les yeux sur le village de Pamprou, sis entre leurs deux camps pour y loger leur avant-garde, et y envoyèrent chacun un détachement. De là une escarmouche vivement soutenue pendant plusieurs heures. Le village demeura au pouvoir des protestants, et ceux-ci se mirent à poursuivre les chevau-légers catholiques, mais le duc de Montpensier vint au secours de ces derniers. D'Andelot, qui commandait les protestants, se trouvant alors inférieur en forces, sut se poster adroitement sur le penchant d'une colline, en imposa et ne fut pas attaqué. D'ailleurs toute l'armée protestante déboucha bientôt pour le soutenir, tandis que l'armée royale ne bougea point, ce qui obligea les combattants catholiques, ayant pris leur part de l'escarmouche, à se retirer ; ces derniers s'arrêtèrent près d'un bois et là étendirent leurs premières files de façon à tromper sur leur force réelle, rendant ainsi à leurs adversaires ruse pour rase ; ils y ajoutèrent même la feinte de semer dans le bois et sur les buissons, en rétrogradant ; plusieurs mèches allumées, afin de faire croire que toutes les forces des catholiques stationnaient là[198]. L'escarmouche de Pamprou montre comment un engagement peut facilement, et sans qu'on le veuille, dégénérer en bataille. V. — Combat de Jarnac (1569). — Une heureuse surprise du passage de la Charente par les catholiques amena ce combat. Après la prise de Châteauneuf, le duc d'Anjou se trouvait sans moyen sûr de traverser, car le pont de cette ville avait été rompu, et était difficile à réparer, surtout en face d'adversaires qui veillaient de l'autre côté il se débarrassa de ces obstacles par une feinte. Laissant des troupes dans Châteauneuf, il prit la mute de Cognac et chemina le long de la rivière Coligny le suivit en escarmouchant avec lui par-dessus la Charente. Mais le soir même l'amiral se fatigua pour ses volontaires de le côtoyer ainsi et revint loger au village de Bassac avec son avant-garde, Mimant à ses chevau-légers et à quelques compagnies de soldats aguerris le soin de garder la rivière. Malheureusement il donna l'ordre de surveiller les lieux divers par où l'on pouvait passer l'eau plus à l'aise, et éparpilla de la sorte son monde[199]. Le duc d'Anjou lança le lendemain des arquebusiers dans, un bateau et fit mine de vouloir passer la rivière sur un point ; il abandonna ensuite celle tentative devant la résistance qu'on y opposa, et continua de marcher jusqu'au déclin du jour suivi par les postes des protestants. Mais à la nuit, il courut vers Châteauneuf, y trouva le pont réparé par ses ordres et un pont de bateaux jeté à côté, et fit parmesan armée. Ce rapide passage, effectué sans opposition, déconcerte Coligny, auquel il faut du temps pour rassembler ses postes épars et qui se retire à Jarnac, afin de demander appui au pionce de Condé. Celui-ci range sa droite contre un étang, sa gauche contre une colline, et laisse en son centre un espace propre à recevoir les escadrons de l'amiral, car son infanterie se trouve trop loin et une partie même s'est mise à couvert eu traversant la rivière, circonstance assez singulière. Il n'était plus temps de résister, les soldats de Coligny, pourchassés par les catholiques résolus à l'action, s'encadrent à peine dans l'espace réservé, qu'ils sont accablés par le nombre et culbutés au point de ne pouvoir gagner une position forte où leur chef désirait les reformer ; le manque d'artillerie dans leurs rangs explique le prompt succès des catholiques : ce succès fut tel que le prince de Condé, qui luttait contre le propre escadron du duc d'Anjou, reçut une blessure, tomba à terre par suite de la mort de son cheval[200], et, après une dernière résistance, un genou en terre, isolé des siens, reçut dans la tête un coup de pistolet qui l'acheva. Dans cette opération, la victoire demeure au plus habile, à celui qui traverse la Charente en agissant à l'inverse de ce que prévoyait son adversaire, et le force à combattre avant qu'il ait eu le temps de concentrer ses forces et de les ranger en bataille. VI. — Combat de La Roche-Abeille (1569). — Ce combat, dans lequel le roi de Navarre, qui devint depuis Henri IV, fit ses premières armes, fut livré par Coligny, malgré la solidité du logement des royalistes, parce que, cantonné au milieu de bois et de pays montagneux, il avait peine à faire vivre les siens, tandis que le duc d'Anjou, fièrement campé La Roche-Abeille sur une colline aux escarpements raboteux, tenait Limoges à proximité et en tirait des vivres en abondance. Ce combat eut principalement lieu contre l'aile gauche des catholiques où se trouvait l'infanterie italienne. Les catholiques avaient pont eux l'avantage d'une position dominante et embarrassée par des plantations ; les protestants los assaillirent arec une grande supériorité numérique[201], et néanmoins ils n'auraient réussi en rien si Strozzi, piqué des reproches des Français et de leurs regrets sur le comte de Brissac, son prédécesseur comme colonel-général de l'infanterie, n'eût quitté son excellente position pour attaquer, démarche téméraire qui amena su captivité, ou plutôt, comme le dit Jean de Tavannes[202], ne se fût laisse entrainer, au lieu de tenir forme, à poursuivre l'ennemi qui simulait une retraite. Ce fut pour les royalistes un échec passager. Les soldats de Strozzi regagnèrent peu à peu leur premier poste, sans permettre qu'on l'entamât. Coligny fut obligé finalement de se retirer. Il parait que l'artillerie royale demeurait entre les mains de ses arquebusiers, si la pluie n'eut éteint les mèches des armes portées par ces fantassins.. VII. — Bataille de Moncontour (1565). — La bataille de Moncontour est l'action la plus considérable des guerres de religion. On soit dans quelles conditions elle se livra. L'armée royale se composait de troupes fraiches, en nombre imposant, tandis que l'armée protestante se trouvait rongée par sa plate habituelle, le mécontentement de ses gentilshommes volontaires qui, hors de chez eux depuis un an, aspiraient à y retourner le plus tôt possible, car cette absence les ruinait, et demandaient en conséquence une bataille ou un licenciement. Est-ce pour cela que dans sa marche, Coligny ne se garda pas, et fut surpris romane à Dreux ? Cette surprise eut lieu deux jours avant la bataille et l'amena. Pris en flanc, et vivement, par l'artillerie catholique, quoique séparés par un marais, les protestants ne durent qu'à la ténacité de l'amiral, au courage de prince de Navarre, et au dévouement de leurs soldats décimés, de conserver leur position jusqu'au soir[203]. Alors ils décampèrent et vinrent se placer dans un poste favorable qui devint le lieu de l'action, non que Coligny désirât lutter après les pertes qu'il venait de Subir, mais parce que ses soldats, excités par les mercenaires allemands, demandèrent à tenter la fortune. Arrivés dans la plaine de Moncontour, les chefs protestants durent donc ranger les leurs, au nombre de 16.000 fantassins, chevaux et 11 bouches à feu : ils les mirent sur une ligne partagée en deux corps. Cet crène fut également adopté mir les catholiques, mais chez ces derniers les corps de réserve s'étendait derrière le centre formé par les Suisses, et tin peu avancé par rapport au front des arquebusiers et des chariots protégeaient les flancs des Suisses. Une longue canonnade qui, de part et d'autre, entame rudement les rangs des cavaliers, amène un combat général de cavalerie. L'infanterie suit dans les deux armées les escadrons aux prises Escadrons et batailles, raconte Davila, se mêlent dans le combat fort vaillamment et sans s'épargner. Le duc d'Anjou, souvent en péril, a son cheval tué, sous lui ; un coup de pistolet brise la mâchoire de Coligny ; l'acharnement indiqué par ces deux faits continue. Il semblait que les protestants allaient avoir le dessus, malgré l'ardeur des catholiques désireux de venger les cruautés dont ils accusaient leurs adversaires[204]. A ce moment les Suisses donnent dans la mêlée et rien n'arrête leur effort, pas même 1.500 reîtres que les coups des arquebusiers pontés derrière leu chariots obligent à s'arrêter. Voyant l'avantage obtenu par les Suisses, Tavannes le consolide et assure le succès au drapeau royal en faisant donner sa réserve cette réserve agit d'autant plus sûrement qu'elle se compose d'escadrons de lances, c'est-à-dire de cavaliers armés de lances et placés sur plusieurs rangs, qui rencontrent les cavaliers protestants rangés en haies et dénués de lances[205]. Ainsi, entre ces deux armées à peu prés égales en nombre et en persévérance, la victoire demeure au plus prévoyant. Un détail servira à le montrer autant que le fait principal. Au début de l'action, l'amiral frappé de voir 17 cornettes fondre sur lui, réclame 3 cornettes au chef de sa bataille ou corps principal ; ce chef (c'était le comte Louis de Nassau), au lieu d'envoyer les cornettes susdites sous les ordres de l'un de ses officiers, les conduit lui-même, et comme bientôt la gravité de la lutte l'oblige à demeurer près de Coligny, son corps reste saris direction. S'il eût été à sa tête, fait observer La Noue, et on l'en peut croire, ce corps eût fait un plus grand effort[206]. Evidemment, le comte Louis pensait avoir le temps de conférer avec l'amiral et de revenir à son poste : s'il ne l'eut pas, c'est que la bataille fut vivement menée, ce qui est à l'éloge du vainqueur, de Tavannes, qui en fut le véritable ordonnateur sous le nom du duc d'Anjou ;'elle dura en effet une demi-heure, la canonnade une fois terminée, et cette promptitude marque encore lin progrès dans l'art utilitaire du temps. VIII. — Action d'Arnay-le-Duc (1570). — Nous citons cette action comme prouvant l'importante que les guerriers réfléchis commençaient à attacher aux positions défensives. Là, en effet, au moyen de plis de terrain garantissant ses arquebusiers, jetés entre deux étangs et un moulin qui rompent la continuité d'une pente douce, Coligny, dénué d'artillerie, arrête tous les rituels du maréchal de Cossé, de son armée quadruple en nombre, de ses canons, et l'oblige à rétrograder, à lui laisser la liberté de ses opérations. IX. — Bataille de Coutras (1587). — Dans cette bataille, où les protestants, guidés par Henri de Navarre, resteront victorieux, on reconnait non-seulement l'influence d'un chef habile, mais dans les détails même il y a du mieux joué de la part des officiers protestants, et l'on sent qu'à faire la guerre depuis 25 ans, ils l'ont enfin apprise. L'influence du chef se traduit par les faits suivants. L'armée protestante, pour mieux couvrir Coutras, dont l'occupation est importante, et où elle a devancé l'adversaire par un prompt passage de la Dronne à gué, se range en croissant[207] convexe en avant de cette ville, disposition rarement employée[208] dans les batailles du une siècle, comme le remarque l'auteur compétent d'un travail historique sur ln période des guerres de religion comprise de 1585 à 1590[209], et, de plus, elle s'arcboute à droite contre un bois, à gauche contre un large fossé, ce qui assure un degré plus marqué à sa résistance, si toutefois sa ligne ne se rompt pas pendant la lutte. Derrière l'aile droite il y a une forte réserve, 1.800 fantassins environ campés dans le bois. L'infanterie forme les deux ailes ; les escadrons occupent le centre, mais entrelardés de petits carrés d'infanterie de 25 hommes chacun. L'artillerie était sur une éminence, dite La Motte-de-Loupsil. L'armée catholique se rangea parallèlement à ces dispositions, en croissant, mais en croissant dont la cavité regardait l'ennemi elle récolta donc, comme eût fait un entonnoir et sans en perdre un seul, tous les projectiles des protestants. Bientôt décimée outre mesure, il lui fallut bouger ; son élan de revanche eut une impétuosité telle que les chevau-légers de l'ennemi furent enfoncés et rejetés dans Coutras. L'infanterie protestante tint ferme. Joyeuse, chef de l'armée de la Ligue, ne s'était nos attendu à une résistance semblable : pour la surmonter, il s'élance inopinément avec des cavaliers d'élite et donne le signal de la charge ; mais cette charge n'a pas été préparée, elle s'opère d'une façon décousue, et les cavaliers qui l'exécutent, partis de beaucoup trop loin, de 800 mètres[210], ne dirigent bientôt que des chevaux essoufflés et incapables d'agir. Le roi de Navarre les laisse approcher jusqu'à trente pas, puis ordonne une attaque générale. Ses gros escadrons, qui prennent le galop à dix pas seulement, culbutent la ligne flottante des cavaliers catholiques, se rejettent sur l'infanterie, lui font éprouve, le même sort et achèvent ainsi d'obtenir la victoire. La supériorité des officiers protestants sur les officiers catholiques se remarque facilement dans cette journée. Ainsi, l'artillerie huguenote enlève 12, 15 et même 25 hommes par coup à l'ennemi[211], tandis que l'artillerie catholique n'a que des coups fichants qui n'atteignent pas la première couse d'énormes ravages parmi, les troupes du duc de Joyeuse, et ce n'est pas le nombre de ses pièces qui produit ce résultat, m'il ne dépasse pas trois ; ainsi trots bouches à fin, combattues par, deux autres, exercent une influence décisive par la manière habile dont on sait les employer. L'inexpérience des royalistes en artillerie se retrouve dans les manœuvres, et ils brillent plus par le luxe que par la connaissance approfondie de l'art militaire. Singulier revirement, et la présence d'un favori à la tête de l'armée royale produit-elle seule ce résultat ? Nous ne le croyons pas. Les officiers protestants se sont formés, instruits ; ils savent la guerre, et le génie du prince, qui devint Henri IV, fouilla à leur savoir comme à leur courage la plus belle occasion de se déployer. X. — Bataille d'Arques (1589). — Le dernier des historiens de Henri IV insiste pour montrer à la place de cette bataille une série de combats[212] se succédant à des jours rapprochés une fois rangées en bataille, en effet, les armées restèrent longtemps en regard, mais le dernier jour il survint une action plus considérable, bien combinée, et c'est ù elle que l'on donne le nom de bataille d'Arques ; l'expression n'est pas trop ambitieuse et s'applique non pas à l'ensemble des jours de la lutte livrée près de Dieppe, comme pour la bataille moderne d'Arcole, mais au dernier jour seulement. Henri IV campait en avant d'Arques, quand le due de Mayenne vint aux environs de Dieppe et chercha à tourner sa position d'abord en s'emparant du faubourg du Palle, ensuite en brusquant le passage de la rivière de Béthune vis-à-vis le village de Bouteille. Ces deux tentatives échouèrent, et le chef de la Ligue dut se résoudre à attaquer en face et se porter par Martin-Église contre le front de l'armée royale. Ce front s'étendait de la rivière d'Eaulne à la forêt d'Arques, couvert par un retranchement à cheval sur le chemin d'Arques à Martin-Église : ce retranchement, très-simple, se composait d'un parapet en ligne droite enclavant une chapelle qui formait saillie et le flanquait ; il laissait entre son extrémité gauche et l'Eaulne un passage libre de 150 mètres de largeur. A 800 mètres en arrière s'élevait un second retranchement de figure bastionnée, qui fermait par derrière le camp royal. Entre les deux retranchements, se tenait le régiment suisse de Soleure. Sur son flanc gauche, l'armée du Béarnais se trouvait protégée par les trois rivières d'Arques, de Béthune et d'Eaulne, dont les confluents se touchent presque et sont entourés de marais assez fâcheux, suivant l'expression d'un contemporain ; sur son flanc droit s'étendait une colline, puis la forêt d'Arques, obstacles assurément, mais obstacles accessibles, et c'est pourquoi le maréchal de Biron se posta à l'extrémité droite du premier retranchement avec deux compagnies et plusieurs volontaires. Il n'était pas jusqu'au château d'Arques qui, prenant des vues sur le champ de bataille, ne vint en aide avec son artillerie aux troupes royales. Ces détails font comprendre combien la position de Henri IV était forte, et avec quelle habileté ce monarque réduit, dit-on, à moins de 7.000 combattants[213], secondait ce qu'il appelait gaiement son bon droit. Ils expliquent également l'hésitation du duc de Mayenne et ces deux ou trois jours d'expectative, uniquement employés à des escarmouches. Enfin, le 23 septembre, celui-ci fait descendre toute son armée dans la plaine, cette plaine qui mesure deux mille pas à peine ; ses fantassins choquent contre le retranchement ; ses cavaliers cherchent à profiter de l'intervalle resté libre. Ces derniers, débouchant sur plusieurs lignes, obligent la cavalerie royale à céder, juste à l'instant où les lansquenets des Ligueurs parviennent dans le retranchement, et où Biron se trouve pressé de fort près. En même temps[214], le brouillant se dissipe et les 4 canons du château d'Arques, soutenus par ceux du retranchement, ouvrent leur feu ; leurs projectiles, adroitement dirigés, tombent tous au milieu de la cavalerie des Ligueurs entassée dans l'étroit espace oh elle s'est engagée. La supériorité numérique de cette cavalerie, naguère à son avantage lors du choc, tourne à son détriment quand il s'agit de supporter le feu d'une artillerie qui la dentine, et les escadrons de Mayenne commencent à se retirer en désordre. Ce revirement heureux est appuyé par l'apparition inopinée de 500 arquebusiers accourus de Dieppe au soutien de l'armée royale. Henri IV saisit ce moment pour reprendre l'offensive sur sa droite, dégager le maréchal de Biron, et replacer ses fantassins dans le premier retranchement[215]. Cette position reprise et renforcée de toute l'artillerie en arrière, les Ligueurs reçoivent des feux multiples r ceux du château d'Arques, nenni du retranchement ; ils essaient en vain de résister encore, une panique les saisit et ils fuient sans que plus de 10 cavaliers fassent mine de tourner tête. L'infériorité du roi comme effectif, l'empoche de profiter de son succès ; craignant une seconde attaque sur son camp[216], il lève pied le lendemain matin, traverse Arques, y laisse garnison et regagne Dieppe. XI. — Bataille d'Ivry (1590). — Dans la journée d'Ivry, c'est encore le petit nombre[217] qui triomphe du grand. Il triomphe par de meilleures dispositions. Henri IV ne donne pas à son armée un front étendu, parce que sen but consiste à percer la ligne de ses adversaires avec son centre renforcé[218] et formé d'un escadron de 600 chevaux placés sur cinq rangs de profondeur cette fois toute l'initiative de l'attaque lui appartient, car c'est lui qui marche à la rencontre de Mayenne. Il se ménage une réserve de 1.400 fantassins et 800 chevaux. Les ligueurs occupent une ligne unique et concave, où leur cavalerie est entremêlée à l'infanterie comme dans l'armée adverse, mais dans celle-ci des pelotons d'arquebusiers à pied[219] flanquent chaque escadron. L'action commence par une canonnade qui procura aux royalistes une supériorité marquée. Pour se soustraire à un feu aussi meurtrier l'aile droite des ligueurs attaque l'artillerie qui les foudroie, tue les canonniers et culbute un corps de chevau-légers : le maréchal d'Aumont charge pour dégager ces derniers, y réussit et revient sans fougue inconsidérée reprendre sa place dans l'ordre de bataille. Ailleurs les pelotons d'arquebusiers arrêtent la cavalerie des ligueurs. Mayenne accourt avec ses lanciers, mais il rencontre mal à propos ses propres mitres débandes, se voit obligé de faire halte et d'abaisser les lances contre eux. Henri IV, pour ne pas perdre une si belle occasion qui se présentait à lui par suite du désordre des ennemis, commande la charge et s'élance en avant. Son escadron, dont le premier rang se composait de gentilshommes, le suit avec bravoure et fait merveille : renversé, tout le centre de l'armée s'enfuit. La déroute de ce centre entraîne la reddition ou la disparition du restant des ligueurs. Ce fut une lutte de cavalerie ; l'infanterie royale n'eut pas même à combattre, et quant à la réserve, elle ne bougea pas, mais imposa par son attitude menaçante. Biron commandait cette réserve, Biron, ce chef, qui reprochait souvent au roi son élan immodéré, lui disant combien de fois il avait dû remplir ses fonctions alors qu'il se laissait entrainer à jouer son rôle. La sage attente de Biron, le retour du maréchal d'Aumont à sa place dans l'ordre de bataille après sa charge, tout cela indique combien l'art de la guerre de la période des guerres de religion s'éloigne des usages irréfléchis de la chevalerie et conduit a n'agir qu'air moment favorable et avec prudence. Observations générales sur les batailles. — Nous avons lu quelque part, ce nous semble, que dans les batailles du temps qui nous occupe, l'avant-garde de l'armée prenait ordinairement la droite de l'ordre de bataille. Pour justifier ce fait, indiquant que l'armée se déployait la droite en tale en arrivant sur le champ de bataille, nous rappellerons la bataille de Dreux (1562) où cela eut lieu dans l'armée catholique[220]. En tout cas, dans l'ordre de bataille, l'avant-garde s'échelonnait le plus souvent par rapport au corps de bataille et se trouvait en avant si l'on combattait dans l'ordre naturel, en arrière si l'on se battait en retraite[221] : c'est dire qu'on en était pas à l'ordre parallèle pur et simple, comme l'entendait Philippe de Clèves dans le cas où l'adversaire abordait avec les trois fractions de son ordre de bataille. On en était si peu à cet ordre d'une manière exclusive que l'on voit, plusieurs années après la publication de l'ouvrage de cet auteur, les habitants des Pays-Bas, luttant contre le duc d'Albe, adopter souvent pour le combat la disposition en demi-lune, ou l'ordre concave[222]. On savait très-bien mettre le terrain et ses particularités en sa faveur. A Ivry, Henri IV effectue un mouvement pour se ménager le soleil à dos. Quant b la pluie il était plus difficile de s'en garantir, et pourtant elle rendait souvent les arquebusiers incapables de pouvoir tirer[223]. On utilisait surtout les circonstances locales par le choix des positions, et c'est en cela qu'éclataient les talents d'un capitaine comme le proclame un contemporain. Les chefs d'armée savaient, et cela depuis le milieu du siècle, qu'il était salutaire, afin d'étonner l'ennemi en survenant inopinément[224], de garder en réserve une des fractions de la ligne de bataille[225]. Seulement cette fraction restait ordinairement faible, quoique divisée en plusieurs parties, et c'était MI inconvénient amuse de l'étendue et de l'amincissement de la ligne unique dont se composait l'ordre de bataille. Cet ordre comportait souvent un mélange confus d'escadrons
et de bataillons, au milieu duquel la cavalerie occupa quelquefois le centre,
étant appuyée sur les deux ailes par l'infanterie de l'avant-garde et du
corps de bataille. Pourtant, après une période où l'ensemble de l'ordre de
bataille fut mal ordonné et présenta un entremêlement singulier de fantassins
et de chevaux, qui amena des désastres[226], on en revint à
un ordre de bataille imité des anciens, c'est-à-dire, à séparer l'infanterie
et la cavalerie, et à mettre cette dernière à part et sur les flancs,
disposition dont Bardin[227] attribue le
renouvellement à Farnèse. Jérémie de Billon, dans ses Principes de l'art
militaire[228], montre en
effet le colonel de l'infanterie comme obligé de se poster à la tête des bataillons, au droit du milieu du front de
l'armée, ce qui indique nettement l'infanterie comme placée au centre
: seulement cet auteur reflète les usages hollandais[229] plus que les
nôtres, et il écrit à la fin des guerres de religion, époque à laquelle
l'usage de l'ordre de bataille régulier, tel que l'antiquité nous l'a légué,
est plus répandu. Nous ne disons pas que cet usage soit complet et absolu,
parte que Maurice de Nassau, dans son ordre de bataille devant Juliers, en
1610, et onze ans plus tard devant Emeric, place de la cavalerie à ses deux
ailes, mais en met également, sinon sur son centre, au moins aux deux tiers
de se ligne, à droite et à gauche. § XI. — FORTIFICATION. Pendant les guerres de religion, en la dernière moitié du XVIe siècle, il s'agit encore, dans la plupart des cas, de la fortification féodale, témoin ce château de Gratedos, à douze kilomètres de Langres, contenant, même en 1591, pour garnison, trente arquebusiers à cheval qui s'en servaient comme d'un repaire pour ravager le pays environnant. A cette même époque, le château de Bonencontre, situé sur la Saône, non loin de Dijon, était d'importance, rapporte Guillaume de Tavannes dans ses Mémoires, pour être bâti tout de briques, avec quatre grands pavillons à mâchicoulis, les murailles de même, épaisses de sept ou huit pieds, avec de grands piliers de pierre du haut en bas. Le maréchal de Tavannes lui ajouta quatre boulevards, avec doubles fossés. Ne nous étonnons pas de voir subsister, pendant la lutte des guerres de religion, la fortification à murailles élevées, aux masses imposantes, mais vues de loin et faciles à battre en brèche. La fortification rasante, réclamée par les progrès de l'artillerie, débitait à peine : ses premières constructions, près de la France, l'enceinte de Calais et la citadelle d'Anvers par exemple, dues la première aux Anglais et la deuxième à Paciotto d'Urbin, sont ou un peu antérieures ou contemporaines des guerres religieuses[230] et elles offrent plutôt des fortifications terrassées[231] que des fortifications abaissées presque au ras du sol. Dans la Vie de Gaspard de Tavannes, écrite par son fils Jean, on parle bien, à la date de 1565[232], des bastions[233], mais c'est une digression comme cette vie en offre tant, présentée théoriquement plutôt qu'en vue d'un objet déjà appliqué ; et en effet, il ne parait pas que la construction des bastions remonte en France antérieurement à 1569 où Scipion Vergano, ingénieur italien[234], en éleva quelques-uns à La Rochelle[235]. Toutefois, Jean de Tavannes se prononce pour les bastions de grandeur moyenne et les veut se flanquant rien que par l'arquebuserie. Il va trop loin quand il demande que l'arquebusier puisse effectuer ce flanquement de blanc en blanc, c'est-à-dire à portée efficace, assez efficace, ajoute-t-il, pour que son coup puisse percer une cuirasse, car atteindre l'ennemi dans ce cas, c'est déjà un résultat, vu que l'effet moral devient alors considérable. Il ne faut s'attendre, dit-il, de défendre les brèches par artillerie, dont les promptes recharges n'égalent celles du mousquet. Il parle en termes sensés de la tenaille, prétendant l'avoir inventée, puis montre son utilité pour couvrir le mur de la courtine en arrière et contraindre l'assiégeant à une étape de plus ; il propose de construire la muraille de la courtine en larges et grandes arcades comme les arceaux d'un pont, afin que le canon soit obligé de couper tous les piliers de ces arcades pour faire brèche, mais il ne peut être compté parmi les précurseurs des voûtes en décharge, ce genre de construction remontant, comme essai, à plusieurs années avant sa proposition. On barrait les rivières qui donnaient accès dans les ports au moyen de chaines en fer, moyen auquel on n'a pas encore, aujourd'hui, entièrement renoncé ; mais avec de l'habileté et l'audace un petit bateau parvenait à s'affranchir de cette entrave[236]. La Noue nous montre l'importance des progrès de la fortification au XVIe siècle quand il écrit : Je ne serai pas de l'opinion de ceux qui s'élèvent contre les nouveautés, car ils me font souvenir de plusieurs de nos pères qui se moquaient de tant d'inventions dont on se sert pour la fortification des plages et disaient que c'étaient inventions italiques[237] et qu'un bon gros rempart suffisait pour garantir les hommes de l'impétuosité du canon, sur lequel il le fallait défendre pique à pique. Et toutefois l'expérience noue a fait voir qu'alors les tilles se prenaient en huit jours, où à présent on consume quasi une saison tant il faut combattre de fois avant qu'on ait gagné un ravelin, puis le rœsti, en après le rempart, puis le retranchement. On construisait, en campagne, des ouvrages de fortification improvisés comme de nos jours. En 1549 les royalistes, arrivant à Châteauneuf (près Cognac), y fout rétablir une arche rompue et élèvent un ravelin (tête de pont) pour garantir l'autre extrémité du pont. Lm pionniers exécutent ce travail. Les soldats mettaient rarement la main à la terre : on voit pourtant, sur le champ de bataille d'Arques, les Suisses exécuter les retranchements qui ajoutent à la force de la position de Henri IV à raison d'un teston[238] par jour. Ces retranchements, le maréchal de Biron les trace lui-même, d'où l'on peut conclure que ce soin ne paraissait pas indigne de leurs fonctions aux chefs de guerre les plus haut placés. Quand on établissait un poste en rase campagne ; dans un vallon, on le couvrait. Ainsi, en 1569, près Saint-Yrier, deux régiments de pied, placés comme corps avancé, avaient pour défenses et gabionades (en cas qu'ils fussent assaillis) force palissades, haies en chastaigniers, qui sont communs en ce pays[239]. Les enginieurs[240] ou ingéniaires de ce temps étaient la plupart des constructeurs ou architectes étrangers, plutôt payés par vacations ou en raison de leurs travaux que par un traitement fixe annuel[241]. Ceux employés près des armées françaises sont si mal appointés que les chefs d'armée se croient parfois obligés de leur commander moins de choses que s'ils étaient mieux traités[242]. Cette exigüité de la position faite aux ingénieurs, dont Vauban, lui aussi, se plaindra plus tard en faveur du personnel placé sous ses ordres, frappe d'autant plus que la nouvelle méthode de fortifier, la méthode italienne, presque adoptée à la fin du XVIe siècle, était fort coûteuse et ne pouvait être pratiquée que par de puissants princes, au dire de La Noue. § XII. — ATTAQUE ET DÉFENSE DES PLACES. La ruse forme le procédé le plus habituel d'attaque, surtout quand il s'agit de petites places de guerre, de châteaux. Les exemples abondent et il semble utile d'en citer quelques-uns[243]. En 1562, le fort Sainte-Catherine, à Rouen, fut enlevé par escalade, en plein feue, escalade qui réussit et parce qu'elle eut lieu à la fois sur tous les côtés de l'enceinte, et parce que les officiers des troupes de la défense se trouvaient absents, ayant pris la mauvaise habitude, après avoir veillé durant la nuit, d'aller en ville pendant le jour pour se divertir. La même année, Gaspard de Tavannes, depuis maréchal de France, s'empare de Mâcon, en vue de l'armée protestante, en faisant avancer près d'une porte[244] de cette ville trois chariots chargés de gerbes de blé et conduits par des soldats déguisés en paysans : une maison voisine, sise à l'extérieur, est également occupée par les siens. A l'ouverture de la porte, un chariot pénètre sur le pont, s'y embarrasse à dessein, et les charretiers de se jeter sur les portiers et sur quelques habitants qui veulent les défendre au bout d'une demi-heure de lutte, la ville demeure aux assaillants. En 1570 les protestants reprennent sur les catholiques une tour servant de moulin et sise près de Salenas, sur la rivière de l'Ardèche, grâce au déguisement en femmes de quatre jeunes soldats qui se saisissent du pont-levis en feignant de décharger le blé porté par leurs ânes. En 1515, Puygaillard surprend Joigny dont il avait obtenu l'entrée sous prétexte d'y amener prisonniers des soldats pillards, à l'effet de les faire pendre dans cette ville pour l'exemple[245]. La tour remplie de sel, nommée Milamperle, près la petite cité de Martigny[246], cette tour bien flanquée et bien fossoyée, laquelle contenait trente soldats, fut surprise par des mousquetaires venus derrière des chariots de foin, et, les voyant prêts à ouvrir la sape, se rendit (1590). On pénétrait dans une place au moyen d'une échelle suspendue à une corde qu'un traitre attachait au haut du rempart, ou l'on attirait au dehors, dans une embuscade, le chef de la garnison d'un château sous le prétexte de lui faire protéger les habitants des environs, mais en réalité pour le tuer et se saisir, en son absence, de l'autorité. Le caractère général des sièges effectués eu France, pendant les guerres de religion, c'est qu'ils sont presque tous entrepris avec des ressources insuffisantes. Il existe néanmoins, pour l'attaque des places, des usages réguliers et pratiques. Quand on donne l'escalade, on a soin de le faire sur les côtés nom flanqués[247], là où les assiégeants ne disposent que de feux directs et inoffensifs par rapport au pied des murailles. Un contemporain[248] recommande de ne jamais battre sans voir le pied du mur, préférant que la contre-escarpe soit abattue avant qu'on cherche à encadrer l'escarpe ; il est encore plus dans la bonne voie et parle comme Vauban quand il dit : Plus on se précipite et plus de reculement, car cela signifie que l'art d'assiéger exige de la régularité, du sang-froid et de la patience. Montluc ajoute, avec raison, qu'il faut connaître cet art et y être entré par l'expérience et la vue pour réussir dans cette partie de la guerre : C'est, écrit-il, la chose la plus difficile et la plus importante ; plusieurs sont bons et grands capitaines qui s'y trouveront empêchés ; il faut avoir fort pratiqué cela, savoir que c'est des fortifications, remarquer et connaitre le défaut d'un bastion, d'on éperon, d'un flanc, deviner ce que peut être fait par dedans, par ce que vous-même feriez si vous étiez dedans[249]. Nous devons citer, en procédés réguliers, celui de pousser les tranchées[250] sur le terrain entre deux bastions au-delà des pointes de ces bastions, de se couvrir lestement alors au moyen des fascines appuyées contre des chandeliers[251] en bois et de gagner ainsi la contre-escarpe, ce mur opposé à l'escarpe et qui limite le fossé par un obstacle de plus, ou bien, encore, de parvenir jusque-là couverts par des saucisses[252] roulées devant eux comme aujourd'hui nos gabions farcis. Une fois au fossé, on exécutait un pont de bateaux sur les fossés pleins d'eau, en garnissant ce pont de rideaux en fascinés nommées blindes. Arrivé à l'escarpe, on établissait un logement pour vingt hommes, logement qui s'agrandissait rapidement et devenait un poste. Ces procédés inventés, ou mieux, appliqués dans les Pays-Bas, où la lutte était vive, paraissent connus et pratiqués en France pendant les guerres de religion, avec les différences inhérentes aux situations. Toutefois, comme il existe plus d'imprévu dans les guerres civiles, le calcul au moyen duquel on présumait la durée probable de la résistance[253], ce calcul se fait moins en France et nos guerriers lui accordent moins de confiance. En revanche, on suit les principes avec opiniâtreté et malgré les difficultés locales. En assiégeant, par exemple, le Havre, défendu par les Anglais (1563), on fait les tranchées dans un terrain de pierres et de gravois, sans avoir de terre, de gabions ou de fascines pour se couvrir, et ces tranchées, longues de huit cents pas, à peine protégées par des sacs de laine ou par du sable mouillé, sont, en outre, lavées par la marée ; on les pousse pourtant jusqu'au bout de la jetée des assiégés[254]. On exécute des mines creusées sous le sol afin de parvenir à l'insu de l'ennemi au-dessous des mitrailles et d'y placer des fourneaux remplis de poudre ; mais l'on prend soin de conduire ces mines de façon qu'elles ne soulèvent pas des amas de terre derrière lesquels les assiégés puissent se remparer et se poster avantageusement pour tirer. On choisit avec attention le meilleur emplacement pour faire brèche. Déjà, au siège d'Ivoy (1542), quatre canons ouvrent une brèche en cinq heures. Les batteries de brèche sont construites en couches alternatives de terre pressée et de fascines, et pour le faire, l'assiégeant va chercher des branchages fort loin si les alentours de la place ont été au préalable dévastés par les défenseurs, comme l'avaient fait en 1573 les habitants de La Rochelle. L'usage de s'opiniâtrer dans les travaux d'un siège et de les mener méthodiquement, n'empêche pas d'improviser parfois une attaque réelle et de prendre ainsi le défenseur au dépourvu. Ainsi, pour les mines dont il vient d'être question, nous voyons s'affranchir du travail pénible de les creuser à pas successifs en s'approchant d'une tour avec des mantelets, puis en formant au pied de cette tour des excavations capables de recevoir chacune un baril de poudre ; cela se passe au siège de Dreux, en 1593, et trois de ces excavations, préparées de la aorte, abattent une partie de la tour par leur explosion, tout en Causant de moindres dommages que la mine ordinaire[255]. Ainsi, on enfonçait les portes des villes et châteaux au moyen d'un pétard, invention nouvelle[256], qui s'accrochait contre les parois et les renversait ou les endommageait assez pour que l'on pût ensuite élargir à coups de hache l'ouverture produite. A la prise de Cahors, par Henri IV, en 1580, et à la prise du château de Semur par Tavannes, en 1589, le pétard joue son rôle. Ainsi, on brusquait parfois les attaques. En 1563, le duc de Guise enleva de la sorte le faubourg du Porteront à Orléans, au moyen de son infanterie qui, précédée de quatre environnes, renversa les barricades pour chasser devant elle les protestants et faillit même atteindre les portes de la ville assez à temps pour y pénétrer avec les fuyards[257]. Une fois introduit dans la place, s'il y a guerre de rues, l'assaillant se couvre souvent tour avancer dans ses cheminements de manteaux en bois de chêne épais d'un demi-pied, longs de quatorze coudées (6 mèt. 30 cent.), larges de cinq (2 mèt. 25 cent.) assis au milieu, sur deux roues en pente du devant, aptes à pousser et conduire ces deux côtés, percés de trois ou quatre visières (meurtrières) à chaque bout[258]. Les travaux nombreux et rudes qu'exige un siège s'exécutaient, soit au moyen de pionniers[259] enrôlés, soit au moyen de soldats que l'on déterminait à se livrer à ce genre de travail pour un salaire. Il parait que dans la seconde moitié du XVIe siècle l'on faisait cas des pionniers, et cela se comprend puisque la tactique consistait[260] souvent à contraindre l'adversaire à se consumer au siège d'une ville. Certains chefs préféraient pourtant le concours des lansquenets, obtenu par quelque argent ceux concédé, et ceux qui sont de cet avis assurent que les lansquenets faisaient plus d'ouvrage que les pionniers, tout en ne coûtant que les jours où ils maniaient la pelle et la pioche[261]. Dans la défense des places, la conduite des défenseurs dépend de celle des assaillants et ne peut se brusquer ; c'est une œuvre de patience et de vigilance. Les ruses y sont, à cette époque, d'un moindre emploi que dans l'attaque, mais l'on s'y montre ingénieux. On propose, par exemple, de placer des tas de pierres sur le bord de la contre-escarpe et de tirer des boulets parmi ces pierres de façon à en projeter les éclats au milieu des assaillants[262]. Au sujet de ces pierres, nous rappellerons que la fronde s'emploie encore pour la défense des remparts comme cela se voit en 1557 au siège de Cony[263]. L'envoi de billets lancés du dehors, au moyen de flèches, sert pour avertir des progrès des assiégeants ; il est vrai que celui qui les lance s'expose à être pendu par l'ennemi[264]. On renouvelle le procédé des anciens pour éventer les lequel procédé consiste à placer l'oreille sur le sol ou à considérer la surface d'un vase plein d'eau[265] pour pesée-voir le moindre ébranlement imprimé à la terre par les coupa de pioche. Quand l'assiégeant a fait brèche, on s'empresse de la réparer. Au siège de Poitiers (le 10 août 1569) l'artillerie des protestants venait d'ouvrir dans l'enceinte une trouée assez grande pour que l'on pût commodément donner l'assaut. Alors rapporte Davila le duc de Guise, s'employant lui même et portant la hotte sur son dos, fut cause qu'à son exemple hommes et femmes mirent tous la main à cette besogne, de manière qu'en peu de temps ils firent un rempart esses haut, mais beaucoup plus fort et plus solide que le premier[266]. On ne se borne pas à réparer les brèches, on élève
derrière un autre parapet, un retranchement nouveau. Ecoutez Vincent Carloix[267] retraçant les
péripéties du siège de Saint-Jean-d'Angély en celle même année 1569 : Monsieur le maréchal fait en toute diligence les approches
et tranchées, et placer huit canons devant lapone d'Aulnis, qui fut si
furieusement battue un jour entier
[268] que la brèche était grande et raisonnable, mais toute la
nuit ceux de dedans travaillèrent si ardemment jusques aux femmes[269], dedans le tond du fossé, avec l'industrie d'un ingénieur
qu'ils y firent une muraille sèche des pierres que le canon avait abattues,
avec d'autres matières, que la brèche fut tout aussitôt remparée et mise en
un tel état de défense qu'elle ne fut point assaillie ; aussi que, entre
autres moyens, ils tirèrent une tranchée derrière la brèche flanquée
bien è propos, et sur icelle dressèrent des barricades pour couvrir leurs
arquebusiers ; et l'accommodèrent de telle façon qu'ils l'estimaient plus
forte qu'auparavant. Si la réparation de la brèche ou sa fermeture en arrière n'étaient pas possibles, on la défendait avec une bravoure que secondaient divers accessoires, les feux de mousqueterie et d'artillerie, les pierres, voire, même les huiles bouillantes projetées sur l'assaillant. Cette même relation du siège de Saint-Jean-d'Angély nous prouve que la coutume n'était pas que les défenseurs, même aux abois, fissent eux-mêmes la proposition de capituler. En racontant, en effet, que le maréchal de Vieilleville, chef de l'armée royale, envoya sommer le capitaine Clermont de Piles de se rendre, elle ajoute[270] que Piles fut très-aise de cette sommation, car il eût été reprochable d'entamer le premier les propos. Piles se soumit à la sommation, mais la population avait déjà voulu le contraindre à capituler ; il obtint dix jours de trêve, promettant de se rendre à leur expiration si aucun secours ne lui parvenait dans l'intervalle, et, comme un parti de quarante chevaux réussit à le rejoindre, il prolongea sa défense de vingt-six jours. Pour bien défendre les places, il faut de bons ingénieurs, entendus, expérimentés : c'est ce qui manquait assez souvent durant les guerres de religion, surtout aux protestants. Coligny s'en aperçut quand il se fut jeté un peu à l'aventure dans Saint-Quentin, qu'il fut enfin obligé de rendre en se constituant prisonnier. L'ingénieur qui le secondait n'était pas fort entendu dans son métier, a avoue son biographe[271]. Cette infériorité des ingénieurs militaires, alors peu payés, comme nous l'avons précédemment indiqué[272], caractérise les guerres de religion, luttes de coups de main et d'escarmouches, où chaque chef faisait le soldat plus que le général, où l'on agissait plus que l'on ne réfléchissait. Elle se constate encore dans les premières années du XVIIe siècle, et, au dire de Tallemant des Réaux, en 1621, au siège de Saint-Jean-d'Angély, personne ne savait comment on faisait les tranchées[273]. Faut-il s'étonner de cette ignorance quand le connétable de Luynes, mort à la Rn de la même année, disait qu'au retour de la guerre contre les Huguenots, il apprendrait l'art militaire de la guerre[274]. § XIII. — DISCIPLINE. L'indiscipline des armées, pendant les guerres de religion, est un fait notoire et qui ne doit pas étonner ; les guerres civiles sont en effet propices à tous les genres de désordre, car les liens sociaux se reliaient dès qu'elles surgissent, et dans ce relâchement général, ceux qui possèdent la force en main subissent trop de tentations pour ne pas se laisser entraîner. Des deux côtés l'indiscipline fut, grande ; La Noue, qui compte dans le parti protestant, l'avoue pour les siens[275] ; Castelnau, l'un des catholiques, ne le cèle pas pour les soldats du roi[276] que Claude Haton, royaliste et prêtre, appelle souvent et franchement canailles de soldats (3)[277]. Il n'y a, sous ce rapport, aucune excuse à présenter, car c'est une simple constatation des malheurs du siècle que de répondre comme le capitaine de Chambar aux plaintes adressées contre ses soldats : C'est la guerre, et par temps de guerre II ne faut réclamer, ni avoir recours à justice[278]. Le grand but de l'indiscipline, c'était moins de désobéir et d'échapper à un frein que de piller pour bien vivre et s'enrichir[279]. Peut-on en douter quand on voit les soldats diriger leurs coups et leur avidité contre les habitons plus que contre les ennemis avec lesquels ils viennent pourtant de combattre et qui leur ont disputé la victoire ? En Normandie, rapporte Castelnau à la date de 1563, les catholiques ne faisaient pas moins de mal que les Anglais et les Huguenots ; de sorte qu'il ne se trouvait rien par les villages ni par les maisons, qui ne fût caché et retiré dedans des carrières longues et profondes qu'ils ont en ce pays-là. Et La Noue écrit : A la prise de Boisgency... nos troupes exercèrent plus de cruauté[280] et pillerie sur ceux de la religion habitants d'icelle, qui n'avaient pu sortir que contre les soldats catholiques qui la défendaient. Les mercenaires étrangers se montraient plus indisciplinés, c'est-à-dire plus pillards encore que les soldats nationaux ; les reîtres surtout, qu'ils fussent an service des catholiques ou des protestants, les reliera, ces chiens fous, comme les appelle Claude Haton, miroir fidèle des impressions populaires. Les reîtres, écrit ce chroniqueur, où ils se logeaient, ne faisaient que chercher et fouiller en terre es-logis, jardins, cours, fumiers, pour trouver butin, et tout ce qu'ils trouvaient de caché et non caché était à eux et n'y avait personne qui y pût donner ordre on qui voulût. Souvent ils mettaient le feu aux maisons et tuaient et massacraient toutes personnes qui leur résistaient[281]. Relativement à l'indiscipline des Allemands, rappelons qu'ils se montraient tels à peu prés partout et que Charles-Quint avait eu fortement à s'en plaindre dans ses armées, où ils s'étaient montrés ..... désobéissants, arrogants, enclins à l'ivrognerie.... incapables de rien faire de bon... les pires soldats qu'on puisse avoir[282]. Ajoutons pourtant que les soldats français n'oubliaient pas de jouer des mains dans cette dévastation générale. Quand La Noue parle de la naissance de Mademoiselle la Picorée, il cite le régiment de M. d'Ivoy, qui estait tout de Français, s'escrimant encore mieux que les autres[283]. Strada nous signale les soldats français victimes de leur empressement à s'enrichir et à piller après les redditions de Cimay et de Nivelle, en Flandre[284]. Le plus triste à dire, c'est que les officiers pillaient encore plus que les Soldats, sans doute parce qu'ils participaient du caractère de Brantôme, c'est-à-dire étaient aussi indifférents sur le bien que sur le mal. L'ordonnance rendue à Saint-Germain-en-Laye le 1er février 1574, et qui porte règlement sur la solde de l'armée, dit en termes précis que les officiers des compagnies d'ordonnance ont commis autant ou plus de pilleries sur les sujets du roi de France que les étrangers et vagabonds. Peut-on s'étonner, après cet aveu officiel qu'un contemporain, le chancelier Michel de l'Hospital, ait composé une épître latine[285] sur l'impuissance des lois pendant la guerre. Outre le pillage qui dispersait une armée et la réduisait
à rien durant plusieurs jours[286], ou bien encore
retardait les régiments dans leur marche[287], il se produisait
parfois des négligences de service et des mutineries parmi les troupes.
Mayenne l'éprouve sous Paris de la part des Allemands qui, dès 1589, menacent
de passer dans le camp du roi s'ils ne reçoivent leur paie et ne trouvent
leurs commodités[288], et en 1590,
après d'étranges désordres dans Paris,
commencent à se mutiner et à se débander malgré les efforts de plusieurs
chefs de la Ligue pour les retenir dans quelque
sorte de discipline[289]. Les Allemands
attachés au parti protestant se conduisent aussi mal ; Davila nous les
dépeint à la date de 1587 se logeant tous au large,
ne débordant après le butin, étant nonchalante à faire la garde, quittant
leurs rangs dans les pays de vignes pour cueillir le raisin dont ils étaient avides...
à vrai dire fort mal conduite et taches observateurs
de la discipline des armes. Les officiera agissaient d'eux-mêmes sans se plier aux intentions du chef de l'armée. — En 1569 un capitaine de chevau-légers, nommé La Rivière, ou pour le butin ou pour autre chose, délibéra de s'aller saisir de la maison de Jarnac qui était pleine de meubles, s'aventurant à 28 kilomètres du camp royaliste pour aller à 6 kilomètres du camp des protestants, n'ayant avec lui que 60 cavaliers, le tout sans ordre. Il fut promptement assailli, ne songea même à donner avertissement de sa situation critique, et finalement fut pris[290]. — Au siège de Montbart (1590), des capitaines du régiment de Champagne abandonnèrent les lansquenets qu'ils avalent mission de diriger dans l'exécution d'une brèche à la sape[291]. On rencontre parfois, dans les mémoires du temps, des exemples de répression, mais ils sont rares. Ainsi, en 1569, au siège de La Rochelle, un capitaine de l'armée royale est pendu pour avoir été trouvé jouant aux cartes pendant que sa compagnie montait la garde. Ainsi, le duc de Mayenne, en 1576, fait faire main-basse par sa cavalerie sur quelques compagnies d'infanterie qui, rebutées par le mauvais temps, avaient refusé de suivre l'armée dans sa marche. Ainsi Guillaume de Tavannes, l'année 1591, prescrit de ranger en ordre un régiment de gens de pied qui avait ravi deux coupables au prévôt, réussit à reconnaître ces coupables et les fait exécuter. Les exemples de sévérité étaient pourtant nécessaires. Ecoutez plutôt ce cri échappé en 1573 à un contemporain : Si la gendarmerie tant de pied que de cheval, n'est autrement réglée qu'on la voit aujourd'hui et surtout n'est réformée à la romaine pour la plupart, nous serons visités de plus de malheurs que nous n'avons encor été[292]. Ce qui prouve combien tes répressions se produisaient peu fréquemment, cannas les plaintes exprimées le 17 mars 1593 au duc de Mayenne par les Etats-Généraux de la Ligue séant à Paris, et cela en ces termes : Plusieurs se plaignent des rançonnements, dépopulations et extorsions qui se commettent par les gens de guerre, tant de la suite des armées que des garnisons ; sans respect aucun des lieux saints, de lige et sexe ni de parti, étant les catholiques aussi maltraités que les ennemis. Sur quoi l'assemblée a pensé être de son devoir vous supplier humblement interposer votre autorité contre telles personnes... et pareillement de pouvoir aux insolences des gens de guerre des armées et garnisons2[293]. Ces plaintes, on en retrouve la substance dans les articles délibérés par les villes pour être remis auxdits Etats-Généraux par les députés qu'elles y envoyaient ; ces articles divers réclament qu'il soit ordonné aux gouverneurs des provinces de faire vivre un chacun selon les lois de la discipline militaire. § XIV. — ADMINISTRATION. L'administration des armées était encore peu perfectionnée au commencement du XVIe siècle, sous le règne de François Ier : Bardin prétend qu'elle ne s'exerçait pas alors à part et par des fonctionnaires spéciaux ; il y avait pourtant des commissaires des guerres depuis 1556, mais sans grande autorité. C'est l'année 1567 qui ouvre une ère nouvelle sous le rapport administratif, et elle appartient aux guerres de religion. En cette année, par une ordonnance du 15 décembre, Charles
IX crée cinquante offices de commissaires des guerres, lesquels deviennent
les délégués et les représentants directs du ministre ; ces commissaires
reçoivent charge d'appliquer les ordonnances relatives aux monstres ou revues dont la première remonte à 1517.
En signalant l'indépendance de ces agents administratifs par rapport au
commandement, nous voulons parler de leur indépendance entière, car, quant à
l'argent, c'étaient déjà des payeurs spéciaux qui le remettaient aux
soldats : Je fus dans Limoges en vingt-neuf
jours, écrit Blaise de Montluc[294], comptant du trentième de septembre que j'écrivois des
lettres, avec mil ou douze cent chevaux et trente enseignes de gens de pied,
auxquelles je fis faire monstre, et aux gens d'armes quelque prest, ayant
pour cet effet amené avec moy le sieur de Gourgues, général des finances. car
je n'avois pas accoustumé toucher aux deniers du Roi. La nécessité le stimulant, Coligny avait introduit dans les armées de son parti une administration vigilante qui cherchait à pourvoir avec économie les combattants des objets dont ils avaient besoin. Il disait comme plus tard le grand Frédéric, qu'il fallait commencer à former une armée par le ventre, et il attachait un boulanger à chaque cornette logeant isolement : l'armée bien nourrie, bien dotée par des commissaires de son choix, munis de chariots et de bises de somme pour effectuer leurs transports, il la jugeait apte à combattre. Malgré ses efforts les armées protestantes souffrirent beaucoup. L'ordre introduit ou tenté par Coligny ne semble pas uvale existé au même degré dans les armées royales, puisque le conseil du roi s'étonne de voir les Huguenots réussir à entretenir aussi longtemps leur armée[295]. En tout cas le difficile a cette époque consistait à fabriquer le pain d'avance, fabrication qui eût été si utile pour rendre les troupes plus mobiles, et ôtait tout prétexte au vol pour les soldats qui répugnaient à moudre les grains distribués[296]. Quand l'armée de Monsieur, raconte Guillaume de Tavannes[297], eut passé Limoges ; les capitaines furent d'avis de suivre les ennemis le plus diligemment que faire se pourroit, et demandèrent de porter avec eux du pain pour un jour, afin que, s'ils trouvaient les ennemis en lieu si avantageux que promptement l'on les pût combattre ils eussent quelque temps pour en chercher les moyens... mais il se fut possible d'en être secourus, encore que, outre les commissaires ordinaires des vivres, plusieurs autres de la suite de la reine-mère s'en meslassent. Il s'agit évidemment ici de pain porté sur le dos des gens de pied, quoique l'on mit défia des moyens de transport : ainsi le duc d'Alençon, frère du roi, possédait un équipage, voire même un capitaine de mulets. Le grand malheur du temps, l'indiscipline paralysa les mesures administratives qui commençaient à surgir, en amenant la dévastation, et surtout la méfiance des cultivateurs. Les magasins de l'Etat ne purent dorénavant se remplir et quand il s'agissait d'une expédition nouvelle, ceux qui la proposaient offraient au gouvernement de lui prêter pour les premiers frais qu'elle entraînerait[298]. Montluc nous cite l'exemple de la ville de Toulouse fidèle au catholicisme, fit une fois une honnêteté à ses soldats en leur octroyant une petite paye[299] au moment où il partait en expédition conne les protestants de Montauban ; c'est là un fait exceptionnel. En général, villes et habitants cachaient leur argent aux troupes, et, comme l'Etat était pauvre, celles-ci recevaient maigre paye. Ainsi, en septembre 1569, le roi fait délivrer quelque argent à son infanterie, avec promesse de plus grande paye dans peu de temps[300]. Voilà pour les catholiques. Chez les protestante, en dépit de la saisie des caisses royales, en dépit également de l'impôt établi sur les gens de leur parti de toutes qualités, tant des villes que villages, nobles, prêtres, marchands, bourgeois et artisans[301], afin de solder les retires, la pauvreté générale restait toujours fort grande et l'on ne payait les troupes que grau à des expédients[302]. Cette pauvreté devint telle qu'en 1593 les Etats généraux réunis par les Ligueurs pour créer un roi, ne disposaient pas d'un denier[303]. Tous les mémoires du temps constatent cette situation factieuse gai aggravait l'indiscipline, en excitant le soldat à prendre de force sa nourriture, et l'indiscipline à son tour réagissait sur cette situation comte déplorable autour duquel se déroulaient les événements de mite époque et qui ne devait avoir fin que sous la main ferme d'un monarque éclairé, Henri IV, et sous la direction vigilante d'un ministre habile, Sully. Faute de paiement les capitaines demandaient à pouvoir se retirer en congé dans leurs maisons, elles soldats se débandaient ; il arriva ainsi parfois que l'infanterie se réduisit à moitié et la cavalerie au tiers[304]. Faute d'argent envoyé de Paris, les chefs catholiques se voyaient obligés de payer leurs soldats avec des deniers levés d'urgence l'épée à la main[305], et le plus souvent cette ressource extrême ne fournissait pas suffisamment. La Cour, en noyant ses revenus diminuer, n'avait pas eu lu
sagesse de limiter ses dépenses : le luxe, les folies y continuaient comme en
des temps plus prospères. On dansait au lieu de payer quand justement le
retard dans les paiements militaires entrainait de nouvelles dépenses, eu
prolongeant le séjour des soldats étrangers au-delà du temps nécessaire aux
opérations[306].
La royauté s'attire ainsi cette plainte du maréchal de Tavannes : Vous estes des sots, vous dépensez vostre argent en
festins, en pompes et masques, et ne payez gens d'armes ni soldats ; les
estrangers vous battront[307] ; mais cette
rude apostrophe fut promptement oubliée et les prodigalités du monarque continuèrent
à tarir les finances qui eussent pu contenter les gens de guerre. Il restait donc peu d'écus pour distribuer la paye et bien des chefs trouvaient encore moyen d'amoindrir cette portion en en dérobant une fraction à leur profit : Le roi Henri III, dit Jean de Tavannes, dans la Vie de son père, permettoit la vente des capitaineries ; j'ai su proposer d'en acheter huit ou dix pour faire un parti dans son Etat. Les acheteurs semblent, sans charge de conscience, pouvoir dérober les payes des soldats, et exiger sur le peuple et sur les marchands, pour retirer l'intérêt de leur argent ; et les officiers de judicature, des finances, par là se licencient et se corrompent. Le témoignage est formel. Plus tard (en 1576) les États généraux convoqués par Henri III, lui refusaient des subsides, tout en le poussant à la guerre contre les protestants, inconséquence qui devait prolonger le mal. Si le gouvernement eût réussi à extirper des abus aussi criants, à fonder un trésor et à assurer, de la sorte, la régularité de la paye donnée aux gens de guerre, le pillage cessait et peu à peu la discipline renaissait : on peut le conclure des meilleures dispositions montrées en 1580, devant La Fère qu'elles assiégeaient, par les troupes du maréchal de Matignon, alors que ce chef avait réussi à les faire solder de mois en mois et à leur faire amener des vivres en abondance, sous la condition par exemple que le premier soldat pris dérobant quelque objet aux paysans, serait pendu sans délai[308]. § XV. — INFLUENCE DES CHEFS DE GUERRE. Les guerres civiles ont leurs difficultés : dominé par les intérêts de parti, les questions d'argent, la présence des volontaires, on s'y trouve moins maitre d'agir à son gré, en vue du succès des armes. Sous ce rapport elles font honneur aux chefs qui les ont dirigées Ces chefs, remarquons-le, paient cher ledit honneur dans la période qui nous occupe, car presque tous périssent de mort violente[309]. Sur neuf, quatre succombent en plein champ de bataille, et cinq tombent assassinés. Les quatre premiers sont le roi Antoine de Navarre tué au siège de Rouen (1562), le maréchal de Saint-André tué la même année à la bataille de Dreux, le connétable Anne de Montmorency tué à la bataille de Saint-Denis (1567), le prince Louis de Condé tué à la bataille de Jarnac (1569) : encore attribue-t-on souvent la mort de ce dernier à un assassinat commis sur sa personne dès la fin de l'action par Montesquiou. Voici les noms des cinq chefs assassinés : François de Guise[310], assassiné devant Orléans par Poltrot de Méré (1563) ; Coligny assassiné à la Saint-Barthélemy (1572) ; Henri de Guise, dit le Balafré, assassiné à Blois, par ordre de Henri III (1588) ; Henri III, assassiné par Jacques Clément sous les murs de Paris (1589) ; Henri IV, assassiné par Ravaillac dans Paris même (1610). Parmi les chefs d'armée de premier ordre[311] qui figurent en France dans les guerres de religion, Tavannes seul fait exception ; il ne mourut ni assassiné, ni tué par le feu de l'ennemi, il succomba dans son château[312], au milieu de ses enfants. Tavannes fut le plus habile des généraux catholiques, car son émule François de Guise[313] appartient à peine aux guerres civiles par la date de son trépas. Caractère original[314], brusque dans ses allures, âpre dans ses réponses, sentant son mérite et orgueilleux ou plutôt entier dans ses avis par cela même, Tavannes fut le guide du duc d'Anjou[315], et le véritable vainqueur de Jarnac et de Moncontour. Gale vit bien quand il se retira après la levée du siège de Poitiers qui suivit cette dernière bataille ; les affaires périclitèrent maigre. la présence de Charles IX à l'armée. Ses mesures prouvent qu'il comprenait la guerre. Il possédait tellement l'entente des opérations que, suivant la relation de sa vie par son fils Jean, il annonça quinze jours à l'avance le combat de Jarnac. Son œil savait aussi embrasser le champ de bataille : Monseigneur, dit-il au duc d'Anjou avant l'action de Moncontour, ils sont à vous, je les ai reconnus estonnés. Il tenait à ce qu'une fois les dispositions prescrites, personne ne s'en écartât par fougue ou tout autre motif, disant qu'il ne fallait chercher de l'honneur particulier aux dépens de l'intérêt de l'armée entière, faute encore commise et qui atteste un vestige des usages de la féodalité. Il se sentait gêné en guerre par l'obligation de gouverner un prince héritier du trône, et son fils retrace sa gêne en homme qui l'a éprouvée lui-même[316] : cette gêne alla si loin que François de Guise, en 1542, au siège d'Ivoy, le provoqua parce qu'il faisait conduire par le duc d'Orléans, en un lieu propice pour faire brèche ; 4 pièces d'artillerie, acte que lui, de Guise, blâmait et qui pourtant réussit et amena la reddition de la place. Cette gêne d'avoir à conduire à la fois la guerre et un jeune prince, beaucoup de généraux s'en sont plaints. Le maréchal de Tavannes se montrait l'adversaire déclaré de l'intervention des femmes dans le gouvernement, les disant irrésolues, indiscrètes, de légère créance et vindicatives. Cette opinion[317] il ne sut pas la celer vis-à-vis de Catherine de Médicis, et la blessa sous ce rapport par ses actes et par ses paroles. Comme homme de cour, Tavannes, on le voit, péchait par trop de franchise. Montmorency, le connétable aux patenôtres[318], était un ignorant dans la guerre ; l'appréciation appartient à François Ier[319] et l'histoire doit la conserver. Il fut battu le Saint-Quentin et à Saint-Denis, il resta prisonnier à la bataille de Dreux, il ne prit le Havre que parce qu'il parut devant cette place au moment où sa chute retrouvait préparée et assurée : sans vouloir condamner sa mémoire parce que le succès lui manqua, il faut mentionner ses mésaventures comme chef parce que, jointes au propos du roi-chevalier qui le connaissait bien, ayant été élevé avec lui, elles corroborent fine opinion émise fort avant qu'elles n'arrivassent. Sa méthode de ravager la Provence pour garantir la France des progrès d'une invasion commencée, méthode antérieure aux événements dont nous venons de parler, n'accuse pas de sa part une grande confiance dans son épée. J'ajouterai n'avoir lu son éloge au point de vue militaire dans aucun livre. Mais sa mort fut belle et digne d'un soldat, alors que blessé sans remède sur. le champ de bataille de Saint-Denis, il dit à un gentilhomme placé à ses côtés : Mon cousin de Sansay, ma mort est fort heureuse, je n'eusse su périr ni m'enterrer en un plus beau cimetière que celui-ci. Nous ne dirons qu'un mot du maréchal de Saint-André et des deux ducs de Guise. Le maréchal de Saint-André tué, assure-t-on, à la bataille de Dreux, par un gentilhomme dont il avait fait confisquer les biens pouf les acheter à vil prix, suivant son défaut invétéré[320], le maréchal de Saint-André, disons-nous, vaut mieux, militairement parlant, que le connétable, et sa devise : Nodos virtute resolvo, n'est pas trop menteuse. On a prétendu de François de Guise que c'était un bras plutôt qu'une tête, voulant par là marquer sa dépendance des autres[321]. Et pourtant quels titres de gloire d'avoir défendu Metz contre Charles-Quint, d'avoir conquis Calais et Thionville, d'avoir vaincu à Dreux[322] ! Quelle tranquillité d'âme pour dormir à merveille le soir de cette bataille couché dans le même lit que le prince de Condé son prisonnier qui ne put fermer l'œil ! François de Guise porte une des plus grandes figures guerrières de ce temps[323]. Son fils, le Balafré, devint le chef de la Ligue, mais, sauf sa belle défense de Poitiers (1569) et son succès dans le combat de Château-Thierry (1575), il a tenu l'épée moins souvent et moins ferme que lui. Si l'éloge du connétable de Montmorency comme chef de
guerre est rare, celui de Coligny est
fréquent. Tout le monde s'accorde à dire que ce fut un général habile, mais
malheureux. Par son habileté, sa prudence, son courage calme, son
inflexibilité de résolution, ses mesures administratives, il sut se
maintenir, en maintenant militairement son parti[324] et tirer ainsi
d'un rôle ingrat tout ce qui était possible. On peut lui appliquer cette
opinion du général de Chambray[325] : Les hommes les plus extraordinaires parmi les chefs de
parti sont sans contredit, ceux qui ont créé leur parti, surtout depuis
l'invention de la poudre, parer que le matériel de guerre se trouvant entre
les mains dos gouvernements, il leur devient très-difficile de s'en procurer. Coligny fut avant tout un administrateur militaire[326], et il le fut à tua degré que ne connurent pas les catholiques, au moins jusqu'a la mort de Henri III, en 1589. S'il eut conservé la foi de ses pères, ses talents, joints à ceux de Tavannes, eussent assuré plus III et plus solidement le triomphe de la royauté. Ce fut aussi un homme de guerre. Les écrivains catholiques, ses adversaires, le reconnaissent[327]. Il faut confesser que Coligny était capitaine, dit Jean de Tavannes. Le colonel de Carrion-Nisas émet l'avis qu'on peut le regarder comme le véritable chef de la première école de l'art moderne[328] : les princes de Nassau[329], dont Turenne devint l'élève, le reconnaissent en effet pour leur maitre, et Turenne est la plus complète personnification de l'art militaire moderne avant 1789 ; tel est le sens que je donnerais à cet avis. Après cette opinion formelle le même auteur ajoute sur Coligny : Général constamment malheureux, sa gloire s'accroissait par ses défaites comme celle des autres par leurs triomphes ; sa gloire et son malheur tenaient également au genre de guerre qu'il faisait, la guerre civile, où le gouvernement établi a tant d'avantages, que le mérite de celui qui résiste à sa puissance, doit être un mérite vraiment extraordinaire s'il parvient à soutenir quelque temps la guerre. Coligny la recommença souvent, presque toujours vaincu, mais ne cessant jamais d'inspirer de la confiance à ses amis, de l'estime à ses ennemis, opiniâtre, inaccessible au découragement. Relativement à ces dernières qualités, nous rappellerons que le lendemain de la bataille de Dreux — il venait de la perdre — il voulait renouveler l'action[330], mais les reîtres s'y refusèrent à défaut il conserva son armée, et parut plus fort après sa défaite, ce qui lui arriva plus d'une fois[331] dans sa carrière d'homme de guerre[332]. Ce fut un chef entendant à certains égards la politique. Castelnau certifie qu'il l'a toujours connu sage et modeste en toutes ses actions[333], mais on reconnaît surtout son instinct politique en le Noyant chercher à entrainer Charles IX dans une guerre an milieu des Pays-lias afin d'éviter le renouvellement de la guerre civile. Le prince de Condé demeura pendant sept ans[334] le chef du parti protestant. Fait prisonnier à Dreux, sans succès Saint-Denis, vaincu et tué à Jarnac, il ne peut passer ni pour un général heureux, ni pour un chef habile, mais il était doué d'énergie et de courage, et dirigea nettement la résistance à l'autorité royale de la noblesse provinciale dont il s'était fait le guide et qui l'avait choisi pour son représentant. Coligny, par son calme, son entente de l'administration et sa persévérance, exerça une influence sur les guerres de religion ; Henri de Navarre, depuis le roi de France Henri IV, en exerça une plus grande encore. Les événements prouvent ce dire jusqu'a l'évidence. Les affaires royales allaient mal : à peine paraît-il, joint-il les troupes catholiques qu'elles se relèvent, et elles se relèvent encore plus quand, après la mort de Henri Ill, il les dirige seul. Ce n'est pas le moment de retracer dans toute leur étendue ses talents militaires, mais, pour compléter cette esquisse sur les chefs qui ont pris part aux guerres de religion, nous devons dire en quoi il se distingue comme guerrier. Il unit la conception à l'exécution. Son grand dessein contre la maison d'Autriche montre comment il conçoit un ensemble d'opérations, une campagne ; disons en outre qu'il sait attendre, mater sur la défensive, préparer ses éléments de succès et notamment une réserve. Quand il croit l'instant favorable il parait et saisit l'occasion ; dans l'offensive, l'épée en main, son courage se déploie, et, cédant à la fougue française, trop souvent en soldat[335], il montre à ses troupes culminées le chemin de l'honneur. S'il possède encore des qualités chevaleresques, il voit clair dans l'avenir et devance son époque par un emploi plus fréquent et plus large de l'infanterie, par des dispositions propices pour assurer l'effet de ses feux, et surtout par ce talent rare et précieux d'approprier ses combinaisons de troupe aux accidents du champ de bataille ; sa variété d'arrangements à ce sujet est telle, on a po l'énoncer, qu'il est peu de dispositions militaires dont ses campagnes n'offrent le germe[336]. § XVI. — PARTICULARITÉS ET INTENTIONS. D'aussi longues guerres offrent évidemment diverses particularités. Voici les plus curieuses parmi celles que nous avons pu noter. La dureté dans ta manière de faire la guerre. — Cette dureté se trouve dans la résolution réciproque de ne pas s'épargner. Un écrivain dit que tee guerriers de ce temps, après avoir vécu ensemble durant les trêves : se baillaient la main et l'accolade au départ ; le frire disant à son frère, Fonde au neveu, le cousin au cousin que, s'ils se rencontraient le lendemain, l'un n'épargnerait pas l'autre[337]. Cette dureté se retrouve dans les cruautés commises par plusieurs chefs, et notamment par le baron des Adrets. On avait, du reste, l'instinct féroce. L'acte de ce jeune seigneur qui met un pendu à sa place dans le lit d'une dame dont il a obtenu rendez-vous[338], et le fait d'envoyer à un chef ennemi une lettre pestiférée[339], en fournissent la preuve. Celui qui reçoit cette lettre dit pourtant en ses mémoires que, se cacher au milieu d'une armée pour y tuer tel ou tel ennemi signalé, mérite gloire et récompense, propos qui atteste l'acharnement amené par une longue guerre civile[340]. Le courage. — En ces temps de relâchement général, le courage se maintenait, et l'on peut appliquer à la durée totale des guerres de religion ce propos de Castelnau[341], au sujet du siège du Havre (1563) : même les plus frisés de la Cour, désarmés, méprisant tout péril, se trouvaient souvent aux tranchées. Non-seulement il y avait du courage, mais la témérité se montrait souvent encore comme au temps de la chevalerie ; en 1590, près de Nuits, en Bourgogne, le marquis de Mirebeau, qui commande les coureurs de Guillaume de Tavannes, s'avance tellement sans attendre les troupes, que les adversaires voltent de Beaune et lui tuent deux gentilshommes à coups de lance, justement lorsque le rôle des coureurs consiste à s'approcher, à voir, puis à se retirer. Institutions. — Les idées d'un avancement plus équitablement réparti se font jour. Jean de Tavannes énonce que les charges de guerres regardent autant le Tiers-Etat que les gentilshommes, et qu'il n'en faut exclure les soldats : autrement ni ceux des villes, ni ceux des champs ne travailleroient que pour le butin et s'en isolent quand ils l'auraient gagné[342]. — En 1569, Coligny distribue des chaînes d'or instituées comme récompense militaire par la reine de Navarre[343]. — Les contemporains entrevoient la nécessité de créer une école militaire. La Noue réclame, des boutiques d'où se tireraient les capitaines d'infanterie[344]. Le chancelier de l'Hospital recommande de mêler l'étude aux exercices militaires pour mieux tourner contre l'ennemi ses propres stratagèmes et s'élancer au besoin dans le fort du danger[345]. Jean de Tavannes propose de réunir pour les habituer aux mêmes exercices trente jeunes gentilshommes de seize à vingt ans, et comme il dit ailleurs que la lecture sert aux jeunes capitaines et supplée leur peu d'expérience, il est probable qu'il entendait comprendre les lettres et les sciences parmi les exercices constituant leur enseignement. — Il n'existait alors expressément que quatre charges de maréchal de France, puisque, en délivrant à Gaspard de Tavannes ses lettres de nomination de maréchal (16 février 1571), le roi dit a b la charge expresse que ledit étal de maréchal de France demeurera supprimé, et le supprimons dès maintenant, après le décès dudit sieur de Tavannes, ou après l'avoir pourvu de l'un des quatre états de maréchal de France, si aucun vient à vaquer durant sa vie[346]. Inventions. — L'esprit de découverte se porte principalement sur les applications de la poudre. On imagine un ressort d'horloge qui se déroule en un certain nombre d'heures, et, attaché à une pièce d'artifice, y met le feu ces artifices sont destinés à incendier les magasins dans l'intérieur desquels on les jette[347]. Le pétard dont nous avons déjà parlé[348], et qui sert à enfoncer les portes de ville, parut à cette époque. Il consistait en un petit mortier tronc-conique, chargé d'une quantité de poudre proportionnée à l'effet que l'on voulait produire[349], et enchâssé dans un épais carré de bois ; ce plateau, consolidé par des croisillons en fer, portait sur un de ses côtés un crochet au moyen duquel on l'appliquait contre la porte à rompre ; il suffisait pour cela d'enfoncer rapidement dans la porte un clou assez fort pour en supporter le poids. En se retirant, le courageux soldat chargé de cette mission, mettait le feu à une petite mèche disposée exprès dans la lumière du pétard, laquelle lumière se trouvait au centre de la culasse[350]. Simples curiosités. — Gaspard de Tavannes, attaché à la personne du duc d'Orléans, frère de Henri II, lui suggère les plus singuliers exercices, pour l'empêcher de s'efféminer, le faisant sauter dans les rues d'un tait à l'autre, l'habituant à mépriser les dames, l'excitant à dresser des embuscades et à tomber à main armée sur les passants ; exagérations bizarres qui nous font voir combien peu nos pitres étaient civilisés, puisque ces faits excentriques se passaient au sein d'une cour galante et polie. On disait alors faire ou entretenir la galantise à l'accoutumée, l'expression galantise signifiant escarmouche[351]. En arrivant à Peyrat (1568), l'armée protestante du midi manque d'eau et fait haire du vin à ses chenaux beaucoup de soldats en firent tant avaler à ces pauvres bêtes, que le lendemain elles étaient ivres et ne purent servir[352]. L'Italien Margarini, sorti de la garde du Roi, conduisait, en 1570, le régiment de Strozzi, en qualité de sergent-major ; il faut entendre par là, par cette dénomination, le grade de capitaine-sergent-major qui dura longtemps encore et qui désignait le premier capitaine du régiment, et par conséquent le second officier du régiment puisqu'il n'existait alors ni lieutenant-colonel ni chef de bataillon. CONCLUSION. Dans les guerres de religion les protestants ont souvent le dessous, et, guerriers improvisés, trop longs à se rassembler, se laissent surprendre, montrent l'ignorance des règles de la guerre. C'est pourtant finalement moins un des deux partis, celui de la majorité de la nation, qui reste vainqueur, qu'une fusion des deux partis ayant Henri IV à sa tête comme roi catholique de la France. Le fait qui ressort le mieux de ces longues et déplorables années de lutte, c'est que la nation s'aguerrit durant ces guerres civiles[353]. Elle s'aguerrit au point que dès leurs dernières années on peut dire : Le Français pour trois ans de guerre ne demandent qu'un mois de bon temps pour se remettre sous les armes[354]. Cette habitude de la guerre prépare le XVIIe siècle qui, après une seconde convulsion, la Fronde, deviendra le siècle des conquêtes et de l'agrandissement de la France. Mais si véritablement la nation s'aguerrit pendant les
luttes dont nous venons d'entretenir l'Académie, c'est-à-dire si elle apprend
à mieux consulter la guerre et à la bien faire, il serait inexact d'en
déduire qu'au début, en 1562, elle n'aimait point les combats. Écoutes en
effet Brantôme : Rien, dit-il, de si brave et si superbe à voir qu'un gentil soldat bien
en point, bien leste ; soit qu'il marche à la tête d'une compagnie, soit
qu'il se perde devant tous, à une escarmouche, à un combat, à un assaut,
tirant son arquebuse, tout nu, désarmé, aussi résolument que les mieux armés[355]. Cette phrase
sent le cliquetis des armes et est à coup sûr une image du parti pris avec
lequel des deux parts on courut aux armes en 1562, à ces armes qui en 1598
tombèrent des mains de beaucoup par lassitude. FIN DU MÉMOIRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||