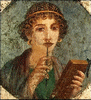LA FEMME ROMAINE
SECONDE PARTIE. — LA FEMME PENDANT LES DERNIERS TEMPS DE LA RÉPUBLIQUE ET SOUS L'EMPIRE
CHAPITRE CINQUIÈME. — RÔLE HISTORIQUE DES MATRONES.
|
Cornélie, mère des Gracques. — Les Romaines pendant la conjuration de Catilina. Sempronia. — Térentia, femme de Cicéron. — Julie et Cornélie, femmes de Pompée. La Cornélie de Lucain et la Cornélie de Corneille. Porcia, femme de Brutus. La Porcia de Shakespeare. — Atia, mère de César. — Julie, mère d'Antoine. — Fulvie. — Octavie. La femme de Marc-Antoine et Cléopâtre. La mère de Marcellus. — Livie. — Plancine. Les deux Julie. — Agrippine, femme de Germanicus. — Antonia. — Césonie, femme de Caligula. — Messaline. — Agrippine, mère de Néron. Octavie et Poppée, femmes de Néron. — Les néo-stoïciennes. Les deux Arria. Helvidie, Pauline, femme de Sénèque. Pollutia. Servilie. — Coup d'œil rapide sur les princesses des temps postérieurs. — Conclusion. Après la courte halte que nous venons de faire au milieu des muses et des inspiratrices romaines, entrons dans un cercle plus agité, et abordons les héroïnes de l'histoire. La mère des Gracques ! c'est elle que nous rencontrons ici la première, en suivant l'ordre chronologique. Rien qu'à prononcer ce nom si simple et si grand, ne croyons-nous pas étudier encore la période primitive des mœurs romaines ? C'est bien une femme de l'ancienne Rome que nous avons sous les yeux. Cette matrone qui, à une époque plus reculée que celle où elle vécut, aurait peut-être été confondue dans la foule des honnêtes femmes : cette matrone se détache, avec un relief extraordinaire, du triste tableau qu'offrent ses contemporaines. Alors les femmes n'ont guère d'autre sentiment que la vanité des choses extérieures : Cornélie, fille de Scipion l'Africain, Cornélie a respiré l'héroïsme dès son berceau ; Cornélie a fortifié son âme par l'étude de la sagesse. Alors les femmes se couvrent d'or, d'émeraudes et de perles : Cornélie montre à une étrangère sa couronne d'enfants, et dit : Voilà mes parures ![1] Ces parures, elle-même les a polies et ciselées ; elle-même a fait jaillir les feux de leurs pierreries. Elle a donné à deux illustres fils sa parole éloquente elle a fait plus, elle leur a donné son âme, une âme vraiment romaine[2] ! Les desseins politiques qui devaient immortaliser ses fils germèrent d'abord dans son cœur. Et ce cœur, quelque viril qu'il fût, était aussi le cœur d'une femme, puisque ce fut une inspiration aussi charitable que patriotique qui fit souhaiter à Cornélie que ses fils pussent remédier à l'état social de Rome et de l'Italie. L'agriculture, qui avait été l'une des forces de la vieille Rome, était alors complètement négligée. Les terres provenant de la conquête s'étaient concentrées dans les mains de quelques grands propriétaires. Trop vaste pour être cultivé par les esclaves d'un seul maître, chacun de ces domaines était converti en pâturages : les prairies avaient remplacé les champs. Loin de s'associer comme autrefois aux travaux de la vie rustique, le maître de la terre n'y veillait même pas, et confiait ce soin au villicus, le métayer. Dépossédés de leurs patrimoines, les Romains des classes inférieures et les Italiens étaient livrés à une misère d'autant plus affreuse que la plupart des arts industriels étaient exercés par les esclaves. La féconde Italie se stérilisait, la classe moyenne disparaissait, et il ne restait plus en présence que les privilégiés de la fortune et une foule besogneuse et avide qui pouvait devenir une armée toute prête au service des factieux. Cornélie ne vit avec indifférence ni le danger qui menaçait son pays, ni la misère où étaient plongés tant de Romains et d'Italiens. Cette femme de vieille race, cette sévère patricienne ne se méprit pas sur la cause du péril ; elle eut aussi compassion de tous les déshérités ; et souriant à une réforme déjà élaborée par son gendre Scipion Émilien, elle excita ses fils à provoquer le rétablissement de la petite propriété. Si, Domaine et femme, elle voyait là, sans doute, le moyen de sauver sa patrie et de secourir bien des infortunes ; mère, elle pensait que là aussi ses fils trouveraient l'occasion de se distinguer. Elle se plaignait sans cesse à eux d'être toujours nommée la belle-mère de Scipion, et de n'être pas encore appelée la mère des Gracques. L'on sait comment Tibérius, l'aisé de ses fils, versa son sang pour la cause qu'elle lui avait fait embrasser[3]. La mort de ce noble et doux jeune homme lui causa une profonde douleur[4]. Mais Tibérius avait un frère qui, héritant de ses desseins, s'y dévoua avec tout l'emportement d'une fougueuse nature. Suivant les uns, Cornélie excita Caïus à la révolte ; selon d'autres, elle lui fut contraire dès qu'il voulut défendre par la violence les réformes qu'il proposait. Cette dernière opinion nous parait la plus conforme au caractère de notre héroïne. D'ailleurs Cornélie venait de donner un gage de sa modération. Caïus ayant fait passer des lois dirigées contre les ennemis de Tibérius, Cornélie lui demanda de révoquer celle de ces mesures qui atteignait un tribun que l'amitié avait naguère uni à rainé des Gracques, et que la politique seule avait éloigné de celui-ci. En rapportant cette loi, Caïus lit savoir au peuple à quelle influence il cédait ; et le peuple, plein de respect pour la matrone que maintenant l'on pouvait appeler la mère des Gracques, le peuple applaudit à cette condescendance filiale[5]. C'est un fait considérable dans l'histoire de la femme, que cet hommage public rendu par un fils à sa mère. Elle était digne de recevoir un pareil honneur, cette mère des Gracques ; il était digne de le lui décerner, ce fils, aussi tendre qu'impétueux, ce fils qui, entendant une parole blessante pour Cornélie, s'écriait à la tribune avec une superbe indignation : Tu insultes ma mère, celle qui m'a mis au jour ![6] Le temps a marché. Ce n'est plus à Rome que nous retrouvons Cornélie. Caïus, lui aussi, est tombé victime de son patriotisme, de sa générosité. Cornélie, autrefois mère d'un grand nombre d'enfants, les a presque tous vus périr et deux de ceux-ci ont payé d'une mort violente leur dévouement aux nobles idées que leur avait inculquées leur mère. Mais du moins elle a vu réhabiliter leur mémoire. Aux lieux où sont tombés ces deux héros de la vie civique, des temples leur ont été élevés par la reconnaissante admiration du peuple, et Cornélie a trouvé que tels étaient les tombeaux qu'ils avaient mérités. Cornélie s'est retirée non loin de l'endroit où s'était volontairement exilé son illustre père alors que, lui aussi, il avait souffert d'une grande ingratitude nationale. La mère des Gracques achève son existence dans sa villa du mont Misène. Ainsi que, dans cette contrée, la terre volcanisée produit et les fleurs des tropiques, et les roses sur lesquelles vient chanter le rossignol[7], de même aussi l'âme de Cornélie, remuée jusque dans ses plus intimes profondeurs par de violentes secousses, a trouvé dans l'épreuve même la paix et la sérénité. De même que, du mont Misène, son regard, planant sur un vaste horizon, voit se dérouler la mer, le Vésuve, les riantes campagnes, le séjour de la Sibylle, l'entrée des enfers, et embrasse ainsi à la fois toutes les grâces et toutes les horreurs de la nature, et les mystères du passé, et les mystères de l'avenir ; de même aussi Cornélie considère de haut les phases de sa vie : joies, triomphes, deuils et douleurs ! Ses amis en pleurs maudissent-ils la destinée qui lui a donné pour fils les Gracques ; croient-ils devoir la consoler ; la plaignent-ils en la disant malheureuse : Jamais, répond-elle, je ne dirai que je ne suis pas heureuse, moi, qui ai mis au monde les Gracques[8]. Entourée de nombreux admirateurs, la fille de Scipion l'Africain, la mère des Gracques, leur parlait de son père et aussi de ses enfants ; et nulle larme ne troublait son regard pendant qu'elle disait les malheurs de Tibérius et de Caïus. Cette voix maternelle était calme et impartiale comme la voix de l'histoire même. Et quel auditoire se pressait autour de la grande matrone ! Ce n'étaient pas seulement des amis, des gens de lettres, des Grecs, c'étaient aussi les envoyés de ces rois avec qui elle échangeait des présents. Autrefois, sans doute au commencement de son veuvage prématuré, elle aurait pu accepter, avec la main d'un Ptolémée, le diadème des reines d'Égypte ; elle avait refusé. Elle avait sagement agi. La reine d'Égypte eût été oubliée sous le granit de quelque pyramide ; la mère des Gracques est immortelle. La mère des Gracques ! Oui, c'est sous ce nom que
l'histoire la confiait ; c'est ce nom qui a été le plus envié de Cornélie,
c'est ce nom qui a été le plus cher à son cœur. Nous n'ajoutons aucune foi à
ces traditions suivant lesquelles Cornélie aurait enseigné publiquement la
philosophie dans les écoles de Rome, et aurait répondu à ceux qui lui
demandaient de quoi elle se glorifiait le plus, ou d'avoir donné le jour à de
si illustres fils, ou d'avoir été la maîtresse de tant de disciples : Moi, en vérité, je me glorifie plus de la science que j'ai
acquise que des fils que j'ai enfantés ; parce que si, à moi leur survivante,
mes fils ont laissé un honneur sans tache ; à moi morte, mes disciples
laisseront une gloire immortelle[9]. Et elle aurait
ajouté que ses fils, en s'avançant dans la vie, auraient pu céder à
l'entraînement des passions, et devenir moins bons ; tandis que les disciples
de son enseignement philosophique ne pouvaient que devenir meilleurs avec le
temps. Non, ce n'est pas Cornélie qui a ainsi parlé, ce n'est pas une auguste matrone, et, pour tout dire, ce n'est pas la mère des Gracques. C'est une rhétoricienne, c'est une pédante. Nous ne croyons pas non plus que les statues que les Romains élevèrent à Cornélie, portassent cette inscription : Cornélie, mère des Gracques, heureuse dans les disciples qu'elle instruisit, malheureuse dans les fils qu'elle enfanta[10]. L'ombre de Cornélie eût protesté contre un éloge qu'elle eût considéré comme un outrage. Nous en avons pour garant la noble parole que nous citions plus haut et d'après laquelle Cornélie défendait que l'on appelât malheureuse la femme qui avait mis au monde les Gracques. Cornélie, mère des Gracques, telle fut la simple inscription que lut Plutarque sur la statue de notre héroïne. Et là, en effet, est le titre à jamais glorieux de la matrone qui avait su s'en rendre digne par une conduite qu'un illustre Père de l'Église devait lui-meule admirer[11]. Le titre maternel de Cornélie nous a nous-même entraînée : et, en elle, nous avons oublié l'épouse. Cette épouse fut cependant la compagne d'un homme digne d'elle, Tibérius Gracchus, deux fois consul et triomphateur. Suivant un témoignage rapporté par Tite-Live, Tibérius, bien qu'adversaire des Scipion, avait eu un admirable mouvement de généreuse colère pour s'opposer à ce qu'on arrêtât Scipion l'Asiatique, injustement accusé. Pendant cette scène, un banquet réunissait le Sénat au Capitole. En apprenant quelle a été la noble attitude de Tibérius, les sénateurs se lèvent comme un seul homme, demandent à Scipion l'Africain de donner sa fille Cornélie au défenseur imprévu de son frère ; et le héros accède à ce vœu[12]. L'union formée sous de tels auspices fut heureuse. Nous avons dit ailleurs qu'un Romain donna sa vie pour sauver celle de sa jeune femme : ce Romain était Tibérius ; cette femme était Cornélie. Si la mère des Gracques nous a ramenée aux temps antiques, Sempronia et ses dignes compagnes vont nous rappeler que nous sommes loin de l'époque où l'amour du foyer et un généreux patriotisme remplissaient l'âme de la matrone. Ces femmes figurent parmi les complices de Catilina. Dans cette conjuration où étaient entrés les plus pervertis des Romains, se trouvaient aussi de ces matrones qui avaient vendu leur honneur pour alimenter leur luxe. En perdant les charmes auxquels elles avaient dû la satisfaction de leurs goûts ruineux, elles avaient gardé la soif du luxe, cette soif qui n'avait plus, pour s'étancher, la ressource d'une eau fangeuse. Le vol devenait dès lors leur suprême expédient. Ces matrones étaient donc les dignes associées de Catilina. Elles avaient encore des esclaves, elles avaient encore leurs maris ; elles pouvaient entraîner ceux-ci dans la conjuration, et pousser ceux-là à l'incendie de Rome. Sempronia était l'une de ces femmes. Elle avait reçu en partage la beauté, l'intelligence, la grâce enjouée et caressante. Elle connaissait les lettres grecques et latines, et maniait le rythme poétique ; elle chantait et dansait avec art, avec un art trop consommé même et peu cligne d'une grave matrone. Mais que lui importaient l'estime de ses concitoyens, l'honneur de son époux, le nom de ses enfants ! Ce qu'elle voulait, c'étaient les basses jouissances de la vie matérielle. Sa fortune et sa vertu avaient été englouties dans le gouffre de ses dissipations. Elle n'était pas seulement devenue la plus vile des courtisanes : elle avait pris le bien d'autrui ; et la vie de l'homme n'avait même pas été épargnée par elle[13]. L'impureté, le vol et l'assassinat, tels étaient les degrés que l'amour du luxe avait fait franchir à la femme romaine. Disons néanmoins que quelques matrones seulement trempèrent dans cette conjuration. La découverte de ce complot fit même éprouver à la masse des Romaines ces terreurs que leur causait autrefois l'approche de l'ennemi. Tremblant pour elles et pour leurs enfants, elles surent encore lever au ciel des mains qui n'étaient plus toutes habituées à se tendre vers cette région[14]. Et dans la nuit mémorable où les conjurés reçurent la mort, quand les Romains délivrés acclamèrent Cicéron et illuminèrent leurs demeures, les femmes, elles aussi, paraissant avec des lumières sur les terrasses de leurs maisons, contemplaient avec vénération le libérateur de Rome[15]. Devant les périls qui avaient menacé leur pays et leurs foyers, leur patriotisme et leur foi religieuse avaient eu un soudain réveil. Ajoutons aussi que les femmes ne furent même étrangères ni à la découverte du complot, ni au châtiment des conjurés. Une matrone, de noble naissance, mais de mauvaises meurs, avait surpris et ébruité le secret de la conjuration. Les révélations de cette femme décidèrent même les Romains à confier à Cicéron, avec le consulat, le salut de leur pays[16]. Cicéron avait auprès de lui une femme énergique, ambitieuse, d'une humeur difficile même. et qui exerçait sur lui l'ascendant que les caractères fermes exercent sur les caractères faibles. C'était sa compagne Térentia. D'après Cicéron lui-même, elle prenait plus de part à la vie politique de son mari qu'elle ne lui en laissait prendre dans leur vie domestique. Pendant le procès des conjurés, les Vestales offraient à Bona Dea le sacrifice qui, suivant l'usage traditionnel, avait lieu chez la femme du consul. Les prêtresses crurent remarquer un prodige qui leur sembla d'un heureux augure pour la tâche patriotique que venait d'accepter Cicéron. A leur prière, Térentia alla trouver son mari, et le pressa d'exécuter sans retard les mesures qu'il avait prises pour le salut de Rome. Ce fut aussi Térentia qui engagea Cicéron à témoigner contre Clodius, accusé de sacrilège. Térentia savait que l'indigne Clodia, sœur de Clodius, souhaitait de prendre sa place au foyer de Cicéron ; et, entraînée par la jalousie, l'impérieuse épouse suscita entre les deux Romains, jusqu'alors amis, une haine qui devait enlever à Clodia tout espoir d'épouser un jour l'ennemi de son frère[17]. Devenu tribun du peuple, Clodius exécuta l'œuvre d'une implacable vengeance. Il fit exiler Cicéron, brûler la demeure du proscrit ; et lorsque Térentia chercha un refuge dans le temple de Vesta, il la fit arracher à cet asile sacré et traduire en justice. Clodia n'était pas irresponsable des persécutions qui atteignaient la famille du banni. Térentia aurait voulu suivre son mari en exil ; mais il lui avait enjoint de rester à Rome pour veiller sur leurs enfants. La compagne de Cicéron se dévoua avec autant d'énergie que de tendresse aux intérêts du banni. Elle l'exhorta à supporter l'éprouve avec magnanimité ; et à attendre l'avenir avec espoir. Cicéron sentait alors le prix de cet attachement, de cette sollicitude. Rien de plus affectueux que les lettres qu'il écrivait alors à la femme qu'il appelait sa vie, sa lumière, la plus fidèle et la plus dévouée des épouses. Il pleurait amèrement sur les outrages que la noble femme souffrait à cause de lui, et le proscrit recommandait sa compagne à Quintus, son frère, à son ami Atticus. Le souvenir du bonheur domestique dont il jouissait naguère le poursuivait dans son exil. Si tout autre espoir devait être perdu pour lui, il souhaitait de pouvoir du moins mourir dans les bras de sa femme[18]. Cicéron est revenu à Rome. Il est réuni à sa bien-aimée compagne. Mais à peine est-il rentré à son foyer, que nous l'entendons se plaindre vaguement de ses chagrins domestiques. Plusieurs années vont s'écouler sans que le nom de Térentia se trouve dans sa correspondance. Au bout de sept années, ce nom reparaît dans les lettres de Cicéron. Au moment de retourner à Rome après avoir gouverné la Cilicie, le célèbre Romain écrit même une lettre affectueuse à sa très-douce et très-désirée Térentia. Elle va au-devant de lui à Brindes. Pendant la guerre civile qui a déjà éclaté alors, Cicéron embrasse dans la même sollicitude inquiète et tendre sa femme et sa fille, ses deux âmes. Comme Tullie, Térentia lui conseille de demeurer fidèle à la noble, mais périlleuse résolution de soutenir Pompée ; mais, pendant cette même guerre civile, Cicéron se refroidit peu à peu à l'égard de sa femme. Il se plaint à Atticus d'un testament que Térentia aurait fait en ne consultant que son intérêt personnel. Il exprime aussi son mécontentement de n'avoir pas obtenu d'elle la valeur intégrale d'une somme qu'il lui a demandée[19]. Enfin, après une union de trente années, il répudie sa compagne. Il lui reprochait alors, et le dénuement où elle l'avait laissé pendant la guerre civile, et un défaut de sollicitude maternelle, et le manque d'ordre domestique. Térentia niait la vérité de ces accusations. Elle savait que son plus grand crime était de n'être plus aimée, et que Cicéron était séduit par la juvénile beauté d'une autre femme[20]. A quel point les griefs de Cicéron étaient-ils fondés ? Comment la fidèle et généreuse épouse du proscrit avait-elle pu devenir l'ennemie domestique de son mari ? Ce sont la de ces faits qui demeureront sans doute à Jamais impénétrables. Si, d'une part, Cicéron sembla justifier Térentia en s'unissant à une jeune fille ; d'autre part aussi, Térentia sembla justifier Cicéron en épousant un ennemi de celui-ci, l'historien Salluste. Après la mort de ce dernier, elle prit un troisième époux, l'orateur Messala ; et peut-être même un quatrième. Elle vécut cent trois ans[21]. Nous ne sommes encore que dans la première période de la décadence ; et le mal, qui lutte victorieusement contre le bien, ne l'a pas cependant tout à fait abattu. Pendant les mauvais jours des deux triumvirats, tout un noble groupe féminin nous attire. Julie et Cornac, épouses de Pompée ; Porcia, la compagne de Brutus ; Atia, mère d'Octave ; Julie, mère d'Antoine ; Octavie, femme de ce triumvir, opposeront leurs vertus aux crimes d'une Fulvie. Julie, fille de César, gage de l'alliance qui s'est conclue entre son père et Pompée ; Julie qui n'a personnellement joué aucun rôle politique, Julie a cependant une grande importance devant l'histoire. Tant qu'elle vécut, son mari et son père demeurèrent unis : et si son existence avait été plus longue, la paix du monde n'eût pas été troublée. Le résultat qu'elle obtint, ce résultat que la savante politiqué des hommes d'État n'eût pas produit, elle le dut à la plus simple et à la plus féminine des causes : l'amour qu'elle inspira, l'amour qu'elle éprouva. Chérie de son père, adorée de l'époux à qui elle avait donné son cœur, elle était la liane frêle, mais vivace, qui unit deux arbres puissants. Le vainqueur de Sertorius et de Mithridate se laissa subjuguer par l'aimable ascendant de cette jeune femme. Il ne pouvait quitter Julie. Pour elle, il renonçait à ses commandements, à ses gouvernements. L'amour conjugal avait dompté jusqu'à l'ambition du général et du chef de parti. Pompée n'avait plus d'autre occupation que celle de promener sa jeune compagne dans ses maisons de plaisance... L'époux de Julie n'avait pas seulement le prestige de la renommée. La noblesse de son attitude, son regard rempli de caresse et de flamme. sa physionomie empreinte a, la fois de gravité et de bonté, la grâce de sa conversation, exerçaient sur les femmes un charme fascinateur. Aussi, bien que Julie fût beaucoup plus jeune que lui, elle l'aima avec passion. Un jour Pompée s'est éloigné d'elle pour assister à une élection d'édiles. Des troubles ont eu lieu ; du sang a été versé et a rejailli jusque sur les vêtements de Pompée. Le général a dû se dépouiller de son costume et en faire chercher un autre à son logis. A la vue des esclaves qui rapportent en courant ces habits ensanglantés, Julie est saisie d'une angoisse indicible : son cœur lui crie que son époux a été tué, et la jeune femme s'évanouit. Longtemps elle demeure inanimée ; et lorsqu'elle revient à elle, si elle sait qu'elle a conservé son mari, elle a la douleur de perdre une espérance maternelle que la terreur a foudroyée en elle. Le peuple s'intéressa à cette tendre jeune femme. Les adversaires même de son père ne pouvaient se défendre de lui accorder une douce sympathie ; et, tout en blâmant l'affection que Pompée témoignait à César, ils ne se sentaient pas le courage d'envelopper dans cette réprobation l'amour de leur chef pour sa jeune compagne. De nouveau Julie fut près de devenir mère. Un fils lui naquit ; mais elle mourut en le mettant au monde ; et peu de jours après l'enfant rejoignit sa mère. Pompée voulut faire enterrer sa femme à Albe, dans l'une de ses terres ; c'était sans doute l'une de ces villas où il la conduisait autrefois, pleine de vie et de bonheur. Mais le peuple vint enlever la jeune morte, et la porta au Champ de Mars, honneur suprême qu'il rendait plus à la fille de César qu'a, la femme de Pompée, et plus encore à la nature aimante de Julie[22]. Cette épouse si chère fut cependant bientôt remplacée au foyer de son mari. Pompée épousa Cornélie, fille de Metellus Scipion et veuve du jeune Crassus. Cornélie était belle, et son esprit singulièrement cultivé. Elle avait le goût des lettres, des sciences et des arts. Elle jouait de la lyre, lisait avec profit les œuvres des philosophes ; et l'étude de la géométrie lui était familière. Possédant la véritable instruction, elle en avait la modestie. Plutarque nous dit que le nouveau mariage de Pompée fut blâmé. Pour les uns, la disproportion qui existait entre l'âge du général et celui de sa femme ; pour les autres, le péril où se trouvait alors l'État dont l'illustre guerrier était l'unique défenseur, auraient dû le détourner de rechercher ces nouvelles joies domestiques. Cependant, comme Julie, Cornélie aima son mari qui probablement avait gardé, sur le déclin de l'âge, ce charme que subissaient les Romaines. Mais ce ne fut pas dans ces belles campagnes où il avait promené Julie, ce ne fut pas là qu'il vécut avec sa nouvelle épouse. Les temps étaient changés. César passait le Rubicon, César marchait sur Rome, Pompée abandonnait cette ville, et Cornélie attendait dans les îles grecques le résultat de la guerre civile. Un premier succès fit croire à Pompée que César était perdu, et l'époux de Cornélie écrivit à sa femme pour lui annoncer que la guerre allait bientôt cesser. Pleine d'espoir, Cornélie se trouvait à Mitylène lorsqu'un courrier se présenta à elle. C'était un messager de malheur ; mais en voyant cette jeune femme si heureuse dont il allait, par une seule parole, détruire le bonheur, il n'eut pas la force de la saluer : il pleura, et ne put que lui dire de se hâter si elle voulait revoir son époux qui revenait avec un seul vaisseau, un vaisseau que le général ne possédait même pas ! Pharsale avait décidé du destin de Rome. Cornélie tomba sur le sol. Muette, affolée, elle resta longtemps dans cette position. Lorsqu'elle redevint maîtresse d'elle-même, elle sentit que cet abattement était inopportun, et que le devoir l'appelait ailleurs. A travers Mitylène, elle courut au rivage. Pompée, qui l'y attendait, alla à sa rencontre, et la reçut défaillante dans ses bras. La jeune femme se reprochait d'avoir porté malheur à son mari. C'était, croyait-elle, depuis leur mariage qu'il avait senti le poids de l'adversité. Elle regrettait de ne s'être pas tuée, comme elle le voulait, après la mort violente de son premier époux. Mais Pompée relevait, avec sa mâle douceur, le courage de sa jeune compagne. ll disait à Cornélie qu'elle n'était pas habituée encore aux brusqués variations de la fortune ; il l'exhortait à souffrir les revers et à espérer des jours meilleurs[23]. Nous voudrions que Pompée eût réellement dit le mot si touchant que Lucain place sur les lèvres du héros qui, dans la Pharsale, reprochant doucement à sa femme de pleurer sa défaite alors que sa vie est sauve, invite Cornélie à s'illustrer par son dévouement à un époux malheureux : Aime-moi, parce que je suis vaincu[24]. Cornélie s'embarqua avec son mari et le suivit à la recherche d'un lieu d'exil. Mais cet exil, où le trouver ? Aussi loin que s'étendait la domination de Rome, aussi loin s'étendait la main de César. Pompée eut la pensée de se réfugier au milieu des Parthes ; mais l'on dit qu'il fut détourné de ce projet par la crainte des périls que l'honneur de Cornélie pouvait courir chez ce peuple. L'Égypte fut choisie, l'Égypte où la trahison attendait le grand Pompée. Le noble banni n'était pas encore descendu de son vaisseau dans la barque que lui avait envoyée le gouvernement de Ptolémée, et déjà il avait pressenti qu'on le conduisait à la mort. Mais il ne pouvait plus reculer. Il embrassa sa femme ; et celle-ci, sentant qu'elle recevait le suprême baiser d'un mourant, répandait déjà des larmes de veuve. Cornélie, demeurant sur le vaisseau, contemplait avec anxiété la barque qui allait aborder au rivage. Un instant, son inquiétude se calma. La femme de Pompée vit les officiers du roi qui s'approchaient de la mer comme pour rendre les honneurs dus à l'illustre Romain. Cornélie regardait toujours. Soudain elle vit tomber son mari : Pompée était assassiné. Les cris qui s'élevèrent du vaisseau monté par Cornélie, et des deux galères qui s'y étaient jointes, ces cris furent si terribles qu'ils parvinrent jusqu'au rivage. Les vaisseaux s'éloignèrent. César punit la perfidie des misérables qui avaient cru lui plaire en tuant son rival. Les cendres de Pompée furent rendues à sa veuve ; et Cornélie, les portant à Albe, les déposa dans un tombeau[25]. Nous avons suivi ici l'admirable récit de Plutarque. La physionomie de Cornélie s'en détache avec une touchante expression de tendresse et de douleur. Bien que, dans une épopée antérieure à l'œuvre historique de Plutarque, Lucain ait parfois déparé Cornélie en lui prêtant un langage ou trop prétentieux, ou trop bas, il a su lui donner souvent aussi une attitude et des sentiments dignes d'elle. Le dévouement que l'héroïne de la Pharsale témoigne à son époux, et qui lui fait désirer de suivre le général jusque sur les champs de bataille, jusque sur la barque égyptienne, ce dévouement appartient vraiment à la femme si aimante que Plutarque a dépeinte. Cc que l'histoire ne nous dit pas, mais ce que tout cœur de femme peut deviner, c'est-à-dire les impressions qu'éprouva Cornélie lorsqu'elle vit tomber son époux ; les efforts qu'elle fit pour arrêter la fuite du vaisseau qui l'emportait ; la poignante émotion que lui causa de loin la vue du bûcher où se consumaient les restes de Pompée, et dont la fumée, de plus en plus légère, annonçait que le grand homme ne serait bientôt plus qu'un peu de cendre ; la farouche et morne douleur où s'ensevelit la veuve, toutes ces images déchirantes ont été dignement retracées par l'auteur de la Pharsale. À cette figure toute féminine, le poète a néanmoins donné la fièvre de la vengeance. Cornélie en appelle à ses fils pour qu'au nom de leur mère ils soulèvent contre César tous ceux qui, dans le monde romain, ont soif de liberté. En faisant parler la veuve de Pompée, Corneille s'est plutôt inspiré de son génie que du récit de Plutarque ou même de la Pharsale. Le côté féminin, que l'historien et le poète avaient fait dominer en Cornélie, disparait presque tout à fait dans la tragédie française. Si l'influence de Lucain s'y montre, c'est tout au plus dans les souhaits de vengeance que forme Cornélie. Et encore, ce qui, chez l'héroïne de la Pharsale, est le cri d'une douleur passionnée, apparait, chez l'héroïne de la tragédie française, comme l'expression énergique et calme d'une résolution mûrement prise. La Cornélie de notre théâtre est maîtresse de son âme. Même dans la superbe scène où elle tient dans ses mains l'urne où sont déposées les cendres de son mari, elle a dompté sa douleur : c'est moins une épouse qu'une Romaine de grande race qui veut, en vengeant la mort de son mari, rendre à sa patrie la liberté : Veuve de Pompée, Fille de Scipion, et, pour dire encore plus, Romaine, mon courage est encore au-dessus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je le l'ai déjà dit, César, je suis Romaine, Et quoique la captive, un cœur comme le mien, De peur de s'oublier, ne te demande rien. Ordonne ; et sans vouloir qu'il tremble, ou s'humilie, Souviens-toi seulement que je suis Cornélie[26]. L'héroïne du tragique français garde à César deux sentiments : elle lui est reconnaissante d'avoir châtié les meurtriers de son époux ; mais elle n'oublie pas que César a vaincu Pompée et causé indirectement la mort du héros. Cependant elle ne prépare pas sa vengeance dans l'ombre. Loin de là. Lorsque des embûches menacent César à la cour de Ptolémée, c'est elle qui vient lui dire : César, prends garde à toi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si je veux ton trépas, c'est en juste ennemie : Mon époux a des lits ; il aura des neveux : Quand ils le combattront, c'est là que je le veux, Et qu'une digne main par moi-nième Dans ton champ de bataille, aux yeux de ton armée, T'immole noblement et par un digne effort Aux mânes du héros dont tu venges la mort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rome le veut ainsi..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu tomberais ici sans être sa victime ; Au lieu d'un châtiment ta mort serait un crime. Et, ayant toujours devant les yeux la grande image de Rome, Cornélie ajoute : Venge-la de l'Égypte..... Et je la vengerai, si je puis, de Pharsale[27]. La Cornélie du tragique français n'est peut-être pas la Cornélie de l'antiquité ; mais, si elle n'est pas l'image exacte de la femme qui a porté ce nom, elle est, à coup sûr, le type idéal de la matrone romaine. A la différence de Cornélie, la Porcia de la tradition moderne est bien la Porcia de l'antiquité. Fille de Caton d'Utique, élevée dans les austères principes de la philosophie stoïcienne, Porcia n'a pas néanmoins toute l'impassibilité que demande la secte dont elle fait partie. Comme les stoïciens, elle sait souffrir avec courage ; comme eux aussi, elle sait malheureusement se dérober à la lutte par le suicide ; mais du moins elle a gardé cette sensibilité que le stoïcisme condamnait comme une faiblesse. Les deux côtés de ce caractère se dessinent tour à tour dans l'histoire. Quand Brutus médite le meurtre de César, et que Porcia le voit sombre, taciturne, elle ne veut l'interroger qu'après s'être assurée du courage avec lequel elle saura garder l'un de ces secrets qui peuvent tuer leurs dépositaires. Porcia se fait une blessure qui met sa vie en péril. Lorsque son mari veille auprès d'elle avec une tendre anxiété, elle lui rappelle que, fille de Caton, elle est entrée chez Brutus, non comme la femme illégitime que l'homme n'associe qu'aux détails de la vie matérielle, mais comme l'épouse qui partage avec l'époux le bonheur et la peine. Pour être digne de porter le secret de son mari, il ne lui a pas néanmoins suffi d'être la fille de Caton, la femme de Brutus. Porcia révèle à ce dernier l'épreuve qu'elle vient de tenter sur elle-même ; elle lui montre sa plaie ; et Brutus, levant les mains au ciel, prie les dieux que, par le succès de son entreprise, il mérite d'être l'époux d'une telle femme. Voilà la stoïcienne. Au jour choisi pour l'exécution du complot, quelle est cette femme qui s'effraye et tressaille au moindre bruit, et qui demande des nouvelles de Brutus à tous ceux qu'elle voit revenir de la place publique ? Quelle est cette femme qui, perdant tout empire sur elle-même, tombe dans un évanouissement tel, qu'on la croit morte ? Est-ce encore la stoïcienne que nous voyons ici en Porcia ? Non, c'est tout simplement une femme qui tremble pour son mari. Brutus, lui, est plus fidèle à son dogme philosophique ; et quand on vient lui annoncer que Porcia est morte, si profond que soit son trouble, il le domine, et reste au Sénat pour y attendre la victime désignée[28]. César est égorgé. Ses vainqueurs et ses meurtriers, se partagent la sympathie des Romains. Brutus va transporter hors de Rome le théâtre de la guerre. Il quitte l'Italie. Sa femme l'accompagne jusqu'à Élée. A. la fermeté avec laquelle Porcia dissimule sa douleur, nous pourrions croire que la stoïcienne revit en elle. Pas encore. Et que faut-il pour faire tomber ce masque d'impassibilité ? La vue d'un tableau : les adieux d'Hector et d'Andromaque. Cette scène, qui ne rappelle que trop à la femme de Brutus, une situation toute personnelle ; cette scène la fait fondre en larmes. Puis, loin de fuir le tableau qui lui a fait trahir sa douleur, Porcia le recherche ; et, chaque fois qu'elle le contemple, ses pleurs jaillissent de nouveau. En la voyant s'arrêter ainsi devant le tableau qui l'impressionnait si vivement, un ami de Brutus répéta cette sublime apostrophe d'Andromaque : Hector, mais tu es pour moi mon père, ma vénérable mère, enfin mon frère ; et tu es mon jeune époux ![29] Brutus souriait, et disait qu'il ne pourrait, lui, comme Hector, renvoyer sa compagne aux travaux féminins, car il connaissait l'esprit viril de Porcia ; il savait que si le corps de cette femme était trop frêle pour supporter les fatigues de la guerre, son âme du moins saurait lutter pour la patrie. La stoïcienne, qui avait paru au moment où la femme de Brutus entrait dans l'histoire, reparut lorsque la veuve.de Brutus quitta cette grande scène. Comme Caton d'Utique, son père ; comme Brutus, son époux, elle crut, dans son aveuglement, que l'homme pouvait disposer de sa vie ; et ceux qui l'entouraient n'ayant laissé aucune arme à sa portée, elle avala des charbons ardents. Nous reconnaissons ici la stoïcienne qui s'était dangereusement blessée naguère pour éprouver son courage. Suivant une autre tradition, Porcia aurait succombé pendant que son mari combattait loin de Rome pour la liberté de leur patrie ; et l'époux absent aurait reproché à ses amis l'abandon dans lequel serait morte l'illustre femme[30]. Shakespeare a noblement ressuscité cette figure énergique et tendre. La scène dans laquelle Porcia demande à Brutus son secret est tout à la fois la traduction et le vivant commentaire du récit de Plutarque. La Porcia de Shakespeare ne se regarde pas non plus comme l'épouse de Brutus si ce dernier ne la fait participer qu'à sa vie extérieure : « S'il n'y a rien de plus, dit-elle, Porcia est la courtisane de Brutus, et non sa femme. » BRUTUS Vous êtes ma vraie et honorable femme ; et vous m'êtes aussi chère que les gouttes de sang qui visitent mon triste cœur. PORCIA Si cela était vrai, alors je saurais ce secret. Je le reconnais, je suis une femme ; mais une femme que le seigneur Brutus a prise pour son épouse. Je le reconnais, je suis une femme ; mais aussi une femme de bonne renommée, la fille de Caton. Pensez-vous que je ne sois pas plus forte que mon sexe, étant ainsi née et ainsi mariée ? Dites-moi vos secrets, je ne les révélerai pas. J'ai fait de ma constance une forte épreuve, me faisant à moi-même une volontaire blessure... Puis-je supporter cela avec patience, et non pas les secrets de mon époux ? BRUTUS Ô vous, dieux, rendez-moi digne de cette noble femme ![31] L'homme illustre qu'avaient frappé Brutus et ses complices, avait, par son testament, laissé à sa vertueuse nièce, Atia[32], le soin de ses funérailles, et légué au fils de cette parente, son nom et son héritage. A la mort violente du dictateur, la première pensée d'Atia est d'appeler son fils à Rome : les instincts héroïques se sont réveillés les premiers en cette mère qui, de même qu'Aurélie, mère de César, a présidé à l'éducation de son fils. Atia exhorte le jeune Octave à se montrer homme par la virilité de la pensée et de l'action. Mais à mesure qu'elle conçoit l'étendue des dangers auxquels va être exposé son fils, elle hésite, elle s'arrête, et parait presque céder à l'avis de Philippe, son second mari, homme prudent qui conseille à Octave de n'accepter ni le nom ni l'héritage de César. Ce nom, cet héritage, c'est la gloire du grand homme ; ce sera peut-être le pouvoir d'un roi ; mais qui sait si ce ne sera pas aussi la mort violente du dictateur ? Tout ce que l'amour maternel a de fières espérances et de cruelles anxiétés agite le cœur d'Atia. Cependant elle permet à son fils de prendre le nom de César ; mais Octave accepte de plus l'héritage de son grand-oncle. Lorsque le nouveau César se décida à combattre ouvertement Antoine, il n'osa prévenir Atia de son dessein ; mais l'œil d'une mère est perspicace. En s'éloignant de l'Italie, Octave n'avait pas tout à fait réussi à tromper la femme qui lui avait donné le jour[33]. Atia vit triompher la cause de son fils. Elle mourut pendant le premier consulat d'Octave. Vivante, elle avait été entourée des hommages de ce fils. Morte, elle fut toujours l'objet de sa vénération, et Octave lui rendit les plus grands honneurs[34]. C'est à l'heure des luttes civiles que, de tout temps, l'on a vu les femmes développer soit pour le bien, soit pour le mal, toute l'énergie, de leurs facultés. Les massacres du second triumvirat voient des matrones se dévouer pour leurs époux[35]. C'est alors aussi que la propre mère d'Antoine, la noble et chaste Julie, se fait admirer dans un sublime élan de courage fraternel. Lucius César, son frère, est sur la liste des proscrits : Antoine a abandonné à Octave la vie de cet oncle. Lucius se réfugie dans la maison de sa sœur. Les assassins y entrent à sa suite, et veulent pénétrer dans la chambre qui abrite le proscrit. Mais Julie, formant, et de son corps, et de ses bras étendus, un rempart vivant, Julie leur crie à plusieurs reprises qu'ils ne tueront Lucius César qu'après l'avoir assassinée la première, elle, la mère de leur général. Par son courage, elle arrête les meurtriers. Pendant ce temps, Lucius peut s'échapper. Puis, mère aussi ferme que tendre sœur, Julie va se dénoncer elle-même à son fils. Après une explosion de colère, Antoine s'apaise et pardonne[36]. Voyons maintenant la femme dans la violence de ces mauvais instincts auxquels les crises sociales donnent une libre carrière. Pendant ces mêmes massacres qui signalèrent l'avènement du second triumvirat, une femme compte parmi les chefs les plus cruels du parti populaire. On a nommé Fulvie, Fulvie, la veuve de Clodius, Fulvie, la femme de Marc-Antoine. Passionnée et vindicative, despotique et ambitieuse, cette étrange créature bouleverse l'État pour donner un aliment à la fièvre de domination qui l'agite. Gouverner un époux ne lui suffirait pas ; mais, par cet époux, commander et régner, tel est son but[37]. Naguère elle fut le mauvais génie de Clodius ; il et, suivant la forte expression d'un ancien, le célèbre, démagogue n'était que l'épée suspendue à la robe de Fulvie[38]. Quand cette épée se brisa, quand Clodius fut mortellement frappé par les gens de Milon, et que son cadavre fut exposé à Rome pour animer la fureur populaire, Fulvie était auprès de ce corps ; elle en montrait les blessures, elle criait ; et la vue de ces plaies, le retentissement de ces cris, ne furent pas étrangers à la farouche résolution de ce peuple qui donna pour bûcher à son idole le palais même où s'assemblait le Sénat, l'aristocratique assemblée tant haïe du factieux Clodius[39]. Ainsi que Clodius, Antoine fut l'épée
de Fulvie. Cet homme d'habitudes grossières et de mœurs dissolues, cet
homme subit avec une docilité extraordinaire l'empire de sa femme. Plutarque
fait spirituellement remarquer que Cléopâtre aurait dû rémunérer Fulvie pour
les leçons d'obéissance que Marc-Antoine avait reçues de cette dernière, et
qu'il mit en pratique auprès de la reine du Nil. On dit que Cicéron pensait
au ménage d'Antoine et de Fulvie quand il écrivait : Pour
moi, est-il libre, celui à qui une femme commande ? celui à qui elle impose
des lois, prescrit, ordonne, défend comme il lui plaît ? qui ne peut dire non
à rien de ce qu'elle commande, qui n'ose rien lui refuser ? Exige-t-elle ? il
faut donner ; appelle-t-elle ? il faut venir ; chasse-t-elle ? il faut sortir
; menace-t-elle ? il faut être épouvanté. Moi, en vérité, j'estime que cet
homme ne doit pas être seulement appelé un serviteur ; mais le plus mauvais
des serviteurs[40]. Cette femme altière semble pourtant avoir aimé Antoine. César, victorieux de l'Espagne, allait revenir à Rome quand le faux bruit de sa mort se répandit. C'est à ce moment si grave où les destinées de Rome peuvent être menacées, c'est alors qu'Antoine se livre à une espièglerie peu opportune. A cette époque il continuait d'entretenir de coupables relations avec la courtisane Cythéris. Il écrit à Fulvie qu'il renonce à cette femme, et que tout l'amour qu'il avait pour celle-ci appartiendra désormais à sa compagne. Un esclave de Marc-Antoine, porteur de cette lettre, se présente dans la nuit à la maison de l'absent. Qui es-tu ? lui demande le portier. — Courrier de Marc[41]. On le conduit auprès de Fulvie. Aussi passionnée dans ses affections que dans ses haines, Fulvie pleure en lisant la lettre de son époux. Alors le messager, se découvrant la tête, se jette au cou de Fulvie : c'est Antoine qui est venu surprendre sa femme, et qui, par ce retour imprévu, a jeté la terreur dans Rome et dans l'Italie[42]. Cette femme qu'une lettre de repentir fait pleurer, cette femme serait-elle donc sensible ! La voici auprès de son mari, à Brindes. Pourquoi son visage est-il taché de sang ? C'est qu'elle vient d'assister à un grand spectacle : trois cents centurions que Marc-Antoine n'a pu enrôler contre Octave ont été massacrés par l'ordre de celui-là. Fulvie était présente à cette exécution, et l'histoire ne nous dit pas que sa figure ait été mouillée par autre chose que le sang des victimes[43]. Quand le second triumvirat se forme sous les lugubres auspices
de la proscription, Fulvie se souvient qu'il lui reste à payer une vieille
dette de haine. Elle déteste Cicéron, l'adversaire de deux de ses maris.
Peut-être aussi a-t-elle deviné à quel couple pensait l'auteur des Paradoxes
quand il flagellait de son mépris l'esclave d'une femme. A coup sûr, Fulvie,
veuve de Clodius assassiné, et veuve aussi de Curion, battu en Afrique par
Juba, Fulvie a compris les mordantes paroles de Cicéron, alors que ce dernier
prévenait Antoine que le sort de ces deux hommes l'attendait, lui qui avait
dans sa maison ce qui leur avait été fatal à l'un et
à l'autre[44]. Fulvie n'ignore
certainement pas non plus que l'illustre orateur a montré le sang qui tachait
sa figure au massacre de Brindes. Elle a dû savoir aussi que, dénonçant au
Sénat les concussions de Marc-Antoine, Cicéron a dit que le trafic de tout
l'empire romain se soldait au milieu des corbeilles
à ouvrage qui se trouvaient dans la maison d'Antoine[45]. Nous ne croyons pas que ce soit calomnier Fulvie que de nous demander si elle ne contribua pas au meurtre de Cicéron. Quoi qu'il en fût, elle se fit apporter la tête de ce grand homme, lui infligea de honteux outrages, et, tirant cette langue éloquente qui l'avait justement flétrie, Fulvie la piqua de l'épingle qui retenait ses cheveux. Elle vengea de moindres offenses. Un Romain ayant refusé de lui vendre sa maison, elle le fit placer sur la liste des proscrits. La tête de ce malheureux fut portée à Marc-Antoine qui, ne la reconnaissant pas, jugea qu'elle devait appartenir au sanglant butin de Fulvie, et la renvoya a sa femme. Ici-bas déjà, Fulvie subit les atteintes du châtiment. Son mari aime la belle et séduisante Cléopâtre. A. tout prix la femme d'Antoine veut rappeler en Italie l'époux infidèle. Pour y parvenir, pour se venger aussi d'une offense d'Octave et satisfaire en même temps son humeur batailleuse, elle fomente la guerre civile, elle déclare la guerre au nouveau César. C'est sans doute alors qu'on la voit porter l'épée, haranguer les soldats, exercer enfin les fonctions de général. Obligée de fuir devant Octave, elle meurt à Sicyone[46]. La disparition de cette cruelle et bouillante héroïne rendit plus aisé le rapprochement d'Octave et d'Antoine. Ainsi qu'autrefois Julie, sœur de César, avait été le doux gage de l'alliance contractée entre son frère et Pompée, Octavie, sœur d'Octave, fut donnée par celui-ci à Marc-Antoine en témoignage de leur réconciliation. Octavie n'était pas la fille d'Atia. Née d'une autre mère que le jeune César, elle était plus figée que lui. Mariée en premières noces à un Marcellus, elle avait de son mariage un fils et deux filles. Veuve, le temps de son deuil n'était pas encore accompli, quand un décret du Sénat lui permit d'épouser l'homme à. qui la destinait son frère. Octavie était jeune et belle ; et s'il faut considérer comme son image le buste qui, au Louvre[47], porte cette attribution, sa beauté avait une expression de douceur, de loyauté et d'intelligence, qui réfléchissait bien cette exquise nature. A la bonté du cœur, Octavie joignait la gravité des mœurs, l'élévation de l'esprit, la sagesse du caractère. Il était permis d'espérer que Marc-Antoine ne résisterait pas au charme de cette grâce touchante, unie à tant de beauté, et qu'il subirait doucement ainsi l'ascendant moral de sa vertueuse compagne. En effet, longtemps il parut oublier, auprès de cette pure et aimante jeune femme, la coupable passion qui l'avait entraîné vers Cléopâtre. Lorsque la jalousie que lui inspirait Octave lui fit quitter Rome, il emmena sa femme à Athènes. Octavie lui avait, à cette époque, donné une fille. De douloureuses préoccupations vinrent assaillir la jeune femme dans sa nouvelle 'résidence. Elle vit son époux s'armer contre son frère, son frère qu'elle chérissait, et dont elle était tendrement aimée. Antoine s'embarqua pour l'Italie avec trois cents vaisseaux. Octavie l'accompagnait. Une seconde fille lui était née, et elle attendait un troisième enfant. La flotte entra dans le port de Tarente. Octavie supplia son époux de consentir à ce qu'elle allât rejoindre son frère. Antoine le lui permit. La jeune femme rencontra Octave sur la route male qu'elle suivait. Devant les conseillers de son frère, Mécène et Agrippa, elle eut avec lui une grave conférence. Elle ne demanda pas à la diplomatie de la guider ; elle n'employa pas le langage de la politique ; elle n'écouta que la voix de sa grande âme, et parla en épouse et en sœur. Elle demanda simplement au jeune César de ne pas faire d'elle la plus malheureuse des femmes, elle qui, jusqu'à ce jour, en avait été la plus heureuse. Quelle que dut être l'issue de la lutte qui se préparait, ce résultat ne pouvait être que fatal pour la femme qui était l'épouse et la sœur des cieux rivaux. Disons-le à la gloire d'Octave : l'astucieux politique, l'homme qui n'avait montré jusque-là que la dureté et l'inflexibilité de son cœur, cet homme se laissa vaincre par le frère. Devant cette sœur que le caractère d'une nouvelle et prochaine maternité rendait encore plus sacrée, Octave fut ému ; et lorsqu'il alla au-devant de Marc-Antoine, ce fut, non en adversaire, mais en ami. L'époux d'Octavie dirigea contre les Parthes la belliqueuse ardeur qui l'avait poussé contre son beau-frère. Il confia à ce dernier sa femme et ses enfants, et fit voile pour l'Asie. Étrange faiblesse de l'homme qui ne sait pas trouver en lui-même la règle et le frein de ses passions ! A peine soustrait à l'influence du foyer, Antoine se souvient de Cléopâtre. Au moment où sa femme vient de lui témoigner un si noble dévouement, il prépare à cette pieuse épouse un sanglant outrage. La passion que la belle reine d'Égypte a inspirée à Marc-Antoine, cette passion n'est pas morte, elle n'est qu'endormie : elle se réveille plus ardente que jamais. Antoine fait venir Cléopâtre en Syrie : il est retombé sous la puissance de la dangereuse sirène ! Avec les seules ressources de la beauté et de la jeunesse, Cléopâtre n'aurait pu l'emporter sur Octavie : mais elle possédait ce genre de séduction qui appartient à la beauté séparée de la vertu, ce genre de séduction qui dégraderait l'honnête femme à ses propres yeux, et dont la courtisane ose seule se servir pour triompher. De même que Cléopâtre parlait dans leurs propres idiomes aux Hébreux, aux Arabes, aux Éthiopiens, aux Syriens, aux Mèdes et à d'autres encore, de même aussi elle savait se plier aux habitudes de l'homme qu'elle voulait asservir. L'élégante et spirituelle fille des Ptolémées sacrifiait, aux grossiers instincts de Marc-Antoine l'atticisme de ses goûts ; et sa parole hardie donnait la riposte aux plaisanteries soldatesques du général romain. Ce devait être un puissant attrait pour cet homme, que de n'avoir pas à subir, auprès de cette reine, la contrainte de langage et de tenue qu'impose la présence d'une honnête femme, et que la chaste Octavie devait lui faire éprouver. Pour Cléopâtre, Antoine foula aux pieds ses titres d'époux et de père, sa renommée de général, la vie de ses soldats, les lois de son pays et l'honneur du nom romain. Il donna à cette femme des royaumes ; il fit lui-même élever les deux jumeaux dont elle l'avait rendu père ; il ne la quitta que pour aller combattre les Parthes ; et le violent désir qu'il éprouvait de la revoir lui fit brusquer des opérations militaires qui eurent un désastreux résultat : vaincu, il dut battre en retraite. Pour revoir plutôt Cléopâtre, il brava les neiges de l'hiver, et le froid lui fit perdre huit mille hommes. A son arrivée en Phénicie, une profonde tristesse s'empara de lui : ce n'était pas sa défaite qui l'affligeait, lui cependant si brave : c'était le retard que, selon son cœur, la reine mettait à le rejoindre. Il ne cessait d'aller au rivage pour y attendre Cléopâtre. Enfin il la revit. Et pendant ce temps, la femme légitime d'Antoine, sachant son mari vaincu et malheureux, oubliait combien il était coupable, et quittait Rome pour se rendre auprès de lui. Elle lui apportait non-seulement tout ce que son cœur renfermait de sentiments miséricordieux, mais encore des secours efficaces : de l'argent, des bêtes de somme, des vêtements pour les soldats, de précieux souvenirs pour les amis du général, pour les officiers. Ce n'était pas tout encore : elle amenait à Antoine deux mille hommes d'élite richement équipés. Octavie était arrivée à Athènes quand son époux lui signifia l'ordre de l'y attendre. Elle comprit tout. Elle obéit à son mari ; mais, toujours magnanime, elle lui écrivit pour lui demander comment elle devait lui faire parvenir les secours et les dons qu'elle lui apportait. Cette lettre fut confiée à Niger, ami d'Antoine ; et, en remettant ce message au général, Niger parla d'Octavie avec l'émotion que lui inspirait sa conduite. Ce moment pouvait décider du bonheur d'Octavie ; la noble et touchante attitude de la jeune femme pouvait entraîner vers elle Marc-Antoine. C'était là ce que redoutait Cléopâtre ; et craignant peut-être que tous les artifices de la coquetterie ne pussent soutenir la lutte contre la nature si simplement grande d'Octavie, l'enchanteresse du Nil eut recours à d'autres moyens : son abattement, ses larmes, l'épuisement de ses forces, alarmèrent Antoine qui, pour la rassurer, manqua même une précieuse occasion de racheter la honte de sa défaite. Le mauvais génie d'Antoine l'avait emporté : Octavie revint à Rome. L'outrage qu'elle avait reçu atteignit le cœur de son frère. Mais, s'il faut en croire plusieurs traditions, Octave avait prévu ce dénouement qui lui permettait de combattre son ennemi en vengeant sa sœur ; et il avait obéi à cette secrète pensée en laissant aller Octavie à la rencontre d'Antoine. Au retour de la jeune femme, Octave, s'armant de l'autorité qu'avait le chef de famille, ordonna à sa sœur de quitter la maison d'Antoine. Toujours fidèle à son admirable attitude, Octavie résista à son frère, et lui déclara qu'elle continuerait d'habiter la demeure conjugale. Elle supplia Octave de ne pas faire, à cause d'elle, la guerre à Marc-Antoine. Et gardant simplement et dignement sa place à son foyer, elle veilla à l'éducation des enfants de son époux, sans excepter de ce soin maternel les enfants de Fulvie. Les amis d'Antoine venaient-ils solliciter à Rome, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de leur chef, c'est Octavie qui les protégeait auprès de son frère. Mais, contrairement à ses intentions, sa générosité ne fit que rendre l'ingrat Antoine plus haïssable aux yeux des Romains. Cependant, après avoir offert à la reine d'Égypte l'hommage d'un triomphe que lui avait valu une nouvelle campagne chez les Parthes, Antoine ajouta des royaumes à ceux qu'il avait déjà donnés à Cléopâtre, et distribua aussi des diadèmes aux enfants qu'il avait eus de cette femme. Toutefois, pendant qu'il était à Éphèse pour y préparer ses armements contre Octave, il se disposa à renvoyer Cléopâtre en Égypte, suivant le conseil que lui donnaient quelques-uns de ses amis. La reine craignit que la femme de Marc-Antoine ne réconciliât de nouveau son mari et son frère. Ses agents firent valoir auprès du général le nombre des combattants qu'elle lui fournissait, et la prudence politique qu'ils lui attribuaient. Cléopâtre resta auprès d'Antoine. Tous deux se rendirent à Athènes ou la reine d'Égypte retrouva vivant le souvenir d'Octavie. Elle était si aimée des Athéniens, cette belle et, intelligente sœur de César, que naguère, par une ingénieuse allusion, ils avaient donné à Marc-Antoine la main de Minerve, leur déesse poliade. Mais ce peuple se laissa également captiver par les largesses de Cléopâtre, et sans doute aussi par les grâces de cette reine et par son Origine hellénique. Ce fut d'Athènes que l'indigne Romain envoya à sa femme un acte de répudiation. Faut-il voir dans ce brusque dénouement un défi jeté à Octave ; ou bien ne serait-ce pas plutôt le résultat des préoccupations qui avaient fait craindre à la reine du Nil que l'épouse d'Antoine ne trouvât dans la guerre une nouvelle occasion de se dévouer à son coupable mari ? Octavie, qui n'avait pas voulu sortir de la maison conjugale lorsque son frère le lui avait ordonné, abandonna, au commandement de son époux, la demeure qu'elle avait fidèlement et chastement gardée. Elle emmena les enfants de Fulvie et les siens. Pendant qu'elle quittait ainsi le foyer dont elle était chassée, elle était tout en pleurs ; ce n'était pas sur son humiliation personnelle qu'elle gémissait ; mais elle se disait avec douleur que les Romains pourraient regarder en elle l'une des causes de la lutte fratricide qui allait déchirer leur empire. Tel n'était pas le sentiment de ses compatriotes. Ceux-ci ne voyaient en elle qu'une innocente victime, digne de leur amour et de leur admiration[48]. Comme notre douce héroïne n'est plus la femme de Marc-Antoine, nous n'avons plus à nous occuper de son ancienne rivale. Cette princesse grecque, souveraine de l'Égypte, n'appartient pas à l'histoire des femmes romaines ; elle ne s'y est rattachée que par les chagrins qu'elle a causés à deux épouses d'Antoine. Laissons donc Cléopâtre mener le faible triumvir à cet abîme où s'est perdu l'honneur du Romain et où s'engloutit enfin sa vie ; laissons Cléopâtre se donner la mort quand elle n'a pu séduire le vainqueur d'Antoine ; tournons quelques pages de l'histoire, et revoyons dans Octavie la sœur de l'empereur. Auguste fut pour elle ce qu'avait été Octave. Il lui témoigna publiquement son affection en donnant à un beau portique le nom d'Octavie. Ce fut le fils de cette bien-aimée sœur, le sympathique Marcellus, que l'empereur choisit pour son gendre et désigna pour son successeur[49]. A ce jeune prince se rattachaient les plus belles espérances du peuple romain. Mais un mal subit vint le foudroyer ; et Octavie perdit cette résignation, cette force d'âme qui l'avaient soutenue pendant les épreuves de son second mariage ; c'est que, pour les âmes d'élite, toutes les peines sont supportables, toutes excepté la perte d'un être aimé ! Ces âmes ne tiennent à la terre que par le lien de leurs affections ; et si ce lien se brise et qu'une foi supérieure ne les élève pas vers le ciel, elles retombent lourdement sur cette terre de larmes. Tel fut le destin d'Octavie, cette malheureuse mère à qui le paganisme ne pouvait offrir aucune consolation digne de son grand cœur. Son désespoir fut terrible et sans fin. Elle, la douce et tendre femme, elle haïssait toutes les mères. Nulle main ne put sécher ses pleurs. Ses autres enfants n'étaient plus rien pour elle ; la sœur d'Auguste ne regardait plus son frère. Elle ne voulait pas être consolée, jugeant, dit Sénèque, qu'en renonçant aux larmes elle eût perdu son fils pour la seconde fois[50]. Un bruit a été entendu dans Rama, des pleurs et des cris lamentables : c'est Rachel pleurant ses fils, et qui n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus[51]. Mais ce cri de détresse qui, chez la fille d'Israël, était le premier élan d'une douleur que pouvaient calmer de célestes espérances, ce cri de détresse fut la note qui résonna à jamais dans le cœur d'Octavie. Fuyant l'éclat de la gloire impériale, cette femme vêtue de deuil ne recherchait que la solitude. Elle n'avait même pas la force de recourir à ce qui, pour tant de mères, est une consolation douce et cruelle à la fois : entendre parler de son fils, en posséder au moins l'image. Elle repoussa les tributs que l'art et la poésie offraient à son désespoir maternel[52]. Ce serait là un argument de plus contre une légende qu'infirment aussi les témoignages de la critique[53], et que nous n'avons cependant pas le courage d'exclure de ce récit, tant elle est poétique et populaire. Le chantre immortel de l'Énéide, l'interprète du vieil Anchise qui prophétisait les destinées de sa race, Virgile disait devant Auguste et Octavie la piété d'un jeune prince, sa fidélité, sa bravoure, et il ajoutait : Hélas ! déplorable enfant ! si tu peux rompre le cours des âpres destinées, tu seras Marcellus. Jetez des lis à pleines mains[54]... Octavie s'était évanouie sur les genoux de l'empereur, et Auguste pleurait. Longtemps la mère de Marcellus demeura sans connaissance ; lorsqu'elle revint à la vie, elle fit compter au poète dix sesterces pour chacun des trente-deux vers que contenait l'épisode de Marcellus. Légendaire ou historique, c'est sur cette dernière apparition d'Octavie que nous quitterons la femme de douleurs, dont l'image a longtemps arrêté nos sympathiques regards. Nous avons dit d'après Sénèque que, depuis la mort de Marcellus, la mère du jeune prince haïssait toutes les mères. Livie surtout, la femme d'Auguste, était, suivant le même écrivain, l'objet de cette aversion. Était-ce parce que la sœur d'Auguste voyait de plus près le bonheur maternel de Livie ? ou bien Octavie pensait-elle, elle aussi, que c'était à l'impératrice qu'elle devait la mort de son enfant ? Livie, la compagne de l'empereur, ou pour mieux dire, l'empereur même ! Belle et impénétrable comme une déesse, la voici qui se pose devant nous sous les attributs de Cérès[55]. Avec une grâce et une majesté souveraines, elle semble répandre sur l'univers prosterné à ses pieds la gerbe d'épis que tient sa main droite. La délicatesse de ses traits s'éloigne du type accentué des Romaines, et cependant c'est bien une vraie matrone que cette femme qui se voile chastement de sa palla. La bouche d'une extrême petitesse, le regard serein et pénétrant, ont une bienveillance et une affabilité étudiées ; mais sous cette expression se devinent, et l'astuce du caractère, et la froideur ou plutôt l'absence du sentiment. Dans ce beau marbre de Luni, parait s'être sculptée l'image que Tacite a dessinée en quelques traits : Par la chasteté domestique, inclinant vers les vieilles mœurs ; mais plus aimable qu'on ne l'agréait chez les femmes antiques ; mère tyrannique, épouse facile, unissant fort, aux talents politiques de son mari, la dissimulation de son fils[56]. À voir l'impératrice à son foyer, c'est bien la matrone primitive, laborieuse comme la reine Tanaquil, faisant elle-même les vêtements que portera l'empereur[57], et joignant à ces humbles occupations domestiques l'austère vertu que lui reconnaitra l'historien le moins prévenu en sa faveur. Mais ne nous y trompons pas ! Ce n'est pas la vertu qui, chez cette femme, a fait taire l'amour coupable : c'est une autre passion, c'est l'ambition ! Cette matrone que paraissent absorber les fils de sa quenouille dévide un écheveau plus inextricable que celui-là : le gouvernement de Rome ! Cette sage épouse, cette mère attentive, ne voit dans un mari, dans un fils, que les organes de sa domination et si ces organes sont ou peuvent devenir rebelles, Livie saura les supprimer par un crime. Nulle femme plus que Livie ne suivit avec constance une ligne politique, parce que nulle femme moins qu'elle, ne sentit battre son cœur. Par la toute-puissance d'Octave, elle fut enlevée à son premier mari alors que, mère d'un fils, elle allait donner un autre enfant à cet époux[58]. Regretta-t-elle son premier hymen ? Se souvint-elle que c'était devant les partisans d'Octave qu'au temps de la guerre civile elle fuyait avec son enfant et traversait une forêt dont l'incendie mettait le feu à sa chevelure et à ses vêtements[59] ? Rougit-elle de mettre au monde, chez un second époux, le fils de son premier mari encore vivant ? L'histoire ne peut nous renseigner à cet égard[60] : déjà Livie était impénétrable. Livie aima-t-elle Auguste ? Il est permis de douter que ce cœur froid ait connu la tendresse. Mais Livie vécut avec son mari en bonne intelligence ; et, comme un témoignage de cette fidèle union, elle éleva un temple à la Concorde[61]. Malgré de fréquentes infidélités, Auguste aima toujours Livie[62]. A la honte des mœurs impériales, nous devons dire, d'après Suétone, que la chaste Livie ne se borna pas seulement à tolérer les infidélités de son mari, mais qu'elle les favorisa[63]. Épouse facile dit Tacite qui confirme par ce mot le témoignage de Suétone. Peu importait à l'impératrice que l'empereur la trahit, pourvu qu'il se laissât toujours gouverner par elle. Peut-être était-ce à son insu qu'Auguste subissait l'ascendant de sa femme. Du moins il paraissait vouloir se défendre contre cette influence. Lorsqu'il allait entretenir Livie de sujets graves, il observait, même à son égard, la règle qu'il suivait dans les affaires sérieuses : il écrivait ce qu'il avait à dire, tant il craignait d'être ou trop peu précis ou trop explicite[64]. Nous ne pensons pas que Livie eût besoin pour elle-même d'une semblable prévoyance : c'est que la dissimulation était l'essence même de son caractère, cette dissimulation qui n'était pas naturelle à Auguste et dont il se servait comme d'une arme d'État. Livie, elle, ne devait jamais craindre de se laisser trahir par la parole. En revanche, elle devait facilement scruter la pensée d'autrui : de tout temps ce talent de pénétration a appartenu aux personnes qui défient elles-mêmes le regard de l'observateur. Aussi pensons-nous que l'habileté de l'impératrice déjoua souvent les prudentes précautions du souverain : les annales romaines ne le prouvent que trop. Pendant cinquante années, Livie domina l'homme qui fut le maître du monde romain. Partout elle le suit, même en Orient[65] : il ne pouvait vivre sans elle. Quelle fut la part de Livie dans les vastes conceptions qui immortalisèrent le règne d'Auguste ? Lorsque le prince réorganisait et unifiait l'empire, lorsqu'il embellissait Rome et protégeait les lettres, dans quelle mesure cédait-il à l'influence de sa femme ? Les annales sont muettes à ce sujet ; elles constatent bien le pouvoir de l'impératrice, mais ne nous montrent l'action de ce pouvoir que dans les intrigues qu'ourdit la princesse pour faire parvenir sa propre famille à la succession impériale. En dehors de ces questions toutes personnelles, nous ne saurions délimiter ce qui, dans l'œuvre d'Auguste, appartient à Livie ; une seule tradition, et encore n'est-elle pas certaine, nous fait assister à une intervention politique de l'impératrice auprès de l'empereur. Après qu'Auguste a eu découvert le complot de Cinna, c'est Livie qui vient lui demander de faire grâce au coupable. Les écrivains qui nous ont conservé la mémoire de ce fait ont bien observé ici le caractère de Livie : elle ne cède pas à une impression de miséricordieuse pitié ; mais elle se laisse guider par une haute pensée politique. Elle sait que les châtiments subis jusqu'alors par les hommes qui ont tramé la mort d'Auguste n'ont pas découragé d'autres conspirateurs. La sévérité est devenue inutile ; mais la clémence donnera un plus vif éclat à la gloire impériale. C'est pourquoi Livie conseille au prince la magnanimité[66]. Nous pouvons encore rattacher à la vie officielle de l'impératrice le soin qu'elle avait de se rendre populaire : un incendie éclatait-il à Rome, Livie se induit courageusement aux travailleurs qui l'éteignaient, et leur donnait des ordres[67]. Quant aux monuments qui furent dus à cette princesse, elle les éleva pour consacrer des souvenirs de son mariage ou de sa maternité[68]. Ces monuments, qui naquirent d'une pensée d'orgueil, ne nous apprennent donc pas si Livie avait le goût des arts et si elle l'inspira à son époux. Pour ce qui concerne les relations que put avoir l'impératrice avec les écrivains de génie ou de talent qui se groupèrent autour d'Auguste, nous remarquerons d'abord que les deux plus illustres chantres de la gloire impériale, Virgile et Horace, ne parlent pas de Livie. Presque tous les pontes contemporains d'Auguste ont suivi cet exemple. Ovide seul célébra avec un zèle de courtisan les vertus, vraies ou supposées, qu'il attribuait à cette princesse. Exilé, il invoqua sa puissance, il adora son image[69] ; mais la souveraine et la déesse demeurèrent sourdes à l'appel du proscrit et dédaignèrent ses hommages adulateurs. Longtemps avant son exil, Ovide avait voulu console,' Livie qui venait de perdre l'un de ses fils, celui-là même qu'elle avait donné à son premier époux dans la demeure du second : le noble et sympathique Drusus avait succombé en Germanie. Ovide peignit en traits émouvants le désespoir de l'impératrice ; il montra Livie refusant toute nourriture, Auguste et Tibère la suppliant de ne pas se donner ainsi la mort et la sauvant par leur tendresse[70]. C'est une vraie mère qu'Ovide fait apparaître ici ; mais ce n'est pas Livie. A cette version toute poétique, nous préférons le récit de Sénèque, récit assurément moins touchant, mais qui est plus conforme au caractère de l'impératrice. Sénèque loue la force d'âme avec laquelle la mère de Drusus endura sou malheur ; le stoïcien admire ce courage qu'il oppose au désespoir qui accabla la mère de Marcellus[71]. Mais le calme de Livie n'était-il pas plutôt l'impassibilité d'une âme égoïste ! Maitriser une immense douleur, c'est beau, c'est grand, trop beau et trop grand même pour les forces humaines si la grâce divine ne supplée pas à notre faiblesse. Mais quel mérite peut-il y avoir à dompter une douleur ou imaginaire ou simulée ? Il est parfois difficile de distinguer l'une de Vautre la force dôme et l'insensibilité ; cependant nous attribuerons plutôt ce dernier état moral à la mère de Drusus : ne savons-nous pas qu'elle chargea le rhéteur Aréus de la consoler, et cille celui-ci s'acquitta à merveille de sa mission ? Étrange chagrin que celui qui demande un allégement au langage d'un rhéteur ! étrange chagrin, répétons-le, et aussi artificiel que le remède qu'il réclame ! Nous constations à l'instant le silence que gardent, au sujet de Livie, les pontes contemporains d'Auguste ; et nous ajoutions qu'Ovide seul témoigna à l'impératrice une admiration qu'elle dédaigna d'ailleurs. Ne pourrait-on pas inférer de ces rapprochements que Livie avait un esprit trop pratique et trop mesuré pour qu'elle se plût aux accents des portes ? Sénèque, qui nous apprend que Livie se fit consoler par le rhéteur Aréus, ne parle pas de la Consolation qu'Ovide offrit à l'impératrice pour le même malheur. Ne serait-ce pas là un indice que Livie avait plus goûté l'écrit du prosateur que le chant du poète ? Il n'est pas aisé, disions-nous, d'assigner à Livie une part déterminée dans l'œuvre civilisatrice d'Auguste. Il n'en est pas de même si nous étudions le rôle que joua cette princesse dans la transmission glu pouvoir. Il ne suffisait pas à Livie de gouverner Auguste. La mort de l'empereur pouvait interrompre le règne de sa femme. L'impératrice prévit cette éventualité ; elle prépara l'avenir. N'ayant pas donné d'enfant à l'empereur, elle chercha à substituer la descendance de son premier époux à la famille des Césars. Comme l'a fait remarquer un historien moderne[72], Livie devient ainsi le premier châtiment d'Auguste. Pour assurer la grandeur de sa race, Octave a tué : pour faire périr cette même race, Livie tuera, non pas ouvertement, mais dans l'ombre, et plus souvent par le poison que par le poignard. Marcellus, neveu et gendre d'Auguste, est l'héritier de l'empereur. Il meurt. Comment ? C'est un mystère. Mais passons. Julie, veuve de Marcellus, remariée à Agrippa, a plusieurs enfants de ce nouvel hymen, trois fils et deux filles. Deux de ses fils sont devenus les héritiers d'Auguste. Ils meurent à peu de distance l'un de l'autre, et un murmure accusateur désigne Livie comme l'auteur de leur mort[73]. Un troisième petit-fils reste à Auguste : Posthumus Agrippa. L'empereur l'adopte ; mais il adopte en même temps Tibère, fils aîné de sa femme. En désignant celui-ci pour l'un de ses successeurs, Auguste cède à la pression morale qu'exerce sur lui Livie[74], Livie qui déjà lui a fait associer Tibère à la puissance tribunitienne. Mais c'est trop peu que de voir donner à ce fils une part de l'empire : Agrippa échapperait à l'influence de l'impératrice, et Livie ne gouvernerait que la moitié du monde romain. La princesse fait exiler Agrippa dans l'ile de Planasie[75]. Un jour deux hommes abordèrent mystérieusement dans cette ile. L'un d'eux était l'empereur ; l'autre, Maxime, son ami. Cette fois, Auguste n'avait pu résister à un élan du cœur : il avait voulu revoir le fils de sa fille. L'aïeul et le petit-fils pleurèrent beaucoup, et se donnèrent de nombreuses marques de leur mutuelle tendresse. Le secret de cette entrevue fut confié par Fabius à sa femme Marcia[76], amie de l'impératrice. Marcia eut la faiblesse de redire à Livie ce que son époux lui avait confié. Peu de temps après, Fabius expirait ; et, à ses funérailles, l'on entendit sa veuve s'accuser en gémissant d'avoir causé sa mort[77]. Plutarque nous dit que le confident d'Auguste s'était tué après qu'une sévère parole de son maître lui eut fait comprendre que l'empereur était instruit de son indiscrétion[78]. La voix du sang avait crié en Auguste : il pouvait rappeler Agrippa. L'empereur mourut, et l'on dit que ce fut après avoir mangé des figues que lui avait offertes l'impératrice[79]. On jugeait Livie capable d'avoir sacrifié à son ambition la vie même de l'époux qui lui avait donné cinquante années de dévouement. Si ce dernier forfait doit être imputé à la femme d'Auguste, un détail le rend plus exécrable encore : jusqu'à son dernier souffle, l'empereur crut à l'affection de sa femme : ce fut au milieu des embrassements de cette épouse chérie qu'il prononça ses dernières paroles, et ces paroles étaient pour elle : Livie, vis en te souvenant de notre union adieu ![80] Il faut maintenant saisir le pouvoir d'Auguste. L'impératrice rappelle, par des lettres pressantes. Tibère qui vient d'arriver en Illyrie. Elle cache la mort de l'empereur, et fait défendre par des gardes les abords de la maison qui ne contient plus que le cadavre d'Auguste. Et ce n'est qu'au moment où tout est disposé pour le succès de Tibère, que Rome apprend à la fois que l'empereur est mort et que le fils de Livie lui succède. Agrippa est encore un danger pour la sûreté du nouveau règne. L'impératrice a tout prévu, Agrippa est tué[81]. Par le testament de l'empereur, Livie et Tibère sont les premiers héritiers des biens d'Auguste ; et, par ce testament, l'empereur adopte sa veuve pour sa fille, et lui donne les noms de Julia Augusta. Après l'apothéose de l'empereur, elle est la prêtresse d'Auguste[82]. Mère du souverain qui lui doit le pouvoir, elle gouvernera sous le nom de Tibère ; mais la justice éternelle veille : et la femme qui, elle aussi, aurait pu dire à son fils : Règne : de crime en crime enfin le voilà roi[83]. cette femme est punie dans son orgueilleuse ambition, par ce même fils qu'elle croyait devoir être le docile instrument de sa toute-puissance. Dès les premiers jours qui ont suivi la mort d'Auguste, Tibère a attendu que les pressantes sollicitations du Sénat vinssent ratifier le choix de son prédécesseur : peu soucieux de paraitre devoir son élévation aux intrigues d'une femme[84], il allégeait ainsi le poids de gratitude filiale sous lequel Livie menaçait de l'accabler. Le Sénat qui a fait ou qui fera frapper des médailles en l'honneur de l'impératrice[85], le Sénat veut nommer la veuve d'Auguste mère de l'empereur, mère de la patrie. Tibère refuse. Il ne consent même pas à être officiellement appelé le fils de Julia. Il s'oppose à d'autres distinctions que l'on veut accorder à sa mère, et ne souffre même pas que la nouvelle Augusta ait un licteur[86]. Cependant Tibère garde encore des ménagements avec Livie. Il a besoin des conseils que peut seule lui donner la femme qui fut initiée à la politique d'Auguste. Il a besoin aussi de l'aide que ne lui refusera pas l'ancienne marâtre des jeunes Césars[87]. Comme Auguste, il subit donc l'ascendant de Livie, non pas, comme son prédécesseur, avec l'entrainement de l'affection, mais avec la haine que lui inspire un joug dont il n e peut cependant se passer. Aux premiers temps de son règne, Tibère confie à Livie une mission diplomatique. Alors qu'il vivait disgracié à Rhodes, il eut à se plaindre d'Archélaüs, roi de Cappadoce. L'empereur se souvient de ce grief de l'exilé. A son tour il veut humilier celui qui l'a humilié. Mais il faut pour cela que le roi de Cappadoce vienne à Rome ; et c'est Augusta qui écrit au vieux Archélaüs pour l'attirer dans le piège que lui tend son fils[88]. En général cependant, et lorsque l'intérêt de son ambition le lui permettait, Livie conseilla à Tibère la modération. Tant qu'elle vécut, le bien et le mal luttèrent dans n'ne profondément troublée de cet empereur. Pendant ce temps, il se montra souvent juste. La clémence même ne fut pas tout à fait exclue de sa politique. Livie qui, disait-on, avait donné autrefois à Auguste un mémorable conseil de générosité, Livie prouva qu'elle saurait encore, au besoin, émettre auprès de Tibère un semblable avis : elle ne souffrit pas que, sous le règne de son fils, l'on appliquât, à cause d'elle, la loi qui punissait les crimes de lèse-majesté, et qui ne protégeait que deux personnes, l'empereur et sa mère[89]. Toutefois la prudence politique de l'impératrice l'abandonnait quand il s'agissait de soutenir une favorite. Ainsi un homme d'un caractère élevé, ayant cité en justice Urgulanie, amie d'Augusta, cette matrone se fit porter au palais impérial. Tibère reconnut l'injustice de sa cause, et ne voulant néanmoins pas blesser Livie, ne put promettre à l'impératrice que d'être l'avocat d'Urgulanie. Ce fut en simple particulier que l'empereur se dirigea à pied vers le Forum avec une lenteur calculée. Il espérait arriver trop tard ; et en effet, l'adversaire d'Urgulanie avait maintenu ses droits si énergiquement que Livie lui avait envoyé la somme qu'il réclamait à l'amie de l'impératrice. Ce fut cette même Urgulanie qui dédaigna de comparaitre devant le Sénat, alors qu'elle y était citée comme témoin ; et si grand était le pouvoir de cette femme, que le préteur dut se rendre chez elle pour recueillir sa déposition[90]. Ce fut aussi cette même Urgulanie qui, plus tard, envoyant un poignard à son petit-fils menacé d'une sentence capitale, l'arracha ainsi à la justice des hommes[91]. Suivant l'expression de Tacite, l'amitié d'Augusta l'avait élevée au-dessus des lois[92]. L'impératrice déroba à la puissance de ces lois une autre femme qu'Urgulanie : mais celle-là était une grande coupable. Elle était même regardée comme l'empoisonneuse de Germanicus, le petit-fils de Livie ; mais dans l'accomplissement de ce meurtre elle n'était peut-être que la complice d'Augusta. Peu importait à l'impératrice que les victimes de son ambition fussent de son propre sang : pour disparaître de sa route, il suffisait d'être un obstacle à sa marche. Et Germanicus était devenu l'un de ces obstacles. Fils de Drusus, il avait hérité des héroïques et généreuses qualités de son père ; et c'était avec orgueil et amour que les Romains contemplaient le jeune prince qui, par l'ordre d'Auguste, avait été adopté par Tibère et devait succéder à celui-ci. Germanicus n'aurait pu devenir un instrument de Livie. L'artificieuse politique de l'impératrice aurait été repoussée par le loyal jeune homme. Et d'ailleurs une autre femme, une femme dont nous allons bientôt parler, Agrippine, la digne et fière compagne de Germanicus, n'aurait pas permis à son époux de subir l'influence d'Augusta, son ennemie. Loin de s'opposer donc à la jalousie que le jeune héros inspirait à son oncle, la mère de Tibère s'associa à ce haineux sentiment. C'était là une de ces occasions où Tibère avait besoin de Livie. Germanicus venait d'obtenir à Rome cet éclatant triomphe dont un admirable camée[93] nous a transmis le souvenir. Assise sur le même trône que Tibère, mais placée au premier plan, Augusta reçoit, ainsi que l'empereur, le jeune vainqueur de la Germanie. Au-dessus de cette scène, l'Olympe s'ouvre pour nous faire assister à l'apothéose d'Auguste. Le fondateur de l'empire s'élance vers les cieux, où l'attendent ses grands ancêtres et le père de Germanicus. Alors déjà, peut-être. Livie songe à envoyer Germanicus dans cette zone éthérée où la gloire des dieux ne gène pas l'ambition des mortels. Le triomphateur reçoit le commandement des provinces romaines d'outre-mer. Le gouverneur de la Syrie, Pison, est nommé en même temps pour susciter au jeune prince de graves embarras. Pison est le mari de Plancine, patricienne dont l'illustre race et la fortune accroissent encore l'orgueil de son époux. Plancine a reçu d'Augusta l'ordre de ne pas ménager les humiliations à la fière Agrippine. Pour soulever contre le jeune couple les légions de la Plancine pousse l'audace jusqu'à assister aux manœuvres militaires, et à prononcer devant les soldats des discours injurieux pour Germanicus et Agrippine. En proie à un mal étrange, Germanicus va expirer ; et l'agonisant accuse de sa mort Pison et Plancine, Plancine surtout. Par la joie que manifeste cette dernière en apprenant que le prince a succombé, elle ne dément pas cette accusation d'un mourant. Alors en deuil d'une sœur, elle quitte ses vêtements lugubres pour fêter la mort de Germanicus. Accusée, ainsi que son époux, Plancine rentre fièrement à Rome avec un nombreux cortège. Quand son mari et elle sont jugés, bien que le crime d'empoisonnement ait été écarté de l'accusation, et que la révolte de Pison contre son chef soit surtout incriminée, Plancine est toujours regardée par le peuple comme l'empoisonneuse de Germanicus. Et néanmoins, au grand scandale de Rome, l'impératrice reçoit cette femme qui s'est publiquement réjouie de la mort de son petit-fils ; l'impératrice obtient que Tibère demande au Sénat la grâce de Plancine ! L'empereur s'acquitte de cette mission avec un air confus qui témoigne de la honte qu'il éprouve à jouer un semblable rôle. Aussi ne manque-t-il pas de dire qu'il cède ici au vœu de sa mère. Plancine continua d'être reçue par l'impératrice. Après la mort d'Augusta, elle vit approcher l'heure du châtiment. Elle la devança en se donnant la mort. Cette femme avait-elle réellement empoisonné Germanicus ? Et si elle l'avait fait, obéissait-elle à Livie ? Où l'histoire doute, nous n'oserions affirmer. Nous remarquerons seulement que ni Augusta ni Tibère n'avaient paru aux funérailles de Germanicus[94]. Cependant l'impératrice n'usa entrer en lutte ouverte avec la veuve de son petit-fils. Elle retint même une lettre par laquelle Tibère dénonçait au Sénat l'ambition d'Agrippine, et ce ne fut qu'après la mort d'Augusta que ce message parvint à sa destination. Était-ce ou par prudence politique, ou par remords, que Livie épargnait la femme qu'elle haïssait ? Ou bien, devant l'aversion de plus en plus complète que lui témoignait son fils, voulait-elle que la veuve et les enfants de Germanicus fussent toujours une menace pour Tibère ? Lorsqu'elle retint la lettre que l'empereur avait écrite au Sénat contre Agrippine, le prince avait abandonné Rome pour File de Caprée. D'après l'une des versions auxquelles cet exil volontaire donna lieu, il fut dit que Tibère fuyait dans le siège de l'empire la présence de Livie, cette grande Augusta qui était plus populaire que lui à Rome. En vain se révoltait-il intérieurement contre cette mère impérieuse qui, en dédiant une statue d'Auguste, plaçait son nom avant le nom de son fils : il dévorait en silence cette humiliation. Pouvait-il oublier qu'il devait à Livie ce pouvoir dont elle réclamait une si large part ? Et l'eût-il oublié, eût-elle souffert qu'il perdit ainsi la mémoire ? Sans cesse elle rappelait à son fils les bienfaits dont elle l'avait comblé. Néanmoins la jalousie de Tibère l'emporta. Il eut si peur que l'on n'attribuât à l'impératrice ses desseins politiques, qu'il évita de la voir, et n'eut plus avec elle de longues ut mystérieuses conférences. Il craignit surtout la rivalité d'Augusta, un jour où il vit l'impératrice se mêler bravement, comme autrefois, au peuple et aux soldats pour éteindre un incendie. Il ne lui ménagea plus dès lors l'avis de renoncer aux affaires publiques, et de se renfermer dans ses attributions féminines. Tels étaient les rapports de Tibère avec Livie quand la princesse vint réclamer de son fils une grâce que, plus d'une fois, elle lui avait vainement demandée : la faveur de faire inscrire sur le tableau des décuries un de ses protégés, déjà honoré du droit de cité. Las de ces sollicitations, l'empereur répondit qu'il s'y rendrait à une condition : c'est qu'il inscrirait en même temps, sur ce tableau, que la grâce qu'il octroyait lui avait été extorquée par sa mère. L'impératrice fut indignée. Elle alla chercher dans le sanctuaire de la maison impériale d'anciennes lettres où Auguste jugeait avec une équitable sévérité le caractère du prince qui lui succéda. Cette révélation fut foudroyante pour Tibère. L'humiliation qu'il éprouva fut si grande que ce fut ; dit-ou, cette scène qui décida le départ de l'empereur pour Caprée. Ne pouvant lutter victorieusement avec Livie, il se serait retiré, et aurait ainsi abandonné à l'impératrice le séjour de Rome[95]. Il ne semble pas que l'éloignement de Tibère ait nui au crédit d'Augusta. Elle vit Fun de ses protégés devenir consul et nous savons qu'elle eut le pouvoir de retenir une lettre adressée par l'empereur au Sénat[96]. Avant le départ de son fils pour Caprée, l'impératrice était tombée gravement malade, et les chevaliers romains avaient voué, pour le rétablissement de sa santé, une offrande à la Fortune Équestre[97]. Malgré son grand âge, elle s'était rétablie. Elle ne résista pas à une seconde attaque de la maladie. Tibère ne daigna pas venir voir la mourante. Il se fit si longtemps attendre pour les funérailles de l'impératrice que la corruption du cadavre ne permit pas que celui-ci fût brûlé. Les obsèques furent simples. Ne redoutant plus la femme qui l'avait courbé sous le joug, Tibère ne craignit plus de résister à sa volonté : il laissa sans effet le testament de cette impératrice qui avait tenu entre ses mains les destinées du monde. Vivante, Augusta disposait des emplois. Morte, ses protégés sont persécutés. Vivante, Augusta avait, comme Tibère, un temple en Asie ; des médailles, frappées en son honneur, l'assimilaient à des déesses : elle y était nommée la Justice, la Piété, le Salut, Junon même ; Ovide l'appelait la Vesta des chastes matrones. Morte, son fils lui refuse l'apothéose que lui décerne le Sénat et qui ne lui sera accordée que par l'empereur Claude, son petit-fils[98]. Ainsi disparut de la scène politique cette femme de mœurs austères et d'habitudes laborieuses, mais qui, tout entière à une immense ambition, commit froidement, et peut-être sans remords[99], les crimes qui pouvaient servir à ses desseins ; mère funeste à la chose publique, marâtre plus funeste encore à la maison des Césars[100] dit Tacite, qui considère cette femme comme l'un des maux légués par Auguste à l'empire romain. Un écrivain moderne[101] nous faisait voir tout à l'heure, en Livie, le premier châtiment d'Auguste. Le même historien nous montre aussi dans Julie, fille d'Auguste, la punition des mœurs détestables dont les Césars se léguaient l'héritage. Cependant l'homme le plus dépravé, à moins qu'il ne soit une monstrueuse exception, cet homme cherche du moins à prémunir sa fille contre les vices qu'il ne connaît que trop. Il aime à respirer dans sa maison l'air salubre qu'y font circuler la vertu et l'honneur. Ainsi agit Auguste. Il éleva sa fille avec respect. Sous les veux de la chaste Livie, Julie croissait dans la demeure paternelle. Connue l'impératrice, elle travaillait la laine, elle faisait les vêtements d'Auguste, et vivait avec simplicité[102]. Son intelligence était cultivée. Les journaux mentionnant ses actes quotidiens, toute parole ou toute action qui n'aurait pu être, publiée hautement lui était interdite. Un jour que Julie était à Baïes, un jeune patricien de mœurs sévères s'approcha d'elle pour saluer la fille de l'empereur. Auguste l'apprit ; et le prince écrivit à ce Romain pour lui reprocher d'avoir manqué aux convenances[103]. Un esprit noblement occupé, des mains laborieuses, une direction austère, n'étaient-ce pas là de sûrs préservatifs contre le vice ? Mais Julie avait le sang des Césars, l'exemple paternel, le souvenir de sa mère Scribonie, épouse adultère ; elle avait enfin un titre qui l'enivrait l'orgueil : elle était la fille de l'empereur : et, par ses mariages, elle apporta successivement à Marcellus, à Agrippa, à Tibère, l'héritage de la dignité impériale. Les traditions de sa race, ses propres passions, le vertige du rang suprême, firent d'elle la première courtisane de Rome, à une époque où Messaline n'était pas encore née. Toutes les mesures qu'a prises Auguste pour l'éducation de sa fille ont un résultat contraire à celui que l'empereur a voulu obtenir. Élevée simplement, Julie réagit contre cette modestie paternelle qui lui semble incompatible avec la majesté souveraine ; elle effraye Auguste par son luxe. L'instruction qui lui a été donnée a aiguisé son esprit ; mais cette subtilité intellectuelle lui dicte les paroles et les actes qui compromettent le plus gravement la dignité de son rang et la pudeur de son sexe. La chaste éducation qu'elle a reçue n'a fait que la contraindre, sans la dompter : et la femme d'Agrippa, la femme de Tibère, rejette sans aucun ménagement, sans aucune réserve, le joug qui a été imposé à la fille d'Auguste. L'effronterie de sa conduite en égale l'horreur. Est-il nécessaire de rappeler que, le lendemain même du jour où Auguste avait proclamé dans la tribune du Forum les lois qui châtiaient l'adultère, Julie osa choisir cette même tribune pour y recevoir ses favoris ? Ne nous arrêtons pas à de tels spectacles. L'empereur fut le dernier à apprendre ce que Rome tout entière savait de sa fille. Il ne la voyait que telle qu'elle nous apparaît dans la célèbre statue du Louvre ; unissant aux séductions de la beauté, la coquetterie de l'ajustement, la grâce élégante du geste, la finesse et l'enjouement de la physionomie ; séduisante enfin comme cette Vénus Aphrodite dont une monnaie de Smyrne lui donne le nom . Auguste ne la croyait que trop recherchée dans sa parure, trop accessible aux gais propos des jeunes Romains ; mais il ignorait ce qu'elle avait fait du nom des Césars. Quand il le sut, sa colère fut terrible. Il exila sa fille ; et, par une lettre adressée au Sénat, il dévoila la honte de sa maison. Plus calme, il regretta d'avoir ainsi publié son déshonneur. Mais il demeura inflexible dans son ressentiment : et la pensée de tuer la coupable traversa même son esprit. L'affranchie Pluché, complice de Julie, s'étant, pendue, Auguste déplora qu'il ne fût pas le père de Phœbé. L'exil de la princesse l'ut des plus rigoureux ; elle ne put recevoir aucun homme dont le signalement n'aurait pas été envoyé préalablement à l'empereur. Auguste avait été atteint au cœur. Il sentait si vivement l'ignominie dont le couvrait sa fille, que pendant longtemps il fuit le monde. Lorsque le peuple le suppliait de pardonner à la coupable, il jetait aux Romains une parole pleine de colère et de désespoir : il leur souhaitait de pareilles filles et de pareilles femmes. Comment l'exilée accepta-t-elle son malheur ? Follement éprise du inonde, douée d'un esprit qui, au moindre choc d'idées, devait lancer l'étincelle, comment cette femme supporta-t-elle non pas seulement l'exil, mais la solitude ? Seule en face de sa conscience, se repentit-elle ? Se cramponna-t-elle, comme à une ancre de salut, aux purifiantes émotions de l'amour maternel ? Ah ! s'il en fut ainsi, quels nouveaux supplices durent la torturer ! La mort de deux de ses fils, ces victimes du Livie : l'exil de Julie, celle L\ FILLE D'AUGUSTE i :19 de ses filles qui avait reçu en partage la dépravation maternelle, voilà ce que l'exilée apprenait de ses enfants, sous le règne de son père. Auguste avait cependant adouci l'exil de sa fille en lui faisant quitter, pour Rhéges, l'ile de Pandateria. Mais Auguste mourut, et Tibère lui succéda ; Tibère, l'époux de Julie ; l'époux qu'elle avait d'abord aimé, puis méprisé et trahi. On sait que le premier acte du nouveau règne fut le meurtre d'Agrippa, le dernier fils de Julie. Ainsi croulait la suprême espérance de l'exilée. Enfin, après avoir subi le d'Affinent que lui avait infligé son père, Julie eut souffrir la vengeance de l'homme qui avait été son mari, et cet homme était Tibère ! Bannie de son nouveau séjour, privée de la pension et du pécule que lui avait laissés son père, et que Tibère lui-même cependant avait autrefois prié Auguste de lui conserver, la fille des Césars périt de misère et de faim[104]. Son exil avait duré trente-cinq ans. L'héritière de ses passions et de ses malheurs, sa fille Julie, mourut quatorze ans après, et ne vit se terminer qu'ainsi un bannissement de vingt années[105]. Par son testament, Auguste n'avait désigné les deux Julie que pour interdire à leurs cendres l'entrée de son tombeau[106]. Des cinq enfants que la première Julie avait mis au monde, il ne restait plus qu'Agrippine. Cette dernière petite-fille d'Auguste n'avait pas, comme sa sœur Julie, sucé le poison dés vices maternels. L'orgueil de la fille des Césars avait seul passé en elle. Cette chaste et fière créature traversa une époque de corruption et d'abaissement moral sans qu'une souillure l'atteignît, sans que la tempête qui s'acharnait contre elle courbât sa tête altière. Comme le chêne inflexible, elle fut renversée sans avoir plié. Auguste lui fit donner l'éducation élevée et sévère qui avait si mal profité aux deux Julie, mais qui produisit en elle des fruits salutaires. Agrippine était spirituelle comme la princesse à qui elle devait le jour. Suétone nous apprend qu'Auguste lui écrivit une lettre dans laquelle il louait son esprit, tout en la prémunissant contre cette recherche de langage et de style si opposée à la simplicité antique[107]. Agrippine était belle. Un buste qui la représente[108] nous donne l'idée d'un type caractérisé, rayonnant d'intelligence, et d'a la fermeté n'exclut pas la douceur. La célèbre statue du Capitole donne à Agrippine quelque chose de plus viril, de trop viril même ; mais cette accentuation des traits, cette puissante expression du visage, révèlent mieux l'énergique et fougueuse nature de l'héroïne[109]. Auguste fit épouser à cette princesse Germanicus, le digne fils de Drusus. Elle comprit le noble caractère du jeune héros, et aima son mari avec toute la passion que peut éprouver un cœur ardent. Sa tendresse conjugale, sa pureté, dirigeaient vers le bien l'impétuosité de son caractère[110]. Après la mort d'Auguste, les légions de Pannonie s'étant révoltées, et Germanicus s'étant rendu au milieu d'elles pour les calmer, Agrippine suivit son époux. Elle portait un enfant dans ses bras, elle allait en Mettre un autre au monde. Mais la révolte devenant plus menaçante, les amis de Germanicus exhortèrent celui-ci à renvoyer sa femme et son fils. Le général hésita longtemps. La courageuse Agrippine ne balançait pas, elle En restant au lieu du péril, elle voulait témoigner qu'elle n'avait point dégénéré de la race d'Auguste. Mais Germanicus prit enfin la résolution de faire partir sa compagne et son enfant : ce ne fut pas sans les serrer bien des fois contre son cœur en versant des larmes. Agrippine ne partait pas seule. D'autres épouses quittaient avec elle le camp où résidaient leurs maris. Les gémissements des fugitives parviennent aux oreilles des rebelles. Ceux-ci quittent leurs tentes. Parmi ces femmes qui fuient sans suite, sans escorte, ils reconnaissent Agrippine, Agrippine, la petite.-fille d'Auguste, Agrippine, la femme de Germanicus, Agrippine, l'épouse chaste et féconde qu'ils respectent et qu'ils aiment ! Et ce sont eux qui ont provoqué sa fuite, et c'est chez l'étranger qu'elle va chercher une protection contre eux ! L'attendrissement, la jalousie, bouleversent leurs cours. Ils s'élancent vers Agrippine, arrêtent ses pas, lui demandent de ne pas les abandonner. Une partie des révoltés reste auprès d'elle ; l'autre se rend auprès de Germanicus. Tout entier à la douleur et à la colère dont le pénètre le sacrifice qu'il vient d'accomplir, le général dit aux rebelles qu'en éloignant sa femme et son enfant, il a voulu épargner aux légions un crime affreux : le meurtre de la petite-fille et de l'arrière-petit-fils d'Auguste. Les légionnaires sont aux pieds de Germanicus ; ils implorent, avec leur pardon, le retour d'Agrippine et de son enfant. Germanicus permet que son fils lui soit ramené ; mais Agrippine allant devenir mère, il ne veut pas qu'elle s'expose à subir dans un camp les rigueurs de l'hiver[111]. Plus tard nous retrouvons Agrippine au milieu des légions romaines. Pendant zinc Germanicus navigue avec une partie de ses troupes, sa femme est restée avec les légions qui suivent la route de terre. Soudain le bruit court que les Germains ont enveloppé l'armée et qu'ils s'approchent des Gaules. La terreur accable les soldats. Agrippine entend proposer la destruction du pont qui traverse le Rhin. Elle s'y oppose ; et, assumant l'autorité et la responsabilité d'un général en chef, elle demeure à la tête du pont, louant et remerciant les légions qui lui ont obéi et qui défilent devant elle. Agrippine ne se borne pas à passer les soldats en revue, à répandre aussi des largesses parmi eux : elle reste femme pour soigner les blessés, pour subvenir au dénuement des soldats malheureux. Deux fois Agrippine a sauvé l'honneur des aigles romaines. Tibère lui en sera-t-il reconnaissant ? Ah ! pour ce prince timoré et cruel à la fois, quelle rage au contraire que de voir la petite-fille d'Auguste populaire et adorée ! Des soldats révoltés que n'avait pu subjuguer le nom de l'empereur, ces soldats ont été vaincus par la douleur d'avoir fait fuir Agrippine ! C'est encore l'ascendant d'Agrippine qui vient d'empêcher les légions romaines de flétrir leurs étendards : elle est plus que la femme de leur chef : elle est leur général[112] ! Nous nous souvenons qu'après le triomphe de Germanicus à Rome, le jeune vainqueur reçut le gouvernement suprême des provinces d'outre-mer. Agrippine l'accompagna. Nous savons quel sort attendait Germanicus. Nous savons aussi que Livie donna mission à Plancine d'humilier la fière princesse que les légions romaines avaient entourée de leurs hommages enthousiastes. Nous savons enfin que Germanicus mourant accusa Plancine et Pison de l'avoir fait empoisonner. Les dernières pensées du jeune héros furent pour Agrippine et aussi pour les six enfants qu'elle lui avait donnés. Qu'allait-il arriver à son infortunée compagne, à ses petits enfants ?[113] Puis il eut une lueur d'espoir ; il crut qu'il serait sauvé, qu'il vivrait ! Mais, dans cette lutte suprême, la mort terrassa son robuste adversaire, et Germanicus confia aux amis réunis autour de lui sa veuve et ses orphelins. Demandant à ses fidèles de venger son trépas, il ajouta ces mots : Montrez au peuple romain la petite-fille du divin Auguste, et en celle-ci ma compagne ; comptez devant lui mes six enfants[114]... Se tournant vers Agrippine, il la supplia, et pour sa mémoire, et pour leurs enfants, de fléchir devant la nécessité un caractère dont il connaissait la hauteur. Mais quand il fut seul avec elle, une tradition rapporte qu'il fit remonter jusqu'à Tibère la responsabilité de sa mort[115]. Comment une femme ardente comme Agrippine, et qui voyait mourir à la fleur de l'âge un époux adoré, comment cette femme aurait-elle pu suivre les conseils de modération que lui avait donnés l'agonisant alors que celui-ci accusait de son trépas le souverain qu'il l'avait exhortée à ménager ? Agrippine ne se souvint que de venger Germanicus ; elle oublia le reste. Ce fut en portant dans son sein les cendres de son époux bien-aimé, que la jeune veuve quitta Antioche où s'était élevé le bâcher de Germanicus. Ni la maladie qui se joignait à la douleur morale pour l'accabler, ni les rigueurs de l'hiver, ne suspendirent sa route : l'œuvre de vengeance ne supportait aucun retard. Une nouvelle épreuve lui était réservée dans ce voyage ; en longeant les côtes de la Syrie et de la Pamphylie, sa flotte rencontra les vaisseaux de Pison, Pison que Germanicus regardait comme l'un de ses meurtriers[116] ! Avant d'aborder à Brindes, la princesse prit à Corfou quelques jours de repus. Afin de pouvoir supporter les fortes émotions qui l'attendaient eu Italie, elle avait besoin de rendre à un corps et à une âme brisés la vigueur de l'action. Une foule d'hommes et de femmes couvre le port et le rivage de Brindes, et se répand sur les murs, sur les toits et les lieux élevés. Cette multitude attache son regard sur une flotte qui s'entrevoit dans le lointain. Lentement la flotte s'avance dans le morne appareil du deuil ; enfin elle entre dans le port. Agrippine descend du navire, portant l'urne sépulcrale de Germanicus, et abaissant ce fier regard où ne brillera plus la flamme d'un heureux et chaste amour. Deux des enfants d'Agrippine se tiennent auprès d'elle. A la vue de la veuve et des orphelins, à la vue de cette urne on est déposé ce qui reste du héros que Rome idolâtrait, un cri de douleur s'échappe de toutes les poitrines et se confond en une immense clameur. Jusqu'à Rome, la pompe funèbre n'est qu'une marche triomphale. Les cendres de Germanicus sont déposées au Champ de Mars, tout illuminé de flambeaux. Les soldats y sont sous les armes : les tribus du peuple y sont assemblées. Oubliant ou dédaignant le pouvoir du sombre empereur, citoyens et soldats pleurent la mort de Rome en même temps que la mort de Germanicus. Tous leurs respects, toutes leurs adorations sont pour la veuve du héros[117]. Ils la nomment l'honneur de la patrie, le seul sang d'Auguste, l'unique modèle de l'antiquité[118]. Les mains tendues vers le ciel, ils appellent sur la jeune femme les bénédictions d'en haut : ils supplient les dieux de la garder saine et sauve, et de permettre qu'elle survive aux hommes d'iniquité. Non plus que Livie, Tibère, répétons-le ici, ne parait aux funérailles de Germanicus ; mais la grande voix du peuple monte jusqu'à lui ; et l'enthousiasme excité par Agrippine alimente la haine qui couve dans le cœur du souverain. Le peuple demeura fidèle au culte qu'il avait voué à notre héroïne. Et quand la protection que Livie accordait à Plancine remplit d'une sourde indignation les vrais Romains, ceux-ci redoutèrent qu'Agrippine, et ses enfants ne devinssent aussi victimes de la haine qui avait frappé Germanicus. Un semblable pressentiment n'était que trop fondé. Ce ne fut d'abord que dans l'ombre que se trama la perte de cette famille. Séjan, le digne favori de Tibère et l'ancien ennemi d'Agrippine, continuait d'aigrir les vieilles rancunes de l'empereur et d'Augusta. Le poison n'était plus une arme sûre alors qu'il s'agissait de faire disparaître une famille entière : un châtiment public pouvait seul délivrer Tibère de sa nièce et de ses petits-neveux ; mais il fallait qu'Agrippine s'exposât d'elle-même à ce châtiment ; il fallait que ses fils fussent assez grands pour être légalement accusés. Tibère était patient : il attendit. Mais il ne négligea aucun moyen pour amener la veuve de Germanicus à se compromettre par un éclat. L'impétueuse nature d'Agrippine rendait facile l'exécution de ce plan infernal. Séjan servit dignement son maître. Si, d'un côté, il représentait à l'empereur que le parti d'Agrippine devenait menaçant ; d'un autre côté, les affidés du favori entouraient la crédule princesse et l'excitaient contre Tibère[119]. D'abord l'on atteignit la veuve dans ses affections. Après que Sosia Galla, son amie, a été condamnée, Claudia, sa cousine, est accusée. A ce dernier outrage Agrippine ne peut maîtriser son indignation. Elle accourt chez l'empereur, et le trouve sacrifiant à Auguste. Superbe de courroux et de dédain, la princesse s'écrie que ce n'est pas à celui qui outrage la postérité d'Auguste qu'il appartient d'offrir des sacrifices à sa divinité, et que l'Anne d' Auguste vit, non flans de muettes images, mais en elle, en elle la petite-fille de l'empereur. Elle ajoute qu'elle ne se méprend pas sur la cause des persécutions que souffrent ses amis : c'est elle que l'on a frappée dans Sosia Galla et dans Claudia. Devant cette explosion de colère et de mépris, le masque de dissimulation qui rendait Tibère impénétrable, ce masque faillit lui échapper. Tibère parla, ce qui était rare, dit Tacite. Saisissant le bras de la princesse, et faisant allusion à un vers grec : Si tu ne règnes pas, ma chère fille, dit-il, tu te crois donc persécutée ?[120] Dans cette lutte, Agrippine sent qu'elle ne combat pas à force égale, puisque, quelle que soit son énergie, elle ne peut opposer à la ruse et à la perfidie de ses adversaires que la loyauté de sa conduite, mais aussi la passion de son caractère. Pour le triomphe de sa cause et pour le salut de ses enfants, elle est disposée à sacrifier, s'il le faut, le souvenir du grand amour qui a rempli sa vie : elle exprime à l'empereur le désir de se remarier. Elle n'allègue que la tristesse et la solitude de son veuvage ; mais Tibère la comprend et il se tait[121]. Cependant Agrippine continue de paraître aux festins de la
cour. Mais les affidés de Séjan la préviennent que Tibère veut l'empoisonner.
A un repas qui suit cette révélation, Agrippine, muette, les yeux baissés, ne
touche à aucun mets : la veuve de Germanicus a vu l'horrible agonie de son
mari ! L'empereur observe la princesse ; il lui présente un fruit dont il lui
a vanté la saveur ; Agrippine le reçoit et le tend aux esclaves qui la
servent. Alors 'Tibère se tournant vers Augusta : Il
ne serait pas étonnant, dit l'empereur, qu'il
fût ordonné quelque chose de sévère contre celle qui me soupçonne d'être un
empoisonneur[122]. Désormais la vie d'Agrippine n'est plus qu'un long martyre. Elle avait une prédilection toute particulière pour son fils Néron, doux et modeste jeune homme qui, sans doute, lui rappelait Germanicus. Séjan excite contre Néron la jalousie de son frère Drusus. Puis Agrippine et son fils préféré sont entourés d'espions qui tiennent note de toutes leurs démarches, et leur donnent le perfide conseil de se réfugier au pied de la statue d'Auguste ou au sein des armées. Parmi les affidés de Séjan se trouve la propre femme de Néron, Julie, digne fille de cette Livilla dont nous allons parler ; Julie qui épie jusqu'aux soupirs de son époux endormi ! La terreur fait le vidé autour d'Agrippine. Un seul ami, Sabinus, reste le courtisan de son malheur. Mais il paie chèrement les larmes qu'il répand sur Germanicus et sur sa veuve : faussement accusé par Tibère d'avoir voulu attenter à la vie de l'empereur, il est traîné au supplice. En remerciant le Sénat d'avoir puni Sabinus, le sinistre habitant de Caprée fait entendre que d'antres complots menacent ses jours. Il ne désigne personne, mais l'on devine qu'il pense à Agrippine et à Néron. Après la mort de Livie, vient l'accusation formelle, retardée, nous nous en souvenons, par la politique d'Augusta. Tibère signale au Sénat les désordres du jeune Néron, l'humeur farouche de sa mère. En recevant ce message impérial, les sénateurs sont atterrés, indécis ; mais le peuple se réveille. Portant les images d'Agrippine et de Néron, il entoure le palais du Sénat, criant que les lettres attribuées à l'empereur sont fausses. Cette manifestation irrite encore le ressentiment du prince. Agrippine vit ses fils condamnés à mourir de faim. Quant à elle, reléguée dans cette île où sa mère Julie avait été exilée, elle fut réservée à d'autres supplices. Comme elle invectivait contre son persécuteur, Tibère la fit fouetter, elle, la fière et chaste matrone, par un vil centurion qui lui creva un œil. C'en était trop. Agrippine voulut se laisser mourir d'inanition. Tibère ne le permit pas. Il fallait qu'elle bût longuement, goutte à goutte, le calice de fiel et de sang qu'il lui présentait. Bien différente de son fils Drusus qui, condamné à mourir de faim, avait essayé de dévorer jusqu'à la bourre d'un matelas ; Agrippine, elle, condamnée à vivre, résista aux geôliers qui voulaient enfoncer la nourriture dans sa bouche. Elle réussit à mourir de faim. Que restait-il à cette grande ombre ? L'amour et le respect de Rome ? Tibère le craignit sans doute ; aussi fit-il déclarer néfaste le jour natal d'Agrippine ; aussi souilla-t-il de ses imputations la vertu immaculée de sa victime. Pendant qu'elle vivait, il n'osait pas attaquer l'honneur d'Agrippine : la veuve de Germanicus eût répondu à cette accusation par l'un de ces superbes élans qui écrasent le calomniateur et grandissent l'accusé innocent. Mais Tibère, nous l'avons déjà vu, Tibère ne craignait plus les morts. En peignant Agrippine si coupable, Tibère, le massacreur de femmes[123], déclara qu'elle n'avait pas été suffisamment punie. Ne devait-il pas la faire étrangler, faire traîner son cadavre aux gémonies ? Mais le grand justicier avait cédé à un sentiment de clémence. Et le Sénat rendit hommage à cette miséricorde, en publiant un décret d'actions de grâces par lequel une offrande en or était consacrée à Jupiter Capitolin, pour le remercier de la mort d'Agrippine[124] ! Essayons de reposer notre imagination, frappée par tant d'horribles spectacles. Contemplons une douce et rayonnante apparition[125], une femme dont la beauté a ce voile de modestie virginale et de grâce attendrie qui appartient surtout au type de la femme chrétienne. Le regard plein de lumière, de caresse et de sourire, ce regard est celui d'une femme heureuse... Heureuse, oui, elle le fut, mais pour bien peu de jours ! La Rome des Césars ne pouvait guère abriter un long bonheur. Cette femme dont l'aspect éveille en nous l'idée de la félicité, cette femme nous ramène encore, par ses malheurs, aux scènes lamentables que nous avons essayé de fuir. Elle se nommait Antonia ; elle fût l'épouse de Drusus, la mère de Germanicus ! Antonin devait le jour à cette touchante Octavie, dont nous avons dit l'histoire. Les œuvres sculpturales où l'on croît reconnaître ces deux matrones se trouvent au musée du Louvre ; et avant même de savoir que ce pouvaient être les images de la mère et de la fille, nous avions remarqué la ressemblance qu'elles offrent sinon par les traits, au moins par la physionomie. Antonia, cette femme si suavement belle, fut tendrement et uniquement aimée de son noble époux. Elle le vit mourir jeune, et se retira près de sa belle-mère Livie. Une grande espérance maternelle vint lui sourire dans sa retraite : son fils Germanicus faisait revivre la gloire si sympathique de son mari. Mais, lui aussi, il mourut à la fleur de rage. Antonin n'assista pas aux funérailles de ce fils ; son désespoir, ou peut-être l'ordre de Tibère et d'Augusta, la retint auprès d'eux. Vit-elle en ceux-ci les meurtriers occultes de Germanicus ? Qu'éprouva-t-elle lorsque Plancine fut reçue par Livie ? Nous ne savons rien d'elle à ce moment, sinon qu'elle eut sa part des actions de grâces qui, après le procès de Pison et de Plancine, furent rendues par le Sénat aux vengeurs de Germanicus, vengeurs parmi lesquels la flatterie ou la crainte avait osé placer Tibère et Augusta[126] ! La veuve de Drusus avait une fille nommée Livilla. Celle-ci avait épousé le fils de Tibère : complice de Séjan, elle empoisonna son mari. Séjan demanda à Tibère la main de la princesse, et l'empereur repoussa cette proposition de son favori. Alors Séjan ourdit une conspiration pour renverser son souverain. Antonia surprit le secret du complot, et fit avertir l'empereur du danger qui le menaçait. A cette époque la famille de Germanicus ; bien que proscrite, pouvait encore espérer des jours meilleurs ; mais c'en était fait d'elle si un Séjan parvenait à l'empire : ce fut sans doute pour sauvegarder les droits de ses petits-enfants que l'aïeule fit connaître au persécuteur de sa race le péril auquel était exposée la maison impériale. Mais en préparant la punition de Séjan, Antonia en avait, à son insu, provoqué une autre : celle de sa propre fille dont le crime fut découvert après huit années d'impunité. Antonia n'obtint pour Livilla qu'une grâce : c'est que la coupable subirait auprès de sa mère son châtiment, et ce châtiment était la faim, la faim jusqu'à la mort[127] ! Comment deux petits-fils d'Antonia, comment sa belle-fille Agrippine, lui furent ravis par la cruauté de Tibère, nous l'avons dit. Il lui restait un fils, pauvre d'esprit, objet de honte pour son amour-propre maternel, et qui devint l'empereur Claude. Elle avait aussi un petit-fils, né de Germanicus et d'Agrippine, enfant qu'elle avait sauvé, et qu'elle surprit alors qu'il corrompait Drusilla, sa propre sœur ! Ce monstre était Caligula. Et quand ce dernier fils d'Agrippine fut empereur, il persécuta à un tel point sa vieille aïeule, qu'Antonia se laissa périr d'inanition[128]. Il est vrai que, d'après une autre donnée, elle fut peut-être empoisonnée par Caligula. Et cependant, au début de son règne, le nouveau souverain avait fait accorder à son aïeule, par un sénatus-consulte, les mêmes honneurs dont avait joui la première impératrice romaine. Alors aussi, il avait été chercher les cendres de sa mère et celles d'un de ses frères. Il les avait pieusement déposées dans des urnes, et solennellement transportées à Rome où elles étaient venues prendre leur place dans le Mausolée, le sépulcre impérial. Caligula ordonna que des jeux funéraires fussent annuellement célébrés en leur honneur, et que l'image de sa mère fût, comme la statue d'une déesse, placée dans un carpentum[129] et menée en pompe aux jeux du Cirque. Ce n'était pas au lâche adulateur de Tibère qu'il appartenait d'honorer les victimes de celui-ci, ces victimes dont le sort ne lui avait pas arraché une plainte du vivant de leur persécuteur[130]. Caligula, qui épousait des femmes mariées, ne tardait pas
à les répudier. Cependant il demeura fidèle à sa dernière épouse, Césonie,
créature dépravée, qui n'était ni jeune ni belle, mais dont il était si fier
qu'il la montrait à ses soldats, couverte du manteau militaire, la chlamyde ;
armée d'un casque et d'un bouclier, et se tenant à cheval auprès de lui. Il
s'étonnait lui- même de pouvoir ressentir un tel amour, et féroce jusque dans
sa tendresse, il disait quelquefois qu'il ferait mettre sa Césonie à la
question afin de savoir d'elle-même pourquoi il l'aimait tant[131] ; propos bien
digne du fou sanguinaire qui n'embrassait jamais sa femme sans prononcer
cette parole : Une si belle tête sera coupée dès que
je l'ordonnerai[132]. En modifiant
un mot célèbre, l'on pourrait dire que chez Caligula la cruauté était le plaisir des autres plaisirs. Caligula, Césonie et leur enfant ont été massacrés. Claude est empereur. Parmi les premiers actes de son gouvernement, figurent les honneurs qu'il rend à la mémoire de Livie et à celle d'Antonia. Il semble avoir ainsi oublié combien son aïeule et sa mère l'ont dédaigneusement jugé d'après son extérieur stupide et gauche. Livie reçoit de ce petit-fils si méprisé d'elle les honneurs de l'apothéose que lui avait refusés le fils à qui elle avait donné l'empire du monde. A la nouvelle déesse est attribué un char traîné par des éléphants pendant les pompes du Cirque : tel était le char d'Auguste. Quant à la mère de Claude, des sacrifices publics sont offerts à ses mânes, et son image est promenée au Cirque dans un carpentum[133]. Claude, cet homme naturellement bon, mais d'une extrême faiblesse, subira l'influence de deux femmes qui feront de lui le digne successeur de Caligula, le digne prédécesseur de Néron. Nous ne suivrons pas Messaline dans ses honteux déportements ; c'est assez, c'est même trop de devoir dire que cette impératrice, qui suivait sur son carpentum le char triomphal de son époux, se plaisait à quitter pour un infâme repaire le palais des Césars. Mais il ne lui suffit pas de donner pour rivaux à l'empereur les moindres de ses sujets : lui vivant, elle se remarie sans même lui avoir signifié la répudiation. Moins entrainée par la passion de l'amour que par l'attrait nouveau d'un crime sans exemple, Messaline, épouse Silius, le plus beau des Romains. La cérémonie matrimoniale s'accomplit suivant les rites, la dot est comptée devant les augures, la fête nuptiale est brillante. Lorsque l'empereur est instruit de ce fait inouï, il est saisi de terreur : il craint d'avoir été remplacé aussi bien comme empereur que comme mari ; et Claude se réfugie dans le camp des prétoriens. Puis il revient à Rome. Messaline préside à une bacchanale célébrée dans son palais. Informée du retour de l'empereur, elle se sauve dans les jardins de Lucullus. Cependant elle ne désespère pas de sa cause : elle n'ignore pas quel est son empire sur le faible Claude, et elle le juge assez insensé pour qu'en la revoyant il oublie tout, hors l'amour qu'elle lui a inspiré. Elle va donc au-devant de lui. L'impératrice ne trouve d'autre voiture qu'un de ces tombereaux qui enlèvent la boue : digne char de la souveraine qui ne vivait que dans la fange ! Le tombereau rencontre la voiture de l'empereur. Messaline crie du prince qu'elle est la mère de ses enfants, qu'il ne doit pas la condamner sans l'avoir entendue. Peut-être Claude qui, pendant le trajet, a parlé de la coupable tantôt avec indignation, tantôt avec attendrissement, peut-être Claude se laisserait-il toucher ; mais l'affranchi Narcisse est auprès de lui, et Narcisse est devenu l'ennemi de Messaline. Plus haut qu'elle encore, il élève la voix pour rappeler à l'empereur la scène scandaleuse qui a rendu l'impératrice bigame. Mais la voix seule de l'affranchi couvre la voix de la jeune femme : Claude qui ne peut plus entendre l'impératrice, peut encore la voir, et fléchir devant sa beauté. Pour occuper les yeux du prince, Narcisse lui fait lire un mémoire où sont consignés les débordements de Messaline. L'empereur lit, la voiture roule vers Rome : Messaline est vaincue. C'est aussi Narcisse qui renvoie les intercesseurs que la coupable a députés vers son mari ; ses petits enfants, Octavie et Britannicus ; et cette souveraine puissance : la grande Vestale. Claude se taisait toujours. Silius et les autres complices de Messaline sont punis de mort. L'impératrice est retournée dans les jardins de Lucullus. Elle espère encore, et non sans raison ! L'empereur, qui s'est mis à table plus tôt que de coutume, est disposé à l'attendrissement par le vin et la bonne chère ; il ordonne que l'on fasse venir cette pauvre femme. Narcisse comprend que les rôles vont être intervertis ; et que, d'accusateur. Il va devenir accusé. Il quitte précipitamment l'empereur ; et, au nom de son maître, donne aux soldats de garde l'ordre d'aller tuer Messaline. Toujours dans les jardins de Lucullus, l'impératrice, étendue à terre, a perdu toute espérance. Pleurant et gémissant, elle ne veut pas mourir. Lépida, sa mère, autrefois outragée par elle, est revenue près d'elle à ce moment d'expiation suprême. Lui présentant une épée, Lépida la sollicite en vain de devancer la sentence de son juge. C'est alors que paraissent les exécuteurs. Messaline, sentant qu'elle est perdue, s'arme du fer ; mais elle ne peut que l'approcher de son sein ; elle n'a pas le courage de s'en frapper, et c'est sous l'épée du tribun des soldats que l'impératrice tombe morte. Messaline atteinte du châtiment suprême dans les jardins de Lucullus, ces jardins achetés par elle au prix d'un exécrable forfait, ah ! c'était là une juste punition du ciel ! Un jour, au temps de sa puissance, elle convoitait ces célèbres ombrages. Mais Asiaticus les possédait. Le propriétaire de ces jardins fut accusé d'un crime imaginaire. Il se défendit devant l'empereur avec la noblesse d'un patricien et la loyauté d'un soldat ; et l'impératrice, qui était présente à cet entretien, fut émue jusqu'aux larmes. Elle se retira pour cacher son trouble ; et tandis qu'elle essuyait ses pleurs, elle parla à Vitellius, cet indigne courtisan qui, une fois, lui ayant demandé comme une faveur insigne la grâce de la déchausser, lui avait ravi un mignon soulier, le gardait entre sa tunique et sa loge, et le portait de temps en temps à ses lèvres ! Pour tramer la perte d'Asiaticus, Vitellius était le complice de Messaline. Que lui dit-elle, alors que ses yeux étaient encore humides de l'émotion que lui avait fait éprouver Asiaticus ? Bien certainement elle lui avouait qu'elle renonçait à poursuivre ce noble Romain ? Non. Tout en s'attendrissant sur l'homme qu'elle persécutait, elle recommandait à Vitellius de ne pas le laisser échapper[134]. Ce fut ainsi que Messaline acquit, avec les jardins de Lucullus, le lieu de son propre supplice. On annonça simplement à Claude que l'impératrice était morte. Il ne demanda pas comment. Il se fit verser à boire et acheva son repas. Cette insensibilité ne se démentit point les jours -suivants. Toutefois, quelque temps après, en se mettant à table, Claude eut une distraction qui lui fit demander pourquoi madame ne venait pas[135]. Ce n'était qu'au gré de ses brutales passions, que Messaline se servait de l'empire qu'elle exerçait sur Claude. Lui imposait-elle des arrêts de proscription, c'était pour satisfaire les haines aveugles que lui inspirait ou la jalousie, ou l'amour déçu, ou la cupidité, ou l'aspect de la vertu, ce reproche muet ! Nulle ligne politique dans sa conduite. Messaline va où la mène cette nature bestiale que révèle si bien la statue du Louvre[136]. Aucune lueur d'intelligence n'éclaire la beauté seulement plastique du visage. Quelque chose de bas et de méchant se lit dans la physionomie ; le regard est celui de la bête fauve convoitant sa proie et semblant menacer ceux qui ne lui permettraient pas de la saisir. Telle ne sera pas la femme qui va prendre la place de l'épouse châtiée. Certes, Agrippine qui porte le même nom que la veuve de Germanicus, sa mère[137], Agrippine n'a point reçu en partage l'inviolable pureté de cette grande matrone ; elle n'a hérité que de l'orgueil et de la violence qui perdirent la première Agrippine ; et si elle y joint l'astuce de Livie, sa bisaïeule paternelle, elle possède malheureusement aussi la dépravation de son aïeule maternelle, Julie. Mais, à la différence de Messaline, Agrippine est mesurée dans ses débordements ; le vice n est pour elle qu'un moyen d'assouvir son ambition politique. Pour dominer, l'orgueilleuse fille des Cc sacs se donne à un affranchi de Claude, le tout-puissant Pallas[138] ; elle prodigue ses séductions à Claude, son oncle, et contracte avec lui une alliance matrimoniale que les Romains considèrent comme incestueuse[139]. Mais qu'importait à cette femme qui, corrompue dès sa jeunesse, ainsi que sa sœur, par son propre frère, l'horrible Caligula, allait, dans son âge mûr, corrompre son propre fils, Néron, pour tenter de raffermir sa domination chancelante ! C'est avec une profonde répulsion que la plume se prête à retracer de si exécrables actions ; mais, pour bien comprendre l'immense bienfait du christianisme, n'est-il pas nécessaire d'indiquer, ne fût-ce que par un geste de souverain mépris, la dégradation de cette société qu'allait régénérer la foi de l'Évangile ? Après qu'Agrippine fut devenue la femme de l'empereur,
l'on eût pu croire qu'une nouvelle Livie venait de prendre les rimes du
pouvoir. Avec la brutale Messaline, tout gouvernement était impossible. Si
l'on nous permettait d'employer une vieille métaphore, nous dirions que le
vaisseau de l'État allait à la dérive, sans autre direction que celle que lui
imprimaient ces flots aveugles : les passions de Messaline ! Messaline était
la mer orageuse qui secouait le navire. Agrippine fut le pilote dont la main
vigoureuse saisit le gouvernail. Son joug fut grave
et presque viril[140], nous dit
Tacite. Le peuple romain retrouvait quelque dignité dans l'obéissance que lui
imposait, non sans hauteur cependant, la fille de Germanicus, la femme qui
lui avait inspiré une sympathique pitié alors que, revenue de l'exil auquel
l'avait condamnée Caligula, elle s'était trouvée exposée à la haine de
Messaline[141]. Mais pour que la nouvelle impératrice eût pu reprendre le rôle de Livie, elle aurait dû, comme sa bisaïeule, se posséder elle-même, et cet empire lui manqua trop souvent. Son enfance, son adolescence, furent trop agitées pour que la fougueuse nature qu'elle avait reçue de sa mère eût pu être contenue. Née dans cette Germanie où sou père et sa mère étaient obéis comme des souverains et adorés comme des dieux, elle se trouvait, à l'âge de deux ans, parmi les cinq enfants de Germanicus que le doux héros avait placés sur le char triomphal qui le ramenait à Rome. L'année suivante elle perdait son père. Elle grandit au souffle orageux des luttes que la veuve de Germanicus soutenait contre Tibère, et qui eurent pour résultats l'exil et la mort de la première Agrippine et de deux de ses fils. La seconde Agrippine garda toujours l'empreinte des influences sous lesquelles elle était entrée dans la vie. En vain eut-elle recours à la ruse, si familière à Livie ; plus d'une fois le masque tomba, et mit à découvert un visage plein de passion. L'un des bustes d'Agrippine[142], en quelque mauvais état qu'il nous soit parvenu, reproduit bien le vrai caractère de cette femme. Ce buste nous met en présence d'un visage presque masculin et tout à fait composé ; mais le trouble de l'âme ne réussit pas à s'y dissimuler. Quelque chose d'inquiet et de contracté se découvre dans cette physionomie, et nous reporte bien loin du calme superbe et de la grâce souriante de Livie. La femme d'Auguste n'est homicide que pour détruire les obstacles qui s'opposent à sa domination ; elle ne les renverse : pas bruyamment : elle les fait disparaitre avec tant de mystère, que l'histoire ne peut même établir d'une manière certaine sa culpabilité. Agrippine commet plus ouvertement la plupart de ses crimes. Sans doute, comme l'a fait Livie, c'est dans l'ombre que cette veuve, devenue femme d'empereur, substitue sa propre race à celle de son second mari[143] ; comme a pu Je faire Livie, c'est encore dans l'ombre qu'elle trame la mort de l'époux impérial, quand elle a surpris en lui le regret d'avoir sacrifié son propre sang au fils d'une nouvelle épouse[144] ; comme Livie, c'est aussi dans l'ombre qu'en taisant la mort du souverain, elle prépare l'avènement d'un autre règne[145]. Ce sont là de ces crimes politiques qui lui sont communs avec sa bisaïeule. Mais l'histoire ne nous dit pas que Livie ait avoué ses forfaits, tandis qu'Agrippine a fait valoir les siens comme un titre à la reconnaissance de son fils. Agrippine met aussi dans ses crimes un acharnement inconnu de Livie ; et même tous ne lui sont pas dictés par cette ambition politique à laquelle cédait uniquement la compagne d'Auguste. Une femme a osé se mettre en concurrence avec Agrippine pour épouser l'empereur : l'impératrice la fait bannir, puis elle l'oblige de se tuer. Une autre femme doit sa perte à une beauté que Claude a simplement et indifféremment remarquée[146]. Agrippine fait mourir sa cousine Domitia parce que celle-ci se prétend son égale et qu'elle cherche à exercer une influence sur Néron[147]. Nous faudra-t-il mettre ces persécutions au compte des ressentiments féminins d'Agrippine ? Ne nous y trompons pas ici ! Si elle frappe les femmes qui ont pu, ou qui pourraient, la supplanter auprès de son mari ou de son fils, c'est pour assurer la stabilité de son empire. C'est encore pour sauvegarder la durée de son pouvoir qu'elle fait mourir les deux gouverneurs de Britannicus, fils de Claude, hommes qu'elle croit capables de rappeler au jeune prince les droits qu'une marâtre lui a fait perdre[148]. Mais lorsque, sous prétexte de veiller aux besoins de l'État, elle pressure les Romains ; lorsque, pour posséder des jardins qui lui plaisent, elle fait accuser l'homme à qui appartient cette propriété, alors ce n'est plus par l'ambition politique d'une Livie qu'elle se laisse inspirer : c'est par la cupidité d'une Messaline[149]. Sous le règne de Claude, Agrippine accumule tant
d'honneurs et exerce une si grande autorité qu'elle semble parvenue à
l'apogée de sa puissance. Elle est nommée Augusta ; le lieu de sa naissance
devient une colonie de vétérans qui porte son nom : Agrippina Colonia, la moderne Cologne[150]. Placée sur une
haute estrade que l'on a dressée dans une plaine qui borde le camp des
prétoriens, Agrippine partage, devant ces soldats, les hommages qu'un roi et
une reine vaincus offrent à l'empereur : Fait assurément
nouveau et peu habituel aux anciennes mœurs, dit Tacite, qu'une femme présidât aux enseignes romaines ; mais
celle-ci prétendait être associée à un empire né de ses ancêtres[151]. Non-seulement
Agrippine a, comme impératrice, la garde prétorienne, mais encore, par une
faveur spéciale, la garde germaine[152]. Couverte d'une
chlamyde brodée d'or, elle préside, non loin de Claude, à un combat naval où
figurent dix-neuf mille hommes. Ce n'est pas tout. Comme les statues des
déesses, elle obtient, seule entre toutes les mortelles, l'insigne honneur de
gravir le Capitole dans un carpentum[153]. Il ne semble pas qu'il fût possible d'ajouter litant de distinctions. Cependant le règne de Néron vint encore en accroître le nombre. Sur les monnaies de cette époque, c'est la face qui nous offre le nom d'Agrippine, et c'est au revers qu'il faut chercher le nom de l'empereur. Le premier jour du nouveau règne, quand un tribun des soldats vient demander à Néron le mot d'ordre, l'empereur répond : La meilleure des mères[154]. Ainsi que la veuve d'Auguste, Agrippine devient la prêtresse de l'époux défunt qu'elle est accusée d'avoir envoyé chez les dieux. Mais, plus heureuse en ceci que Livie, elle ne voit pas son fils s'opposer à d'autres hommages que lui offre le Sénat. Livie s'est vu refuser par Tibère un unique licteur : Agrippine en reçoit deux. Loin de se montrer, comme Tibère, jaloux de l'autorité maternelle, Néron abandonne à l'impératrice-mère une immense influence. Le Sénat ne permet pas à la femme de pénétrer dans son enceinte. Eh bien ! le Sénat se réunira chez l'empereur, afin qu'Agrippine, cachée derrière un voile, puisse assister à ses séances[155]. Mais cela ne suffisait pas encore à l'orgueilleuse fille des Césars. Un jour que l'empereur reçut les ambassadeurs arméniens, elle entra dans la salle d'audience. Elle allait se mettre auprès de son fils quand Néron, bien inspiré ici par Sénèque, se leva, et vint au-devant de sa mère comme pour lui faire honneur, mais en réalité pour arrêter les pas de la princesse[156]. Agrippine trouvait naturel le rôle omnipotent qu'elle remplissait. Ainsi que le fait remarquer Tacite, elle avait voulu que son fils eût l'empire, mais qu'il ne l'exerçât point. Elle ne témoignait à Néron aucune reconnaissance pour les honneurs qu'il lui rendait, et qu'elle croyait lui être dus. Elle ne montrait à ce fils soumis qu'un visage menaçant. Mais dès les premiers temps du règne du Néron, elle vit son influence combattue par les deux gouverneurs qu'elle-même avait donnés à son fils ; Sénèque et Burrus. Ceux-ci ne permirent pas que l'impératrice-mère continuât de suivre la politique sanguinaire qu'elle adoptait[157]. Une femme leur vint en aide pour soustraire l'empereur au joug maternel : Néron aima l'affranchie Acté, et cet amour le rendit moins empressé auprès de sa mère. La dureté avec laquelle Agrippine reprocha à son fils de lui préférer une affranchie éloigna d'elle plus encore le jeune prince[158]. Ce fut alors que, pour ressaisir le pouvoir qui lui échappait, Agrippine eut la monstrueuse idée de commettre le crime[159] dont un infâme calomniateur devait, dix-sept siècles plus tard, accuser une reine martyre en l'appelant une nouvelle Agrippine. Et certes ce n'est pas la mère de Néron qui aurait pu prononcer cette sublime parole de Marie-Antoinette : Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille question faite à une mère... J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici ! Tacite fait remarquer que la mère de Néron fut aussi outrée dans ses viles complaisances qu'elle l'avait été naguère dans son orgueilleuse sévérité. A peine se fut-elle imaginé qu'elle avait repris sur l'empereur l'ascendant d'autrefois, qu'elle redevint exigeante, impérieuse. Parmi les parures qu'avaient laissées les précédentes impératrices, Néron choisit pour sa mère le plus riche vêtement, les plus belles pierreries, et lui envoya ce souvenir. Loin d'accepter ce don avec reconnaissance, Agrippine se plaignit de ce que son fils, en lui offrant une partie seulement de ces parures, lésait les droits qu'elle prétendait avoir sur le tout. Ce propos fut rapporté à l'empereur par des interprètes qui en exagérèrent encore l'amertume[160]. Bientôt commença la disgrâce publique d'Agrippine. L'affranchi Pallas, son complice, se vit enlever la charge qu'il occupait à la cour. A cette nouvelle, Agrippine se laissa emporter par le torrent de son impétueuse nature. Perdre le pouvoir suprême, alors que, pour l'assurer, elle était tombée plus bas que Messaline ! Devoir sa chute à ce même fils qu'elle avait cru enchaîner par un pacte infernal, quelle torture pour son orgueil ! Agrippine perdit toute mesure. Ce n'est point ici la sévère indignation de Livie lorsque Tibère se montre récalcitrant à son joug : Livie pouvait parler en mère, parce que, malgré ses crimes, elle avait gardé intacte la dignité maternelle. Mais Agrippine n'avait plus aucun droit à la vénération de son fils. Ne pouvant plus se faire respecter, elle voulut se faire craindre. Sa fureur éclata en cris et en invectives. Agrippine menaça Néron de porter son appui à Britannicus, le souverain légitime ; et d'avouer même, pour le faire triompher, les crimes qu'elle avait commis pour l'écarter du pouvoir. Cette menace fut l'arrêt de mort de Britannicus. Agrippine assistait au repas pendant lequel le fils de Claude tomba foudroyé. Elle vit avec consternation périr sa dernière espérance[161] ; mais non, ce n'était pas la dernière ! Agrippine chercha un autre marchepied pour son ambition. Elle groupa, autour d'elle les hommes les plus honorés, semblant chercher parmi eux un chef de parti. Les entretiens mystérieux qu'elle avait fréquemment avec ses amis, la grande bienveillance qu'elle témoignait aux tribuns, aux centurions, tout disait qu'elle espérait donner encore un trône. Néron s'en douta. Il retira à l'impératrice la garde prétorienne et la garde germaine, et l'éloigna de son palais. Retirée dans une maison où avait naguère vécu sa grand'mère Antonia, Agrippine fut délaissée de ses courtisans. De rares amitiés la suivirent dans la solitude : elle y trouva aussi la trahison. Son ancienne amie Julia Silana, femme que Silius avait répudiée pour plaire à Messaline, Julia Silana fit savoir à Néron qu'Agrippine avait déjà choisi son successeur. Néron le crut : il voulut faire mourir sa mère. Retenu par de sages avis, il permit que Burrhus et Sénèque allassent interroger Agrippine. Abreuvée d'outrages, l'impératrice retrouve, dans cette suprême humiliation, cet accent maternel qui lui manque devant Néron, mais qu'elle peut prendre encore devant tout autre que son fils. Elle dit qu'une femme qui n'est pas mère peut seule accuser une mère de vouloir détrôner son fils. Qu'aurait-elle donc à attendre d'un nouveau règne, sinon des accusations ayant pour objet, non ces paroles imprudentes qui sont le langage de la tendresse irritée, mais ces crimes, dit-elle, dont je ne puis être absoute que par mon fils ! Devant ce cri de douleur, devant cette justification qui ne reculait même pas devant l'aveu de certains forfaits, l'émotion saisit les auditeurs d'Agrippine. L'impératrice entra chez Néron, sans se disculper elle-même, sans rien reprocher cette fois à son fils, ne demandant que le châtiment de ses délateurs, la récompense de ses amis. Néron fut vaincu : il obéit[162]. Les témoins de cette scène, ceux qui ignoraient à quel point Agrippine s'était dégradée devant son fils ; et ceux qui, le sachant, en doutaient ou refusaient d'y croire, ceux-là pouvaient être émus de sa fière et douloureuse justification. Quant à nous, Agrippine eût-elle été une Messaline, eût-elle commis tous les forfaits, hors celui qui lui enleva son caractère maternel, nous aurions, nous aussi, tressailli à cette revendication d'une mère ! Mais, en nous rappelant combien cette femme souilla, au profit de son ambition, le titre le plus sacré de la nature, nous ne voyons dans sa nouvelle attitude que la révolte de l'orgueil, et aussi, l'audace du mensonge. Nous ne croyons pas Agrippine quand elle nous dit que c'est pour assurer l'empire à son fils qu'elle s'est rendue criminelle : ce n'était pas pour son fils, c'était pour elle-même ! Quand naguère les devins lui ayant annoncé que son fils serait empereur, mais aussi parricide, Agrippine disait : Qu'il me tue pourvu qu'il règne ! c'était la soif de sa propre domination qui lui arrachait ce cri sauvage. Nous croyons donc au complot tramé par Agrippine contre Néron : tout en admirant l'éloquente énergie de sa défense, nous en récusons la véracité. Comment oublierions-nous ici le grand poète français qui a su reproduire la figure d'Agrippine avec un relief digne de Tacite ? L'Agrippine de notre scène tragique est bien la mère impérieuse qui ne montra d'abord à son fils qu'un visage menaçant ; c'est bien la femme qui n'a donné à Néron le souverain pouvoir que pour l'exercer elle-même, et qui est prête à le lui ravir s'il, ne permet plus qu'elle en dispose. Seulement les convenances de la scène n'ayant pas souffert que la princesse parût dans sa dégradation maternelle, Agrippine garde dans son rôle une noblesse qu'elle ne put avoir dans sa vie réelle. Ce n'est que devant des étrangers que Racine lui fait proférer la-menace d'abandonner Néron pour Britannicus, cette menace que, dans les annales romaines, elle jette avec colère à la face de son fils. Racine eût craint d'abaisser la dignité de la mère en la livrant devant son fils à un tel emportement. Mais en revanche, c'est aussi parce que, dans son œuvre, cette dignité est sauve, que le poète français a pu faire prononcer à Agrippine, devant son fils même, la fière et maternelle justification à laquelle Tacite ne donne pour témoins que des tiers. Reprenons le récit historique. Agrippine triomphait ; mais son règne ne fut pas de longue durée. Une femme encore vint détruire sa prospérité renaissante. Ce n'était plus, comme Acté, une pauvre fille qui n'avait peut-être pas conscience des tourments qu'elle causait à la mère de Néron ; c'était une fière patricienne qui voulait être impératrice : c'était Poppée. Mais l'empereur était le mari d'une autre, cette malheureuse Octavie, qu'Agrippine avait donnée à Néron en l'arrachant à un fiancé qui s'était tué de désespoir ; cette malheureuse Octavie qui maintenant voyait dans son époux le meurtrier de son frère Britannicus. Cette douce et timide créature, aussi chaste que sa mère Messaline avait été impudique, ne savait que souffrir en silence. Mais après l'empoisonnement de Britannicus, Agrippine s'était rapprochée d'elle et ne la quittait plus. Poppée savait que tant qu'Agrippine vivrait, Octavie serait la femme de l'empereur : Poppée excita Néron au parricide. Agrippine fut de nouveau délaissée par son fils. Puis, comme elle se trouvait à sa villa d'Antium, elle apprit que Néron, alors à Baïes, parlait d'elle avec une affectueuse indulgence. Elle alla le rejoindre, non sans crainte cependant, si, comme on l'assure, elle avait été prévenue d'un complot tramé contre ses jours par son fils. Mais elle oublia tout en revoyant l'empereur qui était venu au-devant d'elle et qui la serra dans ses bras. Il la conduisit dans la villa de Baule, pittoresquement située entre le cap Misène et le golfe de Baïes, et tout enveloppée de lagunes. Othon, le mari de Poppée, et aussi le complice de l'empereur ! Othon a offert un grand repas à Néron et à la mère du prince. Les plus doux épanchements président à ce festin. Néron, comme un enfant qui pense tout haut devant sa mère, parle à Agrippine avec l'expansion du cœur ; ou bien, grave et mystérieux, le prince prend le langage mesuré de l'homme politique qui s'ouvre de ses desseins à un confident privilégié. Depuis longtemps il fait nuit, et la mère et le fils sont encore à table. Enfin Agrippine va partir ; son fils l'accompagne et lui fait ses adieux avec d'étranges démonstrations de tendresse. Un magnifique vaisseau attend l'impératrice. Un temps des plus favorables promet à la voyageuse une agréable navigation. C'est la nuit, mais une véritable nuit d'Italie. La mer est en repos ; le ciel, irradié d'étoiles. La nature semble s'être parée pour le triomphe d'Agrippine. L'impératrice est étendue sur un lit ; une femme de sa cour, Acerronie, penchée sur les pieds de cette couche, entretient joyeusement Agrippine de la faveur qui lui est rendue. Tout à coup, un horrible craquement se fait entendre ; le plafond s'écroule et tue un courtisan de l'impératrice. Mais Agrippine et son amie ont été protégées par le dais du lit ; et bien que le vaisseau ait été disposé pour s'entrouvrir à un signal, ce sinistre est prévenu par ceux des marins qui n'ont pas été initiés au complot de Néron. Acerronie appelle à son secours, s'écriant qu'elle est la mère de l'empereur : ce titre usurpé, qui lui a paru être le gage de son salut, devient la cause de sa mort. Les sicaires de Néron frappent de leurs crocs et de leurs raines la femme qu'ils prennent pour la mère de l'empereur : Acerronie est tuée. Quant à l'impératrice, elle ne prononce pas une parole qui puisse la trahir. Blessée à l'épaule, elle peut cependant nager. Enfin des barques lui permettent d'atteindre au rivage. L'impératrice se fait transporter à sa villa. Agrippine repasse en elle-même tous les événements de cette journée ; elle a tout vu, tout compris ; mais elle paraitra tout ignorer. Elle fait dire à l'empereur qu'elle a échappé à un grave danger, mais que, malgré la terreur que fera éprouver au prince le sentiment filial, elle de prie de ne pas la visiter immédiatement : elle a besoin de repos. Néron est, en effet, saisi d'effroi, non de ce que sa mère ait été exposée à un grand péril, mais de ce qu'elle ait pu s'y soustraire en sachant quel homme le lui a fait courir. Le prince se représente la fille de Germanicus excitant une révolte ou dénonçant au Sénat et au peuple Néron le parricide. De sa villa ne peut-il pas voir cette foule que l'annonce du naufrage d'Agrippine attire sur le rivage, et qui ne croit néanmoins qu'à un accident fortuit ! Ces flambeaux qui brillent dans la nuit, ce peuple qui monte jusque sur des barques et s'avance dans la mer, ces clameurs qui s'élèvent, ces mains qui s'étendent avec angoisse, ces vœux qui montent vers le ciel, tout dit à l'empereur combien l'arrière-petite-fille d'Auguste est encore populaire. Néron prend un parti : il fera périr avec sa mère le secret qu'elle possède. Mais quelle main armera-t-il contre elle ? Nul soldat ne voudra souiller son glaive d'un sang qui est le sang de Germanicus. Un affranchi seul pourra avoir ce courage : Anicétus, l'homme qui commande la flotte de Misène, et qui a fait construire le vaisseau d'où l'impératrice s'est échappée. Pour cacher le parricide qu'il médite, Néron dira que le messager que vient de lui envoyer Agrippine a voulu attenter aux jours de l'empereur. Après l'assassinat de la princesse, Néron pourra ainsi prétendre qu'elle s'est tuée en apprenant qu'elle n'a pas réussi à faire mourir son fils. Agrippine est demeurée dans sa villa. Toujours cupide, même au sein du péril le plus redoutable, elle fait rechercher le testament d'Acerronie et mettre sous le scellé les biens de cette femme. Généreuse amitié que celle qui unissait ces deux Romaines ! Acerronie se sert du nom d'Agrippine pour se faire sauver aux dépens de l'impératrice : seulement, au lieu de vivre à sa place, elle meurt à sa place. Agrippine, à peine échappée au naufrage, songe à s'approprier les biens de l'amie qui a voulu s'approprier sa vie et qui ne s'est approprié que sa mort. Cependant l'impératrice remarque le vide qui se fait autour d'elle. Agrippine devient anxieuse. Une seule esclave est auprès d'elle ; sa chambre n'est éclairée que par une faible lumière. La princesse entend du bruit... Ce sont ses assassins qui approchent. Un coup de bâton atteint Agrippine à la tête ; mais la mère de l'empereur désigne un autre but au glaive de l'un des meurtriers : c'est le sein qui a porté Néron. Étrange rapprochement ! c'est à deux mères ambitieuses que Rome a dû ses deux plus célèbres tyrans ; et toutes doux ont été haïes des fils qui leur devaient la souveraine puissance. Tibère a refusé à Livie les honneurs que lui offraient ses sujets ; il l'a abandonnée, même à l'heure où elle mourait ! Néron, lui, a comblé Agrippine d'hommages et de respects ; mais il a commis un crime devant lequel Tibère eût reculé : il a fait périr sa mère ! Agrippine vient de mourir, et déjà l'épouvante a saisi le parricide. Tout lui fait peur : les ténèbres au sein desquelles son crime a été perpétré, la mer et les rivages qui ont vu se consommer cet acte exécrable. Puis des faits mystérieux ajoutent à son épouvante : l'on a entendu sur les coteaux le son d'une trompette ; des cris plaintifs s'élèvent de la tombe d'Agrippine. Néron s'enfuit de Baïes ; mais les furies vengeresses le poursuivent. Il joue alors au naturel le rôle d'Oreste qu'il représentera plus tard sur le théâtre : Ce ne sera pas sans motif apparemment que l'impérial acteur choisira, en artiste consciencieux, un ride dont nul mieux que lui ne saurait exprimer les tragiques horreurs. En vain Néron accuse-t-il publiquement Agrippine d'avoir voulu l'assassiner et soumettre Rome à l'autorité d'une femme. En vain le peuple et le Sénat, courbés sous le joug d'une égale terreur, rivalisent-ils de bassesse pour accueillir le parricide ; en vain les femmes elles-mêmes revêtent-elles leurs habits de fête pour recevoir l'homme qui a tué sa mère ; en vain, avant même que Néron ait osé rentrer dans Rome, des prières publiques, des offrandes, des jeux solennels ont-ils été votés pour remercier les dieux d'avoir sauvé le prince et la république ; en vain l'empereur monte-t-il au Capitole pour joindre ses actions de grâces à celles de ses sujets, la conscience du meurtrier parlera plus haut encore que l'adulation de cette multitude affolée par la peur ! Le Sénat déclare néfaste le jour natal d'Agrippine ; mais les terreurs du parricide, mais le soleil qui, en s'éclipsant, parait craindre de souiller sa lumière au contact d'un monstre, mais la foudre qui tombe sur les quatorze régions de la ville où règne le maudit ; tous ces présages, toutes ces angoisses, font certainement trouver à Néron que le jour qui a vu naître sa mère est moins néfaste que celui qui l'a vue mourir. Par la magie, il essaiera inutilement d'évoquer et d'apaiser l'ombre irritée. A la porte même du temple d'Éleusis, il s'arrêtera effrayé, pendant cette nuit solennelle où le héraut éloignera des mystères les impies et les criminels. Quelque perverse que fût Agrippine, et bien qu'elle eût abdiqué son titre de mère, l'homme qu'elle avait mis au monde ne pouvait l'en faire sortir. Pour tuer une mère, même une Agrippine, il fallait à un fils l'Arne d'un Néron. Le remords seul, et non le repentir, pouvait visiter le cœur de ce prince. Si, après la mort de sa mère, il eut un moment de clémence, ce fut pour rappeler à Rome celles des victimes de l'impératrice que la mort n'avait pas soustraites à cette tardive générosité qui était non un hommage à l'humanité, mais un nouvel outrage à la mémoire d'Agrippine. Puis Néron s'abandonna librement aux passions que la crainte d'une mère, quelle qu'elle fût, dit Tacite, avait cependant contenues[163]. La femme de Néron était le dernier obstacle qui séparât Poppée du trône. L'empereur répudia l'une pour épouser l'autre, et la douce Octavie fut mate reléguée dans la Campanie. Mais cet exil dut cesser devant le cri du peuple. Lorsque les Romains surent que la victime de Poppée était rappelée au milieu d'eux, ils abattirent les statues de la nouvelle impératrice ; et portèrent en triomphe les images d'Octavie, couronnées de fleurs. Mais Poppée, abaissant son orgueil jusqu'à tomber aux pieds de Néron, lui montra dans l'impératrice déchue un chef de parti : elle demanda et obtint pour Octavie un exil plus cruel encore que le premier. Abreuvée d'outrages et de calomnies, l'épouse répudiée et chassée subit, dans l'île de Pandateria, un exil que termina bientôt un horrible supplice. Son honneur, sa patrie, sa vie, lui avaient été tour à tour enlevés. Quant au bonheur, jamais la fille de Claude, la femme de Néron, la sœur de Britannicus, ne l'avait connu[164]. L'impure Poppée régnait. Elle était sûre de son pouvoir : elle avait reçu et contemplé la tête d'Octavie. La mort de la jeune victime avait valu aux dieux les solennelles actions de grâces qui leur avaient déjà été offertes après la mort des deux Agrippine, et qui suivirent tout crime de Néron. Le Sénat prodiguait ses adulations à la nouvelle impératrice. Le surnom d'Augusta lui avait été donné par Néron ainsi qu'à sa fille nouveau-née. La petite princesse étant morte à l'âge de quatre mois, et ayant reçu les honneurs de l'apothéose, Poppée était devenue la mère d'une déesse. Son impérial époux l'adorait. Mais l'amour d'un tigre a ses dangers. Dans un accès de colère, Néron renversa d'un coup de pied l'épouse qu'il chérissait. Elle allait devenir mère : elle mourut. L'empereur fit son oraison funèbre. Il ne pouvait ressusciter la morte ; mais il la déifia[165]. Cette atmosphère de sang et de honte nous étouffe et nous lasse. Où donc pourrons-nous librement respirer ? Sera-ce dans les asiles de ce néo-stoïcisme qui fournit à Néron, comme : Claude, d'illustres victimes, et en réserva d'autres aux successeurs de ces princes ? Sans doute le néo-stoïcisme, qui ne reçut pas en vain l'influence du christianisme naissant, et dut à cette influence ce qu'il avait de meilleur[166], le néo-stoïcisme enseigna à ses adeptes d'admirables vertus ; mais en exigeant de l'homme la perfection morale, en le raidissant contre la douleur, cette doctrine ne lui donnait d'autre appui que lui-même. Le néo-stoïcisme lui apprenait aussi à être non l'actif adversaire, mais la passive victime du mal ; et le suprême courage qu'il lui inspirait était de se dérober par le suicide au combat de la vie. Cette doctrine put donc faire revivre dans quelques matrones les vieilles mœurs romaines ; mais quand l'adversité les frappa, leur dogme philosophique fut impuissant à les consoler, et ne leur donna surtout que la force ou le besoin de mourir. Comment ne pas nommer ici Arria, femme de Pétus ? Son époux, accusé d'avoir conspiré contre Claude, est conduit d'Illyrie à Rome. Après avoir vainement imploré la faveur de monter sur le même navire que son mari pour remplacer auprès de lui les esclaves dont ne saurait être privé un personnage consulaire, Arria suit dans une barque l pécheur le grand vaisseau qui emporte ce qu'elle aime le plus au monde. C'est ainsi qu'elle peut se réunir à Pétus sur le sol romain. La condamnation de l'accusé est imminente : Arria, qui a prémédité de mourir, se frappe d'un poignard, et, retirant de son sein cette arme sanglante, elle la présente à son mari en lui disant : Pétus, cela ne fait pas de mal[167]. Le même poignard réunit ainsi dans la même mort ceux qui 'ont vécu de la même vie. Abstraction faite du suicide que nous condamnons, ce trait est grand ; mais Pline le Jeune trouve que ce n'est pas le plus extraordinaire dans la vie d'Arria. Autrefois, elle avait perdu un fils, et son époux était atteint de la même maladie qui avait tué son enfant. Pour cacher à Pétus un malheur qui dit pu le tuer, Arria fit célébrer à l'insu de son mari les obsèques de son fils. Pétus lui demandait-il des nouvelles de leur enfant, elle répondait qu'il allait mieux. Quand les larmes l'étouffaient, elle fuyait la chambre du malade, et la mère se livrait à une douleur que devait s'interdire l'épouse. Puis, elle rentrait calme, comme si, nous dit Pline le Jeune, elle dit laissé à la porte son deuil maternel. Il connaissait bien le cœur d'une mère, ce Romain qui trouvait qu'il avait fallu moins de courage à Arria pour mourir que pour se conduire encore en mère après avoir perdu son fils[168]. Arria laissait une fille portant le même nom qu'elle, et mariée au philosophe Thraséas. Celui-ci fut une victime de Néron. A une époque où la vertu était considérée comme une rébellion, Thraséas était accusé d'avoir conspiré. N'avait-il pas quitté le Sénat en silence, lorsque la mort d'Agrippine y avait été annoncée ? Ne refusait-il pas de croire à la divinité de Poppée[169] ? Ces crimes, et d'autres encore, étaient irrémissibles. Alors que la belle-mère de Thraséas méditait de se donner la mort, son gendre, pour la détourner de ce projet, lui avait demandé si elle voudrait qu'au cas où il serait condamné, sa femme le suivit dans la mort ; et la première Arria avait répondu : Oui, si elle avait vécu avec toi aussi longtemps et dans une telle concorde que moi avec Pétus[170]. Quand Thraséas fut à son tour condamné, la seconde Arria se souvint de cette parole. Elle se prépara à mourir ; mais Thraséas lui ordonna de vivre pour ne pas retirer à leur fille le seul appui qui restât à celle-ci[171]. Cette fille, nominée Fannia, admirable de fermeté, et joignant à d'austères vertus une grâce charmante, devait suivre les traditions de sa mère et de son aïeule, accompagner deux fois en exil son mari Helvidius, y retourner une troisième fois pour avoir honoré publiquement la mémoire de son époux après que celui-ci eut été mis à mort[172]. Mais ces derniers faits allaient se passer sous les successeurs de Néron. Au temps de Néron, la seconde Arria avait eu de nobles émules. Nommons ici Pauline, femme de Sénèque, Sénèque, victime moins pure que Thraséas, Sénèque qui avait été le complice et le panégyriste du parricide de Néron, Sénèque qui aima la vertu comme philosophe, mais la pratiqua fort peu comme courtisan ; et qui, plus stoïcien que stoïque, ne rencontra guère que dans la disgrâce, et surtout dans la mort, l'application de ses rigoureux principes ! Lorsque Néron lui envoya l'ordre de se tuer, il prenait un repas en compagnie de Pauline. Comme, à la fatale nouvelle, sa femme se désespérait, il la serrait dans ses bras, et lui offrait, pour la consoler, la perspective d'une vertueuse existence. Mais Pauline préféra la mort, prouvant ainsi à Sénèque combien il avait eu raison de sentir vivre sa femme en lui[173]. Et cependant il était vieux, elle était jeune, mais un grand lien moral les unissait. Sénèque ne s'opposa pas à la résolution de Pauline : il redoutait les outrages auxquels sa femme pouvait être exposée après sa mort. Ne vivait-on pas sous Néron ? Je t'avais montré les consolations de la vie, dit-il, tu aimes mieux l'honneur de la mort ; je ne t'envierai pas un tel exemple. La fermeté dans une mort si courageuse serait-elle la même chez l'un et chez l'autre de nous, il y aura plus d'éclat dans ta fin[174]. Le même fer ouvrit les veines des deux époux. La vie à son déclin et la vie dans sa fleur allaient s'éteindre en même temps. Sénèque craignit que sa femme et lui ne perdissent courage en se voyant mutuellement souffrir : il conseilla à Pauline de se retirer dans une autre chambre. L'époux seul mourut. Dès que Néron avait appris l'acte de Pauline, il avait fait secourir la blessée : nul motif n'aurait pu lui faire souhaiter la mort de cette jeune femme, et Néron s'était peu soucié d'accroitre inutilement sa barbare renommée. Pauline vécut. Les esprits disposés à rabaisser le mérite des actions extraordinaires crurent que la jeune femme avait consenti à vivre dès qu'elle n'avait plus eu à craindre pour elle-même le ressentiment de Néron. Quoi qu'il en fût, la blancheur marmoréenne de son visage et de son corps témoigna toujours que, pour suivre son mari, elle avait visité les portes de la mort[175]. Néron, qui avait regardé comme inutile la mort de Pauline, jugea plus digne de sa cruauté, c'est-à-dire de sa crainte, deux jeunes stoïciennes. Ces héroïnes étaient cette Pollutia, cette Servilie dont les noms étaient naguère cités par nous comme l'expression même de la piété filiale chez les Romains. Comme d'autres femmes de proscrits, Pollutia a suivi en exil son mari, Rubellius Plautus, jeune patricien qui a adopté, avec l'austère enthousiasme des stoïciens, les mœurs sévères de la vieille Rome, et qui, aux veux de Néron, a en outre le tort irrémissible d'appartenir à la race des Césars et d'être populaire[176]. Pollutia a vu son mari Richement assassiné par l'ordre de Néron. Elle a embrassé cette tête sanglante, elle a conservé, et le sang de son époux, et les vêtements rougis par ce sang. Ne prenant d'autre nourriture que celle qui lui était indispensable pour ne point mourir, elle s'est à jamais ensevelie dans son deuil de veuve. Sa vue seule reproche à Néron l'assassinat dont il est l'auteur ; et la jeune veuve n'est point seule pour produite cette impression sur l'empereur : Sextia, son aïeule maternelle : Antistius, son père, attirent, au même titre la malveillante attention du bourreau couronné. Et Néron attend. Un affranchi se trouve qui dépose contre Antistius, son ancien maître. Alors Pollutia, immolant à son amour filial le long ressentiment de son veuvage, Pollutia va de Formies à Naples pour implorer le tyran qui lui a ravi son époux. L'accès de la demeure impériale lui étant interdit, elle poursuit le prince dans les lieux où il passe, et lui apparaît tour à tour éplorée et menaçante, le suppliant ou le maudissant[177]. Mais l'accent de la piété liliale peut-il émouvoir le cœur d'un parricide ? Néron demeure inflexible, et Pollutia vient annoncer à sou père qu'il faut renoncer à l'espérance et se soumettre à la nécessité[178]. Antistius a compris ; et le dénouement de cette tragédie domestique nous montre Antistius, Sextia, Pollutia, qui, après s'être ouvert les veines, se sont fait porter dans des baignoires où ils attendent la mort en contemplant, le père, sa fille ; la grand'mère, sa petite-fille ; et celle-ci, l'un et l'autre[179] ; tandis que chacun des trois demande au ciel une grâce suprême : celle d'expirer avant les deux autres ! Mais, suivant l'ordre de la nature, la mort prend d'abord l'aïeule, puis le père, et enfin la fille. Nulle amertume n'a été épargnée à Pontifia ; et, pendant son agonie même, la veuve s'est vue deux fois orpheline. Antistius, sa belle-mère et sa fille ont échappé au tyran ; mais si leurs âmes ne sont plus en sa puissance, leurs corps lui appartiennent, et sont condamnés au supplice ! Toutefois Néron veut se montrer bon prince ; et n'épargnant même pas à la majesté de la mort l'ironie satanique, il permet que ces trois cadavres choisissent eux-mêmes le genre de leur trépas... Quelque solennelle et touchante que puisse être la scène qui mit fin à ces trois nobles existences, n'oublions pas que ce dénouement est encore un suicide. C'est là une tache qui n'obscurcit point l'image de Servilie. Comme Pollutia, Servilie a vu son mari exilé ; mais du moins elle n'a pas eu à pleurer la mort de celui-ci ; elle n'a pas assisté aux horribles spectacles qui ont à jamais assombri de leur voile ensanglanté l'imagination de Pollutia. Ayant moins souffert, elle' est restée plus douce envers la vie ; et cependant, elle aussi, elle comparait devant le Sénat qui va juger son père, accusé en même temps que Thraséas. Éloignés l'un de l'autre, le père et la fille sont devant le tribunal des consuls. L'accusateur va nous faire savoir quel est le crime dont Servilie est inculpée : il lui demande si elle a vendu ses parures de noces et son collier, afin de pouvoir consulter et payer des devins ? Étendue à terre, la jeune femme ne répond d'abord que par ses larmes et par son silence. Longtemps elle demeure dans cette attitude : puis elle embrasse les autels, et avec la candeur et la touchante naïveté de ses vingt ans, elle proteste que jamais elle n'a invoqué des dieux impies que pour obtenir que le prince et le Sénat lui conservassent son malheureux père. De même que j'ai donné mes pierreries et mes vêtements, et les insignes de ma dignité ; de même j'eusse donné mon sang et ma vie s'ils m'eussent été demandés ! Quel est le nom de ces devins inconnus de moi jusqu'a présent ; quels arts ils exercent, c'est leur affaire. Jamais nulle mention du prince ne m'a été faite, sinon (en le plaçant) parmi les dieux. Cependant mon infortuné père l'ignorait ; et s'il y a crime, seule j'ai péché ![180] Elle n'a pas achevé ces paroles, et son père, son père qu'elle n'osait regarder tant elle redoutait d'avoir, par son imprudence, aggravé la situation du vieillard, son père l'interrompt. Attestant l'innocence de cette jeune femme qui, par son Age, n'aurait pu prendre part au complot dont il est accusé, Soranus s'offre, lui seul, à la persécution de ses ennemis. Alors, ni la présence de l'empereur, ni la réunion du Sénat, ni l'appareil d'un tribunal, ne peuvent comprimer l'élan qui précipite le père et la fille dans les bras l'un de l'autre ; mais les licteurs les retiennent.... Toutefois leur séparation ne sera pas longue, et la mort va les réunir. Condamnés tous deux, ils ont la liberté de choisir le supplice qu'ils préféreront[181]. Ici du moins, cette faculté n'est pas dérisoirement accordée à des cadavres. Ainsi que nous le disions dans un chapitre précédent, les types de Pollutia et de Servilie vengent dignement l'humanité, sous le règne d'un parricide. Mais quel temps que celui où le crime a de longs triomphes, et où la vertu ne sait que se cacher dans la tombe ! Parricide, époux de l'indigne Poppée, meurtrier de ses deux femmes, corrupteur et bourreau de son peuple, persécuteur du christianisme dont nous allons bientôt saluer la divine aurore, Néron subit son châtiment. La révolte des Gaules lui fut annoncée au jour anniversaire de la mort d'Agrippine ; et quand, pour échapper à ses ennemis, il se frappa lui-même, c'était le jour d'un autre anniversaire : relui de la mort d'Octavie[182]. Irons-nous plus loin ? Continuerons-nous cette étude désolante ? La suite des annales romaines nous offrira-t-elle ce refuge moral que nous avons vainement cherché dans le néo-stoïcisme ? Une Plotine, associée aux grands desseins de Trajan, et lui choisissant un successeur dans Adrien[183], nous dédommagerait-elle suffisamment d'avoir trouvé dans les deux Faustine de nouvelles Messaline, mais des Messaline admises après leur mort à la gloire de l'apothéose ; des Messaline en l'honneur desquelles furent instituées des Vierges faustiniennes[184] ? Avec les empereurs d'origine syrienne, sortirons-nous de l'élément romain, si toutefois celui-ci existe encore, et parlerons-nous des femmes qui jouent alors un rôle considérable ? Une Julia Domna, mère aussi malheureuse que tendre ; une Julia Mæsa et une Julia Mammæa[185], qui règnent sous le nom d'Alexandre Sévère, fils de celle-ci, petit-fils de celle-là, et qui, malgré l'ambition de l'une et l'avarice de l'autre, ont l'honneur de former un prince vertueux, toutes ces 'mères nous feront-elles oublier que la digne mère d'Héliogabale, Julia Sæmis, plus honorée encore que la seconde Agrippine, pénètre dans l'enceinte du Sénat, signe comme témoin le sénatus-consulte rendu en sa présence, et paie un jour de sa vie l'outrage qu'elle a infligé à ce qui reste du nom romain[186] ? En vain continuerions-nous de feuilleter les annales païennes, nous n'y retrouverions plus la grande et simple apparition que nous avons évoquée au début de cet ouvrage : la femme gardienne du feu sacré, soit que, Vestale, elle veille au foyer national, soit que, vierge ou matrone, elle veille au foyer domestique. C'est que ce feu sacré qui, aux temps primitifs, rappelait l'inviolable pureté de la Vestale, l'innocence de la jeune fille, la fidélité de l'épouse, le dévouement de la mère, et enfin le patriotisme de la Romaine, ce feu sacré n'était que la lointaine image de cette flamme divine qui guida l'humanité naissante. La vie de sacrifice exigée de la Vestale, l'austère existence imposée à la jeune fille et à la matrone, n'auraient pu subsister à travers les siècles qu'en provenant directement de cette vraie foi qui seule est éternelle, et seule aussi fait participer à son éternité les vertus qu'elle enfante. Privées de ce principe de vie, les anciennes vertus romaines ne pouvaient que disparaitre. Ce que fut la dégradation de la Vestale, ce que fut la corruption de la jeune fille et de la matrone, l'histoire nous l'a révélé. Mais, au sein même de cette Rome déchue, une autre Rome nait et s'élève, non pas au milieu des splendeurs officielles de la ville impériale, mais dans les artères souterraines que s'est creusées la Rome nouvelle : c'est la Rome des catacombes, c'est la Rome chrétienne ! Là, dans ces silencieuses galeries, nous trouvons ce refuge moral que nous cherchions vainement ailleurs. Là brille ce vrai feu sacré vers lequel notre pensée se reportait au début de notre livre ; le seul feu sacré qui inspire à la vierge la force de renoncer aux douces espérances du mariage et de la maternité ; le seul feu sacré qui jette un reflet divin sur les tendresses de la famille et leur donne la durée de l'éternité ; le seul feu sacré qui, tout en vivifiant le culte du sol natal, remplis un de ces deux sentiments inconnus à l'antiquité païenne : l'amour du Dieu unique, éternel, l'ardeur de la charité ! Ce feu sacré anime d'une telle énergie les cœurs où il pénètre, que non-seulement la femme court d'elle-même à d'affreuses tortures plutôt que de le laisser s'éteindre : mais qu'elle aime mieux assister au supplice de ses enfants que de leur voir perdre la flamme divine ! Ce feu sacré n'existe pas sous une forme matérielle : c'est l'Esprit saint ! Il ne brille pas seulement dans le temps ; il brille dans l'éternité. Le feu sacré de la Rome païenne, ce feu que l'on disait perpétuel, ce feu s'est éteint, parce qu'une main humaine l'avait allumé ; le feu sacré de la Rome chrétienne vivra toujours, car il est d'essence divine : c'est le seul feu perpétuel ! Après plus de dix-huit siècles, ne le voyons-nous pas, dans son action la plus haute, la plus immédiate, départir à un grand et saint Pontife la même lumière céleste qu'il donnait à saint Pierre et à ses successeurs pour éclairer les nations la même force dont il les remplissait pour soutenir, au milieu des persécutions, les droits de la Rome chrétienne ! Mais pour que cet Esprit de vérité et d'amour pût descendre et rester dans l'ancienne Rome, il avait fallu que le Verbe fait chair eût racheté de son sang et éclairé de sa doctrine cette humanité qui avait agrandi, par les crimes de chaque peuple, l'étendue de la tache originelle. Il avait fallu que l'Église de Jésus-Christ instruisit les nations, les purifiât par la pénitence, les lavât dans les eaux régénératrices du baptême, les nourrit du Dieu de l'Eucharistie, les sanctifiât enfin par tous ses sacrements. En sauvant le monde, le Dieu qui s'était incarné dans le sein de la Vierge conçue sans péché avait aussi relevé la femme de son antique déchéance. Dans la Rome païenne, la femme ne s'était souvent dérobée que par une folle émancipation aux entraves que, lui avait imposées le droit quiritaire[187]. Elle n'avait souvent échappé au joug de la loi que pour tomber sous le joug plus tyrannique de ses passions déchaînées. En affranchissant son fils de la servitude du péché, l'Église de Jésus-Christ la rend digne de la liberté qu'elle lui donne et des droits sacrés qu'elle lui confère. La femme chrétienne voit disparaître les dernières traces de cette perpétuelle minorité laquelle l'assujettissait la loi. Elle obtient enfin ce droit dont elle n'avait jamais joui, même à l'heure de ses plus enivrants triomphes : la tutelle de ses enfants. Il ne convient pas de décrire dans un simple épilogue le rôle considérable que remplit la femme dans la Rome chrétienne, la vraie Rome éternelle. Avec la Romaine du paganisme, nous quittons les temps anciens. Avec la Romaine du christianisme, nous entrerions dans les temps nouveaux. Mais s'il plaît à Dieu que nous achevions nos études sur la femme, ce sont les martyres romaines et les pieuses disciples des Pères de l'Église latine qui nous conduiront à la femme française, cette admirable personnification de la femme chrétienne ! FIN DE L'OUVRAGE |