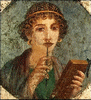LA FEMME ROMAINE
SECONDE PARTIE. — LA FEMME PENDANT LES DERNIERS TEMPS DE LA RÉPUBLIQUE ET SOUS L'EMPIRE
CHAPITRE TROISIÈME. — LA MATRONE.
|
Modifications que la fréquence des divorces apporte au mariage. Le régime dotal remplace la manus. L'épouse dotée. Son alliance est recherchée ; et son influence, redoutée. — Le célibataire. — L'hymne nuptial. — La maison de la femme riche, ses vêtements, ses bijoux, etc. Le luxe et l'abrogation de la loi Oppia. Retour vers le dix-neuvième siècle. Impuissance des lois somptuaires. Le frein du luxe. — Les solliciteuses. Les plaideuses. Le sénatus-consulte Velléien. — Les femmes de Juvénal. — Les Bacchantes romaines. Vénus Verticonlia. — Le mari coupable. — Exceptions à la corruption générale. — L'honnête femme. — Trois héroïnes de Plaute. L'Alemène du poète latin et l'Alemène de Molière. — Inscriptions funéraires des matrones. — Textes épigraphiques ce rapportant au mariage des patrons avec les affranchis. — Oraison funèbre d'une épouse. — Veufs inconsolables. Époux mourant pour sa femme. — La veuve et la mère. Nouveaux droits civils de la mère. Lois Julia et Papia Poppæa. Sénatus-consulte Tertullien. Sénatus-consulte orphitien. — Oraison funèbre d'une mère. — Le règne de la matrone. La famille romaine a perdu sa force en perdant son indissolubilité. Le divorce que la loi antique permettait dans des cas déterminés, mais que les mœurs repoussèrent pendant cinq siècles, le divorce devient l'une des coutumes de Rome dégénérée. En étudiant ailleurs la condition de la femme biblique, nous remarquions quo les Talmudistes multiplièrent les causes de la répudiation avec une profusion inconnue à la loi d'Israël. De même les Romains de la décadence trouvèrent au divorce des motifs que leurs ancêtres eussent repoussés. Ainsi telle femme est répudiée parce que, se montrant en public sans être voilée, elle a attiré sur son visage d'autres regards que ceux d'un mari jaloux. Telle autre subit le même affront pour avoir assisté à des jeux publics sans qu'elle en eût averti son époux. Une troisième enfin est exclue de son foyer parce qu'elle a mystérieusement conversé dans la rue avec une courtisane[1]. Assurément cette matrone était la moins excusable des trois. En échangeant sur la voie publique de secrètes paroles avec une femme de mauvaises mœurs, elle manquait gravement à sa dignité. Toutefois, et en admettant même que l'objet de cet entretien fût un dessein coupable, l'épouse n'avait péché que par l'intention ou l'apparence d'un crime dont la loi ne punissait que la perpétration. Cette sévérité qui, dans les exemples que nous venons de citer, appliquait à des fautes légères ou à l'ombre seule du mal le châtiment réservé à des actes plus pernicieux ; cette sévérité semble à Valère-Maxime l'expression de la vertu antique ; nous y voyons bien plutôt le premier indice de ce relâchement moral, qui couvre d'un masque d'austérité une inconstance de sentiments et une légèreté de principes qui n'osent encore s'afficher[2]. Bientôt il n'est même plus nécessaire de chercher au divorce un prétexte honnête. Cécilia Métella, la femme chérie de Sylla, est répudiée parce qu'elle va mourir, et que la mort est une souillure qui serait néfaste pour la maison de l'heureux dictateur[3]. Aussi miséricordieuse que chaste, Cécilia Métella avait naguère abrité le fils d'un proscrit sous le toit du sanguinaire Sylla[4], sans se douter alors qu'elle subirait à son dernier jour la plus terrible des proscriptions, l'exil du foyer. La vertueuse Octavie est chassée par son mari, parce que celui-ci aime Cléopâtre[5]. Dans un autre exemple, nulle cause n'est donnée au divorce ; et quand les amis de l'époux lui reprochent d'avoir répudié une femme belle et sage, une femme qui l'a rendu père de trois enfants ; ce Romain, leur faisant remarquer la beauté de son soulier, leur dit qu'ils ne savent pas où cette chaussure le blesse[6]. C'est là comme le pense Plutarque, une allusion à ces chocs légers, il est vrai, mais souvent réitérés, qu'amène entre le mari et la femme l'incompatibilité d'humeur. Lorsque le mariage est indissoluble, chacun des époux doit, pour son propre repos, plier son caractère au caractère de l'autre ; et l'habitude de vivre ensemble, l'estime réciproque, et surtout ce lien que nouent les petites mains des enfants, tout cela contribuera à établir entre le mari et la femme une harmonie souvent plus solide que celle de l'amour. Mais quand le divorce a passé dans les mœurs d'un peuple, pourquoi se donner tant de peine pour arriver à la concorde ? N'est-il pas plus facile de rompre un lien que de chercher à le rendre plus léger ? L'époux quittera donc alors la compagne de sa jeunesse ; et, contractant un autre mariage, il y trouvera peut-être des déceptions qui lui feront regretter son premier hymen. Les lettres de Cicéron nous laissent pénétrer dans l'un de ces ménages romains, honorables d'ailleurs, mais où ne régnait point cet esprit de conciliation qui seul rend possible la vie commune. Quintus, frère du grand orateur, a épousé Pomponia, la sœur d'Atticus, la tante de cette gracieuse Attica dont l'image nous retenait naguère. Quintus est loin d'avoir l'aimable douceur de son frère, et sa femme souffre de ses emportements. Cicéron reconnait que c'est à la violence de Quintus qu'est dû le trouble qui agite ce ménage. Tendrement attaché d'ailleurs au frère de Pomponia, il s'efforce de réconcilier les deux époux. Quintus étant venu le voir à la campagne, Cicéron lui parle de Pomponia, et ce que lui dit son frère lui prouve que celui-ci est disposé à devenir meilleur époux. Les deux frères vont ensemble à la villa de Quintus. Ce dernier se fait précéder d'un messager qui doit veiller à la préparation du déjeuner. Il paraît que le choix de ce courrier a déplu à la maîtresse de maison. En arrivant, Quintus prie avec douceur sa compagne d'inviter au repas les femmes de leur connaissance. Mais elle répond d'un air et d'un ton acerbes : Moi, je suis ici une étrangère[7]. — Voilà, dit Quintus à son frère, ce que j'ai à souffrir chaque jour[8]. Malgré la présence de son beau-frère, de son défenseur, Pomponia ne prit point part au déjeuner. Son mari lui envoya les plats qui passaient sur la table ; elle refusa d'y goûter. Cicéron quitta la maison de son frère avec une profonde tristesse. Le lendemain matin, Quintus se rendit chez lui, et lui apprit que Pomponia était demeurée inflexible dans son ressentiment. En narrant ces détails au frère de sa belle-sœur, Cicéron dut avouer que cette fois l'épouse avait eu tort. Nous devinons ce qu'il y avait de douleur et d'amertume dans cette expression. Moi, je suis ici une étrangère ! Mais était-ce au moment où Pomponia voyait revenir à elle son époux, était-ce à ce moment qu'elle devait lui adresser une parole qui était un cruel reproche ? Peut-être que, sans la faculté du divorce, Pomponia eût accueilli avec bonheur les affectueuses dispositions que lui témoignait son mari. Mais la femme qui pouvait se rendre libre dés qu'elle le voudrait devait se plier difficilement à des concessions. La discorde continua d'agiter la maison de Quia-tus. L'année qui suivit la scène que nous venons de rapporter, les époux furent réconciliés par leur fils, jeune homme qui aimait et défendait sa mère. Mais environ six années après ce rapprochement Quintus et Pomponia s'étaient légalement séparés, et le fils de la femme divorcée reprochait durement à son père de vouloir placer une autre femme au foyer qu'avait quitté sa mère[9]. Ce n'était pas l'un des moins tristes résultats du divorce que la situation des enfants à l'égard de leurs parents séparés, surtout quand ceux-ci se remariaient. Cicéron vit dans son propre intérieur ce que cette dernière situation avait de pénible. Lui qui avait tant cherché à pacifier le ménage de son frère, il quitta après une union de trente années sa femme Térentia. Celle-ci épousa un ennemi de son mari, l'historien Salluste, et Cicéron donna à ses enfants une jeune belle-mère qui fut loin de vivre avec eux en bonne intelligence, et à qui la mort de Tullie causa tant de joie que Cicéron, indigné, la répudia. La rupture du lien conjugal n'était du reste que trop familière aux Cicérons. Tullie s'était aussi séparée de son mari Dolabella[10]. Mais voici la scène la plus étrange qu'ait amenée l'usage du divorce. Deux hommes sont en présence. L'un est un héros de la sagesse d'autrefois : c'est Caton d'Utique ; l'autre est Quintus Hortensius, le célèbre orateur. Hortensius désire ardemment que sa race soit honorée par l'alliance de Caton. Il demande à celui-ci la main de sa fille Porcia. Sans doute un obstacle existe : Porcia est déjà mariée à Bibulus ; elle est mère de deux enfants, mais qu'importe à Hortensius ! Ce dernier développe une théorie qui n'est autre que celle de la communauté des femmes. Selon lui, la femme appauvrirait un seul mari en le chargeant d'une trop nombreuse postérité, tandis qu'elle pourrait donner utilement des héritiers à une autre maison ; et si les citoyens honnêtes échangeaient de cette manière leurs compagnes, ce serait un excellent moyen de propager la vertu. Hortensius propose même généreusement de rendre Porcia à son premier époux dès qu'elle aura rendu père le second. Il aura alors atteint son but : l'alliance de Caton et de Bibulus. Mais ces théories, moitié spartiates, moitié platoniciennes, ne persuadent pas Caton, et celui-ci témoigne sa surprise de ce que son ami recherche la main d'une femme mariée. Loin de se déconcerter, Hortensius adresse alors à Caton la plus bizarre des propositions matrimoniales : ce n'est plus sa fille mariée qu'il lui demande, c'est sa propre femme, Marcia, qui va devenir mère pour la troisième fois ! Et Caton à qui il aurait paru étrange d'enlever sa fille à son gendre pour la marier à son ami, Caton semble trouver naturel d'accorder à ce dernier la main d'une épouse qu'il aime et qui doit lui donner un nouveau gage de leur alliance ! Il ne met qu'une condition à ce mariage, c'est que Philippe, père de Marcia, ne s'y oppose point. Philippe, consulté par son gendre, agrée la demande d'Hortensius, mais en posant, lui aussi, une condition : c'est que le premier époux de Marcia assiste au mariage de son successeur et signe au contrat. Caton se soumet à ce rôle ridicule. Un jour cet homme rigide reprend sa femme : Marcia est veuve d'Hortensius, et apporte la fortune de son second mari à celui qui a été son premier époux et qui va devenir le troisième[11]. Voilà ce que le divorce permettait aux plus vertueux des Romains ! Il nous répugne de citer des faits aussi scandaleux ; mais, à une époque où des voix s'élèvent pour demander la liberté du divorce, il nous parait utile de montrer toutes les faces de cette institution, et nous aurons le courage de poursuivre nos pénibles recherches. Depuis la dictature de Sylla et jusque sous le règne d'Auguste, la politique joue un aussi grand rôle dans les divorces que dans les mariages. Pour s'allier entre eux, les puissants du jour ne craignent pas de lacérer les nœuds les plus sacrés. Sylla qui, au temps de ses proscriptions, enlève à ses ennemis leurs compagnes pour les donner à d'autres époux ; Sylla qui répudie sa femme parce qu'elle est mourante ; Sylla arrache au gendre de sa femme une jeune épouse près de devenir mère, et la donne à Pompée qui vient, à son ordre, de répudier Antistia. La mère de celle-ci se tue pour ne point survivre à l'outrage que subit sa fille. Quant à la nouvelle femme de Pompée, elle meurt en mettant au monde chez son second mari l'enfant d'un premier hymen. Octavie elle-même, cette pure et touchante victime de la répudiation, provoque dans un intérêt politique le divorce de sa propre fille, afin que son gendre puisse épouser Julie, veuve de son fils Marcellus et fille de l'empereur. Auguste qui s'était joué du mariage, en enlevant à un époux Livie et l'enfant qu'elle portait dans son sein, Auguste voulut restreindre l'abus du divorce. Au temps où il prétendait restaurer l'ancienne Rome, il établit les lois Julia et Papia Poppæa, suivant certaines dispositions desquelles une amende était imposée à celui des deux époux qui aurait été la cause du divorce. Mais l'exemple d'Octave l'emporta sur les lois d'Auguste ; et, en ceci, les successeurs de l'empereur imitèrent plus sa conduite qu'ils ne suivirent ses prescriptions[12]. Les lois que nous venons de citer ne permettaient pas que
l'affranchie qui avait épousé son patron provoquât elle-même le divorce ;
mais cette initiative n'était pas défendue aux femmes de libre naissance. Le
temps n'était plus où l'épouse ne pouvait être que répudiée, et n'avait pas
le droit de rompre elle-même son mariage. Tant que le divorce est rare, les
femmes n'osent demander cette séparation. Mais alors que nul journal ne
parait sans qu'une cause de divorce y soit citée, alors, dit Sénèque, les
nobles et illustres femmes apprennent à faire ce qu'elles entendent souvent[13]. Si parfois
elles ont de sérieux griefs contre les époux qu'elles abandonnent, il arrive
aussi, suivant l'énergique expression du philosophe, qu'elles divorcent pour cause de mariage
et qu'elles se marient pour cause de divorce[14]. Tantôt,
revenant au mari qu'elle a quitté, la femme le quitte encore ; tantôt elle
continue de s'engager dans des liens toujours nouveaux[15]. Les matrones ne
se bornent pas à suivre la supputation romaine des années, c'est-à-dire à
compter le nombre des consulats : elles calculent le nombre des années d'après
celui de leurs époux[16]. Mais encore
c'est trop peu dire. Huit maris en cinq automnes, dit Juvénal : fait digne d'une
inscription sépulcrale[17], ajoute-t-il,
par une allusion à cette simple et éloquente épitaphe qui est gravée sur les
tombes des dignes matrones : univira, celle qui n'a eu qu'un époux ! Vous qui, au nom de ce que vous appelez la morale, demandez aujourd'hui le rétablissement du divorce, écoutez ce poète qui certes ne rougit pas facilement : Martial ! Si bas que soit tombé cet homme, il ne peut constater sans indignation ce qu'est devenue avec le divorce la vertu des antiques matrones. Ce vieux foyer romain était si pur, si vénéré, que l'homme le plus corrompu ne devait pas voir tomber sans amertume la seule chose dont il respectât peut-être le souvenir. Depuis que la loi Julia est remise en vigueur, dit Martial, et que la Pudicité a reçu l'ordre de rentrer dans les familles, ce n'est ni moins ni certes plus du trentième jour, et déjà Thélésina épouse son dixième mari. Celle qui se marie tant de fois ne se marie pas : elle est légalement adultère. Une plus franche courtisane me choque moins[18]. L'infidélité de l'épouse est le plus souvent la cause du divorce. On se souvient, du reste, que c'était l'un des cas si rares où la loi primitive autorisait le mari à répudier sa femme, si toutefois il ne préférait point de la faire mourir. Les lois d'Auguste[19] enlevèrent à l'époux cette dernière faculté. L'épouse, surprise en faute, ne pouvait être tuée que par son père ; son mari n'avait que le droit de la traduire devant les tribunaux criminels qui la condamnaient à être reléguée dans une lie et à perdre une partie de sa fortune. Le même châtiment frappait son complice ; mais un autre lieu d'exil l'attendait. Des poursuites judiciaires menaçaient le mari qui, souffrant patiemment son déshonneur, n'aurait point déféré en justice sa femme infidèle. César, le père adoptif de l'impérial législateur, n'avait même pas attendu, pour répudier sa compagne, que la faute de celle-ci lui eût été confirmée. Alors qu'il était préteur, le sacrifice offert à Bona Dea avait lieu chez lui. Aucun homme ne peut être admis à ces rites ; le maître de la maison lui-même a dû s'éloigner, et cependant un jeune Romain s'est introduit dans cette demeure à l'aide d'un costume féminin ; c'est un jeune patricien, un Clodius, épris de Pompéia, femme de César. Le sacrilège est reconnu. On le traduit en justice. César est cité, comme témoin. Il à répudié sa compagne, et cependant il déclare tout ignorer. Et comme l'accusateur croit le confondre en lui demandant pourquoi alors il a renvoyé Pompéia, il donne pour motif à ce divorce que. la femme de César ne doit même pas être soupçonnée[20]. Ainsi n'agit pas Mécène. Bravant les lois impériales devant Auguste même, il ne cesse ni de répudier ni de reprendre son infidèle épouse ; il s'est marié mille fois, et cependant il n'a eu qu'une femme[21]. Ainsi, lorsque tant de Romains renvoyaient injustement leurs compagnes, il pouvait arriver que la femme coupable rencontrât dans son mari, en dépit même des lois, une indulgence qu'il eût peut-être refusée pour de légers griefs à une femme plus pure, mais moins séduisante. Chez Mécène, c'est l'amour qui enseigne la miséricorde au mari outragé. Mais ce n'est pas toujours ce sentiment qui retient l'époux auprès d'une femme coupable. Si cette dernière a apporté une grande dot, le mari souffrira l'inconduite de l'épouse qui, en le quittant, le priverait d'une fortune dont la loi ne donne qu'une partie à l'époux outragé[22]. ... Pourquoi Césennia est-elle excellente, selon le, témoignage de
son mari ? Elle lui a donné un million de sesterces ; à un aussi grand prix
il la nomme pudique. Il n'est pas consumé par le carquois de Vénus, il ne
bride pas de sa flamme ; les torches qui l'embrasent, viennent des flèches de
la dot. La liberté a été achetée...
Veuve est
la femme riche qui s'est mariée à un avare[23]. Le nouveau régime dotal qui assure à l'épouse veuve ou répudiée la restitution de sa dot, ce régime a presque partout remplacé le mariage basé sur la maous, et c'est la fréquence : des divorces qui a créé cette situation. En effet, l'épouse divorcée reprenant sa fortune, la communauté des biens n'était plus qu'un mot illusoire[24]. Il en était de même de la puissance maritale, puisque la femme qui répudiait son mari pouvait aussi le contraindre à abdiquer la manus[25]. Des trois formes de l'antique mariage, il ne restait plus guère que la coemption, au temps de Gaïus, c'est-à-dire au IIe siècle de notre ère, et encore tomba-t-elle plus tard en désuétude. L'usus avait complètement disparu. Quant à la confarréation, elle n'était plus employée que dans les alliances contractées par les grands Flamines[26]. Déjà sous Tibère, l'on n'avait pu réunir les trois patriciens entre lesquels il fallait choisir le Flamine de Jupiter et qui devaient être issus d'un mariage par confarréation. Pour expliquer la disparition du mariage sacré, l'empereur constata l'indifférence religieuse des deux sexes, les difficultés cérémonielles de la confarréation, et enfin la répugnance qu'éprouvaient les Romains à se voir frustrer de leur autorité paternelle sur les fils qui devenaient Flamines et sur les filles qui épousaient ces pontifes. Les anciennes coutumes furent modifiées : une loi décida que la compagne du Flamine de Jupiter ne serait sous la puissance de son mari que dans l'exercice du culte, et qu'en dehors de ses fonctions religieuses elle serait soumise au droit commun des femmes[27]. Nous avons vu que le régime dotal qui avait remplacé la manus était l'un des résultats de la décadence morale. Cr même régime, agissant à son tour sur la corruption de l'époque, en accéléra encore la marche. Au sujet du divorce, nous disions que, pour conserver la dot de sa femme, l'époux avare se résignait à la perte de son honneur. Il consentait de male à la perte de son autorité, et se courbait sous l'altière domination de l'épouse : J'ai accepté l'argent, j'ai vendu mon autorité pour une dot[28]. Esclave de cette dot, comment l'époux résisterait-il aux innombrables caprices, aux goûts ruineux de la femme opulente qui daignera lui dire : Je t'ai certainement apporté une dot plus considérable de beaucoup que ta fortune personnelle. Il est assurément juste de me donner de l'or, de la pourpre, des servantes, des mulets, des cochers, des valets de pied, de petits courriers, des voitures dans lesquelles je me fasse trainer[29]. Alors, en rentrant chez lui, le mari trouvera dans ses cours plus de chariots qu'il n'en voit aux champs. Mais ce ne sera encore que l'une de ses moindres dépenses. Le foulon, le brodeur, l'orfèvre, l'ouvrier en laine seront lit. Que d'autres fournisseurs seront auprès de ceux-ci, ou les rejoindront, ou leur succéderont : traiteurs, cuisiniers, parfumeurs, teinturiers en couleur de flamme, teinturiers en violet, teinturiers en mauve, teinturiers en jaune, teinturiers en nuances de safran ; tisserands, tisserands en bordures ; tailleurs, faiseurs de tuniques à manches, fabricants de galons de pourpre et d'or, fabricants de ceintures, fabricants de demi-ceintures, fabricants de petits coffrets, brocanteurs, et quatre séries de cordonniers spéciaux ! A peine les uns seront-ils payés que les autres se présenteront ; et le mari paiera et paiera encore[30]. Devant cette perspective peu rassurante, tel homme, fait rare, aime mieux épouser une fille pauvre que de s'exposer aux exigences d'une femme dotée[31]. Tel autre trouve plus sûr de ne pas se marier du tout : A cause de mes richesses, il m'eût été permis d'épouser une femme
dotée et d'une grande naissance ; mais je n'ai pas voulu introduire une
aboyeuse dans ma maison... Une bonne femme, où
pourrais-je la trouver, en admettant qu'il y en eût quelque part une de cette
sorte à marier ? En vérité, je n'en aurais pas une qui me dirait jamais : Mon
époux, achète-toi de la laine pour que l'on te fasse un pallium moelleux et
chaud, et une bonne tunique d'hiver, afin que tu ne souffres pas du froid.
— On n'entendra
jamais d'une épouse cette parole ; mais avant que les coqs ne chantent, elle
me réveillera et me dira : Homme, donne-moi quelque chose qui plaise à ma
mère, pour les calendes de mars[32] ; donne-moi un cuisinier
qui sache farcir, donne-moi un cuisinier qui sache assaisonner ;
donne-moi quelque chose que je puisse offrir, lois des fêtes de Minerve, à la
conjuratrice des sorts, à l'interprète des songes, à la devineresse et à
l'aruspice. C'est une honte de ne rien leur envoyer. De quel œil sourcilleux
elles me regarderaient ! Ensuite il n'est pas possible que je ne récompense
pas avec bonté la femme qui a fait les cérémonies expiatoires... Ensuite la sage-femme
s'est plainte à moi du pauvre don qui lui a été fait. Eh quoi ! n'enverras-tu
pas quelque chose à la nourrice qui allaite les petits esclaves nés dans la
maison ? — Ces
prodigalités féminines, et beaucoup d'autres semblables, m'empêchent de
prendre, une femme qui me tiendrait de semblables discours[33]. Et ce n'étaient pas seulement les défauts ni même les vices des femmes qui éloignaient les hommes du mariage. Alors que la chasse aux héritages était l'une des plus sérieuses occupations des Romains, le célibataire avait une si douce existence ! Libre de tous les soins de la famille, il était l'objet de soins si touchants, d'attentions si délicates ! La joie et la paix régnaient autour de lui ! Comment eût-il voulu échanger cette vie facile contre les sévères obligations imposées au chef de famille, ou contre les soucis que les matrones ne ménageaient guère à leurs époux ? Quand Auguste voulut faire revivre l'antique et pure association du mariage, ce fut en vain que les lois Julia et Papia Poppæa[34] établirent des peines contre les célibataires, des récompenses pour les pères de famille : l'horreur du mariage persista. Il ne reste plus guère des anciennes coutumes nuptiales que les cérémonies qui présidaient à l'entrée de la mariée dans sa nouvelle demeure. Mais les chants qui accompagnent la jeune femme vers le toit conjugal font maintenant vibrer à son oreille les accents d'une poésie inconnue de ses ancêtres, et tout imprégnée d'harmonie et d'amour. Si ses compagnes s'effrayent de la voir changer d'état, les amis de son époux lui esquissent le tableau de la félicité conjugale. Telle la fleur solitaire qui croit dans l'enclos d'un jardin,
ignorée du troupeau, disent les jeunes filles ; elle n'est pas écrasée par la
charrue, les airs la caressent, le soleil la fortifie, la pluie la nourrit ;
beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles la souhaitent ; mais
cueillie par l'ongle ténu, a-t-elle perdu sa fraicheur, nul des jeunes gens,
nulle des jeunes filles ne la désire. Ainsi la vierge, tant qu'elle demeure
libre, est chère aux siens. Mais quand elle a perdu son éclat virginal, elle
ne demeure ni agréable aux jeunes gens, ni chère aux jeunes filles. Hymen, ô
Hyménée, Hymen, viens, ô Hyménée ![35] Aux plaintes de ces jeunes filles qui, tout en maudissant l'hymen, en appellent le dieu, les amis de l'époux répondent : Telle la vigne veuve qui croit dans le champ privé d'arbres :
jamais elle ne s'élève, jamais elle ne produit le doux raisin ; mais,
fléchissant sous le poids qui fait pencher son tendre corps, bientôt elle
touche à sa racine par son sommet le plus élevé. Nul des laboureurs, nul des
jeunes taureaux ne la cultive ; mais s'unit-elle à l'orme protecteur qui se
marie à elle, beaucoup de laboureurs, beaucoup de jeunes taureaux la
cultivent. Ainsi la vierge, tant qu'elle demeure libre, languit négligée ; mais
lorsque est arrivé pour elle le temps propice au mariage, chérie de son
époux, elle est aussi mieux vue de sa mère... Et toi, vierge, ne sois pas contraire à un
tel époux... Ne sois pas contraire aux parents
qui ont ensemble cédé à leur gendre leurs droits avec ta dot. Hymen, ô Hyménée,
Hymen, viens, ô Hyménée ![36] Mais, de même que les usages nuptiaux qui président à l'entrée de l'épouse dans sa nouvelle demeure n'ont que trop souvent perdu leur haute signification morale ; de même ces chants qui parlent de tendresse conjugale et de protection domestique sont, trop souvent aussi, vides de sens pour la jeune femme. Mieux eût valu pour elle demeurer la fleur solitaire, que de devenir la vigne, qui ne trouve dans l'orme qu'un appui passager, et qui, se détachant parfois elle-même de ce tuteur, tombe jusque dans la boue ! Voyons maintenant, au sein de sa luxueuse demeure et de ses nouvelles habitudes, cette matrone que nous admirions alors qu'elle filait la laine sous l'humble toit qu'elle gardait. Entrons dans le vestibule que forme devant la maison romaine la saillie des bâtiments qui la terminent[37]. Que la porte de marbre ou de bronze nous donne accès dans un couloir dont l'extrémité opposée s'ouvre sur l'atrium. L'atrium ! qu'est-il devenu maintenant ? Les mosaïques qui le pavent, les colonnes qui entourent, au milieu de la salle, l'espace découvert par lequel pénètre la lumière et par lequel aussi les eaux du toit coulent dans un bassin ; les statues qui peuplent les entrecolonnements, tout, dans ce riche atrium corinthien, nous reporte bien loin de ce simple atrium toscan qui était à la fois le sanctuaire des dieux domestiques, le foyer de la famille, la chambre des époux, la salle de réception, le réfectoire et même la cuisine ! Il nous faudra chercher ailleurs maintenant le siège de la vie intime. Si la porte qui fait face à celle du couloir est ouverte, nous voyons se dérouler une colonnade entourant un vaste espace à ciel ouvert, et au centre duquel s'étend un riant parterre décoré d'une fontaine jaillissante : c'est le péristyle ; et c'est autour de cette cour intérieure que sont placées la plupart des salles qui servent aux usages de la vie domestique. Cependant l'atrium est demeuré sinon le siège, du moins le symbole de cette vie domestique. Le lit y a été dressé au jour de l'hymen, et il y demeurera jusqu'à ce que le divorce ou la mort ait rompu le mariage[38]. Ce lit, tout d'apparat, est, sans doute, l'une de ces couches somptueuses qui, taillées dans un bois précieux, ornées d'ivoire ou d'écaille de tortue, sont munies d'un pied d'or ou d'argent, couvertes de pourpre brodée. Le foyer est aussi demeuré à sa place antique, bien que, dans les opulentes demeures, un sanctuaire soit réservé aux dieux dans la partie la plus reculée de la maison. Le foyer de l'atrium n'est plus en pierre, il est en bronze, et ce symbole de la vie domestique, naguère simple et rude comme elle, a reçu, comme elle aussi, la double influence du luxe et de l'art. Les images des ancêtres, les archives de la famille, sont dans l'atrium, ou, pour parler avec plus de précision, dans le tablinum, pièce qui forme le fond de l'atrium et qui s'ouvre sur le péristyle. Les fresques du tablinum nous offrent des paysages, des scènes mythologiques, des vues d'intérieur[39]. A droite et à gauche du tablinum s'ouvrent les ailes, vastes renfoncements grâce auxquels le maître de la maison peut s'isoler de la foule de ses visiteurs pour causer avec quelque ami ou quelque client. Des scènes fantastiques, des arabesques, sont peintes sur les murs[40]. Des portières paraissent séparer du reste de l'atrium le tablinum et les ailes. C'est dans l'atrium que se passe le côté en quelque sorte officiel de la vie romaine. Est-ce à dire qu'il ne faille plus chercher la femme que dans la partie la plus retirée de l'habitation ; et que le péristyle, dont la disposition architecturale rappelle déjà la situation du gynécée athénien, ait aussi la destination de celui-ci ? Assurément non. Plus que jamais la femme est la maîtresse de la maison, et nous savons déjà qu'elle en est trop souvent le fier et capricieux despote. Partout où son mari commande, la matrone a le droit de régner ; et si maintenant elle habite surtout le fond de la maison, c'est que son époux y demeure avec elle. Nous trouvons donc encore la femme dans l'atrium ; nous la voyons aussi dans une grande salle placée à la droite de cette pièce et que décorent des peintures murales ; c'est le triclinium, la salle à manger. Là principalement se déploient tout le luxe et toute la mollesse de la décadence. Les convives sont placés sur les lits triclinaires qui entourent trois côtés de la table[41] ; l'écaille de tortue, l'argent, l'or, brillent sur ces lits de bronze que recouvrent les riches tapis de Babylone. La femme ne s'asseoit plus pour se mettre à table. Maintenant, elle aussi, elle a adopté la position à demi horizontale[42]. Nonchalamment étendue, s'accoudant du bras gauche sur un coussin de soie, la Matrone occupe auprès de son mari une place d'honneur sur le lit du milieu[43] ; mais si d'autres femmes ont été invitées au repas, soin qui concerne la maîtresse de la maison, alors les invitées se couchent sur les mêmes lits. La table d'érable ou de titre, que soutient un pied d'ivoire, offre ces mets bizarres qui ne peuvent guère avoir d'autre mérite que celui de la rareté et d'une folle valeur extrinsèque : des œufs d'autruche farcis avec des œufs de paon et où sont renfermés des becfigues ; des paons revêtus de leur plumage émaillé ; un sanglier des entrailles duquel s'envolent des grives toutes vivantes ; des langues d'oiseaux, des murènes énormes. Les coupes d'or ou les vases murrhins font circuler le chaud Falerne. Nous pensons qu'ici du moins la matrone sera fidèle aux anciennes prescriptions, et que l'enivrante liqueur ne mouillera pas ses lèvres. Nous ne tarderons pas à remarquer cependant une triste dérogation à la coutume générale ; mais ce ne sera hi, sans doute, qu'une exception. Après avoir distribué aux convives les couronnes que les anciens regardent comme un préservatif contre l'ivresse, ]a maîtresse de la maison se retire même au moment où vont commencer les libations qui terminent le repas[44]. Les plats d'argent et de vermeil, les coupes d'or enrichies de pierreries, étincellent sous les feux dei hauts lampadaires qui reposent sur le sol, ou des lampes suspendues au plafond. Tout à l'heure encore, cette précieuse vaisselle décorait l'abacus, l'élégant buffet d'airain, dont les deux tablettes superposées, revêtues de marbre ou d'argent, sont reliées l'une à l'autre par un pied de console reproduisant soit un sphinx, soit la tête et la patte d'un oiseau ou d'un autre animal. Nous disions plus haut que la seconde partie de la maison romaine, le péristyle, était spécialement destinée à l'existence domestique. La vie mondaine n'en était cependant pas exclue, mais elle s'y montrait principalement sous sa forme intellectuelle et artistique. Si, autour du péristyle, se trouvaient les chambres à coucher, les bains, la chapelle domestique, l'on y voyait missi la bibliothèque, la galerie de tableaux, l'exèdre ou salle de conversation. Le Romain avait ainsi placé au fond de sa demeure tout ce qui sert au repos et au charme de la vie. Plus d'une fois la causerie vive et enjouée des matrones dut animer dans l'exèdre les graves entretiens des philosophes[45]. Plus d'une fois aussi, la Romaine de chercher, sur les rayons ou dans les cassettes de la bibliothèque, les volumes de parchemin ou les rouleaux de papyrus sur lesquels s'étaient fixés les chants ailés des poètes. Nul doute non plus que la matrone ne se plût à visiter dans la pinacothèque les peintures des Zeuxis, des Apelles, des Pausias, œuvres inappréciables que protégeaient des cadres à volets ou des châssis vitrés. S'il faut nous en rapporter à l'une des peintures qui illustrent le Virgile du Vatican, les chambres à coucher ne semblent avoir que modérément subi l'invasion du luxe. Dans ce manuscrit, la chambre de Didon est un réduit qui contient pour tout meuble un lit élevé dont le pied se termine par un petit escalier[46]. Mais c'était sans doute, sinon dans la chambre de la matrone, du moins dans le voisinage de cette pièce, que s'abritaient les caisses de hêtre ou de tilleul[47], qui contenaient les vêtements de la Romaine ; et ces coffrets, ces boites qui renfermaient les mille bagatelles plutôt destinées à la parure qu'à l'habillement, et déjà nommées par les vieux Romains : le monde de la femme[48]. Dans les coffres s'amoncelaient ces habits dont la mode renouvelait l'ornementation ou les accessoires[49], mais qui cependant gardèrent toujours les traits caractéristiques du costume des Romaines : la stola et la palla. La stola, longue tunique que les courtisanes n'avaient pas le droit de porter[50], laissait retomber la traîne majestueuse qui semble avoir formé un vêtement distinct et s'être attachée, par derrière, à la ceinture de la matrone[51]. La palla était une ample draperie qui passait généralement sous le bras droit pour retomber sur l'épaule gauche ; ce manteau pouvait aussi servir de voile. Avec ce costume se portait le soccus, soulier qui recouvrait complètement le pied ; ou bien le cothurne, brodequin dont la semelle se prêtait à une élévation que recherchaient les femmes de petite taille. Dans l'intérieur de la maison, la stola parait avoir été remplacée par une tunique plus courte. Au costume de négligé appartenait aussi la solea, sandale se composant d'une simple semelle que retenaient des courroies qui se nouaient sur le cou-de-pied[52]. La laine, la soie de l'Arabie, les aériens et peu décents tissus de Cos, forment la matière de ces vêtements que teint surtout la pourpre de Tyr. Les Romaines portent aussi le blanc, le rose, le bleu d'azur, les nuances d'améthyste, de châtaigne, de safran et de cire, toutes les innombrables teintes qu'à cette époque déjà la mode avait inventées[53]. Les peintures du Palatin nous montrent de quelle manière quelques-unes de ces couleurs se combinaient dans la toilette de la matrone. Une palla jaune recouvre une tunique soit rouge, soit violette, soit blanche doublée de violet, soit encore d'une blancheur diaphane comme un tissu de Cos[54]. En général, ces habits ne sont plus l'œuvre de la matrone et de ses esclaves. De semblables vêtements sont d'un travail trop délicat pour être préparés à la maison[55]. C'est au dehors, comme nous l'avons vu, que de nombreux ouvriers les tissent et les confectionnent. La coiffure reçut d'une manière toute spéciale l'influence de la mode. Nous en avons une preuve dans les statues des impératrices romaines. La coiffure forme souvent dans ces œuvres d'art une pièce mobile que l'on pouvait enlever et remplacer à volonté, afin que l'image male de l'impératrice ne fût pas démodée[56]. Par devant, les cheveux étaient généralement ondulés et relevés ; par derrière, ils retombaient soit en boucles, soit en tresses ; ou bien ils se rassemblaient en un chignon que la mode plaça plus ou moins haut, et qui prit même la forme d'une pyramide. Les cheveux se divisaient aussi en une foule de tresses qui s'enroulaient autour de la tête. Mais si quelques-unes de ces coiffures rappelaient encore la simplicité antique, que dire de ces hautes perruques formées de boucles renversées, et qui semblent avoir été la suprême expression de la mode aux derniers temps de la Rome païenne[57] ? La bandelette, nommée vitta, forme, avec la stola traînante, les attributs de la matrone[58]. Cette bandelette se plaçait derrière les bandeaux relevés. Une autre bandelette, tissue de lin et d'or, pouvait se mettre sur le front pour le ramener aux étroites proportions qu'exigeait la beauté romaine[59]. Les teintes vaporeuses et dorées de cet ornement devaient bien réellement faire rayonner sur la tête le nimbe dont cette bandelette avait le nom. Nous pouvons juger du gracieux effet de cette parure, d'après un buste d'Ariane reproduit par une gravure que nous avons sous les yeux[60] ; ici les cheveux ondulés se relèvent par-dessus le nimbe, courent sous les feuilles et les grappes d'une guirlande de lierre, et retombent en boucles sur les épaules. L'extrême importance que les Romaines attachaient à leur coiffure est attestée par le nombre des esclaves que concernait ce détail de toilette. Chacune de ces femmes, appelées cosmètes, a un office particulier. Si un ingrédient spécial n'a pas teint en blond la chevelure de la Romaine, ou si cette dernière ne porte pas une perruque de cette nuance, une cosmète soufflera de la poudre blonde sur la tête de sa maîtresse. A telle autre cosmète, il appartient de répandre la myrrhe de l'Oronte sur les cheveux de la matrone. Une troisième esclave a pour mission de faire chauffer dans les cendres l'aiguille de fer autour de laquelle elle enroulera les mèches qui doivent former des boucles. L'ornatrice, la plus habile des cosmètes, disposera l'arrangement, et, bien souvent, l'échafaudage de la chevelure. Pendant que l'on coiffe la matrone, une esclave tient devant elle le miroir d'argent[61]. Nous n'énumérerons pas tous les cosmétiques qui venaient se joindre à la teinture blonde pour donner à la matrone ce que la nature avait oublié de lui accorder ou de lui conserver. La blancheur et l'éclat du visage, le noir des sourcils, l'azur des tempes, l'émail des dents, reposaient dans ces petits flacon que la femme grecque nous a déjà fait chercher Herculanum et à Pompéi[62] ; ces flacons presque toue jours aussi funestes à la beauté que la boite fatale que Vénus chargea Psyché de chercher aux enfers. Laissons donc prudemment fermés ces flacons mystérieux. Regardons cet éventail qu'a donné la queue superbe d'Un paon et qu'agitera une esclave[63]. Dans ce climat souvent si chaud, l'éventail ne suffira pas, et notre Romaine tiendra entre les mains pour les rafraîchir un globe de cristal[64]. Ouvrons maintenant les cassettes qui contiennent les bijoux de la matrone, et où ruissellent les émeraudes, les topazes, les perles de l'Inde[65]. Les merveilleuses ciselures de l'orfèvrerie étrusque, la grâce suprême des bijoux grecs, la sévère élégance des joyaux romains, ont versé leurs trésors dans l'écrin de la matrone. Remarquons ce diadème gréco-étrusque d'or et d'émail. De nombreuses petites lames verticales le forment, et sont réunies entre elles par une bande estampée en astragale et qui constitue le bord inférieur du diadème. Sur ces lames sont rivés avec une capricieuse profusion des fleurs et d'autres ornements. La décoration du milieu se compose de marguerites qui courent le long du diadème, et dont le cœur est liguré par une perle. Çà et là se distinguent de mignonnes pâquerettes. Des palmettes, incrustées de perles bleues ; forment le couronnement de ce joyau, dont la royale élégance a ce caractère de simplicité que l'influence hellénique donne aux œuvres d'art[66]. Voyons aussi ce collier grec dont les étoiles d'or sont reliées par des perles[67] ; et ce beau collier romain dont les huit nœuds d'or massif, rappelant nos lacs d'amour, alternent avec sept cylindres d'émeraudes égyptiennes[68]. Bien des objets sollicitent encore notre attention : les petites bulles qu'une chaîne suspend au cou ; les fibules en forme d'arc, et qui agrafent les diverses parties du costume ; les bagues dont la matrone porte des garnitures et qui sont ornées soit de pierreries ou de perles, soit de camées ou d'intailles ; les épingles à cheveux que surmonte un chapiteau d'où l'Amour prend son vol ou sur lequel Vénus préside à sa toilette[69]. Accordons aussi un regard à ce spinther qui s'enroule plusieurs fois autour du bras gauche, et porte à chacune de ses extrémités une tête de serpent[70]. N'oublions pas cet autre bracelet, semblable à une branche de palmier ployée en cercle, et laissant tomber deux spathes qui forment deux petites clochettes[71]. Il parait que la matrone aime le tintement que produit le choc de ces mignons objets. Nous pouvons juger de ce goût par les boucles d'oreilles qui portent le même nom qu'une espèce de castagnettes, la crotale. A chacun de ces petits joyaux se suspendent, comme les plateaux d'une balance, deux elenchi, perles taillées en poires, et qui, en se touchant, produisent un joyeux cliquetis[72]. Les elenchi décoraient encore d'autres boucles d'oreille. Ces pendants pouvaient être si lourds qu'ils allongeaient la délicate membrane qu'ils ornaient[73]. Mais qu'importait cette souffrance aux élégantes Romaines qui ne craignaient même pas de suspendre à chacune de leurs oreilles deux ou trois patrimoines[74] ! La pourpre et l'or étaient déjà recherchés par la matrone, alors même qu'elle travaillait au milieu de ses esclaves. A la fin de la période précédente, nous constations que les lois somptuaires avaient paru utiles, et nous mentionnions la loi Oppia qui limitait la quantité d'or que pouvaient posséder les femmes, leur défendait aussi de porter des vêtements aux couleurs variées, et ne permettait pas que, dans une ville, ou dans le rayon d'une ville, les matrones se servissent de voitures à moins que ce ne fût pour se rendre aux solennités religieuses. Vingt ans après, à peine Rome commençait-elle à respirer après la deuxième guerre punique, qu'un spectacle étrange et vraiment nouveau se produisit dans la grande cité. Bravant à la fois et la défense de leurs époux et les lois de la modestie, les femmes quittaient leurs demeures, se répandaient dans les rues, allaient presque jusqu'au Forum. Parlant aux hommes qui se rendaient sur la place publique, elles ne craignaient même pas de s'adresser aux magistrats, aux préteurs, aux consuls. Qu'était-il donc Arrivé ? Jusqu'alors, cette dispersion des femmes dans les lieux publics avait été le signe le plus effrayant des suprêmes angoisses patriotiques. Annibal s'était-il donc présenté de nouveau aux portes de Rome ? Non, Rome avait bien réellement conquis la paix par la victoire. Et c'était pourquoi les matrones venaient supplier leurs concitoyens de leur rendre leur luxe au sein de leur ville prospère et triomphante. Ce jour-là même, l'abrogation de la loi Oppia de-irait être demandée par deux tribu us. Mais déjà deux collègues de ces derniers avaient l'intention de parler faveur de la loi. De même que ces magistrats populaires, beaucoup de patriciens attaquaient ou soutenaient l'œuvre d'Oppius. Les adversaires et les défenseurs de la loi couvraient jusques au Capitole. Ce fut au milieu de ce tumulte que l'un des consuls — c'était Caton le Censeur — prit la parole dans l'assemblée publique. Avant de blâmer les femmes qui, en abandonnant l'ombre du foyer, ont dérogé aux anciennes coutumes, Caton blâme les hommes dont la faiblesse a rendu possible une telle démarche. Si les Romains n'avaient pas abdiqué devant leurs compagnes leur autorité domestique, les femmes ne seraient pas venues si près du Forum pour les dominer jusque dans leur vie publique. Caton ignore si, en cette circonstance, les matrones ont exercé une pression sur les tribuns, ou si cette pression a été exercée sur elles par ces magistrats. Quelle honte pour les tribuns s'ils se sont servis de femmes même pour donner un nouvel aliment à leurs séditions ! Quelle honte aussi pour les consuls si les matrones, imitant la retraite du peuple sur le mont Sacré, remportent ainsi la victoire ! Ce n'est pas sans rougir que l'austère Caton a dû traverser cette foule de femmes pour aller au Forum ; et si, retenu par le respect que lui inspiraient la pudeur et la majesté sinon de toutes en général, au moins de chacune en particulier, il n'eût redouté d'infliger à ces matrones la honte de se voir apostrophées par un consul, il leur eût sévèrement reproché de quitter leurs foyers pour chercher les suffrages d'hommes étrangers à leurs familles. Que ne se bornaient-elles à exprimer leurs vœux à leurs époux ? Et encore, même dans leurs maisons, devraient-elles s'occuper des lois ? Les anciens Romains qui tenaient sous leur puissance leurs filles, leurs sœurs, leurs épouses, ne permettaient même pas à la femme de s'occuper d'une affaire privée sans leur autorisation. Et les descendants de ces mêmes hommes permettent aux Romaines de traiter jusqu'aux affaires publiques ! Que l'on donne un libre cours à la nature de ce sexe indompté, et que l'on espère ensuite que celui-ci saura s'arrêter de lui-même ! Ce que veut la femme, ce n'est pas la liberté, c'est la licence. Si elle sape, l'une après l'autre, toutes les lois à l'aide desquelles on la contient déjà si difficilement, qu'adviendra-t-il ? Après s'être égalée à l'homme, elle voudra le dominer. En vain dira-t-on qu'elle se borne à repousser une loi injuste. Non, en ébranlant une seule loi, on ébranle toutes les autres. Si chacun détruit les lois qui le gênent, à quoi sert de voter publiquement ces lois ? Caton demande aussi, avec ironie, pourquoi ces femmes effarées parcourent les rues ? Viennent-elles demander, comme autrefois, que l'État rachète ceux de leurs parents qu'Annibal a faits prisonniers ? Cette grâce, elle leur a été naguère refusée. Si les tendres sentiments de la famille ne les animent pas, alors c'est donc un motif religieux qui les rassemble ? Elles vont au-devant de la Grande Déesse ? Quel prétexte convenable peut-on donner à cette révolte féminine ? C'est, me répond-on, afin que nous brillions sous l'or et sous la pourpre ; afin que, dans nos voitures, aux jours fériés et non fériés, nous nous fassions traîner par la ville comme les triomphatrices de la loi vaincue et abrogée, et de vos suffrages captés et arrachés ; et afin qu'il n'y ait nulle limite à nos dépenses, à notre luxe[75]. S'élevant alors à un point de vue plus général, le vieux Romain déplore que les conquêtes mêmes de Rome aient développé, chez les citoyens de cette ville, deux vices opposés : le luxe et l'avarice ; ces vices, ajouterons-nous, qui découlent de la même source, la recherche des biens matériels. En effet, l'avarice recherche l'or pour lui-même, et le luxe pour les jouissances que ce métal procure. Confondant ici le luxe avec l'art, le Censeur semble maudire jusqu'à l'invasion des admirables statues helléniques. Il regrette ses antiques dieux d'argile, et se rappelle avec mélancolie le temps où les Romaines refusèrent les dons de Pyrrhus. Aucune loi somptuaire n'existait alors, parce que, suivant la belle pensée de Caton, la loi suit le mal comme le remède suit la maladie. Maintenant, les dons de Pyrrhus ne seraient plus rejetés. Mais, je l'avoue, continue
l'orateur, il est des envies dont je ne peux
pénétrer ni la cause ni la raison. En effet, si ce qui était permis à
d'autres ne vous l'était pas, peut-être la honte ou l'indignation aurait-elle
quelque chose de naturel. Mais la parure étant ainsi égale pour toutes,
pourquoi chacune de vous craint-elle qu'elle ne se fasse remarquer ? Il est,
en vérité, très-mauvais d'avoir honte ou de l'économie ou de la pauvreté ; mais
la loi vous tire de chacun de ces (soucis), puisque, ce que vous n'avez pas, elle ne vous permet pas
de l'avoir. — C'est cette même inégalité que
je ne peux souffrir, dit cette femme riche. Pourquoi ne me ferais-je pas
distinguer par l'éclat de l'or et de la pourpre ? pourquoi la pauvreté se
cache-t-elle si bien sous l'apparence de cette loi que ce que les femmes
n'ont pas le moyen -d'avoir, il semble qu'elles pourraient l'avoir si cela
-était permis ? — Romains, poursuit Caton,
voulez-vous jeter vos femmes dans un combat où les riches voudront avoir ce
que nulle autre ne pourra posséder ; où les pauvres, pour ne pas être
méprisés à cause de cela, étendront leurs dépenses au delà de leurs moyens ?
Assurément, en commençant à rougir quand il ne le faut pas, on ne rougira pas
quand il le faudra. Celle qui aura des ressources personnelles fera de la
dépense ; celle qui ne le pourra pas s'adressera à son mari. Malheureux cet
homme, et s'il fléchit, et s'il demeure inexorable ! Car, ce que lui-même
n'aura pas donné, il le verra donner par un autre[76]. Ce que de telles réflexions ont encore d'actuel à notre époque n'échappera sans doute à personne. Ce qui était vrai au siècle de Caton est d'une rigoureuse application au nôtre. L'amour du gain, la passion du luxe, sont deux des plaies qui dévorent notre société. La satisfaction des appétits matériels ne laisse plus que bien peu de place à la vie de l'âme. Comme chez les Romains dégénérés, la femme, en particulier, ne contribue que trop à l'extension du luxe ; souvent les femmes opulentes ne voient dans leur fortune que le moyen de se procurer une élégance de parure à laquelle ne peuvent atteindre les autres femmes ; et celles-ci, s'épuisant en de continuels efforts, ruinent leurs familles pour soutenir une lutte trop inégale. Comme chez les Romains dégénérés, plus d'une femme est disposée à sacrifier sa vertu plutôt que sa toilette, et, suivant l'énergique expression du Censeur romain, ce que le mari ne donne pas, un autre le donne ! Les contemporains de Caton et leurs descendants surent, par une amère expérience, ce que coûte le luxe des femmes. Dans cette société corrompue où, comme à une époque trop connue de nous, l'habillement de l'honnête femme ne distingue plus celle-ci de la courtisane, la matrone porte sur elle, nous l'avons déjà vu, ses domaines, sa fortune, le patrimoine de sa famille ; elle vend même son honneur pour une parure[77] ! En achevant son discours, Caton fait observer que déjà les Romaines se sont acheminées vers le déshonneur en allant présenter à des étrangers une requête contraire à l'intérêt de leurs familles. Le consul trouve avec raison que si la loi Oppia doit être abrogée, mieux eût valu qu'elle n'eût jamais été créée : quand la bête fauve a été emprisonnée, elle ne jouit qu'avec plus de fureur de la liberté reconquise ; ainsi en sera-t-il du luxe. C'est pourquoi le Censeur conclut au maintien de la loi. L'illustre orateur termine son discours par un vœu tout patriotique : Quoi que vous fassiez, dit-il, je souhaite que les dieux vous rendent tous heureux[78]. Les deux tribuns favorables à la loi ajoutèrent à cette belle harangue quelques paroles empreintes du même esprit. Puis l'un des tribuns qui avaient proposé l'abrogation de la loi, L. Valérius, monta à la tribune pour soutenir la cause des matrones. Il s'acquitta de sa mission avec une grâce aimable, avec une grande habileté de discussion. Jamais chevalier français ne déploya plus de zèle et de courtoisie pour défendre les intérêts de la femme ; et c'est un fait curieux que cette première apparition d'un pareil langage dans les sévères débats des assemblées romaines. Valérius déclara d'abord que Caton avait beaucoup plus attaqué les matrones que défendu la loi et qu'il avait fort exagéré la portée de leur requête. Nous savons tous, ajouta Valérius avec enjouement, que Caton est un orateur non-seulement sévère, mais, quelquefois aussi, farouche, bien que son naturel soit doux[79]. Le tribun justifie l'attitude des matrones. Est-ce donc la première fois que les Romaines s'assemblent en dehors de leurs maisons ? Valérius énumère adroitement ici les occasions où l'intervention publique des femmes vint à se produire, et les exemples qu'il cite sont en même temps, sans qu'il le dise, les titres des matrones à la reconnaissance et à la faveur des Romains : les Sabines se jetant dans la mêlée pour séparer leurs maris de leurs pères ; les Romaines fléchissant Coriolan, ou apportant leur or au rachat do leur ville prise par les Gaulois ; les veuves secourant de leurs contributions le Trésor épuisé par les guerres puniques : les matrones enfin allant chercher la Grande Déesse pour attirer sa protection sur leur patrie menacée. Sans doute, les circonstances ne sont plus les mêmes. Mais si l'on n'a pas été surpris de voir les femmes se dévouer aux intérêts généraux du pays, peut-on leur reprocher d'agir pour sauvegarder leurs propres intérêts ? Cependant Caton a montré, et le péril qu'il y avait à changer les lois, et le danger qu'offrait l'invasion du luxe. Certes, les lois qui ont une raison permanente d'exister, doivent être respectées. Il n'en est pas de même des lois d'exception ; et la loi Oppia est l'une de celles-ci : elle fut publiée à l'heure où Annibal menaçait Rome, à l'heure où chacun apportait à la nation sa part de sacrifices. Alors les matrones ne pensaient pas à leur parure. Si grande était leur douleur que le Sénat lui-même dut y mettre des bornes pour que les fêtes de Cérès ne fussent pas célébrées par des femmes en deuil. S'il faut maintenir toutes les mesures qui furent prises à cette époque, pourquoi n'oblige-t-on pas aussi les Romains aux sacrifices qu'imposait alors le salut de l'État ? Désormais tous les citoyens de Rome jouiront des bienfaits d'une heureuse paix : leurs femmes seules n'y participeront pas ? La pourpre qui décore la toge du prêtre et celle du magistrat, ce dernier fût-il même de l'ordre le plus inférieur ; la pourpre qui borde la robe de l'enfant, la femme seule n'aura pas le droit de la porter ? Il sera permis à l'époux d'avoir une couverture de pourpre, et l'épouse ne pourra posséder un petit-voile de cette nuance ? La housse de votre cheval sera plus belle que la robe de votre femme ?[80] Valérius veut bien admettre qu'à l'appui d'une injuste
thèse l'on prétende que la pourpre s'use. Mais l'or, l'or n'est-il pas plutôt
une ressource dans les épreuves privées ou publiques ? L'expérience en. a été
faite : Valérius se garde bien de ne pas le faire remarquer, puisqu'il y a là
encore une allusion au dévouement patriotique des Romaines. On a dit que la
loi Oppia faisait disparaître toute rivalité entre les femmes. Entre les
Romaines, soit ! Mais entre les Romaines et.les étrangères, qu'adviendra-t-il
? Comme elles souffriront les matrones, lorsqu'elles verront les femmes des
alliés briller sous l'or et sous la pourpre qui sont défendues aux Romaines ;
et se faire traîner dans des chars qu'elles, Romaines, elles suivront à pied
! Ce serait à faire supposer que l'empire appartient, non à Rome, mais aux
villes alliées. Cela pourrait blesser l'esprit de
l'homme ; que pensez-vous qu'il en soit de ces frôles femmes qui déjà
s'émeuvent de peu ? Elles ne peuvent atteindre ni aux magistratures, ni aux
sacerdoces, ni aux triomphes, ni aux honneurs, ni aux récompenses militaires,
ni aux dépouilles guerrières. L'élégance, l'ornement, la parure, telles sont
les distinctions des femmes ; c'est par cela qu'elles se réjouissent et se
glorifient ; c'est cela que nos ancêtres appelaient : le monde de la femme.
Quelle autre chose déposent-elles dans le deuil, sinon la pourpre et l'or ?
Quelle autre chose revêtent-elles quand leur deuil est fini ? De quelle autre
chose (se parent-elles) dans les actions de grâces et les supplications, si ce
n'est qu'elles y ajoutent plus d'ornement ? Apparemment que si vous abrogiez
la loi Oppia et que vous voulussiez défendre ce que maintenant la loi défend,
cela ne serait pas en votre pouvoir ; et que vos filles, vos femmes, vos
sœurs même seraient moins sous la puissance de chacun de vous. (Non,) tant que
leurs proches sont en vie, jamais les femmes ne sortent de la servitude ; et
cette même liberté qui les fait veuves et orphelines, elles la détestent.
Elles aiment mieux que leur toilette dépende de vous que de la loi. Et vous,
vous devez les avoir sous votre puissance et sous votre tutelle, non dans
votre esclavage ; et il vaut mieux être nommés leurs pères ou leurs époux que
leurs maîtres. Le consul s'est servi tout à l'heure de paroles irritantes,
parlant d'une révolte et d'une retraite des femmes. Certes il n'y a pas de
danger que, comme autrefois le peuple irrité, elles s'emparent du mont Sacré
ou de l'Aventin. Quoi que vous décidiez, leur faiblesse le souffrira. Plus
vous avez de pouvoir, plus votre autorité doit être modérée[81]. L'habile avocat avait fait un sûr appel aux sentiments les plus vivaces des Romains : la reconnaissance, l'orgueil national, et même, pour plusieurs, les affections de famille. Encouragées par ce plaidoyer, les femmes, en plus grand nombre que jamais, se portèrent chez ceux des tribuns qui étaient hostiles à leur cause et dont elles surent vaincre la résistance. Leur triomphe fut complet. Les Romains abrogèrent à l'unanimité la loi Oppia. Certes, comme le disait si justement Caton, il est périlleux de toucher aune loi : en ébranler une, c'est ébranler toutes les autres. Mais, comme le répondit Valérius, la loi Oppia n'était qu'une loi d'exception, votée sous la pression d'un danger qui n'existait plus. Les Romains pouvaient donc l'abroger. En imposant les mêmes limites aux femmes riches et aux femmes pauvres, cette loi était bien réellement, quoi qu'en ait dit le censeur, plus favorable aux dernières qu'aux premières. Les lois somptuaires ne sauraient être équitables qu'en établissant de justes proportions entre les revenus et les dépenses des personnes qu'elles enchaînent ; et qui ne voit combien une pareille constatation serait vexatoire pour les familles qui auraient à la subir ? Si, avec l'austère consul romain, nous déplorons, et l'étrange apparition de la femme dans la vie publique, et les entraînements d'un luxe qui triomphe même de la vertu ; avec Valérius nous trouvons que c'est à la famille, non à l'État, qu'il appartient de prévenir ces abus. Toutefois ce n'est pas seulement, comme le pense le trop indulgent tribun, ce n'est pas seulement, disons-nous, au bon plaisir du chef de la famille, que nous reconnaissons cette influence, c'est aussi, c'est surtout aux sages préceptes et aux bons exemples d'un père et d'une mère. Ce sont les mœurs qu'il faut corriger ici. Quand la femme ne trouve pas dans sa propre raison le frein qui doit modérer ses goûts, les lois somptuaires sont impuissantes, et, comme la loi Oppia, d'une durée éphémère. Il faut donc qu'une sage éducation forme dans la femme, non un automate qui se parc mécaniquement, mais une âme qui se sente vivre. Alors la femme ne considérera plus que comme un détail secondaire les soins qu'elle donnera à sa parure corporelle. Riche, elle saura régler le nombre et l'élégance de ses toilettes d'après sa fortune, et aussi d'après la simplicité de ses goûts. Pauvre, elle se contentera des vêtements qui conviennent à sa modeste situation. En parlant ailleurs des premières chrétiennes, nous verrons aussi quelles armes l'Évangile donnera à la femme pour lui faire repousser le démon du luxe. Mais les enseignements domestiques qui seuls, au siècle de Caton, auraient pu combattre un tel ennemi, ces enseignements étaient devenus rares ; et ce que la loi n'avait pu opérer, la famille ne semble pas avoir souvent tenté de le faire. Répétons-le : l'un des symptômes les plus alarmants qu'offrit l'abrogation de la loi Oppia, ce fut l'irruption des femmes aux abords de la place publique. Les Romaines devaient aller plus loin encore dans cette voie funeste de l'émancipation féminine. Le Forum même était destiné à entendre des femmes plaider leur cause. Deux d'entre elles, Amaésia Sentia et Hortensia, ne le firent du moins que d'une manière accidentelle, et ne soulevèrent même d'autre sentiment que l'admiration de leurs concitoyens pour leur parole virile. Mais Afrania, la compagne d'un sénateur, Afrania, plaideuse infatigable, ne se distingua que par des cris que Valère-Maxime compare à des aboiements ; et cette étrange créature s'attira un tel mépris que son nom devint l'une des plus sanglantes injures qu'une femme pût recevoir. Afrania vécut jusqu'au temps de Jules César, et Valère-Maxime qui précise la date de sa mort (48 ans avant J.-C.), Valère Maxime trouve que lorsqu'il s'agit d'un pareil monstre, l'histoire doit plutôt enregistrer la mémoire de sa destruction que celle de sa naissance[82]. L'impudence avec laquelle Afrania abusa du droit d'agir en justice, pour le compte d'autrui, fit retirer ce droit à toutes les femmes par un édit du préteur. Il vint même une époque où la femme ne put s'engager pour autrui : le célèbre sénatus-consulte Velléien eut pour objet cette prohibition[83]. Si, au temps de Juvénal, les femmes n'avaient plus la faculté de se faire entendre dans les débats judiciaires du Forum, il n'y eut cependant presque pas de procès qui ne fût causé par elles. Leur habileté juridique est comptée par Juvénal au nombre des défauts qu'il leur reproche[84]. Parmi les portraits que le poète satirique nous a tracés de ses contemporaines, quelques-uns sont consacrés à des figures qui se rapportent particulièrement aux variétés d'un type fort répandu alors : celui de la pédante, type de tout temps haïssable, et qui, en dépit du ridicule sous lequel il a été plus d'une fois couvert, a survécu à Juvénal, et même à Molière ! Tâchons d'écouter cette femme, qui, à peine installée à un repas, juge et compare les poètes. Elle ne cause pas, elle ne discute même pas, elle discourt. Devant ce déluge de phrases, le rhéteur s'avoue vaincu ; l'avocat même, et, de plus, une autre femme ! ne peuvent placer une seule parole. La femme qui affecte de savoir et de parler le grec, la grammairienne qui ne souffre pas qu'une amie de campagne emploie une expression que repousse la délicatesse de son oreille, ce sont là des figures que Molière semblerait avoir prises à Juvénal, si nous ne savions que les originaux de ces portraits sont revenus poser devant le comique français, et qu'ils seront d'ailleurs toujours à la disposition du peintre qui voudra les choisir pour modèles. Devant la pédante, Juvénal parle comme parlera quinze siècles plus tard le pauvre Chrysale, et souhaite fort que la femme demeure dans une ignorance qui la préserve du danger d'afficher son savoir[85]. Mais Juvénal et Chrysale se trompent en attribuant à l'instruction véritable les écueils d'un savoir superficiel. La présomption n'appartient qu'à celui-ci ; le vrai savoir ose seul être modeste. Le pédantisme était l'une des faces de cet orgueil que nous ne rencontrons que trop souvent chez les Romaines de la seconde période. Cette humeur altière s'était si fortement enracinée chez ces matrones, que la chaste patricienne elle-même se vantait et de ses aïeux, cette noblesse de race, et de ses vertus, cette noblesse personnelle. Si nous ajoutons à ces portraits celui de la femme curieuse et bavarde[86] qui abandonne son foyer pour chercher des nouvelles qu'elle ira colporter en ville, nous aurons été initiés d'une manière à peu près complète aux travers que Juvénal avait malicieusement notés chez ses contemporaines. Mais le satirique n'a pas seulement mis en lumière les défauts de ces femmes, il nous a longuement entretenus de leurs vices. Quelque répugnance que nous ayons à le suivre ici, nous ne pouvons nous soustraire à cette tâche. Mais le lecteur comprendra que, sous le crayon d'une femme, cette esquisse de mœurs ne pourra apparaitre dans tout son jour ; et que, plus d'une fois, nous avons dû laisser dans l'ombre quelques détails du tableau original. C'est en vain que l'on voudrait pouvoir douter de la hideuse réalité de certains types dessinés par le poète. Malheureusement, l'histoire confirme ici le témoignage de la satire. La Messaline de Juvénal est aussi la Messaline des annalistes ; et s'il nous répugnait de croire à l'effroyable immoralité que le poète découvrit chez ses concitoyennes, Tacite, Suétone nous diraient que, sous le règne de Tibère, des-patriciennes se firent inscrire sur le registre des plus viles courtisanes, afin de pouvoir se livrer au crime sans subir les châtiments réservés au déshonneur des matrones[87]. Cependant, ces châtiments eux-mêmes, la femme de Rome sait aussi, non pas seulement s'y dérober par un infâme moyen, mais encore les braver avec une audacieuse effronterie. Pour que la femme ne fût pas exposée à perdre, avec sa raison, le sentiment de sa dignité, les lois antiques menaçaient du châtiment suprême, réservé à la matrone adultère, la femme qui aurait goûté au jus fermenté de la vigne. Bravant à la fois, et la répression qui attend l'épouse infidèle, et la punition non moins terrible à laquelle s'expose la femme qui a bu du vin, la matrone videra la coupe de Falerne, et, abrutie par l'ivresse, elle perdra ce qui peut lui rester de pudeur. Telle autre n'aura même pas besoin de s'étourdir pour
manquer à ses devoirs. Coupable, c'est elle qui d'abord accusera son mari
d'avoir manqué à la fidélité conjugale. Elle saura même gémir et pleurer ; et
l'aveugle époux, voyant dans cette douleur un témoignage d'amour, séchera
sous ses baisers les larmes dont il croira être la cause. Et quand il
connaîtra la vérité, quand il se verra trahi, même pour un esclave, que dira
la femme convaincue d'adultère ? Il fut autrefois
convenu que tu ferais, toi, ce que tu voudrais, et que je pourrais aussi me
livrer à mon caprice. Crie, cela t'est permis, remue ciel et terre ; je suis
femme ![88] Et dans cette exclamation, le latin a une énergie que ne peut reproduire notre langue ; le poète se sert du mot qui désigne à la fois l'homme, la femme, le genre humain : Homo sum ! s'écrie la matrone infidèle. Oui, en effet, cette femme criminelle appartient à l'humanité, mais à cette humanité déchue qui, dans son orgueil, s'était éloignée de Dieu, et, pour son châtiment, tombait au-dessous de l'animalité. Où les Romaines trouvaient-elles un frein salutaire ? Serait-ce dans le culte de Bona Dea, la déesse qui protège la pudeur de la femme ? Mais nous savons que, même aux siècles d'austérité, ce culte avait des rites que pouvait seule expliquer la grossière naïveté de leur symbolisme. Aux yeux des pures Romaines d'autrefois, peut-être ces rites n'éveillaient-ils le plus souvent qu'une pensée religieuse. Mais pour la matrone de la décadence, l'idée disparaît, le symbole seul reste ; et, par le culte de la déesse qui veille à l'honneur des femmes, la matrone est exposée aux plus honteuses suggestions. Faut-il nous étonner alors que la corruption, qui. émanait du sanctuaire, y eût été reportée ? Voyez cette femme qui se tient devant l'autel de Janus et de Vesta. Chastement voilée, elle a sacrifié aux deux divinités, avec le far et le vin, une victime dont les entrailles vont être interrogées. La matrone prie. Elle demande à Janus et à Vesta de soulever pour elle un coin du voile qui cache l'avenir. Quand la victime est ouverte, la matrone pâlit. Ah ! sans doute, c'est pour un mari ou un fils en danger, qu'elle interroge le destin avec une telle anxiété ? Ce n'est que pour les affections de la famille qu'elle s'est approchée des vieux autels romains, et qu'elle a demandé la protection de Vesta, la déesse du foyer ? Approchons-nous d'elle, surprenons avec le murmure de ses lèvres le secret de son cœur... Que demande-t-elle, cette matrone, cette suppliante ? Ce qu'elle demande ? C'est de savoir si l'homme qu'elle aime, un joueur de lyre, recevra la couronne de chêne aux jeux capitolins. Ce que cette femme désire apprendre au sujet d'un cithariste, une autre le souhaitera au sujet d'un tragédien, ou même d'un comédien, car tous les héros du théâtre ont le privilège de passionner les Romaines. Le mime, le joueur de flûte, ont aussi leurs adoratrices. Mais que dire de l'enthousiasme que soulèvent chez les matrones les gladiateurs du cirque ? Voici la femme d'un sénateur. Pour suivre un gladiateur, elle abandonne son mari, ses enfants, sa sœur, son pays. Elle brave les périls de la mer, elle va jusqu'en Égypte. Mais l'homme à qui elle sacrifie ses devoirs, sa famille, son rang, sa patrie, cet homme a donc reçu en partage ou la beauté sculpturale, ou la noblesse d'attitude que l'art romain a données aux statues de gladiateurs ? Non, cet homme est âgé, il est difforme, il est manchot, il est d'un aspect repoussant. Mais, comme le fait remarquer Juvénal, il est gladiateur ! Il a manié le fer, il a fait couler le sang : charme irrésistible aux yeux d'une Romaine[89] ! La cruauté se joint, en effet, à la dissolution chez la matrone des temps nouveaux. Elle-même, fait rare cependant, descendra dans cette arène où combattaient seulement autrefois des esclaves ou des condamnés à mort. La patricienne se fera athlète ou gladiateur[90]. La vue des jeux du cirque avait habitué la Romaine à contempler, avec un Apre et barbare plaisir, les dernières convulsions de la vie expirante. Pour la femme dépravée, dont toutes les impressions étaient émoussées à l'avance, c'était peu que d'assister à la lutte sanglante : il fallait y prendre part, tuer ou se faire tuer ; goûter à la fois, et l'émotion que lui donnait le sentiment d'un danger personnel, et l'horrible jouissance de voir couler le sang qu'elle-même avait répandu. Et sans descendre dans l'arène, dans cette arène où, après tout, la femme expose sa propre vie pour attenter à la vie d'autrui, la matrone peut se procurer, dans sa propre demeure, la satisfaction de torturer un être humain. N'a-t-elle pas des esclaves ? Cherchons ici la place que tiennent, dans la journée de la femme riche, les relations de la matrone et de ses serviteurs. La Romaine s'est levée de mauvaise humeur. Ses esclaves, hommes ou femmes, vont s'en apercevoir, car voici les bourreaux que leur douce maîtresse a loués à l'année. Les exécuteurs commencent leur tâche hideuse ; et leurs férules, leurs lanières, leurs étrivières, lacèrent les pauvres serviteurs. Pour rendre plus facile l'œuvre du bourreau, les coiffeuses ont dû se dépouiller de leurs vêtements. Le supplice continue, et la matrone n'a d'autre souci que celui d'oindre son visage avec un cosmétique. Le supplice continue, et la matrone reçoit ses amies ou examine la broderie d'or d'un vêtement. Le supplice continue, et la matrone lit un long journal. Les bras des exécuteurs se lassent plus vite que la barbarie de la Matrone ; et lorsque la fatigue arrête les bourreaux, la cruelle Romaine, s'adressant à l'esclave châtié, lui crie d'une voix terrible : Sors, la cause est jugée ![91] Mais la matrone est pressée de quitter sa demeure : on l'attend, ou dans les jardins publics, ou dans le temple immonde de la déesse Isis. Vite, une coiffeuse ! Cette esclave frise les cheveux de sa maîtresse. Mais pourquoi ses épaules et sa poitrine sont-elles découvertes ? C'est pour que le nerf de bœuf la blesse plus sûrement s'il lui arrive d'allonger une boucle un peu plus que l'autre. Ainsi Ovide nous montre une femme déchirant de ses ongles le visage de sa coiffeuse, lui enfonçant dans le bras l'aiguille destinée à retenir ses cheveux : et la pauvre esclave, maudissant la tête qu'elle touche, pleurant et saignant à la Ibis sur ces cheveux détestés[92]. Enfin la matrone est coiffée ; une vieille esclave expérimentée est appelée pour juger du goût avec lequel s'élève sur la tête de sa maîtresse l'édifice pyramidal. Chacune des autres femmes donne à son tour son avis sur une question dont l'importance ne serait pas plus grande s'il s'agissait de la réputation ou de la vie de la coquette patricienne. Le soin de paraître belle est la plus sérieuse occupation de la matrone. Mais cependant, cette femme a un mari ? Ah ! ce mari, elle ne s'en occupe que pour recourir 'à sa bourse, ou pour haïr ses amis, ses esclaves. Où est la matrone filant près de l'autel domestique, au milieu de ses femmes ; ou veillant avec bonté aux travaux agricoles de ses esclaves ? Mais quel est ce bruit étrange ? Les tympanons retentissent, des voix enrouées les accompagnent, et le chœur de la furieuse Bellone et de la mère des dieux fait son entrée chez la patricienne. Coiffé de la mitre phrygienne, un eunuque dirige le cortège. De sa forte voix, il annonce à la matrone que de grands malheurs l'attendent si elle ne lui donne une centaine d'œufs et ses vieilles tuniques feuille-morte. Et cette Romaine, tout à l'heure si orgueilleuse et si barbare, elle tremblera à son tour, elle se soumettra aux plus dures et aux plus humiliantes prescriptions, dût-elle se plonger trois fois, chaque matin, dans le Tibre glacé, dût-elle aller chercher au fond de l'Égypte l'eau dont elle arrosera le temple d'Isis. La religion naïve de ses pères ne lui suffit plus : il lui faut les superstitions étrangères, le culte phrygien de Cybèle, le culte égyptien d'Isis. Après que s'est retiré le chœur des déesses asiatiques, voici la sorcière juive ; voici encore l'aruspice, d'Arménie ou de Comagène qui, de nième que cette horrible Canidie flagellée par Horace, interroge jusqu'aux entrailles d'un enfant ! Et pour quel motif ? Pour promettre à la matrone un amour illicite ! — Voici enfin le plus sûr oracle de la Romaine, l'astrologue chaldéen. La matrone lui demande quelles limites doivent avoir la vie de sa mère, la vie de sa sœur, la vie de son mari, la vie de l'étranger qu'elle aime... Et cette dernière existence est la seule dont cette femme ne souhaite pas le terme... Trop heureux encore l'époux si sa compagne ne hâte pas elle-même la fin de sa vie ! Plus d'une matrone connaît les breuvages qui font perdre à un mari, ou une raison qui la surveille, ou une vie qui la gène[93]. La belle-mère sait aussi les moyens de faire disparaître les enfants d'une première épouse. La mère, la mère elle-même, est un objet de méfiance pour son propre enfant ! Mais devons-nous seulement l'appeler du nom de mère, cette femme qui, selon le témoignage de Tacite, s'est déchargée de ses devoirs maternels sur une nourrice, sur des servantes ; et ne faisant sucer à l'enfant qu'un lait vénal, ne l'entourant que de soins mercenaires, lui a ainsi fait inculquer dès le berceau les vices dégradants de l'esclavage[94] ! Devons-nous l'appeler du nom de mère, cette femme qui ne s'occupe de son fils et de sa fille que pour corrompre leurs cœurs ; dignement secondée en cela par l'aïeule qui, bien différente de cette vénérable parente à laquelle on confiait autrefois la surveillance des enfants, n'inculque à son petit-fils et à sa petite-fille que l'amour du gain, même du gain illicite[95] ! C'est ainsi que se forment les générations qui seront la perte de Rome et l'opprobre de l'humanité. La dépravation de la femme est générale. La plébéienne rivalise de honte et d'audace avec la patricienne. Ainsi que l'a prévu Caton, la femme pauvre cherche à imiter le luxe de la femme riche. Pour aller aux jeux publics, elle ne pourrait, comme son opulente rivale, être portée par de grands esclaves syriens, dans une litière fermée par de larges vitraux ; elle n'aurait ni ces gardes, ni ces noirs esclaves, ni ces coiffeuses, ni ces parasites, qui forment le cortège et défendent l'approche de la patricienne[96]. N'importe ! Ce qu'elle n'a pas, elle paraitra l'avoir ; elle louera une litière, elle louera des esclaves, elle louera même sa toilette. Elle aussi, elle se passionne pour les tristes héros du cirque ; elle donne à l'athlète tout ce qui lui reste de l'argenterie que ses pères lui ont laissée. Elle aussi, elle est superstitieuse ; mais ne pouvant parvenir aux augures que recherche la femme opulente, elle erre dans le cirque ou sur les remparts, pour y rencontrer quelque devin de bas étage ou quelque saga qu'elle désire consulter sur une grave question de sa vie. Devant la corruption de ses contemporaines, le poète reculera d'effroi ; et pour chercher la Pudicité, il oubliera même ces premiers temps historiques où, selon sou propre témoignage, elle s'était montrée si grande ; il se reportera à une époque de barbarie légendaire, et dira : Je crois que, sous le règne de Saturne, la Pudicité séjourna sur la terre, et y fut longtemps vue, alors qu'une froide caverne offrait d'humbles demeures, et enfermait sous une ombre commune, et le foyer, et les Lares, et les troupeaux, et les maîtres ; alors que, sur la montagne, l'épouse faisait un lit rustique avec des feuilles, et du chaume, et les peaux des bêtes fauves d'alentour ; non semblable à toi, Cynthie, non semblable à toi dont les yeux brillants se troublèrent pour la mort d'un oiseau ; mais portant les robustes enfants que son sein nourrissait ; et souvent plus repoussante que son mari..... Peut-être même, sous le règne de Jupiter, subsistait-il plusieurs vestiges de l'ancienne Pudicité, ou, du moins, quelques-uns[97]..... Ce qui ressort principalement du caractère que Juvénal prête à ses concitoyennes, c'est l'alliance de la superstition, de la cruauté et de l'impudicité. Ces traits dominants se retrouvent dans les scènes lugubres qui se rattachent à l'introduction des Bacchanales chez les Romains. Avant de pénétrer à Rome, les Bacchanales avaient traversé l'Étrurie, et avaient plu au génie à la fois sombre et voluptueux de cette nation. Ces mystères ne se montrèrent pas publiquement à Rome : ils s'y glissèrent dans l'ombre. D'abord les femmes seules purent participer à ces fêtes étranges qu'elles présidaient tour à tour ; et les initiations, qui n'avaient lieu que pendant trois jours de l'année, se faisaient à la clarté du soleil ; mais une Campanienne, étant devenue prêtresse, fit initier ses deux fils, et décida que désormais cinq jours par mois seraient consacrés aux initiations, et que celles-ci s'abriteraient au sein des ténèbres nocturnes. Tout ce que l'imagination peut se figurer de monstrueux se joignit dès lors à ces rites qui avaient pour théâtre le bois sacré de Simila. L'ivresse entraînait les initiés à d'horribles excès. Ceux qui ne voulaient ni souffrir ni commettre de hideux attentats mouraient d'une étrange manière. Ils étaient égorgés, ou bien on les précipitait dans de mystérieuses cavernes. Les hurlements des initiés, le bruit des tambours et des cymbales, étouffaient les cris des malheureux à qui l'on ravissait l'honneur ou la vie. Comme en Grèce, les femmes se faisaient remarquer par leur délire ; des matrones appartenant à d'illustres familles comptaient parmi les initiés. Vêtues en Bacchantes, les cheveux épars, les femmes couraient vers le Tibre, et y plongeaient des torches ardentes qui, enduites de soufre et de chaux, étaient retirées de l'onde sans avoir perdu leur vive flamme. Si les vices les plus ignobles trouvaient un aliment dans ces fêtes, les crimes les plus affreux s'y préparaient également : faux témoignages, fausses signatures, faux testaments, meurtres et empoisonnements, s'ourdissaient dans ces réunions sataniques. Il y avait là quelque chose de si infâme et de si terrible, qu'une affranchie, une courtisane, Hispala Fécénia, sachant qu'Ébutius, jeune homme qu'elle aimait, allait être initié aux Bacchanales par sa propre mère, ce fut cette affranchie, ce fut cette courtisane qui jeta le cri d'alarme ! Et par ce cri les Romains surent quels abîmes de fange et de sang recélaient Rome et l'Italie. Mais si redoutable était le pouvoir occulte des initiés, — ce pouvoir qui frappait dans l'ombre, — qu'Hispala n'avait osé révéler qu'a Ébutius le mystère des Bacchanales. Par cet aveu, elle risquait sa vie, mais elle sauvait l'homme à qui elle était si dévouée, que, pour avoir le droit de l'instituer son héritier, elle avait demandé un tuteur après la mort de son patron. En voulant faire initier son fils, la mère d'Ébutius désirait plaire à son second époux, le beau-père de ce jeune homme. Comment aurait-elle jugé celui-ci capable de lui désobéir ? Sans doute, il avait moins de vingt ans, puisque, depuis deux années, l'on n'admettait plus d'initiés ayant moins de cet âge. Si jeunes, ils étaient peu armés contre la séduction. Prévenu du danger qu'il courait, Ébutius refusa de se faire initier. Sa mère et son beau-père le chassèrent. Il se réfugia chez la sœur de son père, Ébutia, femme de mœurs antiques. Suivant l'avis de sa tante, il alla trouver le consul Posthumius, et lui fit connaître les révélations d'Hispala. Posthumius apprit, de sa belle-mère Sulpicia, combien était cligne de respect la tante d'Ébutius. A la prière de son gendre, Sulpicia manda chez elle la digne matrone. Le consul assista à l'entrevue des cieux femmes, et vit Ébutia pleurer sur la triste destinée d'un neveu qui avait été chassé par sa mère pour n'avoir pas consenti à un acte ignominieux. Posthumius demanda à sa belle-mère de faire venir chez elle Hispala Fécénia. Ce ne fut pas sans trouble que la courtisane se vit appeler chez une patricienne de mœurs sévères. Combien son émotion devint plus vive devant la demeure de Sulpicia ! Le consul se tenait dans le vestibule, et tout l'appareil de sa puissance l'environnait. A la vue du magistrat suprême et de ses licteurs, Hispala se sentit défaillir. Le consul l'emmena dans l'intérieur de la maison. Devant sa belle-mère, il l'adjura de répondre avec franchise à son interrogatoire, lui garantissant, par sa parole et celle de la vertueuse Sulpicia, que si elle disait la vérité, elle n'en éprouverait aucun dommage. Que se passait-il dans les mystères bachiques célébrés au bois de Simila ? Alors la courtisane est saisie d'un tremblement tel, que ses lèvres ne peuvent proférer une parole. Enfin elle parvient à se faire entendre. Elle avoue qu'étant jeune fille elle a été initiée aux Bacchanales par sa maîtresse ; mais qu'à partir des années qui se sont écoulées depuis son affranchissement elle ignore ce qui a lieu dans ces mystères. Comme Posthumius, tout en la louant d'avoir confessé une partie de la vérité, la presse d'en avouer aussi la seconde, elle persiste à dire qu'elle ne sait rien de plus. Le consul lui déclare que, si le témoignage d'un autre peut la confondre, elle aura perdu tout droit à l'indulgence ; et le magistrat lui apprend que c'est d'Ébutius qu'il tient la vérité. Par ses dénégations, Hispala expose sa liberté, sa vie même ; mais cependant la menace des châtiments publics l'épouvante moins que les mystérieuses vengeances de ses associés d'autrefois. Elle se jette aux pieds de Sulpicia, la supplie de n'attacher aucune importance à l'aveu qu'elle a fait à Ébutius, et qui n'était qu'un simple badinage. Alors le consul laisse éclater son courroux. Il demande à l'affranchie si elle croit encore plaisanter avec Ébutius, et non parler au consul dans la maison de la matrone la plus sévère. Sulpicia vient au secours de la malheureuse femme ; elle calme son gendre, elle rassure l'affranchie. Hispala va parler. Mais, auparavant, elle déplore la conduite d'Ébutius, et croit y lire la perfidie et l'ingratitude. Elle redoute, dit-elle, les dieux qui président aux mystères, mais plus encore les initiés qui y participent ; et, pour échapper au danger qu'elle court, elle prie Sulpicia et le consul de lui assurer, hors de l'Italie, une retraite où ne pourront la chercher ceux qu'elle va trahir. Posthumius lui promet que, dans Rome même, elle n'aura rien à craindre ; et le magistrat reçoit les terribles aveux d'Hispala Fécénia. Après avoir achevé son récit, la courtisane s'agenouille de nouveau, et, de nouveau, sollicite l'exil. Le consul lui donne pour abri la maison même de Sulpicia. On fait monter l'affranchie dans une chambre située à l'étage supérieur ; l'escalier extérieur qui mène de la rue à cette pièce est condamné ; et la retraite d'Hispala ne communique plus qu'avec l'intérieur de la maison. Les esclaves de l'affranchie lui sont amenés, ses effets apportés. Ébutius reçoit l'ordre de se rendre chez un client du consul. Après avoir pris toutes ces précautions, Posthumius convoque le Sénat, et lui fait part de la ténébreuse affaire qu'il vient de découvrir. Les sénateurs tremblent, non pas seulement comme citoyens, mais comme chefs de famille : peut-être leurs maisons recèlent-elles aussi des coupables..... Un sénatus-consulte ordonne une enquête judiciaire et proscrit les rites infimes qui y ont donné lieu[98]. Des mesures de police sont prises pour assurer la tranquillité de Rome. Alors seulement les consuls montent à la tribune pour informer les Romains de ce qui a menacé leur sécurité, et de ce que le Sénat a fait pour conjurer le péril. La terreur se propagea dans Rome et dans l'Italie. Pendant la nuit qui suivit cette révélation publique, les triumvirs qui gardaient les portes de Rome arrêtèrent des fugitifs et les firent rentrer dans la ville ; des coupables furent dénoncés ; des hommes, des femmes, se donnèrent la mort pour échapper à la justice de leur pays. Plus de sept mille personnes, disait-on, avaient été initiées. La procédure fut longue et difficile. Les moins coupables furent emprisonnés ; les grands criminels, décapités. Les femmes condamnées furent remises à leurs familles qui les firent exécuter dans l'intérieur des maisons ; celles qui n'avaient point de parents aptes à ce cruel office reçurent des bourreaux publics le châtiment de leurs crimes. Un sénatus-consulte, confirmé par un plébiscite, récompensa Ébutius et Hispala du service qu'ils avaient rendu à leur patrie. Parmi les priviléges. extraordinaires qui furent spécialement accordés à Hispala Fécénia, celle-ci obtint le droit de se marier hors de la gens à laquelle elle appartenait par son patron[99]. Un homme libre même pouvait l'épouser sans que cette union fût pour lui une flétrissure[100]. L'histoire ne nous dit pas si Ébutius profita de ce droit. Mais le dévouement qu'Hispala lui avait témoigné, les sentiments qui élevaient cette femme au-dessus du misérable état auquel l'avait condamnée l'esclavage, nous permettent de supposer que la libératrice d'Ébutius devint sa compagne. Cette mère qui veut faire perdre à son fils ou l'honneur ou la vie, ces patriciennes qui sont affiliées à une association de bandits, toutes ces femmes n'appartiennent cependant qu'aux premières années de la décadence (185 ans avant Jésus-Christ) ; et déjà nous voyons les matrones livrées à tous les mauvais instincts que, cieux siècles plus tard, Juvénal flétrit en elles. Soixante-douze ans après la répression des Bacchanales, la démoralisation des femmes, pénétrant jusque dans le sanctuaire de Vesta, effraya les Romains qui consultèrent les livres de la Sibylle. L'oracle prescrivit d'élever un temple et une statue à Vénus Verticordia, Vénus qui change les cœurs. Une femme nommée Sulpicia, la plus chaste des matrones, fut appelée à poser pour l'image de la déesse[101]. Mais ce n'était pas à une Vénus, même pudique, qu'il appartenait de changer les cœurs ; et la corruption des femmes ne cessa de croître. Dans ces tristes temps, la Romaine ne fait d'ailleurs que suivre le courant malsain qui précipite ses compatriotes vers l'abîme où s'engloutira leur puissance. Non moins que l'épouse, l'époux est coupable. Cette femme que trop souvent il a prise pour sa dot, il la néglige et la trahit. S'il l'a épousée par inclination, mais que la beauté qui le captivait naguère ait été ravagée par le temps, alors le mari qui comblait sa jeune femme des dons les plus-précieux, ce même mari dédaigne la compagne qui a vieilli avec lui[102]. La matrone est exposée à la suprême humiliation de se voir préférer l'une de ses esclaves, et de souffrir ainsi deux fois, et dans sa dignité d'épouse et dans son autorité de maîtresse de maison. Élève-t-elle la voix pour réclamer sa place : Va dehors, femme ![103] lui répondra peut-être son mari. Qui la défendra alors ? Son père ? Mais si son père est l'allié de son mari ? Si, indulgent pour la faute de son gendre, il n'est sévère que pour le ressentiment de sa fille outragée ?[104] Cependant Dieu a créé la nature humaine si belle et si grande, que les siècles de corruption même nous offrent encore quelques doux spectacles de beauté morale et d'harmonie domestique. Ce fut principalement le néo-stoïcisme, — nous le verrons plus loin, — qui tenta d'arrêter la chute complète des anciennes mœurs. Les types historiques que nous étudierons dans les deux chapitres suivants nous prouveront suffisamment que, dans cette Rome si dépravée, les vertus de famille avaient encore leurs représentants. Même alors, mais bien rarement, il est vrai, la femme travailla la laine et garda dans l'atrium la place de son aïeule ; la femme pardonna à un époux infidèle ; elle soutint le courage de sort mari au sein d'une périlleuse mission patriotique ; elle lui sauva la vie, ou le suivit soit dans l'exil, soit dans la mort[105]. Le théâtre même de Plaute, ce théâtre que souille l'immorale peinture du vice, ce théâtre qui ne nous montre généralement que des courtisanes éhontées, ou des matrones affolées de luxe, s'entendant pour tromper leurs maris sur le prix de leurs achats, dominant leurs époux par la puissance de la dot ; ce théâtre représente aussi certaines figures féminines qui nous font souvenir que Plaute, n'ayant vécu que dans les premiers jours de la décadence, a pu trouver chez ses contemporaines quelques types clignes de l'ancienne Rome. Telles sont les deux héroïnes du Stichus, Panégyris et Pinacie, touchants modèles de ce dévouement conjugal qui ne faiblit ni devant la misère de l'époux, ni devant sa longue absence. Panégyris et Pinacie, les deux sœurs, ont épousé deux frères qui les ont quittées pour chercher au loin une fortune que leur refusait leur pays. D'après la loi romaine, si l'absence du mari se prolonge pendant trois années, la femme délaissée peut se remarier. Le père des deux jeunes épouses, qui les a sous sa puissance depuis le départ de leurs maris, veut leur faire abandonner la maison de ces derniers, et les reprendre sous son propre toit. A l'inquiétude et au chagrin que leur cause le long silence de leurs époux, se joint la crainte de cette autorité paternelle qui peut les contraindre de manquer à leur tendre et volontaire fidélité conjugale. Panégyris, l'aînée des sœurs, ne manifeste pas tout d'abord, cependant, l'intention de sacrifier au souvenir de son mari la volonté de son père. Elle aime son époux ; mais voici la troisième année que les deux frères sont partis, et pas une lettre, pas un message n'a prouvé aux deux sœurs que les absents aient gardé leur souvenir ! Mais Pinacie juge sévèrement l'hésitation de sa sœur : Parce qu'ils ne remplissent pas leur devoir, ma sœur, est-ce qu'il t'en coûte de remplir le tien ?[106] demande-t-elle à Panégyris. Comme celle-ci répond affirmativement, Pinacie la blâme ; elle l'avertit que, quelle que soit la conduite de leurs époux, elles doivent leur l'ester fidèles, et qu'en manquant à cette obligation elles s'attireraient le mépris public. Il y à dans les paroles de la jeune Romaine, un reflet de ce dévouement inébranlable que la femme indienne garde à un époux heureux ou malheureux, vertueux ou coupable. Loin de s'offenser du reproche que lui adresse sa sœur cadette, Panégyris en reconnaît la justice ; elle proteste d'ailleurs qu'elle se souvient avec gratitude de la bonté que son mari lui témoignait naguère ; mais elle sait que sa sœur et elle ne pourront demeurer fidèles à leurs époux qu'autant que leur père le leur permettra. Pinacie avoue que telle est aussi la préoccupation qui rend sa douleur plus profonde. Devant leur père, les deux sœurs déploient une égale fermeté pour se garder à la foi conjugale. Quand le chef de famille traite ses gendres de mendiants, Pinacie répond avec noblesse : Mon mendiant me plaît comme un roi à sa reine. Mon cœur est pour lui dans la pauvreté ce qu'autrefois il fut dans la richesse[107] ; et Panégyris, aussi courageuse maintenant que sa sœur, dit à son père : Je pense que tu m'as mariée, non à l'argent, mais à l'époux[108]. Le vieillard, ému, n'insiste pas ; il cède à une résistance qui d'ailleurs ne s'est montrée à lui que sous la forme d'une tendre et respectueuse piété filiale. C'est la dernière épreuve qu'ont eu à subir les deux sœurs, et, avant que la journée ne s'achève, elles ont retrouvé leurs maris qui sont revenus avec de grands biens. Mais un détail de ce retour nous inquiète pour la généreuse Pinacie : l'époux qu'elle a attendu avec non moins de douleur que de constance ramène avec lui une joueuse de lyre et une joueuse de flûte. Cet incident, aussi bien que les scènes immorales qui terminent le Stichus, nous rappellent que nous sommes loin de la vieille Rome. C'est surtout dans le personnage d'Alcmène que Plaute a fait ressortir ce mélange de fermeté et de tendresse qui caractérisait l'ancienne matrone, et que la société nouvelle avait si rarement l'occasion d'admirer. Sous la forme d'Amphitryon, mari d'Alcmène, Jupiter s'est
introduit chez l'épouse abusée. Alcmène a cru recevoir en lui l'époux que la
guerre retenait loin d'elle, et que la guerre lui a de nouveau enlevé après
une courte entrevue. Quand son mari s'est éloigné : Maintenant,
dit-elle, il me semble que je suis seule ici, parce
qu'il est absent d'ici, celui que j'aime au-dessus de tout. J'ai reçu plus de
chagrin du départ du mon époux que de joie de son arrivée. Mais ce qui me
rend du moins heureuse, c'est qu'il a vaincu les ennemis, et qu'il est revenu
à la maison chargé de gloire : c'est là une consolation. Qu'il parte, pourvu
qu'il revienne à la maison avec la gloire acquise ; je supporterai et
j'endurerai toujours son départ avec un courage ferme et constant, pourvu que
j'obtienne en récompense, que mon époux soit appelé le vainqueur de la guerre
; et je jugerai que c'est assez pour moi ! La valeur est le meilleur des
biens. La valeur surpasse certainement toutes choses. La liberté, le salut,
la vie, les biens, les parents, les enfants, sont protégés et préservés par
elle. La valeur renferme tout en elle ; tous les biens existent en celui qui
a la valeur[109]. C'est bien là le langage d'une vraie matrone ; l'attachement de l'épouse et le patriotisme de la Romaine s'y combinent dans une admirable proportion. A ces deux sentiments se joignent la dignité de la femme et la fierté de la patricienne lorsque notre héroïne, infidèle à son insu, est accusée par son véritable époux : Le crime dont tu m'accuses est indigne d'une femme de ma race, dit-elle. Si tu cherches à me prendre en faute, tu ne pourras me convaincre d'infidélité[110]. Par Jupiter et par la déesse qu'elle redoute le plus, Junon, mère de famille, Alcmène jure qu'elle a gardé la foi conjugale ; mais Amphitryon demeure incrédule. Tu es femme, dit-il, tu jures hardiment. ALCMÈNE A celle qui n'a point failli, il convient d'oser se défendre sans crainte et hardiment. AMPHITRYON Tu es assez hardie. ALCMÈNE Comme il convient à la femme chaste. AMPHITRYON Tu le prouves par des paroles. ALCMÈNE Je ne me regarde pas comme dotée par ce qui est, appelé une dot, mais par la pudicité, et la modestie, et le calme des passions ; par la crainte de Dieu, par l'amour filial et l'accord avec les parents ; par la soumission à ton égard aussi bien que par la générosité pour les bons et la serviabilité envers les honnêtes gens[111]. Elle n'attend pas, la fière matrone, que son mari exécute
une menace de répudiation qu'il lui adresse. Elle prévient cette honte en se
séparant elle-même de celui qui a osé douter de sa vertu. C'est elle qui, à
l'acte suivant, prononce la formule du divorce, sans savoir que celui à qui
elle l'adresse n'a que les traits du mari qui vient de l'outrager. Mais le
faux Amphitryon implore sa grâce ; il reconnaît hautement la vertu d'Alcmène,
et, si en cela je parle contre ma pensée,
dit-il, alors, grand Jupiter, je te demande d'être à
jamais irrité contre Amphitryon ! — Ah ! qu'il
lui soit plutôt favorable ![112] ajoute l'épouse
qui, par ce cri du cœur, a laissé échapper le pardon du coupable. Dans la tragicomédie latine, Alcmène rachète, à force de grandeur morale et de touchante simplicité, ce qu'a d'étrange le rôle qu'elle joue à son insu. Molière n'a pas obtenu le même résultat en reproduisant la figure d'Alcmène. Son héroïne manque de cette candeur et de cette dignité qui rendent si respectable l'héroïne de Plaute. La comédie de Molière parut dans l'année même qui vit commencer le règne de madame de Montespan. Le contemporain de la belle marquise ne nous semble pas avoir bien sérieusement compati à la situation d'Alcmène et à sa douleur. C'est le courtisan de Louis XIV qui a mis sur les lèvres de Jupiter cette maxime dont la coupable légèreté ne se trouvait pas dans l'original latin : Un partage avec Jupiter N'a rien du tout qui déshonore ; Et, sans doute, il ne peut être que glorieux De se voir le rival du souverain des dieux. Il est vrai que ce n'est pas le dernier mot du poète : Le seigneur Jupiter sait dorer la pilule, dit Sosie, qui parait douter quelque peu de la nouvelle gloire.que le roi des dieux attribue à son maître ; mais Sur telles affaires, toujours, Le meilleur est de ne rien dire, ajoute prudemment l'adroit serviteur. Par bonheur, ce que le théâtre n'avait pas le courage de dire, la chaire chrétienne le proclama : rappelons-nous cet illustre orateur tonnant contre l'adultère devant Louis XIV. Si nous étions surpris de voir que c'est à Plaute que nous devons un type aussi pur que celui de l'Alcmène latine, nous pourrions nous souvenir que le Romain, quelque dépravé qu'il fût, s'arrêtait, ému et respectueux, devant la matrone qui restait fidèle uses devoirs. Les poètes, qui ont si légèrement parlé de la femme déchue, n'auraient ose profaner la majesté d'une chaste épouse. Il est vrai que, non pour Plaute, mais pour ses successeurs, contemporains d'Auguste, un autre motif que celui-là s'y joignait, ou meule y suppléait. L'empereur, nous l'avons dit, avait annoncé l'intention de restaurer les anciennes mœurs ; ses courtisans les poètes l'aidaient officiellement dans cette mission[113], et encore tous ne s'acquittèrent-ils pas de cette tâche avec beaucoup de scrupule, témoin Ovide. Si nous ne consultions que les monuments funéraires qui appartiennent à la nouvelle période des mœurs romaines, nous pourrions croire que toutes les matrones dont les restes y furent déposés étaient dignes de leurs aïeules, et que l'amour conjugal régnait à leurs foyers. Mais quand les pontes félicitaient Auguste d'avoir relevé le niveau moral de la famille[114], quand plus tard une Faustine se faisait représenter avec les attributs de la Pudicité[115], pouvons-nous croire toujours à la sincérité des épitaphes qui célébraient les vertus des femmes et les regrets de leurs époux ? Quoi qu'il en soit, beaucoup de ces inscriptions nous attachent par une forme d'une antique simplicité et un sentiment d'émotion contenue. Ici repose Amymone de Marcus, excellente et très-belle, travaillant la laine, pieuse, pudique, sobre, chaste, demeurant à la maison[116]. Travaillant la laine, demeurant à la maison, c'est vraiment la femme d'autrefois. Nous distinguons encore ces traits dans une inscription en vers qui loue aussi, chez une matrone, l'attachement de l'épouse, la beauté et la grâce de la femme, et, de plus, ce charme particulier aux Romaines : le talent de la conversation. Étranger, ce que j'ai à dire est court. Arrête-toi et lis jusqu'au bout. Ceci est le beau sépulcre d'une belle femme. Ses parents l'appelèrent du nom de Claudia. Elle chérit son mari de tout son cœur. Elle mit au monde deux fils. Elle laissa l'un de ceux-ci sur terre ; elle déposa l'autre sous terre. D'une conversation délicate, et, en outre, d'une allure agréable, elle garda sa maison, elle travailla la laine. J'ai dit, tu peux partir[117]. Ailleurs un mari loue la femme pieuse, très-chère, et de bon conseil, la femme dont il n'a jamais eu à se plaindre, et avec laquelle il a bien et honorablement vécu[118] ; ou, employant une expression que Louis XIV a rendue célèbre après la mort de Marie-Thérèse, un Romain déclare que sa compagne, très-chaste et très-pieuse, ne lui a causé d'autre chagrin que celui de sa mort[119]. Un autre veuf dédie un monument à la femme très-chère avec laquelle il a vécu dix-huit ans sans sujet de plainte, et suivant le désir de laquelle il a juré de n'avoir aucune épouse après elle[120]. Une classe de ces inscriptions se rattache aux unions matrimoniales conclues entre les patrons et les affranchis. Il était loin, en effet, le temps où la fierté patricienne s'alarmait même des mariages contractés entre les nobles et les plébéiens. Pour prévenir la dépopulation de Rome, les mêmes lois qu'Auguste établit contre le célibat permirent aux personnes libres, excepté aux sénateurs toutefois, de s'allier aux affranchis qui se trouvaient dans d'honorables conditions. Des patriciennes recoururent à cette faculté afin de pouvoir gouverner à leur aise des époux qui avaient reçu l'empreinte de la servitude. Cependant, s'il faut en croire un texte épigraphique, le mariage de la patronne et de l'affranchi pouvait être heureux. Ici l'affranchi, devenu veuf, parlé de sa femme avec un sentiment de vénération où se lisent à la fois l'amour de l'époux et le respect de l'ancien serviteur : Moi, T. Claudius Hermès, j'ai déposé dans le tombeau de ses pères Claudia... patronne excellente, et de même épouse très-fidèle, avec laquelle j'ai vécu vingt-deux ans, un mois, deux jours, sans aucun sentiment de rivalité, grâce à sa bienveillance dont j'ai recherché le bienfait par ma fidélité et mon estime. Tant que je vivrai, excellente et très-sainte maîtresse, puissé-je demander aux dieux qu'ils accordent aux miens quelque chose de semblable à ce qui m'est arrivé ! Elle vécut quarante-sept ans, un mois, deux jours[121]. Nous avons sous les yeux, au Louvre, un cippe sépulcral qui nous semble avoir contenu les restes d'une affranchie épousée par son patron ; comme les affranchis, elle porte le nom de son ancien maître ; et le nom grec qu'elle y joint, vient à l'appui de notre conjecture : L. Cornélius Émilien, aux dieux mânes de Cornélia Eutychia, épouse très-chère, très-douce, très-rare[122]. Ce cippe est décoré d'un bas-relief dont l'ornementation est remarquable : une brebis broute les fleurs contenues dans un vase. Était-ce une image de la douce femme que la mort avait enlevée tandis qu'elle commençait à goûter les fleurs' d'une vie naguère opprimée et depuis libre et heureuse ? Les inscriptions que nous venons de citer ne sont que des épitaphes, mais il en est qui sont de véritables oraisons funèbres ; et comme telles, sans doute, elles durent être prononcées au Forum, alors que le convoi de la matrone, suivant les images des ancêtres, s'arrêtait sur la place publique[123] où un suprême hommage était accordé aussi bien aux humbles vertus de la femme qu'à la gloire du citoyen et à celle du soldat. Nous aurons plus loin l'occasion de traduire une oraison funèbre qui se rapporte spécialement à une mère de famille. Mais nous allons en analyser ici une autre qui concerne spécialement l'épouse, et qui, malgré de regrettables lacunes, nous offre tout un roman, tout un poème[124]. Un Romain rappelle, en termes émus, les titres qu'avait à sa gratitude la compagne qu'il vient de perdre. Proscrit par les seconds triumvirs, il dut s'éloigner de sa patrie ; mais sa femme veillait sur lui. A l'heure des pressants périls, elle fut la conseillère écoutée dont les avis contribuèrent à sauver son mari. Elle avait voulu obtenir d'une manière plus prompte ce dernier résultat : elle s'était prosternée aux pieds de Lépide pour demander la grâce de l'exilé ; mais le cruel triumvir, loin de la relever, l'avait repoussée avec brutalité. Violemment entraînée loin de cet homme sanguinaire, elle avait porté sur son corps la trace des meurtrissures qui lui avaient été faites, et dont le souvenir accablait encore de douleur et d'indignation l'époux qui, sur sa tombe, se rappelait, avec cette pénible scène, le dévouement de la noble femme. Enfin réunis à leur foyer dans leur patrie pacifiée, les époux auraient pu vivre heureux ; mais il leur manquait un enfant ! L'épouse souffrait à la pensée qu'elle ne donnerait pas à son mari les joies paternelles qu'il rêvait ardemment. Alors cette femme qui s'est exposée naguère à d'indignes outrages pour faire revenir son époux, cette femme va sacrifier à cc même époux jusqu'à la tendresse qui lui a inspiré son intrépide dévouement. C'est elle qui demandera le divorce à son mari ; c'est elle qui appellera à son foyer la présence d'une autre femme ; c'est elle qui cherchera la nouvelle épouse, dont le règne succédera au sien. Mais elle ne reprendra pas sa fortune ; elle en rendra maître celui à qui elle s'immole ; et si son époux ne veut pas se séparer d'elle, elle restera auprès de lui comme une sœur, comme une amie. Voilà ce que cette femme offrit à son mari. Mais, quelque grand que fût en lui le désir de laisser une postérité, l'époux résistait... Eh quoi ! à peine avait-il vu se terminer un exil dont il devait la cessation à sa compagne, et il renverrait celle qui avait été la courageuse épouse du proscrit ! Il admirait la femme qui, ne pouvant être mère, voulait préparer la maternité d'une autre ; mais ce dévouement, devait-il l'accepter ?... Ah ! devant cette tombe, il regrette cruellement de n'avoir pas persisté dans son refus, de ne s'être pas acheminé vers la vieillesse avec la tendre compagne qui lui eût tenu lieu d'un enfant, d'une fille ! Mais enfin les exhortations de sa femme l'ont emporté : il s'est incliné devant une résolution dont il voudrait immortaliser l'héroïque grandeur. Et maintenant l'époux est brisé de douleur devant la tombe où est descendue sa libératrice, sa bienfaitrice. Et nous, nous nous demandons si la généreuse femme n'était pas morte de son dévouement même ; et si son cœur n'avait pas été trop déchiré pour qu'il pût battre longtemps ? Nous voudrions aussi savoir si, avant de fermer les yeux, l'ancienne épouse du proscrit avait vu s'accomplir le nouvel hymen auquel elle l'avait exhorté. Les fragments mutilés que nous avons sous les yeux nous permettent de croire qu'il hésitait encore à remplir jusqu'au bout le vœu de son amie. Pourtant il souhaitait qu'après lui les enfants qu'il aurait laissés vinssent offrir leurs hommages aux dieux mânes de son ancienne compagne ; et qu'en lui donnant ainsi le repos de l'éternité, ils fussent protégés par elle. Nous déplorons que le besoin d'une postérité ait provoqué ici une nouvelle application de ce divorce que la loi divine du Sinaï avait, il est vrai, toléré pour ménager encore la faiblesse humaine, mais que la loi du Christ devait interdire à l'homme perfectionné par l'Évangile. Cette réserve faite, nous ne pouvons qu'admirer cette Romaine qui profita d'une coutume de son époque pour s'immoler avec un élan sublime. En présence de ces épitaphes, de ces oraisons funèbres, comment ne pas nous rappeler ces beaux vers que Properce met sur les lèvres d'une patricienne morte avant l'heure : La dernière récompense qui convienne au triomphe d'une femme est la libre louange qui glorifie son bûcher éteint ![125] Ce n'est pas seulement la pierre des tombeaux qui nous parle de la douleur que la perte d'une épouse apportait quelquefois à l'homme. Stace nous montre Abascantius pleurant encore, après deux années de veuvage, la noble Priscille, la matrone qui réalisait le type de l'ancienne Romaine, la compagne dévouée qui le soutenait au milieu des soucis d'une haute position, et qui restait néanmoins fidèle aux modestes occupations de la ménagère. Il la vit mourir dans ses bras ; et pendant qu'il recueillait le dernier soupir de la femme aimée, celle-ci appuyait sur ses yeux la main de l'époux, comme si elle eût voulu sentir du moins le doux contact de l'ami que ne pouvait plus distinguer son regard voilé par les ombres de la mort. Comme le roi indien dont nous contions ailleurs la poétique histoire, Abascantius voulut se tuer ; mais lui aussi, il fut arrêté par le sentiment du devoir. Il put conduire le deuil de sa femme. Portée sur un lit de parade, Priscille dormait sous la pourpre de Tyr. On l'appelle heureuse ; mais des larmes ont coulé pour l'époux[126]. Abascantius ne voulut pas que ces restes chéris devinssent la proie des flammes ; et ce fut sans avoir passé par le bûcher que le corps de Priscille fut déposé dans un tombeau de marbre. Le veuf ne se lassa pas de faire reproduire par la sculpture, l'image aimée qu'il avait vue disparaître. Abascantius avait eu la force de survivre à son désespoir de veuf. D'autres Romains n'eurent pas ce courage : deux veufs, portant tous deux le nom de Plautius, se donnèrent la mort pour ne point survivre à leurs compagnes. Nous ne savons si le premier vécut dans l'ancienne ou dans la nouvelle période des mœurs romaines ; quoi qu'il en fût, le surnom que portait ce Romain, Numida[127], devait se rattacher aux guerres puniques. Quant au deuxième, Plautius, il vécut certainement pendant l'époque dont nous nous occupons maintenant, puisqu'il reçut du Sénat la mission de reconduire en Asie une flotte alliée. Orestilla, sa femme, l'accompagna dans ce long voyage. Elle tomba malade à Tarente, et y mourut. Le corps d'Orestilla fut déposé sur le bûcher ; le veuf parfuma la couche funèbre, et, après avoir accompli ce pieux devoir, il se perça de son épée. Alors ses amis, voulant tout à fait réunir dans la mort ceux qui avaient été si tendrement liés dans la vie, ne prirent même pas le temps de retirer à Plautius sa toge et sa chaussure. Ils placèrent le corps de l'époux auprès du corps de l'épouse, et mirent le feu au bûcher. Une même flamme brûla les deux cadavres qui se confondirent en une même cendre. Au temps de Valère-Maxime, l'on voyait encore à Tarente le tombeau de ces deux époux, et les Grecs appelaient ce monument le tombeau de ceux qui s'aimaient[128]. L'histoire nous dira que, par un dévouement analogue à celui de ce prince hindou qui céda à sa fiancée la moitié de sa propre vie[129], le père des Gracques mourut pour que la chère existence de sa femme fût épargnée[130]. C'était une généreuse revanche du sacrifice que l'Alceste grecque avait consommé en faveur de son époux. De nobles veuves apparaissent encore à cette époque,
dignes de porter dans leurs mains ou dans leurs vêtements les cendres d'un
héroïque époux, et de les déposer dans le sépulcre ; dignes aussi de cette
simple et touchante épitaphe que nous lisons sur la tombe de l'une d'elles : A Julia Rénata, la plus sainte de toutes les femmes. Après
avoir accompli les années de la vieillesse, elle suivit son mari Julius
Sarnianus. Elle vécut soixante-dix ans[131]. Le veuvage, même celui de l'épouse, ne fut pas encouragé par les lois matrimoniales d'Auguste. Désormais la veuve âgée de moins de cinquante ans ne put recevoir un legs ou un héritage provenant d'un ami ou d'un parent éloigné, que si elle se remariait, au bout d'un an, disait la loi Julia, au bout de cieux ans, disait la loi Papia. Les époux qui étaient appelés à recueillir un héritage ou un legs de cette nature, mais qui n'avaient pas d'enfants ou qui n'en avaient plus, ne pouvaient toucher que la moitié de ce legs ou de cet héritage. Depuis l'âge de vingt-cinq ans jusqu'à celui de cinquante, l'épouse était soumise à cette pénalité. Les mêmes lois qui châtiaient le célibat, le veuvage et la privation d'enfants, récompensaient la paternité et la maternité. Les héritiers et les légataires qui avaient des enfants recevaient les caduca, c'est-à-dire les parts ou les demi-parts que ne pouvaient toucher ceux de leurs cohéritiers ou de leurs co-légataires qui ne remplissaient pas les conditions prescrites par les lois[132]. Ces mêmes lois accordaient aussi à la mère de trois enfants le privilège de ne plus subir la tutelle. La mère disposait alors librement de ses biens, et testait sans avoir besoin d'y être autorisée. En règle générale, le mari et la femme ne pouvaient se léguer que le dixième de leurs biens ; mais le père et la mère de trois enfants avaient une plus grande latitude. La faveur impériale accorda parfois tous ces privilèges à des particuliers qui n'y avaient aucun titre[133]. Sous le règne d'Adrien, le droit de maternité reçut un complément. En étudiant les anciennes coutumes romaines, nous avons vu que si la matrone ne s'était pas mariée sous le régime de la manus, ses enfants et elle n'avaient aucun droit à la succession ab intestat l'un de l'autre. L'usage modifia cette loi, et l'édit du préteur appela la mère à recueillir la succession de son fils lorsque, les agnats faisant défaut, les cognats prenaient la place de ceux-ci. Mais, sous Adrien, alors que l'influence chrétienne pénétrait jusque dans la jurisprudence païenne, le sénatus-consulte Tertullien, accordant à toutes les mères qui avaient trois enfants un privilège que l'empereur Claude avait donné à une seule de ces femmes, les autorisa à recueillir la succession ab intestat d'un fils ou d'une fille qui n'aurait laissé ni enfants, ni père, ni frère consanguin. Si le défunt n'avait que des filles, sa mère concourait à l'hérédité avec celles-ci. Adrien permit aussi à toutes les femmes de tester sans avoir rempli la formalité de la coemption. Au temps de Marc-Aurèle, le sénatus-consulte Orphitien ajouta encore à ces mesures de progrès : les enfants purent recueillir la succession ab intestat de leur mère[134]. Est-ce à une législation antérieure ou postérieure aux lois Julia et Papia Poppæa, qu'il faut rapporter une oraison funèbre que nous allons traduire et qui contient de curieux détails sur les droits civils de la matrone ? Cette longue inscription nous semble d'autant plus précieuse à recueillir que nous y trouverons aussi, avec le pieux hommage qu'un fils rend à la mémoire de sa mère, une preuve nouvelle que les mœurs d'autrefois avaient encore quelques rares adeptes au sein de la corruption romaine. ... Ayant donné un legs à sa
fille, elle institua héritiers tous ses fils également. Son amour maternel
répondit à la tendresse de ses enfants par l'égalité de ce partage. Elle
légua à son époux[135] une somme déterminée, pour que le droit de la dot fût augmenté
par l'honneur du testament. Pour me rappeler la mémoire de mon père et y ajouter
le souvenir de sa prudence et de sa fidélité (maternelles), elle me prélégua,
après estimation faite, des propriétés déterminées, non qu'elle eût
l'intention de me montrer une préférence injurieuse pour mes frères ; mais,
en souvenir de la libéralité de mon père, elle décida qu'elle me rendrait
ceux de mes biens patrimoniaux qu'elle avait reçus par le testament de mon
père, pour que les biens que, suivant l'ordre de celui-ci, elle conservait
sur cette propriété, me fussent restitués. Elle fut d'accord avec elle-même
afin que, par la déférence et la probité dont elle usa à l'égard des époux
auxquels ses honorables parents l'avaient mariée, elle devint une épouse plus
agréable ; qu'elle leur fût plus chère par sa fidélité ; que, par le
testament qu'elle laissait, elle fût plus honorée ; et qu'après sa mort elle
fût louée du consentement des citoyens. Comme, dans la répartition de ses
devoirs, elle eut l'âme reconnaissante et fidèle, et qu'en vérité elle fut
équitable envers ses époux, juste envers ses enfants, pour ces motifs...
et bien qu'il convienne que l'éloge de toutes les
qualités des femmes soit simple et identique, parce que les qualités
naturelles propres à faire observer la vigilance ne demandent pas une grande
variété de mots et qu'il suffit que ma mère ait tout fait pour être cligne
d'une bonne réputation cependant comme les choses ordinaires dont la vie a
été agitée doivent titre recueillies par un parent dans leurs, moindres
vicissitudes, de peur qu'oubliant de justes préceptes, il ne déshonore les
survivants ; à cause de cela, ma très-chère mère a mérité le plus grand éloge
de tous, parce qu'elle fut égale et semblable aux autres femmes par la
modestie, la probité, la pudicité, la complaisance, le travail de la laine,
la diligence, la fidélité, et qu'elle ne le céda à nulle autre par l'honneur
de la vertu, du travail, de la sagesse[136]... Par cet exemple, et par d'autres encore que nous offrira l'histoire, il est aisé de voir qu'aux jours de la décadence même il y eut des mères qui, loin d'empoisonner, comme leurs contemporaines, le corps ou l'âme de leurs enfants, veillèrent sur eux avec sollicitude, enseignèrent a leurs fils l'honneur, à leurs filles le respect du foyer. Alors aussi, il y eut des mères si tendres que celui de leurs enfants qu'elles aimaient le mieux était celui qui était le plus en danger[137], et qu'en perdant un de leurs fils elles pouvaient s'écrier : Tu étais unique pour moi ![138] N'oublions pas enfin que ce fut à cette époque que Virgile put dire encore : Petit enfant, commence à connaître ta mère à son sourire[139]. Nous avons signalé les effroyables ravages de la corruption, et nous avons pieusement recueilli les traces si rares que les mœurs antiques avaient laissées. En étudiant les figures des matrones célèbres, nous obtiendrons les mêmes résultats. Le mal, hélas ! nous apparaitra plus souvent que le bien ; et l'influence néfaste, généralement exercée alors par la Romaine, nous semblera d'autant plus dangereuse que jamais l'intervention de la femme n'aura été plus active dans les affaires publiques. À cette époque, l'influence de la femme est considérable dans les élections politiques et municipales. Dès les derniers temps de la république, une matrone se sent même le pouvoir de faire modifier un sénatus-consulte[140]. Ce ne sont pas seulement des hommes d'État que les femmes protègent : des cités municipales entrent dans leur clientèle. L'une de ces villes consacre à la mémoire de sa patronne un monument d'airain élevé à frais communs par les citoyens des cieux sexes[141]. La prêtresse voit aussi un municipe solliciter l'honneur d'être admis dans la clientèle de sa maison[142]. La cité où elle exerce son sacerdoce, et dont elle embellit ou restaure les édifices, lui témoigne sa reconnaissance en lui consacrant un monument, en lui élevant une statue[143]. De leur côté, les prêtresses s'associent pour décerner l'une de ces deux dernières récompenses à un magistrat dont elles honorent le mérite[144]. Les femmes des magistrats chargés d'administrer les provinces peuvent exercer une puissance souveraine. Des statues leur sont même érigées. Suivant un décret des décurions, le commandant de la flotte de Pannonie dédie l'une de ces statues à la femme d'un personnage consulaire qui a gouverné ce pays[145]. Des corps de troupes, en garnison à Lambæse, la moderne Lambessa[146], élèvent aussi de tels monuments aux compagnes de deux légats qui représentent le pouvoir impérial dans cette région. Ce dernier fait nous semblerait extraordinaire, si nous ne savions que les femmes des gouverneurs exerçaient volontiers l'autorité militaire. L'histoire nous montrera une Plancine qui, indigne imitatrice de la noble épouse de Germanicus, commandait les manœuvres militaires et haranguait les soldats. Quelque temps après, un sénateur mettait ce dernier scandale au nombre des causes qui, selon lui, devaient faire interdire aux magistrats des provinces la faculté d'emmener leurs compagnes dans leurs résidences officielles. Ce sénateur dénonça les exactions et les autres mesures tyranniques dont ces femmes savaient être capables. Il les montra tenant une cour, ayant un tribunal, commandant les armées. Néanmoins la mesure que proposait ce sénateur fut repoussée par ses collègues[147]. Les femmes se réunirent en associations. L'insensé Héliogabale fonda même un sénat féminin, le petit sénat, assemblée qui ne s'occupa heureusement que de questions de toilette et d'étiquette ; et que l'empereur Aurélien voulut rétablir en n'y admettant que des femmes dignes d'exercer le sacerdoce. Il est à remarquer que ces deux princes étaient d'origine étrangère et qu'ils furent mis au monde par des prêtresses du Soleil. L'un était né dans cette Syrie que les Arabes avaient peuplée ; l'autre avait vu le jour dans un pays celtique, la Pannonie. Avant de passer sous le joug romain, la Syrie et la Pannonie avaient été soumises à la domination des Macédoniens, qui, non moins que les Arabes et les Celtes, accordaient à la femme un rang élevé. Habitués au règne de la femme, nés de mères qui exerçaient les fonctions publiques de prêtresses, Héliogabale et Aurélien furent amenés à favoriser la plus ridicule des causes : l'émancipation féminine. Héliogabale surtout, qui devait le souverain pouvoir aux agissements publics de sa mère et de son aïeule, ne pouvait trouver étrange que la femme jouât un rôle officiel[148]. Rome ne fut pas la seule ville qui eut un sénat féminin. Une inscription nous révèle à Lanuvium l'existence d'une Curie des femmes[149]. Nous sommes loin des temps où l'influence politique de la matrone ne s'exerçait qu'au foyer. Sous l'empire romain, la femme ne se borne plus à avoir une part occulte dans le maniement des affaires publiques ; elle gouverne par elle-male. Et, en remontant jusqu'au rang le plus élevé, nous verrons que l'empire de la femme sera l'empire mène de Rome : l'empire du monde. Les peuples de la terre ne se contenteront pas de saluer dans la matrone l'impératrice, la mère des camps, la mère du Sénat et de la patrie[150] ; ils adoreront en elle la déesse et lui élèveront des autels. |