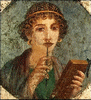LA FEMME ROMAINE
SECONDE PARTIE. — LA FEMME PENDANT LES DERNIERS TEMPS DE LA RÉPUBLIQUE ET SOUS L'EMPIRE
CHAPITRE DEUXIÈME. — LA JEUNE FILLE.
|
Loi Voconia portée contre les héritières. — Décadence de la tutelle. — Transformation des sentiments domestiques dans certaines familles. Adoucissement de la puissance paternelle. Tendre intérêt inspiré par la vierge. La fille de Cicéron. Cicéron et la fille de son ami. Sentiments délicats révélés par des inscriptions et par de petits poèmes. Dévouement filial de quelques Romaines. — Instruction donnée à la vierge. La fille de Fundanus. La poésie familière aux jeunes filles. Horace chantant pour les vierges et conduisant leurs chœurs. Les interprètes du Chant séculaire au temple d'Apollon Palatin. Jeunes filles chantant à Diane un hymne de Catulle. La mission du poète et les prières des vierges. La fille de Rome et la fille d'Israël. — Les jeunes Romaines de la décadence ; leur incrédulité, leur goût pour les chants de l'amour païen. Corruption que la jeune fille et le poète exercent mutuellement l'un sur l'autre. Funestes enseignements que les Romaines reçoivent au cirque, au théâtre, dans les temples, etc. Vices des jeunes filles. Nous avons dit quelles influences altérèrent les mœurs antiques, et développèrent en particulier chez la femme l'amour du luxe. Nous avons vu que, par une loi somptuaire, l'on avait tenté d'opposer un frein aux goûts dispendieux des Romaines. Mais cette loi fut abrogée. Nous n'avons pas à nous arrêter aux moyens qu'employèrent les matrones pour arriver à ce résultat ; nous en reparlerons plus loin. On crut pouvoir combattre le luxe des femmes en restreignant leur fortune. La loi Voconia (169 ans av. J.-C.) établit que tout Romain qui, avant son décès, aurait été inscrit sur les registres du cens pour une somme de cent mille as d'airain au moins, ne pourrait instituer une femme sou héritière, cette femme fût-elle sa fille unique. Il avait cependant la faculté de faire un legs à une femme, mais ce legs ne devait point être supérieur à la part qu'il laissait à son héritier[1]. Par un contraste qui, au premier abord, semble bizarre, la femme succédait à son père et à ses agnats si ceux-ci étaient morts sans avoir fait de testament[2]. Mais, dans ce dernier cas, elle n'héritait que si elle était restée dans les lieus de l'agnation ; et, suivant la conjecture d'un jurisconsulte[3], c'était peut-être pour ce motif que le législateur lui abandonnait une fortune dont elle ne devait jouir que sous la tutelle intéressée de ses agnats. Ceux-ci, au contraire, eussent été exposés à voir sacrifier leurs droits si le parent qu'ils avaient perdu avait fait un testament, parce qu'il aurait pu instituer soit une fille ou une parente qui fût déjà sortie de sa famille ; soit encore une fille placée sous sa puissance, mais à laquelle il eût donné un tuteur testamentaire. Or nous savons que ce genre de tutelle n'était guère que fictif, et c'est précisément celui-ci qui prit alors le plus d'extension. L'empereur Claude supprima même la tutelle des agnats ; il laissa toutefois subsister celle des ascendants ; mais ce dernier pouvoir était destiné à disparaître sinon des lois, au moins des mœurs[4]. Les législateurs axai eut cru que la loi Voconia ne réprimerait pas seulement le luxe des femmes, mais qu'elle contrebalancerait encore l'affaiblissement de la tutelle. Cette loi fut éludée. Le père qui voulait laisser ses biens à sa fille les léguait à un ami qui devait les remettre à l'orpheline ; le droit romain sanctionna même ce fidéicommis[5]. A une époque qui précéda la législation impériale, l'insuffisance de la loi Voconia fit donner à celle-ci, par les jurisconsultes, une interprétation qui excluait même des successions ab intestat, non pas les filles, il est vrai, mais les agnates autres que les sœurs. La coutume adoucit aussi cette jurisprudence, et l'édit du préteur appela les femmes à une succession lorsque, l'ordre des agnats étant épuisé, elles se trouvaient les plus proches parentes du mort[6]. La loi Voconia tomba elle-même en désuétude. Cicéron et saint Augustin s'accordent pour protester contre l'injustice de cette loi[7]. Celle-ci, en effet, pour prévenir les désordres des femmes frivoles, lésait également les intérêts des femmes sages ; et ces dernières existaient encore, existeront toujours ! Quelque générale que fût la corruption romaine, il était des foyers, rares certainement, niais qui gardaient quelques-unes des traditions d'honneur et de vertu léguées par les ancêtres, ces traditions où nous aimions à retrouver l'empreinte du sceau divin. Dans les familles qui avaient conservé, sinon en totalité, du moins en partie, ce précieux héritage, l'on ne rejetait pas toujours, avec les abus de la civilisation, les progrès légitimes que celle-ci avait enfantés. Ainsi les mœurs acquéraient, sous l'influence grecque, une douceur qui n'était pas familière aux vieilles habitudes romaines ; et si, trop souvent, l'antique esprit de famille vint à disparaitre, parfois aussi les relations domestiques durent au nouvel état social plus de grâce et de délicatesse. Ainsi les droits les plus rigoureux du père de famille sont atténués par la coutume comme, à partir du règne de Trajan, ils le seront par une législation qui, il est vrai, subira déjà le contrecoup de l'influence chrétienne. Au temps de Gaïus, la vente des enfants n'est le plus souvent qu'une solennité fictive qui a pour but leur émancipation. La liberté de la jeune Romaine est même l'objet d'une sollicitude si délicate que la fille de famille eût-elle causé un dommage quelconque à un étranger, elle n'est plus exposée, comme autrefois, à passer sous la servitude de l'homme auquel elle a nui[8]. Aussi bien que la voix de pierre qui s'élève des tombeaux, les vivantes expressions du langage ou poétique, ou familier, ou même oratoire, nous apportent les échos du concert d'amour qui berçait la jeune fille. C'est avec un doux attendrissement que Catulle nous montre la vierge que son chaste petit lit aux suaves parfums laissait croître sous le tendre embrassement de sa mère. Tels les myrtes qu'engendre l'Eurotas ou les fleurs variées que produit le souffle du printemps[9]. Le même poète veut-il peindre l'attachement d'un moineau pour Lesbie, il nous dit que l'oiseau la connaissait aussi bien que la jeune fille connaît sa mère[10]. Et quant aux relations du père et de la fille, nul Romain mieux que Cicéron ne nous en révèle le touchant caractère. Entendez-le s'élever contre Verrès qui, par une injuste application de la loi Voconia, a frustré une orpheline de l'héritage paternel : Et je ne cloute point que, de même qu'a moi, à qui ma fille me tient le plus au cœur, cette chose ne paraisse cruelle et indigne à chacun de vous qui êtes émus du même sentiment et de la même tendresse pour vos filles. Car, qu'est-ce que la nature nous a donné de plus agréable ? quoi de plus cher ? quel objet plus digne d'épuiser toute notre sollicitude et toute notre tendresse ?[11] Mais c'est surtout dans sa correspondance que le grand
orateur donne un libre cours à l'effusion de ses sentiments paternels. La petite Tullie, mes délices ; ma petite fille chérie ; Tullie,
notre lumière. C'est ainsi qu'il nomme cette fille qui lui est plus douce que la vie[12], cette fille
qui, présente, est sa joie, son repos ; absente, son regret, mais toujours
son fidèle conseil ; malheureuse, son plus poignant souci ; morte enfin, son
éternelle douleur ! Pendant vingt-trois ans, les lettres de Cicéron nous font suivre les vicissitudes de son amour paternel. Quand s'ouvre cette correspondance, Tullie a neuf ans. A cette époque, Atticus, le meilleur ami de son père, est à Athènes ; il lui a promis l'un de ces menus dons si chers aux jeunes filles ; mais il ne paraît pas se souvenir de son engagement. Avec quelle gracieuse mutinerie Tullie le lui fait rappeler par son père ! Cicéron a trente-neuf ans alors. Comme homme politique et comme orateur, il a déjà conquis l'illustration. Deux années auparavant, il a fait triompher sur Verrès la cause de la Sicile. Et néanmoins c'est avec une aimable gaieté qu'il prend en main une cause assurément moins grave que celle d'une province opprimée : La petite Tullie, nos petites délices, réclame ton petit présent, et m'attaque en garantie. Mais il est fort certain que je me parjurerai plutôt que de payer[13]. Cependant Atticus demeure sourd aux réclamations de la plaignante ; et, l'année d'après, Cicéron poursuit le cours de sa procédure judiciaire : La petite Tullie t'assigne le jour ; elle actionne le répondant[14]. Sept années plus tard, Tullie a dix-sept ans. Elle a vu son père consul de Rome et sauveur de la ville éternelle. Mais déjà a commencé pour l'illustre Romain le temps des déceptions. Alors Tullie contribue à donner à son père attristé les seuls moments de repos dont il jouisse au milieu de l'accablement des affaires et de la douloureuse indignation que lui cause l'acquittement de Clodius[15]. Un an après, toujours agité par les soucis de la lutte qu'il soutient contre Clodius, Cicéron pense néanmoins à distraire sa fille et se dispose à quitter Formies, aux calendes de mai, pour conduire aux jeux d'Antium Tullie qui désire les voir[16]. Mais, l'année suivante, à pareille date, il n'est plus auprès des siens. Clodius a triomphé, Cicéron est exilé, et, dès la fin de mars, il a el abandonner son foyer et sa patrie. C'est alors que l'image de sa fille absente vient encore ajouter à un accablement d'autant plus profond chez lui, que Cicéron ne joint que trop souvent la faiblesse du caractère à la grandeur d'âme et à la puissance oratoire. Quand il reçoit des lettres de sa femme, de sa fille, de son fils ; quand il répond à ces êtres chéris, les larmes inondent son visage[17]. Après quinze mois d'exil, écrivant de Thessalonique à son frère, et lui exprimant la douleur qu'il éprouve d'être séparé de lui, il ajoute : De plus, ne regretté-je pas en même temps ma fille ? Que de piété, que de modestie, que d'esprit ! Effigie de mes traits, de mon langage, de mon âme ![18] L'âme de Cicéron, mais avec une force plus virile, vivait en effet dans Tullie, et l'on comprend quel vide devait laisser, auprès de l'exilé, l'absence de ce noble cœur et de cette intelligence si haute et si cultivée. Ce qui augmentait encore son chagrin, c'était l'inquiétude du sort réservé à Tullie. Qu'adviendrait-il maintenant de la fille du proscrit[19] ? Dans la lettre dont nous venons de citer un fragment, Cicéron recommande à son frère, Tullie, ma fille et la tienne[20] dit-il. Il la recommande également, ainsi que son fils, à son cher Atticus, et cette prière termine une lettre dans laquelle il a dit à ce fidèle ami que, malgré son découragement, il secondera les efforts de ceux qui désirent son retour. Je ne manquerai pas, dit-il, à l'instante prière de ma petite Tullie, la plus malheureuse des femmes[21]. En appelant ainsi Tullie, Cicéron sentait qu'il était regretté d'elle autant qu'il la regrettait lui-même. Et le banni comparait aux afflictions dont il l'accablait maintenant, les jouissances qu'il lui prodiguait autrefois[22]. Lorsque, après un exil de deux ans et demi environ, le célèbre orateur retourna en Italie, la première personne de sa famille qu'il revit en débarquant à Brindes fut sa fille qui était venue au-devant de lui. Par une touchante coïncidence, ce jour était l'anniversaire de la naissance de Tullie[23]. En retrouvant son père, la jeune Romaine dut se dire que cette date symbolisait pour elle une nouvelle naissance. Réuni à cette fille bien-aimée dont la tendresse le consolait des déceptions que lui fit éprouver sa femme Térentia, il chercha, comme naguère, à. rendre heureuse sa Tullie. Obligeait-il une amie de sa fille, il se réjouissait de faire valoir ce service aux yeux de celle-ci[24]. Tullie, malade, craignait-elle que son père n'engageât une nouvelle lutte contre Clodius, nous voyons l'orateur manquer une occasion de parler dans une affaire criminelle[25]. Néanmoins, au temps de ces troubles civils pendant lesquels Cicéron hésitait à suivre ou César vainqueur, ou Pompée vaincu, sa fille lui conseilla de demeurer fidèle à ce dernier et d'embrasser ainsi le parti le plus périlleux, mais aussi le seul honorable[26]. A cette époque, Tullie, mariée à Dolabella, et malheureuse dans cette union, oubliait ses propres chagrins pour consoler son père et le fortifier. Bien que, suivant la touchante parole de Cicéron, la tendresse réciproque du père et de la fille fût réellement la fusion de leurs âmes. Tullie préférait de voir le grand orateur s'exposer à de graves dangers plutôt que de dévier de la droite voie et de compromettre sa réputation. Ces sentiments étaient dignes et d'une Romaine, et de la fille d'un généreux citoyen. En les retraçant à Atticus avec admiration, le père de Tullie se sent si ému qu'il s'interrompt soudain, craignant de céder à son attendrissement[27]. Désormais, cependant, Cicéron n'éprouvera plus que les tristesses de l'amour paternel. Après avoir compromis son patrimoine, il s'accuse de la pénible situation à laquelle ses embarras de fortune ont exposé Tullie. La joie même que devraient lui causer la vertu et l'affection d'une telle fille, est étouffée on lui par la pensée qu'il a mis dans une cruelle situation une femme qui n'a point mérité de souffrir. Pendant son séjour à Brindes, il confie à Atticus les intérêts de sa fille, et veut même que ses dernières ressources soient employées à assurer l'avenir de Tullie. Sur le point de quitter l'Italie, il regarde comme les plus grandes de toutes ses infortunes le malheureux abandon où il laisse sa fille et le déplorable état de santé où elle se trouve[28]. La maladie de ma Tullie et sa faiblesse physique me font mourir[29], écrit-il un jour à Atticus. Deux ans après que Cicéron a laissé échapper ce cri de détresse, sa vie s'est tout à fait brisée : il a perdu sa fille. Si grand est le désespoir du père quo le citoyen même semble mort en lui. Atticus le recueille dans sa demeure ; mais la retraite que lui a offerte l'amitié n'est pas encore assez profonde pour lui. Il lui faut la solitude complète. Cicéron se retire dans sa villa d'Asture. Dès le matin, il s'enfonce dans les sombres profondeurs des bois, et ne rentre chez lui que le soir. Les voix mystérieuses que la nature fait résonner au milieu du silence des forêts sont les seilles que Cicéron puisse entendre sans en être blessé. Ses amis tentent vainement de le rappeler à Rome, et l'avertissent que sa réputation souffrira de l'abattement auquel il se livre. Brutus et Servius Sulpicius lui écrivent des lettres de condoléance dont le résultat négatif nous montre, une fois de plus, combien étaient illusoires les consolations offertes par la philosophie antique. Nous ne possédons pas l'épître de Brutus ; mais nous savons que celle-ci arracha à Cicéron de nouvelles larmes sans les rendre plus douces. Lettre sagement écrite, disait Cicéron, mais rien qui me secoure[30]. La lettre de Sulpicius nous est demeurée. Elle est belle, et le début en est touchant. Avec une délicatesse de sentiment qui n'est pas commune chez les Romains de cette forte trempe, le grave proconsul avoue que ce n'est pas sans répandre bien des larmes, ni sans avoir besoin d'être raffermi soi-même, que l'on essaie de consoler ses amis en deuil. Mais il reproche à Cicéron l'excès de sa douleur. Après avoir vu tant de maux fondre sur sa patrie, comment Cicéron peut-il ressentir si profondément un malheur de plus ? Comment peut-il regretter que sa fille soit morte à une époque où vivre est si cruel ? D'ailleurs, puisque les villes elles-mêmes s'écroulent et meurent, comment s'étonner qu'une frêle créature ait aussi disparu de ce monde ? Tels sont les principaux arguments que développe Sulpicius. Ainsi, pour alléger le chagrin de ce père, il ne peut que montrer à ce dernier, avec la fragilité des choses humaines, l'image des calamités auxquelles Tullie a été enfin soustraite par la mort. Faible consolation que celle qui s'appuie, non sur les espérances célestes, mais sur les tristesses de la terre ! Certes, nous aussi, chrétiens, nous connaissons le néant de ce qui passe ; mais nous nous en consolons par la pensée de ce qui est éternel ; et cette pensée-là n'apparait point dans la lettre de Sulpicius. Aussi ne nous semble-t-il pas étonnant que Cicéron réponde au proconsul que c'étaient précisément les malheurs publics qui lui faisaient trouver plus de douceur encore dans la présence de sa fille. Je savais en quoi me réfugier, où me reposer ; dans l'entretien et dans le charme de qui déposer tous mes soucis et toutes mes douleurs[31]. Et Cicéron ajoute que maintenant il quitte à la fois et sa maison et la place publique qui ne peuvent pas le consoler l'une de l'autre. Le seul adoucissement qu'il trouve à sa douleur, ce sont les lettres ; niais ici encore, c'est la pensée de sa fille qui surtout l'inspire. Le premier ouvrage qu'il écrit dans sa retraite, et qui a pour titre Consolation, est malheureusement perdu aujourd'hui. Outre le monument littéraire qu'il consacrait à la mémoire de sa fille, Cicéron veillait à lui faire préparer un monument de pierre. Mais les lois imposent des limites à la richesse des édifices funèbres. Ne pouvant offrir à la mortelle un tombeau digne de ses mérites, le père élèvera un temple à la déesse, et sa fille recevra les honneurs de l'apothéose. Fidèle à cet esprit romain qui, au lieu de reléguer les morts loin de la ville, les faisait dormir tout près de la vivante cité, Cicéron souhaite que le temple qu'il dédiera à Tullie soit placé dans des jardins fréquentés, pourvu toutefois que ceux-ci ne soient pas exposés à passer entre les mains d'un propriétaire qui ne respecterait pas le pieux monument. Cicéron est prêt à tous les sacrifices pour s'acquitter de ce qu'il regarde comme une dette sacrée. Ce projet, qui tient une place considérable dans sa correspondance depuis le mois de mars jusqu'au mois d'août de l'an 44 avant J.-C., ne semble pas cependant avoir été exécuté. A Astuce, à Antium, à Tusculum, partout Cicéron recherchait la solitude de la campagne. Pendant longtemps toutefois, il ne put se résoudre à revoir sa villa de Tusculum, la plus chère de ses résidences, mais aussi celle qui lui rappelait le plus vivement le souvenir de Tullie. Étageant ses deux terrasses sur le flanc de la montagne qui domine la cascade de Frascati, cette délicieuse villa avec ses jardins, ses statues, ses peintures[32], avait vu Cicéron trop heureux pour qu'elle pût l'abriter impunément après que le malheur l'eut foudroyé. Mais c'était Rome surtout qu'il redoutait de revoir. Dans les premiers temps de son deuil, Cicéron apprend-il qu'un autre père a perdu sa fille, il écrit : Pourquoi Ligus serait-il un si heureux père ? Et que dirai je de moi, qui ne pourrais jamais être soulagé s'il m'arrivait toutes les choses que je pusse désirer ?[33] Il y a là une explosion de cette douleur égoïste qui parfois fait trouver naturel à l'homme que d'autres souffrent ce qu'il a souffert lui-même. Mais ne croyons pas que ce fût, chez Cicéron, un état d'âme habituel. Loin de là. Dès les premiers jours qui suivirent la mort de Tullie, il s'inquiétait, avec une affectueuse sollicitude, d'une longue fièvre qui tourmentait la jeune Attica, fille d'Atticus. C'était une aimable enfant. Naguère Cicéron s'était réjoui de ce que son plus cher ami connût par cette petite créature le sentiment, si naturel et si doux, de l'amour paternel[34]. Cette enfant, que Cicéron avait aimée même avant de l'avoir vue[35], demeura toujours l'objet de sa tendre prédilection. Tout l'intéressait dans sa petite amie. Une année avant la mort de sa fille, il écrivait : Et puissé-je sur-le-champ courir à l'embrassement de ma Tullie et au baiser d'Attica ! Écris-moi, je te prie, ce qui concerne celle-ci, afin que tant que je resterai à Tusculum, je sache ce 'qu'elle gazouille, ou, si elle est à la campagne, ce qu'elle t'écrit. A elle cependant écris ou dis mon salut[36]. Pour exprimer avec plus d'énergie la part qu'il prend aux souffrances d'Attica, Cicéron emploie le verbe hellénique συμπάσχω. Je souffre avec elle, dit-il, de ces petits mouvements de fièvre[37]. Le verbe latin compatior, plus tard vulgarisé par la charité évangélique, traduisit cette expression grecque. A ces deux mots correspondent en français ceux de sympathiser et de compatir ; mais l'usage en est devenu si banal, la signification en est si souvent absente, que nous ne saurions y trouver l'équivalent du terme hellénique choisi par Cicéron. Nous ne pouvons comparer à cette délicate expression que la célèbre parole de Mme de Sévigné écrivant à sa fille : J'ai mal à votre poitrine. Ce fut pendant la maladie d'Attica que Cicéron, perdit sa fille ; et, comme nous le disions plus haut, sa douleur, cette douleur qui le rendait indifférent à la gloire même, ne le laissait pas insensible à la pénible épreuve que subissait l'enfant d'Atticus. Dans la solitude d'Asture, il s'inquiétait de voir se prolonger la fièvre qui agitait la jeune fille ; et plus tard cette crainte alla jusqu'à l'angoisse. Nous nous intéressons avec lui à cette douce enfant qui, supportant la douleur avec résignation, conservait même sa gaieté au milieu de ses longues souffrances et priait son père de n'être pas triste[38]. Cicéron approuve Atticus de chercher à distraire la jeune fille par la vue des pompes religieuses : Il y a toujours pour l'esprit quelque soulagement dans un spectacle, surtout si celui-ci se rapporte aux croyances et à l'honneur de la religion[39]. Attica se rétablit. Sa mère put la quitter pour aller passer quelque temps dans l'une des villas de Cicéron ; et la jeune fille remercia son vieil ami des soins qu'il rendait à celle qui lui avait donné le jour[40]. Au milieu des troubles politiques qui suivirent la mort de César, et à la veille de partir pour sa légation de Grèce, Cicéron trouva encore un sourire pour son Attica qui lui faisait une petite guerre. Sans doute, il avait à se reprocher à son égard quelque négligence, bien pardonnable en un pareil moment. Avec quel enjouement il feint de redouter la mutine enfant ! Avec quelle bonne grâce il se reconnaît coupable ! Aussi l'aimable jeune fille offre-t-elle à son tour ses excuses à Cicéron qui les accepte avec tendresse. Avant de s'embarquer, il écrit à son ami : Je désire embrasser bien affectueusement notre Attica absente ; le salut que tu m'envoies de sa part m'est si doux ! Rends-le-lui donc bien des fois[41]. En route, il se rappelle encore au souvenir de la jeune Romaine : Attica, mes délices et mes amours[42], dit-il. Et quand la situation politique l'oblige de reprendre le chemin de Rome, il a encore une pensée pour la très-suave Attica[43]. Cicéron retrouvait ainsi, pour la jeune personne qu'il aimait si paternellement, quelques-unes des épithètes qu'il donnait naguère à la fille chérie qui était morte à temps pour ne point assister à la un tragique de son père. Comme Cicéron, bien des Romains eurent à pleurer leurs filles. Nous en voyons un touchant témoignage dans les inscriptions de ces monuments funèbres décorés de colombes, de lauriers et de guirlandes[44], et qui s'étaient ouverts pour recevoir les cendres de ces jeunes vierges dont la mort prématurée arrachait des larmes à Juvénal lui-même[45]. Il savait, le poète, qu'un fils est cher à son père, et cependant il trouvait une fille plus douce[46] encore. Et c'est cette impression d'ineffable suavité que retracent les épitaphes : fille très-douce. Mais bien que ce soit cette expression qui se retrouve le plus fréquemment sous le burin du graveur, elle n'est pas la seule. Lisons plutôt quelques-uns de ces textes qui proviennent, les uns de Rome même, les autres de régions asservies à la maîtresse du monde et imprégnées de son influence. Aux dieux mânes d'Aurélia Lucidia, agréable, très-douce, adolescente très-chaste et très-belle, M. Aurélius Lucidius, père très-malheureux, a consacré ce tombeau inattendu, et leur offre les derniers devoirs[47]. Ailleurs un père et une mère dédient une inscription à leur fille très-sainte et très-douce[48]. Remarquons aussi ce touchant hommage rendu à la pieuse Cicéreia Félicula par son père, homme très-malheureux qui a perdu une telle jeune fille[49]. Il arrivait que la même tombe réunissait à une jeune morte son père, sa mère, son frère[50]. Ainsi se confondaient les cendres du même foyer. Les funérailles d'une vierge pouvaient être somptueuses. Une Romaine, dont nous nous occuperons bientôt, étant morte à la veille de son hyménée, Fundanus, son père, accablé de douleur, consacra à ses obsèques la somme qu'il avait destinée aux perles, aux pierreries et aux vêtements de la mariée[51]. C'est de l'amour paternel et de l'amour maternel que nous parlent les textes épigraphiques et littéraires qui viennent de nous attirer. Une inscription nous apporte un éloquent témoignage de la tendresse filiale que pouvait renfermer le cœur de la Romaine. On sait ce que fut parfois ce sentiment sur les bords du Tibre. C'est à Rome qu'à une date inconnue[52], l'on vit une émule de la fille de Cimon intervertir les lois de la nature, en allaitant sa mère ; sa mère, misérable créature cependant, et que la pitié d'un geôlier ne dérobait au supplice que pour la laisser mourir de faim[53] ! C'est à Rome aussi que, sous le règne d'un parricide, l'on vit, par un généreux contraste, les filles de nobles accusés, une Pontifia, une Servilie, braver jusqu'à la mort en se dévouant à leurs pères ![54] Mais il nous faut revenir à l'inscription qui nous appelait tout à l'heure. Celle-ci appartient à l'urne funéraire de Julia Alpinula, fille de ce Julius Alpinus qui souleva l'Helvétie contre Vitellius et qui fut mis à mort par Cécina[55]. N'ayant pu sauver son père, la jeune fille n'avait pu sans doute vivre sans lui. Moi, Julia Alpinula, prêtresse de la déesse Aventina[56], ici je repose, malheureuse lignée d'un père malheureux. Je n'ai pu conjurer par mes prières la mort violente d'un père : il était dans sa destinée de mourir misérablement. J'ai vécu vingt-trois ans[57]. L'étranger lui-même se sentait ému devant ces tombes prématurément ouvertes. Nous avons vu le sévère et satirique. Juvénal céder à cet attendrissement. Voici un autre poète, l'écrivain qui, le plus souvent, roule, dans une fange immonde, les ailes de sa muse : c'est Martial. Eh bien ! pour pleurer la Mort d'une enfant, cet homme si dépravé a des paroles d'une grâce à la fois chaste et mélancolique. Et pourtant cette petite créature n'est que la fille de son esclave. N'importe ! Dans sa dégradation morale même, le poète n'a pu respirer sans émotion ce parfum d'innocence qui, pendant une courte aurore, s'est mêlé à la malsaine atmosphère de sa vie habituelle. Trois petits poèmes sont consacrés par Martial à cette douce mémoire. Le premier est une épitaphe où il se met à la place de la mère, pauvre femme déjà veuve. Cette mère recommande à son époux, l'enfant qui la quitte pour le rejoindre, l'enfant que sa sollicitude suit avec anxiété et terreur au delà de la tombe, l'enfant dont la mère ne veut pas être oubliée même dans la mort. Rien ne pouvait mieux terminer ce petit poème que le vœu qui, même dans les figes chrétiens, devait être toujours populaire. Mais laissons la parole au poète : A Fronton, son père, moi, Flaccilla, sa mère, je confie cette jeune fille, mes baisers et mes délices. Que la toute petite Érotion ne redoute pas les noires ombres, ni le chien du Tartare à la gueule monstrueuse. Elle eût maintenant accompli six de ces froids hivers si elle avait vécu encore autant de jours. Parmi de si anciens patrons que, folâtre, elle joue ; et que, de sa bouche bégayante, elle gazouille mon nom. Qu'un doux gazon couvre ses tendres ossements. Terre, ne pèse pas sur elle : elle n'a pas pesé sur toi[58]. Ailleurs Martial peint les attraits de la jeune Érotion ;
et bien que l'enflure de certains traits décèle l'origine espagnole de
l'auteur, il y a vers la fin du poème une explosion de cette sensibilité qui
d'ordinaire n'appartient qu'aux finies pures. Après avoir esquissé l'image de
l'enfant qu'il appelle mes amours, ma joie et mon
plaisir[59],
il ajoute : Et mon Pétus me défend d'être, triste :
— N'est-ce pas honteux à toi de pleurer la mort de
cette petite esclave en te frappant la poitrine, et en t'arrachant en même
temps les cheveux ?[60] Le corps de la jeune fille a été déposé dans un champ dont Martial est le propriétaire ; et avec l'inquiète prévoyance que Cicéron avait pour le temple destiné à sa fille, le poète recommande ce petit tombeau au futur possesseur de sa terre. L'épitaphe où il exprime ce vœu se termine par l'un de ces traits qui nous font regretter plus vivement encore que Martial ait presque toujours souillé un talent assez délicat pour surprendre et reproduire les notes les plus tendres et les plus exquises de l'âme humaine. Traduisons encore ce poème funéraire : Ici repose Érotion, ombre prématurément enlevée dans son sixième hiver par un crime du destin. Qui que tu sois, qui, après moi, seras maître de ce champ, offre annuellement à ces petits Mânes de justes sacrifices. Ta maison étant ainsi perpétuée et ainsi préservée du trouble, puisse dans ton domaine cette pierre être la seule qui fasse pleurer ![61] Ces fleurs sur lesquelles le ponte gémissait lorsque la mort les avait fauchées, ces fleurs étaient cultivées avec sollicitude. Aux temps primitifs, nous avons déjà remarqué la présence-des filles aux écoles du Forum. A mesure que la civilisation se développe, la vierge participe au mouvement intellectuel et artistique du peuple romain. Dans les familles aristocratiques, des pédagogues et des précepteurs sont spécialement chargés d'instruire la fille de la maison. La correspondance de Cicéron mentionne le pédagogue d'Attica[62]. On le voit : bien que la société nouvelle se développe sous l'influence hellénique, Rome n'imite cependant pas Athènes pour l'éducation des femmes. Les Romains font au contraire participer celles-ci aux lumières qu'ils ont reçues des Athéniens, et dont ces derniers privaient leurs filles. De la même main qui travaille la laine, la vierge romaine sait tenir le livre du philosophe, celui du poile, ou la lyre harmonieuse. Nous avons nommé la docte Tullio ; et nous aurons à signaler plus loin celles de ses compatriotes qui se distinguèrent dans les sciences, les lettres et les arts. Ajoutons cependant que, dans les familles demeurées fidèles aux anciennes coutumes romaines, le père n'osait permettre que sa fille approfondit trop les études littéraires qui, pour plusieurs femmes, avaient été un instrument de séduction[63]. Ces vieux Romains se trompaient ici. Ce sont précisément les connaissances superficielles qui, pour la femme surtout, sont dangereuses, car elles ne font qu'éveiller son imagination sans affermir son âme. Un enseignement solide est au contraire une arme défensive contre les passions. Lorsqu'une instruction sagement réglée s'alliait aux vertus et aux grâces d'une adolescente, il résultait de ce mélange un type que Pline le Jeune nous a fait connaître en dépeignant une fille de son ami, le savant Fundanus, ce proconsul d'Afrique dont nous citions plus haut la paternelle douleur. La plus jeune fille de notre
Fundanus est morte. Je n'ai jamais rien vu de plus enjoué, de plus aimable
que cette jeune fille, ni rien de plus digne, non-seulement d'une plus longue
vie, mais presque de l'immortalité. Elle n'avait pas encore accompli quatorze
années, et déjà elle avait la prudence d'une vieille femme, la gravité d'une
matrone, et cependant la douceur de la jeune fille avec la pudeur virginale.
Comme elle avait hérité des facultés de son père ! Avec quelle tendresse et
quelle modestie elle nous choyait, nous, les amis de son père ! Comme elle
aimait ses nourrices, ses pédagogues, ses précepteurs et toute personne
attachée à son service ! Avec quelle application et quelle intelligence elle lisait
et relisait ! Combien rarement elle jouait et avec quelle circonspection !... Fundanus a perdu une
fille qui ne rappelait pas moins ses mœurs que son visage et sa physionomie,
et qui reproduisait toute la personne de son père avec une admirable
similitude ![64] La poésie surtout était familière aux Romaines. C'était dans cette langue, depuis ses informes débuts jusque dans son splendide épanouissement, c'était dans cette langue que les vierges offraient aux dieux les prières de leurs concitoyens. On se souvient que Livius Andronicus fut leur premier instituteur poétique. Un autre poète qui était à Livius ce que le fruit savoureux est à la graine, Horace, fut aussi et le chantre et le maître des jeunes Romaines. Rappelons-nous ici le beau vers par lequel Horace commence le troisième livre de ses odes : Je hais le profane vulgaire et je l'éloigne. Gardez un religieux silence. Prêtre des Muses, je chante aux vierges et aux jeunes garçons des vers qui n'ont pas encore été entendus[65]. Pour trouver Horace digne d'exercer ce sacerdoce auprès des jeunes filles, nous devons oublier que trop souvent il a célébré les jouissances égoïstes de la vie terrestre, et nous ne devons nous rappeler que ce bon sens pratique dont il a formulé les règles, ce bon sens qui nous enseigne à nous contenter de notre sort, à fuir les grandeurs, à trouver la paix de l'âme dans une condition médiocre ; à garder dans le malheur, l'espoir ; dans la prospérité, la prudence. Nous devons encore laisser ici dans l'ombre le soldat qui s'est vanté d'avoir jeté son bouclier pendant le combat, et nous ne devons penser qu'au patriote qui a gémi sur les discordes de ses concitoyens et qui a su dire : Il est doux et beau de mourir pour la patrie[66]. Des deux poètes qu'il y avait en Horace, un seul était digne de faire entendre aux vierges romaines des accents nouveaux. Comme Alcman, Horace se plaisait à conduire lui-même les chœurs de ses élèves : Vierges d'élite, jeunes garçons
nés de pères illustres, vous que protège la déesse de Délos dont l'arc arrête
le lynx et les cerfs en fuite, observez le rythme de Lesbos frappé par mes
doigts, lorsque, selon les rites, vous chanterez le fils de Latone, et, selon
les rites, l'astre croissant qui, de son flambeau, luit pendant la nuit,
propice aux moissons, et, rapide, fait tourner les mois qu'il entraine. Et
toi, bientôt jeune mariée, tu diras : Quand le siècle a ramené les jours de
fête, j'ai fait entendre le chant qui rend les dieux favorables, instruite
aux accents du poète Horace[67]. Horace fait allusion ici au chant qu'il composa pour les jeux séculaires, rétablis sous le règne d'Auguste. Au troisième et dernier jour de ces fêtes qui étaient destinés à appeler sur l'Empire la protection des dieux, neuf jeunes garçons et neuf jeûnes filles, réunis au temple d'Apollon Palatin, devaient chanter des hymnes et d'autres poésies latines et grecques[68]. C'est à cette occasion que fut composé par Horace le Chant séculaire. Représentons-nous le temple d'Apollon Palatin, cet édifice de marbre blanc qui se dresse, clans sa souveraine élégance, à l'une des extrémités d'un atrium ; représentons-nous aussi cet atrium dont les portiques, en marbre rouge et jaune, sont peuplés de statues de bronze, figurant les Danaïdes et leurs ravisseurs[69]. Et, sur cette vaste scène, écoutons les accents que le poète fait redire à l'élite de la jeunesse romaine. Le chœur des jeunes garçons et le chœur des jeunes filles s'unissent au début pour invoquer Apollon et Diane, les deux divinités qu'Auguste fit adjoindre aux dieux infernaux, seuls célébrés autrefois par les jeux séculaires et maintenant relégués ici au dernier plan. Phébus, et toi, puissante Diane des forêts, brillante parure du ciel, ô divinités toujours vénérables et toujours adorées, exaucez nos prières dans ce temps sacré pendant lequel les vers de la Sibylle ont recommandé que des vierges choisies et de chastes garçons célébrassent les dieux propices aux sept collines. CHŒUR DE JEUNES GARÇONS Soleil qui animes la nature, toi qui, de ton char brillant, projettes et caches le jour ; toi qui te lèves différent et cependant le même, puisses-tu ne rien voir de plus grand que la ville de Rome ![70] Les vierges invoquent en Diane la déesse protectrice des jeunes mères, et les deux chœurs s'unissent de nouveau : Que le cercle déterminé par onze
fois dix années ramène ce chant et ces jeux pendant trois brillantes journées
et autant d'agréables nuits. Et vous, Parques véridiques, vous dont il est
dit plus d'une fois que cc que vous avez annoncé est immuable et préside à la
fin des choses, ajoutez aux bons destins déjà accomplis. Que, fertile en
moissons et en troupeaux, la l'erre donne à Cérès une couronne d'épis. Que
les eaux salubres et le souffle de Jupiter développent les germes. CHŒUR DE JEUNES GARÇONS Doux et bon, et gardant ta flèche, écoute tes jeunes garçons suppliants, Apollon. CHŒUR DE VIERGES Reine des astres, déesse qui portes le croissant, écoute, Lune, tes jeunes filles. LES DEUX CHŒURS Si Rome est votre ouvrage, si une
partie de la multitude troyenne reçut l'ordre de transporter au rivage des
Étrusques, par une course heureuse, ses Lares et sa ville, et suivit le pieux
Énée qui, survivant à la patrie des hommes libres, lui ouvrit un chemin sans
embûches à travers Ilion embrasé pour lui donner plus que ce qu'elle
abandonnait : dieux, donnez de bonnes mœurs à la docile jeunesse ; dieux,
donnez a la vieillesse un doux repos, au peuple romain ]a souveraineté, la
perpétuité, et toutes les gloires. Que celui qui vous honore par le sacrifice
de blancs taureaux, que le sang illustre d'Anchise et d'Énée[71], après avoir été le premier en combattant, commande avec
douceur à l'ennemi abattu. Déjà, sur mer et sur terre, le Mède et l'Albanais
craignent ses mains puissantes et les faisceaux de Rome. Déjà les Scythes,
naguère superbes, et les Indiens, sollicitent ses décisions. Déjà la Foi, et
la Paix, et l'Honneur, et l'antique Pudeur, et la Vertu négligée, osent
revenir ; et l'heureuse Abondance reparaît avec sa corne pleine. CHŒUR DE JEUNES GARÇONS Dieu qui révèles l'avenir, et que décore l'arc fulgurant, Phébus agréable aux neuf Muses, toi qui, par ton art salutaire, ranimes les membres du corps fatigués ; si le Palatin te voit le chercher avec bienveillance, que le temps heureux et toujours meilleur prolonge dans un autre lustre la puissance de Rome et du Latium. CHŒUR DE VIERGES Que celle qui est maîtresse de l'Aventin et de l'Algide, que Diane, soit attentive aux prières des quinze pontifes[72], et prête une oreille amie aux vœux des enfants. LES DEUX CHŒURS Que Jupiter et tous les dieux
nous entendent, c'est la bonne et certaine espérance que je rapporte à la maison,
moi le docte chœur qui ai célébré les louanges de Phébus et de Diane[73]. Déjà un prédécesseur d'Horace, Catulle, avait, pour une fête de Diane, consacré l'une des plus gracieuses productions de son génie aux chœurs de jeunes gens et de vierges qui célébraient la déesse. Nous ignorons quel fut le lieu où vibrèrent ces accents. Nous aimerions à savoir s'ils retentirent dans le bois sacré qui entourait le lac de Némi, le miroir de Diane ; ce bois consacré à la Diane des forêts, et si connu, des femmes romaines qui venaient y prier, et y suspendre leurs offrandes[74]. Ce cadre d'une ravissante fraicheur eût été merveilleusement adapté au poème de Catulle. Nous qui sommes sous la protection de Diane, jeunes filles et chastes garçons ; chastes garçons et jeunes filles, chantons Diane. Ô fille de Latone, illustre
rejeton de Jupiter très-grand, toi que ta mère déposa près de l'olivier de
Délos ; Pour que tu fusses reine des
monts et des forêts verdoyantes, et des bocages retirés, et des fleuves
mugissants ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toi, déesse dont la course
mensuelle mesure le voyage de l'année, toi qui remplis d'opulentes moissons
les rustiques abris du laboureur ; Sous quelque nom que tu préfères, sois vénérée, et, comme de coutume, protège par ton aide l'antique peuple de Romulus[75]. Certes, nous ne trouvons pas, dans l'hymne de Catulle, la pompe majestueuse du Chant séculaire. Catulle, qui avait rame fière et libre d'un vieux Romain, Catulle ne connut pas et n'aurait pas voulu connaître les splendeurs impériales qui rayonnaient jusque dans le sanctuaire des dieux, et que l'ami d'Auguste chanta ici en y joignant toutefois le souffle d'une haute inspiration morale. Ajoutons aussi que la fête pour laquelle Catulle composa son hymne, fut assurément moins solennelle que les grands jeux séculaires. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de Catulle, pour être plus simple, n'en est pas moins empreinte d'une majesté qui n'est autre que celle de la nature, et qui donne à ce petit poème un caractère tout antique. Mais que Catulle appelle sur la vieille Rome la protection de Diane, ou qu'Horace demande aux dieux la grandeur de l'Empire, le mène amour du sol natal respire dans les accents des deux poètes. Nous avons eu déjà l'occasion de remarquer combien les Romains attachaient de valeur aux prières de l'enfant et à celles de la vierge. Aussi le poète, dont ces voix traduisaient les mélodies, était-il fier de sa mission, et en proclamait-il les résultats : Vierges ignorantes unies à de chastes garçons, dit Vorace, d'où vous aurait-on enseigné les prières si la Muse n'eût donné le poète ? Le chœur demande le secours (des Immortels), et la présence divine se fait sentir ; par l'éloquente et douce prière, il implore les eaux du ciel, il détourne les maladies, éloigne les périls redoutables ; il obtient et la paix, et une année abondante en moissons. Par le chant s'apaisent les dieux du ciel ; par le chant, les dieux des enfers ![76] Ainsi habituées à prier les dieux pour leur pays, les jeunes Romaines respiraient, dès leur fige le plus tendre, ce sentiment que les filles d'Athènes ne purent guère connaître : l'amour du sol natal ! Leur piété et leur patriotisme s'unissaient ainsi ; et par celte alliance elles semblent d'abord nous rappeler les vierges d'Israël. Mais la piété du Romain, cette piété toute païenne, toute matérielle, renfermée dans les étroites limites d'un formalisme tout officiel, et cependant disséminée dans une foule de cultes, cette piété ne pouvait produire le généreux enthousiasme avec lequel l'adorateur du vrai Dieu regardait dans son pays la terre même de Jéhovah, et saluait dans ses victoires nationales les triomphes de l'Éternel. C'était d'un amour plus humain que les enfants de Rome aimaient leur patrie. Bien qu'ils se plussent à l'appeler la terre de Saturne, elle leur était surtout chère par elle-même, par ses souvenirs, par ses espérances, par l'héroïsme de ses enfants, par la fécondité de son sol : Salut, grande mère des moissons, terre de Saturne, grande mère des guerriers ![77] Comme nous le disions dans un chapitre précédent, l'éducation toute domestique de la Romaine donnait plus d'expansion à ses sentiments de famille qu'à son patriotisme. Certes la fille d'Israël ne fut pas plus que la fille de Rome élevée hors de son foyer ; mais à ce foyer vivait le Dieu sans commencement et sans fin ; et c'était à la terre de ce Dieu qu'elle savait se dévouer en mourant pour son pays. Ce n'était malheureusement pas toujours au milieu des fêtes religieuses que les Romaines se familiarisaient avec la poésie. Là où avait pénétré l'influence corruptrice que nous signalions plus haut, qu'importait à la jeune fille le culte des dieux ! Ces dieux, elle les méprisait, dit Properce. Et, après tout, quel autre sentiment pouvaient lui inspirer les scandaleuses légendes dont l'Olympe était l'objet ! Qu'importaient aussi à cette jeune fille les mystères de la nature et ceux de l'autre monde[78] ! Beaucoup de femmes alors voulaient paraître instruites, mais peu l'étaient réellement[79] ; et la première science que l'aïeule transmettait à sa petite-fille était le prix de l'or, de l'or, quelle qu'en fût l'origine[80] ! Ce qu'il fallait à ces filles de la décadence, ce n'étaient ni les graves enseignements de la philosophie, ni les males inspirations d'une poésie élevée. Si, pour se rendre digne de ses virginales disciples, Horace donnait à sa Muse un plus haut essor, Properce disait à un ami : En amour, un vers de Mimnerme vaut plus qu'Homère ; le doux Amour cherche de doux chants. Allons, je t'en prie, ensevelis ces tristes ouvrages, et chante ce que voudra connaître toute jeune fille[81]. C'est qu'Horace voyait la jeune Romaine telle qu'elle existait encore dans les foyers où les anciennes vertus s'étaient perpétuées, tandis que Properce la voyait telle que les mœurs contemporaines l'avaient faite. Oui, c'étaient des poèmes d'amour que demandaient alors les filles de Rome ; non pas, comme plus tard les châtelaines du moyen âge et les inspiratrices de Pétrarque et du Dante, les chants des pures amours, mais les accents voluptueux des passions païennes. Et les poètes ne furent que trop souvent dociles à cette inspiration, et ne se plurent que trop souvent à développer le goût malsain qui leur préparait, outre le succès littéraire, d'autres triomphes encore. Faut-il rappeler ici les étranges leçons qu'Ovide donnait aux jeunes filles et aux matrones, et qui furent la cause apparente de son exil ? Le poète se défendit, il est vrai, d'avoir écrit son livre pour les femmes honnêtes[82]. Mais l'ouvrage qui lui fut justement reproché comme un crime trahit sa véritable pensée, 'et les préceptes d'Ovide avaient certainement une portée plus haute qu'il ne l'avouait. Dans ce livre immoral, Ovide conseille aux jeunes filles la lecture de poètes parmi lesquels il souhaite que la renommée vienne à le placer. S'il les exhorte à cette étude, ce n'est pas pour élever leur esprit, c'est pour fortifier encore la puissance de leurs plus dangereux attraits en faisant d'elles les interprètes d'une poésie sensuelle. C'est ainsi qu'il appelle à son aide Sappho, Anacréon, Properce, Tibulle. Quant à Térence qui a peint l'amour avec une délicatesse de touche bien opposée à la grossièreté de Plaute, Ovide ne désigne en lui que le pote qui, dans l'une de ses comédies, a enseigné l'art de tromper un père. Si Ovide n'avait pris soin de nous faire connaître le motif de ce dernier choix, nous pourrions nous étonner qu'il n'eût pas plutôt rangé Plaute parmi ses alliés. Nous nous étonnerions encore à plus juste titre de voir Ovide recommander surtout à la jeune Romaine la lecture de l'Énéide, cette œuvre du chaste Virgile ; mais Ovide avait sans doute pris en considération les pages, cependant si voilées, où le cygne de Mantoue chante la malheureuse passion de la souveraine carthaginoise. C'est encore pour ajouter aux séductions de la femme qu'Ovide souhaite que son élève sache faire résonner la cithare et le psaltérion. Il l'engage aussi à cultiver le chant, et, toujours fidèle à ses perverses leçons, il lui indique, outre les airs qu'elle a appris au théâtre, ces chansons égyptiennes qu'accompagnaient des mouvements désordonnés[83]. Alors, en effet, la danse pouvait s'allier à la récitation des vers. C'était une espèce de pantomime. Énumérant les talents de sa belle-fille, Stace nous apprend qu'elle disait, avec de gracieuses attitudes, les vers qu'il avait composés[84]. Le goût des jeunes filles pour les danses de l'Ionie est noté par Horace comme Fun des signes de la corruption romaine[85]. Aussi Ovide ne manque-t-il pas de placer la danse parmi les arts qui pouvaient rendre ses élèves plus dignes de ses funestes enseignements[86]. Quand Ovide, exilé, cherchait à justifier les licences de sa poésie, il disait que bien d'autres influences démoralisatrices s'exerçaient sur les Romaines. Les Pères de l'Église n'indiqueront pas avec plus de précision que ce païen si épris des vices de son siècle tous les pièges que le séjour de Rome offrait à l'innocence : les portiques, ces élégantes promenades où se trament les intrigues qui perdent l'honneur des familles ; le Cirque qui réunit sur les mêmes gradins les hommes et les femmes, et où la jeune fille peut se trouver placée auprès d'un inconnu ; le théâtre où la verve du poète comique n'épargne ni la sainteté du foyer domestique, ni la majesté de l'Olympe ; les temples, ces temples consacrés à des dieux dont les désordres encouragent tous les vices des mortels ; et enfin certaines solennités du culte, telles que les jeux floraux, ces infâmes spectacles auxquels Caton eût rougi d'assister et que l'on ne dérobe pas aux regards de la vierge. Le toit paternel même n'offre pas à la jeune fille un refuge contre les images qui blessent sa pudeur : l'art des peintres grecs introduit dans les maisons, des scènes analogues à celles qui ont frappé ailleurs l'imagination de la jeune Romaine[87]. Tel est le tableau que nous trace un peintre si prévenu cependant en faveur de son modèle. Mais ce n'est pas se disculper d'avoir contribué à la démoralisation générale que de prendre celle-ci pour excuse ; et l'homme dont le brillant langage a propagé le venin des mauvaises mœurs doit être marqué d'un stigmate plus bridant encore que celui qui s'attache au malfaiteur. Les empoisonneurs de la morale ne sont pas les moins dangereux de tous, et, sous une législation qui châtiait le séducteur de la jeune fille[88], Ovide mérita l'exil. Assurément Properce fut bien moins coupable qu'Ovide. Et
cependant, lui qui n'avait que trop cédé au goût des Romaines pour les chants
d'amour, avait-il le droit de gémir sur les vices précoces de ses jeunes
contemporaines ? C'est lui qui nous signalait tout à l'heure l'incrédulité de
la jeune fille ; c'est lui encore qui s'écrie avec amertume : Tu dessécherais plutôt le lit de la mer, et d'une main
humaine tu détacherais plutôt les astres du ciel, que de faire que nos jeunes
filles ne voulussent plus pécher[89]. Devant les envahissements d'un luxe qui ne semble néanmoins pas trop lui déplaire, Ovide avertit les filles du Tibre qu'elles devront leur plus grande parure à la pureté de leurs mœurs[90]. Mais cette pureté, lui était-il permis seulement d'en prononcer le nom, lui qui avait enseigné aux jeunes filles les plus sûrs moyens de la perdre ? Nous avons montré les deux courants que suivent à cette époque les mœurs romaines : le plus petit est seul demeuré pur ; l'autre ne roule plus que de la fange. Peut-être celui-ci aurait-il dû nous arrêter plus longuement que celui-là ; mais alors que nous commençons seulement à étudier les mœurs corrompues de la nouvelle Rome, l'on nous pardonnera de nous être attardée près du ruisseau à l'onde claire, et de n'avoir que rapidement passé devant ce fleuve de boue au bord duquel ne nous ramènera que trop souvent la matrone. |