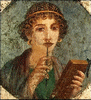LA FEMME ROMAINE
PREMIÈRE PARTIE. — LA FEMME SOUS LA ROYAUTÉ ET PENDANT LES TROIS PREMIERS SIÈCLES DE LA RÉPUBLIQUE
CHAPITRE DEUXIÈME. — LA JEUNE FILLE.
|
Unité de la famille romaine. — Le nom de la jeune fille. — Égale servitude du fils et de la fille sous la puissance du chef de famille. — Vente de la jeune fille. — Les deux sexes ont, à l'origine, les mêmes droits de succession. — Perpétuelle minorité de la Romaine. Les agnats. Le tuteur testamentaire. — L'affection paternelle. Un souvenir patriarcal. — Le jour natal. — La vierge et le Lare. — La jeune, fille au bois de Lanuvium. — L'hymne de Livius Andronicus, chanté par les vierges à l'heure des angoisses nationales. — Éducation à la fois domestique et patriotique reçue par la Romaine. — Occupations rurales de la jeune fille. — La vierge romaine et la vierge spartiate. — Horatia, sœur des trois Horace. — Clélie. Chez la femme, la chasteté est élevée par les Romains au-dessus même du patriotisme. — Virginie. La Virginie d'Alfieri. — La vierge antique, d'après Virgile. Lavinie. — Type exceptionnel de la vierge guerrière, d'après le même poète. Camille. — Les premières jeunes filles latines comparées à d'autres vierges antiques. La famille romaine se présente nous avec un caractère particulier de force et de grandeur. Elle est une dans toute l'acception du mot. Cette unité, elle la doit, non pas à l'amour mutuel des membres qui la composent, mais à un élément d'une essence toute romaine : la puissance du père[1], ce chef de famille qui réunit sa femme, ses enfants et les enfants de ses fils sous le triple sceptre du père, du juge, du pontife[2]. Comme pour attester une fois de plus ce pouvoir absolu, il ne semble pas qu'à l'origine la jeune Romaine ait reçu un prénom particulier. Elle ne porte que le nom de son père, mais avec une terminaison féminine. Valeria est la fille de Valerius ; Lucretia, celle de Lucretius. S'il y a deux sœurs, l'aînée est surnommée Major, la seconde Minor. Plusieurs jeunes filles sont-elles nées du même père ; elles prennent, suivant leur âge, les dénominations de Prima, de Secundo, de Tertio. Et parfois ces surnoms se transforment en ces diminutifs tendres et caressants qui se donnent dans les familles : Tertulla, Quartilla, Quintilla, petite troisième, petite quatrième, petite cinquième[3]. Pendant l'époque primitive qui nous occupe, la fille est, au foyer paternel, l'égale du fils. Tous deux sont soumis de la même manière au chef de famille. Aïeul ou père, celui-ci peut les tuer dès qu'ils ont accompli l'âge de trois ans. Il peut les exposer, les vendre. Les enfants tombent alors sous la puissance de l'homme qui les a achetés ; mais si ce dernier les affranchit, la fille seule demeure maîtresse d'elle-même[4], tandis que le fils retourne sous la puissance paternelle, à laquelle il ne peut être soustrait qu'après avoir été vendu trois fois[5]. Les Romains jugeaient-ils que c'était assez d'avoir exposé une fois à l'humiliation, et peut-être à la honte d'une vente, les sentiments délicats et la pureté de la jeune fille ? Ou bien, comme en dehors de la puissance paternelle l'enfant perdait ses droits naturels de succession, la loi qui, au premier abord, semblait si dure pour le fils, protégeait-elle réellement ses intérêts en lui permettant d'être remis par deux fois en possession de son titre d'hérédité ? Si, devant le chef de famille, le fils et la fille sont égaux en servitude, ils le sont aussi en droits. Ils ont le même titre à la succession paternelle, et la formule d'exhérédation est la même pour l'un et pour l'autre[6]. Si, du vivant de leur père, et quel que soit leur âge, ils ne peuvent rien posséder en propre, après sa mort tous deux seront également aptes à recevoir la succession de leurs agnats[7], c'est-à-dire de ceux de leurs parents qui leur sont unis par la descendance masculine[8]. Cependant, lorsque la jeune fille aura perdu son père, sa situation légale se manifestera dans toute son infériorité. Tandis que l'héritier ne subira la tutelle que jusqu'à l'âge de quatorze ans, l'héritière sera toujours mineure[9]. Aussi la tutelle des femmes constituera-t-elle un droit plus important que la tutelle des hommes[10]. Les tuteurs de la femme exerceront sur sa fortune un contrôle d'autant plus sévère qu'étant ses agnats, ses héritiers naturels, ils seront personnellement intéressés à ce que son patrimoine demeure intact[11]. Aussi, comme le fait justement remarquer Gaïus, si les Romains assujettissaient la femme à une perpétuelle minorité, ce n'était pas qu'ils la jugeassent incapable d'administrer ses biens ; nous verrons même qu'il lui était permis de les gérer dans une certaine mesure. La tutelle que subissait l'héritière avait été établie, non pour protéger sa faiblesse, mais pour sauvegarder, dans sa fortune, le patrimoine de sa famille[12]. Aussi la tutelle ne s'exercera-telle jamais sur la conduite privée de la femme ; cette surveillance n'appartiendra qu'au conseil de famille. Les tuteurs n'auront même sous leur garde que les biens dont la vente constitue un acte solennel, la mancipation : la terre, ce domaine sacré du vieux Romain ; l'esclave, le bétail, l'instrument de labour, qui servent à la cultiver, ne pourront être aliénés par l'héritière sans le consentement de ses tuteurs. Il lui sera interdit d'emprunter, acte qu'elle ne peut accomplir qu'avant la mort de son père, parce que, ne possédant alors aucun bien, elle n'engage que sa liberté. Elle n'aura le droit de faire un testament qu'avec l'autorisation de ses tuteurs. Mais c'est dans le chapitre suivant que cette dernière question nous occupera. Quant aux revenus mêmes de ses propriétés, à tout objet dont la vente ne constitue pas un acte solennel, l'héritière en disposera librement ; elle affermera ses terres, elle en vendra les produits ; elle dépensera son argent. Il sera même permis à la pupille d'accomplir, sans ses tuteurs, certains actes solennels qui ne concernent pas son patrimoine : elle pourra comparaître seule devant la justice, soit pour déposer son témoignage, soit pour représenter autrui. II arrivait aussi que, plus préoccupé de la liberté de sa fille que de l'avenir de son patrimoine, le Romain préservait son héritière du vigilant contrôle des agnats, en lui donnant un tuteur testamentaire qui, étranger à la famille, n'avait aucun motif personnel pour gêner l'orpheline dans la complète jouissance de la succession paternelle[13]. Par cette prévoyante sollicitude du chef de famille, nous pouvons juger que, même chez les rudes habitants de la Rome primitive, l'affection que leur inspiraient leurs filles était parfois assez forte pour vaincre l'aristocratique sentiment dont ils étaient pénétrés : l'orgueil de la race, le souci du patrimoine. Dans cette antique famille romaine où nous retrouvons le reflet patriarcal qui nous a déjà frappée chez les Aryâs de l'Inde et les premiers Hellènes, la vie de la jeune fille pouvait donc être douce. Certes, la vierge devait être moins libre et moins heureuse dans le sévère atrium de la maison romaine que sous cette tente hébraïque que protégeait le vrai Dieu. Mais, quel que fût ce pouvoir paternel qui était plus redoutable encore chez les Romains que chez les patriarches, nous voyons que, sur les bords du Tibre même, l'affection du père venait plus d'une fois adoucir l'autorité du maître. La sévérité du milieu domestique, où croissait la jeune fille, n'excluait pas le charme intime du foyer. Le jour natal de la Romaine est, comme celui du Romain, une fête de famille. La fille du logis reçoit les dons de ceux qui l'aiment, et le pauvre esclave apporte lui-même de petits bijoux à sa jeune maîtresse. La flamme, vive et joyeuse, brille sur l'autel domestique[14]. Cet autel, ce foyer est bien connu de la vierge antique. C'est elle, nous le savons, qui en alimente le feu. Bientôt Virgile nous montrera Lavinie assistant son père dans un sacrifice, et brûlant sur l'autel les branches odorantes du pin[15]. Le Romain vent-il remercier les Lares de lui avoir accordé une faveur, sa jeune enfant le suit, portant un pur rayon de miel[16]. Et c'est, ainsi que le pontife domestique, faisant passer par les mains de sa fille l'une de ses offrandes religieuses, témoigne de quel prix est pour lui la naïve candeur de cette enfant : l'innocence de la fille devient la protection du père. Aux siècles meules qui voient commencer la décadence morale de Rome, Plaute nous montre encore le plus important des génies du foyer, le Lare familier, qui fait découvrir un trésor à un avare qu'il n'aime pas, mais dont la fille s'est concilié sa bienveillance : Elle m'offre chaque jour, dit le Lare, ou de l'encens, ou du vin, ou autre chose : elle me donne des couronnes. En faveur d'elle, j'ai fait qu'Euclion découvrit ici ce trésor, à l'aide duquel il la mariera plus facilement s'il le veut[17]. Comme nous le mentionnions ailleurs, la jeune fille veillait donc sur le foyer privé comme la Vestale sur le foyer de l'État[18]. Elle se mêlait aussi au culte officiel. Était-elle fille d'un prêtre et d'une prêtresse, elle était, comme son frère, appelée à aider ses parents dans leur ministère. On nommait Camilles ces jeunes servants du culte[19]. En dehors des familles sacerdotales, les filles de Rome prenaient aussi part au culte publie. Parmi les cérémonies où nous les voyons figurer, il en est une dont le caractère, grave et naïf à la fois, dénote l'antique origine. Cette coutume se rattache au culte de Junon, la déesse dont toute femme, jeune fille ou matrone, donnait le nom au génie bienfaisant qu'elle croyait voir veiller sur elle. Sous l'épithète de Sospita, protectrice, Junon avait à Lanuvium un temple et un bois sacré. Dans celui-ci se trouvait un dragon, qui était voué à la déesse, et qui, à chaque printemps, devait recevoir de la main d'une vierge l'offrande religieuse d'un gâteau[20]. Acceptait-il cette nourriture, c'était pour la crédulité populaire le présage d'une année féconde. Mais si la jeune fille chargée de lui présenter ce don avait perdu sa pureté, le serpent refusait de le recevoir. Que d'angoisses pour la jeune messagère ! Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend ; tout ce qu'elle redoute, doit la glacer de terreur. Il lui faut descendre dans l'antre ténébreux où le serpent réclame, par de stridents sifflements, le tribut annuel ; et il suffira d'un caprice de l'animal pour que, la vertu de la jeune fille soit suspectée... Vierge, garde-toi d'un tel chemin tout entier ![21] s'écriera un jour le poète. Enfin, pâle et frémissante, la jeune Romaine offre au reptile le gâteau sacré... Sa corbeille même tremble pendant que le dragon se jette sur la nourriture que lui présente sa main... Et cependant, alors déjà, la jeune fille a triomphé : elle vient d'échapper a un danger plus terrible encore que la mort, le déshonneur ! Elle court se jeter dans les bras de ses parents, et les laboureurs s'écrient : Fertile sera l'année ![22] La jeune fille figurait probablement aussi dans les rites nocturnes de ces jeux séculaires qui paraissent avoir été institués au temps de la première guerre punique, pour appeler sur Rome la protection des dieux infernaux : Proserpine et son redoutable époux[23]. Nous reparlerons ailleurs de ces jeux qui furent transformés au siècle d'Auguste. Peu de temps après l'institution de ces fêtes, c'est-à-dire presque sur la limite de l'époque que nous étudions dans ce chapitre, nous voyons les vierges se mêler à une solennité religieuse et patriotique où nous apparaît, pour la première fois, la libre expansion du langage poétique dans les fêtes romaines. C'était pendant la seconde guerre punique. D'effrayants présages se joignaient aux victoires d'Annibal pour atterrer les Romains. Les pontifes ordonnèrent que trois chœurs de neuf vierges traverseraient la ville en chantant un hymne. Cet hymne, adressé à Junon Reine, fut composé par Livius Andronicus, ce Grec qui, le premier, tenta de faire passer dans le rude langage de la Rome primitive les richesses poétiques de son harmonieux idiome natal. Mais ce premier essai devait un jour paraitre informe à l'élégant Tite-Live[24]. Les jeunes filles répétèrent, dans le temple de Jupiter Stator, l'hymne de Livius Andronicus. Au jour fixé pour la cérémonie, la procession se déroula dans un ordre qui rappelle celui des pompes grecques. En tête du cortège, étaient conduites deux blanches génisses à la suite desquelles on portait deux statues de cyprès représentant Junon Regina. Comme les vierges des Panathénées, les jeunes filles marchaient ensuite, chastement enveloppées de leurs longues robes, et modulant le poème de Livius. Les décemvirs des sacrifices, couronnés de lauriers, vêtus de leurs toges prétextes, fermaient le cortège qui, parti du temple d'Apollon, entra dans la ville par la porte Carmentale, et suivit la voie Jugaire pour se rendre au Forum. La procession s'arrêta à ce foyer de la vie romaine. Alors les vierges, tenant une corde[25], commencèrent cette danse religieuse qui, chez les Romains, était une marche rythmée ; et, par le mouvement de leurs pieds, elles cadençaient le son de leurs voix jeunes et fraîches. La procession se remit en marche, passa par la voie Étrusque, par le Vélabre, par le Marché aux bœufs, gravit l'Aventin par la Montée publique, et atteignit le temple de Junon Reine, édifice qui se dressait sur la plus haute cime de ce mont rocailleux[26]. Ce fut dans ce temple que les décemvirs immolèrent les deux génisses, et que les simulacres de Junon furent déposés[27]. C'était une douce et touchante idée que de placer sur des lèvres virginales les supplications qu'un grand peuple adressait aux dieux. Les Romains attribuaient une vertu puissante aux hymnes modulés par des voix qui n'avaient jamais traduit que d'innocentes impressions. Et cependant cette chasteté, dont les Romains sentaient si vivement le prix qu'elle leur paraissait devoir attirer sur leurs moissons le sourire du ciel, et sur leur patrie la clémence divine ; cette chasteté qui, chez leurs Vestales, était le gage de leur prospérité publique, savaient-ils toujours la respecter dans leurs filles ? Faut-il rapporter aux premiers siècles de Rome les chants déshonnêtes interprétés par les jeunes filles lorsqu'elles célébraient Anna Pérenna[28], déesse qui semble avoir présidé aux années[29], et dont la fête, essentiellement romaine, attirait sir les bords du Tibre le peuple qui goûtait là de champêtres plaisirs ? Certes, il nous répugne de penser que la coutume immorale à laquelle nous venons de faire allusion appartenait à cette Rome patriarcale d'autrefois qui gardait dans ses austères vertus un reflet de la révélation primitive. Nous voudrions croire que ce ne fut qu'aux siècles de dépravation morale qu'un tel usage vint se greffer sur le culte d'Anna Pérenna. Malheureusement, d'autres détails de la vieille religion romaine ne nous permettent pas de trop mettre en cloute l'antiquité de cette tradition. Il faut apparemment voir dans de semblables coutumes, non le fruit d'une corruption précoce, mais un témoignage de cette naïveté grossière où tombent les peuples naissants lorsqu'ils ne se laissent plus guider par le vrai Dieu. Nous aimons mieux placer les jeunes Romaines aux fêtes de Diane et à celles de Minerve. Nous ne nous arrêterons cependant pas ici sur la part qu'elles prenaient au premier de ces deux cultes, et nous attendrons que Catulle inspire l'hymne qu'elles chanteront à leur virginale déesse. Aux fêtes de Minerve, les Quinquatries, les jeunes filles célébraient l'institutrice des travaux féminins[30], et sans doute aussi elles fêtaient, avec les écoliers, la protectrice des lettres. En effet, la Romaine n'apprenait pas seulement, comme l'Athénienne, à filer, à tisser ; mais, de même que la vierge israélite, elle était initiée aux choses de l'esprit. Nous venons de voir que Livius Andronicus, comme naguère Alcman à Sparte, fit répéter aux jeunes filles les accents de sa voix cadencée. Dès qu'il y eut un poète à Rome, la vierge sut chanter. Mais longtemps avant cette époque les traditions nous montrent Virginie allant aux écoles de lettres qui se tenaient dans les échoppes du Forum, et où les jeunes filles recevaient, en même temps que les garçons, l'éducation publique[31]. Quels que fussent les périls de cette éducation mixte, ils pouvaient être partiellement conjurés par la pureté des mo.urs antiques, et par l'éducation toute féminine que la jeune Mlle recevait dans la maison paternelle. Son esprit seul était l'objet d'une direction virile. A la différence de la Spartiate, elle n'était pas livrée à ces exercices publics où se perdaient la grâce et la modestie de la femme. La vigueur de la Romaine n'avait pas besoin de ces luttes gymniques pour se développer. A cette époque où les patriciens eux-mêmes passaient aux champs la plus grande partie de leur vie, les Romains associaient leurs filles à leurs rustiques labeurs. Ainsi que ses sœurs de la Mésopotamie et de l'Inde védique, la jeune Romaine sait être bergère. A elle les prairies où elle fait paître ses agneaux[32] ! A elle le vaste horizon des montagnes et les vivifiantes émanations de leurs forêts ! A elle aussi les dons des jeunes campagnards[33] : les coings, les paniers de mûres, les grappes de raisins revêtues de leur feuillage, les violettes et les lis destinés à sa corbeille, et l'oiseau aux nuances diaprées, fleur vivante et chantante ! Au souffle puissant d'une nature encore primitive, et sous les rayons du soleil d'Italie, la jeune fille acquérait cette force et cette beauté qui devaient immortaliser le type de la Romaine. Pour parvenir à ce résultat, on ne lui avait pas fait perdre ses qualités natives ; l'on n'avait pas substitué à des habitudes masculines. Les Lacédémoniens n'élevaient leurs filles que pour la patrie : les Romains élevaient les leurs pour la famille et pour la patrie, ou plutôt, pour la patrie par la famille. Il n'était pas jusqu'aux jouets de la petite Romaine, qui ne lui parlassent de la mission à la fois domestique et patriotique qu'elle devait remplir. Si sa poupée[34] l'exerçait aux sollicitudes maternelles, l'épée, la hache, la faucille[35], qui figuraient parmi ses jouets, lui apprenaient qu'elle était destinée à devenir la compagne et la mère du Romain, agriculteur et soldat ! Aussi, grâce à cette éducation domestique, la Romaine restait femme, quelque héroïque qu'elle pût être ; et bien que le Romain, de mène que le Lacédémonien, sacrifiât à son pays ses plus légitimes affections, sa fille n'eut pas, comme la Spartiate, la cruauté de ce courage. Nous pouvons même ajouter que ce fut seulement chez la matrone que l'élan du patriotisme se déploya avec vigueur. Chez la jeune fille, fleur délicate qui se penchait plus vers sa racine qu'elle n'aspirait au soleil, les tendresses du foyer l'emportaient sur l'amour du pays. Les premiers types de vierge que nous offrent les historiens latins nous montrent ce triomphe des affections du cœur. Quand le dernier des trois Horace revient vainqueur des trois Curiace, Horatia, sa sœur, va à sa rencontre au delà de la porte Capène. Naguère elle a été fiancée à l'un des trois Curiace... Et maintenant elle reconnaît sur les épaules de son frère l'habit guerrier que, suivant la coutume romaine, elle a fait à son fiancé. Une Spartiate eût embrassé le vainqueur mais la jeune Romaine, s'arrachant les cheveux et fondant en larmes, ne peut qu'appeler son fiancé mort[36]. Tite-Live nous dira le reste : Les
lamentations de sa sœur, au milieu de sa victoire et d'une si grande joie
publique, courroucent l'âme du fougueux jeune homme. Tirant son glaive, et la
frappant en même temps de ses injures, il perce la jeune fille : Va maintenant, avec ton amour hors de saison, chez ton
fiancé, dit-il, oublieuse de tes frères
morts et de celui qui vit, oublieuse de ta patrie. Qu'ainsi soit traitée
toute Romaine qui pleurera un ennemi ![37] Les Romains, habitués à immoler à l'État leurs liens les plus chers, les Romains qui, plus tard, devaient admirer Brutus condamnant à mort son propre fils et présidant au supplice de celui-ci, les Romains approuvèrent-ils Horace d'avoir tué une sœur qui n'avait commis d'autre crime que celui de pleurer un fiancé dans un ennemi de Rome ? Non. Tite-Live nous apprend que ce fratricide fut un horrible spectacle pour les patriciens et pour le peuple[38]. Entraîné devant le roi Tullus Hostilius, jugé par les duumvirs[39] Horace avait déjà entendu prononcer contre lui une sentence terrible : on allait lui voiler la tête, l'attacher à un poteau et le flageller, lorsque, suivant l'avis paternel du roi, il en appela au jugement du peuple. Devant cette immense assemblée, le vieil Horace, père de l'accusé, eut seul le courage de dire que le châtiment de sa fille lui paraissait si juste, qu'il n'avait pas mandé le meurtrier à son tribunal domestique ; mais n'était-ce point pour sauver le dernier enfant qui lui restait, que le père l'absolvait de ce crime ? Quoi qu'il en fût, les larmes du vieillard, le souvenir des récents exploits du jeune Horace, l'impassible courage que montra l'accusé pendant son jugement, émurent le peuple, qui acquitta le coupable. Mais pour témoigner qu'ils absolvaient en lui, non le meurtrier d'une sœur, mais le sauveur de l'État, les Romains ordonnèrent au père d'Horace de racheter son fils par une amende publique. Le vieillard fit aussi des sacrifices expiatoires dont les traditions se conservèrent dans sa race avec ce soin scrupuleux qui faisait de chaque famille romaine le foyer d'un culte particulier. Deux autels furent élevés : l'un des deux était consacré à Junon, gardienne des sœurs. Le vieil Horace mit au-dessus de ces autels un soliveau qu'il en plaça en travers de la rue ; puis il fit passer sous ce joug le jeune vainqueur, la tête voilée. Ce soliveau, nommé le soliveau des sœurs[40], subsistait encore six siècles après, et l'État entretenait toujours à ses frais ce monument expiatoire d'un crime que réprouvait la conscience publique. Ces faits rendent peu probable l'opinion qu'émet Denys d'Halicarnasse, et suivant laquelle le père d'Horace ne se serait pas contenté de célébrer la victoire de son fils, le jour même où celui-ci l'avait souillée par le fratricide. D'après l'archéologue grec, le vieux Romain aurait même défendu que le cadavre de sa fille fût déposé chez lui et reçût les honneurs funèbres. Ce corps virginal, abandonné au lieu même où il était tombé, n'aurait eu d'autre sépulture que les pierres et la terre que lui auraient jetées les passants. Ainsi, pendant que le cadavre de l'innocente victime eût été exilé du foyer paternel, une fête eût été donnée dans cette même maison, en l'honneur du meurtrier, par celui qui était le père de l'un et de l'autre ! Il y avait là un contraste qui devait saisir la mobile imagination d'un écrivain grec, mais qui eût révolté, chez les Romains, ce sentiment moral dont Tite-Live a recueilli l'énergique expression. Nous suivrons donc l'historien latin, qui nous dit simplement qu'un tombeau en pierre de taille fut élevé à la jeune fille, au lieu même où elle avait été renversée par le glaive d'Horace[41]. Bien différente de l'héroïne de Corneille, cette Camille qui sait mieux maudire que pleurer, et dont le courroux s'exhale en d'immortelles invectives, la sœur d'Horace ne nous est apparue dans Tite-Live qu'au milieu de ses larmes. Voici une autre vierge romaine qui se présente à nous, non plus dans cette attitude passive, mais dans l'élan d'un courage tout viril. Est-ce néanmoins au service de Rome que Clélie déploiera cette fière énergie ? Non, c'est au détriment de l'intérêt public. Mais elle obéira à un mobile plus délicat encore que le patriotisme : la sauvegarde de son honneur ! Comprise parmi les otages que les Romains ont dû livrer à Porsenna, roi des Étrusques, Clélie est retenue dans un camp où sa pudeur peut être exposée à des souffrances plus cruelles que la mort. Dût-elle, en fuyant, exposer le sort de son pays, la jeune Romaine préservera avant tout son innocence virginale. Les Étrusques campaient non loin du Tibre. Les jeunes prisonnières expriment le désir de se baigner dans le fleuve, et leurs gardes s'éloignent. Alors Clélie propose à ses compagnes de traverser le Tibre à la nage. Elles suivent ce conseil ; et toutes les jeunes filles, se tenant par la main et fendant les ondes, bravent les traits que les ennemis lancent sur elles. Aucune n'est blessée, et Clélie ramène ses compagnes à leurs doux foyers. Parmi ces jeunes filles était Valéria, fille du consul Valérius Publicola. D'après Plutarque et Denys d'Halicarnasse[42], le suprême magistrat de la république, sacrifiant son amour paternel à l'intérêt de son pays, aurait, de son propre mouvement, rendu à Porsenna les jeunes fugitives. Selon Tite-Live, Valérius ne prit pas l'initiative, de cette mesure ; mais Porsenna, irrité, envoya des ambassadeurs à Rome pour réclamer Clélie. Il ne semblait pas insister sur le renvoi des autres otages. Mais l'admiration que lui inspirait le courage de Clélie ne tarda pas à éteindre le courroux qu'avait allumé en lui la fuite de sa captive. Le trait de la vierge romaine lui paraissait plus héroïque encore que les actes qui venaient d'immortaliser Horatius Coclès et Mucius Scévola. Il fit savoir aux Romains que si Clélie n'était pas ramenée dans son camp, il romprait le traité par lequel il s'était engagé à retirer ses troupes du territoire romain ; mais que si la jeune fille lui était rendue, il la respecterait et la renverrait même à Rome. Les fugitives furent reconduites, avec une escorte, vers le camp des Étrusques. Mais Tarquin le Superbe, qu'avaient expulsé les Romains et dont Porsenna venait d'abandonner la cause, Tarquin le Superbe fit tomber dans une embuscade les otages et leur suite. Valéria, passant courageusement à cheval au milieu des combattants, arriva au camp étrusque avec trois esclaves. Aruns, fils de Porsenna, accourut au lieu du danger, et mit en déroute les gens de Tarquin. Quand Clélie parut devant Porsenna avec ses compagnes, le roi rendit hommage à la valeur de la jeune Romaine. Suivant Denys d'Halicarnasse, il félicita Rome de ce qu'elle produisait non-seulement des hommes héroïques, mais des femmes qui rivalisaient de courage avec eux. Ainsi que Plutarque, Denys nous apprend aussi que Porsenna offrit à la jeune Romaine, comme souvenir de son acte viril, un cheval de son écurie, harnaché avec un luxe royal. Tite-Live ne mentionne pas ce don ; mais, d'après l'historien latin, le roi des Étrusques aurait fait à Clélie un présent dont la valeur dut être plus appréciée encore de la vierge héroïque qui avait naguère exposé sa vie pour reconquérir sa liberté. Porsenna, donnant à Clélie une partie des otages qu'il retenait dans son camp, lui aurait permis de les choisir elle-même. Avec une délicatesse toute féminine, la noble jeune fille aurait désigné les otages dont la jeunesse exposait le plus l'innocence. La paix rétablie, dit
Tite-Live, les Romains, récompensant dans une femme
un courage extraordinaire par un genre d'honneur extraordinaire, lui
consacrèrent une statue équestre. Au sommet de la Voie sacrée, fut placée
l'image de la vierge montée sur un cheval[43]. Denys d'Halicarnasse ajoute que cette statue fut élevée à Clélie, par les pères des autres jeunes filles qui avaient été envoyées avec elle comme otages[44]. Nous voyons ainsi que, malgré leur indomptable énergie, les Romains admirèrent l'héroïne qui, même au péril de l'intérêt public, avait courageusement préservé son honneur. La chasteté était la première vertu que ces austères citoyens cultivassent dans leurs filles. Ils se distinguaient ainsi de ces Lacédémoniens chez lesquels, nous le rappelions tout à l'heure, la vierge était exercée à des luttes gymniques qui n'accroissaient la force de la Spartiate qu'en étouffant la pudeur de la femme. Le nom seul de Virginie ne nous fait-il pas souvenir du prix qu'attachaient les Romains à l'innocence de leurs filles ? Appius Claudius, le plus odieux des décemvirs, aperçut à une école du Forum une belle jeune fille qui y lisait : c'était la fille de Virginius, l'un des premiers centurions de l'armée qui occupait l'Algide. Virginius était le vivant modèle des vertus militaires et privées. Naguère, une femme digne de lui l'aidait à élever leur fille[45] suivant les principes qui étaient l'honneur de leur foyer ; mais un jour vint où la matrone fut arrêtée par la mort dans sa mission de mère éducatrice : le père continua seul l'œuvre commencée à deux. Mais lorsque le centurion se trouvait à l'armée, la jeune fille était deux fois orpheline. A l'époque qui nous occupe, bien que Virginius fût à son poste, il n'avait pas laissé sa fille sans protecteurs. Le frère de sa femme, Numitorius, était à Rome, ainsi que le fiancé auquel le centurion avait promis sa fille à l'ancien tribun Icilius. Appius Claudius ne put voir Virginie sans un trouble profond. Obligé de passer souvent devant l'école du Forum, il entretenait ainsi la passion coupable qui s'était allumée en lui, et qu'il ne pouvait satisfaire par des moyens honnêtes. Marié lui-même, il aimait la fiancée d'un autre. D'ailleurs Appius, l'un des auteurs de la loi qui interdisait le mariage entre les patriciens et les plébéiens, Appius ne pouvait violer, comme homme, la défense qu'il avait établie comme décemvir. Il résolut donc d'enlever Virginie à son père. Tandis que le centurion défendait sa patrie à l'armée de l'Algide, l'un des maîtres de Rome allait tenter de profaner son foyer[46]. Après avoir vainement essayé de captiver la jeune fille, le décemvir eut recours à la force. Virginie allait au Forum. Soudain un client d'Appius, Marcus Claudius, la réclamant comme son esclave, met la main sur elle, et déclare que, si elle refuse de le suivre, il saura l'y contraindre. La jeune fille demeure muette d'effroi, mais les cris de sa nourrice, qui invoque la protection des Romains, attirent la foule, et cette foule s'émeut et s'indigne. Cette jeune fille, cette innocente victime, c'est l'enfant de Virginius, c'est la fiancée ces deux citoyens si chers au peuple. Tous les hommes qui environnent Virginie deviennent pour elle autant de protecteurs. Désormais la jeune fille n'a plus rien à craindre de la violence de Marcus. Mais ce dernier cite Virginie devant le tribunal d'Appius. Suivant l'avis de ses défenseurs, la jeune Romaine les y accompagne. Alors Marcus, répétant la leçon que le décemvir lui a apprise, prétend que Virginie est née dans sa maison, qu'elle est fille de son esclave[47], et que celle-ci l'a donnée à la femme de Virginius. Numitorie, qui était privée du bonheur de la maternité[48]. Les défenseurs de Virginie demandent qu'il soit sursis au jugement jusqu'à ce que Virginius, absent pour le service de l'État, ait pu revenir à Rome. Mais Appius déclare que, par respect même pour la loi, il doit, en attendant l'arrivée de Virginius, remettre la jeune fille à celui qui la réclame. A ce moment, la foule s'écarte, et livre passage au fiancé et à l'oncle de Virginie[49]. Les licteurs veulent repousser Icilius malgré ses cris. C'est par le fer qu'il te faut
m'éloigner d'ici, Appius, pour que tu tiennes caché ce que tu veux celer,
dit au décemvir le fiancé de Virginie. Je dois
épouser cette vierge, et avoir en elle une femme pudique. Ainsi, convoque à
la fois tous les licteurs de tes collègues, ordonne de préparer les verges et
les haches : la fiancée d'Icilius ne demeurera pas hors de la maison de son
père. Non, si vous nous avez enlevé l'aide tribunitienne et l'appel au peuple
romain, ces deux arches où se gardait la liberté, il n'a pas été donné
pouvoir à votre passion sur nos enfants et sur nos compagnes. Exercez votre
fureur sur nos corps et sur nos têtes : que la pudeur, au moins, soit en sûreté.
Si la violence est employée contre cette jeune fille, moi, devant les
Quirites, pour ma fiancée ; Virginius, devant les soldats, pour sa fille
unique, nous implorerons la protection de tous les dieux et de tous les
hommes ; et tu ne rendras cet arrêt qu'en nous massacrant. Je te le demande,
Appius, considère de plus en plus jusqu'où tu t'avances. Virginius verra ce
qu'il fera pour sa fille. Qu'il sache seulement ceci : que s'il fait défaut
aux vengeurs de sa fille, il ait à chercher un autre parti pour elle. Moi,
pour réclamer la liberté de ma fiancée, la vie me manquera plutôt que la fidélité[50]. Virginie avait trouvé dans son fiancé un protecteur, un sauveur. La liberté lui était rendue jusqu'au lendemain : et, avec un enthousiasme qui avait arraché des pleurs à Icilius, la foule entière avait offert de répondre pour elle ; mais la caution de ses proches avait suffi. Le frère d'Icilius et le fils de Numitorius courent au camp pour y chercher Virginius. Ils y volent : si le centurion n'est pas de retour le lendemain, c'en est fait de sa fille. Le lendemain, ceux des décemvirs qui se trouvent au camp reçoivent d'Appius l'avis de ne donner aucun congé i Virginius, et de le tenir sous leur garde ; mais il est trop tard, le centurion est parti[51] ! L'aube répand sur la cité romaine ses clartés blanchissantes : et déjà le peuple est réuni au Forum. A cette lueur sépulcrale, on voit s'avancer un cortège en deuil. Un homme, un vieux soldat, conduit une belle jeune fille : tous deux sont misérablement vêtus. Des femmes, un grand nombre de défenseurs, accompagnent Virginius et sa fille. Le triste cortège fait le tour de la place publique, et le centurion implore pour son enfant la protection des Romains. Il fait plus : cette protection, il leur en impose le devoir comme le paiement d'une dette, lui qui combat chaque jour pour leurs enfants et pour leurs femmes, lui dont les valeureux faits d'armes n'ont été dépassés par nul autre soldat. Et Virginius demande à quoi sert ce courage si, dans une ville qui est debout, les enfants des Romains ont à supporter ce qu'il y a de plus à redouter dans une ville prise d'assaut. Le fiancé joignait ses prières à celles du père. Mais rien ne touchait plus la foule que le silence et les larmes de Virginie et des femmes qui l'accompagnaient. Ce fut au milieu de cette émotion populaire qu'Appius monta sur son tribunal. Comme s'il voulait jeter un défi à la foule agitée et hostile qui se pressait au Forum, il ne laissa même pas Marcus achever sa requête, et lui adjugea comme esclave la fille de Virginius[52]. Une morne stupeur accueille cet arrêt. Forçant le groupe de matrones qui entoure virginie, Marcus va saisir la jeune fille ; et les lamentations des femmes s'élèvent au milieu du silence de la foule. Mais le centurion, étendant la main vers le décemvir, lui dit : C'est à Icilius, non à toi, Appius, que j'ai fiancé ma fille ; et c'est pour l'hymen, non pour la honte, que je l'ai élevée[53]. Avec une amère indignation, Virginius demande à l'oppresseur s'il lui plaît de se ravaler au rang des brutes pour satisfaire ses passions ; et le vieux soldat ajoute : Si ceux qui sont ici le souffrent, je n'en sais rien ; mais j'espère qu'ils ne le souffriront pas, ceux qui ont des armes[54]. Des armes ! ils étaient loin, ceux qui les portaient, les fiers soldats de l'Algide, les compagnons de Virginius ! Ici la jeune fille n'était défendue que par les femmes et les avocats qui repoussaient loin d'elle le misérable complice d'Appius. Le héraut ramène le silence, et le décemvir déclare que non-seulement par la violence d'Icilius et de Virginius, mais encore par des indices certains, il sait qu'un complot menace la sécurité de Rome. Cette sécurité, il saura la défendre. Des hommes armés sont là, non pour menacer les citoyens paisibles, mais pour châtier les factieux. Se tenir tranquille sera donc meilleur, ajoute-t-il. Va, licteur, écarte la foule et donne passage au maître pour saisir l'esclave[55]. A l'accent plein de colère qui vibrait dans ces paroles, la multitude, frappée de terreur, s'écarte pour laisser passer Marcus : les Romains ont abandonné Virginie. Le centurion le comprend. Lui aussi, il semble fléchir. Il prie Appius de pardonner à la douleur d'un père les invectives qu'il a dirigées contre lui ; puis il lui demande la permission d'interroger la nourrice en présence de la jeune fille. Si réellement il n'est pas le père de Virginie, il abdiquera de meilleure grâce les droits qu'il avait sur elle. Le décemvir consent. Alors Virginius conduit sa fille à l'écart, près des boutiques du Forum. Se saisissant du couteau d'un boucher : Ceci, dit-il, est la seule manière dont je puisse, ma fille, te rendre la liberté ![56] Le fier Romain plonge son couteau dans le sein de la vierge ; et tournant alors son regard vers le cruel décemvir, le père laisse éclater dans une terrible imprécation le désespoir qui l'anime : Par ce sang, Appius, je dévoue ta tête aux dieux infernaux ![57] Le cri que jette la foule est le réveil du peuple romain ; c'est le rugissement du lion qui sort de son sommeil. En vain le décemvir ordonne-t-il l'arrestation de Virginies, le peuple suit le centurion qui, le fer à la main, s'est frayé un passage, et qui atteint les portes de la ville. Icilius et Numitorius soulèvent dans leurs bras le corps de la victime, ce corps que protège désormais le sceau inviolable de la mort. Tout en montrant au peuple la pille vierge qu'ils portent à travers la foule, ils gémissent sur le crime d'Appius, sur cette malheureuse beauté qui en a été la cause, sur la nécessité qui a contraint un père d'immoler la vie de sa fille afin de sauvegarder l'honneur de la vierge. Et tandis qu'ils portaient le corps de Virginie, les matrones les suivaient et se lamentaient. Elles demandaient en criant si c'était pour un pareil sort que l'on mettait des enfants au monde, et si telle était la récompense de la pudicité. En Icilius, la douleur du fiancé, loin d'abattre l'énergie du Romain, donnait à ce courage civique un aliment de plus. Ainsi que les hommes qui l'entouraient, mais plus qu'eux encore, il réclamait les libertés que Rome avait perdues. Devant la tyrannie qui, non contente d'abaisser les citoyens, ne respectait même pas la pureté des jeunes filles, Icilius et ses compagnons pensaient surtout à la honte de la patrie[58]. L'âme des vengeurs de Lucrèce renaît dans la vieille Rome. Le peuple repousse les licteurs qui, suivant l'ordre d'Appius, vont arrêter Icilius et Numitorius ; le peuple les empêche aussi de recueillir le corps de Virginie[59]. Le combat s'engage, et le décemvir est obligé de fuir son tribunal[60]. De magnifiques funérailles sont faites à Virginie. Au Forum même, la jeune morte est déposée par ses parents sur un lit de parade décoré avec splendeur. De la place publique, le corps est porté comme en triomphe à travers les rues les plus habitées. Matrones et vierges quittaient leurs maisons pour honorer de leurs larmes celle dont la mort avait préservé la pureté. Les unes jetaient sur le lit funèbre des fleurs et des couronnes ; d'autres, leurs bandelettes et leurs ceintures ; il en était qui offraient à la douce victime des tresses de leurs cheveux. Les hommes, ces graves Romains qui, alors même, changeaient leur constitution politique, ne dédaignaient pas, à cette heure solennelle, de chercher dans les boutiques voisines de petits objets avec lesquels ils ornaient la couche funèbre de la jeune vierge. Ce spectacle vivifia encore la généreuse indignation de Rome[61]. Et pendant que ces scènes animaient la cité, Virginius,
tout couvert encore du sang de sa fille, tenant encore à la main l'arme de
son parricide, Virginius gagnait le camp avec une escorte de quatre cents
citoyens. Ses larmes seules parlent d'abord pour lui ; puis il raconte
l'horrible événement qui vient de s'accomplir. Suppliant ses frères d'armes,
il demande qu'ils ne lui attribuent pas ce qui est
le crime d'Appius Claudius, qu'ils ne se détournent pas de lui comme du
meurtrier de son enfant. L'existence de sa fille lui eût été plus chère que
la sienne s'il avait été permis qu'elle vécût libre et pure. Lorsqu'il l'a vu
entraîner à la honte comme une esclave, il a cru meilleur de perdre son
enfant par la mort que par l'opprobre ; en lui, la miséricorde est tombée
dans l'apparence de la cruauté. Il n'eût pas survécu à sa fille s'il n'avait
pas eu l'espoir de venger la mort de celle-ci avec l'aide de ses compagnons
d'armes. Eux aussi ont encore des filles, des sœurs, des épouses : la passion
d'Appius Claudius n'est pas éteinte avec sa fille ; mais elle sera d'autant
plus effrénée qu'elle aura été impunie. Par le malheur d'autrui, un
enseignement leur est donné pour qu'ils se gardent d'une semblable injure.
Quant à ce qui le concerne, sa femme lui a été ravie par le destin ; sa
fille, pour qu'elle ne fût pas plus longtemps vivante que pure, est couchée
morte dans le tombeau, malheureuse, mais honnête. Il n'y a dès lors plus de
place dans sa maison pour la passion d'Appius... Que les autres veillent sur eux et sur leurs enfants[62]. Et l'armée s'écrie qu'elle ne fera défaut ni à la douleur de Virginius, ni à sa propre liberté. La chute des décemvirs, le rétablissement du tribunat et de l'appel au peuple, répondent à cette promesse. Virginius, élevé comme Icilius à la puissance tribunitienne, devient le juge de celui qui l'a rendu parricide. C'est au Forum, c'est au lieu même où Appius a traité Virginie comme une captive de guerre[63], c'est au lieu même où il a forcé un père de tuer sa fille, c'est au Forum qu'Appius entend s'élever contre lui la voix vengeresse de ce père. C'est de là qu'il est jeté dans la prison où, devançant son arrêt, il se donne la mort. Ainsi périt celui des collègues d'Appius qui s'est plus particulièrement associé à sa tyrannie ; les autres décemvirs sont exilés. Marcus Claudius, l'affidé d'Appius, ne doit qu'à la générosité de Virginius la grâce d'échapper par le bannissement à une sentence de mort. Sans doute le père de Virginie jugeait que le client d'Appius n'avait pu qu'obéir aveuglément à celui qui joignait à l'autorité toute-puissante du patron le despotisme du décemvir. Et, dit Tite-Live[64], les mânes de Virginie, plus heureuse morte que vivante, après avoir erré à travers tant de maisons pour réclamer des châtiments, se reposèrent enfin quand nul coupable ne resta. Vivante ou morte, c'est toujours comme une ombre silencieuse et triste que Virginie traverse les grands événements dont elle est la cause. Elle ne parle que par ses larmes[65]. C'est bien la vierge romaine, l'être pur et sacré qu'un peuple entier saura venger, mais qui, à l'heure même des suprêmes périls, n'osera pas élever la voix hors du foyer. Bien des siècles plus tard, un fils de l'Italie moderne
reproduisit sur la scène le type de l'antique héroïne de sa race. Il lui
donna des sentiments dignes d'une Romaine, et les lui fit exprimer dans un
fier langage. Les nécessités de l'action dramatique ne permettaient pas à
Alfieri de faire de Virginie un personnage muet comme celui de Tite-Live.
Mais il nous semble entendre, en l'écoutant, une matrone plutôt qu'une vierge
romaine. La matrone seule aurait pu, sans violer les convenances, défendre
elle-même sa cause. Reportons-nous encore vers la Virginie de Tite-Live.
Quand Marcus veut s'emparer d'elle, elle ne parle pas, elle ne crie même pas
; elle demeure immobile de stupeur, et c'est sa nourrice qui invoque l'aide
des Romains. Mais dans la tragédie italienne, avec quelle fière protestation
Virginie repousse celui qui ose la réclamer comme esclave ! Et si cependant, dit-elle, nul
défenseur ne surgit, force vous sera, bourreaux, de m'égorger ici avant de me
mener esclave. Moi, d'un père héroïque, certes, je suis la fille. Je sens l'âme
romaine palpiter, libre, dans mon sein. Autre l'aurais-je, bien autre, si de
ton vil pareil j'étais née, esclave plus vile encore ![66] Digue fille de Virgipius, l'héroïne de la pièce italienne est aussi la digne fiancée d'Icilius. Voyons-la traverser le Forum avant l'attentat de Marcus : Jamais, dit-elle, je ne passe par ce Forum sans que de hautes pensées m'arrêtent. C'est là le champ d'où l'on entendit naguère les sentiments libres tonner dans la parole de mon Icilius[67]. Muet aujourd'hui le rend le pouvoir absolu. Oh ! combien sont justes en lui la douleur et la colère ![68] Enfin, c'est la Virginie d'Alfieri elle-même qui, devant le péril que court son honneur, invoque la mort libératrice. Toutefois, les grands sentiments qui font bien réellement palpiter en elle lame romaine n'excluent pas de sa personne le charme si doux, et parfois même la faiblesse de la jeune fille. Aussi y a-t-il, dans ce mélange d'énergie et de grâce, de fierté et de simplicité, de courage et de timidité, un type qui rappelle à la fois et la matrone antique, et la jeune fille moderne, élevée par le christianisme au noble sentiment de son individualité, mais néanmoins enveloppée plus que jamais dans son voile de modestie. L'attitude passive que Tite-Live donne à la sœur d'Horace et à la fille de Virginius ne nous explique-t-elle pas le rôle si effacé que Lavinie joue dans l'Énéide ? Le poète qui, par un brillant effort d'imagination, avait essayé de ressusciter les antiques traditions du Latium, nous offre dans Lavinie un type virginal qui ne dut pas être rare dans les vieilles mœurs romaines. Quatre fois seulement, Lavinie apparait en personne sur la scène de l'Énéide ; et chacune de ces apparitions forme un tableau d'on la jeune fille se détache comme un portrait expressif, mais muet. La première fois qu'elle se présente à nous, elle assiste son père, le roi Latinus, dans un sacrifice domestique. Se tenant auprès de lui, elle brûle des branches de pin sur les autels. Soudain la flamme court dans sa chevelure d'or, la flamme embrase sa parure, son bandeau royal ; la flamme éclate dans les pierreries de sa couronne. Une fumée à la fauve lueur enveloppe les ornements de la vierge. L'incendie se répand dans le palais. Les spectateurs de cette scène imposante sont saisis de crainte, et les devins déclarent que ce prodige annonce à Lavinie un brillant avenir, mais aux sujets de Latinus les périls d'une grande guerre[69]. C'était en effet par sa glorieuse destinée que la future mère du peuple romain devait mettre le feu au royaume de son père. Parmi les cent princes latins et ausoniens qui recherchaient la main de Lavinie, il en était un que chérissait la reine, la mère de Lavinie, la reine Amata : c'était le plus beau de tous, le valeureux et sympathique Turnus. Mais les Immortels s'opposaient, disait-on, au mariage des deux jeunes gens ; et la scène mystérieuse que nous venons de retracer n'était que l'un des mille prodiges par lesquels les dieux manifestaient leur volonté. Les oracles eux-mêmes parlèrent, et, défendant à Latinus d'unir sa fille à Turnus, lui annoncèrent que Lavinie était destinée à un étranger qui, mêlant son sang à celui des Romains, serait le père d'un peuple auquel le monde serait soumis. Au onzième livre de l'Énéide, nous voyons déjà
s'accomplir les destins qui ont présagé, dans la gloire de Lavinie, la source
d'une calamité nationale pour les sujets de son père. Énée, l'époux que lui a
promis le sort, et auquel son père l'a fiancée, Énée ne peut maintenir que
par les armes les droits qu'il a sur elle. Il a contre lui, et Junon, cette
implacable ennemie du Troyen, et la reine Amata, et le héros que protège la
mère de Lavinie. Latinus lui-même a été contraint de subir une guerre que ses
avis n'ont pu prévenir. Déjà l'on s'est battu aux portes de Laurente, la
capitale de son royaume. La fougueuse valeur de Turnus n'a pu faire triompher
les Latins. Après une première défaite, suivie d'une courte trêve, ceux-ci
recommencent le combat. Comme dans l'Iliade, les femmes de la cité assiégée
implorent Pallas dans son temple. Ici, comme à Troie, c'est pour une femme
que s'est allumée la guerre ; mais, dans l'épopée latine, ce n'est plus pour
une épouse coupable, c'est pour une vierge innocente des maux qu'elle a
suscités. Aussi, contrairement à Homère qui, par un sentiment délicat, ne met
point Hélène parmi les femmes qu'il prosterne devant Pallas, Virgile nous
montre-t-il, dans le temple, auprès de la reine, la vierge
Lavinie, cause d'un si grand malheur, et baissant ses beaux yeux[70]. Un nouveau désastre marque pour les Latins la reprise des hostilités. Les Troyens sont aux portes de Laurente, et la nuit seule interrompt le combat. Turnus se dispose à engager avec Énée une lutte à mort dont le vainqueur sera l'époux de Lavinie. La jeune fille entend son père supplier Turnus de renoncer à sa main ; elle est témoin de la fière résistance du jeune homme ; elle voit aussi sa mère conjurer le prince de ménager une vie à laquelle tient la vie même d'Amata. Et, même à cette heure de détresse, alors que les sentiments les plus comprimés font explosion, alors que la reine en pleurs serre dans ses bras le jeune héros, Lavinie se tait. Elle se tait, mais les larmes brûlantes qui coulent de ses yeux, la rougeur qui enflamme ses joues, trahissent son émotion et sa douleur. Sans doute, ce n'est pas pour Énée, ce n'est pas pour cet homme qu'elle n'a jamais vu, et qui ne lui est connu que par le désastre de sa patrie, ce n'est pas pour cet étranger, pour cet ennemi, ce n'est pas pour lui qu'elle souffre et qu'elle pleure. Tout en elle nous dit qu'elle aime Turnus, tout, excepté elle-même ! Et le jeune prince, troublé, attache son regard sur ce beau visage qui inspire au poète de ravissantes comparaisons : Ainsi, dit Virgile, l'ivoire de l'Inde est teint par la pourpre sanglante, ou les grands lis blancs rougissent mêlés à la rose[71]. Plus que jamais, Turnus brille pour le combat. La dernière fois que Virgile évoque l'image de Lavinie, c'est pour nous représenter la jeune fille après la mort violente de sa mère. Ici encore, sa douleur n'a point de paroles, et nous la voyons lacérant ses cheveux d'or et ses joues de rose[72]. Aux dernières lignes de l'Énéide, le sort des combats a donné Lavinie à Énée, ainsi que le reconnait Turnus mourant et disant à son vainqueur : Lavinie est ta femme[73]. Pleura-t-elle la mort de Turnus ? Fiancée du juste. mais froid Énée, ne comparait- elle point celui-ci au noble et ardent jeune homme que sa mère avait chéri comme un fils, et qui avait succombé en la disputant aux dieux, au Destin même ? Le souvenir du mort vint-il lutter contre la présence du vivant ? Le poète nous laisse tout ignorer, fidèle jusqu'au bout au rôle plein de réserve qu'il a donné à Lavinie. Mais à côté de cette figure toute passive le poète a placé un autre type virginal : et tout, dans celui-ci, respire l'action, la lutte : c'est Camille, la guerrière, Camille, la reine des Volsques. Quand arrivent dans le Latium les alliés de Turnus, avec quelle prédilection enthousiaste, de quels traits nobles et charmants, Virgile peint l'entrée de la jeune souveraine ! Après eux arriva, de la nation
volsque, la guerrière Camille conduisant une troupe de cavaliers et de
bataillons brillants d'airain. Elle n'a pas habitué ses mains à la quenouille
ni aux corbeilles de Minerve ; mais la vierge endure les rudes combats, et, à
la course, l'emporte sur les vents. Elle eût volé sur les hautes tiges de la
moisson sans les toucher ; elle n'eût point froissé les tendres épis ; ou, se
soutenant sur la vague gonflée, elle se fût ouvert un passage au milieu de la
mer sans mouiller ses pieds rapides. Les jeunes gens et les mères, se
répandant en foule hors des maisons et des champs, l'admiraient, et, tandis qu'elle
passait, ils considéraient de loin, en s'extasiant, comme l'ornement royal de
la pourpre voilait ses douces épaules, comme la fibule d'or réunissait sa
chevelure, comme elle portait le carquois lycien et le myrte pastoral terminé
en pointe[74]. L'origine volsque que le poète donne à Camille, l'étonnement des Latins en voyant passer la jeune guerrière, nous disent déjà qu'en dessinant ce type Virgile ne le considérait pas comme familier aux ancêtres des Romains. Camille est une Italienne : mais ce n'est pas une femme latine. Et encore le ponte a-t-il soin de nous dire que, même pour ses compatriotes, elle était une brillante exception. Pour expliquer ses habitudes viriles, le poète a recours à une délicieuse légende. Il nous apprend que le père de Camille, Métabe, s'étant attiré la haine de ses sujets par sa tyrannie, fuyait naguère son royaume. Mais au cœur de cet homme superbe vivait un amour : la tendresse paternelle. L'exilé emportait avec lui son enfant, sa fille ; et c'était en la tenant dans ses bras qu'il parcourait les sentiers boisés des montagnes, poursuivi là encore par les flèches que lui lançaient les rebelles. Un cours d'eau se présente à l'exilé : mais les pluies ont grossi les eaux de l'Amasène. Métabe va s'élancer à la nage... il s'arrête... Comment se soutiendrait-il sur les ondes, chargé de son doux et cher fardeau ?... Indécis, il réfléchit... Et cependant ses ennemis le pressent et vont l'atteindre peut-être... Une de ces idées hardies que suggèrent le péril et le désespoir traverse son esprit... Il attache fortement à sa javeline un berceau d'osier dans lequel est déposée sa fille. Alors, balançant l'arme et la corbeille, il voue à Diane l'enfant qu'il va exposer à un suprême danger ; puis, ramenant son bras en arrière, il jette la javeline et le berceau par-dessus l'Amasène. Métabe s'élance dans le fleuve, il atteint l'autre rive, et, triomphant, arrache du gazon la javeline et la vierge[75]. Camille vit, mais elle appartient à Diane. Qui donnera à l'enfant le lait nourricier ? Métabe charge de ce soin une cavale sauvage ; et cet homme si farouche, trouvant dans son amour toutes les sollicitudes d'une mère, presse contre les lèvres de la petite fille les mamelles de l'animal. Métabe n'oublia pas le vœu qu'il avait formé, et Camille savait à peine marcher que, vêtue d'une peau de tigre qui couvrait sa tête et son corps, elle portait l'arc sur l'épaule, et les dards dans sa petite main. Enfant, elle abattait les grues et les cygnes, et se préparait ainsi au jour.oil les hommes devaient tomber sous sa hache guerrière, sans que le cœur de la femme éprouvât un tressaillement de pitié devant l'appel désespéré du vaincu. Jeune fille, elle demeura fidèle à sa déesse, et ce fut en vain que les femmes des cités tyrrhéniennes la désirèrent pour bru. Et, continue la légende, Diane ne fut pas ingrate ; elle aima tendrement la vierge guerrière, celle que Turnus nommait avec admiration la gloire de l'Italie ; et, dans la lutte décisive où Camille réclama et obtint l'honneur de combattre au premier rang, si la déesse ne put détourner le trait sous lequel succomba la jeune reine, du moins elle enleva son corps dans un nuage, vaporeux linceul virginal, et transporta la fille de Métabe dans le tombeau de ses ancêtres. Déjà Diane avait vengé sa fidèle adoratrice : le Troyen qui avait frappé Camille, et qui, effrayé de sa victoire, fuyait l'héroïne abattue, fut arrêté dans sa course par une flèche meurtrière. Un dernier détail nous prouve combien le type de la vierge guerrière était exceptionnel pour les Latins. Quand la jeune souveraine est tombée et que les Troyens sont aux portes de Laurente, les femmes latines, exaltées par l'exemple que leur a donné Camille, lancent des traits et des pieux contre l'envahisseur, et se disputent la gloire de mourir pour la défense du sol natal. Mais ces femmes, sont-ce des jeunes filles ? Non. Le poste nous dit que ce sont des mères. La vierge latine pleure à son foyer : elle ne se bat point. Pour faire revivre Lavinie, Virgile n'avait eu qu'à regarder autour de lui, dans les rares familles où se conservait encore de son temps le vieil esprit romain. Mais pour trouver le type de Camille le ponte avait dû regarder en lui-même, dans cette brillante imagination qu'avait séduite le mythe des Amazones. Combien toutefois les figures virginales que viennent de nous livrer l'histoire légendaire et la poésie nous semblent inférieures à ces types de jeunes filles que nous admirions naguère, soit dans nos livres sacrés, soit dans les épopées de l'Inde et de la Grèce : Rébecca, Damayanti, Sacountalâ, Nausicaa ! Sans doute, pour juger des mœurs primitives de Rome, les documents contemporains nous manquent ; si ceux-ci fussent parvenus jusqu'à nous, peut-être nous eussent-ils révélé des physionomies plus expressives que celles qui nous sont apparues. Néanmoins, il est permis de supposer que le rigoureux formalisme des anciennes coutumes romaines n'eût guère permis le libre développement de cette spontanéité à la fois naïve et contenue, de cette vivante personnalité qui caractérisent chez les peuples primitifs le rôle de la jeune fille, et qui dénotent, ici, un souvenir de l'époque patriarcale ; là, l'influence immédiate de ce temps béni où les qualités natives de l'âme s'épanouissaient librement sous le regard paternel du Dieu de la Genèse. |