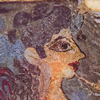LA FEMME GRECQUE
TOME DEUXIÈME
CHAPITRE VI. — ŒUVRES DES FEMMES DANS LA POÉSIE, DANS LES ARTS, ET DANS LES SCIENCES MORALES.
|
Les neuf Muses terrestres. — Sappho. L'île de Lesbos. Portrait de Sappho d'après une médaille mytilénienne. Caractère de la poétesse et de ses chants. Ode à la rose. Sappho et sa fille. Sappho et Alcée. Difficulté de réhabiliter la Muse lesbienne. Opinion de Sappho sur la fortune. Ses vers à une femme ignorante. Gloire de Sappho. — Érinne. Sa pure renommée. Ode à Rome, poème restitué à Mélinno. — Télésilla. — Myrtis, institutrice de Pindare ; et Corinne, rivale de ce poète. — Mossis. — Praxilla. — Anyté. — Mœro. — Autres poétesses : Cléobuline ; Mégalostrata, chantée par Alcman ; etc. ; Irène et une inscription grecque. Artistes. Cora et l'invention de la plastique. Femmes peintres : Timarète, Irène, etc. ; Lalla de Cyzique et une peinture de Pompéi. Prosatrices. Les Pythagoriciennes Théano, Damo, Arignoté, Périetioné et Phintys. Lettres de Théano sur divers sujets de morale. Fragments de livres dus à Théano, à Périctioné, à Phintys, et concernant les sciences morales. Conclusion de l'ouvrage. Non moins que dans l'histoire, les Éoliennes et les Doriennes manifestèrent dans les lettres, les remarquables facultés qu'avait développées leur éducation. C'est surtout parmi elles que nous trouverons les poétesses, qui furent nommées par le poète Antipater les neuf Muses terrestres. Nous sommes dans une île de l'Archipel, île dont le sol paraît reposer sur une base volcanique. Que de contrastes dans l'aspect de Lesbos ! A l'occident, parmi les sombres déchirures de la côte, s'étend la colline d'Érèse dont le froment eût été digne des dieux si les Immortels ne se fussent nourris d'ambroisie ; et sur les coteaux de la même colline, les vignes qui donnent le meilleur vin de la Grèce, inclinent jusqu'à la terre leurs pampres opulents. A l'intérieur de Lesbos, même opposition dans le caractère du paysage. Les montagnes, sombres toujours, se revêtent de forêts ou restent nues et désolées. Après des vallons égayés par des tamaris et des lauriers-roses, et où les peupliers bordent les ruisseaux, le voyageur rencontre avec effroi les rocs et les torrents. Mais sur la côte orientale, celle qui regarde les belles rives de l'Ionie et où se trouve Mytilène, tout sourit au regard. Les coteaux qui descendent jusqu'à la mer, sont couverts de blés, d'oliviers, d'orangers et de myrtes. Ici, doucement hospitalière, l'île ouvre au navigateur son golfe immense, coupe d'azur où ondulent les flots dorés de la lumière, et que ceint gracieusement une couronne de forets et de montagnes. L'air est pur et doux ; et néanmoins, même dans cette ravissante contrée, les vents déchaînés soufflent parfois la mort[1]. Telle est la patrie de Sappho, cette femme dont le génie tour à tour ardent et placide, réunit tous les contrastes du sol où il se déploya. Née à Mitylène (612 av. J. C.), dans la plus belle partie de l'île, Sappho grandit dans cette atmosphère de poésie, d'art et d'amour, où nageait Lesbos, Lesbos qui croyait être l'héritière d'Orphée, Lesbos qui produisit Terpandre et Alcée, Lesbos qui établissait entre ses filles des concours de beauté ! Sappho chanta, elle aima ; et trop souvent son génie ne fut que l'écho de ses passions. Quoique petite et brune, elle était belle. Si les médailles mytiléniennes qui la représentent[2], reproduisent exactement sa figure, sa physionomie correcte et souriante respirait, non le trouble et l'égarement du cœur, mais la sérénité de l'esprit. La tête, coiffée du saccos, a un embonpoint qui ne dérange pas l'harmonie des traits, mais qui leur donne un caractère plus gracieux qu'idéal. Le regard, il est vrai, est intelligent et beau ; mais il lui manque la flamme divine[3]. Ce portrait seul témoignerait que Sappho pensa plus à la terre qu'elle ne rêva du ciel. C'est à la terre, en effet, qu'elle s'attacha. Elle décrivit les charmes de la nature : l'aurore qui éveille l'activité matinale, le soir qui ramène au foyer les hommes et les troupeaux ; la nuit éclairée par la douce lueur de la lune. Elle se plut à entendre la source qui bruit sous les pommiers odorants. Elle admira la rose, la rose qui devait symboliser sa poésie dans la Couronne de Méléagre[4], et dont elle devait elle-même ceindre les fronts des Muses[5], plus habituées jusqu'alors au chaste laurier d'Apollon qu'à la fleur de Vénus. Si Dieu avait voulu attribuer la royauté aux fleurs, il aurait couronné la belle rose. La rose est la parure de la terre, l'éclat du feuillage, l'œil des fleurs, la rougeur qui colore les prés, une beauté étincelante ; elle exhale l'amour, elle est l'hôte de Vénus, elle se pare de ses feuilles parfumées, s'enorgueillit de ses mobiles pétales ; le pétale sourit au zéphyr[6]. C'est encore sur la terra que s'arrête Sappho soit que, dans ses épithalames, elle chante l'hymen païen ; soit qu'elle découvre les blessures de son cœur et que, pour attirer l'objet de sa passion, elle implore le secours de Vénus, sa souveraine. Jeune et veuve, nul frein ne la retint dans ses coupables attachements, pas même la pensée de sa fille, cette Cléis qu'elle aimait si tendrement : J'ai une belle enfant, d'une élégance semblable à celle des fleurs dorées, Cléis, ma Cléis chérie. En échange d'elle, je ne voudrais ni de toute la Lydie, ni de l'aimable Ionie[7]. On a voulu disculper la mémoire de Sappho[8] ; on a dit qu'une femme méprisable n'eût pas osé reprocher à son frère d'avoir affranchi une courtisane[9] ; qu'elle n'eût pas été nommée par Alcée : couronnée de violettes, chaste Sappho au doux sourire[10] ; qu'elle n'eût pas inspiré à un homme aussi léger, l'amour timide qui se lit dans ce dialogue que cite Aristote : Je veux dire quelque chose, mais la honte m'arrête, disait Alcée à Sappho. Et la poétesse répondait : Si la passion des choses bonnes ou belles te possédait, ni la crainte de dire quelque chose de mal ne troublerait ta langue, ni la honte tes regards ; mais tu parlerais de ce qui est juste[11]. On On a ajouté que la réponse même de Sappho était celle d'une femme honnête, et que d'ailleurs ses contemporains ne lui imputèrent jamais les souillures que dévoilèrent des écrivains postérieurs. A l'honneur de notre sexe, nous voudrions croire que la plus illustre des poétesses ne fut pas la plus coupable des femmes ; malheureusement ce qui nous reste de ses neuf livres, témoignerait encore contre elle à défaut d'autres accusateurs. Pour que Sappho fût réhabilitée, il faudrait retrancher de ses poésies cette ode qui est le chef-d'œuvre de son talent, mais la honte de sa vie. Malgré la célébrité de ce fragment poétique, on nous permettra de ne pas le traduire dans une œuvre écrite par une femme et consacrée à la femme. Nous aurons d'autant moins d'indulgence pour Sappho que le sentiment moral n'est pas toujours absent de ses œuvres. En faisant le mal, elle connaissait cependant le bien. Elle n'ignorait point que seule la beauté immatérielle n'exerce pas une impression éphémère. Si elle aimait la mollesse, elle prétendait que ce goût n'entravait pas en elle l'élan du bien et du beau. Si l'opulence lui semblait précieuse, elle disait toutefois : La richesse sans la vertu n'est pas une innocente voisine ; mais le mélange de l'une et de l'autre est le suprême degré du bonheur[12]. Enfin, si les croyances et les mœurs où fut élevée Sappho, ne purent lui donner la notion de la vie éternelle, elle comprit du moins que les jouissances du luxe étaient passagères. C'est avec une juste fierté qu'elle s'adresse ainsi à une femme ignorante : Morte, tu seras gisante dans le tombeau. Ta mémoire n'existera pas pour la postérité, car tu n'as pas joui des roses des Piérides ; mais obscure, tu erreras dans les demeures d'Adès, voltigeant sur le sol des aveugles ombres[13]. Et voyant des femmes se glorifier de leur fortune et de leur beauté, Sappho leur dit que le bonheur qu'elle devait aux Muses, était le seul qui fût réel et désirable, et que son souvenir survivrait à sa mort[14]. La postérité ne fut pas avare pour la poétesse qui avait compté sur elle. Nous avons vu ses compatriotes graver leurs monnaies à son image. La Grèce l'honore comme une dixième Muse, lui élève des statues jusqu'en Sicile ; et comme par un souvenir de son ode & une femme ignorante, les épitaphes qui lui sont consacrées dans l'Anthologie, rappellent que si ses cendres reposent dans le tombeau, ses poèmes ont conquis l'immortalité[15]. Toutefois, parmi les élèves que la Muse éolienne groupa autour d'elle, il en est une qui éveilla chez les poètes grecs un sentiment plus respectueux et plus tendre que celui qu'ils éprouvèrent pour Sappho : c'est Érinne[16], la vierge modeste. Abritée par l'ombre du foyer, filant ou tissant, elle méditait, à l'insu d'une mère sévère, le poème où elle chanta l'un des instruments de son labeur, la quenouille ! Si le temps avait épargné ces vers, il eût été intéressant de les comparer à ceux que Théocrite écrivit sur le même sujet, et que nous avons traduits plus haut. L'œuvre d'Érinne était composée en hexamètres qui furent égalés à ceux d'Homère. Autant Érinne était inférieure à Sappho dans la poésie lyrique, autant elle lui fut jugée supérieure dans les hexamètres de la Quenouille. Une puissante inspiration morale animait sans doute ce morceau ; et la forme devait être digne de la pensée chez la poétesse qui fut surnommée sobre de paroles. Les potées comparaient à un rayon de miel, le travail polir lequel la gracieuse abeille avait butiné parmi les fleurs de l'Hélicon. Ils respiraient aussi dans cette production virginale, la fraîcheur et le parfum du printemps. Ils assimilaient encore les accents de la jeune fille à la voix si douce avec laquelle, suivant une croyance populaire, le cygne chante sa mort prochaine : rapprochement trop juste, hélas ! pour cette poétesse qui mourut à vingt ans ! Par une allusion à son chef-d'œuvre, on put dire que la Parque dont la quenouille retient les fils de la vie humaine, avait enlevé Érinne. On déplora que ce trépas prématuré l'eût empêchée de s'élever au-dessus de tous les poètes. Son image, modeste et pensive, inspira le sculpteur[17]. Que ne peut-on exhumer sa statue ! Et que ne peut-on surtout retrouver les œuvres de cette pure jeune fille qui sut comprendre que, chez la femme, le génie ne doit être qu'une vertu de plus ! On a longtemps attribué à Érinne une ode remplie de vigueur et d'éclat, et adressée à Rome, appellation qui aurait désigné alors, non la ville qu'Érinne ne pouvait connaître, mais la Force dont le nom grec lui est synonyme[18]. On restitue maintenant ces vers à une autre poétesse, Mélinno de Lesbos, et on y lit l'expression de l'enthousiasme reconnaissant qu'inspira aux Hellènes la grande cité qui, cent quatre-vingt-quinze ans avant Jésus-Christ, se servit de sa puissance non pour les asservir, mais pour les délivrer. Je te salue, Rome, fille de Mars, couronnée de la mitre d'or, reine belliqueuse, qui habites sur la terre un auguste Olympe toujours invulnérable. A toi seule la Parque vénérable a donné la gloire royale d'une indestructible domination, afin qu'ayant la force souveraine, tu commandasses. Par de solides courroies, ton joug étreint les plaines de la terre et de la mer blanchissante ; tu diriges sûrement les villes des peuples. Le temps renverse tout ce qu'il y a de plus grand, et transforme la vie tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Toi seule, le vent qui remplit la voile de ta puissance ne change pas. Toi seule entre toutes, tu enfantes les hommes les plus forts, les grands guerriers ; chargée de beaux épis comme la terre de Cérès, tu produis le grain des hommes[19]. Après avoir salué dans Érinne le mélange de la beauté morale et de la beauté intellectuelle, honorons la même alliance dans une femme qui nous est déjà apparue parmi les héroïnes de l'histoire. Née dans une illustre famille, Télésilla était d'une constitution faible. Ayant demandé aux dieux comment elle pourrait remédier à cette délicatesse physique, les Immortels lui conseillèrent de servir les Muses[20]. Admirable symbole de l'influence salutaire qu'exerce sur la santé la sage culture de l'intelligence ! La force que l'esprit acquiert, la sereine lumière où il se baigne, lui donnent une puissance de vie et de bonheur qui rejaillit sur le corps ; et l'harmonie de celui-ci répond aussi à l'harmonie de celui-là. Télésilla trouva la santé dans ses occupations littéraires[21] ; elle y puisa plus encore. Quand l'amour du beau a saisi une âme, cette âme a soif de le manifester, non-seulement par la parole, mais encore par l'action. Et au jour d'un péril national, Télésilla, exaltée par un généreux patriotisme, communique à ses compagnes la flamme qui l'anime elle-même, et, à leur tête, fait reculer l'ennemi. Ce n'est que par l'imagination que les trois premières Muses terrestres ont vécu sur l'Hélicon. Mais, dans le voisinage de la montagne sacrée, naissent deux femmes dont l'une devient l'institutrice de Pindare ; l'autre, l'heureuse rivale du grand poète. Est-ce de la Muse aux chants si doux[22], est-ce de Myrtis, que le génie de Pindare reçut cette majesté et cet éclat que l'on dirait puisés aux sources bibliques ? Nous ne savons quelle fut sur Pindare l'influence de cette poétesse ; mais une élève de Myrtis, la célèbre Corinne, donna à son jeune condisciple des avis où nous ne saurions reconnaître l'inspiration spiritualiste que devait suivre Pindare. Corinne reprochait à ce dernier de trop s'attacher à la forme des vers, et de négliger l'âme de la poésie, cette âme qui, pour elle, chantre de ses dieux nationaux et du bouclier de Minerve, ne résidait pas néanmoins dans les pensées, mais vivait dans les fictions. Pénétré de ce conseil, Pindare composa une ode au début de laquelle étaient entassés tous les souvenirs mythologiques de Thèbes. Comme il la lisait à Corinne, la poétesse sourit, et lui donnant une leçon dictée par ce goût si sobre qui caractérisait le génie grec, elle lui fit remarquer qu'on devait ensemencer avec la main, et non à plein sac. Malgré les critiques que Corinne n'épargnait pas à son compagnon de travail, elle admirait tant le génie du poète qu'elle blâma leur maîtresse Myrtis d'avoir osé concourir avec lui. Elle eut du reste la même témérité, et cette audace fut encouragée. Cinq fois Corinne vainquit Pindare ; mais s'il faut en croire Pausanias, elle dut une partie de ce succès à l'idiome éolien qu'elle employait, et qui était plus familier aux Thébains que le dialecte dorien dont se servait son rival. Quant à l'autre partie de ce triomphe féminin, le voyageur grec crut en voir la cause en contemplant au gymnase de Tanagre, patrie de Corinne, un tableau où la poétesse, couronnée de bandelettes qui rappelaient ses victoires lyriques sur Pindare, apparaissait dans l'éclat d'une beauté incomparable. Avec un amour-propre tout masculin, Pausanias pensa donc que les charmes de la femme avaient plaidé la cause de ses vers. La tombe de la poétesse qui seule avait composé des hymnes à Tanagre, occupait dans cette ville une place d'honneur. Ainsi les anciens gardaient au milieu d'eux les restes de leurs concitoyens illustres, comme pour recueillir au foyer de leur vie nationale les cendres même du génie et de la gloire[23]. Après avoir mentionné les poésies que Corinne consacra au bouclier de la belliqueuse Minerve[24], Antipater nomme, peut-être avec l'intention d'établir un contraste, Nossis aux accents efféminés[25]. Dans la Couronne anthologique de Méléagre, les épigrammes de cette poétesse sont symbolisées par l'iris à la pénétrante senteur. Nous pouvons déjà nous représenter par ces deux citations, la mollesse et le parfum qu'avaient les vers de Nossis, simples et gracieux d'ailleurs. Comme Sappho, Nossis chanta la puissance de l'amour ; comme Sappho aussi, elle célébra sa fille Ajoutons cependant que si, devant le portrait de Mélinna, elle loue le joli visage qui semble la reconnaître avec bonheur, la poétesse y voit aussi le reflet de sa propre beauté. Elle s'enorgueillit de cette ressemblance avec cette vanité naïve qui, dans l'épitaphe qu'elle composa pour sa tombe, lui fait dire qu'elle a égalé Sappho. L'épigramme par laquelle Nossis dédia aux Immortels, les armes que les ennemis des Locriens avaient abandonnées sur le champ de bataille, nous apprend que sa voix voluptueuse sut néanmoins une fois trouver de mâles accents pour exalter la gloire de ses concitoyens[26]. La mollesse que respiraient les poèmes de Nossis se retrouvait sans doute dans les œuvres de la Sicyonienne Praxilla qui chanta Vénus comme mère de Bacchus, et qui redit la légende de l'Adonis phénicien[27]. Mais les deux dernières muses terrestres que nous ayons à mentionner, nous font traverser une région plus pure. Dans la Couronne de Méléagre, les lis immaculés représentent les petits poèmes que l'Anthologiste a empruntés à Anyté et à Mœro. Née à Tégée, mais vivant dans la cité dorienne d'Épidaure (trois siècles avant notre ère), Anyté y versifiait les oracles d'Esculape, et ce fut même par son ministère, disait une légende, que le dieu rendit la vue à un habitant de Naupacte[28]. Très peu de fragments nous restent de ses œuvres ; mais l'Anthologie renferme une vingtaine d'épigrammes qui nous sont parvenues sous son nom. Par leur fraîcheur et par leur pureté, elles font rêver à ces lis qui les symbolisent ; et quelques-unes même d'entre elles, vivifiées par le souffle épique, justifient l'enthousiasme d'Antipater qui surnomme Anyté un Homère féminin[29]. Parce que l'âme de notre poétesse est simple et pure, les idées les plus élevées et les sentiments les plus doux s'y réfléchissent comme dans une onde limpide ; et parce que son style n'est que le vêtement de sa pensée, il s'adapte merveilleusement aux formes tour à tour héroïques et gracieuses que revêt celle-ci. Quel charme et quelle fraîcheur dans cette invitation par laquelle Anyté engage le passant à se reposer sous les arbres, à goûter l'eau de la source, à recevoir les caresses du zéphyr qui bruit dans le feuillage ! Quelle spirituelle vivacité dates l'oraison funèbre de ce coq qu'un voleur a étranglé, et dans lequel la poétesse ne semble pas très-disposée à pleurer la cause d'un réveil trop matinal peut-être ! Mais aussi, quelle émotion profonde et mélancolique lorsqu'elle peint une jeune fille que la mort a arrachée aux bras d'un père ou dérobée à l'appel désespéré d'une mère ! Et comme les accents d'Anyté sont vigoureux, hardis, vraiment homériques, soit qu'elle consacre dans un temple la lance homicide, soit qu'elle accorde un souvenir au cheval tué dans la mêlée, soit qu'elle exalte la mort d'un guerrier dont la mère porte le deuil, mais dont la tombe retrace la fin glorieuse ! Tous les héroïsmes font tressaillir Anyté, depuis celui du soldat qui succombe en défendant sa patrie, jusqu'à celui de la jeune fille qui se tue pour sauvegarder son honneur ! Et avec quelle élévation cette poétesse, cette prêtresse, juge le néant des choses humaines, quand elle écrit l'épitaphe d'un homme qui, pendant sa vie, était esclave, et que la mort a rendu l'égal de Darius, le grand roi ! Ce qui nous reste de Mœro de Byzance, ne nous permet pas d'apprécier par nous-mêmes sa valeur littéraire. Elle composa un poème héroïque, Mnémosyne, des élégies, des imprécations et un grand nombre d'épigrammes. Parmi celles-ci, deux seulement nous ont été conservées dans l'Anthologie, et révèlent chez la poétesse épique, une imagination accessible aux scènes riantes de la nature. Mœro eut un fils qui hérita de ses goûts intellectuels : ce fut Homère, tragique qui florit sous les Ptolémées[30]. Mentionnons encore quelques poétesses secondaires. Cléobuline, fille de Cléobule, magistrat suprême de Rhodes et l'un des sept sages de la Grèce, acquit de la renommée par ses énigmes en vers hexamètres. Mais elle mérita plus encore la célébrité par les tendances pratiques de sa haute intelligence, et par la touchante sollicitude avec laquelle elle veillait à ce que, sous le gouvernement de son père, les hommes fussent heureux dans l'île qui était la rose de l'Archipel[31]. Cléobule se plaisait à nommer sa fille, Eumétis, belle intelligence. Plutarque nous montre Cléobuline dans la demeure de Périandre, tyran de Corinthe. Il la représente vive et gracieuse, alliant à la modestie et à la simplicité de la jeune fille, la liberté dont jouissait la vierge dorienne. En interrogeant Anarcharsis sur le traitement que les Scythes font suivre aux Malades, elles se promet sans doute de faire appliquer par sa charité les connaissances dont son esprit s'enrichira[32]. A Sparte, nous voyons la poétesse Mégalostrata qui captivait les cœurs par les attraits de sa compagnie, et qui fit éprouver à Alcman une tendresse respectueuse, que l'on est surpris de rencontrer chez un homme de mœurs aussi corrompues. Alcman chanta la blonde enchanteresse[33]. Parmi les femmes qui cultivèrent la poésie à Lacédémone, nommons aussi Cléitagora, dont l'origine spartiate n'est cependant pas certaine, et Myia qui composa des hymnes[34]. Irène figure dans le catalogue des poétesses helléniques[35]. C'est donc à elle que nous croyons pouvoir rapporter une inscription découverte en Grèce, et par laquelle le sénat et les habitants de Lamie, en Thessalie, reconnaissants des élégies qu'une femme de leur race, Irène, Éolienne de Smyrne, a consacrées à leur cité et à leurs ancêtres, la nomment proxène[36] et bienfaitrice de la ville, lui accordent de précieux privilèges et perpétuent dans sa famille la proxénie et le droit de cité[37]. Les poétesses grecques, chantant leurs vers, étaient doit aussi musiciennes. Les filles de la Grèce n'étaient pas étrangères non plus aux autres arts de leur pays. N'est-ce pas à l'une d'elles qu'une légende attribue la première invention de la plastique ? Une jeune Corinthienne, Cora, fille du potier Dibutade, voit s'éloigner pour un long voyage l'homme qu'elle aime. La séparation commence, éternelle peut-être.... Mais la lueur d'une lampe projette sur la muraille l'ombre de celui qui part.... La jeune fille veut du moins fixer cette fugitive image ; et, à l'aide d'un couteau, elle en esquisse les contours. Le père de Cora applique de l'argile sur cette silhouette, et obtient ainsi un modèle qu'il fait cuire au four[38]. On ne nous dit pas que les femmes helléniques aient compté des sculpteurs parmi elles. Il est vrai que par les lignes si pures de leur ravissante beauté, elles étaient elles-mêmes les vivants modèles qui devaient guider le ciseau de l'artiste. Plusieurs Grecques se distinguèrent dans la peinture. Timarète, fille de Micon le jeune, reproduisit l'image de Diane, œuvre qui se voyait à Ephèse : c'était l'un des plus anciens monuments de cet art, et la déesse y était probablement représentée sous la forme étrange et symbolique qu'elle avait dans son sanctuaire d'Asie. Irène, qu'il ne faut pas confondre avec la poétesse de ce nom, eut pour maître son père Cratinus ; Éleusis renfermait une de ses productions, la figure d'une jeune fille, vierge initiée peut-être aux mystères des grandes déesses. Calypso, Alcisthène, firent aussi des tableaux dont le souvenir se conserva. Aristarète, fille et élève de Néarque, eut quelque réputation. Olympias qui forma elle-même un disciple, ne fut pas oubliée non plus ; mais la plus célèbre de toutes les femmes qui s'adonnèrent à la peinture, fut Latta, née dans cette ville de Cyzique à laquelle Apollon avait accordé le don des arts. Bien que la Cyzicénienne travaillât avec une extrême rapidité, cette promptitude n'enlevait rien au mérite de ses œuvres, et balla était considérée comme le premier peintre de son temps. La peinture au pinceau et la peinture sur ivoire à l'aide du cestre[39], lui étaient également familières. Les portraits qu'elle exécuta, furent principalement consacrés aux personnes de son sexe ; et Pline rapporte qu'au temps où il vivait, Naples montrait un grand tableau où balla avait représenté une vieille femme. L'auteur latin ajoute qu'elle avait reproduit sa propre image, réfléchie dans un miroir[40]. On a trouvé à Pompéi une peinture où se voit une artiste dans laquelle les antiquaires ont cru reconnaître Lalla. Assise sur un escabeau, dans une espèce de portique, une jeune femme a les yeux attachés sur un hermès de Bacchus, et transporte ce sujet sur une ta- blette que tient un enfant. A sa main droite se voit un pinceau qu'elle plonge dans une petite cassette posée sur un tronçon de colonne, et qui a paru devoir contenir des couleurs. La main gauche de l'artiste tient une palette[41]. Cette femme est élégamment drapée. Une bandelette ceint ses cheveux ondulée qui retombent sur sa nuque et sur son dos. Un regard profond, intelligent, illumine ses traits harmonieux et délicats. Si cette image est réellement celle de la célèbre Cyzicénienne, Lalla était admirablement belle, et cependant, fervente prêtresse de son art, elle ne se maria pas. Dans cette Grande-Grèce où Lalla nous a appelée, avait surgi à Crotone, un rameau de la vieille souche achéenne qui était à peu près effacée en Grèce aux temps historiques, mais qui, dans cette colonie, conservait sans doute à la femme, le rang qu'elle lui accordait autrefois dans la mère-patrie. Nous en avons la preuve dans la liberté avec laquelle purent appartenir à l'école de Pythagore, ces habitantes de Crotone que leurs époux eux-mêmes conduisirent au philosophe, et qui appliquèrent les leçons du maître en consacrant à Junon leurs élégantes parures. Elles se mêlèrent dans cet institut, à des Doriennes, et même, par une remarquable exception, à des Ioniennes nées, il est vrai, à Samos, patrie de Pythagore[42]. Nous ne reviendrons pas ici sur les doctrines de cette école[43]. Nous ne nous occuperons que des Pythagoriciennes qui se distinguèrent dans les lettres. La plus illustre de ces femmes est Théano qui, suivant des traditions, naquit à Crotone, et fut la compagne de Pythagore[44]. Non moins pure qu'intelligente, et belle, Théano fut aimée de l'austère philosophe[45], et lui garda la plus scrupuleuse fidélité. En s'habillant, elle découvrit un jour son bras : Le beau bras ! dit quelqu'un. — Mais pas public[46], répondit-elle. Belle parole qu'un Docteur de l'Église devait louer plus tard[47]. Parmi les enfants nés de Pythagore et de Théano, nous citerons une fille, Damo, qui commenta Homère par de remarquables écrits. La fermeté et le désintéressement de son caractère égalaient la hauteur de son intelligence. A la mort de son père, elle reçut de lui, dit-on, un précieux héritage, le seul qu'il pût lui laisser : les Mémoires du grand philosophe. En les lui confiant, il lui recommanda de les tenir secrets aux personnes qui n'appartiendraient pas à la famille du maître. En vain offrit-on à Damo une somme considérable en échange de ces manuscrits, elle préféra supporter la misère, se trouvant plus heureuse de se sacrifier au devoir que d'immoler à un gain coupable la volonté paternelle[48]. D'autres versions, ne mentionnant pas l'existence de Damo, donnent pour filles à Théano, deux Pythagoriciennes célèbres, Myia et Arignoté. Celle-ci, originaire de Samos, fit un ouvrage sur le culte de Cérès[49]. Théano, devenue veuve, prit avec ses deux fils, la direction de l'école qu'avait fondée son mari[50]. Diogène de Laërte rapporte qu'elle composa quelques ouvrages[51]. Si les écrits qui nous sont parvenus sous son nom, ne sont pas authentiques, ils attestent du moins la haute idée que se firent de son caractère, les Grecs qui se crurent fondés à les lui attribuer. Il ne nous reste d'elle que trois lettres d'un charme tout intime, et un fragment philosophique et didactique d'un livre Sur la piété. Nous traduisons ici sur le texte grec ces divers morceaux, ainsi que quelques pages qui subsistent des œuvres attribuées à deux autres Pythagoriciennes, Périctioné et Phintys. Nous rappelons ici que ces lettres et ces fragments n'ont pas encore passé, croyons-nous, dans les langues modernes[52]. LETTRE DE THÉANO SUR L'ÉDUCATION DES ENFANTS[53]. Théano à Eubule, salut. Je t'entends dire que tu élèves
mollement tes petits enfants. Il est d'une bonne mère, non d'avoir de la
sollicitude pour le plaisir de ses enfants, mais de les conduire aux bonnes
mœurs. Veille donc à ce que tu ne fasses pas l'œuvre d'une femme aimante,
mais flatteuse. Le plaisir, croissant avec les enfants, fait des hommes
dissolus. Car, est-il quelque chose de plus doux aux jeunes gens que
l'habitude du plaisir ? Il ne faut donc pas, ô amie, que l'éducation des
enfants soit pervertie. La perversion de la nature existe lorsque, étant dans
leurs âmes amis du plaisir, ils deviennent voluptueux dans leurs corps. Et,
ennemis du travail dans celles-là, ils sont plus mous dans ceux-ci. Il faut,
exercer les enfants aux redoutables soins de l'éducation, même s'il est
besoin qu'ils s'affligent et qu'ils aient du mal, afin qu'ils ne soient pas
comme esclaves des souffrances, avides de plaisirs, et paresseux aux
fatigues, mais afin qu'ils honorent les belles qualités au-dessus de toutes
les autres, abandonnant celles-ci, persévérant dans celles là. Il ne faut pas
les accoutumer à se gorger de mets, ni faire une grande dépense pour leurs
plaisirs ; tu rendrais tes enfants indociles et sans frein. Il ne faut pas
les laisser tout dire et tout faire, ni t'effrayer s'ils pleurent, ni
chercher à les faire rire ; ni te mettre à rire s'ils battent leur nourrice
et s'ils te parlent mal ; ni leur procurer dans l'été la fraîcheur, dans
l'hiver la chaleur[54], et beaucoup de luxe. Les enfants pauvres ne font
nullement l'essai de ces choses, et sont élevés plus facilement, et n'en
croissent pas moins, mais y sont au contraire mieux disposés. De même que la
race de Sardanapale élève ses enfants, tu amollis par les plaisirs la nature
virile des tiens. Car, que faire d'un enfant qui, s'il ne mange pas aussi
vite qu'il le désire, pleure ; et s'il mange, demande les jouissances des
mets délicats ; et si le temps est chaud, tombe en défaillance ; et si le
temps est froid, grelotte ; et si quelqu'un le châtie, lui résiste ; et si
quelqu'un ne le sert pas pour un plaisir, s'afflige ; et s'il ne mâche, se
fâche, et qui est réduit à s'efféminer ? Sachant, ô amie, que lorsque les
enfants qui s'amusent parviennent à l'âge d'homme, ils deviennent esclaves,
ôte-leur de tels plaisirs, et donne-leur une éducation, non aussi
voluptueuse, mais austère ; fais que tes enfants supportent la faim et la
soif, et encore le froid et la chaleur, et le mépris de leurs camarades ou de
leurs supérieurs. Ainsi il arrive que les enfants sont nobles quant à l'âme,
s'élevant à de hauts sentiments, ou y dirigeant leurs efforts. Car les
labeurs, amie, sont aux enfants certains astringents qui perfectionnent la
vertu ; et y étant suffisamment trempés, ils reçoivent une teinture plus
intime de la vertu. Veille donc, amie, à ce que, de même que celles des
vignes qui viennent mal, manquent de fruit ; de même, sous l'influence de la
mollesse, tes enfants n'engendrent le vice de l'insolence et d'une grande
vanité[55]. LETTRE DE THÉANO POUR EXHORTER À CALMER LA JALOUSIE. Théano à Nicostrate, salut. J'ai entendu raconter la folie de
ton mari et la tienne : celle de ton mari, parce qu'il a une courtisane ; la
tienne, parce que tu es jalouse de lui. Moi donc, ô amie, j'ai connu
plusieurs hommes qui avaient cette maladie. Traqués, semble-t-il, par ces
femmes, ils sont retenus captifs, et ne résistent pas. Toi, tu es découragée
nuit et jour, tu te tourmentes, et tu complotes quelque chose contre ton
mari. Pour toi, ô amie, la vertu du mariage est, non d'espionner ton mari,
mais d'avoir de la condescendance pour lui. La condescendance consiste à
supporter son erreur. S'il fréquente l'hétaïre, c'est pour le plaisir ; et
l'épouse, pour le support mutuel. Le support mutuel consiste à ne pas mêler
les mauvaises actions aux mauvaises, à ne pas jeter la folie sur la folie. Ce
sont de ces fautes, amie, que le blâme excite au plus haut degré, et que le
silence apaise le plus ; comme le feu, dit-on, s'éteint dans l'isolement. Si,
blâmant ce que ton mari a paru te vouloir cacher, tu ôtes le voile de ses
passions, il péchera au grand jour.... Crois
donc qu'il va à la courtisane pour le plaisir, et qu'il se trouve avec toi
pour la vie commune ; et qu'il t'aime suivant la raison, et qu'il l'aime
suivant la passion. De courte durée est le temps de celle-ci. Aussitôt que la
passion possède, la satiété se montre vite et la calme. De courte durée est
le temps que donne à l'hétaïre le mari qui n'est pas tout à fait vicieux.
Est-il quelque chose de plus vain que la passion jouissant de l'injuste ? Ton
mari comprendra que la vie honnête s'amoindrit ainsi ; car nul homme sage ne
persévère dans une volontaire démence. Se représentant donc tes droits, et
considérant les abaissements de sa vie, il te comprendra, et ne supportant
pas l'injure du blâme, vite il se repentira. Vis donc, amie, sans être en
procès avec les courtisanes, et en te distinguant par ton mérite à l'égard de
ton mari, par ta sollicitude pour ta maison, par tes relations avec tes
connaissances, par ta tendresse pour tes enfants. Ne rivalise pas avec
l'hétaïre, car il est beau d'appliquer l'émulation à imiter les gens
vertueux. Cette émulation-ci te disposera favorablement aux réconciliations,
parce que les bonnes mœurs nous amènent à être bienveillants pour nos ennemis,
amie, et l'estime est l'œuvre de l'honnêteté seule. Pour qu'il soit possible
à la femme d'avoir en quelque sorte de l'autorité sur l'époux, il faut plus
l'honorer que l'observer comme un ennemi. Plus ton mari sera honoré de toi,
plus il rougira de lui-même, plus vite il voudra se réconcilier avec toi,
plus il aura de penchant à te chérir, reconnaissant son injustice envers toi,
remarquant la prudence de ta vie, et faisant l'épreuve de ta tendresse pour
lui. De même que les souffrances du corps rendent douces les guérisons, de
même les différends des amis amènent les réconciliations les plus intimes.
Oppose donc ces résolutions aux passions de ton mari. T'excite-t-il, en ayant
une folle passion, à te troubler par les chagrins ; et en manquant de
dignité, à en manquer toi-même ; et en lésant les intérêts de la maison, à
les léser (aussi), tu sembleras être au même rang que celui où il est tombé ;
et en le blâmant, tu te blâmeras toi-même. Et si, le quittant, tu passes dans
une autre maison ? Tu feras aussi l'épreuve d'un autre époux, après avoir été
délivrée du premier, et si celui-là commet les mêmes fautes, encore d'un
autre ! Car, pour les jeunes femmes, l'état du veuvage n'est pas supportable.
Ou bien, seule tu demeureras séparée de ton mari, telle qu'une célibataire.
Mais tu négligeras ta maison et tu perdras ton mari ? Aussitôt tu
distingueras le préjudice d'une vie douloureuse. Mais tu te vengeras de la
courtisane ? Veillant à sa sûreté, elle t'évitera ; et quand même tu te
vengerais, une femme pudique est inhabile au combat. Mais est-ce qu'il est
beau de combattre chaque jour pour le mari ? Et qu'y gagne-t-on ? Car les
querelles et les injures ne font pas cesser la licence, et accroissent le
différend dans ses progrès. Mais quoi ! tu méditeras quelque chose contre ton
mari ? Nom, amie. La tragédie a enseigné l'empire de la jalousie, dans la
composition des drames où Médée est criminelle. Mais, de même qu'il faut
écarter la main du mal d'yeux, éloigne ainsi la recherche de tes chagrins.
Car, en supportant avec constance ton affliction, tu la calmeras plus tôt. EXHORTATION DE THÉANO SUR LA DIRECTION DES SERVANTES. Théano à Callisto. Aux plus jeunes de vous, le pouvoir de commander aux servantes a été donné par le mariage. Il est utile de se rendre à l'enseignement de femmes plus âgées lorsqu'elles donnent des conseils sur la direction de la maison. A qui ne sait pas, il est beau de s'instruire d'abord, et d'estimer le conseil le plus convenable de femmes plus âgées. Il faut élever à cela la jeune âme de la vierge. Le premier commandement de la
femme dans la maison, est le commandement des servantes. Ce qu'il y a de plus
important, ô amie, c'est la bienveillance des esclaves. La possession de ce
sentiment ne s'achète pas avec leurs corps, niais les maîtres intelligents la
font naître plus tard. La cause de ce sentiment est le juste emploi (qu'on fait des domestiques), quand elles ne travaillent pas, étant fatiguées, ou
impuissantes par le manque de forces. Ces infirmités appartiennent à la
nature humaine. Il y a des maîtresses qui, guidées par le gain le moins
lucratif, traitent mal les esclaves, les surchargent de travail, et diminuent
ce qui est nécessaire à leur vie. Ensuite si les servantes se sont procuré un
profit de la valeur d'une obole, elles sont condamnées aux grands châtiments,
à la malveillance et aux embûches les plus méchantes. Qu'il te soit facile de
mesurer les vivres des esclaves au nombre des ouvrages de laine qu'elles font
chaque jour. Il en est ainsi pour la nourriture. Quant aux désordres des
servantes, préfère ce qui te paraît convenable à ce qui favorise ces fautes.
Car il faut condamner les domestiques suivant ce qu'elles méritent. Ne te
laisse pas emporter par la colère à la cruauté. Non moins que la haine contre
les méchants, que la raison juge. Si, chez l'une des domestiques, le comble
du vice est invincible, qu'on la renvoie en la vendant. Privée de son emploi,
qu'elle devienne étrangère à sa maîtresse. Que la raison du proèdre[56] t'appartienne pour reconnaître la vérité de la faute et la
justice de la condamnation. Que la grandeur des fautes commises corresponde à
celle de la répression. La sentence de la maîtresse (étant prononcée),
que ta bienveillance exempte l'esclave de la punition de sa faute[57]. Ainsi tu maintiendras ce qui convient à la direction de la
maison. Il y a des femmes, ô amie, qui, rendues sauvages par la jalousie ou par la colère, fouettent cruellement leurs servantes, comme témoignage du comble de l'amertume. Avec le temps, les esclaves ont été consumées de travail, excitées à la fuite, et quelques-unes ont terminé leur vie en se l'ôtant de leurs propres mains. Et désormais l'isolement de la maîtresse gémissant sur sa propre imprudence, appartient au regret solitaire. Mais, ô amie, imite les instruments. Trop détendus, ils ne résonnent pas ; trop tendus, ils se rompent. Qu'il en soit ainsi dans tes rapports avec tes servantes. Le trop grand relâchement occasionne la dissonance de l'obéissance ; et la tension de la contrainte, la destruction de la nature. D'où il suit qu'il faut comprendre en toutes choses la meilleure mesure. DE LA MÊME. Du livre sur la Piété[58].Je suis engagée à dire par un grand nombre d'Hellènes, que Pythagore fait naître toutes choses du nombre. Cette parole est controversée, de cette manière qu'il a dit, non que les choses qui ne sont pas imaginées et qui sont incréées, naissent du nombre ; mais qu'elles naissent selon le nombre ; parce que, dans le nombre, il y a d'abord l'ordre ; et la participation de l'ordre appartient aux choses qui peuvent être comptées pour la première fois, pour la seconde fois, et ainsi des autres. PÉRICTIONÉ, DE L'ÉCOLE PYTHAGORICIENNE. Du livre sur la Sagesse[59].L'homme est né et organisé pour contempler la raison de toutes les choses de la nature et de la sagesse. C'est son œuvre d'acquérir et de contempler l'intelligence des êtres. La géométrie, l'arithmétique et
les autres sciences théorétiques sont fort occupées des choses qui sont ; la
sagesse (recherche) en tout les éléments des êtres. Car la sagesse ne (distingue) pas les
choses qui existent, comme la vue, celles qui sont visibles, et l'ouïe,
celles qui peuvent être entendues. Les accidents de la substance arrivent
soit à tous les êtres en général, soit à la plupart d'entre eux, soit à
chacun d'eux. C'est le propre de la sagesse que d'embrasser d'un coup d'œil
ces accidents en général et de les contempler. Les accidents qui arrivent à
la plupart des choses, concernent la science de la nature : l'objet de cette
science étant de considérer chacun de ces accidents en particulier et de le
distinguer sous quelque rapport. Et c'est pourquoi la sagesse découvre les
principes de tous les êtres ; la physique, les événements de la nature ; la
géométrie, l'arithmétique et la musique, ceux de la quantité et de
l'harmonie. Quiconque est capable d'analyser toutes les espèces par l'effet
d'un même principe, de les examiner de nouveau suivant ce principe et de les
compter, celui-là paraît le plus sage et le plus véridique. Une belle
observation à découvrir, est encore celle par laquelle il sera possible de
contempler l'Être divin et toutes les choses qui, dans la même série et le
même ordre, sont séparées de lui. DE LA MÊME. Du livre sur l'harmonie de la femme[60].Il ne faut faire de mal à ses parents ni par la parole, ni par l'action ; il faut leur obéir, qu'ils soient humbles ou grands : dans quelque condition qu'ils se trouvent, soit de l'âme, soit du corps, soit de l'extérieur, et dans la paix, et dans la guerre, et dans la santé, et dans la richesse, et dans la pauvreté, et dans la gloire, et dans l'ignominie ; qu'ils soient simples citoyens ou magistrats, il faut habiter pris d'eux et ne jamais les fuir ; il faut obéir presque à leur folie. Car ces choses sont jugées prudentes et utiles par les hommes pieux. Quiconque méprise ses parents, sa faute, chez les vivants et chez les morts, est inscrite par les dieux au nombre des crimes, haïe des hommes ; et sous terre, dans le lieu des impies, nouée de toute éternité aux mauvaises actions, par la justice des dieux infernaux qui furent établis les gardiens de ces choses. Divin et beau spectacle, en
effet, que le visage des parents ! Et combien leur aspect et le culte qui
leur est rendu, sont plus grands encore que la vue du soleil et de tous les
astres dont le ciel se revêt et qu'il fait danser en chœur autour de lui ! Et
y a-t-il une autre chose que quelqu'un croie plus merveilleuse que cette (dernière)
contemplation ? Lorsque les dieux voient les parents méprisés, je juge qu'ils ne sont pas disposés à le souffrir. Et si, malades ou trompés, les parents méconnaissent quelque chose, il faut les consoler, les instruire, et ne les haïr d'aucune manière. Car, parmi les fautes et les injustices des hommes, il n'en est pas de plus grande que l'impiété envers les parents. DE LA MÊME. Du, même ouvrage[61].Pour que la femme atteigne l'harmonie, il faut qu'elle soit remplie de raison et de prudence. P faut que la vertu éclaire son aine. Ainsi elle sera juste, virile, prudente, modérée dans ses désirs, et elle haïra une vaine gloire. Par là il naîtra de belles actions chez elle, chez son mari, chez ses enfants et dans sa maison. Ainsi que, dans les royautés, l'on gouverne les États, cités ou nations ; ainsi la femme gouvernant les désirs de la passion, la divine harmonie naît. Comme les amours illicites ne la poursuivent pas, l'épouse trouve d'autres amitiés chez son mari, chez ses enfants et dans sa maison. Combien de femmes infidèles deviennent dans la maison les ennemies des hommes libres et des serviteurs ! La femme machine près de son mari des ruses et lui raconte des mensonges contre tous, afin qu'elle seule paraisse se distinguer par la bienveillance qu'elle a pour la maison et par la manière dont elle la gouverne. Elle aime la paresse, et de là naît la perte de tous, perte qui est commune autant à elle qu'à son mari. Mais assez sur ce sujet. Il faut conduire le corps humain
d'après les règles de la nature, concernant la nourriture, les vêtements, les
liniments, l'arrangement des cheveux, et tout ce qu'il y a d'or et de
pierreries dans la parure. Combien toutes les choses que les femmes mangent,
boivent, dont elles se vêtent et qu'elles portent, les disposent au péché
d'un vice complet, et (leur font) commettre d'injustices dans le mariage et ailleurs ! Il
faut seulement apaiser la faim et la soif par des choses frugales ; le froid,
par une toison ou une fourrure grossière. Ce n'est rias un petit vice qui se
montre, que de se procurer des aliments lointains, ou très-chers, ou renommés
; de chercher vraiment trop d'habits aux couleurs variées par le coquillage
marin ou par une autre teinture coûteuse : c'est une grande folie. Comme le
corps ne veut pas être transi de froid, ni être nu à cause de la décence, il
ne faut pas, d'un autre côté, qu'il manque d'un seul vêtement. L'opinion des hommes ignorants se porte vers les choses frivoles. Ainsi la femme ne courra ni après l'or, ni après la pierre de l'Inde[62], ni après les choses d'un autre lieu. Elle n'aura pas envie de tresser ses cheveux avec beaucoup d'art, elle ne s'oindra pas avec le parfum de l'Arabie ; elle ne se peindra pas le visage avec des fards pour le rendre blanc ou rouge, pour noircir ses sourcils, ses yeux et sa blanche chevelure ; elle ne se baignera pas fréquemment.... La beauté produite par la sagesse, et non par ces choses, plaît aux femmes bien nées. Il n'y a pas de nécessité que la
femme fasse cas d'être noble, riche, d'avoir vu le jour, bon gré mal gré,
dans une grande ville, ni d'avoir l'estime et l'amitié des hommes illustres
et des rois. S'il en est ainsi, qu'elle ne s'afflige pas ; sinon, qu'elle ne
le regrette pas. Une femme juste et sensée n'entrave point sa vie par ces
choses grandes et admirables dont il a été question ; jamais son âme ne les
recherche. Qu'elle marche sans elles. Car elles sont plus nuisibles et
entraînent plus au malheur qu'elles ne sont utiles ; avec elles, on est
exposé aux embûches, à l'envie, à la jalousie ; ainsi la femme ne serait pas
dans le calme de cette manière. Il faut vénérer les dieux dans la bonne espérance du bonheur. Il faut obéir aux lois et aux règlements de la patrie. Après les dieux, disons qu'il faut honorer et vénérer les ancêtres ; ceux-ci sont et se montrent comme des dieux à leurs descendants. Pour son mari, que la femme vive avec lui légalement et bien, ne considérant pas ses intérêts particuliers, mais surveillant et gardant la foi conjugale. Tout est là. Que la femme supporte tout de son
mari, s'il éprouve des revers, s'il pèche par ignorance, s'il s'adonne à
l'ivresse ou à d'autres femmes. Qu'elle pardonne à l'époux sa faute ; et, à
l'égard de ces femmes, qu'elle ne fasse pas non plus intervenir la vengeance.
Il faut donc honorer la loi, et ne pas être jalouse. Il faut supporter la
colère (du mari), sa parcimonie, ses reproches, sa jalousie, ses
accusations, et quelque autre défaut qu'il ait de la nature. Que l'épouse
vive avec lui en toutes choses, de manière que, par sa modestie, elle soit
pour lui un objet d'amour. Quand la femme est chère au mari et qu'elle agit
bien avec lui, l'harmonie subsiste, la femme aime la maison entière, et lui
concilie la bienveillance des étrangers. Lorsqu'elle n'aime pas la maison,
elle ne désire voir, ni ses enfants, ni ses serviteurs, à aucun heureux
sacrifice. Elle les conduit tous à leur perte, et le désire, parce que la
discorde existe ; elle appelle de ses vœux la mort de son mari, parce qu'il
lui est odieux ; et elle hait autant les voisins de l'époux que les personnes
qui plaisent à celui-ci. La femme paraît en harmonie si elle devient pleine de raison et de sagesse, si elle aime, non-seulement son mari, mais ses enfants, ses proches, ses domestiques, et toute la maison. Dans ses biens, sont des citoyens, des étrangers, des amis ; elle se pare pour eux avec une naturelle simplicité, disant et entendant de belles choses, suivant son mari dans la conformité d'opinions de la vie commune, s'accordant avec ceux qu'elle voit près de lui et avec les amis de ce dernier, et le guidant encore à travers les douceurs et les amertumes (de la vie), à moins qu'elle ne soit en tout dépourvue d'harmonie. PHINTYS, FILLE DE CALLICRATE, DE L'ÉCOLE PYTHAGORICIENNE. Du livre sur la chasteté de la femme[63].En général, que la femme soit
bonne et modeste ; sans la vertu, personne ne deviendrait jamais tel. Car chaque
vertu rend estimable la substance qui la contient : la vertu des yeux[64], les yeux ; la vertu de l'ouïe, l'ouïe ; la vertu du
cheval, le cheval ; la vertu de l'homme, l'homme ; ainsi la vertu de la
femme, la femme. La plus grande vertu de la femme est la chasteté ; par
celle-ci, elle pourra honorer et aimer son mari. Beaucoup croient également qu'il n'est pas plus convenable à la femme d'être philosophe que de monter à cheval et de haranguer devant le peuple. Je juge quelles sont les qualités propres à l'homme, celles qui le sont à la femme, celles qui sont communes à. l'homme et à la femme, celles qui appartiennent plus à l'homme qu'à la femme, celles qui appartiennent plus à la femme qu'à l'homme. Les attributs de l'homme sont de
faire des manœuvres militaires, d'administrer les affaires publiques et de
haranguer devant le peuple. Les attributs de la femme sont d'être dans la
maison, d'y demeurer, d'en avoir la charge et de servir le mari. Je dis que
les qualités communes aux deux sexes sont la force d'âme, la justice et la
raison. Et la vertu du corps convenant à l'homme et à la femme, il en est de
même pour la vertu de l'âme. Et comme la santé est utile au corps de l'un et
de l'autre, il en est ainsi pour la santé de l'âme. La vertu du corps est la
santé, la force, la vigueur des sens, la beauté : Il y a des qualités que
chaque sexe doit plus particulièrement exercer et posséder. La force et la
raison appartiennent plus à l'homme, et avec cela, la vigueur de la
constitution et la puissance de l'âme. La chasteté est plus particulière à la
femme. C'est pourquoi celle-ci doit apprendre de combien de manières, et de
quelles manières, la chasteté s'éloigne de la femme. Je dis qu'il y en a
cinq, et qu'elles s'appliquent aux choses qui concernent : premièrement, la
plus grande sainteté et la piété du mariage ; deuxièmement, la parure du
corps ; troisièmement, les sorties de la maison ; quatrièmement, l'abstention
aux bacchanales et aux fêtes de la Mère des dieux ; cinquièmement, la piété
et la convenance en assistant aux sacrifices offerts à la Divinité. Le plus grand de ces principes et
celui qui contient le plus de choses de la chasteté, est que le lien nuptial
ne soit pas corrompu et qu'il soit pur (du
contact) de l'étranger. D'abord, celle qui
enfreindra la loi en ceci, péchera contre les dieux qui président à la
naissance, contre la maison et la parenté auxquels elle donnera, non des
alliés légitimes, mais des bâtards. Elle péchera contre les dieux de la
nature, qu'elle a pris à témoin de ses serments, et contre ses ancêtres et
ses parents en réunissant à la vie de la communauté, les enfants qu'elle aura
produits contre la loi, Elle péchera contre sa patrie, en ne restant pas
fidèle aux règlements nationaux. Ensuite, pécher contre ceux-ci (entraîne) la mort
qui est la plus grande des punitions établies, parce que, être coupable et
commettre des désordres quant au plaisir, c'est le comble de la plus grande
iniquité et le crime le plus inexcusable. La fin de tout désordre est la
perte (du pécheur). Et il faut que la femme réfléchisse qu'elle ne trouvera
pas comme remède de son égarement, une victime expiatoire, parce que, pour
s'approcher des temples et des autels, il faut être pure et aimée des dieux ;
car pour cette faute qui est la plus grande (de toutes), la Divinité devient
inexorable[65]. L'épouse obtiendra la plus belle parure d'une femme
libre, quand ses enfants montrant le type le plus conforme à celui du père
qui les a engendrés, leur aspect témoignera de sa fidélité à son époux. Et
sur le mariage, il en est ainsi. Quant à la parure du corps, il me semble qu'il faut que la femme soit vêtue de blanc, et simplement et sans superfluité. Elle sera telle, si elle ne se sert de. vêtements ni transparents, ni de couleurs variées, ni tissus au bembix[66], mais convenables et blancs. Elle fuira ainsi surtout la parure, le luxe, la recherche, et elle ne fera pas naître chez les autres une mauvaise émulation. Elle ne se procurera absolument pas l'or et les smaragdes[67]. Ces objets coûtent beaucoup d'argent, et montrent (chez celles qui les portent) de l'orgueil, à l'égard des plébéiennes. Dans une ville bien régie, et tout entière réglée en toutes ses parties, il faut que la sympathie existe entre celles-ci, et qu'elles suivent la même loi. Il faut repousser de la ville les ouvriers qui travaillent ces matériaux. Que la femme ne s'applique pas à s'enluminer le visage avec du fard ; qu'elle y rende son corps étranger, et qu'elle l'habitue à être lavé avec de l'eau. La pudeur la parera davantage. Elle rendra ainsi son mari honorable. La femme sortira de sa demeure dans son intérêt, dans celui de son mari et de toute sa maison, pour les sacrifices offerts par le peuple de la ville au Dieu, cause première. Ensuite la femme ne paraîtra (dehors), ni le soir, ni la nuit ; mais, ayant à faire une sortie, soit à cause de quelque procession, soit d'un achat, elle s'approchera de la place publique à la clarté du jour, décemment conduite par une domestique de la maison, ou par deux au plus. Elle présentera aux dieux, en son nom, des sacrifices simples et appropriés à ses moyens. Elle s'éloignera des orgies et des fêtes de la Mère des dieux. Car l'usage commun de la ville empêche les femmes de les célébrer, et d'ailleurs ces cérémonies entraînent à l'ivresse et au délire de l'âme. Il faut que la femme qui est maîtresse d'une maison et qui y préside, soit chaste et inattaquable en toutes choses. Que les pages que nous venons de traduire soient authentiques ou apocryphes, nous avons pu y remarquer la forme tout à fait distincte que revêt la pensée de chaque Pythagoricienne. Le fragment philosophique attribué à Théano, est trop court pour que nous puissions y distinguer autre chose qu'une grande force de raisonnement ; mais dans ses lettres, son langage, austère toujours, a néanmoins une grâce familière et une tendresse contenue qui lui donnent beaucoup de charme. Le style de Périctioné a de l'éclat et de la majesté. Quant à celui de Phintys, plus didactique que celui de ses émules, il a une vivacité d'allure tout à fait caractéristique. Mais le même fonds d'idées morales se retrouve chez nos prosatrices. C'est Phintys qui a le mieux exposé la manière dont les Pythagoriciennes entendaient la mission de notre sexe. Retraçant ce que les Grecs ont si rarement compris : les attributions qui sont particulières à chaque sexe et celles qui leur sont communes, Phintys base les devoirs de la femme sur les facultés qui lui sont naturelles. A ceux qui, suivant son expression, croient qu'il ne convient pas plus à la femme d'étudier la philosophie que de monter à cheval, la Pythagoricienne fait une réponse qui est le langage de la raison même. Également contraire à l'éducation masculine de la femme et à l'ignorance de celle-ci, elle établit entre ces deux extrêmes un sage milieu. Elle laisse à l'homme la défense de la patrie, l'administration des affaires publiques ; à la femme, la garde du foyer et le gouvernement de la maison. Mais elle reconnaît chez l'un et chez l'autre, bien qu'à des degrés divers, la même notion du vrai et du bien. Phintys déclare seulement que, parmi les qualités morales de l'homme, c'est la force qui doit dominer ; et parmi celles de la femme, la chasteté. C'est cette parfaite alliance de la beauté intellectuelle et de la pureté morale, qui permit à nos Pythagoriciennes de comprendre à la fois les spéculations philosophiques les plus élevées, et les devoirs les plus minutieux de la vie pratique. La même voix que nous entendons s'élever pour annoncer, avec une éloquence digne de Platon, que l'homme est né pour connaître la raison de ce qui est, cette même voix enseigne à la femme comment naîtra en elle par sa vertu, et dans son ménage par l'amour, cette harmonie que Périctioné admirait dans l'univers. La femme, telle que la désirent les Pythagoriciennes, rend à la Divinité un culte pur comme celle-ci. Elle vénère ses ancêtres ; elle obéit à ses parents avec la plus héroïque abnégation. L'épouse partage les idées de son mari ; le respectant encore dans les fautes qu'il commet, elle les lui pardonne avec cette indulgence que la vertu nous fait accorder même à nos ennemis. Elle le subjugue à force de magnanimité et le conduit au bien par son propre exemple. Elle étend cette influence salutaire, non-seulement sur ses enfants qu'elle prépare par le travail et par le sacrifice, aux luttes de la vie, mais sur ses esclaves qu'elle aime et dans lesquelles elle respecte la nature humaine. Elle répand sur toutes ses relations le charme de sa vertu et de son intelligence. Enfin elle demande sa parure, non à l'éclat emprunté d'un luxe pernicieux, mais au doux éclat de la pudeur. Répétons ce que nous disions en rappelant les préceptes analogues que formulèrent quelques philosophes : de telles maximes furent peu suivies dans la Grèce historique. A l'aurore de la civilisation hellénique, la femme est grande devant les dieux et devant les hommes. Avec cet instinct spiritualiste qui ne l'abandonne jamais, c'est elle qui, au sein du naturalisme pélasgique, a proclamé le Dieu éternel. Lorsque, dans le panthéon des Hellènes, les personnifications morales remplacent les forces naturelles, la femme ne représente pas seulement la Beauté, la Grâce ; elle symbolise aussi la Sagesse, la Justice ; et, de même que chez les Hindous elle était Sâraswatî, la parole sainte, elle devient en Grèce la Muse inspiratrice. Dans la maison homérique, la femme nous est apparue telle que la compagne de l'Arya, ou, pour remonter plus haut, telle que la reine de la tente patriarcale. La sage liberté de la jeune fille a préparé l'autorité de l'épouse ; et ce n'est qu'à son veuvage que la femme des temps héroïques voit s'abaisser devant son fils sa majesté souveraine. A l'époque historique, les Grecs se prosternent devant la beauté idéale que l'art a imprimée à leurs déesses. Ils honorent leurs prêtresses ; et attribuant à la femme cette intuition divine que respectaient en elle les Aryas aussi bien que les Sémites, ils reconnaissent chez la Pythie, le souffle du dieu-prophète. Le précurseur de temps plus heureux, Platon, avoue même que c'est une femme qui lui a enseigné à s'élever du spectacle de la beauté créée à la contemplation de la Beauté incréée. Mais si, dans les temples de leurs divinités ou dans les écoles de leurs philosophes, les Ioniens vénèrent la femme, ils l'abaissent à leurs foyers où a pénétré l'influence orientale[68]. Dans le silence du gynécée, ils laissent inculte l'esprit de leurs filles ; et dédaignant d'initier leurs femmes aux merveilles d'art et de poésie qu'ils font éclore, ils demandent aux hétaïres la sympathie de l'intelligence. Et cependant, si l'esprit de celle qui doit être mère, est privé d'aliment, ses sentiments de pureté et d'amour débordent avec une telle effusion, qu'ils palpitent dans le génie des tragiques athéniens. Souvenons-nous de ces sublimes modèles de filles, de sœurs, d'épouses et de mères, que la poésie enchanteresse de Sophocle et d'Euripide a présentés à nos yeux attendris. Les Doriens conservent à notre sexe son antique dignité, et ne lui refusent pas la culture intellectuelle. Mais à Sparte, ils impriment à ses habitudes une direction masculine qui, à part d'heureuses exceptions, substitue à la pudeur, à la sensibilité de la femme, une hardiesse, une cruauté sans nom, et ne peut même soutenir longtemps l'austère et célèbre vertu de l'épouse lacédémonienne. Si le peu de soin que les Athéniens accordèrent à l'esprit de leurs filles, déprava leur société, l'éducation de la Spartiate ne fut pas étrangère à la chute de Lacédémone. Pour qu'une nation vive, il faut que son cœur batte, et ce cœur ne battra que si la force de l'homme est contrebalancée par la délicatesse de la femme ; que si ces deux puissances se complètent en s'harmonisant. Dans la Grèce septentrionale, chez ces peuples où vivaient, ici les traditions doriennes, là, les souvenirs de la Grèce primitive, la femme est forte et honorée ; mais dans ce milieu barbare, ce sont surtout les passions sauvages qui se développent librement en elle. Chez certains peuples doriens étrangers à Sparte, et dans la race éolienne, quelques femmes d'élite témoignent qu'elles pouvaient à la fois cultiver le beau et demeurer fidèles aux modestes occupations de leur sexe. Cependant, la dureté inhérente au caractère dorien ; la sensualité que les Éoliens montrèrent, sinon dans l'austère et rude Béotie, du moins dans la riante Lesbos, ne nous permettent pas de savoir si, chez les femmes de ces races, les talents littéraires furent souvent relevés par la charité d'une Cléobuline ou par la modestie d'une Érinne. Quant à la race achéenne, presque annihilée en Grèce, ce n'est que sous l'influence de Pythagore, qu'à Crotone, ses filles renoncent aux séductions du luxe pour s'attacher aux biens solides de la sagesse et de la science. A diverses époques de la civilisation grecque, Aristote, Xénophon, mais surtout Plutarque et nos Pythagoriciennes, tracèrent à notre sexe une mission que lé christianisme étendit et sanctifia. Ils montrèrent la femme cultivant son esprit à ce foyer domestique où elle vivifie son cœur, et où elle abrite sa pureté ; cherchant dans son époux, la beauté divine qu'il trouve lui-même en elle ; donnant à ses enfants cette vie morale dont elle fait rejaillir les bienfaits sur tous ceux qui l'entourent. Ainsi, même chez les peuples polythéistes, le Verbe s'est révélé aux âmes d'élite, jusqu'au jour où l'humanité a reçu les notions élevées qu'Il a perfectionnées par l'Évangile. La religion qui vénéra la Vierge-Mère, ne se borna pas à compléter le rôle de l'épouse. Les anciens ne donnaient généralement à la vie de leurs filles qu'un but : le mariage, la maternité ; la loi chrétienne reconnaissant la valeur individuelle de la femme, prépara en elle, non-seulement la compagne de l'homme, mais la fille de Dieu, et la vierge put se créer une famille par l'exercice de la charité[69]. Lorsque la Croix étendit vers la Grèce les bras qui sauvèrent le monde, la déesse tomba de son piédestal, mais la femme se releva. FIN DU DEUXIÈME ET DERNIER TOME |