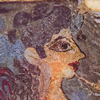LA FEMME GRECQUE
TOME DEUXIÈME
CHAPITRE PREMIER. — LA FEMME DANS LA FAMILLE ET DANS LA SOCIÉTÉ PENDANT LES TEMPS HISTORIQUES.
|
Sparte : Éducation des filles, leurs exercices gymniques, leurs entrevues avec les hommes. Les élèves d'Alcman. Les vierges, juges de la bravoure. Danses. Périls de l'éducation lacédémonienne. — Athènes : La naissance d'une fille et la bandelette de laine. Réclusion de la vierge, ses travaux, ses sorties. Doctrines d'Aristote et de Platon sur l'éducation des femmes. Comparaison entre l'éducation spartiate et l'éducation athénienne. — Comment les filles étaient élevées dans la race éolienne et chez les peuples doriens autres que les Spartiates. — Age du mariage. — Célibataire noté d'infamie à Lacédémone. — Alliances étrangères. — Lycurgue proscrit la dot, Solon la limite. Infractions de ces lois. — Le douaire de la femme athénienne. — Fille héritière. Orpheline pauvre. L'orpheline de Thurium. — Coutumes nuptiales. — L'épouse spartiate, sa vie cachée, sa vertu, son autorité ; abaissement de son caractère. — Grandeur et liberté des femmes de la race dorienne et de la Grèce septentrionale ; leurs droits politiques. Une idylle de Théocrite : le dialogue des Syracusaines. —Athènes. La demeure et l'appartement de la femme ; meubles divers, ustensiles de cuisine. Préparatifs de la toilette. Costumes et bijoux. Le calathus ; la Quenouille de Théocrite. L'époux instituteur, d'après Xénophon. — Plutarque décrivant la communauté morale et intellectuelle des époux. La femme de Plutarque. — Les préceptes nuptiaux de Xénophon et de Plutarque furent rarement ceux des Grecs. — Le règne de l'hétaire. — L'épouse coupable, à Athènes, et la pécheresse de l'Évangile. — Divorce. La femme d'Alcibiade. — La mère spartiate, ses premières angoisses ; le berceau de son fils ; son héroïsme et sa cruauté. — La mère athénienne, caractère de son influence. — La mère de Cléobis et de Biton. — Dernière séparation des époux athéniens. En décrivant les cérémonies du culte hellénique, nous y avons remarqué l'attitude si opposée des filles d'Athènes et de Sparte, les unes paraissant avec cette réserve modeste que commandaient les mœurs ioniennes, les autres avec cette singulière hardiesse qu'autorisaient les coutumes doriennes. Le moment est venu d'expliquer le contraste que nous avons déjà indiqué. Aussi, tout en ne négligeant pas de suivre la femme dans les divers États helléniques, étudierons-nous principalement son rôle social chez les deux nations qui, dans les temps historiques, dirigent les destins de la Grèce, et où se développent au plus haut degré les tendances des Doriens et celles des Ioniens. La femme était l'égale de l'homme à Sparte ; son inférieure à Athènes, chez ces Ioniens qu'atteignit l'influence asiatique. Dans chacune de ces villes, l'éducation des filles répondit au rang qu'assignait à leur sexe l'esprit de leur race. Le législateur spartiate eut l'intention de préparer dans la vierge, la mère à venir. Cette idée est si belle et si profonde qu'aujourd'hui encore, après tant de siècles écoulés, on, ne saurait donner une meilleure base à l'éducation des femmes. Mais voyons comment Lycurgue appliqua ce principe. Quelles mères formera l'homme de génie qui a créé la nation lacédémonienne, ce peuple aristocratique et pauvre, dédaigneux des travaux agricoles et industriels qu'il abandonne aux esclaves, ce peuple que la discipline militaire et les exercices du gymnase préparent pendant la paix aux privations et aux fatigues des camps, ce peuple concis, sentencieux, ennemi de l'éloquence, mais épris de cette poésie guerrière qui excite la valeur du soldat et chante la gloire du héros ? De quelle femme naîtra ce fils qui n'appartiendra pas à ses parents, qui ne disposera même pas de sa personne, et qui, dès le premier jour de sa vie, sera la propriété de l'État ? Lycurgue a voulu qu'exercée à la course, à la lutte, au maniement du disque et du javelot, la fille de Lacédémone se développât et se fortifiât de manière à pouvoir mettre un jour au monde, des êtres vigoureux, et à savoir au besoin défendre son foyer et sa patrie. Théocrite nous montre deux cent quarante vierges spartiates qui, se livrant à de virils exercices sur les bords de l'Eurotas, se sont ointes d'huile. Ainsi, lorsqu'après avoir parcouru cent fois le stade, Pallas se prépara à disputer à Junon et à Vénus le prix de la beauté, elle ne rechercha d'autre parfum que le jus de l'olivier ; et ses joues s'animèrent de ce vif incarnat que Callimaque compare au coloris de la rose matinale, et, mieux encore, à l'éclat dont brillent les pépins de la grenade. Rien, dans le costume de la jeune Lacédémonienne, n'entrave la liberté de ses mouvements. Elle n'a d'autre vêtement que le chiton dorien, tunique de laine s'agrafant sur les épaules, et qui, n'atteignant souvent que le genou, est fendue sur un côté dans sa partie inférieure[1]. La jeune fille ne se dérobe pas aux regards des hommes, soit que, dans les luttes gymniques, elle rivalise de force et d'adresse avec ses compagnes[2], soit qu'elle se rende aux cérémonies religieuses sur son canathre, char en forme de griffon, de cerf ou de bouc[3]. Les hommes assistaient encore à ces fêtes où paraissaient les Parthénies, chœurs de vierges. Celles-ci, répondant à leur maitre ou dialoguant entre elles, interprétaient les élans lyriques d'Alcman, le ponte qui les dirigeait, et qui, leur consacrant la plupart de ses odes, s'enivrait de leur juvénile approbation[4]. Les filles de Sparte savaient aussi des chants par lesquels, en présence des rois, des sénateurs et de tous les citoyens, elles louaient celui de leurs jeunes compatriotes qu'une action courageuse avait distingué, et raillaient celui qui avait commis une faute. Et tandis que ce dernier souffrait autant que si le blâme le plus sévère lui avait été infligé, le premier triomphait sous la glorieuse auréole dont l'avait couronné la beauté virginale. Tantôt les jeunes gens étaient simples spectateurs des chœurs de chant et de danse que formaient les jeunes filles, tantôt ils en étaient acteurs[5]. Dans la ronde nommée Hormos, nom qui désigne aussi une rangée de perles, un collier, le jeune homme ouvre la marche et prend des poses belliqueuses ; la jeune personne le suit à pas mesurés, et garde l'attitude qui convient à la femme[6]. Le caractère de cette danse nous paraît d'autant plus curieux qu'il s'éloigne complètement de l'éducation masculine que les Spartiates donnaient à leurs filles. C'était une de ces rares occasions où la nature opprimée réagissait contre les étranges coutumes qui confondaient ce qu'elle avait séparé. Le grand défaut de la constitution lacédémonienne fut, en effet, de méconnaître les lois éternelles qui assignent à chaque créature son rôle dans l'harmonie du monde. L'homme, destiné à la vie militante, doit y être formé par une éducation publique qui l'initie à. la vie de la cité. Quant à la femme, elle doit au contraire être préparée dans sa famille à la vie domestique. Les Spartiates qui reconnaissaient que le but de l'éducation doit être tout pratique, et que l'enfant ne doit apprendre que ce qui peut être utile à l'homme[7], les Spartiates se rendaient-ils bien compte de ce principe en élevant leurs filles ? Où donc développaient-ils en elles les qualités natives de la femme, cette grâce, cette douceur, cette sensibilité, qui doivent s'unir à sa force morale ? Les fêtes et les exercices publics préparaient-ils la vie cachée à laquelle l'épouse spartiate elle-même était assujettie ? Arrivons enfin au point le plus délicat et le plus périlleux de l'éducation reçue par les Lacédémoniennes. Dans ces luttes, dans ces jeux, où la jeune fille paraissait, légèrement vêtue, devant les hommes, que devenait sa modestie[8] ? Certes, nous n'ignorons point que, par l'austère éducation que Lycurgue donnait aux fils de Sparte, il était assuré de n'exposer les vierges qu'à de chastes regards. Mais viennent les siècles de décadence, et que sera chez la femme une vertu que ne fait pas respecter sa pudeur ? Nous sommes loin de méconnaître le rôle généreux et charmant que jouait la belle Lacédémonienne dans les fêtes où elle excitait l'enthousiasme de la poésie, l'élan du courage, et où elle inspirait ainsi à quelque jeune guerrier, l'une de ces vives et pures affections que cimentait l'hymen. Et cependant nous repoussons le système d'éducation qui fit de la place publique le principal théâtre d'une influence qui doit surtout s'exercer au foyer. Que notre imagination nous conduise maintenant dans la ville rivale de Sparte. Une femme va devenir mère, et un emblème, suspendu à la porte de sa demeure, nous apprendra le sexe de son enfant. La couronne d'olivier nous annoncera-t-elle qu'Athènes a un fils de plus, un fils que la cité de Minerve, la cité du travail, voue dès le berceau aux nobles et fécondes occupations de l'agriculture[9] ; un fils en qui la nation qu'enivrent toutes les gloires, semble aussi pressentir et saluer la grandeur du citoyen, le génie de l'artiste, la vigoureuse beauté de l'athlète[10] ?... Non ; mais une bandelette de laine, symbole des labeurs réservés à la femme, témoigne que dans cette maison est née une fille[11]. Toute la vie de la femme athénienne se lit dans ce tableau. Sévèrement renfermée dans le gynécée, la fille des Ioniens est privée de cette douce liberté dont jouissaient les héroïnes d'Homère. Ainsi, chez les Aryas de l'Inde, la femme a perdu au temps de Manou les privilèges qui lui appartenaient à l'époque védique[12]. La jeune Athénienne n'ose lever le regard que sur ses proches parents. Elle file la laine, ourdit et brode des tissus. Comme la vierge d'Israël, elle voit de quelle manière on distribue la tâche aux servantes ; mais on ne lui apprend pas, comme à la femme forte de l'Écriture, à ennoblir par l'élévation de son intelligence les humbles détails du foyer domestique. Comment se formerait son esprit ? On lui dérobe avec un soin jaloux le spectacle de la vie ; et si, par hasard, un coin du voile qui le lui cache venait à se soulever, si le besoin de savoir s'éveillait en elle, elle ne pourrait satisfaire cette curiosité qui est un si puissant moyen d'instruction : la jeune fille a été habituée à interroger le moins possible ceux qui l'entourent[13]. De temps en temps elle voit s'ouvrir les portes de sa prison, soit que, habillée d'un vêtement couleur de safran, elle se mêle aux filles de cinq à dix ans qui, allant en procession au sanctuaire de Diane Brauronia, y sont consacrées à la déesse[14] ; soit que, chargée de broyer l'orge sacrée, ou désignée pour les fonctions de Canéphore, d'Errhéphore, elle soit de nouveau appelée aux cérémonies du culte. Certes nous n'ignorons pas ce qu'une pareille éducation avait de défectueux, et combien elle était peu conforme à la doctrine d'Aristote, le philosophe qui, reconnaissant que l'homme et la femme composent les deux parties de l'État, déclarait que les études politiques ne devaient pas négliger l'éducation des femmes[15]. Nous regrettons d'autant plus de ne pas savoir de quelle manière Aristote appliquait ce principe, que les tendances pratiques de son esprit le prémunissaient sans doute contre les utopies de Platon. Celui-ci se méprit en effet lorsque, pour régénérer la femme, il dépassa encore la pensée de Lycurgue, et crut que les deux sexes, doués selon lui des mêmes aptitudes, mais à un degré inégal, pouvaient recevoir la même éducation, être soumis à. la même règle et chargés des mêmes emplois[16]. L'éducation vraiment digne de ce nom, étant le développement harmonique de toutes les facultés propres à un individu, l'éducation athénienne qui négligeait l'intelligence de la femme, ne doit pas plus servir d'exemple que l'éducation spartiate qui traitait la femme en homme. Mais eussions-nous à choisir entre ces deux systèmes opposés, ce serait à l'éducation athénienne que nous accorderions la préférence. Si celle-ci ne cultivait pas l'esprit de la jeune fille, du moins elle n'étouffait pas son cœur. La retraite, trop sévère assurément, dans laquelle vivait cette ignorante enfant, concentrait néanmoins toutes ses affections dans le cercle de la famille, et leur donnait une force et une tendresse dont les poètes tragiques nous offrent de sublimes exemples. Cette réclusion laissait aussi à sa chasteté ce parfum de modestie que la fille de Lacédémone perdait en se montrant trop hardiment au milieu des hommes ; et les habitudes sédentaires de la vierge athénienne préparaient plus sûrement en elle la douce gardienne du foyer que les jeux et les exercices publics de la jeune Spartiate. La race éolienne et les peuples doriens autres que les Spartiates, préservèrent leurs filles des excès de ces deux éducations. Tout en laissant à la femme le goût des occupations domestiques, ils favorisèrent en elle l'épanouissement de l'intelligence. Les antiques législations prolongeaient le temps pendant lequel les jeunes filles attendaient l'heure du mariage. On ne sait pas précisément à quel âge Lycurgue permettait l'hymen[17] ; mais ce qu'on n'ignore pas, c'est qu'il défendit aux jeunes gens de s'unir avant qu'ils eussent atteint le complet développement de leur vigueur. Toutefois, si l'homme se mariait trop tard, il s'exposait à une accusation publique dont se trouvaient aussi menacés, et celui qui contractait une union mal assortie, et celui qui demeurait célibataire. L'homme qui refusait de 'donner des enfants à Sparte, était particulièrement noté d'infamie. Entre autres châtiments, il était, pendant une fête, traîné autour d'un autel par les femmes, qui le frappaient ; et il ne pouvait assister aux combats gymniques des jeunes filles parmi lesquelles il avait dédaigné de se choisir une compagne[18]. A Athènes, l'âge de l'hymen était autrefois fixé à trente-cinq ans pour l'homme, à vingt-six ans pour la femme. Cet âge fut abaissé dans la suite[19]. Quant au célibataire, si la loi qui, dit-on, le décrétait d'accusation, tomba en désuétude, il ne put du moins être général ou orateur, fonctions réservées à ceux qui, pères de familles et propriétaires, protégeaient dans leur pays leur propre foyer[20]. Dans beaucoup de pays grecs, ce n'était qu'entre les enfants d'un même État que se contractaient les mariages[21]. Les Athéniens surtout proscrivaient sévèrement les unions avec les étrangers. Gardiens jaloux de la pureté de leur sang et de la possession de leurs libertés, ils se refusaient à des alliances qui eussent introduit dans leur cité les descendants d'autres races, et qui eussent fait participer ces intrus à leurs glorieux privilèges. L'étranger ou l'étrangère qui épousait un membre de la nation athénienne, était vendu comme esclave ; ses biens étaient confisqués, et le tiers en était remis au dénonciateur qui l'avait traduit devant les thesmothètes. L'Athénien qui, faisant passer une étrangère pour sa fille, l'avait frauduleusement mariée à l'un de ses concitoyens, se voyait enlever sa fortune de la même manière, et perdait ses droits civils. Quant à celui qui s'était uni à une étrangère, la loi le jugeait sans doute assez puni par le chagrin de voir vendre sa compagne, et le condamnait simplement à une amende de mille drachmes. Les enfants nés de ces unions étaient rayés des registres de l'état civil ; et si, après avoir appelé de cette mesure devant un tribunal, ils perdaient leur procès, alors, eux aussi, ils étaient vendus comme esclaves[22]. Les fréquentes entrevues que le Lacédémonien avait avec les filles de son pays, les plus belles femmes de la Grèce, lui permettaient de se choisir lui-même une compagne suivant son cœur[23], privilège dont jouissait bien rarement l'Athénien qui n'entrevoyait guère les vierges que dans les pompes religieuses. Les législateurs de Sparte et d'Athènes s'accordèrent pour proscrire ou pour limiter la dot. Lycurgue avait voulu que seules les vertus d'une jeune fille attirassent les regards de ceux qui la recherchaient, et que rien d'étranger à sa personne ne contribuât à les éblouir. Il lui défendit aussi bien de demander au fard et aux parures un éclat emprunté, que d'offrir à ses prétendants une fortune qui leur fit oublier sa valeur individuelle[24]. Les Spartiates comprirent cette double pensée de leur législateur, témoin ce père qui, craignant que ses filles ne lui parussent moins belles en étant moins simples, refusait les vêtements précieux que leur envoyait Denys, tyran de Sicile[25] ; témoin aussi cette jeune et pauvre Lacédémonienne à qui l'on demandait quelle était sa dot, et qui répondait fièrement : La pudeur de ma famille[26]. La question posée à cette noble enfant se rapporte probablement à une époque où l'amour des richesses, s'introduisant dans Sparte, rendit vénal le lien du mariage, à une époque où les filles d'un grand homme étaient délaissées après la mort de leur père, par leurs fiancés auxquels elles n'auraient apporté d'autre fortune que la gloire de leur maison. Ajoutons cependant que, dans le pays où l'on punissait comme coupable d'une union mal assortie celui qui avait préféré la fortune à la vertu, ces hommes lâches furent punis d'une amende[27]. Les lois de Solon furent aussi méconnues à cet égard. Le législateur athénien avait vu dans le mariage, non le rapprochement de deux fortunes, mais l'union de deux cœurs et la source sacrée de la paternité. Il déclara donc que la fiancée n'apporterait en mariage, en sus d'une dot, sans doute, que trois vêtements et quelques meubles d'une valeur minime[28]. Mais, dans les temps postérieurs, des sommes parfois considérables et de riches parures accompagnèrent la nouvelle épouse dans la demeure conjugale ; et la fille pauvre fut menacée de vieillir dans le célibat, à moins que son père ne l'eût exposée dès sa naissance, ou que, de même que l'Arabe de l'époque antéislamique, il ne se fût armé à son égard du droit qu'avaient les chefs de famille sur la vie de leurs enfants. L'apport de la dot fut ce qui distingua surtout l'épouse, de la femme illégitime. Aussi la première fût-elle même sans fortune, s'était-elle vu reconnaître par son fiancé une dot qui assurait sa dignité de maîtresse de maison[29]. A Sparte, aussi bien qu'à Athènes, la femme pouvait voir sa fortune singulièrement accrue, lorsque n'ayant point de frère, elle héritait des biens paternels[30]. En ce cas, la fille unique, ou la plus âgée des filles que laissait un Spartiate, lui succédait dans la possession d'une des terres qui avaient été également distribuées par Lycurgue entre neuf mille citoyens, et qui étaient léguées aux aînés des familles. L'héritière épousait probablement alors celui de ses compatriotes qui n'avait point d'apanage, et qui était choisi, d'abord parmi ses parents, puis dans le sein de sa tribu, et enfin dans le reste de la cité. La désignation du fiancé devait être faite par le père de la jeune fille, mais non pas arbitrairement ; et si celui-ci était mort sans avoir rien statué à cet égard, le sort de l'orpheline était remis à la justice du roi[31]. L'Athénien qui avait une fille, ne pouvait instituer un autre légataire qu'en la lui fiançant[32]. Mourait-il intestat, l'héritière devait épouser son plus proche parent[33]. Laissait-il plusieurs filles, elles se partageaient également ses biens, et épousaient ceux de leurs collatéraux que les nœuds de la parenté rattachaient le plus intimement à elles. L'héritière devait être revendiquée devant l'archonte éponyme, protecteur des faibles, par le parent qui se croyait autorisé à réclamer sa main. Si un autre collatéral disputait son alliance, il devait signifier au premier une citation devant ce magistrat suprême ; et celui-ci portait la cause en litige, devant un tribunal qui décidait auquel des deux prétendants appartenait, selon le degré de parenté, le droit d'épouser la jeune fille. Fût-elle déjà mariée par son père, l'orpheline devait suivre le nouvel époux que lui donnait la loi. L'homme à qui venait à échoir la revendication d'une héritière, pouvait répudier sa première femme[34]. L'enfant qui naissait de l'orpheline, recevait le nom de son aïeul maternel. Considéré comme le fils de ce dernier, il perpétuait sa race et son héritage[35]. Par ces dispositions qui rappellent les lois de Moïse et de Manou, se trouvait atténuée chez l'Athénien, la douleur de mourir sans enfants. Comme l'Hébreu, il voulait que son nom ne fût pas retranché de son héritage, et que sa postérité perpétuât sa foi religieuse. Comme l'Hindou, il voulait que ses descendants honorassent ses mânes des offrandes funèbres, non qu'il crût, ainsi que son frère du Gange, que son expiation d'outre-tombe pût être abrégée par ces sacrifices, mais il aimait à penser que le culte de sa mémoire vivrait encore dans ces pieuses coutumes[36]. Si, dans la ville de Minerve, le plus proche parent de l'orpheline avait le droit de participer à sa fortune, il avait aussi le devoir d'alléger sa pauvreté. Il ne pouvait renoncer à sa main qu'en lui accordant une dot calculée d'après la classe à laquelle il appartenait[37]. Les collatéraux à degré égal se cotisaient pour établir la jeune fille ; mais si plusieurs sœurs avaient perdu leur père, l'une d'elles seulement était épousée ou dotée par celui de ses parents à qui cette obligation était imposée. L'archonte devait soigneusement veiller à l'exécution d'une loi si humaine. Négligeait-il de la faire observer, il était condamné à une amende de mille drachmes, somme qui enrichissait le temple de la déesse qu'il avait offensée : Junon, la protectrice du mariage[38]. La loi de Solon, d'après laquelle les orphelines pauvres étaient établies par leurs proches, fut une de celles que le législateur Charondas donna à Thurium, colonie athénienne de la Grande-Grèce. Voulant prévenir la trop grande facilité avec laquelle les États corrompaient leurs constitutions, Charondas établit que, quiconque proposerait la révision d'une loi, serait conduit, la corde au cou, devant l'assemblée. Si le peuple adoptait cette motion, le citoyen qui en avait pris l'initiative était libre. Sinon, il était immédiatement étranglé. Deux fois seulement, des Thuriens avaient osé braver ce péril. Or, un jour vint où une femme parut devant l'assemblée. Orpheline et noble, elle était pauvre, et la dot de 500 drachmes que lui assurait la loi, était trop humble pour lui attirer un époux. Tout en pleurant, la jeune fille retraçait l'abandon où elle se trouvait ; et exposant sa vie pour échapper à son isolement, elle demandait à ses compatriotes d'ordonner que le parent d'une orpheline fût forcé de remplacer le don d'une dot modique par celui de sa main, lorsque sa pupille le poursuivrait en justice. Tant de douleur, tant de courage, émurent le peuple. En votant la réforme proposée par l'une de ses filles, il lui sauva la vie et l'arracha au malheur : un riche parent de la jeune Thurienne dut l'épouser[39]. La nation athénienne dota elle-même les tilles ou les descendantes d'un grand homme[40]. Ajoutons que des orphelines furent aussi établies par des citoyens étrangers à leurs familles[41]. A Sparte, lorsqu'un père avait accepté pour gendre un jeune homme[42], celui-ci devait enlever sa fiancée. Il la déposait chez la femme qui avait négocié le mariage, et qui, après avoir dépouillé la nouvelle épouse de sa chevelure, lui donnait un habit et une chaussure d'homme. Ayant, comme d'ordinaire, sobrement partagé le repas public qu'il prenait avec ses camarades, le marié entrait alors dans la maison où se trouvait sa compagne et où cette dernière demeurait pendant quelque temps encore. Les deux époux ne pouvaient se voir qu'a la dérobée jusqu'au moment où la jeune femme était installée par son mari dans la maison de celui-ci. Suivant une coutume qui parait avoir existé aussi en Crète, il arrivait qu'elle était déjà mère quand elle entrait dans la demeure conjugale[43]. Chez les Athéniens, de même que chez les Hébreux, les fiançailles étaient la partie essentielle du mariage, celle qui en constituait la légalité. Aussi la dot de la femme y était-elle mentionnée. Lis jeunes gens ne pouvaient contracter ce lien sans le consentement de leurs pères et de leurs mères. Si l'Athénienne était orpheline du côté paternel, son frère, ou son aïeul, ou son tuteur, disposait d'elle. En présence des deux familles, le père de la jeune fille, prononçant l'une des formules usitées dans les fiançailles, s'adressait ainsi à l'homme dont, il agréait l'alliance : Afin que naissent des enfants légitimes, je te donne ma fille. Les fiancés échangeaient leurs serments en unissant leurs mains droites ou en s'embrassant ; et la jeune personne recevait, en témoignage d'amour, un don de son nouveau protecteur[44]. Le mois attique, spécialement consacré aux solennités nuptiales, se nommait Gamélion, et correspondait en partie au mois de janvier. Dans divers États grecs, la veille du mariage en général, on cherchait à attirer sur les futurs époux, par des prières et des sacrifices, la bienveillance des divinités favorables ou hostiles au mariage. Selon les cultes particuliers à chaque localité, c'était le Ciel et la Terre, couple primordial ; Jupiter et Junon, protecteurs spéciaux de l'hymen ; Vénus, souriante personnification de la beauté et de la fécondité ; les Parques qui président à la vie ; la Bonne Renommée et les Grâces qui en font l'honneur et le charme. C'était aussi l'austère Minerve à qui la fiancée athénienne ou argienne faisait agréer le sacrifice expiatoire de sa chevelure[45] ; c'était encore la farouche Diane dans le bois de laquelle la fiancée syracusaine se présentait, portant dans une corbeille de mignonnes offrandes destinées à apaiser la déesse, tandis que des animaux féroces, entourant la canéphore, témoignaient devant Diane, par leur présence, que les êtres les plus sauvages se courbaient sous la puissance de l'hymen[46]. Par d'autres sacrifices, on cherchait à savoir si les dieux étaient favorables au mariage qui allait être contracté. Les entrailles de la victime étaient consultées, et suivant que les devins y découvraient des présages ou heureux ou funestes, l'hymen était ou cimenté ou rompu. L'apparition de deux tourterelles ou de deux corneilles était aussi d'un joyeux augure : les premières annonçaient que l'amour unirait les fiancés ; les secondes, remarquables par leur longévité et par leur fidélité, promettaient que cet amour serait sans fin, et charmerait encore l'extrême vieillesse des époux. Mais rappelons-nous ce chant nuptial : Jeune fille, chasse la corneille[47]. Ah ! c'est que cet oiseau est aussi, lorsqu'il est seul, le symbole du veuvage inconsolable. Dans le sacrifice offert à Junon nuptiale, le fiel de la victime était jeté derrière l'autel. On désirait ainsi éloigner des fiancés le courroux céleste, et leur montrer en même temps qu'aucune aigreur ne devait troubler leurs relations[48]. Comme en Palestine, le bain était l'une des cérémonies du mariage. L'eau qu'on y destinait était, à Athènes, la seule qui provînt d'une source ; c'était celle de la fontaine Callirhoé, la fontaine au beau cours près de laquelle se réunissaient les femmes, et que Pisistrate fit décorer avec élégance[49]. A la célébration de l'hymen, les fiancés, vêtus de pourpre, les cheveux flottants et parfumés, sont couronnés de fleurs consacrées à Vénus[50]. La mariée n'a pas acheté les pavots, les sésames, les autres plantes qui ceignent son front. Chez les Hellènes, une couronne nuptiale qui aurait été échangée contre de l'argent, serait devenue d'un mauvais présage[51]. Aussi la jeune fille a-t-elle cueilli de sa main ces riants emblèmes de l'amour. N'y a-t-il pas dans cette touchante coutume, autre chose encore qu'une superstition ? N'y lit-on pas que les chastes tendresses de l'hymen ne s'achètent pas plus que les fleurs qui les symbolisent ? La couronne placée sur le voile de la fiancée béotienne se composait d'asperges sauvages. Si la tige de cette plante est armée d'aiguillons, le fruit en est aussi doux que ce bonheur dont les époux ne jouissent qu'en supportant mutuellement les aspérités de leurs caractères[52]. Une première fête a lieu dans la demeure de la fiancée. Est-ce alors que le père opulent, remplissant de vin une coupe d'or massif, l'offre à son gendre comme un souvenir destiné à passer de génération en génération[53] ? Chez les Gaulois, nous verrons aussi apparaître la coupe nuptiale ; mais celle-ci, présentée par la jeune fille à l'homme qu'elle choisit pour époux, devient le signe d'une alliance librement contractée par elle. Dans la soirée, la fiancée grecque monte dans le char qui la conduira à sa nouvelle habitation. Elle s'y place entre le marié et le plus intime ami de celui-ci, le paranymphe[54]. Homère nous ayant déjà fait suivre le brillant cortège des jeunes époux, nous n'en retracerons plus l'aspect. Nous sommes arrivés devant la maison nuptiale, étincelante de lumières. Cette demeure, ainsi que celle que nous venons de quitter, se pare aujourd'hui de guirlandes de laurier et de lierre. La plante chère à Apollon, et dont le feuillage aromatique inspire le génie et couronne la gloire, cette plante ne nous paraît pas destinée à saluer spécialement l'entrée de la femme. A l'époux, le laurier ! Mais à sa jeune compagne, le lierre, le lierre faible et gracieux qui, recherchant la force, s'enlace à l'arbre ou s'appuie sur le roc, le lierre qui devient ainsi le symbole de l'attachement conjugal ! Lorsque les époux, se tenant par la main, atteignent le seuil de la porte, une corbeille de figues et de fruits divers est momentanément placée sur leurs têtes : c'est ainsi qu'avec le jeune couple l'abondance entre dans la maison. Mais cette prospérité dépend de la manière dont la femme saura remplir ses devoirs de maîtresse de maison. Aussi, au milieu des festons et des illuminations qui ornent sa nouvelle demeure, la mariée a-t-elle vu au-dessus de la porte l'instrument qui sert à piler les grains ; une de ses suivantes porte un crible, et elle-même pénètre dans sa maison avec un de ces vases de terre où l'on fait griller l'orge. C'est dans cette demeure, c'est là seulement que s'exercera désormais son activité bienfaisante. Le seuil qu'elle vient de franchir sera maintenant la limite de sa liberté ; et, en Béotie, on le lui fait particulièrement comprendre en brûlant devint la maison conjugale l'essieu du char qui, après y avoir conduit la fiancée, ne pourra plus en ramener l'épouse[55]. Comme aux temps homériques, la solennité nuptiale consistait en un banquet dont les convives étaient autant de témoins de l'union contractée. Bien qu'à Athènes, les femmes ne fussent pas invitées aux repas où figuraient les hommes, on dérogeait à cette coutume pour les mariages ; mais il parait que la fiancée, toujours voilée, et les autres femmes, occupaient une table particulière[56]. Des chants et des danses fêtent les dieux de l'hymen. A moitié couvert d'aubépine et de chêne, un enfant, portant une corbeille de pains, module un hymne qui débute ainsi : J'ai fui le mauvais, j'ai trouvé le meilleur[57]. Que d'images fait surgir cette apparition ! L'aubépine, blanche parure des forêts, le chêne dont les glands nourrissaient les Pélasges, rappellent l'époque antique où les hommes vivaient sans liens sociaux. Mais les pains dont le jeune Hellène est chargé, témoignent qu'en abandonnant leurs retraites, les Grecs goûtèrent ensemble les grains du blé, et s'unirent par le mariage, cette institution qui devait son caractère sacré au fondateur d'Athènes[58]. J'ai fui le mauvais, j'ai trouvé le meilleur, pouvaient se dire les Grecs primitifs, quittant leurs habitudes sauvages pour constituer régulièrement la famille, la première et la plus douce des sociétés[59] ; la cité, la famille agrandie ! J'ai fui le mauvais, j'ai trouvé le meilleur, pense aussi l'heureux époux, renonçant à l'isolement du célibat, et recevant sous son toit da femme qui consolera sa vie et fondera sa race ! Il n'est pas bon à l'homme d'être seul, avait dit le Dieu de la Genèse, le Dieu de l'humanité. Les mariés se dirigent vers leur appartement à la lueur des flambeaux. Leurs mères surtout observent avec un soin pieux la coutume de porter les torches nuptiales[60]. Puis, quand, à Athènes, les époux ont vu s'éloigner leurs familles, la loi leur ordonne de manger ensemble un coing, fruit dont la douceur symbolise celle qui doit présider à leurs relations[61]. Mais que nous soyons dans une cité ou dorienne ou ionienne, quels accents frais et gracieux, quels poétiques échos du Cantique des cantiques[62] nous appellent hors de l'appartement nuptial ! Douze vierges, couronnes d'hyacinthe, chantent l'épithalame, et leurs pieds frappent la mesure. Elles regrettent celle qui, sous les yeux de sa mère, partageait leurs jeux, et dont elles louent les charmes et les talents. Ô belle, ô aimable fille ! te voilà maintenant au rang des épouses. sous, dans nos courses du matin, lorsque nous irons cueillir les fleurs des prairies pour en tresser des couronnes odorantes, nos cœurs soupireront après toi comme l'agneau nouveau-né soupire après le lait de sa mère[63]. Et continuant leurs chants d'hyménée, les jeunes filles se proposent de suspendre une couronne de lotos sous un platane qu'elles arroseront avec les essences parfumées contenues dans un vase d'argent. -Une inscription, gravée sur l'écorce de l'arbre, prescrira au passant de le respecter : le majestueux platane sera l'arbre fie leur compagne à jamais absente. Les vierges saluent les nouveaux époux, et demandent pour eux aux Immortels une noble postérité, un mutuel amour, une opulence durable. Elles se retirent enfin, non sans annoncer leur retour : Demain, dès que le chantre du matin, dressant sa crête superbe, appellera le jour, nous reviendrons chanter l'hymen. Ô Hymen, réjouis-toi de cette union ![64] Théocrite, le poète dorien, nous a fait entendre l'épithalame du soir ; c'est un chantre de l'Ionie, c'est Anacréon qui nous livre le chant nuptial du matin : Vénus, reine des déesses ; Amour, puissant vainqueur ; Hymen, source de vie, c'est vous que je célèbre dans mes vers. C'est vous que je chante, Amour, Hymen et Vénus. Regarde, jeune homme, regarde ta maîtresse ; lève-toi, Stratocle, favori de Vénus, Stratocle, mari de Myrille, admire ta jeune épouse ; sa fraîcheur, ses grâces et ses charmes la font briller entre toutes les femmes. La rose est la reine des fleurs : Myrille est une rose au milieu de ses compagnes.... Puisses-tu bientôt voir croître dans ta maison un fils qui te ressemble ![65] A Athènes, cette aurore ouvrait encore un jour de fête : c'était probablement celui qui était consacré à la réception des présents nuptiaux. Les époux échangeaient des dons et agréaient ceux de leurs amis. Comme la jeune femme paraissait pour la première fois sans être voilée, les souvenirs que lui offraient son mari et les amis de celui-ci, étaient destinés à rappeler ce moment. Les dons que les époux recevaient en commun du père de la mariée, étaient solennellement apportés. Un enfant, vêtu de blanc, et tenant une torche, précédait une jeune canéphore que suivaient des femmes chargées de vases précieux, de boîtes à parfums et d'autres objets. Dans la soirée, la jeune femme revenait auprès de ses parents chez lesquels elle passait la nuit. Touchant retour qui adoucissait et pour sa famille et pour elle, l'amertume d'une première séparation[66]. Lorsque, dans la digne situation que lui assurait la monogamie[67], la femme grecque était installée dans la maison conjugale, une vie pleine de recueillement s'ouvrait à elle. Ce changement était très-sensible surtout dans l'existence de la jeune Spartiate. Pour elle, plus de ces exercices publics, plus de ces fêtes joyeuses, où un léger vêtement lui permettait de déployer en toute liberté son activité physique ! Elle se retire maintenant dans cette humble demeure à la construction de laquelle la cognée et la scie ont seules pu être employées, et où l'on ne remarque d'autre luxe que la bonne exécution des meubles les plus utiles, les lits, les sièges, les tables[68]. Quand la femme mariée sort de sa maison, un tissu abrite son visage. Comme on demandait à Charilaus pourquoi le voile qui ne couvrait pas la vierge, était porté par l'épouse, il répondit : C'est que les filles ont besoin de trouver un mari, et les femmes de conserver le leur[69]. La beauté morale de la Spartiate ne devait pas plus être louée que sa beauté physique, par d'autres hommes que son mari. Dans les premiers temps de Lacédémone, sa chasteté était si bien reconnue qu'aucune loi pénale n'avait prévu le cas où la vertu de l'épouse pourrait défaillir[70]. Si. à Sparte comme à Athènes, des magistrats veillent à la conduite de la femme, nulle autre surveillance ne contraint l'épouse lacédémonienne. Si cette dernière sait garder la maison, si elle sait être fidèle, elle sait aussi être libre[71]. Quelle n'est pas son influence ! Son mari, presque toujours sous les armes, lui abandonne le gouvernement de la maison, et le rude soldat se courbe sous la volonté de sa compagne. Ainsi Aristote remarque que les peuples guerriers ont facilement subi l'ascendant des femmes, et que ce n'est pas en vain que l'union de Mars et de Vénus a été imaginée. — Le Spartiate ne craint même pas de reconnaître hautement cette autorité domestique, et il appelle sa femme despoina, maîtresse[72]. Ce titre du reste était un héritage de l'époque védique où le nom de patnî, maîtresse, s'appliquait à l'épouse, comme celui de pati, maître, désignait l'époux[73]. Au temps d'Aristote, Sparte n'était plus l'asile de l'austère simplicité et de la pauvreté fière. Pour plaire à ces Lacédémoniennes que dévorait alors la soif du luxe, il fallait des richesses, et c'est ainsi que s'introduisit dans la ville de Lycurgue, cet amour de l'or que le législateur avait cru étouffer. Sparte n'était même plus la cité des femmes courageuses et chastes. Devant cette décadence, Aristote fait à Lycurgue un reproche contre lequel le défend Plutarque : c'est de n'avoir pas étendu jusque sur les femmes les réformes qu'il opéra chez ses concitoyens. Le philosophe de Stagire rapporte une opinion d'après laquelle le législateur aurait tenté cette épreuve, mais n'aurait pu assouplir sous le même joug que les hommes déjà domptés par la discipline des camps, les femmes habituées à régner dans leurs maisons[74]. Il fallait blâmer Lycurgue d'avoir, non pas négligé, mais faussé l'éducation des femmes lacédémoniennes. Une culture aussi artificielle pouvait, dans les premiers temps, faire naître des fruits d'une beauté extraordinaire, mais ne devait pas tarder à produire des sujets difformes. Aux derniers temps de son existence politique, Sparte eut un admirable réveil auquel participèrent des femmes pures et fortes comme celles de Lycurgue, mais chez lesquelles un courage viril n'exclut point la délicatesse morale de leur sexe. La liberté, l'autorité des femmes, signes caractéristiques de la race dorienne, se retrouvent chez les Thessaliens et les Épirotes, ces populations pélasgiques dont les Doriens s'étaient séparés plus tard que les autres branches de la famille hellénique ; et chez ces Macédoniens auxquels ils s'étaient unis. Chez ces peuples aussi bien que dans certaines colonies doriennes, la femme pouvait régner[75]. Les droits dont jouissaient les femmes dans la Grèce septentrionale, développèrent en elles un caractère énergique, mû tantôt par la générosité, tantôt par la cruauté, ou sachant même s'inspirer de l'une et de l'autre. L'indépendance de la femme dorienne se retrouve jusque dans son langage. L'idylle des Syracusaines, ce chef-d'œuvre où Théocrite nous apparaît avec le vif et scintillant esprit d'un homme de cour et la scrupuleuse et vivante fidélité d'un poète de la nature, ce tableau de mœurs nous donnera une idée complète de l'allure hardie et fière qui était propre aux femmes de cette race. Théocrite met en scène Gorgo et Praxinoé, Syracusaines qui habitent avec leurs maris la ville d'Alexandrie alors soumise à la dynastie grecque des Lagides. La cité égyptienne est en fête ; elle va célébrer Adonis, le beau favori de Vénus. Gorgo vient chercher son amie pour la conduire à cette solennité. C'est ici que commence le poème que nous allons essayer de traduire, tout en désespérant de faire passer dans notre langue la grâce, l'énergie, la spirituelle malice du modèle. GORGO[76]. Praxinoé y est-elle ? PRAXINOÉ. Chère Gorgo, comme tu viens tard ! J'y suis. Je m'étonne que tu sois venue maintenant. Cherche-lui un siège, Eunoé, et mets-y un coussin. GORGO. C'est pour le mieux. PRAXINOÉ. Assieds-toi. GORGO. Ô l'âme extravagante[77] ! C'est avec peine, Praxinoé, que je réchappe jusqu'à vous de cette multitude de peuple et de chars. Partout des trépides[78], partout des hommes portant la chlamyde[79]. La route interminable ! Tu demeures trop loin de moi. PRAXINOÉ. C'est à cause de ce fou (le mari....) qui est venu acheter au bout du monde une tanière, non une maison, afin que nous ne fussions pas voisines l'une de l'autre. Pour la dispute, toujours le même, méchant jaloux ! GORGO. Ne parle pas ainsi de ton mari Dinon devant le petit, ma chère. Vois, femme, comme il te regarde ! Rassure-toi, Zopyrion, doux enfant, elle ne parle point de papa. PRAXINOÉ. Il comprend, le petit enfant, oui, par la vénérable déesse ! GORGO. Il est beau, papa ! PRAXINOÉ. Or, ce papa-là, dernièrement (je dis dernièrement, c'est-à-dire en tout temps), étant allé aux baraques du marché pour acheter du nitre et du fard, revint à la maison nous apportant du sel, le géant[80] ! GORGO. Ce bourreau d'argent, Dioclède (encore un mari....), en fait certes de pareilles. Hier il acheta au prix de sept drachmes chacune, cinq toisons, vraies peaux de chiens[81], vieilles besaces aux poils arrachés brin à brin.... Mais allons, mets l'ampéchonion et la péronétris[82]. Allons au palais de l'opulent Ptolémée, contempler l'Adonis. J'entends dire que la reine a préparé quelque chose d'admirable. PRAXINOÉ. Chez le riche, richesses partout. Des choses que tu as vues et de celles dont tu viens de parler, à qui n'a pas vu[83]..... GORGO. Il est temps de se mettre en route. PRAXINOÉ. Pour les oisifs il est toujours fête. Eunoé, apporte de l'eau, fainéante.... Les chats demandent à dormir mollement. Remue-toi donc, apporte l'eau plus vite. C'est de l'eau qu'il faut auparavant. Elle apporte le savon ! Donne cependant. Ne verse pas tant d'eau, insatiable. Malheureuse, tu arroses ma tunique ! Assez. Je me suis lavée comme il plaît aux dieux. La clé du grand coffre ? Apporte-la ici. GORGO. Praxinoé, cet empéronéma[84] plissé te sied beaucoup. Dis-moi, combien t'en a coûté le tissage ? PRAXINOÉ. Ne me le rappelle pas, Gorgo. Plus d'une mine d'argent pur ou deux ; et quant au travail, j'y ai exposé ma vie. GORGO. Mais du moins cela a réussi à ton gré. PRAXINOÉ. C'est parler avantageusement. (A Eunoé) Apporte mon ampéchonion, et place le chapeau rond[85] sur ma coiffure. Je ne t'emmènerai pas, mon fils : Mormô (Croquemitaine) ! Le cheval mord. Pleure autant que tu le voudras ; il n'est pas nécessaire que tu deviennes boiteux. Allons-nous-en. Phrygia, prends le petit et joue avec lui ; appelle le chien à l'intérieur, ferme la porte de la cour. Ô dieux, quelle foule ! Comment et quand faudra-t-il la traverser ? Fourmis innombrables et immenses ! Tu as fait de grandes choses, ô Ptolémée, depuis que ton père est chez les Immortels. Nul méchant, se glissant furtivement à l'égyptienne, n'outrage le voyageur comme auparavant, lorsque ces hommes forgés de ruses, semblables les uns aux autres, tous querelleurs, s'amusaient à de mauvais jeux. Très-douce Gorgo, qu'allons-nous devenir ? Les chevaux de bataille du roi ! Mon ami, ne me foule pas aux pieds. Le cheval roux se dresse debout. Vois comme il est sauvage ! Eunoé, effrontée, ne songes-tu pas à fuir ? Il tuera son cavalier. J'ai été grandement heureuse que mon petit enfant soit resté à la maison. GORGO. Rassure-toi, Praxinoé : nous sommes derrière eux. Ils s'en sont allés à la place. PRAXINOÉ. Enfin je me remets. Le cheval et le serpent qui glace, c'est ce que je crains le plus depuis l'enfance. Hâtons-nous. Une foule nombreuse afflue vers nous. GORGO. Viens-tu de la cour, ô ma mère ? UNE VIEILLE. J'en viens, ô mes enfants. GORGO. Est-il aisé d'y pénétrer ? LA VIEILLE. C'est en essayant que les Grecs entrèrent dans Troie, la plus belle des enfants ! Par l'effort on exécute assurément tout. GORGO. La vieille s'éloigne en rendant des oracles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regarde, Praxinoé, combien de foule autour des portes ! PRAXINOÉ. Immense ! Gorgo, donne-moi la main. Prends aussi, Eunoé, celle d'Eutychis. Tiens-toi auprès d'elle, ne t'écarte pas. Que nous entrions toutes ensemble ! Tiens ferme auprès de nous, Eunoé. Hélas, malheureuse ! mon vêtement d'été est déjà déchiré en deux, Gorgo. Pour Dieu, si tu veux devenir heureux, ô homme, prends garde à mon ampéchonion. L'ÉTRANGER. Cela ne dépend pas de moi, cependant j'y veillerai. PRAXINOÉ. Quelle foule compacte !..... L'ÉTRANGER. Rassure-toi, femme, nous sommes en bonne situation. PRAXINOÉ. Maintenant et toujours, toi qui m'es cher parmi les hommes, puisses-tu être heureux, toi qui nous as protégées I Homme bon et compatissant ! Eunoé est pressée contre nous. Pousse, ô infortunée, force-toi un passage. C'est au mieux. Tous sont entrés.... GORGO. Praxinoé, approche-toi d'ici. Regarde d'abord ces étoffes brodées. Combien elles sont délicates et gracieuses ! tu dirais les vêtements des dieux. PRAXINOÉ. Vénérable Minerve, quelles ouvrières en laine y ont travaillé ? Quels peintres ont exécuté ces tendres dessins ? Combien naturellement ces figures se tiennent et combien naturellement elles se meuvent ! Elles sont vivantes et non tissues. Assurément l'homme est un être d'une singulière sagesse.... UN AUTRE ÉTRANGER. Cessez, ô malheureuses, tourterelles jasant sans fin ! Ouvrant une grande bouche[86], elles nous étourdiront partout. GORGO. Par Cérès ! Comment cela, ô homme ? Que t'importe si nous sommes babillardes ? Commande à ceux qui t'appartiennent. Commandes-tu aux Syracusaines ? Que tu saches que nous sommes d'origine corinthienne, comme Bellérophon. Nous parlons péloponnésien. Il est permis, je crois, aux Doriennes de dorienniser. PRAXINOÉ. Ne fais pas naître, ô Proserpine, l'homme qui nous dominerait ! Je ne m'inquiète que d'un seul maître. Que tu ne me traites pas en esclave[87] ! GORGO. Silence, Praxinoé ! Elle se prépare à chanter l'Adonis, la fille d'Argos, l'habile chanteuse qui remporta le prix du Sperchis, l'hymne plaintif. Elle chantera, je le sais bien, avec talent. Elle minaude déjà. (La chanteuse module son hymne, et lorsqu'elle l'a
terminé, Gorgo, enthousiasmée, dit à son amie) : Praxinoé, c'est plus beau que je ne croyais. Heureuse femme, qu'elle est instruite ! Tout à fait heureuse, qu'elle chante doucement ! Il est l'heure cependant de rentrer à la maison. Quand Dioclède n'a pas dîné, cet homme est tout vinaigre. Je ne vais jamais à lui lorsqu'il a faim. Adieu, aimable Adonis, et viens parmi ceux qui se réjouissent[88]. — Nous n'avons voulu interrompre par aucun commentaire, le mouvement si rapide et si naturel de cette scène. Avec quelle vérité se dessinent les caractères et les situations ! Ces femmes qui, à peine réunies, se plaignent de l'époux absent, et louent la toilette de l'amie.... présente, ces femmes ont réellement vécu, peut-être vivent-elles encore ! Mais ce qui est particulier au caractère dorien, c'est le ton impérieux avec lequel la femme parle de son mari ou s'adresse à son esclave. Son mari, c'est l'homme qui pourrait devenir son maître ; son esclave, c'est la chose dont elle est elle-même maîtresse. Avec le premier, elle sauvegarde son indépendance ; avec la seconde, elle maintient son autorité. Elle a le grand défaut de sa race : l'amour effréné de la liberté et de la domination. A un moment, il est vrai, l'esclave reçoit de sa maîtresse, des preuves de sollicitude. Mais est-ce par pitié pour Eunoé, ou par intérêt pour elle-même, que Praxinoé s'inquiète de la pauvre fille qui est sa propriété ? Le sentiment qui lui fait craindre que son esclave ne soit écrasée, n'est-il pas le même que celui qui lui fait regretter que son vêtement soit déchiré ? Que notre héroïne se nomme Gorgo ou Praxinoé, la Dorienne se retrouve surtout lorsqu'un homme, un inconnu, se moque de son accent, et veut lui imposer silence. Eh quoi, cet étranger critique son langage, et de plus il lui donne des ordres ! Par quelle audace se permet-il de railler une Syracusaine, et même, chose inouïe, de la traiter en esclave ! Aussi, en lui répondant avec une vivacité dédaigneuse, défend-elle à la fois la noblesse de son origine et la fierté de son sexe. La hardiesse de son langage ne l'empêche pas d'être sujette à toutes les terreurs des femmes. Elle se laisse effrayer par la foule, par les chevaux. Les craintes qu'elle exprime, les exclamations qui lui échappent, nous transportent avec elle dans ce flot mouvant qui l'entraîne, et dont l'agitation est reproduite avec une fidélité qui tient de la magie. Empressons-nous de dire encore que cette hautaine fille de Syracuse sait montrer quelquefois un caractère aussi solide que charmant. Elle ne quitte sa maison qu'après en avoir assuré la sécurité. Elle a soin de son petit enfant qu'elle ne veut pas faire estropier au milieu de la foule, et qu'elle laisse prudemment jouer au logis avec l'une de ses femmes. Puis, si elle sent vivement un mauvais procédé, comme elle sait remercier l'homme qui, dans la cohue, lui a rendu quelque bon office ! Que de gracieuse simplicité, que d'effusion naïve et touchante dans l'expression de sa gratitude ! Enfin, si notre Syracusaine a l'enthousiasme du bon, elle a aussi à un très-haut degré, le sentiment d u beau. La manière dont elle loue les tentures intérieures du palais, décèle un goût exquis. En vraie fille de la Grèce, ce qu'elle apprécie surtout dans une œuvre d'art, c'est le naturel ; et lorsque cette œuvre lui parait vivante à force d'être vraie, alors elle admire le génie créateur de l'homme. Après avoir entendu la femme qui a composé et chanté l'hymne d'Adonis, elle envie le bonheur de celle qui sait concevoir et exprimer le beau. Toutefois son exaltation ne lui fait pas oublier les soins prosaïques du ménage. Elle se souvient que son mari doit avoir faim ; mais elle ne quitte pas le palais sans avoir prié l'aimable Adonis d'embellir de sa présence, l'une de ces fêtes qui répandent de temps à autre sur la vie leur charme poétique. N'importe. Après avoir suivi dans une foule bruyante, nos libres et impérieuses Doriennes, nous éprouvons le besoin de nous reposer dans la maison athénienne où nous avons vu entrer une fiancée. Plus profonde que large, cette maison est simple, car les Athéniens réservent à leurs dieux les splendeurs de leur architecture. Après avoir franchi le seuil de la porte, nous nous trouvons dans un corridor étroit placé entre la loge du portier et les écuries[89]. Ce couloir nous mène dans le péristyle, cour entourée des quatre portiques qui décorent l'appartement des hommes. Là se trouve l'autel des dieux domestiques. Mais rappelons-nous que nous sommes à Athènes : ne jetons pas de trop curieux regards sur des appartements où n'apparaissent que craintives et voilées ces femmes qui, même mariées, ne peuvent s'entretenir librement avec les hommes étrangers à leur famille. Une porte située en face du corridor d'entrée, nous conduira dans le péristyle du gynécée. Ici les portiques n'environnent la cour que de trois côtés, et limitent diverses pièces que nous allons rapidement parcourir. Dans la salle à manger, d'élégantes petites tables rondes ont pour pieds trois jambes de biche ou trois têtes et trois pattes de lion[90]. Un lit de repos est destiné au chef de la maison qui s'y étendra pour prendre ses repas, tandis que les femmes de sa famille se placeront sur des chaises à forme droite ou renversée, et qui seront munies de draperies jetées sur leurs dossiers, ou de coussins posés sur leurs sièges. Des marchepieds ajouteront encore à la gracieuse commodité de ces chaises[91]. Remarquons le cellier où les amphores de vin, d'huile, de miel, de viandes marinées, sont parfois fixées dans la terre par leurs extrémités inférieures[92]. N'oublions pas non plus la cuisine dont les casseroles même témoignent que le goût du beau guidait encore les anciens, dans la fabrication des plus humbles objets. Les fines incrustations des ustensiles qui nous sont parvenus, ne se bornent pas à reproduire des feuilles, des poissons, des quadrupèdes, sujets qui sont ici tout à fait à leur place ; mais élevant l'esprit jusqu'aux conceptions mythologiques, elles font régner jusque dans les cuisines, le charme de l'idéal. Et le trépied sur lequel est mis le vase où l'on fait probablement bouillir de la viande ou des légumes[93], le trépied lui-même ne rappelle-t-il point par son nom et par sa forme, le siège de l'enthousiasme qui anime la prophétesse d'Apollon ? Le portique manque à la façade du fond : c'est là que se trouve vraiment le foyer de la femme athénienne. Au milieu de motte façade est un vestibule qui sépare d'une pièce, peut-être consacrée aux visites, la chambre à coucher où sont déposés les vases et les tapis les plus précieux de la maison, et où se dresse le lit incrusté d'ivoire, garni d'un coussin et d'une couverture brodée[94]. C'est dans cette dernière pièce probablement que l'Athénienne essaye de corriger en elle les erreurs de la nature, tandis qu'une esclave tient devant elle par le manche, l'un de ces miroirs de bronze ovales ou ronds qui, dans leurs fines gravures, représentent des scènes fabuleuses[95]. Filles du Midi, les Grecques ont le plus souvent les cheveux noirs ; mais la couleur blonde étant préférée par les Hellènes, une poudre donne à la chevelure la teinte d'or que chantent les poètes[96]. Femmes d'Orient pâlies par la réclusion, nos Athéniennes ont recours aussi à des secrets que certains flacons antiques de cristal ou d'ivoire trahissent encore aujourd'hui. On y a trouvé une couleur dont les nuances, plus ou moins claires, se rapportent invariablement au rouge. L'un de ces petits vases explique en même temps, la coquetterie de celle qui s'en servait. Sur la mate blancheur de l'ivoire, se dessine en relief la figure de l'Amour, l'Amour présentant une coupe[97] ! Comment résister à une pareille invitation, et ne pas accepter ce que l'on croyait être offert par le fils même de la Beauté ? Comment s'imaginer que ce fard n'était pas un des dons les moins perfides du malicieux enfant, et devait produire plus de ravages qu'il n'en pouvait masquer ? Pour voir nos Athéniennes dans l'éclat de leur parure, il nous faut passer dans la salle de réception[98]. Toutes portent la tunique ionienne à manches plus ou moins longues, et qui descend jusqu'aux pieds chaussés de souliers ou de sandales. Une ceinture par-dessus laquelle ce vêtement déborde, le maintient à la taille[99]. Plusieurs de ces femmes s'enveloppent d'un péplus ; si celui-ci ne leur sert pas de voile, elles le font généralement passer sous le bras droit et sur le bras gauche[100]. D'autres ont jeté sur leurs épaules, une écharpe, l'anaboladion[101]. Une Athénienne porte sur une longue tunique blanche, une deuxième tunique bleu de ciel, courte et à manches larges. Une troisième tunique, ronde, descendant un peu moins bas que la précédente, nous parait être l'encycle[102]. Les étoiles qui scintillent sur ce vêtement, le cercle rayonnant qui le décore dans sa partie supérieure, la bordure qui le termine, se détachent en argent sur sa pourpre éclatante[103]. Les cheveux ondulés des Athéniennes, se nouent généralement en corymbe sur le sommet du crâne[104]. La coiffure est retenue par des épingles d'or et d'argent, dont une pomme de pin, un lotus, forme la tête[105]. Ici les cheveux sont cachés par un bonnet rond, le saccos ; là ils sont emprisonnés dans le cécryphale, résille d'or, de soie, ou de ce byssus éléen avec lequel la fabriquent les femmes de Patras. Ailleurs, la tête est entourée de la mitre, large bandeau d'étoffe ; ou le front se pare de l'ampyx d'or, le diadème des déesses[106]. L'exquise simplicité qui caractérise la beauté hellénique, se retrouve aussi bien dans les bijoux d'or que dans les vêtements des femmes grecques. De petites amphores suspendues à des rosettes, forment les pendeloques d'un collier dont la chaîne est tressée en bandes plates d'une rare délicatesse[107]. Une autre chaîne soutient des boutons d'asphodèle[108]. Voici des colliers qui se composent de boules d'or et de grenats entremêlés, ou d'émeraudes alternant avec des perles fines et reliées à celles-ci par des chaînettes[109]. Les bracelets doivent leur principal nom grec[110] à la forme que leur donnaient généralement les Hellènes, celle du serpent. Ils s'attachent au poignet, au-dessus du coude et même du pied[111]. Parfois ce sont des cercles d'or interrompus de distance en distance par des médaillons enchâssant, soit des émeraudes, soit des grenats et une perle fine qui occupe le centre du joyau[112]. Les motifs des pendants d'oreilles sont d'une grâce et d'une originalité charmantes : c'est un cygne d'émail blanc dont le bec, les ailes, les pattes et la queue sont en or[113] ; c'est une colombe posée sur un mignon piédestal[114] ; c'est un sphinx[115] ; c'est une tête de panthère[116] ; c'est une grappe de raisin à la tige d'or, aux grains d'émail, suspendue à un disque où s'épanouit une fleur[117] ; c'est enfin un petit vase d'améthyste dont la partie inférieure et les anses sont en or ciselé[118]. Quant aux fibules qui agrafent sur les épaules et sur les bras, les deux parties de la tunique, et qui retiennent le péplus, elles se courbent souvent en arc[119], mais il en est une qui nous frappe par son ingénieuse disposition et sa rare beauté : l'épingle en est supportée par un corps de serpent, à l'extrémité duquel se tend une petite main où se distinguent une bague et un bracelet cordelés, ornés tous deux d'un chaton qui encadre une pierre fine[120]. Cette petite bague nous offre ainsi un modèle des bijoux analogues que portaient les femmes grecques. Nous ne savons si celles-ci se servaient comme leurs époux, d'anneaux à pierres gravées. Par les cornalines, les agates, les sardonix, les améthystes, les opales, dont les admirables intailles nous ont conservé d'intéressantes représentations de la mythologie, de l'histoire et des mœurs helléniques, nous pouvons juger de la valeur que donnaient de semblables pierres aux bagues qui les enchâssaient[121]. Contemplons maintenant la femme athénienne sous un aspect plus simple et plus touchant. La porte placée au fond du vestibule nous conduira dans les salles consacrées au travail, et qui s'étendent vers le jardin[122]. Là un objet attire nos sympathiques regards : c'est le calathus, cette corbeille à ouvrage que l'on a vu représenter jusque sur la tombe d'une femme laborieuse[123]. Le haut calathus dont le fond est étroit, et qui s'évase dans sa partie supérieure, contient avec le fuseau cette quenouille qui a inspiré à Théocrite une idylle d'un charme intime et profond. Qu'il nous soit permis de traduire ici ces vers qui entourent d'une poétique auréole les humbles détails de la vie domestique[124]. Ô quenouille, amie de la laine,
don de Minerve aux yeux d'azur, les femmes utiles à leurs maisons, comprennent
ta signification[125]. Viens sans crainte avec moi vers la brillante ville de
Nilée, au lieu où, sous le tendre et vert roseau, est le hiéron de Cypris.
C'est ici que nous demandons à Dieu de nous faire naviguer par un vent
favorable, afin que j'aie la joie de voir mon hôte, et de rendre amitié pour
amitié à Nicias, rejeton sacré des Muses à la voix charmante. Et toi,
offrande, née de l'ivoire avec beaucoup de peine, nous te remettrons aux
mains de l'épouse de Nicias. Avec elle, tu produiras à la fin d'abondants
matériaux pour les péplus d'hommes, pour les longues robes transparentes
comme de l'eau[126], telles qu'en portent les femmes. Deux fois par an, les
mères des agneaux devraient, dans les pâturages, être dépouillées de leurs
molles toisons, en faveur de Theugenis aux beaux pieds : tant elle est
laborieuse ! Elle aime tout ce qu'aiment les femmes sages. Ce n'est pas, en effet, dans les maisons inertes et oisives que je voulais te donner, toi qui est sortie de notre terre. Car ta patrie que fonda Archias d'Éphyre, c'est la moelle de la Sicile, c'est la ville des hommes éprouvés. Certes, maintenant tu occuperas la maison d'un homme qui connaît de nombreux et de sages remèdes pour éloigner des mortels les tristes maladies ; tu habiteras l'aimable Milet avec les Ioniens, afin que Theugenis à la belle quenouille tourne (le fuseau) parmi ses concitoyennes, et que tu lui présentes toujours le souvenir du poète, son hôte. Qu'après t'avoir regardée, on dise : Certes, grande est la reconnaissance pour un faible don : tout et précieux de la part d'un ami. L'art d'exécuter les ouvrages féminins, tel est d'ordinaire le seul talent qu'apporte la jeune Athénienne[127], lorsque, selon la touchante pensée d'Aristote, elle vient dans la demeure conjugale comme ce suppliant qui se présente au foyer, et à qui le maitre de la maison accorde le titre sacré et les privilèges de l'hôte[128]. Ainsi que cet étranger, elle sera reçue avec un affectueux respect ; mais, de même aussi que cet homme qui, hier encore, était un inconnu, et qui, demain, aura repris le bâton du voyageur, elle n'entrera généralement pas dans l'intimité morale de celui qui lui a ouvert sa demeure. Il y eut toutefois des Athéniens qui surent être des époux. Parfois, en recevant sous son toit, cette jeune fille si ignorante des choses de la vie, l'homme lui témoignait, avec la tendresse d'un ami, la sollicitude d'un père. Il devenait l'instituteur de cette enfant inexpérimentée ; et se penchant vers elle pour l'élever jusqu'à lui, il faisait pénétrer dans son âme neuve encore la connaissance de l'honnête et du beau[129]. Ischomaque, l'un de ces époux, apprit lui-même à Socrate comment il avait rempli son rôle d'initiateur[130], et Xénophon nous a conservé le récit de cet entretien où se retrouve à un degré éminent, le caractère élevé et pratique de la philosophie de Socrate. Ce fut sous les auspices de la religion qu'Ischomaque plaça son bonheur ; ce fut par la prière qu'il inaugura sa mission d'initiateur. L'époux et l'épouse sacrifièrent ensemble à la Divinité, et lui demandèrent, pour le maitre, la grâce de bien diriger sa pupille ; pour l'élève, le don de comprendre ce qui devait être utile au bonheur de tous deux. Sommes-nous donc dans une famille chrétienne ? Quel exemple nous recevons ici de ces philosophes antiques qui, sachant déjà chercher au ciel le principe du bien, ne séparaient pas la morale de sa base religieuse ; ces philosophes qui pressentaient aussi que les époux ne s'unissaient réellement qu'en appelant au milieu d'eux la Divinité ! La compagne d'Ischomaque s'engagea même devant les dieux à remplir fidèlement ses devoirs ; et, en l'entendant, son époux comprit qu'elle ferait fructifier les leçons qu'il lui donnerait. Il attendit qu'elle le connût mieux, qu'elle fût avec lui moins timide, plus confiante ; et quand ce moment fut venu, il dit à la jeune femme, une parole qui contenait le germe de tout son enseignement. Savait-elle pourquoi il l'avait épousée, et pourquoi elle lui avait été confiée elle-même par son père et par sa mère ? Était-il donc si difficile de les marier autrement ? Non ; mais le fiancé et les parents. de la fiancée avaient dû rechercher les convenances morales qui préparent le bonheur d'un ménage. Désormais tout devenait commun entre le mari et la femme, l'administration de la fortune, aussi bien que l'éducation des enfants que Dieu leur accorderait. L'époux ne voulait pas 'qu'on examinât lequel des deux avait apporté le plus de fortune dans la demeure conjugale : c'était à celui des deux qui gérerait avec le plus d'intelligence les biens de la communauté, c'était à celui-là seulement que reviendrait l'honneur d'avoir le plus enrichi la maison. La jeune femme s'étonnait de ce langage si nouveau pour elle : Et en quoi pourrai-je t'aider ? disait-elle. De quoi suis-je donc capable N'est-ce pas sur toi que tout doit rouler ? Ma mère m'a toujours dit que mon affaire à moi, c'était d'être sage et réservée. — Eh ! mais, ma femme, mon père me recommandait la même chose. Or il est du devoir d'un homme et d'une femme sensés de se comporter de manière qu'ils administrent le mieux possible les biens qu'ils possèdent, et qu'ils en acquièrent de nouveaux par des moyens justes et honnêtes. — Mais en quoi vois-tu que je
puisse coopérer avec toi à l'accroissement de notre maison ? — En remplissant de ton mieux les fonctions que la nature te
destine, et que, d'accord avec la nature, la loi déclare légitimes. — Quelles sont donc ces fonctions ?[131] Ischomaque les énumère, et détermine en même temps les limites qui séparent des devoirs de l'homme ceux de la femme. Il se plaît à reconnaître la sagesse avec laquelle la Divinité a préparé l'union des deux sexes, et a fait du mariage une association utile à chacun des époux, une association qui leur réserve encore dans leurs enfants, les soutiens de leurs vieux jours. A l'homme qui doit acquérir le pain de la maison, présider aux travaux agricoles, veiller au soin des troupeaux, et se défendre contre les ennemis dont les attaques troubleraient ses occupations, Dieu a départi la vigueur, le courage. A la femme qui, dans sa demeure, doit conserver et préparer les aliments, transformer la laine en vêtements ; à la femme qui doit trouver en elle-même le lait dont elle nourrira son nouveau-né, Dieu a donné la délicatesse physique qui la retient au foyer, l'exquise tendresse de cœur qui lui fait un besoin de son amour maternel, enfin la timidité vigilante qui jette au moindre danger le cri d'alarme. Mais chacun des époux est doué des mêmes facultés d'attention et de mémoire. Chacun des deux a la même force d'âme pour dompter les passions, et celui qui se distingue le plus par l'exercice de cette vertu, obtient par la volonté de Dieu une meilleure récompense. Cependant, ajoute Ischomaque, comme aucun des deux n'est parfait, ils vivent dans une dépendance réciproque ; et leur union leur est d'autant plus utile, que ce qui manque à l'un, l'autre peut le suppléer[132]. Ces dernières paroles ne nous reportent-elles pas au début de la Genèse ? L'homme et la femme, moitiés du même tout, et se réunissant pour se compléter, n'est-ce pas là ce mariage dont l'Éden avait vu s'épanouir la fleur sitôt fermée, mais destinée à se rouvrir sous les chauds rayons de l'Évangile ? Après avoir aussi nettement défini les attributions de l'homme et celles de la femme, Ischomaque fait observer que les époux, en remplissant leurs fonctions respectives, se conforment aux règles du beau et du bien. La femme quitte-t-elle souvent la maison, l'homme au contraire s'y retire-t-il, l'un et l'autre violent les lois de la nature[133]. Une aimable idée qu'Ischomaque avait déjà rapidement évoquée, traverse de nouveau son esprit. Il compare les fonctions de la femme à celles de la mère-abeille qui, sans quitter sa ruche, répand autour d'elle son activité, envoie ses compagnes aux champs, reçoit et conserve les provisions que celles-ci lui apportent, veille à la construction des cellules, élève les petites abeilles, et lorsque ces dernières savent travailler, les envoie fonder une colonie avec l'assistance d'une de ses sujettes. Néanmoins il est une mission qu'Ischomaque semble redouter de confier à la délicatesse de la jeune épouse : celle de soigner ses domestiques malades. Mais à cette crainte répond le cœur de la femme, ce cœur avide d'affection, ce cœur que l'aspect de la souffrance attire et ne rebute pas : Que dis-tu ? Je n'aurai pas de plus grand plaisir, puisque, reconnaissants de mes bons offices, ils doubleront leur attachement pour moi[134]. Ce généreux élan pénètre de joie le noble époux. N'est-ce pas, ma femme, un
intérêt aussi tendre de la mère-abeille qui lui concilie un tel amour, que si
elle quitte la ruche, aucune des abeilles ne croit pouvoir y rester ? Toutes
s'empressent de suivre leur reine[135]. Leur reine ! Ce titre effraye tout d'abord la jeune femme plus qu'il ne la charme. Sans doute, elle sait qu'elle n'est pas une captive. Ainsi que le pensait généreusement Aristote, la femme n'est assimilée à l'esclave que là où l'homme lui-même n'est pas libre[136]. — Mais enfin l'éducation de la fille d'Athènes lui a appris à considérer l'obéissance passive comme le premier devoir de l'épouse. Et c'est son mari lui-même qui lui confie une autorité qu'elle jugeait devoir être l'unique partage du chef de la maison ; c'est son mari qui remet entre ses mains un sceptre qu'elle se croit inhabile à tenir ! — Voilà qui nie surprend. Est-ce que l'exercice de l'autorité ne t'appartiendrait pas plus qu'à moi ? Quelle étrange intendance j'exercerais dans l'intérieur, si tu ne veillais à ce qu'on apportât quelque chose du dehors ! — Et mes soins à moi ne seraient-ils pas ridicules, si je n'avais personne pour conserver ce que j'apporte ? Vois-tu quelle pitié inspirent ces fous que l'on dit vouloir remplir un tonneau percé, parce que l'on connaît l'inutilité de leur travail ? — Assurément. Qu'une telle conduite les rend malheureux ! — Tu auras, ma femme, d'autres soins non moins touchants à remplir ; par exemple, lorsque d'une esclave, que tu auras prise ne sachant pas filer, tu feras une bonne fileuse dont les services doubleront pour toi ; lorsque d'une femme de charge maladroite et d'un service désagréable, tu auras fait une femme intelligente en ménage, fidèle, prompte au service, un trésor en un mot ; lorsque tu seras en droit soit de récompenser les serviteurs sages et utiles, soit de punir ceux dont tu aurais à te plaindre. La plus douce de toutes tes jouissances, ce sera quand, devenue plus parfaite que moi, tu trouveras en moi le plus soumis des époux ; quand, loin de craindre que n'éloigne de toi la considération, tu sentiras au contraire que plus tu te montreras bonne ménagère, gardienne vigilante de l'innocence de nos enfants, plus tu verras, avec les ans, s'accroître les respects de toute la maison. Dans le monde, ce n'est point la beauté qui acquiert de nouveaux droits à l'estime, au véritable respect ; ce sont les vertus[137]. Ainsi se termina le premier entretien qu'Ischomaque se souvenait d'avoir eu avec sa femme. Ce fut ainsi que la nouvelle épouse acquit, avec le sentiment de son utilité, la conscience de sa responsabilité. Ischomaque fut si bien compris que, dans une circonstance où la jeune femme ne put trouver un objet que son mari lui avait demandé, elle se troubla et rougit comme une enfant surprise en délit de négligence. Toujours indulgent et, bon, l'époux déclara que c'était lui qui était en faute et non pas elle, puisque, en livrant à sa compagne les meubles du ménage, il ne l'avait pas avertie de la place qu'occupait chacun d'eux. Il profita de cette circonstance pour enseigner à son élève l'ordre tel que l'entendaient les Hellènes, l'ordre dans le sens le plus vaste et le plus élevé ; l'ordre, c'est-à-dire l'harmonie ! La disposition d'un chœur dont les personnages divers concourent à l'unité de l'ensemble ; le mouvement d'une armée dont les hoplites, les troupes légères, les chevaux et les chars s'avancent sans confusion au-devant de l'ennemi ; la marche d'un vaisseau dirigé par des navigateurs dont les efforts individuels, loin de se heurter, s'unissent en une action commune, tous ces spectacles fournirent à Ischomaque des comparaisons aussi frappantes que justes. Il proposa à sa femme d'assigner avec lui une place déterminée à tout ce qui leur appartenait : Par là nous connaîtrons ce que nous aurons perdu et ce qui nous reste. La place elle-même nous avertira de ce qui manque : un coup d'œil nous fera découvrir ce qui demande des soins. Enfin, l'arrangement une fois pris, tout se trouvera sous la main[138]. Avec cette simplicité naturelle aux hautes intelligences, Ischomaque n'hésita même pas à confesser qu'il trouvait de la beauté jusque dans des marmites symétriquement placées.... Et cet aveu ne nous étonne pas, surtout quand nous pensons aux élégants ustensiles de cuisine dont nous avons précédemment parlé. Mais il n'est pas nécessaire de justifier par une raison d'art, le plaisir qu'éprouvait Ischomaque à voir régner l'ordre dans les plus humbles objets du ménage. Et d'ailleurs l'homme dont l'âme est pure, ne subit-il pas le charme intime et paisible qui s'attache aux détails de la vie domestique ? La jeune femme fut enchantée du projet de son mari. Tous deux parcoururent la maison pour disposer le plan de leurs nouveaux arrangements ; puis ils classèrent leurs effets, remirent à leurs domestiques ceux qui devaient habituellement, servir à ces derniers ; et, confiant les plus précieux à la servante qui ; par sa sagesse, par son intelligence, avait mérité l'emploi de femme de charge, ils lui montrèrent où ces objets devaient être posés, et en dressèrent un état par écrit. Ils donnèrent encore d'autres instructions à cette esclave, et s'appliquèrent à s'attacher son cœur, à élever son caractère. Enfin Ischomaque dit à sa compagne que tous les soins qu'ils venaient de prendre seraient inutiles si la maitresse de maison ne veillait elle-même à ce que l'ordre établi ne fût pas troublé. La comparant aux magistrats qui font respecter les lofs d'une ville, il lui parla ainsi : Ma femme, regarde-toi donc comme la conservatrice des lois de notre ménage. Telle qu'un commandant de garnison qui fait la revue de ses troupes, procède, lorsque tu le juges convenable, à la revue de nos meubles, vois s'ils sont bien tenus ; fais ton inspection comme le conseil fait celle des chevaux et des cavaliers. Reine de ta maison, use de tout ton pouvoir pour honorer et louer ceux qui le mériteront, pour réprimander et châtier ceux qui rendront ta sévérité nécessaire[139]. Et comme si l'époux craignait que la jeune femme ne fût mécontente de ce qu'il lui donnât une charge plus lourde que celle des domestiques, il lui fit remarquer que ceux-ci n'avaient pas le même intérêt qu'elle à conserver des objets qui étaient, non leur propriété, mais la sienne. Jusqu'à présent, c'est l'enfant aimante et inexpérimentée qui a répondu à son maître. Maintenant, c'est la femme, c'est la maîtresse de maison qui apparaît, et qui, dans un langage à la fois sérieux et enjoué, s'adresse ainsi à son époux, à son ami : Tu me jugerais mal si tu pensais
que j'accepte à regret des fonctions et des soins dont tu me démontres la
nécessité. Tu me ferais bien plus de peine en m'abandonnant à ma négligence.
Il est naturel à une lionne mère, il lui en coûte moins, de soigner ses
enfants que de les délaisser. Il est de même dans la nature, qu'une femme
raisonnable trouve plus de plaisir à prendre soin des possessions auxquelles
l'attache le sentiment de la propriété qu'à les négliger[140]. Quand Ischomaque rapporta cette réponse à Socrate, le grand penseur y découvrit l'indice d'une intelligence virile, et, voyant que l'époux n'avait pas encore terminé l'éloge de l'épouse, il l'encouragea à parler et ajouta : Xeuxis me montrerait une beauté, chef-d'œuvre de son pinceau, que j'aimerais mieux contempler la vertu d'une femme[141]. C'était une courageuse action qu'Ischomaque voulait raconter à la gloire de sa compagne. La nouvelle épouse lui était un jour apparue, alors que les flacons qui nous occupaient tout à l'heure, avaient répandu sur son visage des roses et des lis artificiels. De plus, la hauteur de ses semelles grandissait sa stature. Ischomaque lui demanda s'il lui paraîtrait pics aimable en lui montrant comme une sérieuse partie de sa fortune, de l'argent faux, des bracelets aux grains de bois dorés ou argentés, de la pourpre d'une mauvaise teinte ? La jeune Athénienne déclarant à son mari que s'il la décevait ainsi, elle ne l'aimerait plus jamais, Ischomaque lui dit avec bonté que l'homme et la femme ; en se donnant l'un à l'autre par le mariage, ne devaient pas se tromper non plus en se parant d'un éclat emprunté[142]. La jeune femme ne se montra plus devant son mari qu'avec un extérieur simple et naturel : ce fut sa réponse[143]. Toutefois elle le pria de lui indiquer le moyen non-seulement de paraître, mais d'être véritablement belle[144]. L'époux lui conseilla de ne pas se borner à surveiller les travaux de ses domestiques, et de s'y associer d'une manière active. Elle trouverait ainsi plus de saveur à sa nourriture ; et, fortifiant sa santé, elle augmenterait la beauté de sa carnation. Ischomaque, s'enorgueillissant du mérite de son élève, disait à Socrate : L'énumération de ses devoirs fait l'énumération de ses vertus[145]. Il était devenu alors ce qu'il avait promis d'être : le plus soumis des époux. Écoutons-le plutôt lui-même : Plus d'une fois je me suis vu condamné à une peine, à une amende déterminée. — Par qui Ischomaque ? lui demanda Socrate. Voilà du nouveau pour moi. — Par ma femme. — Et comment te défends-tu avec elle ? — A merveille, quand heureusement, j'ai la vérité pour moi ; mais quand je ne l'ai pas, j'ai beau faire, il m'est impossible de faire une bonne cause d'une mauvaise[146]. La communion morale de l'homme et de sa compagne, cette communion que ne sut pas comprendre la grande âme de Platon, fut pressentie par Aristote aussi bien que par Xénophon ; mais ce fut un philosophe issu de cette race éolienne où la femme montra un si grand caractère et put donner à son esprit un si libre essor, ce fut Plutarque qui, quelques siècles après, posa les vraies bases de la fusion morale et intellectuelle des époux[147]. Le moraliste qui prescrit au mari et à la femme de respecter également la sainteté du lien nuptial, demande que tout soit commun entre eux, les bonnes mœurs et les croyances aussi bien que les richesses ; et qu'ils soient si intimement unis qu'ils forment un seul et même être. L'épouse s'attachera à fuir le vice, qui rend la laideur plus repoussante ; à cultiver la vertu, qui fait épanouir sur le visage sa fleur immatérielle : la beauté ! L'épouse devra aussi rendre cette vertu souverainement aimable et séduisante, se taire quand son mari s'emportera, lui parler avec douceur quand il gardera un sombre silence. Pour préparer la femme à sa mission, Plutarque l'a initiée aux fortifiantes doctrines de la philosophie. En la mariant, il demande à l'époux de continuer l'éducation de l'épouse, et de se rendre lui-même digne d'un pareil rôle. Que le mari soit pour la femme un exemple vivant de vertu et d'honneur. Qu'avec une autorité contenue par une indulgente bonté, il la fasse renoncer aux goûts futiles. Qu'il s'instruise lui-même, et que, butinant parmi les fleurs des connaissances utiles, il en fasse goûtera sa compagne le miel le plus pur. Et Plutarque, rappelant les noms de père, et de mère, et de frère, qu'Andromaque donnait à Hector, déclare que l'époux ne serait pas moins honoré de s'entendre dire par l'épouse qu'il est son maître et son instituteur dans les sciences les plus belles et les plus sublimes[148]. Alors la femme méritera plus que jamais l'estime et l'amour de son mari. Elle dédaignera les amusements frivoles ; et, disciple de Platon et de Xénophon, elle méprisera les pratiques superstitieuses. L'étude de ce qui est, remplira son esprit d'idées justes qui en éloigneront ces opinions erronées, ces goûts déréglés dont se peuple une intelligence vide. De même que les femmes célèbres, l'épouse sera parée d'une instruction moins coûteuse et plus précieuse que les pierreries et les tissus de pourpre. Enfin si Sappho a pu préférer à l'or d'une femme opulente, les roses que la poétesse a cueillies sur l'Hélicon, l'épouse ne pourrait-elle pas se glorifier à plus juste titre quand elle aura cueilli, non des roses passagères, mais ces fruits précieux que les Muses prodiguent à ceux qui cultivent les lettres et la philosophie ?[149] C'est ainsi que les époux sont dignes de réaliser cet idéal que Plutarque leur a montré, et de rechercher l'un dans l'autre, non les agréments extérieurs et fugitifs, mais cette beauté divine, impérissable, source d'un amour qu'ils se garderont encore sous leurs rides et sous leurs cheveux blancs[150]. Pour formuler les préceptes du mariage, Plutarque n'avait eu, a-t-on dit, qu'à décrire son propre intérieur[151]. Pour dessiner le type de l'épouse, il n'avait eu qu'à regarder Timoxène, sa compagne, la femme simple et courageuse dont l'esprit élevé comprenait les devoirs d'ici-bas et les espérances de la vie éternelle. Ne nous y méprenons pas toutefois, et ne croyons pas que les préceptes de Plutarque aient été souvent pratiqués en Grèce. Quand vécut le philosophe de Chéronée, la voix de saint Paul s'était fait entendre aux Hellènes. L'Évangile avait répandu dans le monde le souffle de liberté et de pureté qui releva la femme, l'atmosphère en était comme imprégnée ; et Plutarque et Timoxène purent recevoir à leur insu l'influence spiritualiste de croyances qu'ils ne partageaient pas. Ce qui a perdu la société athénienne, c'est l'absence trop fréquente de ce lien intellectuel qui doit unir les époux. Certes, dans les rares occasions où la femme franchissait le seuil de sa demeure[152], elle voyait les temples, les statues, les peintures que l'art des Phidias, des Praxitèle, des Apelle, multipliait à Athènes. Elle pénétrait aussi dans ce théâtre immense[153] qui, entouré de portiques, avait pour dôme la voûte du ciel, pour flambeau le disque du soleil, pour horizon, la mer et les montagnes ; dans ce théâtre où se révélaient la grandeur d'Eschyle, la noble et touchante simplicité de Sophocle, la douceur passionnée d'Euripide. Mais si l'esprit de l'Athénienne n'avait pas été préparé à recevoir les impressions de l'art, si un guide n'était pas auprès d'elle pour éveiller et pour régler son goût, ce qu'elle voyait pouvait charmer ses regards, ce qu'elle entendait pouvait toucher son cœur, mais les sensations qu'elle éprouvait ne dégageaient pas dans son intelligence le type même de la beauté. L'éducation défectueuse de la femme, telle est donc la cause essentielle de l'éloignement que les Athéniens eurent trop souvent pour le foyer domestique. Ajoutons-y cette absence de sympathie morale qui accompagnait certaines unions auxquelles l'or seul avait servi d'appât. Il arrivait, alors déjà, qu'en se mariant, l'homme avait supputé avec soin les mines, les talents, les drachmes de la dot ; mais dans cette addition, il avait oublié de compter les qualités ou les défauts de la fiancée. Un jour, l'or était parti, mais la femme restait, et, avec elle, le regret de sa présence : J'ai épousé un démon qui avait une dot. Ne te l'ai-je pas dit déjà ? Vraiment ne te l'ai-je pas dit ? Ma maison et mes champs me viennent d'elle : mais, pour les avoir, il a fallu la prendre aussi, et c'est le plus triste marché ![154]..... Privé des ressources et des consolations que l'homme trouve dans une compagne intelligente et aimée, l'Athénien cherchait donc hors de sa maison les jouissances qui lui manquaient chez lui. Ainsi commençait le règne de l'hétaïre, la courtisane ! Comment les pures, mais ignorantes Athéniennes qui, assurées des droits que leur donnait la loi, pouvaient dédaigner de plaire à leurs époux, auraient-elles lutté contre ces femmes qui, pour maintenir leur puissance irrégulière, joignaient aux dangereuses séductions d'une beauté moins chaste, les attraits enchanteurs d'un esprit cultivé ? Qu'elle se nomme Aspasie ou Phryné, Thaïs ou Glycère, l'hétaïre est la véritable reine d'Athènes. Elle réunit autour d'elle la plupart des hommes éminents de la Grèce. L'homme d'État lui sacrifie la paix de son pays, et le juge, la justice. Le philosophe perd la sagesse auprès d'elle. Le poète célèbre ou maudit son immoral empire. L'artiste la trouve si belle qu'il oublie d'élever le regard au-dessus de cette créature périssable, et que, donnant à Vénus les traits de la femme aimée, il présente ainsi l'hétaïre à l'adoration de la Grèce. La statue de la courtisane est même placée sous son véritable nom dans cet édifice où une lemme austère rend les orales d'Apollon, et les magistrats de Delphes ne renversent pas cette image, eux qui lisent au-dessus de la porte du temple, que l'accès de ces lieux est interdit à ceux dont les mains sont souillées ! L'hétaïre veut même que son opprobre soit utile à son pays. A sa voix, l'incendie du palais de Xerxès venge Athènes brûlée par le grand roi. Elle propose de faire rebâtir Thèbes avec cette fortune qui est le salaire de sa honte ; mais il faudra que, dans la nouvelle cité, une inscription rappelle que la ville détruite par Alexandre, a été réédifiée par une courtisane. Les Thébains ont trop d'honneur pour ne pas refuser cette offre ; mais, dans une autre circonstance, les Athéniens, acceptant d'un lieutenant d'Alexandre un considérable envoi de blé qu'il leur fait en l'honneur d'une hétaïre, les Athéniens sont aux pieds de la courtisane, la saluant du titre de reine, et l'entourant des respects dus à leurs épouses, à leurs mères[155]. Corinthe, la cité où les courtisanes se multiplièrent le plus, et qui eut pour prêtresses ces femmes d'une élégante corruption, Corinthe asservie et agonisante, fit survivre le souvenir de Laïs à celui de ses monuments détruits. Une médaille gréco-romaine de cette ville, représente sur une face, la courtisane ; et sur l'autre, le groupe qui à Corinthe, décorait son tombeau : une lionne déchirant un bélier, triste emblème de l'avidité qui caractérisait Laïs[156]. La Thessalie disputait à Corinthe l'ignominieux privilège de posséder les cendres de cette femme. Sur les bords du Pénée s'élevait un monument avec cette inscription : La Grèce, glorieuse et invincible, fut esclave de la divine beauté de Lais, que l'Amour engendra, que Corinthe nourrit, et qui repose dans les belles campagnes de la Thessalie[157]. Lorsque les Hellènes se prosternaient ainsi devant les impures images de la beauté, ils tombaient dans une fange plus profonde encore que celle où ils cherchaient leurs indignes idoles. La courtisane, cette créature si adulée dans sa déchéance, savait néanmoins rougir devant l'honnête femme. Dans deux pièces dont l'une est imitée d'Apollodore et l'autre de Ménandre, Térence a délicatement exprimé ce trouble. Au moment de se rendre chez une jeune épouse à laquelle cependant elle apporte le bonheur, l'hétaïre avoue la honte qu'elle va éprouver devant la maîtresse de maison. Ailleurs, la courtisane est prise d'un sentiment de respect et de mélancolie en parlant à une pauvre et vertueuse jeune fille. Elle compare le sort de l'hétaïre à celui de la femme de bien : l'une, après avoir allumé des flammes coupables, les voit s'éteindre quand s'évanouit la beauté qui en a été l'aliment ; l'autre au contraire, s'unit-elle à un homme dont les goûts sont assortis aux siens, on croirait les deux époux rivés l'un à l'autre, et rien ne trouble jamais leur mutuelle tendresse[158]. Les courtisanes d'Athènes étaient d'origine étrangère. Il arrivait très-rarement qu'une Athénienne augmentât leur nombre et perdit ainsi le titre de citoyenne[159]. Une seule faute exposait la femme mariée à de terribles châtiments. Son complice pouvait être tué par son époux. Si cet époux lui-même restait auprès d'elle, il était condamné à la perte de ses droits civils[160]. Honteusement exclue de la demeure conjugale, où l'épouse coupable cherchera-t-elle un refuge si la maison paternelle même vient à lui être fermée ? Le rameau d'olivier à la main, se jettera-t-elle comme une suppliante, dans les temples des dieux ? Démosthène va nous répondre : Notre législation permet à
l'étrangère, à l'esclave d'entrer dans nos temples, soit pour regarder, soit
pour prier : la femme adultère est la seule à qui le sanctuaire soit fermé.
Si elle force la barrière élevée par la loi, le premier venu a droit de
punition sur elle, et peut lui faire subir toutes sortes de mauvais
traitements, excepté la mort. En vain demanderait-elle vengeance aux
tribunaux : il faut qu'elle expie le scandale de sa présence, et la vengeance
n'appartient ici qu'au temple souillé, au culte profané. On a pensé que, pour
la contenir dans le devoir, il suffisait de lui inspirer de la crainte, et
d'annoncer que l'épouse infidèle serait chassée à la fois du domicile
conjugal et de nos temples[161]. Au premier aspect on est tenté d'admirer les prescriptions dont s'autorise ici Démosthène.... Mais non. Qui donc, si ce n'est la Divinité, pourra relever la femme coupable ? Certes, la loi antique qui préservait le sanctuaire d'un contact impur, cette loi était grande. Combien est plus sublime néanmoins la pensée du Verbe qui n'éloigna pas la pécheresse pleurant à ses pieds, du Verbe qui 'savait que Dieu, étant le principe de la pureté, ne reçoit aucune atteinte de la présence du criminel, mais que celui-ci trouve dans la présence de Dieu la source de sa régénération ! Même innocente, l'épouse grecque ne jouissait pas d'une complète sécurité. A Sparte, où cependant la loi punissait d'une amende l'homme qu'une autre affection éloignait de sa compagne, l'épouse stérile pouvait être répudiée[162]. Cette exception était naturelle chez le peuple qui n'élevait dans la femme que la mère à venir. Bien qu'à Athènes l'épouse fût protégée par la loi contre les mauvais traitements de son mari, elle était répudiée pour des causes futiles. Pour se séparer d'elle, il suffisait à l'époux de lui rendre sa dot[163] et de lui remettre un écrit constatant les motifs du divorce' Les' tuteurs de la femme avaient, il est vrai, le droit d'intenter une action judiciaire à l'homme qui avait trop légèrement renvoyé sa compagne, et de soumettre à l'archonte l'acte de répudiation. Mais la loi qui permettait la réintégration de l'épouse au foyer conjugal, valait-elle celle qui l'eût préservée d'un affront immérité ? La femme pouvait-elle rentrer avec joie dans une demeure dont le maître l'avait injustement bannie, et ne la recevait que par contrainte ? Que le divorce fût accepté ou provoqué par l'épouse, il était toujours humiliant pour elle. Aussi ne pouvait-elle en prendre l'initiative aussi aisément que son mari. Les expressions seules qui désignaient le divorce, marquaient cette différence. L'homme répudiait-il sa compagne, c'était un renvoi (άποπομπή). La femme se séparait-elle de son époux, c'était une désertion (άπόλειψις). Quand le divorce était demandé par l'épouse, cet acte était entouré de formalités très-pénibles pour elle. Il fallait que cette femme timide, habituée à une vie cachée, se résigna à paraître elle-même devant l'archonte, à lui remettre un mémoire contenant l'exposé de ses griefs. Plutôt que de tenter cette démarche, et de découvrir à des regards étrangers les blessures de son cœur et celles de son amour-propre, elle préférait souvent rester Et souffrir à son foyer. Nous approuvons la loi qui avait ce résultat salutaire ; mais nous voudrions qu'elle eût été égale pour les deux époux ; nous voudrions même qu'elle eût, non pas seulement entravé, mais proscrit le divorce. Ajoutons cependant que la comparution de la femme devant l'archonte, a semblé avoir pour but de donner à son mari une occasion de la revoir et de se réconcilier avec elle. Ainsi le plus beau et le plus volage des héros athéniens, — est-il besoin de nommer Alcibiade ? — rejoint chez l'archonte, Hipparète, sa vertueuse compagne, au moment où celle-ci, après avoir beaucoup souffert, se dispose à rompre un lien qu'elle n'a que trop chéri, mais que l'époux n'a pas su respecter.... Alcibiade saisit sa femme dans ses bras, l'emporte chez lui en traversant la place publique, et la foule applaudit, et l'épouse ne résiste pas. Lorsque le mari s'opposait à une séparation, et, qu'il n'avait pas, pour reconquérir sa femme, l'irrésistible séduction d'Alcibiade, il avait le droit de faire un procès à la partie adverse. Si les époux se quittaient à l'amiable, leur consentement mutuel suffisait pour rompre leur mariage. Par le divorce, l'homme et la femme retrouvaient la liberté de contracter d'autres liens. Parmi les exemples qui l'attestent, il en est un qu'Isée retrace avec une simplicité émue. Uni à une jeune orpheline, un vieillard pensait avec chagrin que les glaces de son hiver attristeraient le printemps de sa compagne, et que, sous son toit, celle-ci serait toujours étrangère au bonheur de la maternité. Il préféra souffrir seul, et proposa à sa femme une séparation qui lui permettrait un nouvel hymen. Elle ne voulut pas en entendre davantage. Le jour arriva enfin où, non sans lutte, elle consentit à quitter pour un autre époux le vieillard qui, restant son père, augmenta sa dot et adopta pour fils un de ses frères[164]. Comme la femme d'Israël, l'épouse spartiate devait doublement se glorifier d'une maternité qui la protégeait au foyer domestique. Lorsqu'elle avait l'espoir de devenir mère, on plaçait sous ses yeux les portraits des héros ou des immortels les plus renommés pour leurs charmes physiques[165]. C'est ainsi que, s'imprégnant des images du beau, elle se préparait à mettre au monde un mortel semblable aux dieux. Elle ne connaissait pas alors cette religion qui, substituant le culte de la beauté morale à celui de la beauté physique, allait exciter la mère future à rechercher dans l'essence d'un Dieu immatériel, ce qui pourrait sanctifier l'âme de son enfant. L'heure qui donnait un fils à la femme lacédémonienne, était encore pleine d'angoisses. Le nouveau-né était enlevé à sa mère, et porté par son père au lieu de l'assemblée publique, au Lesché où il était examiné par les anciens de sa tribu[166]. Sa faiblesse n'annonçait-elle en lui qu'un homme inutile à la défense de l'État, le père rentrait seul, et le corps du pauvre enfant gisait au fond du gouffre où l'avaient fait précipiter les vieillards. La constitution du nouveau-né promettait-elle au contraire un citoyen robuste, alors seulement sa mère le revoyait... Ces rudes Spartiates ne savaient-ils donc pas quelles âmes généreuses et fol tes peuvent animer les corps les plus frêles ? Ne se souvenaient-ils donc pas que ce fut aux mâles accents d'un Tyrtée, d'un poète infirme, qu'ils durent un jour le courage héroïque qui sauva leur nationalité menacée ? On a rendu le fils à la mère ; mais de ce moment, elle a appris à sacrifier à l'État Son amour maternel. Aussi, imitant Alcmène, donne-t-elle à son fils pour berceau, un bouclier[167]. Ayant une fois baigné et rassasié de lait Hercule, âgé de dix mois, et Iphiclée, d'une nuit plus jeune, Alcmène de Midée les déposa sur le bouclier d'airain, la belle armure dont Amphitryon dépouilla Ptérélaus abattu. Or, touchant les têtes des enfants, la femme dit : Dormez, mes nouveau-nés, d'un sommeil doux et dont on peut se réveiller ; dormez, mes âmes, couple fraternel, enfants qui vivez au sein du bonheur ; heureux endormez-vous, et heureux parvenez à l'aurore. En parlant ainsi, elle fit tourner le vaste berceau : le sommeil les prit[168]. Quelle grâce et quelle douceur a, dans le texte grec, cette poésie que nous avons si imparfaitement traduite ! C'est bien là une de ces mélodies que murmure une jeune mère en berçant son enfant ! Mais nous n'avons pas le loisir de nous abandonner à la rêverie de l'idylle. Cette armure qui sert de berceau à l'enfant, évoque des tableaux moins tendres que celui-là. Le jour est venu où la mère elle-même remet à son fils, devenu homme, un bouclier semblable à celui qui a abrité le sommeil du nouveau-né, un bouclier que le lâche peut perdre, mais sur lequel est porté le soldat mort à son poste : Reviens avec lui, ou sur lui, dit la mère à son fils[169]. — Le jeune homme se plaint d'avoir une épée trop courte : Allonge-la d'un pas[170]. — Le guerrier est-il boiteux : A chaque pas que tu feras, souviens-toi de la vertu[171]. La bataille s'engage. Qu'un de ses fils tombe, la mère le fait remplacer par le frère de celui-ci. Avec quelle avidité elle attend aux portes de la ville, l'issue du combat ! Enfin elle voit un compagnon d'armes de ses enfants ; elle lui demande comment s'est terminée la mêlée-. Ses cinq fils sont morts, c'est cet homme qui le lui apprend. — Misérable, est-ce là ce que je te demande ? Je veux savoir quel a été l'événement de la bataille. — Nous l'avons gagnée. — J'apprends donc sans regret la mort de mes enfants[172]. Mais il ne suffit pas à une Lacédémonienne de savoir que son fils a été tué. Elle va examiner les blessures du guerrier. Ces blessures témoignent-elles qu'il a été frappé dans sa fuite, alors seulement elle se cache pour pleurer non sa mort, mais son déshonneur. Quant au cadavre, elle le fait enterrer secrètement, ou l'abandonne à la sépulture commune. Mais si le Spartiate a été plusieurs fois atteint à la poitrine, c'est avec fierté que sa mère fait porter au tombeau de ses ancêtres celui qui est mort digne d'eux[173]. Pendant qu'elle célèbre les rites funéraires, une femme
s'approche d'elle pour la plaindre et la consoler : la mère réclame des
félicitations. Je l'avais mis au monde afin qu'il
mourût pour sa patrie. Je l'ai obtenu[174]. Une Lacédémonienne apprend-elle que son fils est vivant et qu'il a fui, elle lui écrit : Ou justifie-toi, ou meurs[175]. Revient-il, elle saura le tuer. Pourquoi hésiterait-elle ? Il n'était pas son fils ! Elle l'aurait reconnu pour tel s'il était mort en homme de cœur. C'est de l'héroïsme, a-t-on dit en vantant le courage de ces femmes. Soit, mais trop souvent aussi, c'est de la cruauté. Ces femmes ont pu être de bonnes citoyennes ; mais la plupart d'entre elles ont été des mères barbares. N'était-ce pas le résultat de leur éducation toute masculine ? On avait étouffé en elles les instincts de leur sexe ; on leur avait donné en échange des habitudes viriles qui, ne leur étant pas naturelles, se manifestaient avec une affectation exagérée. Athènes ne nous offrira pas de ces mères cruelles que produisit Sparte. Nous y trouverons plutôt une femme écrivant à son fils qui a fui le champ de bataille, qu'elle lui sait bon gré de ce qu'il se soit conservé pour elle[176]. Comme nous n'aimons pas plus la faiblesse que la dureté, nous ne citons pas ce trait à la gloire de nos Athéniennes. Mais cherchons-nous une mère qui soit fière, sinon des succès guerriers, du moins des victoires morales de son fils, Démosthène, plaidant contre ses tuteurs, nous apprendra qu'elle existe à Athènes : Ma mère ! elle m'attend pour m'embrasser, vainqueur de l'injustice[177]. Bien qu'il existât peu d'Athéniennes dont l'esprit fût assez élevé pour qu'elles pussent transmettre à leurs enfants toute leur existence morale, bien qu'on ne nous en cite aucune qui, comme l'Illyrienne Eurydice, se fût instruite pour mieux remplir ses devoirs de mère éducatrice[178], les œuvres de Sophocle et d'Euripide prouvent que les qualités essentielles de la femme, la douceur, la pureté, la tendresse, pouvaient être léguées par les Athéniennes à leurs fils. Le peuple formé par Solon, avait un si profond sentiment du respect filial, que le fils dénaturé ne pouvait monter à cette tribune où tout citoyen avait le droit de se faire entendre[179]. N'est-ce pas Solon lui-même qui disait à Crésus que parmi les hommes qu'il avait vus les plus heureux, figuraient au second rang ces deux Argiens qu'avait immortalisés leur piété filiale ? Une prêtresse de Junon devait se rendre à la fête de la déesse sur son char traditionnel. Mais les bœufs qui devaient le conduire, n'étant pas arrivés des champs, Cléobis et Biton, fils de la prêtresse, s'attelèrent eux-mêmes au char, et le traînèrent au temple éloigné de quarante-cinq stades[180]. Les hommes louaient le dévouement filial de ces nobles jeunes gens ; les femmes reconnaissaient le bonheur de leur mère.... Et la prêtresse, heureuse et fière, ne pouvait dans sa joie, que demander à Junon d'accorder à ses fils ce que l'homme peut obtenir le meilleur[181]. La déesse exauça cette prière, mais non pas, hélas comme l'eût espéré la pauvre mère.... S'endormant dans le temple, les pieux jeunes gens quittèrent cette vie où les eût attendus la douleur... Celui qui est aimé de dieux meurt jeune[182]. Solon ajoutait à ce récit que les Argiens avaient placé dans le temple de Delphes les statues de Cléobis et de Biton[183]. Quand, plus heureuse que la prêtresse argienne, la mère athénienne mourait avant son fils, celui-ci eût regardé comme une affliction amère de ne pouvoir la porter dans le tombeau de ses aïeux[184], dans ce tombeau où il devait la rejoindre[185]. Peut-être était-elle déjà attendue dans le sépulcre par son mari..... Des bas-reliefs funéraires de l'Attique, parmi lesquels figurent les beaux vases de marbre pentélique trouvés à Marathon[186], représentent les suprêmes adieux d'époux qui vont se séparer pour toujours sur la terre. Comme au jour de leurs fiançailles, ils se donnent la main. Le costume de voyage que porte le mari, le cheval qui le suit, peuvent déceler que c'est lui qui est parti le premier ; mais quand ces indices manquent, on distingue difficilement du mourant qui regrette de laisser sur la terre l'objet de sa tendresse, le survivant qui s'afflige de voir s'abîmer dans les enfers ce qu'il a aimé ici-bas[187]. |