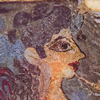LA FEMME GRECQUE
TOME PREMIER
CHAPITRE VI. — L'ART GREC ET LES DÉESSES D'HOMÈRE. - RÔLE RELIGIEUX ET PHILOSOPHIQUE DES FEMMES DANS LES TEMPS HISTORIQUES.
|
Comment l'art nous fera retrouver les déesses d'Homère. — Temple de Junon à Olympie. Les femmes aux fêtes de la reine des dieux et aux jeux olympiques. Les deux grands sanctuaires de Junon, Samos et Argos. La prêtresse argienne. La Junon d'Homère et la statue de Polyclète. — La souveraine d'Athènes. L'Acropole. Les peintures des Propylées Le temple de la Victoire sans ailes. Le colosse de Minerve Promachos et la Pallas des vases peints. Minerve Hygiée. Statues de femmes dans l'enceinte du temple de Minerve Ouvrière. En votant pour Minerve, les femmes perdent leurs droits politiques. La grande prêtresse de Minerve Poliade. L'Érechthéion. Le Palladium. La tribune des six jeunes filles, les Errhéphores et le péplus de Minerve. Le Parthénon et ses 'sculptures. Les Panathénées. Le trône de Xerxès. La Minerve d'or et d'ivoire. Les offrandes et le trésor du Parthénon. — Diane. Le temple d'Éphèse. Diane à la biche. Bas-relief des danseuses spartiates aux fêtes de Diane. La Pythie, arbitre du monde ancien. — Les Bacchantes. Les Athéniennes à l'approche des vendanges, à la procession des Lénées, aux Anthestéries. Rapprochement entre la femme de l'archonte-roi et le doge de Venise. Bas-relief des offrandes. — Les Thesmophonies. L'hymne homérique à Cérès. L'enlèvement de Proserpine et la mort des jeunes filles. L'enlèvement du jour. Apothéose de la femme. L'immortalité de l'âme et la vierge de Thasos. Les Pythagoriciennes Les mystères d'Éleusis. Scène d'initiation d'après un vase peint. Visions de la vie éternelle. — Contrastes dans le culte de Vénus. La Vénus de Milo. Vénus Uranie. — L'étrangère de Mantinée montrant à Socrate le divin Principe du beau. Au début de cette étude, nous cherchions les déesses dans la fécondité du sol, dans l'azur du ciel, dans la vapeur de l'air, dans le cristal de la source, dans le vent de la forêt. A ces divinités qui n'étaient que des manifestations de l'ordre physique, il fallait un culte naturaliste : c'était dans l'épaisseur d'un bois, dans la grotte d'un rocher, que les hommes les priaient, les remerciaient. Mais quand les dieux ont perdu leur caractère physique pour revêtir la forme humaine, quand Homère les a présentés à la Grèce dans tout l'éclat de leur majesté et de leur beauté, une enceinte rustique n'a plus été jugée suffisante pour les recevoir. Cependant c'est encore dans la nature que l'homme puise les éléments des premiers édifices qu'il consacre à ses dieux. S'inspirant de ce que cette nature offre de plus parfait, l'Hellène lui emprunte ses lignes correctes, ses courbes harmonieuses ; il demande à l'arbre la forme de la colonne ; à la forêt, le développement du péristyle ; à ]a feuille, à la fleur, au fruit, à la perle, des ornements d'architecture, et le temple s'élève, simple construction de bois d'abord, monument de marbre ensuite[1]. On continue de révérer dans quelques sanctuaires, les anciens et grossiers simulacres des forces naturelles qu'adoraient les Pélasges ; mais ce n'est pas là que les Hellènes doivent reconnaître les formes idéalisées par le génie d'Homère. De même que l'épopée, la sculpture donne aux Immortels les proportions du corps humain, agrandies, transfigurées. Sans doute, comme Homère aussi, elle représente quelquefois les Olympiens avec leurs attributs les moins nobles ; mais en général, l'art exprime les vertus qu'ils incarnent. Le vulgaire, confondant la divinité avec son image, se prosterne devant la statue, quelle qu'elle soit ; mais les esprits élevés ne cherchent dans la sculpture que le reflet de cette beauté éternelle qui vient de Dieu et qui ramène à lui. Ainsi l'art lui-même contribue à alimenter les deux courants contraires que suit la religion grecque, et qui entraînent les Hellènes, d'une part, à la pratique de l'idolâtrie ; de l'autre, à la conception du monothéisme. Cherchons donc les déesses, non plus au sein de la nature, mais dans les monuments élevés par l'homme. Aujourd'hui que le temps a ruiné ou anéanti ces édifices, contemplons-les par l'imagination, au temps de leur antique splendeur. L'Altis, le bois sacré qui renfermait, à Olympie, le temple de Jupiter, contenait aussi celui de Junon. La déesse y était représentée sur un trône, et le roi de l'Olympe était debout auprès d'elle. De même que la statue de Jupiter élevée dans le sanctuaire du dieu, ces sculptures étaient taillées dans l'or et dans l'ivoire. Mais quel contraste dans la mise en œuvre de ces matériaux ! Quelle distance existait entre les statues des deux époux, productions d'un art encore rudimentaire[2], et l'œuvre du grand sculpteur qui avait moulé l'image où Homère avait peint le maître de la foudre[3] ! Deux femmes choisies parmi les plus nobles et les plus dignes dans chacune des huit tribus éléennes, faisaient le voile que, tous les cinq ans, on offrait à Junon. A la fête de la déesse, elles précédaient la procession, et dirigeaient les deux chœurs qui chantaient la reine du ciel[4]. Elles présidaient aux jeux célébrés en l'honneur de Junon[5] par de jeunes filles qui, les cheveux dénoués, la robe relevée, l'épaule droite découverte, luttaient entre elles à la course, dans le stade olympique. Suivant leur âge, elles étaient divisées en trois groupes ; les plus jeunes s'élançaient les premières dans l'arène, et les plus âgées concouraient les dernières. Celles qui avaient remporté le prix, recevaient avec une couronne d'olivier, une portion de la vache sacrifiée à Junon, et avaient le droit de placer leurs portraits dans le temple de la déesse[6]. Les courses auxquelles présidaient les Éléennes, reproduisaient dans un cadre restreint un concours des jeux olympiques, ces fêtes où, tous les quatre ans, l'adoration de Jupiter Olympien unissait les tribus helléniques et rapprochait leurs cultes particuliers[7], ces fêtes où les Grecs rivalisant de beauté, d'adresse et de courage, rendaient à la divinité suprême l'hommage des dons qu'ils en avaient reçus. Pendant ces jeux, la prêtresse de Cérès Chamyne s'asseyait dans le stade sur un autel de marbre blanc[8]. Il était interdit aux femmes mariées, non-seulement de se mêler aux luttes de l'Élide, mais encore d'y assister : celle qui aurait franchi l'Alphée pendant ces solennités devait être précipitée du haut du mont Typœus. Une seule femme s'exposa aux rigueurs de cette loi : c'était Phérénice, fille de Diagoras, cet illustre athlète dont les triomphes furent célébrés par une ode sublime de Pindare[9]. Veuve et mère, Phérénice voulait voir concourir son fils. Déjà elle s'était placée parmi les spectateurs, quand les juges des combats s'écrièrent : Que faites-vous là ? votre sexe vous interdit cette enceinte. — Ma gloire me l'ouvre, répondit-elle avec une noble fierté : fille et sœur de vainqueurs aux jeux olympiques, j'ai encore l'honneur d'y avoir envoyé un fils[10]. Les Grecs aimaient trop les grands caractères pour s'opposer à une volonté si éloquemment exprimée[11]. D'après les mœurs doriennes, qui accordaient à la vierge plus de liberté qu'à l'épouse, les jeunes filles pouvaient être présentes aux jeux olympiques[12]. Elles avaient même la faculté d'y concourir, permission qui ne s'appliquait sans doute qu'à la course des chars[13]. Dans le bois sacré, on remarquait parmi les statues des vainqueurs, un groupe où Cynisca, sœur d'Agésilas, roi de Sparte, était montée sur un char conduit par un écuyer. Des inscriptions étaient consacrées dans ce même lieu à la princesse lacédémonienne[14]. Cynisca fut la première femme qui disputa un prix aux jeux olympiques[15]. Elle y fut excitée par le roi, son frère. Quelques Spartiates s'enorgueillissant des chevaux qu'ils entretenaient et qu'ils destinaient probablement aux courses de chars, Agésilas voulut leur prouver que l'homme qui triomphait à ce dernier concours, devait son succès, non à sa force personnelle, mais à la fortune qui lui avait permis de nourrir ses rapides coursiers. Ce fut ainsi qu'Agésilas eut la pensée de faire participer sa sœur à cette lutte[16]. Cynisca reçut la couronne réservée aux vainqueurs, cette humble branche que donnait un olivier sauvage situé dans l'Apis[17], et qui semblait aux Hellènes plus enviable que le diadème royal. Pausanias ne se souvient pas que, chez les Spartiates, la poésie ait chanté plus d'un de leurs rois ; mais il constate qu'elle célébra la sœur d'Agésilas. Dans Sparte même, un monument héroïque lui fut élevé près du Plataniste, l'un des quartiers de la ville[18]. La femme dont le nom fut ainsi tiré de l'oubli, offrit à Jupiter Olympien des chevaux en bronze, de grandeur naturelle, qui se voyaient à droite, en entrant dans le pronaos du temple éléen[19]. D'autres femmes suivirent l'exemple de Cynisca. Euryléonis, l'une de ses compatriotes, eut les honneurs d'un prix à Olympie et d'une statue à Sparte. Les Macédoniennes surtout remportèrent la victoire dans les luttes de l'Élide[20]. A Olympie, le culte de Junon devait être effacé par celui de Jupiter. Il n'en était pas ainsi à Samos et à Argos, qui possédaient les deux grands sanctuaires de la déesse[21]. Samos était l'une de ces colonies grecques nées par suite de l'invasion dorienne qui, déplaçant les peuples du Péloponnèse, contraignit plusieurs de ceux-ci à déployer dans l'Archipel et sur les côtes de l'Asie Mineure leur activité féconde. Ce fut dans ces colonies que la civilisation hellénique, vivifiant les antiques traditions de l'Orient, et jouissant de la paix et de la liberté au sein d'un climat enchanteur, parvint pour la première fois à sa luxuriante maturité. Ainsi, un arbre déjà vieux et dont les belles fleurs n'ont jamais donné de fruits, en produit soudain. On s'étonne ; mais l'on découvre qu'à une certaine distance vient de fleurir un, jeune arbre dont le pollen, enlevé par le souffle du vent, a fécondé le végétal stérile. Les désignations primitives de la montagneuse Samos faisaient rêver à ses épais ombrages, à ses fleurs, à cette verte couronne qui ceignait son front souriant et fier ; mais elle avait encore porté un autre nom qui témoignait que la reine de l'Olympe était née sous les saules-osiers de l'Imbrasus : l'île, recevant l'épithète qu'on donnait aussi à son fleuve, se nommait Parthénia, vierge[22]. Au lieu même où Junon avait vu le jour, un temple lui était consacré. Par une touchante coïncidence, le droit d'asile était accordé au sanctuaire qui conservait le saule dont le feuillage avait protégé la naissance de la déesse[23]. Aux fêtes de Junon, approchons-nous de ce temple avec les jeunes filles et les femmes qui, parées de bracelets et le front ceint du diadème, sont suivies de guerriers[24]. Au jour où l'an célèbre la déesse qui idéalise la vie de son sexe, la femme est reine, et le héros lui-même cède le pas à la vierge, à l'épouse. Les hommes se désarment respectueusement à l'entrée du temple[25]. Eux aussi, ils doivent leur culte à la compagne de Jupiter. Si le maître de l'univers est le protecteur des femmes mariées, Junon, comme déesse de l'hymen, est la protectrice des hommes[26]. Le temple de Samos était le plus vaste qui fût connu au temps d'Hérodote, et sa richesse répondait à son étendue. Les trépieds, les vases, les miroirs, tous ces objets d'or et d'argent qui ornaient l'autel ; les statues et les cratères d'airain, les tableaux, qui décoraient l'édifice, contribuaient à faire de ce monument la première merveille de Samos[27]. Mais ce n'est pas encore là que nous rencontrerons la Junon d'Homère. Le grossier soliveau qui était autrefois le simulacre de la déesse, avait été remplacé par l'une des premières statues où la sculpture se Mt essayée à une représentation plus humaine de la divinité[28]. Cette statue était de l'Éginète Smilis. Le vêtement nuptial que portait Junon, rappelait que le lieu de sa naissance avait été aussi celui de son mariage, c'est-à-dire que Samos, après avoir reçu son culte, l'avait associé à celui de Jupiter[29]. Ce n'était pas seulement dans cette île que Junon paraissait avec la toilette d'une mariée. Quand les Grecs fêtaient la commémoration de ses noces par l'hiérogamie ou mariage sacré, son simulacre, revêtu du même costume, était suivi d'un véritable cortège nuptial que formaient les jeunes filles couronnées de fleurs, et les jeunes gens interprétant sur la flûte un air religieux[30]. Après avoir vainement cherché à Samos une digne image de Junon, reprenons notre course capricieuse. Voguons vers l'Argolide ; et quand nous aurons débarqué, rendons-nous à Argos, la ville qui se considérait aussi comme le berceau de la déesse ; puis, suivons le cours du ruisseau Éleuthérius qui arrose la route de Mycènes et dont l'eau purifie les prêtresses de Junon. Au pied du mont Eubée, nous apercevons le monument dédié à la reine du ciel. Remarquons devant l'édifice, des statues de femmes et de héros. Ces femmes sont les ministres du temple[31]. La prêtresse de Junon semble avoir été le grand pontife de la ville. Elle offre à la déesse les sacrifices secrets. A la fête de Junon, quand les jeunes Argiens, couverts d'armes brillantes dont ils se dépouilleront avant de parvenir à l'autel[32], escortent l'hécatombe qui est dirigée vers le temple, la prêtresse suit la procession sur un char attelé de deux bœufs blancs. Les années de son sacerdoce deviennent des dates auxquelles Thucydide rattache des faits historiques. Pendant sa vie enfin, la prêtresse a la gloire de voir s'élever sa statue, monument où, après sa mort, seront gravés et le nom qu'elle a porté, et le temps qu'a duré sa mission religieuse[33]. Au-dessus des colonnes du temple, la sculpture retrace, d'un côté, la naissance de Jupiter et la lutte des géants contre les dieux ; de l'autre, la guerre de Troie et l'entrée victorieuse des Grecs dans Ilion. Quels plus beaux sujets à développer sur le temple de Junon que ceux où éclatent, et la gloire de son époux, et la reconnaissance que les Argiens ont vouée à leur reine, à la déesse qui les a secourus devant Troie ! Mais hâtons-nous d'entrer dans le sanctuaire. Quelle imposante apparition frappe nos regards ! Une colossale statue d'or et d'ivoire se dresse devant nous sur un trône d'or. C'est Junon. Les Grâces et les Heures figurent sur son diadème. D'une main elle tient une grenade[34] ; de l'autre, un sceptre. Des pampres forment les guirlandes de son manteau ; une peau de lion s'étend sous ses pieds. La majestueuse beauté de cette statue décèle le siècle de Périclès. Cette œuvre a eu pour auteur un émule de Phidias, Polyclète, qui a dû, lui aussi, s'inspirer de l'Iliade. Mais ce n'est pas l'épouse courroucée de Jupiter qu'il a représentée : c'est la puissance suprême incarnée dans une forme féminine. Ainsi la chaste et sévère beauté de Junon ne s'offre plus à l'adoration des Hellènes qu'à travers la poésie d'Homère et l'art de Polyclète[35]. Et, dans ce même temple, existaient d'anciennes statues de Junon, premières et informes tentatives de la sculpture hellénique. En comparant ces essais au chef-d'œuvre de Polyclète, les Grecs pouvaient mesurer le chemin qu'ils avaient parcouru en joignant au culte de la tradition l'esprit de liberté. La tradition seule les eût condamnés à l'immobilité des arts orientaux. La liberté seule eût produit dans leurs œuvres plastiques l'anarchie qu'elle amena dans leur vie politique. Mais une sage alliance de l'une et de l'autre enfanta cet art incomparable dont ils léguèrent au monde, sinon le secret, au moins le modèle. Comme au temps d'Agamemnon, la souveraine du ciel règne à Argos ; mais à cette ville n'appartient plus la suprématie qui lui est attribuée dans l'Iliade, et qui, après avoir été le privilège de Sparte, a passé à une autre cité : Athènes est devenue la tète, le cœur, le bras de la Grèce ; elle l'éclaire, elle l'anime, elle la défend, elle l'asservit enfin. C'est naturel. Athènes n'est-elle pas la ville de Pallas-Minerve, la Sagesse qui donne à un peuple le courage guerrier et la beauté morale ! Pour Homère, les noms de Pallas et de Minerve s'appliquaient indistinctement à la déesse, quel que fût l'aspect sous lequel elle se présentât[36]. Maintenait Pallas désigne surtout la déesse de la guerre, et Minerve celle de l'intelligence. Aux yeux du philosophe, celle-ci sera même la sagesse de Dieu[37]. L'Acropole d'Athènes, la citadelle, était le foyer du culte que les Athéniens rendaient à la déesse dont leur ville portait le nom[38]. C'était leur cité, primitive. Quand ils s'établirent dans la plaine, l'Acropole fut exclusivement réservée à leurs dieux, ou plutôt à leur déesse. Et dans cette enceinte où s'élevèrent les temples de Pallas-Minerve, se virent aussi les statues des grands hommes qu'avait inspirés la déesse de la sagesse et des combats. Périclès grava sur ce rocher abrupt la plus admirable empreinte du siècle auquel son nom est demeuré attaché. Des ruines majestueuses, voilà ce qui reste aujourd'hui d'une œuvre que le temps avait épargnée, mais que l'homme n'a pas su respecter[39]. Cette fois encore, oublions le présent. Ne nous arrêtons pas devant ces débris dont la beauté excite et décourage tout à la fois les artistes modernes qui viennent y chercher les traditions d'un art inimitable. Que notre imagination nous fasse vivre dans les siècles où subsistaient encore les œuvres des Phidias, des Mnésidès, des Ictinus, des Alcamène, ces hommes dont le génie répondit aux desseins de Périclès. Par un large escalier, creusé dans le roc et revêtu de marbre pentélique, gravissons le côté occidental de la citadelle. Un vaste palier qui interrompt les marches, supporte les Propylées, imposante décoration de marbre qui forme l'entrée de l'Acropole et dont l'aile gauche contient une collection de peintures. Entre tous ces tableaux, nous en remarquerons deux. L'un nous montre Diomède emportant d'Ilion le Palladium, l'image de Minerve, la statue de bois d'olivier que l'on croyait tombée du ciel, et que nous retrouverons tout à l'heure dans l'Érechthéion. Le second de ces tableaux, dû au pinceau de Polygnote, représente la plus gracieuse de nos héroïnes homériques, Nausicaa qu'entourent aux bords du fleuve ses jeunes compagnes et le guerrier cher à Minerve. En avant des Propylées, s'élève à droite un petit monument ionique dont la construction a paru antérieure probablement à l'administration de Périclès, c'est le temple de la Victoire sans ailes. Le souvenir de la statue placée dans ce ravissant édifice, dicte à Pausanias l'une de ces idées poétiques qui n'émaillent pas d'ordinaire ses arides récits. Suivant le voyageur grec, si les Spartiates ont cru fixer le dieu de la guerre dans leur cité en mettant des fers aux pieds de sa statue, les Athéniens ont voulu s'assurer la fidélité de la Victoire en coupant à la capricieuse déesse des ailes aussi rapides que brillantes. Mais pourquoi les Athéniens auraient-ils redouté l'abandon de la Victoire ? Celle-ci ne leur apparaissait-elle pas comme une personnification de Minerve ; et, d'après une ingénieuse interprétation, la jeune déité n'aurait-elle été représentée sans ailes que parce qu'elle était réellement Minerve, Minerve-Victoire[40] ? Du côté où se trouve le temple de la Victoire, on découvre la mer[41]. Quel rapprochement pour les vainqueurs de Salamine ! Et, quant aux héros de Marathon, quelle joie, quelle fierté, ils devaient éprouver en considérant la Minerve Promachos, la Minerve qui combattit pour eux, cette statue d'airain haute d'environ quatre-vingts pieds, ce colosse qui se dressait au nord-est de l'axe des Propylées, et à l'érection duquel avait été consacrée la dîme de leur butin ! C'était l'œuvre de la jeunesse de Phidias[42]. Minerve devait ainsi sa plus haute statue à l'héroïsme guerrier et au génie artistique de ses enfants adoptifs. La pointe de la lance que tient la déesse, l'aigrette de son casque, sont visibles en mer pour ceux qui reviennent du promontoire Sunium. Cette statue n'est pas, comme les autres monuments de l'Acropole, tournée vers le soleil levant : elle regarde l'entrée de la citadelle. Couverte d'une longue tunique et d'un péplus, s'appuyant sur sa pique de la main droite qu'elle élève, tendant son bouclier de la main gauche, elle est bien, dans cette fière et calme attitude, l'invincible gardienne de la vieille citadelle attique[43]. Combien nous préférons la Minerve Promachos la Pallas des vases antiques ! Celle-ci est peinte dans toute l'ardeur du combat. Tantôt, luttant contre un géant, elle le défie d'un sourire ironique et froid qui nous glace ; tantôt elle l'abat avec une joie victorieuse, ou, conduisant un quadrige comme Jupiter, et foulant sous les pieds de ses fougueux coursiers son ennemi abattu, elle laisse éclater sur son visage une joie cruelle[44]. Ce n'est plus Pallas, ce n'est plus la Sagesse présidant aux combats : c'est Bellone, c'est la furie des batailles ! Dans la citadelle, les habitants de Lemnos ont dédié à Minerve une statue de bronze que Pausanias considère comme le chef-d'œuvre de Phidias, et qu'il cite peu de lignes après avoir décrit le colosse de même métal. Si la Minerve Promachos nous a montré dans la déesse attique le principe de la force guerrière, une autre statue, placée contre la dernière colonne de l'angle sud-est des Propylées, témoigne que la déesse de la sagesse est aussi celle de la santé, Minerve Hyginé[45]. Après cette dernière sculpture, voisine du temple de Diane Brauronia, nous chercherons encore la protectrice d'Athènes sous un doux aspect dans le temple de Minerve Ouvrière, Minerve Ergané, édifice dont la science archéologique a cru retrouver l'emplacement au midi de l'Acropole[46]. Les Athéniens ont les premiers donné à Minerve un surnom qui fait souvenir qu'elle a enseigné aux femmes l'usage de l'aiguille, de la navette et du fuseau[47]. Dans l'enceinte qui appartient à ce sanctuaire, la tendresse conjugale et la piété filiale ont érigé à trois femmes d'une même famille, Lysippe, Timostrata, Aristomaché, l'aïeule, la mère et la fille, des statues exécutées par Léocharès, et par Sthennis. La sage conduite et les laborieuses occupations de ces trois femmes furent, sans doute, les titres qui leur valurent l'honneur d'être représentées dans l'enceinte de Minerve Ouvrière[48], sur cette Acropole où la Pudeur avait un autel[49]. Leur sexe avait du reste acheté le droit d'être immortalisé dans la citadelle. D'après une légende recueillie par saint Augustin, c'étaient les femmes qui avaient donné à Minerve la souveraineté de l'Attique[50]. Au temps de Cécrops, disait-on, l'on vit soudain apparaître dans la citadelle un olivier et une source. L'oracle, consulté, déclara que l'olivier représentait Minerve ; la source, Neptune, et que les sujets de Cécrops devaient choisir entre les deux Olympiens leur divinité éponyme. Cécrops convoqua l'assemblée, à laquelle les femmes avaient alors droit de suffrage. Les hommes accordèrent leurs voix à Neptune, le dieu marin qui livrait à leur ardent esprit de conquête le chemin des contrées lointaines. Les femmes.... est-il besoin de le dire ? les femmes préférèrent l'olivier, l'arbre dont la culture retiendrait leurs pères, leurs frères, leurs maris, dans les champs du pays natal, et deviendrait ainsi le symbole de la paix. Le nombre des femmes dépassait d'une unité celui des hommes, et ce fut cette douce voix qui fit pencher la balance du côté de Minerve. Courroucé, le dieu des mers submergea l'Attique. Pour l'apaiser, les habitants du pays inondé retirèrent aux femmes le droit de voter, celui de transmettre leurs noms à leurs enfants, et celui de porter le titre d'Athéniennes. Ce dernier châtiment eût été le plus cruel de tous ; mais la mesure était trop violente pour être appliquée ; et nous ne pensons pas que celles qui avaient donné à leurs concitoyens le nom de leur déesse, eussent jamais été privées de s'en glorifier elles-mêmes. Quant au deuxième droit qui leur fut enlevé..., si les femmes ne pouvaient léguer leurs noms à leurs enfants, elles pouvaient du moins leur laisser l'héritage de leurs vertus. Les plaindrons-nous davantage d'avoir perdu la faculté de voter, cette faculté dont l'exercice leur avait valu la déchéance civile et politique ? Non. Certes, elles en avaient noblement usé : elles avaient préféré aux expéditions maritimes, les occupations agricoles ; de plus, ce n'était pas à une lâche paix qu'elles avaient accordé leurs suffrages, c'était à la paix armée, c'était à Pallas-Minerve ! Repoussant la guerre offensive, elles acceptaient la guerre défensive, celle qui protège l'honneur de la patrie et l'honneur du foyer. Peut-être même, si les voix féminines avaient toujours été recueillies dans les assemblées, les Athéniens auraient-ils dû à leurs compagnes le bonheur de n'avoir point d'histoire.... Et cependant, qui sait si la légende des belliqueuses Amazones n'eût pas été d'un funeste exemple aux Athéniennes ? D'ailleurs, la vie publique leur eût fait oublier cette vie privée, qui est l'élément naturel de la femme ! Ne regrettons donc pas pour elles les droits politiques, nous qui n'en coudrions pas pour nous ! Si le dévouement que les Athéniennes avaient témoigné à Minerve, les priva de toute participation à la vie publique, quelles attributions religieuses elles durent au culte de la déesse ! Au temple même où est conservé l'olivier de Minerve ainsi que l'empreinte du trident de Neptune et le puits d'eau de mer creusé par le dieu, à l'Érechtéion, nous rencontrons la grande prêtresse de Minerve Poliade ; et cette femme jouit de prérogatives analogues à celles qui distinguent la prêtresse argienne de Junon : le temps de son sacerdoce indique une époque, et sa statue peut s'élever dans la citadelle de Minerve[51]. La prêtresse demeure dans l'enceinte qui dépend de l'Érechthéion[52]. Ce monument historique, entièrement construit en marbra, et qui est, croit-on, postérieur à Périclès, est dédié à Minerve Poliade, et à Pandrose dont on a fait la première grande prêtresse de la déesse attique. Le principal portique, tourné vers l'orient, conduit au sanctuaire de Minerve où se voit le Palladium et qu'éclaire nuit et jour une lampe d'or, surmontée d'un palmier de bronze qui en reçoit la fumée et qui s'élève jusqu'au plafond[53]. Ce temple communique avec celui de Pandrose, auquel donnent aussi accès deux portiques situés à l'extrémité occidentale des longs côtés de l'Érechthéion. Celui de ces portiques qui regarde le midi, et qui, fermé au public, n'a qu'une porte dérobée, offre l'une des plus merveilleuses combinaisons de l'architecture et de la sculpture. Six jeunes filles d'une grave beauté, soutiennent l'entablement avec une grâce et une aisance pleines de liberté. Ces statues paraissent représenter les Errhéphores, vierges chargée ; de diriger les ouvrières qui tissaient et brodaient le péplus dédié à Minerve Poliade lors des grandes Panathénées, et qui appartenaient, comme leurs guides, à l'aristocratie athénienne[54]. L'architrave que supporte le demi-globe posé sur la tête de chaque statue, a rappelé le fardeau confié aux Errhéphores pendant l'une des nuits qui précédaient les grandes Panathénées. La prêtresse de Minerve Poliade leur remettait un fardeau dont elle ignorait elle-même la nature, et que les jeunes filles portaient dans une caverne en l'échangeant contre un autre objet tout aussi mystérieux que le premier. On a conjecturé qu'elles déposaient dans ce souterrain, les restes de la laine qui leur avait servi pour l'ancien vêtement de Minerve, et qu'elles y cherchaient la laine destinée au futur péplus que devaient faire exécuter de nouvelles Errhéphores[55]. Sur ce péplus de couleur safran, étaient brodés en or les combats de Minerve contre les géants, et les actions héroïques que l'État avait jugées dignes de figurer près des exploits de la déesse[56]. Pendant l'année consacrée à ce pieux et patriotique travail, les vierges qui s'en occupaient, résidaient dans l'enceinte qu'habitait la grande prêtresse et qui avoisinait l'élégant portique que nous venons de décrire[57]. Lorsqu'elles paraissaient en public, elles étaient habillées, d'un vêtement blanc et d'un surtout d'or. Les riches Athéniens se faisaient un honneur de subvenir à l'entretien des Errhéphores et de leurs compagnes[58]. Les premières surtout étaient entourées d'une vénération que prouve le nombre des statues qui leur furent élevées dans la citadelle[59]. Nous allons revoir ces jeunes filles en contemplant le Parthénon. Le Parthénon, la demeure de la vierge, la plus noble expression du sentiment religieux chez tes Grecs ! Oui, quand Ictinus et Callicratès ordonnent, sous la direction de Phidias, ce magnifique ensemble, quand Phidias lui-même y met tout son génie, ces artistes ont élevé leur âme vers un idéal plus sublime que celui de la Pallas adorée par le peuple : ce n'est plus à une déesse, c'est à la sagesse même de l'Éternel qu'ils semblent avoir rêvé ; et, lorsque le paganisme se sera écroulé, leur œuvre subsistera, et sera digne d'être consacrée par le christianisme à la Vierge Marie, à la Mère de Dieu, à la sainte femme que l'Église invoquera comme le Temple de la sagesse. Au point culminant de l'Acropole, le Parthénon repose sur un soubassement de trois hauts degrés. C'est un vaste rectangle polychrome, entouré d'un péristyle de quarante-huit colonnes doriques dont huit sont placées à chacune des deux façades. Mais ce qui rend ce monument inimitable, ce n'en est pas le plan, aussi simple que majestueux ; ce n'en sont pas les riches matériaux. Le Parthénon lui-même livre son ordonnance ; et voici, au nord de l'Acropole, le Pentélique qui renferme encore dans ses flancs ses carrières de marbre.... Ce qui constitue la perfection de ce temple, ce sont les courbes savantes que suivent les lignes de l'édifice et dont les anciens Hellènes ont emporté le secret avec eux ; c'est l'heureuse imitation de cette nature qui nous présente, non des plans droits, mais des surfaces horizontales[60]. Et maintenant, examinons les détails du Parthénon : l'histoire d'Athènes nous y apparaîtra dans ses traits généraux et caractéristiques. Plaçons-nous devant la façade principale. Le fronton de cette façade est, le premier, caressé par les rayons du soleil qui se lève derrière l'Hymette ; l'Hymette, la montagne dont les plantes odoriférantes composent le miel inspirateur que les abeilles déposent sur les lèvres de l'enfant qui sera Platon. C'est précisément de l'angle gauche du fronton, c'est du côté tourné vers l'Hymette, que Pnidias a fait surgir les chevaux du Soleil, ces fringants coursiers qui, les naseaux entr'ouverts, paraissent s'enivrer eux-mêmes de la vie qu'ils vont répandre. Nous voudrions nous arrêter devant les admirables figures de ronde-bosse qui décorent ce fronton, depuis Hercule, le protégé de Minerve, le vainqueur de la fatalité, jusqu'aux Parques précédant le char de la Nuit, jusqu'à ces personnifications du Destin, dont les statues sont si séduisantes qu'il semble que, sur le temple de la Sagesse, l'art ait voulu donner à la vie une beauté tour à tour sévère et gracieuse ; à la mort, un attrait effrayant et enchanteur tout ensemble. Mais hâtons-nous de reporter notre regard sur le milieu du fronton, et saluons la Sagesse s'élançant, tout armée, du cerveau de Jupiter[61]. Après avoir assisté à la naissance de Minerve, allons voir sur le fronton occidental, comment la fille de Jupiter devint la déesse de l'Attique. Ici, il ne paraît pas que l'olivier et l'onde marine aient symbolisé la lutte de Minerve et de Neptune. Une autre allégorie a dû être traduite par le sculpteur. D'un coup de son trident, Neptune a créé le cheval, emblème de la source jaillissante[62] ; mais que ferait l'homme de ce coursier furieux, que nul frein n'a encore dompté ?... Minerve étend la main, et assouplit au joug le cheval qui traîne un char que conduisent Érechthée et la Victoire. Et le fleuve qui coule au pied de l'Acropole, l'Ilissus, représenté sous une forme humaine si belle qu'elle restera l'un des modèles de l'art, l'Ilissus se soulève comme pour contempler le char que la personnification de l'Attique et la Victoire dirigent à l'aide de la Sagesse[63]. Qu'il poursuive sa course, ce char glorieux : il porte la civilisation ! Les métopes qui ornent la frise extérieure du temple, nous retracent, avec les actes héroïques accomplis ou provoqués par Minerve, la victoire des Lapithes, ou plutôt des Athéniens, sur les Centaures, cet antique triomphe de la force morale sur ]a force brutale, et la bataille de Marathon, cet autre triomphe d'Athènes, la cité jeune et libre, non plus sur un peuple sauvage, mais sur une vieille et immobile civilisation orientale. D'autres métopes représentent des scènes religieuses, agricoles, où ne figure pas toujours Minerve, mais qui devaient être chères à la déesse. Ici aussi, il faut le dire, on voit Pandore tenant ouverte sa boite fatale[64] ; mais tout ce qui l'entourait ne disait-il pas que les malheurs amenés par elle étaient devenus moins amers, et que les chaînes de Prométhée étaient tombées ? Parcourons l'intérieur du péristyle, et nous y rencontrerons l'expression de la reconnaissance vouée par les Athéniens à leur protectrice. La frise intérieure nous initiera aux solennités nationales d'Athènes, les Panathénées. Ayant été rétablies par Thésée pour célébrer la réunion des douze bourgades de l'Attique en une seule ville, les anciennes fêtes de Minerve prirent dès lors le nom de Panathénées. Elles se célébraient chaque année au mois d'Hécatombéon qui commençait au solstice d'été ; mais la cinquième année, ces solennités avaient un caractère plus auguste, et recevaient te nom de grandes Panathénées[65]. Une panégyrie[66], des courses de chevaux et de chars, des jeux gymniques, des concours de musique et de poésie, tels étaient les éléments communs à la solennisation des grandes et des petites Panathénées ; mais ce qui donnait aux premières un éclat particulier, c'était la procession de ce péplus que nous, avons vu préparer par les vierges d'Athènes. Après s'être rendu à Éleusis, le cortège, suivi d'un vaisseau à roues auquel le péplus servait de voile, et qui était traîné par des matelots, le cortège se dirigeait vers l'Acropole. A la hauteur du temple d'Apollon Pythien, le vêtement destiné à la déesse était détaché du navire, et la procession, gravissant la citadelle, portait le péplus au temple de Minerve Poliade[67]. La frise du Parthénon retrace les grandes Panathénées, non avec un fidélité servile, mais avec une liberté de dessin qui en reproduit, sinon l'ordonnance, du moins la physionomie générale[68]. Au-dessus de l'entrée, les préparatifs de la fête occupent le centre de la composition. A gauche s'avancent, l'une après l'autre, les deux Errhéphores qui portent sur leurs tètes des corbeilles contenant les objets mystérieux qu'elles ont été chercher. D'une main, la grande prêtresse enlève à la première jeune fille le fardeau dont celle-ci est chargée ; de l'autre, elle semble ou lui donner, ou en recevoir, soit un fuseau, soit un flambeau. A droite, l'un des Praxiergides, famille qui a le privilège d'habiller la statue de Minerve Poliade, plie, avec le secours d'un enfant, l'ancien péplus du Palladium. A droite et à gauche de ces scènes, douze divinités assises et deux divinités debout, regardent la procession qui, venant de la façade occidentale et suivant toute la longueur du temple, tourne les angles de la façade orientale. Les groupes qui forment la panégyrie se correspondent de chaque côté, et figurent ainsi un cortège dont les rangs auraient été dédoublés[69]. Les Athéniens qui prenaient part à cette solennité devaient être vêtus de blanc ; et les étrangers, de rouge. Des hommes d'un rang élevé, prêtres ou magistrats, ouvrent la marche, et s'entretiennent sans s'apercevoir de la présence des Immortels. Deux de ces personnages, dont l'un tient un rouleau, se tournent vers le cortège des jeunes Athéniennes, et paraissent donner aux premières des indications que celles-ci recueillent avec déférence et modestie[70]. Les yeux baissés, les belles et virginales Athéniennes s'avancent, chastement enveloppées dans leurs longues tuniques et leurs pépins,- et tenant, celle-ci un candélabre, celle-là une corbeille[71] ; les autres, des vases d'offrande. Les filles des métèques, ou étrangers domiciliés à Athènes, suivent aussi la procession ; mais, dans cette solennité toute nationale, les étrangères ont un rôle humiliant : elles portent des aiguières en signe de servitude[72], ainsi que les ombrelles et les pliants destinés aux canéphores[73]. Dirigés par les ordonnateurs de la fête, de jeunes hommes et des sacrificateurs conduisent les bœufs qui ont été envoyés par les colonies de l'Attique. Les victimes marchent à la mort, les unes sans la voir, les autres en se débattant contre elle. Les vieillards thallophores, appelés par leur beauté à figurer dans le cortège, ont à la main des branches d'olivier, comme l'indique leur nom. Les métèques leur font pendant de l'autre côté de la frise, et paraissent chargés d'auges et d'outres, contenant l'huile sacrée que chaque vainqueur des jeux panathénaïques recevra dans une amphore, avec une couronne d'olivier[74]. Des musiciens s'avancent à la suite des métèques : les uns jouent de la flûte, les autres de la lyre, et les voix de ceux-ci semblent se mêler aux accents des hommes qu'ils précèdent, et qui, dans une attitude inspirée, modulent les vers d'Homère, le chantre immortel de Pallas-Minerve[75]. Les exigences de la sculpture n'ont pas permis à Phidias de reproduire dans la panégyrie le vaisseau auquel était attaché ]e péplus de Minerve. En revanche, l'artiste a placé à la fin du cortège les chars et les brillants cavaliers qui devaient concourir aux luttes des Panathénées. Un détail nous frappe ici particulièrement. Chaque quadrige est conduit par une femme ayant à côté d'elle un guerrier. Est-ce réellement une femme ? Si nous étions à Sparte, la patrie de Cynisca, la cité où les jeunes filles luttent entre elles sous le regard des hommes, nous pourrions le croire ; mais nous sommes à Athènes, la ville qui cache les femmes dans l'ombre du gynécée, et ne leur permet de se mêler aux pompes religieuses que dans l'attitude recueillie qui sied à leur sexe. Nous aimons mieux voir dans les conductrices des chars, les êtres allégoriques qui personnifient le génie du combat[76]. Aux Panathénées, on priait pour Athènes et pour sa fidèle alliée de Marathon, Platée[77]. Si un citoyen s'était distingué au service de la patrie, c'était l'une des époques que l'on choisissait pour le couronner. Les sentiments de piété, de patriotisme, n'étaient pas les seuls qui remplissent alors l'âme des Athéniens ; la charité s'y mêlait aussi. Durant les Panathénées, les captifs étaient libres ; et les victimes immolées aux sacrifices qui terminaient ces fêtes étaient généreusement distribuées au peuple. Ces jours-là sans doute, les Athéniens aimaient à se rappeler que, seuls en Grèce, ils avaient consacré un autel à la Pitié ; que leurs douze bourgades s'étaient groupées autour de ce monument, que leur ville tout entière jouissait du droit d'asile, et que, à l'aréopage même, l'austère tribunal établi par leur déesse, c'était, non dans l'urne de la mort, mais dans l'urne de la miséricorde, que le suffrage de Minerve était jeté quand les juges se partageaient[78]. Ainsi la sagesse incline l'âme vers la pitié... Nous nous sommes longuement attardée à contempler devant la frise du Parthénon la fête des Panathénées. Il est temps de visiter l'intérieur de l'édifice. Derrière la grille du portique, sont exposés de riches objets d'orfèvrerie religieuse. On a placé aussi dans le vestibule le trône au pied d'argent, du haut duquel Xerxès vit égorger ses soldats, les combattants de Salamine[79] : comme aux temps héroïques, les dépouilles des vaincus sont offertes à la protectrice des Grecs. Si naguère nous étions frappée d'étonnement devant la Junon de Polyclète, qu'éprouverons-nous à la vue du colosse de Minerve, statue haute d'environ quarante-sept pieds[80], et due à Phidias qui a reproduit les chairs par l'ivoire, les draperies par l'or ! Minerve est debout. Sur sa tunique talaire[81], brille l'égide au milieu de laquelle se découvre la tète de Méduse. Son casque porte, au sommet, le sphinx, emblème de la pénétration divine, et, de chaque côté, un griffon, être fabuleux ayant le corps du lion ; le bec et les ailes de l'aigle, et exprimant dignement ainsi la force de celte intelligence suprême, son regard perçant qui plonge dans la plus éblouissante lumière, et son vol rapide, élevé, qui plane au-dessus des hauteurs terrestres. D'une main, la déesse porte une victoire ; de l'autre, elle tient une pique. Près de cette arme, un serpent symbolise Érechthée, roi né de la terre. La lance de Minerve protège ainsi une personnification du peuple athénien. Aux pieds de Minerve est un bouclier sur lequel sont gravés, à l'intérieur, la lutte des géants contre les dieux ; à l'extérieur, le combat des Athéniens et des Amazones. Cette dernière scène révèle de curieux détails. Les Athéniens, si fiers de l'œuvre de Phidias qu'ils ont voulu se l'approprier tout entière, lui ont défendu de la signer : l'artiste a répondu à cet ordre en plaçant son image parmi les figures des guerriers athéniens. D'après l'agencement des diverses parties qui composaient la statue, le colosse se serait écroulé si l'on en avait détaché le portrait de Phidias. L'artiste n'avait pas voulu sacrifier sa gloire : il n'oublia pas davantage la reconnaissance qu'il devait à Périclès, le grand homme que l'on distinguait aussi dans ce belliqueux tableau. Phidias paya cette fière revendication de ses droits et cette généreuse expression de sa gratitude, en mourant soit dans une prison, soit dans l'exil. Des bas-reliefs ayant pour sujet la lutte des Centaures contre les Lapithes, ornent la haute semelle de la chaussure tyrrhénienne que Phidias a donnée à la déesse ; et la naissance de Pandore, la séduisante, protégée de Minerve, est sculptée sur le piédestal[82]. Représentons-nous maintenant la grandeur et la majesté que le génie de Phidias dut répandre sur les formes de la déesse ; la beauté calme et sévère qu'il dut imprimer sur son visage. Animons cette figure du regard étincelant qu'Homère attribue à Minerve, et que l'artiste obtint par les deux pierres précieuses dont il forma les yeux de la déesse. En évoquant ce type aujourd'hui perdu, notre imagination s'émeut ; et cependant, pour nous, la Minerve de Phidias n'est qu'une œuvre d'art. Quelle impression causait-elle aux Athéniens qui la vénéraient comme un objet de leur culte le plus ardent ? La piété publique ou individuelle remplit d'offrandes précieuses le temple de Minerve. Les sacrifices grecs se célébrant à l'extérieur, sur un autel élevé devant la temple, le Parthénon était probablement fermé à la foule qui, à l'exception des visiteurs, ne pouvait en admirer les richesses que de loin. Ainsi purent être déposés autour de la statue de Minerve, les armes, les emblèmes, les meubles, les lyres, les joyaux, dont on a retrouvé l'inventaire[83]. Au Parthénon aussi étaient placés des bijoux et des vêtements consacrés à Minerve par des femmes. Mais pourquoi quelques-uns de ces habits ont-ils été donnés au temple, usés ou défraîchis[84] ? De pieux souvenirs se rattachaient-ils à ces vêtements qu'avaient portés une femme, un enfant ? Derrière le sanctuaire s'étend l'opisthodome auquel appartient la façade occidentale du Parthénon. Là étaient conservées, avec le trésor public, les contributions que les villes grecques payaient à la cité qui défendait leur indépendance contre l'invasion des Barbares, mais non pas contre sa propre ambition[85]. A Athènes, Minerve tenait sous sa sauvegarde l'or de la Grèce. A Delphes, elle était, sous le surnom de Providence, invoquée comme l'une des protectrices de la ligue amphictyonique, l'assemblée générale des Hellènes[86]. La première déesse de cette confédération était Diane qui, aux siècles de décadence, fut entièrement identifiée avec une autre déesse lunaire, Hécate[87]. Un temple, classé parmi les sept merveilles du monde, fut élevé à Diane dans la cité d'Éphèse. Toutes les villes de l'Asie Mineure concoururent à l'érection de cet édifice, où Chersiphron formula pour la première fois les règles de l'ordre ionique. Il était naturel que l'ordre architectural qui, par sa grâce et son élégance, a été comparé à la femme, et opposé à la mâle beauté du dorique, fût inauguré pour le temple d'une déesse. Bientôt incendié, ce monument fut réédifié ; mais les Éphésiens seuls voulurent payer les frais de cette reconstruction, et leurs femmes y consacrèrent les bijoux qu'elles possédaient. Ce n'est pas dans ce temple que nous apparaîtra la sœur d'Apollon. La Diane d'Éphèse est une déesse asiatique analogue à l'Anahid arménienne et perse, à la Diane Taurique, et avec laquelle on a confondu la déesse grecque ; c'est une divinité qui réunit les attributs de la terre féconde à ceux de la lune. Le simulacre placé dans le sanctuaire, est d'une forme toute primitive : c'est une gaîne que rayent des zones de cerfs, de lions, de taureaux[88]. Hâtons-nous de quitter ce temple où, d'ailleurs, sont seules admises ces prêtresses de Diane qui eurent pour devancières les farouches Amazones[89]. Nous trouverons tout près de nous[90], la déesse dorienne telle que nous la rêvons : c'est l'admirable statue que l'on nomme Diane à la biche. Dans l'attitude de la course, Diane paraît franchir d'un pas rapide et ferme les escarpements de la montagne. Sa courte tunique spartiate, son manteau roulé en ceinture, dessinent sa taille souple, élancée. Aucun tissu ne voile ses bras ni ses jambes, membres pleins de vigueur et de légèret4. D'élégantes sandales s'attachent à ses pieds. Les formes sobres et nerveuses de cette statue décèlent la déesse chasseresse. D'un geste protecteur, Diane étend sur une biche qui s'est réfugiée auprès d'elle sa main gauche armée de l'arc[91]. Elle tourne la tête vers le carquois suspendu à son épaule droite et y cherche une flèche. Un diadème couronne sa chevelure ondulée qui se noue par derrière en corymbe, coiffure particulière aux vierges athéniennes. Rien ne saurait rendre le mélange d'indignation et de dédain qu'expriment les traits si purs de l'altière déesse. On sent que Diane a devant elle un adversaire dont l'audace l'étonne, mais dont le châtiment lui est assuré d'avance. Ce téméraire, c'est, d'après une séduisante conjecture, Hercule même : Hercule à qui la reine des forêts enlève la proie qu'il poursuit[92]. On comprend maintenant les impressions qui se trahissent sur le visage de Diane, et l'on devine que si Hercule, par sa nature humaine, provoque le mépris de la déesse, par son héroïsme du moins il lui semble digne du courroux qu'elle ressent. Ce n'est pas vous, filles d'Athènes, jeunes recluses qui suivez avec lenteur et recueillement la procession des Panathénées, ce n'est pas vous que nous appellerons pour rendre hommage à la déesse chasseresse. Mais, vierges spartiates, vous qui êtes habituée aux courses rapides, vous qui savez lancer le disque et le javelot, venez fêter votre divinité ! La base d'un candélabre antique[93] nous montre trois jeunes filles qui, couronnées des roseaux de l'Eurotas, vêtues d'un costume léger, se livrent à une danse vertigineuse. Deux d'entre elles élèvent les bras vers la tête, tandis que la troisième fait retentir un tympanon. Ils ne se sont pas trompés, sans doute, les archéologues qui ont vu dans ces danseuses des Lacédémoniennes célébrant le culte de Diane[94]. Mais nous nous sommes éloignée de Delphes au moment où nous y entrions. Reprenons la route montagneuse de la ville sacrée qui se dessine comme un amphithéâtre entre les deux sommets du Parnasse, la montagne chère aux Muses[95]. Que dans le temple d'Apollon[96], où les Hellènes placent le centre du monde, les oracles du dieu nous soient dévoilés par la plus célèbre des prophétesses et des sibylles de la Grèce, la Pythie[97]. Le consultant que la voie des sorts, ou la priorité d'un droit national, a désigné pour s'approcher de la Pythie, et qui, avant de pénétrer dans le sanctuaire, s'y est préparé par une purification et des sacrifices, le consultant n'interroge pas directement la prêtresse. Il a remis au prophète chargé d'écrire la réponse de ]a Pythie, une tablette sur laquelle est tracée sa demande. Le front couronné de laurier, il tient à la main l'arme des suppliants, le rameau d'olivier entouré d'une bandelette de laine blanche. La prophétesse n'apparaît aux regards qu'au milieu d'un nuage d'encens. Autrefois c'était une vierge qui rendait les oracles d'Apollon ; mais un exemple ayant montré les dangers auxquels la beauté de la prêtresse pouvait l'exposer, on ne choisit plus la Pythie que parmi les Delphiennes ayant dépassé l'âge de cinquante ans. Toutefois la prophétesse continua de porter le costume d'une jeune fille, et la pureté de mœurs fut toujours exigée d'elle aussi bien que des prêtresses en général. La Pythie a méché des feuilles de laurier ; l'arbre d'Apollon lui a aussi donné sa couronne et les guirlandes qui entourent son trépied sous lequel rampe un serpent, emblème de la divination. Ce trépied recouvre, vers le milieu du sanctuaire, une ouverture qui se creuse pour livrer passage aux exhalaisons de la source Cassotis. La vapeur qui s'échappe de cette caverne, c'est le souffle d'Apollon, c'est le principal agent du délire qui animera la prophétesse. La Pythie s'est placée sur le trépied après avoir goûté l'eau de la fontaine Castalie, onde inspiratrice que buvaient les poètes. Par un de ces curieux rapprochements qui, dans la Grèce moderne, ne sont pas rares entre l'antiquité profane et l'antiquité chrétienne, on voit aujourd'hui près de cette fontaine une chapelle dédiée au grand et vrai prophète qui baptisait dans une onde plus justement vénérable que cale de Castalie : celle du Jourdain L'esprit troublé par la vapeur du gouffre, par les rites mystérieux qu'elle vient d'accomplir, et sans doute aussi par l'influence magnétique du prophète, le corps affaibli par le jeûne et par la maladie, la Pythie est en proie à une violente surexcitation nerveuse. Le soulèvement de sa poitrine, la rougeur et la pâleur successives de sou visage, les mouvements convulsifs qui la saisissent, les plaintes qu'elle exhale, trahissent ses tortures, jusqu'au moment où, la flamme dans le regard, l'écume sur les lèvres, les cheveux dressés d'horreur, empêchée de fuir le trépied par les prêtres qui la maintiennent au lieu de son supplice, elle lacère son bandeau, et, hurlant de douleur, laisse échapper quelques paroles..... Le dieu s'est fait entendre ; et c'est ainsi, dit une légende, que le vers héroïque fut, pour la première fois, employé par la Pythie pour traduire l'inspiration divine. L'arrêt d'Apollon, tracé par le prophète sur la tablette du consultant, est donné à celui-ci. Quel moment d'agitation pour l'homme crédule qui allait savoir le sens de sa destinée[98] ! Bien qu'on demandât à la Pythie d'expliquer les moins intelligibles réponses de Dodone, l'oracle delphique était souvent ambigu ; de plus, il fut quelquefois vénal. Néanmoins, quand on parcourt l'ensemble des décisions qu'il rendit, on y sent un souffle patriotique et généreux qui explique et justifie son influence. Les peuples de la Grèce et les rois de l'étranger consultent la Pythie. A sa parole, les Grecs émigrent en Italie, en Afrique, et y répandent, avec leurs colonies, leur brillante civilisation. La prophétesse sanctionne les lois ; elle enseigne à Lycurgue que les meilleures sont celles qui obligent les chefs à bien commander, les peuples à bien obéir ; et qu'on obtient ce résultat, non par l'esclavage, cause de discorde et de malheur, mais par la liberté basée sur la concorde des citoyens et défendue par leur courage. La Pythie confirme la royauté du plus puissant souverain asiatique connu. À elle de décider l'entreprise, la marche des guerres, d'en indiquer l'issue ! Elle conseille aux vaincus la résignation et l'espoir, ou leur promet une éclatante revanche. A ceux qui souffrent d'une défaite, d'une famine, ou qui désirent une conquête, elle ordonne de raviver leur piété envers la divinité, de rechercher et d'honorer les ossements de quelque héros qu'ils ont méconnu ou dont ils ont cessé de cultiver la mémoire ; elle les adjure encore de rappeler les exilés ; et leur apprend ainsi que les peuples se relèvent et se fortifient en reconnaissant la puissance divine, en vénérant et en imitant les grands hommes, et qu'ils s'attirent le pardon du ciel en se montrant eux-mêmes miséricordieux. Pourquoi faut-il qu'une fois la prophétesse ait mis le salut d'une nation au prix d'un sacrifice humain, celui d'une vierge ! Passons rapidement sur un oracle aussi exceptionnel, et que le noble rôle de la Pythie nous attire de nouveau[99]. La prophétesse déclare à un roi que s'il est malheureux, il le doit à ses injustices et à celles de ses prédécesseurs ; elle recommande la clémence à ce même souverain, alors qu'il va rentrer dans le royaume d'où ses sujets l'ont chassé. Elle refuse de répondre à l'homicide, au sacrilège, au lâche. Elle estime que l'homme le plus heureux du monde est celui qui a donné sa vie pour son pays. Si elle place le bonheur dans une mort glorieuse, elle l'associe aussi à une vie de labeur, et dit au possesseur du plus célèbre empire d'alors, qu'il y a un homme dont la félicité dépasse la sienne : c'est un vieux cultivateur vivant dans la montagneuse Arcadie sans aucune de ces ambitions inassouvies qui causent au riche tous les soucis de la pauvreté[100]. Le Spartiate Glaucus essaye de faire légitimer par l'oracle un parjure qui le mettrait en possession d'un trésor. La Pythie lui répond que si la mort n'épargne pas plus l'homme fidèle à son serment que celui qui a immolé son honneur à la fortune, la postérité du premier est heureuse, tandis que celle du second s'éteint. Et lorsque le Lacédémonien repentant prie Apollon de lui pardonner la demande qu'il a osé lui faire, la prêtresse réplique sévèrement que l'homme qui a tenté d'associer la divinité à un projet déloyal, est aussi coupable que celui qui aurait exécuté ce dessein. Peu de générations après, la maison de Glaucus a disparu[101]. Par cette morale si pure et si élevée, l'oracle delphique était digne de juger le mérite des hommes et de régler le culte des dieux. C'est la Pythie qui salue Lycurgue plutôt comme un immortel que comme un homme. C'est elle aussi qui fait d'un trépied d'or le prix de la sagesse ; et les sept sages de la Grèce se déclarant indignes de cette récompense, se la renvoient mutuellement jusqu'à ce qu'elle soit consacrée à Apollon. C'est encore la Pythie qui proclame Socrate le plus vertueux des mortels. Pindare exalte-t-il la Grèce.de son enthousiasme lyrique, la prophétesse dit aux Delphiens de lui donner, dans les sacrifices qu'ils offrent au dieu de la poésie, une part semblable à celles que reçoivent les prêtres d'Apollon. A la Pythie enfin ; il appartient de décerner aux grands hommes les honneurs de l'apothéose, et de sanctionner l'entrée d'un dieu nouveau dans le panthéon hellénique[102]. Quelle puissance dans les mains d'une femme ! Une créature frêle, nerveuse, représentant l'institution religieuse la plus influente du monde païen[103], présidait aux destinées d'une illustre nation, et les rois des contrées lointaines se courbaient sous ses oracles ! On nous dira que la Pythie, faible d'esprit et de corps, issue d'une humble famille[104], n'était que l'instrument des prêtres, soit ! Mais il n'en est pas moins vrai que les Grecs, de même que les Indiens, les Gaulois, les Germains, attribuaient à notre sexe le don de seconde vue. Il n'en est pas moins vrai non plus, que la vie immaculée qui était exigée de la Pythie, attestait que, pour recevoir l'inspiration du dieu de la lumière, il fallait une pureté dont la femme seule pouvait alors offrir l'exemple. Étrange contraste ! notre sexe ne pouvait consulter cet oracle delphique qu'interprétait une femme[105]. Tous les deux ans, au solstice d'hiver, pendant la nuit la plus longue, les échos du Parnasse retentissaient de cris qui exprimaient un délire moins noble que celui de la Pythie, bien que la fureur de la prophétesse fût parfois confondue avec lui : c'était au temps où les Thyiades athéniennes, ces prêtresses de Bacchus, la divinité nouvelle, venaient se mêler aux femmes de Delphes pour célébrer les souffrances du dieu de la vigne, alors que celle-ci était dépouillée de ses pampres. Une tradition légendaire désignait particulièrement le Parnasse à la vénération des Bacchantes : les deux cimes de ce mont, consacrées, l'orne à Apollon et à Diane, l'autre à Bacchus, étaient illuminées, pendant la nuit, par les torches que le dieu du vin tenait en dansant. Exclusivement fêtées par les femmes, les Bacchanales se
renouvelaient ailleurs en général tous les trois ans. C'étaient des orgies
dont la tristesse se transformait en un sombre délire. Les femmes de Thrace,
de Phocide, de Béotie, les Lacédémoniennes, quittaient leurs travaux
domestiques. Elles croyaient sans doute entendre cet appel que leur dieu
Bacchus, Évios, adressait aux Lydiennes : Courage, courage, Bacchantes, délices du Tmolos,
dont l'or enrichit le Pactole ! Chantez Bacchus au bruit des tambours
retentissants ! Évoé ! célébrez votre dieu Évios par des cris
de joie, par des chants phrygiens, lorsque les doux sons de la flûte sacrée font entendre des accents sacrés en accord
avec vos courses rapides. A la montagne ! à la montagne ![106] Et ces Bacchantes : Ménades, Thyiades et autres, s'élancent dans les cavernes de l'Olympe, sur les âpres sommets du Parnasse, du Cithéron, du Taygète. Vêtue d'une longue tunique sur laquelle est jetée la nébride ou peau de faon, l'adoratrice de Bacchus a demandé sa couronne au lierre, au feuillage du chêne, au smilax fleuri, aux pampres de la vigne. Sa main droite agite le thyrse, cette tige de férule ornée d'une bandelette et terminée par une pomme de pin. Des serpents s'entrelacent dans sa chevelure, ou attachent sa nébride. Une Ménade qu'une panthère accompagne en bondissant, frappe son tympanon avec les reptiles qui s'enroulent autour de son bras ; le tambour retentit, la panthère hurle, le serpent siffle, et au bruit de ce sinistre concert, les autres Ménades, les vêtements en désordre, se livrent à une danse vertigineuse, tandis que les guirlandes glissent de leurs têtes rejetées en arrière et que leurs cheveux épars sont agités par le vent. Que les bergers ne conduisent pas leurs troupeaux dans le
voisinage des Bacchantes ! Celles-ci savent imiter le dieu dont elles
chantent ainsi les sauvages plaisirs : Quelle joie pour lui de s'égarer dans les montagnes, de quitter les danses rapides, pour se jeter sur la
terre, revêtu de la nébride sacrée, de poursuivre le bouc et de manger sa
chair palpitante !..... Évoé ![107] Dans leur ardeur de carnage, les Bacchantes ne discernent pas entre l'homme et l'animal. La mère elle-même déchire son fils qu'elle prend pour un lionceau, et place avec fierté au sommet de son thyrse la tête sanglante de son enfant[108]. Hâtons-nous de dire qu'Athènes goûta peu ces orgies dont l'immoralité égalait la cruauté[109]. Les fêtes de Bacchus avaient en Attique un caractère plus doux. L'approche des vendanges donnait naissance à une solennité dont, les frais étaient payés par de riches Athéniennes, et pendant laquelle des pampres, ainsi que des fruits attachés à des rameaux sacrés, étaient portés en pompe[110]. Quand, aux Lénées, les raisins étaient foulés dans le pressoir, et que le jus de la vigne était goûté avant sa fermentation, il se faisait une procession à laquelle se rattache l'origine de la comédie. On y remarquait les Bacchantes qui représentaient les compagnes du dieu, et les canéphores qui appartenaient à l'élite des familles athéniennes. Lors des Anthestéries, où les tonneaux étaient ouverts et livraient leur liqueur, des rites mystérieux étaient accomplis pendant la nuit au Lénéon, le plus antique et le plus respecté des temples de Bacchus, et dont l'accès, toujours interdit aux Athéniens, était alors permis à la Basilissa, épouse de l'archonte-roi[111]. Celle-ci était accompagnée de quatorze femmes vénérables, désignées par son mari, et recevait près de l'autel le serment par lequel ses compagnes attestaient qu'elles étaient pures. Suivant une loi qui était gravée sur une colonne de marbre placée dans le temple, la Basilissa, héritière du sacerdoce des reines, citoyenne d'Athènes, femme de mœurs irréprochables, la Basilissa offrait des sacrifices pour le salut de l'État[112]. Représentant, d'après une intéressante conjecture, la ville et le sol de l'Attique, elle s'unissait à Bacchus, dieu de la production Cette coutume en a rappelé une autre, celle où le doge de Venise renouvelait les fiançailles de la ville des lagunes avec la mer qui fut la source de la puissance vénitienne[113]. Les Anthestéries avaient lieu au retour de la belle saison ; et, jusqu'aux petits enfants, tout le monde s'y couronnait des fleurs printanières. Lorsque la fête était terminée, ces guirlandes étaient portées au Lé-néon, et dédiées à Bacchus par sa prêtresse[114]. Une sculpture du Louvre nous a paru retracer le souvenir de cet hommage ; c'est le bas-relief des Offrandes qu'on a cru pouvoir attribuer au même monument que celui des Danseuses, ces belles et souriantes hiérodules à la taille svelte, élancée, aux mouvements nobles, modestes, et qui, drapées dans leurs vêtements d'air tissu, et se tenant par la main, marient si harmonieusement leurs pas devant un portique. La scène des Offrandes nous montre un temple devant lequel des parfums brûlent dans de hauts candélabres. Trois jeunes filles, rasant le sol de leurs pieds légers, s'apprêtent à orner de fleurs les abords de l'édifice. L'une porte une couronne ; ses compagnes vont suspendre d'un candélabre à l'autre des guirlandes terminées par des bandelettes. Leur attitude gracieuse et digne convient au rite religieux qu'elles accomplissent. A ce bas-relief appartenait une Bacchante qui en est détachée aujourd'hui, et qui se dirigeait rapidement vers la droite. Bien que sa tète ravissante soit rejetée en arrière, le bandeau n'a pas échappé à sa flottante chevelure, et ses draperies, tout enflées qu'elles soient par le souffle de l'air, enveloppent chastement ses formes d'une antique beauté. Sa main droite tient le thyrse, et sa main gauche, la partie antérieure d'un chevreuil, morceau épargné par le feu de l'autel pour le festin du sacrifice. Il a été présumé que les Offrandes se rattachaient au culte de Bacchus[115]. Ce tableau ne rappellerait-il pas le moment où les fleurs dont s'étaient parés les Athéniens, venaient d'être consacrées à Bacchus ? Dieu de la végétation, Bacchus était quelquefois, notamment aux Anthestéries, vénéré en commun avec les grandes déesses agricoles. Le culte de Bacchus fait donc penser à celui de Cérès et de Proserpine. Pendant les cinq jours des Thesmophories de l'Attique, au moment des semailles d'automne, on rendait particulièrement hommage à la Cérès législatrice, la déesse qui avait basé ses institutions sur l'agriculture et la propriété. Les Thesmophories étaient solennisées par le sexe auquel appartenaient les grandes déesses. Deux femmes, choisies dans chaque tribu par leurs compagnes, étaient chargées de présider à ces fêtes. Pour honorer dans la terre féconde, le symbole de la maternité, elles devaient être mariées. Si leurs époux possédaient trois talents[116], ils étaient obligés de leur donner la somme nécessaire pour payer les frais de la fête. Mais là se bornait le rôle de l'homme : la peine de mort attendait le téméraire qui eût osé pénétrer dans l'édifice où les femmes accomplissaient pendant la nuit les rites mystérieux des Thesmophories. Les femmes se préparaient par une conduite pure à une solennité où elles paraissaient couvertes de voiles blancs. Le premier jour des Thesmophories, le 9 du mois de Pyanepsion, elles allaient au siège primitif de la fête, à Halimus, près du promontoire Colias. Avec ce singulier mélange de gravité et de légèreté qui caractérisait le spirituel peuple d'Athènes, elles égayaient de leurs railleries cette pompe religieuse : c'était là disait-on, un souvenir des plaisanteries par lesquelles une esclave fit sourire Cérès, alors que la déesse regrettait amèrement sa fille enlevée par Pluton. Arrivées au temple de Cérès Thesmophore et de Proserpine, sur les bords de la mer, les femmes y célébraient des rites nocturnes qui se confondaient probablement avec le culte de Vénus Colias, déesse dont la statue se voyait sur le promontoire de ce nom. Le 11, la procession rentrait à Athènes ; et les nuits suivantes jusqu'au 13, la fête se continuait au Thesmophorion. Le lendemain de leur retour, les femmes, assises par terre dans le temple de Cérès, jeûnaient jusqu'au soir. Elles invoquaient les dieux au son de la cithare,' ou dansaient en chantant des hymnes. Elles appelaient aussi, au milieu d'elles, Pallas, la virginale protectrice d'Athènes. Elles souhaitaient que la sage et libre guerrière fût accompagnée de la paix, et invitaient Cérès et Proserpine, les divinités civilisatrices et agricoles, à assister dans leur temple aux cérémonies de leur culte. Le 13 de Pyanepsion, dernier jour des Thesmophories, un sacrifice était offert à Calligénie, surnom sous lequel les Athéniennes honoraient dans Cérès la mère d'une belle enfant. Elles paraissaient ainsi demander à la terre de toujours bénir le grain qu'elle faisait germer, et de leur accorder à elles-mêmes la grâce d'une maternité aussi heureuse, aussi bienfaisante que la sienne. Pendant les Thesmophories, les femmes se souvenaient également que les joies de Cérès avaient été mêlées de bien des douleurs. Des scènes dramatiques représentaient l'enlèvement de Proserpine et le chagrin de sa mère[117]. La légende des grandes déesses donna naissance à un hymne homérique qui est probablement le plus ancien poème attique qui nous soit parvenu[118]. Rappelons ici ce chant d'un sens si profond et d'une expression si émue. Proserpine, jouant avec les Océanides, cherchait des fleurs dans une prairie que visitait la belle saison succédant à l'hiver. Ainsi les poètes antiques aimaient à confondre la jeunesse de la femme et celle de la nature, les fleurs printanières de celle-ci et les charmes naissants de celle-là[119]. Les jeunes vierges cueillaient la rose, l'iris, la violette..... La plante qui, par son éclat ou sa délicatesse, devait enchanter les filles des dieux, ne pouvait faire surgir chez les Immortelles l'arrière-pensée mélancolique que cause aux humains la vue de la fleur passagère. Le blanc narcisse dont la coupe d'or se couronne de pourpre, parfumait aussi la prairie. Proserpine l'arrache avec joie.... Soudain, du sol qui s'entrouvre, s'élance le dieu des régions souterraines, et Pluton enlève la fille de Cérès. Ainsi la terre absorbe la graine qui tombe des fleurs[120]. Les cris de la déesse sont répercutés par les cimes des monts et les abîmes de la mer. Cérès a reconnu la voix de sa fille. Elle lacère les bandelettes qui entourent sa chevelure ; elle s'enveloppe d'un sombre manteau, et, rapide comme l'oiseau de proie, elle se précipite sur la terre, sur la mer. Pendant neuf jours, renonçant au nectar, à l'ambroisie, elle ne rafraîchit plus dans le bain ses membres immortels ; mais elle cherche sa fille en tenant des flambeaux. Ces torches étaient les attributs que les mystères d'Éleusis devaient donner à ces déesses souterraines que l'imagination se représentait plongées dans une telle nuit que, lorsqu'elles montaient vers la lumière, elles obscurcissaient jusqu'aux rayons du soleil[121]. C'est pourquoi Cérès ne quitte point ses flambeaux lorsque, accompagnée d'Hécate, la Lune, qui a entendu les cris de Proserpine, mais qui n'a pas vu le ravisseur, elle se rend auprès d'Hélios, le Soleil[122], ce témoin des actions divines et humaines auquel elle demande ce qu'est devenue sa fille. Hélios lui apprend que Pluton a enlevé Proserpine, et ne lui laisse pas ignorer que l'aveu de Jupiter a encouragé l'audace du coupable. En vain le Soleil essaye-t-il de consoler Cérès en lui rappelant l'illustration de son gendre, la déesse s'afflige plus encore lorsqu'elle sait que sa fille a franchi le seuil qu'on ne repasse point, et que, si celle-ci règne, c'est sur la mort ! Cérès ne veut plus habiter ce lumineux Olympe d'où son enfant est bannie. Elle revêt la forme d'une femme âgée, et parcourt les cités humaines. Son cœur meurtri doit plus comprendre les peines des mortels que les joies des Olympiens. Enfin Cérès s'arrête à Éleusis. Sur le bord de la route, un olivier abritait le puits Parthénios, près duquel s'assoit la déesse. Les quatre filles du roi Céléus viennent puiser de l'eau dans leurs vases d'airain. Elles remarquent l'étrangère, l'interrogent avec sympathie, lui proposent d'entrer dans les demeures des Eleusiniens où des femmes de son âge la recevront cordialement. Cérès leur dit qu'elle se nomme Deo, et qu'elle a été enlevée par des pirates auxquels elle a pu échapper. Elle supplie les jeunes filles d'avoir pitié d'elle, et exprime le vœu qu'on la charge du soin d'un enfant ou de la garde d'une maison. Callidice, la plus belle des quatre princesses, donnant à la malheureuse femme le nom de mère, l'exhorte à la résignation. Elle lui assure que toutes les femmes des héros éleusiniens, fidèles gardiennes de leurs foyers, seront bienveillantes pour l'étrangère qui est semblable à une divinité ; elle lui dit aussi que ses parents ont un fils, cher rejeton de leur vieillesse, et lui fait espérer que cet enfant pourrait lui être confié. Les jeunes filles se rendent chez Métanire, leur mère, et bientôt Cérès lés voit accourir, vives et légères, laissant flotter sur leurs épaules les boucles de leurs luxuriantes chevelures : la reine a désiré recevoir l'étrangère, et les princesses viennent la chercher. Enveloppée dans un voile qui tombe jusqu'à terre, Cérès paraît à la porte du palais et s'arrête sur le seuil. Sa haute taille, l'éclat qui l'environne, trahissent la déesse dans la femme. La reine est saisie d'un recueillement religieux ; elle offre son siège à l'étrangère ; mais celle-ci, muette, les yeux baissés, ne consent à se reposer qu'au moment où Iambé lui présente un siège sur lequel cette esclave a étendu une blanche toison de brebis. Cérès s'assoit ; mais elle ramène son voile sur sa figure, et, toujours immobile et silencieuse, représente l'éternelle douleur de la divinité vaincue par le destin. Iambe réussit enfin, par ses saillies, à amener un sourire sur les lèvres de la mère affligée ; mais Cérès refuse toujours de goûter aux aliments des mortels. A sa demande, la reine lui prépare un mélange d'eau et de farine parfumé avec de la menthe ; c'est le cycéon, qui devint le breuvage sacré des initiés d'Éleusis. Métanire s'adresse alors à l'étrangère, dans le regard de qui elle reconnaît une grâce et une pudeur royales ; elle essaye de la consoler, remet à sa garde le jeune Démophon, l'enfant qu'elle est si heureuse de posséder, et lui promet pour prix des soins qu'elle lui demande, un sort digne d'envie. Cérès élève tendrement Démophon. Elle ne lui donne ni le lait des enfants, ni le pain des hommes ; mais elle le parfume d'ambroisie comme les enfants des dieux. Soit sur le sein de la déesse, soit dans son souffle vivifiant, soit au milieu des flammes où Cérès le plonge chaque nuit, Démophon puise une force surhumaine et se prépare à l'immortalité. Mais une nuit, la reine veut surprendre le secret de cette éducation qui transforme son fils en un dieu ; elle voit l'étrangère cacher Démophon dans un ardent foyer, et le cri déchirant de la mère interrompt la tâche de la déesse. Cérès se courrouce. Retirant Démophon des flammes, elle le met sur le sol, et déclare à la reine que, sans son imprudence, son enfant, toujours jeune, eût ignoré le trépas. Toutefois, l'enfant qui a eu pour berceau les bras d'une déesse, se ressentira toujours de ce contact, et il aura, sinon un destin immortel, du moins un sort glorieux. Cérès se nomme alors, et ordonne que les habitants d'Éleusis lui élèvent un autel et un temple sur la colline Callichore. Elle leur enseignera de quelle manière ils doivent l'adorer. Quittant sa forme humaine, la déesse apparaît dans tout le rayonnement de sa divinité. Une lumière fulgurante éclaire le palais. Cérès disparaît, et la reine, anéantie, n'a même pas la pensée de relever son enfant. Les gémissements de Démophon attirent ses sœurs ; mais en vain l'entourent-elles des soins les plus tendres. Aucune sollicitude humaine ne peut consoler l'enfant qui vient d'échapper aux bras d'une déesse. L'homme élevé par la divinité et perdu par la femme, c'était là un vague souvenir de la révélation primitive et de la chute originelle[123]. Pendant toute la nuit ; les princesses effrayées prient Cérès ; et au lever du jour, elles transmettent au roi les ordres de la déesse. Le temple d'Éleusis s'élève, et quand il est terminé, Cérès y réside. Livrée à son désespoir, la déesse des moissons demeure inactive, et la terre absorbe, sans les faire germer, les grains qu'on lui confie. L'imminente disparition de la race humaine allait anéantir le culte des dieux. Jupiter envoie à Cérès tous les Immortels, qui la supplient de reprendre au milieu d'eux une place qui sera aussi brillante qu'elle le désirera. La déesse leur répond qu'elle n'accédera à leurs désirs et ne rendra à la terre sa fertilité que lorsqu'elle aura vu Proserpine. A l'ordre de Jupiter, Mercure va demander à Pluton que celui-ci permette à sa compagne de visiter Cérès. La tristesse de la jeune épouse décelait le même vœu. Le dieu à la noire chevelure ne se montre pas implacable ; il sourit, et consentant à ce que la fille de Cérès se rende auprès de sa mère, il lui parle des honneurs royaux qui lui seront réservés à son retour dans les régions infernales. Pluton attelle ses chevaux au char sur lequel monte Proserpine, que sa récente promesse a comblée de joie. Mercure guide hors des ténèbres le brillant véhicule. Voici la lumière, voici l'éther ! Le char vole au-dessus de la mer, des fleuves, des vertes vallées et des hautes montagnes, et s'arrête devant le temple d'Éleusis. Cérès aperçoit sa fille, se précipite comme une Ménade sur la colline boisée ; Proserpine s'élance de son char, et la mère et la fille sont dans les bras l'une de l'autre. Les larmes de Cérès ne lui permettent pas d'abord de parler. Enfin, elle demande à Proserpine si celle-ci n'a pris aucune nourriture dans le palais de Pluton. S'il en est ainsi, la jeune déesse ne sera jamais séparée de sa mère. Sinon, elle devra demeurer un tiers de l'année chez le roi des ombres, et en passer le reste avec Cérès et les autres dieux. Proserpine répond à sa mère qu'avant son départ, Pluton lui a fait manger un pépin de grenade, ce fruit qui, chez les Grecs, est un symbole de l'hymen. C'était avouer qu'elle avait épousé son ravisseur et qu'elle ne pouvait abandonner pour toujours son mari[124]..... Les deux déesses se livraient encore à leurs doux épanchements quand la Lune, Hécate, vient caresser Proserpine, dont elle reste désormais la compagne et l'amie. Rhéa, la mère des dieux, est envoyée par Jupiter pour ramener Cérès dans l'Olympe, et l'exhorter à faire cesser la famine. La mère de Proserpine se laisse fléchir. La terre se revêt de feuillages et de fleurs. Cérès elle-même initie à ses mystères les chefs éleusiniens, Triptolème, Dioclée, Eumolpe et Céléus ; puis elle remonte avec sa fille sur les hauteurs de l'Olympe. Ce mythe avait une signification à la fois naturaliste et philosophique. Proserpine, déesse de la végétation ; est la graine qui tombe dans le monde souterrain, et qui, pendant l'hiver, y demeure enfouie, tandis que Cérès, la terre végétale, s'afflige d'être privée de production. Mais lorsque vient le printemps, la plante surgit et s'élève vers le ciel. C'est ainsi que Proserpine passait un tiers de l'année avec Pluton, les deux autres avec Cérès[125]. Ce symbolisme nous reporte au naturalisme des Pélasges et à la théogonie d'Hésiode ; mais un sens moral d'une remarquable élévation semble aussi s'être caché sous ce mythe[126]. De même que la semence descend sous terre pour renaître, l'homme ne traverse la mort que pour entrer dans la vie éternelle. L'enlèvement de Cérès est souvent figuré sur les vases peints trouvés dans les tombeaux des jeunes filles qui, mortes avant l'hymen, étaient appelées épouses de Pluton. Elles n'étaient pas enterrées à la pleine lumière du soleil ; leurs corps étaient ordinairement brûlés pendant la nuit, et c'était à la faible lueur du crépuscule matinal que leurs cendres étaient recueillies, mélancolique cérémonie qui se nommait l'enlèvement d'Héméra, l'enlèvement du jour[127]. Oui, le jour avait été ravi en commençant sa course..... Si le sort de Proserpine retraçait aux malheureux parents des jeunes mortes les destins de l'âme immortelle, un autre tableau devait aider à les consoler. Aussi bien que la femme mariée, la vierge pouvait être représentée sur son sépulcre avec les attributs d'une déesse[128], et cette apothéose élevait les regards de ceux qui restaient, vers ces demeures célestes qu'entrevirent vaguement les religions païennes. Une inscription découverte à Thasos[129], île qui reçut de bonne heure le culte éleusinien, provient de la tombe d'une jeune fille. La vierge regrette en vers élégiaques, de mourir avant d'avoir goûté toutes les joies de la jeunesse, avant d'avoir revêtu les parures de l'hymen. Et cependant, avant d'exhaler cette plainte, elle a hautement affirmé sa croyance à une autre vie qui durera à jamais et pendant laquelle les vierges ont le privilège de s'entretenir directement avec les mortels. Cette jeune fille avait sans doute été initiée aux mystères d'Éleusis, rites qui eurent généralement une salutaire influence en propageant la foi à l'immortalité de l'âme, bien que les Orphiques eussent postérieurement introduit dans ce culte, avec des usages immoraux, la croyance à la métempsycose[130]. La philosophie contribua à la diffusion de cette dernière doctrine. Pythagore la répandit, tout en spiritualisant d'autre part le culte et la morale. Pour lui, l'âme, nombre émané de la Monade primordiale, de l'Intelligence suprême, expie par une suite de transmigrations les fautes qu'elle a commises en s'écartant de l'Unité divine, et se meut dans le Cosmos, l'ordre de l'univers, jusqu'à ce que, purifiée de ses souillures, elle s'absorbe dans son principe immatériel[131]. Comme dans l'Inde, la métempsycose est ici le résultat du panthéisme. Après Pythagore, Platon, il faut le dire, crut aussi à la transmigration de la substance immatérielle qui anime l'homme ; mais lui du moins, lui qui adora un Dieu personnel, reconnut l'individualité de l'âme humaine. Théano, Périctioné, Phintys, Arignoté de Samos[132], toutes ces femmes auxquelles s'ouvrit l'austère congrégation fondée par Pythagore, toutes ces femmes dont la vaste intelligence comprenait la musique des sphères qui roulaient autour du soleil, toutes ces héroïnes apprirent à l'école du maître, non-seulement les notions de vertu et de charité qui règlent l'harmonie de la vie humaine, mais malheureusement aussi les erreurs qui obscurcissent le sens de la vie éternelle. Notre sexe doit donc plus s'attrister que s'honorer de la tradition suivant laquelle Pythagore aurait reçu de la Pythie Thémistoclée ses principes philosophiques[133]. Nous ne nous sommes pas écartée du culte d'Éleusis en signalant le système pythagoricien, qui eut tant de ressemblance avec l'enseignement donné par les réformateurs des mystères. Selon la croyance hellénique, si l'initiation aux rites éleusiniens était le chemin du bonheur éternel, les supplices du Tartare attendaient les hommes et les femmes qui ne s'étaient pas soumis à ce devoir[134]. Il y avait trois degrés d'initiation. Pour parvenir aux derniers, il fallait avoir passé par le premier ; mais celui-ci pouvait suffire : c'était l'initiation aux petits mystères, la seule à laquelle les enfants fussent admis en général, et qui avait lieu à la fête des Anthestéries, au retour printanier de Proserpine. L'initiation aux grands mystères et l'époptie ou contemplation, constituaient véritablement le culte d'Éleusis ; mais il est difficile de distinguer ce qui élevait les époptes au-dessus des autres initiés. Bornons-nous à indiquer les traits caractéristiques des Éleusinies. Les grands mystères se célébraient en automne, à l'époque des semailles, peu de temps avant les Thesmophories ; c'était alors que Proserpine descendait vers les régions souterraines. Ces fêtes duraient depuis le 15 de Boédromion jusqu'à la fin de ce mois. Les premiers jours, passés à Athènes, étaient consacrés aux purifications, aux sacrifices, aux autres formalités préparatoires. Une de ces cérémonies avait un caractère doux et attendrissant. Un petit garçon ou une petite fille, enfant dans les veines duquel devait couler sans aucun mélange le sang athénien, était placé tout près de la flamme du sacrifice ; et l'enfant du foyer, — c'est ainsi qu'on l'appelait, — remplissait les rites expiatoires, au nom des futurs initiés. Ainsi cette douce incarnation de l'innocence implorait des dieux le pardon de fautes auxquelles elle était étrangère[135]. Le quatrième jour, le calathus, corbeille sacrée de Cérès, arrivait d'Éleusis à Athènes, sur un chariot suivi d'une foule de personnes qui, la tête et les pieds nus, criaient : Salut, ô Cérès ! salut, ô déesse nourricière, déesse des moissons ! Venaient ensuite des vierges portant des cistes tissues d'or. Parmi les attributs mystiques placés soit dans ces paniers, soit dans le calathus, se trouvaient des fruits et des gâteaux[136]. Comme le témoigne la formule des mystère., ces aliments servaient, avec le cycéon, à rompre le jeûne par lequel on rappelait celui de Cérès : J'ai jeûné, j'ai bu le cycéon ; j'ai pris de la ciste, et, après avoir goûté, j'ai déposé dans le calathus ; j'ai repris du calathus et mis dans la ciste[137]. Le 20 de Boédromion, Éleusis devenait le théâtre de la fête. Une procession accompagnait dans ce bourg une image d'Iacchus, personnification de Bacchus considéré comme la vie qui anime les êtres. Au bruit des hymnes et des acclamations joyeuses, la procession suivait la Voie sacrée, et atteignait Éleusis pendant la nuit, à la lueur des flambeaux[138]. Selon les prescriptions de Cérès, l'Éleusinium, le temple des grandes déesses, avait été bâti sur la colline Callichore : c'était sur cette élévation que les Éleusiniennes avaient formé autour d'un puits le premier chœur de danse et de chant qui célébrât Cérès. Le temple fut reconstruit sous les auspices de Périclès, par quelques-mis des artistes qui vécurent au beau siècle de l'art grec[139]. Les mystères étaient célébrés dans la grande nef, p.ar les personnages suivants : l'hiérophante, grand pontife d'Éleusis, qui était aussi le grand prêtre de l'Attique ; le dadouque ou porte-flambeau, le héraut sacré et l'assistant à l'autel. Pendant la nuit, les novices, vêtus de longues tuniques de lin, couronnés de myrte et ayant des cigales d'or dans les cheveux, entraient dans le temple, et le héraut s'écriait : Loin d'ici les profanes, les impies, et tous ceux dont l'âme est souillée de crimes. Alors commençait l'initiation. Le sacerdoce d'Éleusis comprenait aussi une hiérophantide, qui appartenait à la famille des Phillides, soit qu'elle y fût désignée par l'hérédité, soit qu'à une époque que l'on suppose postérieure, elle y fût élue par les Athéniennes. Une autre prêtresse remplissait des fonctions semblables à celles du porte-flambeau. Ces femmes avaient le droit d'initier certaines personnes[140]. Une belle calpis, découverte à Nola, représente une prêtresse prononçant debout l'invocation, tandis que l'initié, courbé devant elle, fléchit le genou. Derrière la prêtresse, une femme présente une phiale, tout en ne perdant de vue, ni un vase placé, croit-on, sur le feu, ni un grand lébès où se trouve une amphore. Du côté opposé, une de ses compagnes tend une lékané, et deux femmes qui sont peut-être Cérès et Proserpine, éclairent de leurs torches cette cérémonie[141]. Il est difficile de décrire l'aspect majestueux de cette scène. L'attitude imposante de la prêtresse et de ses acolytes, révèle que ces femmes sont profondément pénétrées de l'acte religieux qu'elles accomplissent. Les rites éleusiniens étaient destinés à frapper l'imagination des initiés en élevant leur âme. Une nuit, les initiés de chaque sexe, portant des flambeaux en commémoration des courses douloureuses de Cérès, quittaient silencieusement, deux à deux, l'enceinte sacrée ; ils y rentraient avec rapidité, tantôt en secouant leurs torches pour se purifier par les étincelles qu'ils faisaient jaillir, tantôt en se donnant leurs flambeaux comme un symbole de cette lumière divine que les hommes doivent se transmettre réciproquement. Cette course appartenait probablement au drame sacré qui avait pour sujet la légende de Cérès et de Proserpine, et auquel succédaient les épreuves des initiés, scènes où se déroulait le symbole moral que cachait ce mythe. La terre paraissait mugir, la foudre grondait, et, à la lueur des éclairs, apparaissaient des fantômes qui hurlaient et gémissaient. Les initiés traversaient les régions où les âmes, se purifiant par l'expiation, se préparaient à la félicité suprême. Tout à coup retentissaient comme le tonnerre, des portes d'airain qui s'ouvraient et qui laissaient voir le Tartare et ses supplices. C'était l'image la plus effrayante de la mort, de la mort avec ses angoisses, ses terribles hallucinations Mais voici que les initiés voyaient briller une sereine lumière sur les ombrages et les prairies d'une retraite élyséenne ; voici que, conduits dans le sanctuaire, ils y découvraient l'image rayonnante de Cérès. C'était le symbole des joies éternelles réservées à l'âme après les souffrances qu'elle a éprouvées en déchirant les liens qui la retenaient au corps[142]. Ainsi, l'instinct spiritualiste de l'homme est si vivace que, du culte même de la terre, se dégageait la notion de l'immortalité. Quelle leçon pour les matérialistes auxquels une imparfaite étude de la nature a appris, avec la négation de Dieu, l'anéantissement final de l'âme ! Le culte même de Vénus, ce culte qui trop souvent fit oublier aux Grecs qu'ils avaient élevé des autels à la Pudeur[143], ce culte eut quelquefois aussi une influence moralisatrice. ai, à Guide, l'élégant ciseau de Praxitèle ne réussit à faire admirer dans la mère de l'Amour, que le type de l'hétaire ; si, à Corinthe, les courtisanes étaient appelées à desservir le temple de la déesse, et y offraient dans leurs impures prières les supplications de la Grèce en péril ; à Lacédémone, véritable déesse du mariage, Vénus voilée avait aux pieds des fers qui symbolisaient la fidélité conjugale ; et, dans le même édifice, elle était aussi représentée armée, pour rappeler que, par un acte de valeur, les femmes de Sparte avaient su unir le courage à la beauté[144]. En général, la Vénus guerrière et la Vénus victorieuse personnifient la puissance de la beauté[145]. Nous avons sous les yeux une image de la Vénus victorieuse : c'est la Vénus de Milo[146]. Cette statue est le type le plus accompli que puisse créer l'imagination. En la contemplant, nous éprouvons à la fois un sentiment d'admiration et une impression de repos qui nous prouvent que nous sommes en possession de la vraie beauté, et que l'art a atteint dans ce chef-d'œuvre les dernières limites de la perfection. Comment décrire l'harmonie de ces formes, les traits si purs et la grâce idéale de ce visage ; comment dépeindre ce regard d'une sérénité virginale, et ce doux et léger sourire qu'avait rêvé Homère ? Le sculpteur a su donner au marbre de Paros, si transparent et si lumineux en lui-même, une vie qui est encore celle de la femme, mais qui est aussi l'immortalité de la déesse. On se détache avec peine de la Vénus de Milo. Aussi ne la quitterons-nous que pour aller à la beauté morale, à Vénus Uranie, l'Astarté phénicienne. Contrastant avec la Vénus Pandémos ou populaire, qui provoquait les vains attachements basés sur les charmes physiques, la Vénus Uranie ou céleste inspirait les affections immatérielles et moralisatrices[147]. Mais la philosophie s'éleva plus haut encore qu'à la conception de Vénus Uranie. Au delà de celle-ci, Platon reconnut la source même de la beauté dans le Dieu créateur du monde et distinct de son œuvre, dans l'Être suprême qui a pour attributs les Idées éternelles ; et, d'après le sublime penseur, ce fut une femme de Mantinée, Diotime, qui, après avoir enseigné à Socrate comment l'amour a pour but, non la contemplation stérile du beau, mais la reproduction de l'idéal entrevu, lui indiqua comme dernier terme de cet amour la recherche de Dieu[148]. Ainsi, par deux fois, ce fut la femme qui révéla Dieu à la Grèce : les prêtresses de Dodone avaient célébré l'Éternel, l'institutrice de Platon découvrit le divin Principe du beau. FIN DU TOME PREMIER |