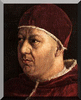HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXXVII. — CAUSES DE LA RÉFORME.
|
Pouvoir de l’empereur
d’Allemagne. - Ce qu’étaient les nobles à l’époque de la Réforme, et les
évêques et les moines. - Peu d’institutions pédagogiques au delà du Rhin. -
Ignorance du peuple. - L’ivrognerie répandue dans la société. - Dépendance
mutuelle des ordres. - Combien l’appel à la liberté fait par Hutten et Luther
devait favoriser la révolte religieuse.
Nous nous figurons d’abord que rien n’était plus facile à l’empereur que d’imposer silence au frère augustin ; mais l’empereur n’avait pas la puissance qu’il possède aujourd’hui. Les princes reconnaissaient, il est vrai, la juridiction impériale ; mais, lorsqu’il s’agissait ou de leur honneur, ou de leur foi, ou de leur vie, la constitution leur permettait d’en appeler à un tribunal spécial, véritable cour des pairs, formée de juges ayant le même rang que les prévenus. Dans la dévolution d’un fief ad manum imperii, comme s’exprimait le droit écrit, celui qui se croyait lésé par la sentence du souverain pouvait porter l’affaire devant une chambre supérieure, la chambre ou le tribunal de l’Empire. Les villes possédaient des privilèges en vertu desquels elles déclinaient toute espèce de tribunal étranger, c’est-à-dire établi par l’empereur. La sentence fendue, il fallait la faire exécuter ; et c’est alors que lu volonté impériale éprouvait le plus de difficultés ; tellement, que le souverain, pour ne pas voir son autorité méconnue, était obligé d’abandonner le rôle de juge pour prendre celui d’arbitre. Il faut rendre justice aux efforts de Maximilien Ier pour améliorer les mœurs nationales ; malheureusement ces tentatives louables ne furent pas couronnées d’un grand succès. Les nobles formaient une caste nombreuse qui vivait de brigandages. Les historiens qui ont vu de près les grands seigneurs teutons s’accordent à les peindre comme de vrais larrons. Campano, nonce en Allemagne, les représente cherchant à prouver, à force de rapines, que Dieu les avait faits d’illustre race. Poggio nous dit que parmi eux le vol était un titre de gloire. Ils avaient un vocabulaire où certains mots du langage usuel changeaient de signification : ils appelaient chevalerie ce que le peuple, dans son idiome, nommait brigandage. Le grand chemin nourrissait les membres de cet ordre nouveau. Un archevêque de Cologne avait élevé un magnifique château : l’intendant, à qui Sa Grâce ne voulait donner aucun gage, s’avisa de lui demander comment il ferait pour vivre ? Le prélat se contenta de lui montrer du doigt les quatre routes qui venaient aboutir au palais. On voit encore dans la Souabe, en Saxe et sur les rives du Rhin, des ruines d’anciens donjons en granit d’où le maître s’élançait comme un oiseau de proie sur le passant. Quand il l’avait détroussé, comme faisait Frédéric de Neumagen des marchands qui descendaient la filoselle, il disait qu’il venait de percevoir son droit de péage. Et ce n’était pas seulement sur le voyageur qu’ils prélevaient ainsi des impôts forcés : quand leurs celliers étaient vides, que leurs meutes aboyaient de faim, que leurs bouffons de table menaçaient de les quitter, alors ils partaient de nuit avec leurs gens, armés de pied en cap, se ruaient sur le premier palais d’évêque qu’ils trouvaient, et le dévalisaient de la cave au grenier. Un de ces évêques s’écrie douloureusement Les nobles nos voisins s’arrogent violemment, à l’envi les uns des autres, mes droits de prince, et non seulement nie troublent dans ma juridiction, mais l’énervent et la détruisent. A peine dans toute l’Allemagne trouve-t-on un diocèse dont l’évêque n’ait été plus d’une fois forcé de prendre les armes pour s’opposer aux attaques des nobles et à l’insolence des bourgeois. La position du prélat allemand est singulière : s’il veut se défendre les armes à la main, les nobles et les bourgeois crient au scandale ; s’il se laisse dépouiller, les chapitres le blâment hautement. Aussi qu’arrive-t-il ? c’est que l’évêque, en lutte perpétuelle avec ceux qui dépendent de lui, au temporel ou au spirituel, car il est prince et prêtre, ne quitte pas le gantelet de fer, tient sa monture toujours sellée, ses armés toujours nettoyées, pour s’en servir contre ceux qui l’attaqueront dans ses droits. Muller parie d’un évêque d’Eischtedt, vertueux prélat du reste, qui portait une lourde cotte de mailles, et une longue rapière bavaroise dont le manche était formé d’un crâne d’homme. Ce n’est pas le prêtre qu’il faut accuser, nais l’époque, la société. Il ne nous conviendrait pas d’être plus sévère que le savant Æneas Sylvius, une des lumières de l’Église au quinzième siècle, qui ne s’effarouche pas de voir Thierri, archevêque de Cologne, à la guerre, combattre à la fois en soldat et en capitaine, et, de retour dans son diocèse, remplir tous les devoirs de sa charge sacerdotale. Malheureusement tous les évêques ne ressemblaient pas à Thierri, et Æneas Sylvius nous le dit ailleurs, da nous peignant quelques-uns de ces grands seigneurs mitrés qui ont des écuries pleines de chevaux, des chenils remplis de chiens de chasse, des tables splendidement servies, et ressemblent à cet Hibosadam des Écritures, intendant de-la cuisine, et qui minait les murs de Jérusalem. En Allemagne, comme en Italie, les ordres religieux s’étaient multipliés au moment de la réforme ; mais, il faut le dire, rien ne ressemble moins en général à une cellule italienne qu’une cellule allemande. Dans l’une habite ordinairement, comme nous avons pu le voir, la science unie à la piété ; le moine italien est théologien, philosophe, historien, peintre et sculpteur. Érasme ne pouvait jeter les yeux sur les rayons de la librairie de son ami Alde Manuce sans y rencontrer des grammaires, des lexiques, des traités de pédagogie, des éléments de sciences astronomiques et mathématiques, écrits par des moines. Ce n’est point en Italie qu’Ulrich de Hutten aurait pu publier ses Epistolæ obscurorum virorum : on n’aurait compris ni son mauvais latin ni ses saillies. En Allemagne, il n’en est point ainsi : le moine a trop souvent négligé les sciences, parce qu’il n’a pas près de lui un pape pour les prêcher ; son supérieur ecclésiastique est un être symbolique, moitié prêtre, moitié laïque, qui est obligé d’étouffer la lumière intellectuelle que Dieu a mise en lui, s’il veut veiller, dans l’intérêt de ses ouailles, à la conservation de cette vie matérielle qu’on leur dispute à chaque instant. Or, qu’on lise l’histoire, les peuples barbares n’ont presque jamais opposé de résistance à ceux qui leur proposèrent de changer de religion. L’Allemagne, qui possédait plusieurs universités, comme celles de Prague, de Vienne, de Cologne, de Bâle, d’Ingolstadt, d’Erfurt, manquait d’écoles élémentaires : l’instruction n’y était pas gratuite ainsi qu’en Italie. C’est à cette absence d’institutions pédagogiques qu’il faut attribuer ce vice ignoble répandu dans toutes les classes de la société, l’ivrognerie. Chaque nation a son démon familier, a dit Luther ; celui qui possédera l’Allemagne jusqu’à la consommation des siècles, c’est le démon de la bouteille. Au seizième siècle encore, celui qui enivrait un convive jusqu’a lui faire perdre la raison et à le laisser mort-ivre sous la table, se vantait, au rapport de l’historiographe de Nuremberg, de ce haut fait comme d’une victoire sur l’ennemi. Maximilien, cet empereur qui ambitionnait la double gloire de restaurer les mœurs et l’éducation du peuple allemand, demanda, lors de la diète, en 1495, que les ordres de l’Empire travaillassent à supprimer les santés nombreuses qu’on portait à chaque repas. Tout ce qu’il put obtenir, ce fut que les villes où régnait cette coutume conserveraient leurs privilèges, que d’autres villes ne pourraient réclamer. Ces toasts trouvèrent un singulier avocat, le démon, qui se servit de Hans de Schwarzenberg, en guise de secrétaire, pour faire l’apologie du vin, et apprendre au monde que les peuples qui s’enivrent sont francs, loyaux, sincères, hardis, fidèles et robustes ; tandis que les buveurs d’eau, le diable évidemment veut parler des Italiens, sont mous, efféminés, ne savent ni porter une pesante armure ni garder un secret. Campano, légat du saint-siège à la diète de Ratisbonne, en 1471, fait une triste peinture de l’état intellectuel de l’Allemagne à cette époque : pays malheureux, dit-il, plongé dans une épaisse barbarie, et où quelques esprits s’occupent à peine de lettres. Trente ans plus tard, ces ténèbres où Campano avait laissé l’Allemagne étaient à peine dissipées ; au delà du Rhin, on trouve des savants, mais qui font peu de cas des lettres, qu’ils regardent comme inutiles. Hutten s’en est moqué dans son dialogue qui a pour titre : Nemo et nulles. Qu’étaient devenus ces temps où la cour des empereurs de Souabe était l’asile et le rendez-vous des poètes ? A ces hommes inspirés avaient succédé les fous, meuble nécessaire des grandes maisons. Le nombre s’en était tellement accru, que la diète d’Augsbourg, en 1500 ; se vit forcée d’ordonner qu’ils ne pourraient porter désormais les armes, la bannière et l’écusson d’autres personnes que de celles qui les entretenaient. Quand on suit attentivement Luther en chaire, à table ou dans sa cellule, on voit arriver incessamment, sous sa plume ou sur ses lèvres, un mot bien capable de remuer les masses, le mot de liberté. Il l’inscrit dans son livre de Libertate christianâ ; il le place en tête de son traité de Captivitate Babylonicâ ; il le glisse souvent dans sa correspondance avec ses frères. Hutten, dans sa première lettre au moine augustin, donne à son épître pour devise : Vive, libertas ; et Mélanchthon semble lui-même avoir deviné l’effet magique de ce mot, lorsqu’il nous représente le chevalier Ulrich partant pour aller trouver Ferdinand, le frère de Charles-Quint, afin de préparer la délivrance de l’Allemagne. Plaçons ici une remarque importante d’un historien A la vérité, nous dit Schmidt, on aspirait plus à la liberté politique qu’à la liberté religieuse ; mais l’une et l’autre sont si étroitement liées, et l’esprit humain est si accoutumé de sa nature à procéder par voie d’analogie, qu’il n’est point étonnant qu’on ait passé de l’une à l’autre, et même qu’on les ait confondues. Il est certain que l’émancipation religieuse devait produire l’émancipation politique ; or, à cette époque, chacun, en Allemagne, se croyait esclave, et l’était peut-être : l’empereur, de la diète et des princes ; les princes et la diète, des nobles ; les nobles, des évêques ; les évêques, des villes ; les villes, du sacerdoce et de l’Empire. Tous les pouvoirs étaient confondus : dans le recez de la diète de Cologne, en 1542, lors de la déposition de Jules II par le conciliabule de Pise, l’empereur, au lieu de parler au nom de l’Église, d’invoquer les secours de l’autorité ecclésiastique, se pose en défenseur de la communauté chrétienne, et comme ayant droit de chercher les moyens d’éteindre le schisme. Le clergé, qui travaillait à s’affranchir de plus en plus de la dépendance civile, en appelait, pour soutenir ses prétentions, à la bulle d’Innocent III, qui voulait qu’en cas de litige, la partie demandant que son affaire fût jugée par un tribunal ecclésiastique forçât la partie adverse à l’y suivre ; tandis qu’un rescrit de Guillaume de Saxe, de 1446, statuait que personne, de quelque qualité qu’il fût, noble ou roturier, ne citât devant un tribunal sacerdotal son adversaire pour une contestation de la vie commune, On voit donc quel effet devait produire l’appel à la liberté que Luther fit retentir en chaire. La liberté, c’était pour l’empereur, suivant le sens que Hutten donnait à cette expression, la délivrance du joug du pontife romain, le droit de veiller de ses propres yeux sur le salut de l’Église allemande, l’affranchissement des taxes de la chancellerie romaine ; pour les nobles, la conquête des grands chemins, qui leur appartiendraient en toute propriété, avec tout ce qui les traverserait, homme de pied ou cavalier, marchandises ou denrées ; pour les villes, la sécularisation d’un grand nombre d’abbayes, dont les biens allaient passer à la commune ; pour certains prélats, hommes de camp bien plus que de presbytère, l’absolution du recel des produits des indulgences, qu’ils gardaient dans leurs mains ; pour les pauvres paysans attachés à la glèbe, comme ceux qui se révoltèrent en Franconie, le droit de pêcher dans l’étang de leur seigneur, de couper l’herbe de ses prés, de cueillir l’épi de ses champs ou le raisin de ses vignes, puisqu’il est, disent-ils, comme eux enfant du même père, qu’il se chauffe au même soleil, qu’il aspire le même air, et que, bien plus, eux travaillent quand il dort, qu’ils font l’office de sa monture, qu’ils bêchent, ensemencent, plantent et arrosent, pendant qu’il est à table avec ses courtisans. A ces causes diverses qui hâtèrent le triomphe de Luther, ajoutez le mouvement imprimé à l’esprit humain par l’invention de l’imprimerie ; le discrédit où étaient tombés certains moines de Cologne, depuis leur malheureuse attaque contre Reuchlin ; les querelles des théologiens et des humanistes ; les sarcasmes d’Érasme contre diverses pratiques des catholiques ; les fureurs de Hutten contre les Italiens ; et vous comprendrez Myconius, qui nous dit que la parole de Luther marchait comme si elle eût été portée sur les ailes d’un ange. Seulement Myconius se trompait sur la nature du séraphin ; ce n’était point un ange de lumière, nous en avons pour garant un historien protestant : Hume affirme que la logique ne fut pour rien dans les progrès du luthéranisme. |
 Pour comprendre le succès de la parole de Luther en
Allemagne, il nous faut connaître les éléments dont la société germanique
était alors composée, et peut-être sera-t-on moins surpris des triomphes du
moine.
Pour comprendre le succès de la parole de Luther en
Allemagne, il nous faut connaître les éléments dont la société germanique
était alors composée, et peut-être sera-t-on moins surpris des triomphes du
moine.