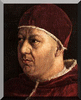HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXXV. — PEINTURE. - RAPHAËL.
|
Raphaël est nommé par
Léon X intendant des travaux de l’église de Saint-Pierre. - Lettre de Sa
Sainteté à l’artiste. - Plan de Raphaël. - Marco Fabio Calvi l’aide dans ses
recherches et ses travaux. - L’architecte de Saint-Pierre est chargé par le
pape de la surveillance des ruines de l’ancienne Rome. - Salles du Vatican
auxquelles travaille le peintre. - L’incendie du Bourg. - Les Loges. - Les
tapisseries de la chapelle pontificale. - Raphaël imagine de ressusciter les
monuments de l’ancienne Rome. - Lettre qu’il écrit à ce sujet à Sa Sainteté.
- Raphaël peint le tableau de la Transfiguration. - Il tombe malade et meurt.
- Causes de cette mort subite. - Funérailles du grand artiste. - Léon X
vient, dans l’église de la Rotonde, baiser la main du peintre. - Découverte,
sous Grégoire XVI, du corps de Raphaël. - Ce peintre a réhabilité la forme en
l’idéalisant. § IV. RAPHAËL SOUS LÉON X. Ordinairement, au sortir du Vatican, Raphaël allait jeter titi coup d’œil sur la maison qu’il se faisait bâtir dans le Borgo Nuovo, et dont il dirigeait les travaux avec Bramante, son ami et son parent. Cette habitation devait être digne du grand artiste qui, peintre et architecte, en avait conçu le plan. Elle se composait de deux étages : le premier étage reposait sur six colonnes doriques ; cinq fenêtres s’ouvraient dans toute la largeur, encadrées dans des colonnettes ioniques, surmontées de corniches arrondies ou angulaires, genre d’ornementation dont Raphaël aimait à faire usage, à l’imitation des anciens architectes romains. La fenêtre du milieu était ornée des armes de Léon X : six médaillons en relief rehaussaient encore la beauté de cet édifice. Sous Alexandre VII, quand le Bernin imagina cette colonnade qui fait aujourd’hui le plus bel ornement de la place de Saint-Pierre, le pape acheta la maison au prieur de Malte 7.163 scudi et 34 bajochi, et la fit démolir. Jamais artiste n’avait été aussi heureux que Raphaël, si le bonheur se compose d’odes et de sonnets, de bruit et de gloire, d’honneurs et de fêtes. A l’exception d’un seul homme, Michel-Ange, qui le boudait à Florence, tout ce que l’Italie comptait d’intelligences d’élite lui était attaché. Quand, après le couronnement de Léon X, l’Arioste vint à Rome, sa première visite fut pour le saint-père, la seconde pour le peintre d’Urbin. Plus tard, Bramante, étant près de mourir, le fit appeler, et, devant le pape, qui venait bénir son architecte, le désigna comme seul capable de continuer les travaux de la basilique de Saint-Pierre. Léon X ne cachait pas qu’il voulait faire une œuvre merveilleuse. L’artiste eut l’honneur de présenter à Sa Sainteté un modèle qui excita l’admiration universelle. Quelques jours après, il était nommé intendant en chef des travaux de Saint-Pierre. Ce fut Bembo qui rédigea le bref que Raphaël reçut au commencement d’août 1514, bien qu’il se fût mis à l’œuvre dès le mois d’avril. Les titres du peintre à l’admiration du monde y sont noblement rappelés. Raphaël d’Urbin, disait Léon X, ce n’est pas seulement comme peintre que vous vous êtes acquis parmi les hommes une gloire immortelle ; Bramante, avant de mourir, proclamait vos talents en architecture, et vous désignait pour continuer l’œuvre qu’il avait si glorieusement commencée. Les plans que vous nous avez présentés témoignent de votre rare capacité ; et comme tout notre désir est d’achever ce saint temple avec toute la magnificence possible, nous vous nommons intendant de Saint-Pierre avec 300 scudi d’or par an, qui vous seront payés par notre trésorier à des époques convenues, ou de mois en mois si vous le préférez. N’oubliez pas, nous vous en conjurons, qu’il s’agit dans ces fonctions d’assurer l’honneur de votre nom ; de fonder, jeune encore, votre gloire à venir ; de répondre dignement à la bienveillance toute paternelle que nous vous portons, à la célébrité du temple que vous allez édifier, à notre vénération pour le prince des apôtres. Nous n’avons pas oublié ce bon Simon Ciarla, qui aimait si tendrement son neveu ; test à lui que Raphaël donna la première nouvelle de sa bonne fortune. Simon, dans sa petite habitation de la contrada del Monte, ne se doutait ni du bonheur ni de la gloire de son enfant chéri : il le croyait apparemment un excellent broyeur de couleurs, et il avait jeté les yeux, depuis quelque temps, sur une belle fille d’Urbin qu’il voulait lui donner en mariage. Carissimo, lui écrit Raphaël, ne vous inquiétez pas de moi ; je vous dirai que je suis bien content de n’avoir pas accepté la main de celle que vous me destiniez : je n’en serais pas où je suis si je vous avais écouté ; car figurez-vous que j’ai en propriétés pour plus de 3.000 florins, et un revenu de 50 scudi d’or ; sans compter que Sa Sainteté m’a confié la direction des travaux de Saint-Pierre, avec un traitement de 300 ducats l’an ; puis on me donne pour mes œuvres tout ce que je demande : j’ai 200 ducats pour peindre une nouvelle Stanza au Vatican. Vous voyez, mon bon oncle, que je vous fais honneur, à vous, à ma famille et à mon pays. Vous savez si je vous aime ; aussi, quand j’entends prononcer votre nom, c’est comme si j’entendais celui de mon père. -Vous saurez que le cardinal de Santa-Maria in Portico veut nie donner une de ses parentes ; et, avec votre agrément et celui de mon oncle Barthélemy Santi, j’ai promis d’être agréable à son éminence. Je ne puis manquer à ma parole. Sachez que si François Buffa peut là-bas trouver de bons partis, il ne m’en manquera pas ici ; et si je voulais, je pourrais épouser à Rome une fille de bonne famille et de bonne réputation, qui m’apporterait en dot 3.000 scudi. Et impossible de demeurer ailleurs ! d’abord, par amour pour l’église de Saint-Pierre, dont j’ai entrepris la construction ; puis, parce que j’occupe maintenant la place de Bramante ; ensuite, parce qu’il n’y a pas au monde de ville plus illustre que Rome ! Le pape avait adjoint à Raphaël Julien de Sangallo et fra Giocondo de Vérone, tous deux employés déjà par Bramante ; mais, usés par l’âge et le travail, fra Giocondo, obligé d’aller passer l’hiver à Florence pour recouvrer la santé, y mourut en 1518, et Sangallo cessa, vers la même époque, d’être porté sur les registres de l’administration. Raphaël resta donc seul chargé des travaux de la basilique. Le modèle original d’après les plans de l’artiste est perdu ; nous n’en possédons que la description que Serlio a donnée dans ses Règles générales d’architecture. Raphaël avait imaginé une croix latine avec une coupole à l’intersection des deux bras de la croix. Le vaisseau avait trois nefs, chacune des ailes cinq chapelles, chaque pilier une niche ; le chœur et les tribunes latérales étaient également ornés de niches, dont chacune reposait sur un évidement soutenu par deux piliers et douze colonnes accouplées par quatre. La façade avait trois entrées principales. Le portique, exhaussé par des marches, reposait sur trente-six colonnes, trois dans la profondeur, douze sur la largeur, disposées de manière à ce que les lignes intérieures et extérieures fussent toujours doubles. Les maîtres de l’art donnent de grands éloges à la simplicité de ce plan, que quelques-uns préfèrent à celui de Michel-Ange, parce qu’Il se rapproche davantage de la sévérité antique. Il fallait d’abord consolider les quatre piliers élevés par Bramante, qui devaient supporter la coupole, et qui reposaient sur un sol trop faible pour supporter un poids aussi grand. Ce fut un travail difficile que l’étayement des voûtes souterraines : des mois se passèrent à cette œuvre, en sorte que, les fonds consacrés par Léon X à l’édification de Saint-Pierre étant absorbés par les travaux de fondation, Raphaël ne put exécuter le dessin qu’il avait conçu. Il fut plus heureux dans le plan de la cour du Vatican. Celui que Bramante avait laissé avant de mourir semblait à Léon X plus grandiose que beau ; il lit appeler son artiste chéri, qui, quelques jours après, présentait à Sa Sainteté un modèle en bois dont tout le monde fut charmé. Cette cour aujourd’hui est un des beaux ornements de Rome. Raphaël, dans quelques-unes de ses lettres, nous montre avec quel soin éclairé le pape étudiait les travaux qu’il avait inspirés ou commandés. A chaque instant l’artiste était obligé de quitter son ouvrage pour aller dire à Léon X les progrès matériels d’un édifice ou d’une peinture. Le pape voulait tout voir de ses yeux, le dessin surtout, dont il discutait avec Raphaël le choix ou la convenance. Souvent il arrivait à l’improviste avec quelqu’un de ses serviteurs, et, mêlé à la foule des travailleurs, il excitait leur zèle par ses louanges ou ses libéralités. Raphaël, pour répondre aux encouragements du pape, passait les nuits à étudier. Il y avait alors à Rome un savant en haillons qui aidait puissamment l’architecte dans ses recherches à travers l’ancien monde des empereurs : il se nommait Marco Fabio Calvi. Calcagnini, protonotaire apostolique, nous a laissé quelques curieux détails sur cet homme, qui semblait avoir hérité de la stoïque indépendance de Pomponio Leto, et dont les vêtements tombaient en lambeaux comme les ruines du Colysée. Fabio de Ravenne, dit-il, est un vieillard d’une probité antique. On ne sait si l’érudition en lui l’emporte sur l’amabilité. Grâce à sa science, Hippocrate a cessé de s’exprimer dans le jargon ridicule du moyen-âge, et parle maintenant en fort beau latin. Ce saint homme a horreur de l’or : il a sur la cassette de Sa Sainteté une pension mensuelle qu’il distribue le plus souvent à ses parents ou à ses amis, se contentant, pour vivre, d’herbes et de racines. Il mène la vie d’un pythagoricien, et loge dans un trou, vrai tonneau de Diogène, où il végète en feuilletant des livres. Aussi a-t-il gagné à ce métier une maladie grave. Il est en ce moment le pensionnaire de Raphaël, qui le nourrit et le choie comme un enfant. Raphaël est un artiste riche et le favori de Léon X. A un cœur excellent il unit un génie admirable. C’est peut-être le premier de nos peintres, sous les rapports théorique et pratique. Architecte d’un rare talent, il a dés inventions que les plus grands génies n’auraient jamais trouvées : j’en excepte peut-être Vitruve, dont, au reste, il ne reproduit pas seulement les idées, mais qu’il réfute et corrige avec tant de convenance, qu’on ne saurait l’accuser de jalousie. Il exécute en ce moment une œuvre merveilleuse : je ne parle pas de la basilique de Saint-Pierre, dont il dirige les travaux, mais de cette Rome antique qu’il veut faire revivre à nos regards dans toute sa grandeur et toute sa magnificence, en abaissant les terrains, en fouillant les décombres, en restituant aux ruines leur physionomie primitive. Le pape en est tellement content, qu’il en fait un envoyé du ciel qui a reçu d’en haut la mission de ressusciter la ville éternelle. Et quelle rare modestie, quelle affabilité ! Comme il aime à prendre conseil, comme il écoute les objections, comme il se rend avec grâce quand on lui a montré son erreur ! Il honore Fabio comme son père et comme son maître ; il le consulte et l’écoute en véritable disciple. C’est pour Raphaël que Fabio avait traduit, dans ce tonneau dont parle Calcagnini, l’Œuvre architecturale de Vitruve. Si l’on en juge par les notes marginales du manuscrit, car la traduction n’a point été imprimée, Raphaël avait profondément étudié les préceptes de l’écrivain antique. Sur ces ruines où le noble vieillard aimait à se reposer pour respirer un peu de soleil, de toutes les substances de la création la seule à laquelle il fit la cour, les Romains posaient souvent un marteau sacrilège ; la pierre volait en éclats que ramassaient des ouvriers pour construire des maisons particulières. Léon X, averti par la clameur publique, se hâta de mettre un terme à cette spoliation de vandale. Il écrivit à Raphaël : Comme il importe pour la construction du temple romain dédié au prince des apôtres, que la pierre et le marbre soient tirés du sol même de la ville plutôt que des environs, et que Rome en recèle dans son sein une grande quantité dont on se sert arbitrairement pour élever des habitations privées, je vous charge, vous l’architecte de Saint-Pierre, de la surveillance de toute espèce de ruines qu’on trouvera à dater de ce jour, soit à nome, soit hors des murs de la ville, dans un rayon de mille pas, et dont vous ferez l’acquisition, si elles vous conviennent, pour la construction du saint temple. Je veux donc que quiconque trouve de ces marbres ou de ces pierres dans l’espace indiqué vienne vous en avertir sur-le-champ. Qui enfreindra cet ordre, trois jours après sa promulgation, sera passible d’une amende qui ne pourra être moindre de cent ducats d’or. Et comme nous avons appris que des tailleurs de pierre se servent, dans leur ignorance, de marbres ornés souvent d’inscriptions antiques, anéantissant ainsi des documents dignes d’être conservés dans l’intérêt des lettres et de la belle latinité, nous défendons à tous ceux qui exercent ce métier à Rome de mutiler aucune de ces vieilles pierres, sans votre permission expresse, sous peine d’une amende égale à celle qui a été ci-dessus mentionnée. Ce bref, que Rome connut bientôt, causa la joie la plus vive aux humanistes, aux peintres, aux statuaires et à tous les artistes. A partir de cette époque, le palais pontifical, qui ne comptait que quelques rares statues : le groupe de Laocoon, découvert en 4506 ; l’Apollon du Belvédère, que Jules II avait acquis lorsqu’il n’était que cardinal ; le torse d’Hercule, que Michel-Ange regardait comme une merveille ; l’Ariane célébrée par Castiglione, l’Antinoüs, les groupes du Nil et du Tibre, s’enrichit chaque jour de quelque nouvelle découverte. .lais Léon X n’abandonnait pas la grande pensée con rue par son prédécesseur ; il voulait que Raphaël achevât la peinture des salles du Vatican ; deux restaient encore à peindre. Cette fois il s’agissait de raconter, à l’aide de la couleur, l’intervention divine dans l’établissement du christianisme. C’est la grande image de la papauté, représentée par Léon III, que l’artiste évoquera. C’est le : Exurgat Dominus et dissipentur inimici ejus, traduit à la manière de Raphaël. Les neveux d’Adrien Ier accusaient Léon III. Charlemagne rassemble dans l’église de Saint-Pierre de nombreux évêques, des docteurs et des savants, pour juger la conduite du pape. Au moment où il s’apprête à demander l’opinion des assistants, une voix se fait entendre qui crie : Il n’appartient à personne de juger celui qui juge les autre ! et Charlemagne s’incline. Au bas du tableau on lit ces paroles du livre divin : Il appartient à Dieu et non pas aux hommes de juger les pontifes. C’est l’infaillibilité du pape mise en action. Dans la seconde fresque, Léon III pose la couronne sur le front de Charlemagne. C’est le droit de la tiare sur les couronnes temporelles. Raphaël a placé dans son tableau les deux figures de Léon X et de François Ier, en signe de l’alliance contractée entre ces deux souverains, à Bologne, dans l’hiver de 1515 à 1516. Un page tient la couronne de fer de Lombardie, debout, à côté de l’empereur des Romains agenouillé devant le pape. Sous les traits du page, Raphaël a représenté le jeune Hippolyte de Médicis, que Léon aimait tendrement. La troisième fresque raconte la défaite des Sarrasins à Ostie. Ils allaient envahir les États du pape, quand Dieu soulève une tempête qui brise leurs vaisseaux et engloutit dans les eaux de la Méditerranée les hordes barbares. Le pape, sous les traits de Léon X, est assis sur le rivage, les renards tournés vers le ciel, pour le remercier de l’assistance qu’il lui a si miraculeusement prêtée. Des prisonniers sont enchaînés à ses pieds, tandis que des canots arrivent, dans le lointain, portant d’autres captifs. La joie répandue sur la figure du pontife forme un poétique contraste avec l’abattement et le désespoir empreints sur les traits des vaincus. Le plus bel ornement de cette salle est l’Incendie du Bourg, que Raphaël exécuta de sa main. En 847, un violent incendie éclate tout à coup dans le quartier habité par les Saxons et les Lombards, et qui s’étend du Vatican au mausolée d’Adrien. L’église de Saint-Pierre est menacée, les flammes commencent à l’envelopper, lorsque Léon IV apparaît, fait le signe de la croix, et le feu obéissant s’éteint. Comme pensée, ce tableau est admirable ; le peintre a su y jeter un intérêt tout dramatique : on assiste vraiment à un incendie. Ici, c’est une famille plongée dans un sommeil profond, tout à coup réveillée au sifflement des flammes, et qui, de tout ce qu’elle possédait, n’a pu sauver qu’un enfant à la mamelle ; ailleurs, des hommes, des femmes qui, ne comptant plus sur aucun secours, regardent tristement le pape, dont la prière seule peut apaiser le ciel ; plus loin, deux femmes, au type tout romain, descendant peut-être de ces Sabines par qui fut repeuplée Rome, et qui apportent de l’eau pour éteindre les flammes, deux des belles figures qu’ait créées Raphaël, aussi pures de proportion qu’aucune de celles du Jugement dernier ; ailleurs, une pauvre mère qui ne songe qu’à son premier-né, que le père dispute aux étreintes maternelles ; plus loin, un jeune homme qui se sépare de ce qu’il a de plus cher au monde et ne songe qu’à sauver son vieux père, tandis que son fils court à côté de lui, et qu’une vieille femme s’occupe d’emporter quelques futiles objets, mais qu’un long usage lui a rendus chers. Raphaël a voulu montrer qu’il pouvait lutter avec Michel-Ange. Il essaye ici le nu, et l’on voit qu’il l’a étudié tout à la fois dans les livres, sur le corps vivant, et dans les œuvres de son rival. Si Buonarotti possède une science plus approfondie des détails anatomiques, si ses contours respirent une vie plus apparente, si ses muscles sont plus énergiquement attachés, si la charpente osseuse de ses personnages a plus de relief, en revanche Raphaël est plus vrai. Buonarotti a fait l’homme à son image ; être idéal, type exceptionnel, nature toute gigantesque. L’homme de Sanzio n’a rien de conventionnel ; il se meut et vit selon les lois ordinaires de la nature ; il sort de la famille des êtres créés de Dieu ; il ressemble, dans sa structure, à tout ce que nous voyons autour de nous. C’est le fils d’Adam dans les différents âges de son existence mortelle : enfant, avec les grâces naïves du corps dans ses premiers développements ; adulte, avec une exubérance de vie qui ruisselle dans tous ses membres, ainsi que la sève dans les branches du jeune arbre ; vieillard, avec ses muscles relâchés et ses fibres amollies. Un jour qu’il visitait avec son disciple, Jean d’Udine, les bains de Titus, la pioche du maçon rencontra tout à coup quelques arabesques merveilleuses d’inspiration fantasque : Raphaël était dans l’extase. Peu de temps après, Jean d’Udine apportait à son maître un cahier rempli de toutes sortes de figures, comme le fiévreux en rêve la nuit dans son délire, comme nous en voyons le jour sur un ciel nuageux. Restait à donner à ces monstres aux milles formes la vie apparente que l’antiquité avait trouvée. Pour l’artiste, ce fut l’affaire de quelques jours. Raphaël fut si content de son élève, qu’il le chargea de reproduire ces caprices sur divers segments des Loges du Vatican, sa bible à lui, comme l’appelle l’école. A l’imitation de Dante, dans la Divine Comédie, Raphaël tenta, dans les peintures des Loges, la combinaison des deux éléments chrétien et païen. Ainsi, dans l’histoire de la création du premier homme, le chérubin des livres saints est prosterné en contemplation devant la majesté de son Créateur, tandis qu’autour d’Adam on voit des Amours luttant contre des Harpies : image de l’homme tombé du ciel, et luttant misérablement, après son péché, contre la grâce divine. Dans l’Embrasement de Sodome et de Gomorrhe, il a figuré des monstres tels que la nature n’en produisit jamais. Ailleurs, ce sont des figures d’invention pour expliquer Salomon ou les joies de la famille. M. Passavant, qui a étudié habilement le génie des peintures de Raphaël, insiste avec raison sur leur caractère symbolique, et il montre que celui qui n’est pas initié à cette philosophie de l’art, dont Dante est le père, risque de se tromper en attribuant au naturalisme de la renaissance cet amour du mythe qui brille éminemment dans les créations de Raphaël, et qui, bien loin d’être la glorification de l’antiquité fabuleuse, n’est destiné qu’à faire ressortir par le contraste la vérité chrétienne. Dans l’Eglise byzantine, on suspendait, aux grandes solennités, sur les murs des chapelles, des tapisseries ornées d’or et de soie. Le pape avait rêvé pour sa chapelle une décoration qui l’emportât sur celle des basiliques grecques. II chargea Raphaël de dessiner les sujets des tapisseries. L’artiste les tira des Actes des Apôtres, et les traça sur des cartons qu’il coloria lui-même avec le plus grand soin. Richardson, Zanzi, Bottari et d’autres juges compétents regardent ces cartons non seulement comme l’œuvre la plus admirable de Raphaël, mais comme l’expression la plus sublime de l’art. Il y en avait douze. Sept existent encore dans le palais de Hampton-Court, préservés par une glace de l’impression de l’air, et par un poêle perpétuellement allumé, dans la salle, de l’humidité de l’atmosphère. Léon X les avait envoyés en Flandre, où les plus habiles ouvriers devaient les reproduire sur des tapisseries tissues d’or et de soie. Panvinio porte à cinquante mille couronnes d’or la somme que le pape paya aux artistes flamands. Ils méritaient ce titre, car le jour de saint Étienne, le 26 décembre 1519, où les tapis furent exposés dans la Sixtine, Vasari raconte que Rome fut tentée d’attribuer ces beaux ouvrages à un prodige plutôt qu’au travail d’une main d’homme. Malheureusement les dessins étaient restés en Flandre, où Charles Ie, les fit acheter au dix-septième siècle, et où Charles II, un moment, fut sur le point de les vendre à Louis XIV, qui avait chargé son ambassadeur d’en faire l’acquisition. Après la mort de Léon X, son successeur Adrien VI, qui n’entendait rien aux arts, oublia de les réclamer. Un moment notre peintre fut distrait de son œuvre des Loges par une idée aussi grande qu’ingénieuse, et que lui inspira sans doute André Fulvio. Il s’agissait pour lui de rappeler à la vie ce qu’il nommait le cadavre de la vieille Rome ; de rendre à la ville ses édifices sacrés et profanes, ses palais, ses naumachies, son Colysée, ses arcs de triomphe, ses colonnes, ses jardins, ses places et ses rues ; de sorte que Virgile ou Horace, rappelé à la lumière, eût reconnu la cité d’Auguste. Ce miracle devait lui coûter beaucoup de temps, l’achat d’immenses ateliers, de grandes dépenses, des frais de voyage : le pape promit tout, à l’exception du temps, que Dieu seul pouvait accorder à l’artiste, mais qui était jeune et plein de santé, et qui avait trouvé un procédé graphique à l’aide duquel il pouvait relever en une journée plus de ruines qu’un dessinateur en un mois. C’est assis sur une de ces ruines qu’André Fulvio avait songé à refaire l’ancienne Rome ; et sur-le-champ il s’était mis à l’ouvrage, communiquant à Raphaël chacune de ses descriptions, dont l’artiste traçait aussitôt le dessin. Il semble, en vérité, que quiconque touche aux ruines de Rome y trouve des trésors cachés : Pomponio Leto, le mot d’un grand nombre d’énigmes historiques ; Fulvio, la traduction de passages obscurs de Vitruve ; Sadolet, des odes splendides ; Jules II et Léon X, de magnifiques statues ; Jean d’Udine, de ravissantes arabesques ; et Raphaël, de la poésie de style. On en jugera par les fragments de la lettre qu’il écrit à Sa Sainteté : Depuis que je me livre à l’étude des antiquités, en m’aidant, dans mes investigations, des écrivains qui les ont décrites, et en comparant l’œuvre à la description, je pense avoir acquis quelque connaissance en architecture. Si la joie que j’éprouve à la vue de tous les prodiges de science opérés par nos ancêtres est vive, ma douleur ne l’est pas moins lorsque je contemple le cadavre de cette cité, autrefois la reine du monde, à cette heure si misérablement mutilé. Si la piété envers nos parents, envers notre patrie, est un devoir sacré, ne suis-je pas obligé d’employer tout ce que j’ai en moi de puissance pour conserver le dernier souffle, la dernière étincelle de vie, à cette Rome, qui fut autrefois la patrie de tout ce qui porte le nom de chrétien, et un moment si grande, qu’on put la croire, seule sous le ciel, au-dessus des coups de la fortune ; seule, en dépit des lois de la nature, exempte du trépas. Mais il semble que le temps, jaloux de la gloire des mortels, et se défiant de son pouvoir destructeur, ait fait pacte avec les Barbares, qui, à sa lime rongeante, à sa morsure venimeuse, ont uni le fer, le feu et tous les instruments de destruction. Alors on vit tomber, sous les assauts de cette ragé impie, toutes ces merveilles de pierre dont il ne resté plus, à cette heure, qu’un squelette privé de chair et de sang : biais que parlons-nous des Goths, des Vandales, lorsque ceux que la nature avait placés, comme pères et tuteurs, à la garde de ces reliques, ont eux-mêmes contribué à leur destruction ! Que de pontifes, très saint-père, qui, revêtus de la même dignité que vous, mais n’en possédant ni la science, ni l’imagination, ni l’esprit, dons supérieurs qui vous élèvent presque jusqu’à Dieu, ont travaillé, eux aussi, à ruiner les vieux temples de la Rome antique, ses vieilles statues, ses vieux et glorieux édifices !... Cette Rome moderne, qui étale avec tant de splendeur ses palais, ses églises, ses monuments civils et religieux, a été, je n’ose le dire, construite avec la chaux de marbres antiques ! Je ne puis songer sans un déchirement de cœur inexprimable à tout ce que j’ai vu depuis onze ans, à Rome, de colonnes et de temples abattus et ruinés... Cette lettre, dont on voudrait faire honneur à Castiglione, et qu’on dirait écrite en quelques passages par Benvenutto Cellini, tant l’artiste y dit librement sa pensée, montre avec quel amour Raphaël avait étudié la vieille Rome. Quand l’édifice qu’il voulait dessiner n’offrait plus que des débris imparfaits, il avait, dit-on, recours à un instrument de son invention qui lui en livrait sur-le-champ toutes les proportions ; instrument merveilleux, nous dit Paul Jove, et dont Raphaël malheureusement n’a pas voulu donner le secret. En quelques minutes, l’artiste restituait une ruine, à peu près comme Cuvier, au moyen de son anatomie comparée, reconstituait un animal perdu. Au moment même où il présentait à Sa Sainteté le spécimen d’un édifice rétabli d’après le procédé qu’il avait trouvé, il songeait à donner une histoire complète de l’art chez les anciens, et laissait dans des manuscrits que la mort ne lui permit pas d’achever, des notes dont Vasari s’est heureusement servi. Léon X était insatiable. A peine son artiste favori commençait-il une œuvre, qu’il lui en demandait une autre. Raphaël se prêtait à toutes les fantaisies du pape ; mais, si sa gloire y gagnait, sa santé en souffrait visiblement, car ce n’était pas seulement la main qui travaillait, mais le cerveau qui s’épuisait. Il était aisé de s’apercevoir que chez ce sublime artiste l’intelligence finirait par tuer le corps. Pendant qu’il s’amusait à crayonner les profils de la ville antique, quittant cette vie si pénible d’atelier pour passer quelques douces heures avec tes vieux Romains, qu’il aimait si tendrement, il reçut de Léon X l’ordre de décorer la grande salle qui conduit aux appartements du pape dans le Vatican. Cette fois, il avait à retracer la domination visible de l’Église sur les puissances de la terre, d’après quelques-uns des actes de la vie de Constantin. Sébastien del Piombo, que Michel-Ange mettait, comme coloriste, au-dessus de Raphaël, avait, d’après un carton de son ami, peint à l’huile, sur l’une des murailles de la chapelle Borgherini à Saint-Pierre in â1ontorio, une Flagellation qui avait obtenu un grand succès. Raphaël voulut imiter ce procédé. En conséquence il fit préparer le plâtre et exécuter à l’huile, par Jules Romain et François Penni, les deux figures allégoriques de la Justice et de la Charité. C’était un essai qu’il tentait et dont les artistes romains devaient être juges ; mais la mort vint le surprendre sans qu’il pût compléter sa pensée. Ses élèves achevèrent sous Clément VII une œuvre que le temps avait interrompue. Le cygne allait chanter pour la dernière fois : Rome, dit ici Vasari, était dans l’enthousiasme, et disait que Raphaël avait vaincu Michel-Ange. Michel-Ange, pour faire taire ces bruits, résolut d’entrer en lice avec Raphaël, et de s’aider dans cette lutte du talent de Sébastien del Piombo. Deux hommes donc, pour vaincre l’Urbinate : l’un Buonarotti, l’ange de l’Arioste, qui dessinera le sujet ; l’autre Sébastien, ange aussi, mais dans le coloris, qui peindra le tableau. Deux toiles avaient été préparées : sur l’une, Sébastien peignit la Résurrection du Lazare ; sur l’autre, Raphaël retraça l’une des scènes les plus sublimes du Nouveau Testament, la Transfiguration du Christ. Les deux tableaux terminés, on les mit en présence dans la salle du consistoire. L’épreuve ne pouvait être douteuse : Sébastien était un maître habile, un coloriste éblouissant qui étonnait le regard, mais qui ne disait rien à l’âme. Il n’y eut qu’une voix dans Rome pour décerner la palme à Raphaël. Bien que l’artiste ait pris son sujet dans l’Évangile, il est difficile de nier que, dans le choix de sa composition, il n’ait obéi, comme il l’a fait si souvent, au symbolisme mis en pratique par Dante ; il a voulu personnifier deux images : la nature divine dans la Transfiguration du Christ sur le Thabor ; l’Humanité déchue dans le démoniaque. Considérée sous ce point de vue, la pensée du peintre est admirable d’unité, tandis qu’autrement il y aurait deux actions dans le même cadre : d’abord la Transfiguration, et puis la possession de l’enfant. Nous savons bien que des hommes comme Rutgers, Fuseli, MM. Viardot et Constantin, ont combattu victorieusement ce dualisme apparent ; mais l’objection est bien plus facile à réfuter, si l’on soutient, avec M. Passavant, que l’artiste, en s’inspirant du poète florentin, a voulu mettre en présence deux signes pour exprimer une même idée. Il est aisé de s’apercevoir, en examinant attentivement le tableau de la Transfiguration, de la coopération de Jules Romain à l’œuvre du maître. Sandrart avait entendu le vieux Michel-Ange Cacoselli raconter que, lorsque Jules peignait la tête du Possédé, Raphaël avait pris le pinceau des mains de son disciple, et touché l’œil et la bouche du démoniaque pour lui donner une vie que Jules n’avait pu réussir à formuler. Un peintre qui, dans un long séjour à Rome, passa devant cette toile dix-huit cents heures, ainsi qu’il nous le raconte, M. Constantin, a décrit avec une patience enthousiaste les beautés toujours nouvelles que l’œil découvre dans ce tableau. La Transfiguration, à son avis, est le chef-d’œuvre de toutes les écoles, le dernier terme de la puissance humaine en peinture, la limite qui, dans l’art, sépare l’homme de l’ange. C’est l’opinion d’un bon nombre d’artistes, bien que des critiques dont le témoignage est d’un grand poids, M. Delécluse par exemple, préfèrent à la Transfiguration la Vierge au Donataire. Pour nous, oserons-nous le dire ? nous trouvons dans cette œuvré admirable les signes d’une transformation malheureuse, peut-être même d’une chute prochaine de Raphaël. Il nous semble que l’expression, où le peintre n’avait pas encore de rival, n’est pas aussi belle que dans ses autres tableaux. Ici, ce qui d’abord attire le regard, ce n’est ni le Christ, ni le démoniaque, ni les apôtres ; mais cette Romaine aux formes demi-viriles, dont Raphaël étale les belles lignes dorsales avec une complaisance sensuelle. Jusqu’alors, en contemplant une œuvre de Raphaël, on sentait plus qu’on ne voyait ; ici, tout au contraire, 1’œi1 est plus occupé que l’esprit. Évidemment, c’est une route nouvelle où le peintre paraît vouloir s’engager. S’il vit encore quelque temps, il est à craindre qu’il ne tombe dans l’exagération de la forme ; et cette funeste révolution sera provoquée peut-être par l’admiration qu’excite le torse de sa belle Romaine. C’est pour la ligne savante qui coupe si harmonieusement le dos de cette femme, pour son profil gréco-romain, pour l’anatomie de ses bras, pour ses chairs luxuriantes, qu’on se passionne à Rome. On n’a pas l’air de faire attention à la figure du Christ, non plus qu’aux têtes des apôtres. Qui sait ? dans l’intérêt de la gloire du peintre, la mort était peut-être une récompense au lieu d’un châtiment. Tant de travaux devaient à la fin tuer Raphaël. Vingt ans après la mort de l’artiste, Fornari de Reggio assignait, dans un opuscule, d’autres causes à ce trépas subit ; et Vasari, qui ne cachait pas ses prédilections pour Michel-Ange, répétait avec une complaisance maligne les détails donnés par le critique. Depuis, dans le monde artiste, il est presque de foi que Raphaël succomba aux excès d’une passion qu’il ne cherchait pas à cacher. M. Passavant a cru devoir venger le peintre d’une accusation posthume qui n’a pour garantie qu’un biographe comme Vasari. Il nous montre l’artiste, la veille même où il se mit au lit, parcourant les ruines de Rome pour lever les plans des édifices antiques, puis travaillant, pour se distraire de ses longues courses, au tableau de la Transfiguration ; et le soir, rentrant dans sa maison, où il trouve son vieux Fabio Calvi, cet homme de stoïque vertu, qu’il regarde comme un père et dont il écoute pieusement les conseils. Il invoque en faveur de l’artiste le témoignage de Celio Calcagnini, de Marc-Antoine Michel de Ser Vettor, qui, dans diverses lettres, parlent avec honneur des mœurs du peintre. Il cite encore, pour nous mettre en défiance contre le récit de Fornari, ce que Paul Jove et André Fulvio racontent de la conduite exemplaire de Raphaël. N’est-il donc pas plus probable, avouons-le, de supposer, avec André Fulvio, que l’activité infatigable de son tempérament, que l’ardeur incessante de son cerveau, que des travaux de nuit et de jour, que des études prolongées le soir à la lampe allumée par Fabio Calvi, que de longues courses à travers la vieille Rome, usèrent avant le temps une constitution altérée si puissamment, du reste, par ce poison qu’on nomme la gloire, et qui a tué avant le temps un si grand nombre de beaux génies ? Aux premières atteintes de la maladie, Raphaël, averti par un pressentiment secret, comprit qu’il lui fallait dire adieu pour toujours à ce monde dont il était l’orgueil. Il laissait beaucoup d’œuvres inachevées, que la main d’un autre devait terminer : il chargea de ce soin Jules Romain et François Penni, ses disciples, auxquels il laissa comme récompense, ou plutôt comme souvenir, tout ce qu’il possédait d’objets précieux. Il institua pour légataires universels les parents qu’il avait à Urbin, et disposa des biens de son père en faveur de la confrérie de Sainte-Marie de la Miséricorde : il devait ce souvenir de reconnaissance aux bons pères qui avaient fait en partie la fortune de Jean Santi. Il donna sa belle maison de la place Saint-Pierre au cardinal Bibbiena, son ami plus encore que son protecteur. Longtemps avant sa mort, il avait manifesté le désir d’être enterré à Sainte-Marie de la Rotonde, le Panthéon d’Agrippa, dans un petit caveau pratiqué, de son vivant et d’après ses dispositions, près d’un autel où devait s’élever la statue de la Vierge qu’il chargea Lorenzetto d’exécuter. Toute sa vie Raphaël avait eu pour Marie un amour d’enfant. Il affecta, dans son testament, mille scudi à l’acquisition d’une maison dont les revenus étaient destinés à l’entretien de cette chapelle et au traitement du prêtre qui la desservirait : ce chapelain devait, chaque mois, dire douze messes pour le repos de l’âme de l’artiste. Il choisit pour exécuteurs testamentaires Balthasar Turini de Pescia, dataire, et Jean-Baptiste Branconio d’Aquila, camérier de Sa Sainteté, ses vieux et intimes amis. Ces dispositions terrestres réglées, l’artiste se confessa, et reçut les sacrements de l’Eglise avec les plus’ tendres sentiments de foi et de piété. Pendant le cours de la maladie, qui dura quinze jours, Léon X envoya souvent demander des nouvelles de son artiste bien-aimé. Rehberg raconte, d’après le récit d’un vieux peintre romain, que le pape, informé par ses médecins que tout espoir de sauver Raphaël était perdu, se préparait à partir pour donner sa bénédiction au moribond, quand un messager vint lui annoncer que Raphaël rendait le dernier soupir. Ce récit n’a rien d’invraisemblable : jamais âmes ne furent si bien faites pour se comprendre et s’aimer ; et si Dieu eût fait de Léon un artiste, nul autre que Léon n’aurait fermé les yeux à Raphaël. Ce fut le vendredi saint 1520, entre neuf et dix heures du soir, que mourut le peintre, à l’âge de trente-sept ans, le jour même de l’anniversaire de sa naissance. Le corps fut exposé dans la maison que Bramante avait fait construire pour Raphaël, sur un catafalque éclairé par de nombreuses lampes, afin que Rome tout entière pût contempler une dernière fois les traits de son adorable artiste ; car, suivant la coutume italienne, le mort avait la face découverte. Léon X, dit Pâris de Grassi, voulut qu’on rendît d’insignes honneurs aux restes du peintre par qui l’art avait été régénéré, l’orgueil du saint-siège, la gloire de Rome. Longtemps avant le départ du funèbre cortège pour la Rotonde, la foule se pressait autour du corps de Raphaël ; l’un baisait les franges du drap mortuaire ; un autre touchait la main qui avait peint tant de chefs-d’œuvre ; un autre posait ses lèvres sur ce front que le génie d’Apelles avait animé pendant trente-sept ans. Le cortége prit le chemin du château Saint-Ange. Il était précédé d’une foule de chars, de chevaux, d’hommes armés ; puis venaient les confréries de la ville sur deux lignes étincelantes de flambeaux ; ensuite tout ce que Rome possédait de peintres, de statuaires et d’architectes, d’une main tenant un cyprès, de l’autre un cierge allumé ; après, les cardinaux, les prélats, le clergé, enfin le corps de Raphaël soutenu par quatre cardinaux en habit violet : les coins du poêle étaient tenus par le cardinal doyen, l’archichancelier, le camerlingue et le dataire. Derrière le corps marchaient à pied le gouverneur, le trésorier et toute la magistrature de Rome. Le cortége était clos par la garde suisse, derrière laquelle se pressait un peuple immense. Des fenêtres et des balcons, les femmes jetaient des fleurs sur les restes du glorieux artiste : pas un œil qui ne versât des pleurs ; c’était comme un deuil immense et une calamité publique. Après que chacun des assistants eut répandu l’eau sainte sur le corps du défunt, on le déposa dans la niche pratiquée près de l’autel de la Vierge ; puis on boucha l’entrée du caveau à l’aide d’une pierre sur laquelle on grava l’inscription que Bembo fit plus tard en l’honneur de l’artiste. Le corps resta exposé dans l’église pendant trois jours. Au moment où l’on s’apprêtait à le descendre dans sa dernière demeure, on vit arriver le pape, qui se prosterna, pria quelques instants, bénit le corps, et lui prit pour la dernière fois la main, qu’il arrosa de ses larmes. Bientôt s’éleva sur l’autel de la Vierge la statue dont Raphaël avait confié le travail à Lorenzetto (Lorenzo Lotti), et devant laquelle le peuple romain vint prier : elle a reçu le nom de Madone del Sasso ; c’est une couvre médiocre. Raphaël, comme on l’a vu, avait assigné dans son testament une somme de 1.000 scudi à l’acquisition d’une maison dont les revenus annuels serviraient à faire célébrer douze messes par mois pour le repos de son âme. Ses exécuteurs testamentaires achetèrent donc dans la rue des Coronari (fabricants de chapelets) une petite maison qui existe encore, mais où l’on ne voit plus, comme autrefois, le portrait du peintre qui servait d’enseigne. Pendant près de trois siècles, le chapelain célébra dévotement la messe votive pour Raphaël ; mais, en 1805, l’archiprêtre Carbonara voulut rétablir la maison qui tombait en ruines : les frais exigés pour la reconstruction absorbèrent en partie les revenus de cette maison, qui rend à peine aujourd’hui quelques scudi ; en sorte que la voix du prêtre ne peut plus s’élever comme autrefois, peur recommander à la miséricorde divine celui que Léon X pleura si amèrement. Espérons que la prière de Castiglione, quand il apprit la mort de son ami, aura été exaucée ! En vérité, disait le noble comte, je suis bien à Rome, mais c’est comme si je n’y étais pas, parce que mon pauvre petit Raphaël me manque. Que Dieu ait pitié de cette belle âme ! Depuis plus de trois siècles, les restes de Raphaël reposaient dans le caveau de l’église de la Rotonde, ensevelis moins profondément encore que le génie de l’artiste, suivant la belle expression d’Overbeck, quand une discussion s’éleva tout à coup sur l’identité du crâne, que l’Académie de Saint-Luc croyait posséder. La société montrait aux visiteurs ce crâne comme appartenant à Raphaël. Quelques hommes érudits prétendaient que les restes tout entiers du peintre d’Urbin reposaient dans une église de Rome. on avait oublié généralement le nom de l’édifice. Le sculpteur Fabris demanda au gouvernement la permission d’ouvrir, ou plutôt de chercher la tombe de Raphaël. Grégoire XVI l’accorda, et, le 9 septembre 1833, les investigations commencèrent dans la Rotonde : le 14, on découvrit les restes authentiques de Raphaël. Rome était représentée à cette exhumation de son grand peintre par toutes sortes de célébrités européennes : le cardinal Zurla, le chevalier Camucini, Horace Vernet, le sculpteur Fabris. M. Overbeck était là présent, attendant avec une anxiété religieuse le moment où apparaîtrait à son regard l’image, ou ce je ne sais quoi qu’on appelait autrefois Sanzio. Je ne vous dirai pas, écrit-il dans une lettre toute poétique au directeur de l’école des Beaux-Arts de Francfort-sur-Mein, l’émotion qui nous saisit à la vue de ce squelette que les assistants reconnurent pour celui de Raphaël. On comprendra le frisson qui nous agita tous tant que nous étions : c’était lui, c’était Raphaël ! Ainsi, le crâne de l’Académie de Saint-Luc devait quitter sa demeure de verre : ce n’était plus qu’un crâne vulgaire, celui du chanoine de la Rotonde, Desiderio d’Adjutorio, fondateur, en 1539, de la congrégation des Virtuosi. Le squelette était long de sept palmes et demie (cinq pieds deux pouces) ; la tête était tournée vers le côté droit de l’autel ; le crâne était parfaitement conservé ; seulement l’eau, en s’infiltrant, pendant les inondations du Tibre, dans le caveau, avait légèrement corrodé l’occiput. A en juger d’après le modèle en plâtre moulé par le sculpteur Fabris, le front était saillant, mais étroit, d’une hauteur ordinaire ; les dents d’une grande blancheur et au nombre de vingt-neuf ; les mains fort belles. Goëthe a écrit que, de tous les artistes, Raphaël est le seul dont on voudrait avoir fait tout ce qu’il a fait. Cherchez dans cette vie si courte, et pourtant si pleine, il n’est pas une pensée qui ne soit poétique : c’est l’artiste des âmes spiritualistes. Jamais il ne s’est servi de la matière que pour l’idéaliser. Il aima la forme, sans doute ; mais à la forme il ne sacrifia pas la pensée. On peut dire de la peinture ce qu’on a dit de la littérature, qu’elle est l’expression de la société ; car peindre, c’est écrire en couleur. Au quinzième siècle, quand la vie est tout absorbée en Dieu, le peintre ne peut la reproduire que dans la manifestation ordinaire, la prière. Aussi sa composition est-elle toute spiritualiste, la matière n’y entre que comme un accident qu’il dédaigne ou qu’il néglige ; c’est l’âme seule qu’il veut traduire aux regards. De là son indifférence systématique pour le corps ou tout ce qui peut le rappeler. Mais quand la société sortit du cloître pour apparaître dans l’intérieur du ménage, sur la place publique, dans le tribunal, dans ce qu’on nomme la vie réelle, le peintre dut comprendre que l’homme, qui jusqu’alors n’avait formulé qu’une unité, était double désormais, et qu’il devait le représenter en corps et en âme. Alors on sentit la nécessité d’étudier le phénomène extérieur, et la forme dut avoir son culte. Cimabue de Florence, et Duccio de Sienne, surent animer de quelque étincelle de vie les types engourdis de l’école byzantine ; Giotto, Simon di Martino et quelques autres s’essayèrent dans une voie nouvelle. S’ils restèrent fidèles aux représentations traditionnelles de leurs devanciers, obligés de peindre des événements et des personnages pris dans la légende des cloîtres, ils cherchèrent à mettre en scène l’esprit et le corps de leurs personnages. Ces tentatives de réhabilitation de la forme, poursuivies depuis par Giotto, Masaccio et quelques peintres florentins, n’eurent de résultat que sous Léonard de Vinci, qui, possédant une science profonde de l’anatomie, exprima beaucoup mieux qu’on ne l’avait fait jusqu’alors la vie organique. il fallait un peintre comme Raphaël, doué d’une exquise sensibilité, porté de sa nature à la contemplation, amoureux des rêveries spiritualistes, initié au symbolisme de Dante, pour réhabiliter la forme à force d’idéalisation, et faire resplendir le phénomène visible sans tomber dans le naturalisme. Si la forme n’eût eu pour représentant qu’un artiste comme Léonard, si éminent du reste, mais trop porté vers le paganisme, peut-être n’eût-elle pas séduit autant d’esprits ; mais quand on la vit reproduite avec tant d’amour par un peintre de l’école du Pérugin, il n’est pas étonnant qu’on se passionnât pour tout ce qu’il y avait en elle de merveilleux. Par elle on fascinait le regard, par elle on attirait la foute, par elle on subjuguait les sens, par elle on faisait du bruit dans le monde. Mais comme il était impossible de dérober à Raphaël son pinceau pour orner le vêtement de cette fée visible, Raphaël mort, ce qu’on tâcha de reproduire ce fut sa couleur seulement : on ne comprit pas que cet artiste, qui voyait dans chaque objet créé un reflet de la Divinité, n’avait jamais fait la faute d’effacer sous l’ornement l’origine céleste que chaque objet créé portait en lui. Raphaël écrivait à Castiglione : Pour formuler ma beauté, j’ai mon type dans l’esprit. C’est d’après cet idéal qu’il composait ses madones. Il savait que la peinture, en se servant de couleurs et de lumières, substances tout à fait immatérielles, devait avant : tout représenter la vie de l’âme, élément principal du christianisme. L’idéal produit dans la tête de sa Vierge, tout le reste, vêtement, pose, perspective, paysage, n’était destiné qu’à relever la beauté spirituelle dont il imprégnait la figure de Marie. Ses disciples, ses successeurs, tombèrent dans une exagération contraire à celle qu’on avait si justement reprochée à ses devanciers. Chez les maîtres anciens, l’homme n’est qu’une unité : il n’a pas de corps, il n’a qu’une âme ; de son enveloppe terrestre ils ne font aucun cas. Ils ne veulent pas voir que le Christ a pris un corps, et que l’art, en représentant l’homme, doit à la fois exprimer ce dualisme ; et c’est ce qu’a fait si heureusement Raphaël. Sous les successeurs de Sanzio, l’homme a perdu, ce semble, son âme ; ce n’est plus que la matière organisée qu’ils s’étudient à embellir de toutes sortes de manières, tombant ainsi dans un naturalisme qui fait de la peinture un métier au lieu d’un art. |