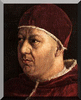HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXVIII. — NOMINATION DE CARDINAUX. - 1517.
|
Intention de Léon X
en créant de nouveaux cardinaux. - Egidius de Viterbe. - Lettre que lui écrit
Léon X. - Il refuse d’abord et est obligé d’accepter la pourpre. - Adrien
d’Utrecht. - Ses premières années à Louvain. - Son amour pour les pauvres. -
Vertus qu’il fait briller quand il monte sur la chaire de Saint-Pierre. -
Thomas de Vio (Cajetan) entre dans l’ordre des Dominicains. - Succès qu’il
obtient à l’université et en chaire. - Ses mérites divers. - Ponzetti cultive
les sciences et les saintes lettres. - Paul-Émile Cesio se distingue par sa
charité. - Quelques mots sur les autres cardinaux. - Luther à Wittemberg,
jugeant Rome et l’Italie. Depuis longtemps Léon X avait conçu le projet d’augmenter le nombre des membres du sacré collège. Il voulait que le cardinalat romain offrit au monde catholique la réunion de tout ce que les nations chrétiennes avaient de plus éminent dans les lettres. La sainteté des mœurs devait se trouver unie, dans l’élu, aux lumières, et le savoir à l’expérience des affaires. C’est le mérite et la vertu qu’il allait honorer. De pauvres religieux vont donc échanger leur robe de bure contre la soutane de cardinal. Il sait que dans le silence des couvents vivent cachées à tous les regards, aux siens exceptés, des intelligences qu’il faut tirer de leur obscurité volontaire, pour les produire au grand jour, et qu’il destine à servir l’Église par leurs talents, comme elles édifiaient le cloître par leurs vertus modestes. Dans l’histoire de Léon X, il n’est pas de pane plus belle que celle où il doit inscrire de sa main le nom de trente et un personnages illustres à tant de titres, qu’il va faire passer de tous les rangs de la société religieuse à la dignité la plus enviée du siècle. EGIDIUS DE VITERBE. Dans le couvent des Augustins, à Viterbe, vivait un moine, né de pauvres cultivateurs, ancien élève de Mariano de Genazzano, qu’il devait surpasser en éloquence et en savoir. A cette époque, il n’est pas d’homme comme un pape pour découvrir le mérite, même quand il se cache dans la prison d’un cloître. Jules II tira notre moine, qui se nommait Egidius, de son monastère, et l’employa comme légat à Venise et à Naples. La chaire convenait mieux au moine que la cour. Il y monta donc pour remplir une couvre toute catholique, pour prêcher une croisade contre ce Turc, qui ne pouvait laisser un seul jour de repos à la chrétienté. L’historien que nous avons sous les yeux compare la parole de l’orateur tantôt à un torrent qui entraîne l’auditeur, tantôt à une sirène qui séduit et endort les grands et le peuple, le docte et l’ignorant, l’homme et la femme, le vieillard et l’adolescent. Egidius était poète, historien, philosophe, théologien, linguiste. Il savait l’hébreu, le chaldéen, le grec, le latin ; et non seulement il parlait admirablement dans une église, mais, dans un concile comme celui de Latran, il méritait que Sadolet le comparât à l’aurore. Ajoutez, pour connaître pleinement cette nature d’homme, qu’aussitôt sa tâche remplie, il allait bien vite se cacher dans sa solitude. C’est dans ce couvent que le moine, alors général de son ordre, reçut de Rome une bien belle lettre. Je vois souvent ici Corneille
Benigno, que j’aime beaucoup, et qui vous aime merveilleusement (mirabiliter) ; que vous aimez aussi, et avec raison ; c’est un homme
de meurs et de lettres élégantes : je prends plaisir à l’écouter, car sa parole
est grave, sage, toute romaine en un mot. Comme il m’a dit qu’il allait
bientôt vous revoir, en me demandant mes ordres, j’ai songé à vous écrire,
non pas en vérité par désœuvrement, je suis si peu souvent inoccupé, mais
pour avoir le bonheur de lire une de vos lettres, comme vous m’en écrivez
quelquefois. Ces lettres sentent la forêt, et l’ombre où elles sont écrites,
et le charme des lieux que vous habitez. Je veux vous dire aujourd’hui que je
nie propose d’augmenter le nombre des membres de mon sénat : j’y ferai entrer
quelques-uns de ceux que j’aime, d’autres que réclame l’état de l’Eglise :
c’est une mesure que je vous soumets, et sur laquelle je vous demande votre
avis. Le jour de la promotion n’est pas encore fixé ; quand il le sera, je
vous le dirai. Cette belle lettre était signée du nom de Léon X. Tout autre que le bon augustin aurait deviné Sa Sainteté, qui s’expliquait si clairement du reste. Egidius ne la comprit pans. Il répondit en félicitant le pape sur la détermination qu’il venait de prendre. Nouvelle lettre de Léon X. Mais cette fois le pape ne va pas chercher ces ombres qu’aimait tant le moine ; il lui dit : Je vous avais écrit pour savoir si vous consentiez à entrer dans le collège des cardinaux ; vous ne me répondez pas, peut-être par modestie, vous en avez tant ; peut-être parce que vous n’avez pas grande envie de la dignité ; pudeur chez vous ou défaut d’ambition, je vous félicite, quand tant de gens recherchent les honneurs avec un empressement qui va,jusqu’à la folie. Votre silence n’a fait que me confirmer dans ma résolution. Il y a longtemps que je songe à vous faire cardinal, d’abord pour vous récompenser de trente années de travaux, ensuite afin que l’État mette à profit vos lumières. Du reste, je sais bien que vous honorerez le chapeau beaucoup plus qu’il ne vous honorera. Je veux donc aujourd’hui exécuter ce que j’ai arrêté depuis longtemps : vous serez cardinal aux calendes du mois d’août ; je vous dis le jour, afin que vous soyez à Rome, et que je puisse vous voir et vous embrasser. Il fallait se résigner et obéir au pape. Egidius quitta donc son couvent, mais en pleurant cette épaisse forêt où il aimait à se promener après le repas de midi ; ces bois pleins d’un silence si propice à la méditation ; cette verdoyante solitude, que l’oiseau seul égayait plutôt qu’il ne la troublait : Thébaïde toute littéraire dont le pape a pris soin de célébrer lui-même les charmes, dans un style à donner du regret au bon moine qui la quittait. ADRIEN D’UTRECHT. A Utrecht, un pauvre ouvrier nommé Florent, tisserand ou brasseur de son métier, avait un fils, Adrien, qui dès son enfance montrait de grandes dispositions pour l’étude ; un véritable Flamand, un peu lourd, un peu épais, apprenant assez difficilement, mais n’oubliant jamais ce qu’il savait une fois. Ses maîtres en étaient enchantés, et le citaient pour son amour du travail, pour son assiduité aux leçons et pour sa bonne humeur. Adrien ne perdait pas une heure de la journée. Quand il sortait de classe, il avait coutume d’entrer dans une église et de prier le bon Dieu. S’il rencontrait un pauvre en allant à l’école, il partageait avec lui le pain de son déjeuner. Un prêtre se trouva qui prit en amitié l’écolier, et le fit entrer à Louvain au collège des Portiens, séminaire gratuit. Adrien faisait de rapides progrès ; il étudia la philosophie, les mathématiques, le droit pontifical qui régissait alors un double monde ; le latin, le grec et l’allemand. Marguerite, la veuve de Charles le Hardi, comme on dit en Allemagne, le Téméraire suivant notre langage, gouvernait alors les Pays-Bas. C’était une femme qui aimait les lettres ; son bonheur était d’aller à la recherche des écoliers studieux, qu’elle savait découvrir, surtout quand ils s’emprisonnaient, comme Adrien, dans une chambrette qui touchait les toits, et froide et malsaine. Une fois, en traversant la ville de Louvain, au milieu d’une nuit d’hiver, elle aperçut un point lumineux à l’une des fenêtres de l’université. Elle demanda à son chambellan qui pouvait veiller si tard et par un froid si rigoureux ; on lui dit que c’était Floritz, ou le petit Florent, le fils du tisserand ; et, le lendemain, Adrien recevait d’une main inconnue du bois pour se chauffer, et 300 florins pour acheter des livres. Plus tard, elle obtint pour son protégé une cure, et enfin un canonicat. Adrien bénissait le ciel et le nom de Marguerite, sa bienfaitrice. C’est à Louvain qu’il commença et acheva son docte livre de Rebus Theologicis, qu’un de ses amis lui vola et fit imprimer, sans que l’auteur, à ce qu’il parait, eût pu revoir les épreuves. La réputation d’Adrien était arrivée jusqu’à la cour de Maximilien Ier. Lorsque l’empereur voulut donner un précepteur à son enfant, il jeta les yeux sur le chanoine de l’église de Saint-Pierre à Louvain, lequel apprit à son élève les quatre langues du monde nouveau : l’italien, l’allemand, l’espagnol et le français. Charles-Quint n’oublia pas son professeur. Adrien vivait à Louvain, à l’écart, dans un inonde qu’il s’était fait à lui, et, comme il l’aimait, formé de quelques auteurs antiques, grecs et latins, mais en prose ; car toute sa vie, même étant écolier, il avait méprisé les poètes. Ses convives, quand il ne dînait pas seul, étaient d’anciens camarades de collège, quelque humaniste étranger, voyageur de passage, ou quelque pauvre qu’il avait trouvé en rentrant au logis. Il n’avait ni prôneurs ni courtisans, parce que personne à Louvain, non plus qu’à Tolède plus tard, ne comprenait ce bon Flamand, qui n’avait jamais voulu quitter les modes du Brabant ; qu’on voyait toujours seul à la promenade, un livre à la main ; qui n’entendait rien aux arts, savait à peine le nom de Raphaël, et n’aurait pas donné une obole d’une statue de Phidias, à moins que ce ne fût pour la revendre, afin d’en distribuer le prix aux pauvres ; et qui disait de Sadolet : Ce n’est qu’un poète ; et du Laocoon : Ce n’est qu’une idole. Quand il avait trouvé une larme à sécher, il s’en revenait tout joyeux chez lui ; il avait gagné sa journée. La mère de famille qui avait besoin d’un peu de bois en hiver pour se chauffer, d’une robe neuve pour sa fille qui devait faire sa première communion, ou d’un médecin pour son mari alité, n’était pas obligée de chercher longtemps : elle entrait dans la première église venue, et près du bénitier elle trouvait un pauvre auquel elle disait : Où demeure le docteur Florent ? et le pauvre donnait l’adresse. La mère de famille montait un escalier de mince apparence, s’arrêtait à une toute petite porte de bois, tirait une petite ficelle qui traversait une planche de sapin enduite d’une couche de rouge ; et Adrien, averti par le bruit de la sonnette, accourait et donnait ce qu’il avait, et, quand il n’avait plus rien, empruntait pour donner. Ce fut un beau jour pour le monde catholique que celui où Florent fut décoré de la pourpre romaine. Déjà il avait été élu évêque de Tolède ; et, en Espagne comme en Flandre, on l’avait surnommé le père des pauvres. Dieu avait ses vues sur Adrien. Cet écolier flamand, qui étudiait toute la nuit, qui n’avait jamais vu de sa vie l’Italie, qui aurait passé et repassé devant une statue de Praxitèle sans lever les yeux, qui appelait les artistes les voleurs du bien des pauvres, fut choisi pour succéder à Léon X. Il faut que le schisme soit confondu ; il parlait hier du paganisme de la cour de Léon X : voila un pape flamand qui, par un véritable miracle à cette époque, ne comprend rien à l’art, un phénomène vivant de science et de charité ; ses yeux s’ouvriront-ils ? Le schisme ne veut rien voir. Florent prit le nom d’Adrien VI. Alors Erasme écrivit au pape : Au milieu des acclamations de tout un peuple, des mille voix des trompettes, du tonnerre des canons, est-ce que je ne pourrais pas espérer que ma petite voix arrivera jusqu’à vos oreilles, et que vous vous rappellerez votre Erasme, un des disciples les plus assidus à vos doctes leçons de théologie, l’admirateur de vos vertus, et aujourd’hui une des toutes petites brebis de votre grand troupeau ? Le maître de la sainte science à Louvain n’avait point oublié Érasme. Pendant plus de trois ans, ce ne sont, de la part du pontife pour son compatriote, que de douces paroles, des conseils de miel, de tendres épanchements. Adrien voudrait que le philosophe se levât comme le géant de l’Écriture pour combattre le sanglier qui ravage la vigne du Seigneur. Érasme a peur du sanglier ; et, pour en finir avec le pape, il se compare à l’écrevisse. Il demande des ailes, que la papauté ne peut lui accorder ; si bien qu’un jour le pauvre Adrien meurt de douleur de n’avoir pu donner la paix au monde chrétien. Que faut-il donc pour réconcilier des frères baptisés de la même eau, si Adrien a succombé dans cette tâche, après avoir mérité les éloges d’un moine qui dit du mal de tout ce qui porta la tiare ? Pontife aux splendides vertus, c’est l’expression de l’un de tes ennemis, tu tueurs parce que tu n’as pu accomplir l’œuvre de paix que tu poursuivais jusque dans tes songes ; tu meurs parce que Luther et les âmes qu’il a séduites n’ont pas voulu t’écouter, toi dont la parole était un écho de la voix de Dieu ; tu meurs parce que les Ordres de l’Allemagne ont repoussé tes conseils ; tu meurs parce que ta fille bien-aimée, ton Église de Saxe, se débat dans l’impénitence ! Mais, en t’envolant vers le tribunal du Père de toute charité, une consolation te reste ; c’est que tu n’as pas fait couler une larme, que tu n’as jamais su qu’aimer et pardonner. Jouis de ta gloire en voyant, à défaut d’artistes, ce cortége de paralytiques, de lépreux, d’aveugles, qui t’accompagne vers ce petit tombeau modeste comme tes vertus. Au dernier jour, quand ta poussière se ranimera et que tu revêtiras un corps glorieux, tu prendras ton vol vers les cieux, en tenant dans tes mains cette devise qu’un Allemand écrivit sur ta tombe : Il n’est pas de plus grand malheur que de commander aux autres. THOMAS DE VIO (CAJETAN). L’Église sait que de généreux exemples ont un grand pouvoir sur les âmes ; que la force et le courage se prisent surtout dans l’union des esprits et des cœurs ; et l’Église, éclairée par les plus pures lumières de l’Evangile, inspirée par Dieu même, n’a pas reculé devant une pensée qui atterre et confond l’esprit humain : devant la pensée d’associer des hommes pour le sacrifice ; devant la pensée d’établir, non pas des associations passagères et momentanées, mais des associations durables et permanentes dont l’appât des sacrifices serait la souveraine et l’unique loi. Elle a voulu opposer aux terribles maladies qui minent la société des remèdes efficaces, en ouvrant au milieu de nous des sources intarissables de dévouement et d’amour ; elle a voulu que les âmes énervées, amollies par les joies de la terre, pussent venir se retremper dans ces fontaines sacrées ; en un mot, elle a institué les Ordres religieux pour donner au inonde la leçon et l’exemple des plus angéliques vertus. Voilà de belles paroles ; et ce n’est point un prêtre qui les a écrites, mais un homme du monde, une des gloires de la science, M. Augustin Cauchy. Thomas de Vio, auquel Léon X donnait la pourpre romaine, appartenait à l’ordre de Saint-Dominique. Sur les bords de la mer Tyrrhénienne, où Virgile place la tombeau de la nourrice d’$née, est un petit bourg du nom antique de Cajeta. C’est là que naquit, en 1469, Cajetano, de l’illustre famille de Vio. Son père le destinait au monde. L’enfant, pour échapper aux séductions de cette vie, embrassa volontairement l’ordre des frères Prêcheurs. Il fit sa théologie à Bologne. En 4491, il fut choisi à Padoue comme lector artium. Sa réputation s’étendit bientôt dans toute l’Italie. Le chapitre général de l’ordre s’était assemblé à Ferrare ; la province de Lombardie désigna Cajetan pour y soutenir, selon la coutume, une thèse de théologie. Il eut pour auditeurs, ce jour-là, le duc de Ferrare, le sénat et Jean Pie de la Mirandole. Cajetan s’était pris d’une véritable passion pour saint Thomas d’Aquin, cet ange de l’école, trop peu connu de nos jours, qui a sondé, à la manière des Allemands, tous les mystères du moi, et qui, pour les expliquer, s’est heureusement inspiré de Dieu. Il le savait presque par cœur ; aussi disait-on que si la Somme du théologien avait pu se perdre, elle se serait retrouvée dans le cerveau de son disciple. Il y a dans saint Thomas un enchaînement logique qui rappelle la méthode d’Aristote, et une imagination de poète qui tient de Platon. Cajetan savait enchaîner un auditoire à l’aide de cette alliance des deux natures grecques ; il parlait à la fois à la raison et au cœur. Ses succès aussi étaient immenses. Les cardinaux, les doyens d’églises, les séminaires, les universités, les grands et le peuple aimaient également à l’entendre. Cajetan fuyait toutes les gloires mondaines. La couronne qu’il demandait à Dieu était bien plus belle que celle que les hommes voulaient lui tresser. A Padoue, il se cacha pour échapper au triomphe qu’on allait lui décerner. Il avait vaincu ce jour-là Maurice et Trombetta devant un auditoire nombreux formé de maîtres et d’écoliers. Alors, dit son biographe, c’était la coutume en Italie de disputer sur des matières toutes spirituelles, tournois où l’âme seule était appelée à combattre ; tandis que dans l’antiquité païenne, c’était le corps qui entrait en lice. Cajetan parut dans d’autres luttes philosophiques, et toujours avec le même succès. Combien nous aimons mieux le voir dans la cathédrale de Pise, sans peur de la robe rouge que porte Carvajal, reprocher en pleine chaire aux cardinaux schismatiques leur désobéissance, les poursuivre de ses moqueries, les accabler sous les foudres de son éloquence, et les citer au tribunal de Dieu, s’ils ne se repentent et ne font pénitence ! C’est à Pise qu’il composa son Traité célèbre de l’autorité du pape et du concile, où il a défendu victorieusement la suprématie monarchique du souverain pontife. L’Eglise ne pouvait oublier dans ses récompenses un de ses fils les plus illustres. Le cardinal Caraffa voulut voir Thomas de Vio ; il le chargea des intérêts de l’ordre de Saint-Dominique. La vie de Cajetan change alors : ce n’est plus une existence littéraire dont les muses remplissent les instants, mais une vie de cénobite occupée tout entière de soins religieux, et où le frère trouve moyen de faire admirer sa science, sa charité, son zèle évangélique, son amour pour la pauvreté. Des poètes se rencontrent sur sa route, et se mettent à chanter ses vertus diverses : Non
opibus, gemmis aut fulvo ditior auro, Sed modicis contentus crat actilibus usus, dit Flavio, qui en fait un Père de l’Eglise. Un pape aussi allait se présenter sur le chemin du moine pour lui offrir la pourpre. Mais Jules II meurt trop tôt, et c’est Léon X, son successeur, qui se charge de ce grand acte de justice. Encore un mot : il y a une belle scène dans la vie de notre dominicain. Le connétable de Bourbon venait de s’emparer de Nome. Quand il ne resta plus un seul clou à arracher des murs du Colysée, ses soldats se répandirent dans la ville comme des furieux, dévalisant tous ceux qu’ils trouvaient sur leur chemin. Près du pont Saint-Ange ils avaient saisi Cajetan, qu’ils menaçaient de tuer s’il ne se rachetait à prix d’or. Mais voici le pape Clément VII qui crie aux meurtriers : Arrêtez ! n’allez pas éteindre le flambeau de l’Eglise ! Les soldats, frappés de terreur comme s’ils avaient entendu la voix de Dieu, ont pitié du malheureux, l’aident à se relever, le conduisent à son couvent, et lui laissent la liberté moyennant cinq mille ducats, que lui prêtèrent des âmes généreuses, et que Cajetan rendit en des temps plus heureux, sur les revenus de son évêché de Gaëte. PONZETTI. C’est un Florentin qui a conquis tous ses grades dans l’état ecclésiastique à force de travail et de talents : d’abord un des sept de la chancellerie romaine ; puis clerc de la chambre apostolique, puis chanoine, puis évêque de Melfi ou Malfatta, petite ville de la Pouille ; enfin cardinal du titre de Saint-Pancrace. En lui donnant la robe rouge ; Léon X eut évidemment l’idée d’honorer la science philosophique, dont Ponzetti était une des gloires. Il était connu par des travaux importants et de diverses natures. Il avait dédié à Augustin Nifo ses trois livres sur les Poisons, écrit un Traité de physique, une Dissertation sur l’origine de l’âme. Dans son livre de Physicâ, il avait enseigné que l’âme ne peut comprendre sans le secours des sens : Anima non intelligit sine sensibus. On imprima que l’auteur niait la spiritualité de l’esprit. Ponzetti prit la plume, et donna sa profession de foi dans son livre de Philosophiâ naturali. Comme Benivieni son compatriote, Ponzetti cherchait l’horoscope d’un homme dans les signes célestes qui avaient présidé à sa naissance. Il croyait à la puissance de certains chiffres ; le nombre 7 lui semblait réunir les perfections de tous les autres. Sept, disait-il, est formé de 2 et de 5, ou de 4 et de 3. S’il vient de 1 qui est impair, et de 6 qui est pair, il ne saurait procéder que de la source de tous les nombres, car 6 est engendré et n’engendre pas. S’il vient de 2 et de 5 ; 2, dualité, sera le premier nombre, parce que l’unité n’est pas nombre, mais principe ; et 5 représentera les cinq causes des choses : Dieu, l’esprit, l’âme du monde, le ciel, les quatre éléments. Vient-il de 3 et 4 : 4 sort de 1 et 3 ; 1, unité ou principe ; 3, origine du premier cube impair. Peut-être nous est-il permis aujourd’hui de rire de problèmes qui occupaient alors de graves esprits. L’astrologie avait fait refleurir la science des nombres, mais elle ne l’avait point inventée : l’antiquité la pratiquait. On sait les propriétés mystérieuses que Pythagore attachait aux nombres. Ponzetti était un des admirateurs du philosophe ; l’un et l’autre regardaient l’unité comme principe, fontaine, origine, source de toutes choses ; mais Ponzetti ne trouvait pas dans le nombre 6 un nombre maudit. Cette croyance, du reste, à la puissance occulte de certains chiffres, ne doit en rien nous prévenir contre la foi de l’adepte. Qui ne sait que saint Augustin partagea sur ce sujet quelques idées du philosophe grec ? PAUL-ÉMILE DE CÆSIS. Paul-Émile de Cæsis (Cesio), que Léon X décora de la. pourpre romaine, était un habile juriste. Professeur de droit, il avait eu souvent occasion de recevoir la visite de gens du peuple, et, dans ce contact obligé avec les pauvres, il s’était pris pour leurs souffrances d’une ardente sympathie ; c’était l’homme de l’orphelin, de la veuve, de l’opprimé, de tout ce qui souffrait dans l’âme ou dans le corps. On le voit, après la mort de Léon X, administrer un grand nombre d’églises où partout il institue des quêtes dont le produit est, destiné à secourir les indigents. Quand les revenus de son diocèse ne suffisent pas pour les soulager, il fouille dans sa cassette, entame ses revenus patrimoniaux, et fait comme Sadolet, l’évêque de Carpentras. Dieu, souvent aussi, lui envoie, comme au Modénais, de bons anges qui emplissent son bûcher et ses poches vides. Il disait gaîment : Mieux vaut manquer du nécessaire que d’en laisser manquer les autres : eh bien ! si nous ne pouvons mener un train de prince, nous vivrons dans la pauvreté ; il faudra dire adieu à nos nombreuses robes, nous contenter de vêtements modestes, n’entretenir qu’une petite famille de serviteurs, et nous arranger de façon à ce que personne ne souffre. Il avait établi dans ses divers diocèses de sages règlements. Il voulait que les prêtres, à certaines heures, vinssent à l’église pour chanter des hymnes à Dieu ; qu’ils les récitassent avec respect et gravité. Il défendait de parler dans le saint lieu. Devenu vieux, il habitait au Quirinal une petite maison qu’il préférait au plus beau palais de Rome. Son plaisir était, quand venait le soir, d’aller se promener sur ces hauteurs où s’élève la tour de Néron ; là, quand il voyait venir à lui un hôte ancien de la cour de Léon X, il l’arrêtait, le faisait asseoir à ses côtés, et commençait un long récit sur les vertus du pontife. Un soir que la pluie tombait à torrents, sans pouvoir interrompre ces hymnes de reconnaissance, les pieds du vieillard, malades depuis longtemps, furent atteints d’humidité. Cesio se mit au lit, saisi d’une fièvre qui le conduisit bientôt au tombeau. Il fut pleuré de tous ceux qu’il avait obligés, c’est-à-dire du monde romain tout entier. Qu’on ne s’étonne pas de ces longues pages que nous consacrons à la biographie d’hommes dont le nom n’apparaîtra plus dans notre histoire ; ce n’est pas ce nom, quelque grand qu’il soit, que nous voulons glorifier, mais le pontife seulement qui le mit en lumière. Nous devons le voir, c’est moins les lettres que Léon X veut honorer que les vertus. Presque tous ces nouveaux cardinaux ont des titres à l’admiration du chrétien. Louons-les avec effusion, sans crainte qu’on nous accuse de flatterie. C’est le reproche que mériterait Fabroni quand il nous vante la gravité, la sagesse, la prudence consommée du Romain André della Valle ; — la science profonde du droit unie à l’austérité des mœurs de l’évêque de Côme, Scaramouche Trivulce ; — le génie consommé des affaires du Génois Jean-Baptiste Pallavicini ; — le zèle pour l’avancement des saintes lettres de Boniface Ferreri de Verceil, qui fit élever à ses frais un collège à Bologne, où il était légat ; — la piété exemplaire de Guillaume Raymond de Vie, natif de Valence. N’est-ce pas à Campeggi, dont Léon X récompensa magnifiquement la science, qu’Érasme écrivait, à propos d’une bague qu’il en avait reçue : Le feu brillant de l’or sera l’éternel symbole de votre sagesse cardinaliste ; la lumière du diamant ne sera jamais qu’une pâle image de la gloire de votre nom. Citons encore d’autres savants, mais chrétiens surtout, que Léon X voulut récompenser. C’est Nicolas Ridolfi, que Sadolet aimait, que Marc-Antoine Flaminio chanta dans ses vers, et auquel Bernard Rutilio dédia sa Vie des Jurisconsultes, qu’il terminait ainsi : Vale sæculi decus. C’est Franciscus, Franciotto Orsini (des Ursins), que chérissait Laurent de Médicis, auquel Politien adressa ses lettres de Ponderibus et Mensuris, et qui, après la mort d’Adrien VI, fut un moment sur le point d’être élu pape, tant les cardinaux avaient de confiance dans ses lumières et sa piété ! Pie voyez-vous pas que, dans un vague pressentiment des luttes que l’Église soutiendra bientôt, et comme illuminé d’une lumière céleste, Léon X a cherché dans l’élu les mœurs unies à la science des lettres divines ? Ce sont de grands maîtres en théologie que Cajetan, l’auteur de de Pontificatus institutione divinà, de Invocatione sanctorum, de Potestate papæ et concilii ; Adrien d’Utrecht, professeur à Louvain, à qui nous devons les Quæstiones et le Supra computum hominis agonizantis ; Alexandre Cesarino, célébré par Paul Manuce comme un des hommes les plus versés dans la science des livres saints ; et Jacobatio, qui dans les questions dogmatiques a toute l’autorité d’un apôtre, et dont le livre de Concilio obtint l’insigne honneur de faire partie des actes du concile de Latran. Quelques jours après cette promotion de cardinaux que Rome accueillit avec de grands témoignages de joie, tous ces princes de l’Église se trouvaient rassemblés à la même table, dans une des salles du Vatican que Raphaël achevait de peindre.
Si vous quittez l’Italie, et qu’après avoir traversé le Rhin, vous fassiez route pour la Saxe, vous trouverez une autre table dressée dans une auberge de Wittemberg. Là quelques moines assis parlent de Rome. Celui que les convives écoutent en silence se nomme Martin Luther ; voici ce qu’il raconte à ses disciples : En Italie comme en France, tous les diseurs de messes sont de véritables ânes qui n’entendent pas le latin, et, en Italie, pas même la langue maternelle qu’ils sont chargés d’enseigner aux autres. Les Italiens sont des gens sans Dieu. Vous savez, mes amis, que je vis il n’y a pas longtemps la face du pape ; maintenant c’est autre chose qu’il nous montre. Je vous le dis : Tibère l’empereur, ce méchant garnement ; était un ange comparé à tout ce qui fait partie de la cour de Rome. Ecoutez-moi bien : En ce temps-là il y avait un homme qui avait si grande envie d’être pape, qu’il se donna au diable pour obtenir la tiare. II fit donc un pacte avec Satan, et dit au diable : Je me donne à toi, je t’appartiendrai, mais seulement quand j’aurai célébré la messe à Jérusalem. Or il fut nommé pape. Comme il célébrait la messe dans une chapelle qui se nommait Jérusalem, le diable parut qui dit au célébrant : Sais-tu comment s’appelle cette chapelle ? La chapelle de Jérusalem. Et alors le pape se rappela le pacte qu’il avait fait avec le malin esprit, et quand il eut achevé la messe, il dit : Qu’on me coupe en morceaux ; si les corbeaux emportent mes chairs et laissent mon cœur, c’est preuve que j’aurai là haut obtenu miséricorde. Et il arriva ce qu’il avait prévu : signe qu’il avait été, selon les papistes, pardonné, et que la mort était une expiation du pacte. Or ce que nous traduisons ici le plus fidèlement possible était fort sérieusement raconté par Luther, qui dans son récit n’oublie qu’une chose, le nom du pape. Et les convives croyaient à la parole du docteur qui tenait en ce moment l’Allemagne sous sa main, et la poussait à la révolte, c’est-à-dire à la perdition de sa foi et de sa liberté, car l’une était enchaînée à l’autre. C’est ici que nous devrions raconter la révolte du moine de Wittenberg contre l’Eglise. Mais nous avons pensé que nous pouvions sans scrupule intervertir l’ordre chronologique des faits, et tracer aussi complètement que notre cadre nous le permet le tableau du mouvement intellectuel qui va se produire sous Léon X. Luther viendra plus tard, quand rien ne pourra nous distraire du spectacle de cette lutte funeste qu’il doit engager avec l’autorité. Montrons, en attendant, que la vérité, pas plus que le soleil, n’a peur des ténèbres ; que pour éclairer l’esprit la papauté appela tout ce qui peut séduire l’imagination, histoire, peinture, musique, sculpture, poésie. Les larmes arrivent toujours trop tôt : n’avons-nous pas le temps de pleurer sur le plus cruel événement de l’histoire moderne, la réformation, c’est-à-dire la guerre au foyer domestique entre le fils et sa mère. |