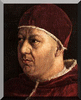HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXVI. — EXPÉDITION DE MAXIMILIEN. - GUERRE D’URBIN. - 1516.
|
Schinner rallume les
haines contre la France. - L’empereur Maximilien prépare une nouvelle
expédition en faveur du duc de Milan. - Il est sur le point de prendre la ville,
quand les Suisses se révoltent dans son camp. - Maximilien s’enfuit. - Belle
conduite de Léon X lors de la prise d’armes de l’empereur. - Ses lettres à
Schinner et à l’évêque Ennio. - Le pape garde fidèlement sa parole. - Révolte
du duc d’Urbin. - Griefs du saint-siège contre ce prince. - Le pape lui fait
la guerre et le dépouille de sa principauté. - Heureuses influences pour
l’Italie de la conquête d’Urbin. François Ier, après avoir licencié son armée, à l’exception de sept cents lances, de six mille lansquenets et de quatre mille Gascons et Biscayens, était parti pour la France, laissant le gouvernement du Milanais au connétable de Bourbon. Schinner ne se décourageait pas : les revers, loin de l’abattre, le grandissaient. Après la funeste journée de Marignan, il avait quitté Milan, traversé les gorges du Tyrol et gagné la ville d’Inspruck, emmenant avec lui François Sforce. C’était le frère puîné du duc Maximilien qui venait de s’enfermer dans le château de Milan, son dernier asile, son dernier patrimoine, et qu’il avait si mal défendu. Si le sort livrait le malheureux Maximilien au vainqueur, François restait pour soutenir la querelle et sauver les droits de sa maison. Schinner avait assisté à une restauration qui semblait beaucoup plus difficile que celle des Sforce : les Médicis n’étaient-ils pas rentrés à Florence après vingt ans d’exil ? C’était dans les mains de l’empereur d’Allemagne un puissant auxiliaire que cet enfant conduit au camp impérial par l’évêque de Sion. Ferdinand le Catholique venait de mourir. Ce prince, auquel il est impossible de refuser quelques-unes des qualités qui font les grands rois, peu de temps avant sa mort avait fait passer à Maximilien cent vingt mille florins pour l’aider à troubler la victoire des Français en Italie, pendant que Henri VIII, excité par Schinner, ému par les plaintes de François Sforce, envoyait dans le même but des subsides à l’empereur. Schinner, sous le titre de Philippique, avait imprimé depuis quelque temps à Londres un pamphlet où, tantôt s’inspirant de Démosthènes, et tantôt d’Aristophane, il disait au monarque de la Grande Bretagne : Il ne s’agit pas de couper, mais d’arracher les ongles à ces coqs (les Français). Henri VIII se laissait entraîner. Maximilien sembla secouer alors cette indolence que lui reprochent ses contemporains, et recouvrer l’ardeur qu’il montrait dans son jeune âge, quand, grimpé sur les rochers, il apercevait de loin le chamois que le brouillard de la montagne cachait à tous les regards, et qu’en véritable chasseur il marchait sur les pics comme sur un sol uni. Il comptait que Henri VIII ferait une irruption sur les côtes de France, comme il l’avait promis, tandis que les Impériaux attaqueraient le Milanais : le roi d’Angleterre faillit à sa parole. Mais, grâce aux subsides de ses deux alliés, et peut-être plus encore à l’assistance du cardinal, l’empereur eut assez vite levé une belle armée ; elle était forte de cinq mille chevaux fournis par ses Etats héréditaires, de dix mille fantassins espagnols et italiens, et de quinze mille Suisses recrutés dans les cantons qui n’avaient pas voulu faire leur paix avec la France. C’est à la tête de ces troupes que Maximilien, au printemps de 1516, entra par Trente en Italie. Maximilien eut tort de ne pas suivre les conseils de Schinner : cette soutane rouge en savait plus que le meilleur général de l’armée impériale. Le cardinal voulait que, sans s’arrêter en chemin, le prince marchât au pas de course sur Milan, dont il se serait infailliblement emparé, grâce à l’épouvante que cette apparition subite aurait jetée dans les esprits. L’empereur, en route, avait trouvé un petit château, Asola, qui voulut lui barrer le chemin. Le provéditeur Contarini, qui le défendait, répondit en homme de cœur à la sommation du prince, c’est-à-dire par le canon. Maximilien, pour châtier l’insolence du commandant vénitien, assiégea le château, mais inutilement : après quelques attaques infructueuses, il prit le parti de marcher sur Milan, poursuivant l’épée dans les reins Odet de Foix, seigneur de Lautrec, qui avait tenté avec quelques cavaliers de disputer le passage de l’Adda aux Impériaux. L’épouvante était dans Milan, qui se crut un moment perdu. Heureusement le vainqueur allait lentement ; il s’amusait en chemin, et laissait ainsi le temps au connétable de Bourbon de mettre la ville en état de défense. Le capitaine bernois de Stein, ennemi du cardinal de Sion, arriva sur ces entrefaites avec six mille Suisses, et Milan passa, bien vite du 3ésespoir à la confiance. Mais sa joie fut de courte durée ; car, au moment d’en venir aux mains avec les Impériaux qui bloquaient la ville, les Suisses refusèrent de combattre, et partirent l’arme au bras, licenciés par le connétable, qui leur avait fait promettre de ne pas se battre contre les Français. A la nouvelle de cette défection, Maximilien se crut maître de Milan, et fit sommer les habitants de lui ouvrir leurs portes dans trois jours, les menaçant, en cas de refus, de détruire la ville de fond en comble, et sur les ruines de semer du sel, ainsi que l’avait fait autrefois Frédéric Barberousse. Le gouverneur ne se laissa point intimider, et le blocus de Milan devint plus rigoureux. Cependant les Suisses à la solde de Maximilien étaient mal payés et murmuraient hautement. Des murmures ils en vinrent aux menaces, et leur colonel Stapffer, un matin, alla trouver au lit l’empereur, réclamant avec une insolence soldatesque l’arriéré de la solde qui leur était dû. En cas de refus, il déclarait qu’il irait avec ses gens rejoindre le connétable. L’empereur eut recours aux prières et à la colère ; mais le colonel fut inflexible : pour l’apaiser, il lui promit d’aller au quartier des Suisses, le soir, avec le cardinal de Sion. Maximilien n’attend pas la nuit, et se hâte de remettre à Schinner seize mille écus, à compte d’une somme beaucoup plus forte qu’il va se procurer ; puis il monte à cheval et part, avec une escorte de deux cents cavaliers, pour Trente, sans rien dire à son armée, qui se débande, lève le siége de Milan, et pille Lodi et Saint-Angelo, pour se payer de ce que leur devait l’empereur. Quelques historiens cherchent à expliquer la fuite de Maximilien par l’apparition des ombres de Charles duc de Bourgogne et de Léopold d’Autriche, qui, la nuit, auraient réveillé l’empereur de son sommeil, pour l’avertir de se défier des Suisses. Cette prise d’armes, tentée courageusement, on ne saurait en disconvenir, aurait demandé, pour réussir, une vigueur d’action dont Maximilien, malgré ses talents militaires, était incapable en ce moment. On a prétendu que le pape avait sourdement excité ce prince à descendre en Italie. L’histoire doit la vérité aux vivants comme aux morts. Le pape remplit toutes les conditions du traité qu’il avait conclu quelques mois auparavant avec François Ier. En cas d’attaque du Milanais, il avait offert à son allié cinq cents hommes d’armes et un corps de trois mille Suisses. Requis d’exécuter le traité, Léon X répondit qu’il n’était pas en état de fournir le contingent stipulé ; mais, en compensation, il promit l’assistance d’un corps de troupes florentines qui se mit en marche pour Bologne, où il arriva quand l’empereur était en pleine déroute. Il fit plus encore : au moment où les montagnards s’ébranlaient pour porter secours à l’Église, qui n’avait même pas besoin de les appeler à elle, Léon X écrivit à l’évêque de Sion une lettre que nous voudrions ne pas avoir trouvée dans le recueil de Bembo. A Dieu ne plaise que nous blâmions le pontife du respect qu’il montre pour la foi jurée, de ses généreux efforts pour conserver la paix, de son inébranlable obstination à garder un traité qu’il a signé, quelque dur qu’il soit pour la papauté ; mais il nous semble qu’un serviteur comme Schinner a droit à de grands ménagements. Ce n’est pas assez de lui dire : Aussitôt que vous aurez reçu ma lettre, renoncez à votre entreprise ; demeurez tranquille, et ne cherchez pas à troubler la paix de vos montagnes le pape ajoute : Il n’est rien qu’un homme sage et prudent doive plus éviter que de jeter le trouble dans une république où la paix va régner, et de pousser à la révolte un pays qui l’a vu traître ; c’est mal servir les intérêts de la république chrétienne. Un soldat tel que Schinner, qui s’estimerait heureux de mourir en défendant l’Eglise, si nous supposons qu’il ait failli par trop de zèle, méritait d’autres paroles que celles que lui adresse Léon X. Ne craignez rien pour Schinner : si le soldat a pu se sentir blessé jusqu’au cœur, le prêtre est là pour verser du vin sur la plaie. L’évêque se tait, obéit, jette son cor d’Uri, dit adieu à ses montagnards jusqu’à ce que le moment arrive, et il viendra, où Léon X aura besoin du guerrier. Schinner, dans son repos studieux à Rome, n’aura point oublié son ancien métier. Nous le reverrons, les yeux inondés de larmes, chanter comme le Siméon de nos livres saints : Mon âme, loue le Seigneur. C’est qu’avant de mourir il aura vu Parme et Plaisance rentrer dans le domaine de l’Eglise. Nous avons lu dans Roscoë : A cette époque, Léon X envoyait Ennio, évêque de Veruli, en qualité de légat près des cantons helvétiques, pour les engager à fournir des troupes aux ennemis de François Ier, qui ne l’ignorait pas. Ainsi se vérifie ce mot profond du comte de Maistre : Depuis trois siècles, l’histoire semble n’être qu’une grande conspiration contre la vérité. Or, sait-on ce que Léon X écrivait à Ennio ? Comme je vous l’ai dit aussitôt après mon traité de bonne amitié signé avec François Ier, prenez bien garde, dans vos relations avec les Suisses, d’offenser directement ou indirectement Sa Majesté ; je m’en rapporte à votre prudence. Vous savez qu’à la cour de ce prince on n’est pas entièrement revenu sur votre compte ; il est donc bien important pour vous de ne prendre aucune part à ces diètes qu’on annonce en Suisse ; tenez-vous à l’écart, et montrez ainsi que vous n’avez pas même la pensée de rien faire qui puisse déplaire au roi de France. N’oublions pas que cette lettre fut écrite quelque temps avant l’expédition de Maximilien. Voilà, ce nous semble, un pape bien lavé du reproche de parjure. Qu’on écrive demain une nouvelle histoire de France, nous sommes sûrs d’y lire un chapitre qui aura pour titre : Léon X fausse ses serments et trahit François Ier. Lors de l’invasion du Milanais, le pape, justement alarmé, dut compter, pour arrêter les Français, sur l’assistance du duc d’Urbin, qu’il avait sommé de venir, comme feudataire du saint-siège, se rallier sous l’étendard de l’Église. François de la Rovere obéit, mais mollement. Quand les deux monarques se rencontrèrent à Bologne, François Ie, essaya d’intervenir en faveur du due d’Urbin ; niais la faute du feudataire avait eu de si funestes conséquences pour les confédérés, que le pape dut demeurer inflexible. II invoquait la parole que le roi avait donnée de ne prendre sous sa protection aucun sujet du saint-siège apostolique. Ce n’était pas la première fois que le duc d’Urbin encourait le blâme de son souverain. Sous Jules II, il s’était montré partisan des Français ; et, chargé par le pape du rétablissement des Médicis à Florence, il avait refusé formellement de s’associer aux projets du pontife. Après la bataille de Ravenne, on l’avait vu s’acharner à la poursuite des troupes pontificales ; enfin, en pleine rue, il avait frappé d’un coup de stylet le cardinal de Pavie, François des Alidosi, assassinat dont il avait obtenu l’absolution, grâce à l’intervention du cardinal de Médicis. Tels étaient les griefs du saint-siège contre le duc d’Urbin. Le souverain avait le droit de punir le vassal. Léon X, dans un monitoire où sont rappelées les plaintes de Rome contre le sujet désobéissant, le somma de comparaître devant le consistoire dans le terne de quelques semaines. Au lieu d’obéir, le due eut recours à l’intervention de la duchesse Élisabeth, veuve du due Guidubald, et dont Bembo a célébré les belles qualités. La duchesse eut plusieurs audiences du pape ; mais ses prières furent inutiles. Pendant qu’elle implorait le pardon du coupable, que faisait le duc d’Urbin P Au lieu de se soumettre, il jetait dans la citadelle de Pesaro une garnison de trois mille hommes dont le commandement était confié à un officier d’une fidélité et d’un courage à toute épreuve. Si le prince se fût présenté volontairement à Rome, il aurait été pardonné sans doute. Au sujet qui persistait dans sa révolte Léon X devait un châtiment exemplaire : il l’excommunia, le déclara rebelle, et le priva de ses titres et dignités. En même temps, les troupes pontificales, sous la conduite de Laurent de Médicis, envahissaient les Etats du duc d’Urbin, s’emparaient de sa capitale, puis de ses places fortes, presque sans coup férir, et en donnaient l’investiture au commandant de l’expédition. Cet acte de vigueur et de justice, trop rigoureux peut-être, reçut l’approbation en plein consistoire des membres du sacré collège. Un seul d’entre eux, Grimani, évêque d’Urbin, refusa de signer une sentence qui privait de ses Etats un prince dont la cour avait toujours été ouverte aux proscrits. Il reprochait à Léon X d’oublier l’hospitalité que l’ancien duc Guidubald avait autrefois si généreusement exercée envers Julien de Médicis. François de la Rovere supporta courageusement l’exil ; il avait à ses côtés une femme bien capable d’en adoucir les rigueurs, la fille d’Isabelle de Gonzague, qui rappelait au monde toutes les vertus dont sa mère était ornée. Les temps changèrent ; Laurent de Médicis, que les Urbinates avaient accueilli comme on accueille un prince non veau, par amour du changement, s’en dégoûtèrent bien vite. François de la Rovere, qui ne tarda pas à connaître les dispositions des habitants, rêva la conquête d’Urbin. A cette époque, tout projet aventureux a des chances de fortune ; dès qu’il est connu, on est sûr de voir accourir une foule de soldats mercenaires que le repos fatigue, et qui troqueraient une année de vie contre quelques heures de pillage. Au premier appel, le duc vit arriver 3.000 Italiens, 1.500 cavaliers, et un chef expérimenté, Frédéric de Gonzague, seigneur de Bozzolo, ennemi juré de Laurent de Médicis. La marche de François de la Rovere fut une suite de triomphes. Il passa le Savio, sous les murs de Césène, sans que Laurent essayât de l’arrêter. Urbin n’était gardé que par une faible garnison qui se rendit à la première sommation. Rosseto, le gouverneur, avait trahi. Alors ce peuple qui avait fait éclater sa joie lors de l’occupation de la ville par les troupes du pape s’arme pour les chasser, et se met à pousser des vivat à la vue de son ancien maître. Il ne lui suffit pas d’insulter au vaincu, il veut l’humilier, et il frappe une médaille où d’un côté on voit la figure du pape régnant, avec l’exergue : Leo, Pont. Max. An. IIII ; et de l’autre, un ballon gonflé d’air, avec la devise de Sa Sainteté : Vi et virtute. Ce fut un revers et une leçon pour Léon X, que la capitulation d’Urbin. Le pape perdait un duché important, et il apprenait à ses dépens combien peu il devait compter sur le connétable de Bourbon, dont le lieutenant Lautrec avait autorisé Frédéric de Gonzague à s’enrôler sous les ordres de la Rovere. Le pape, justement alarmé, requit l’assistance des princes chrétiens contre un sujet rebelle qui trouvait un appui jusque dans le camp des alliés du saint-siège. Roscoë a raison de dire que les plaintes d’un souverain tel que Léon X ne pouvaient être dédaignées par les monarques étrangers. Si la paix régnait en Europe, on le devait certainement aux efforts du pontife : et d’ailleurs le pape, comme le remarque voltaire, c’était l’opinion gouvernant le monde chrétien. Chaque fois que la papauté craint quelque danger, c’est vers l’Angleterre qu’elle tourne les regards ; c’est de cette fille bien-aimée qu’elle attend, après Dieu, l’assistance la plus efficace. Entre le pape et le roi qui régnait alors sur la Grande-Bretagne il existait un perpétuel échange de témoignages de dévouement. Léon X demande à Henri VIII la liberté de Polydore Virgile, et l’humaniste sort aussitôt de prison. Henri VIII recommande à Sa Sainteté Richard Névyl, qui ne tarde pas à obtenir le titre sollicité par son royal protecteur. Au premier bruit de la conquête d’Urbin par François de la Rovere, le pape écrivit à Henri VIII pour lui demander de prompts secours. Ce prince intervint sur-le-champ, par le ministère de ses ambassadeurs, auprès de ses alliés, qui eurent égard aux représentations du monarque. Le roi d’Espagne donna l’ordre au comte de Potenza de se mettre en marche à la tête de quelques milliers de soldats pour renforcer l’armée pontificale, et François Ier envoya de son côté trois cents lances à Sa Sainteté, et promit de la secourir envers et contre tout feudataire révolté. Il est vrai qu’il mit plus tard un bien haut prix à cette intervention armée : il exigea en échange la restitution de Modène et de Reggio au duc de Ferrare, et avec tant d’insistance, qu’il finit par l’obtenir. Cependant le pape travaillait à former une armée assez puissante pour réduire le sujet révolté ; elle se trouva forte bientôt de dix mille hommes d’armes, de quinze cents chevau-légers et de quinze mille fantassins. Le commandement en fut confié d’abord à Laurent de Médicis. Les deux armées se rencontrèrent, et les hostilités commencèrent au mois d’avril. Le château de San-Costanza fut emporté par les troupes papales, qui vinrent camper sous les murs de Mondolfo, où Laurent reçut à la tête un coup de feu qui le mit hors de combat. Il fut remplacé par le cardinal Bibbiena, qui arriva fort heureusement pour rétablir la discipline, que l’éloignement de Laurent avait gravement compromise. Si la Rovere eût surpris l’ennemi dans cette occasion, il en aurait eu bon marché ; mais il crut détourner le danger qui menaçait Urbin en faisant tuer au milieu de son camp, à coups de pique, quatre officiers qu’il accusait de vouloir le livrer aux Médicis. Après cette odieuse exécution, il se jeta sur les terres de la Toscane, laissant ainsi ses États exposés aux ravages de l’ennemi. Bientôt il fut forcé de rebrousser chemin et de marcher sur Urbin. Il était trop tard ; ce n’était plus seulement aux troupes pontificales qu’il avait affaire, mais aux rois d’Espagne et de France, qui n’étaient pas sans crainte sur leurs possessions en Italie. L’ordre fut donné aux troupes des deux nations de quitter l’armée de la Rovere et de regagner leurs garnisons. Le malheureux duc, ainsi abandonné, fut obligé de souscrire aux conditions que lui dicta son vainqueur. La plus dure de toutes fut l’abandon de ses domaines. Le pape leva la sentence d’excommunication prononcée contre le duc et ses adhérents, défendit de rechercher aucun de ceux qui avalent aidé le prince dans sa révolte, laissa la jouissance de tous leurs biens à la duchesse sa femme et à la duchesse douairière, et permit enfin au vaincu d’emporter avec lui ses armes, ses effets mobiliers, et la belle bibliothèque formée par Frédéric son aïeul. Ce fut un coup de fortune pour l’Italie que la conquête d’Urbin par les armes de Sa Sainteté. Désormais, tant que la papauté posséderait le duché, l’Italie n’avait plus à craindre d’être envahie par l’étranger. Si, comme autrefois sous Charles VIII, il voulait la traverser pour s’emparer de Naples, elle avait dans les places fortes de San-Costanza, Mondolfo, Pesaro, Sinigaglia, San-Leo, Majuolo, autant de forteresses pour arrêter l’ennemi ou l’inquiéter dans sa retraite. Ce qui manquait à ce malheureux pays, c’était l’unité, dont la papauté seule, à partir de Jules II, comprit toute l’importance. Avec ses vingt ou trente maîtres, elle ne pouvait avoir de volonté ; réunis au moment du danger dans une commune pensée de salut, tous ces souverains se détachaient un à un, à la première occasion, de la commune alliance, et l’indépendance nationale périssait faute d’un chef suprême. Avec Rome telle que l’a rêvée Jules II, telle que la veut Léon X, l’Italie n’a plus à trembler pour ses libertés. En cas d’invasion, elle vient s’abriter derrière la papauté, qui, pour défendre la nationalité menacée, a pour armes l’épée et la croix. On accuse d’ambition l’un et l’autre de ces pontifes ; qu’importe, si l’œuvre à laquelle ils travaillaient était dans les intérêts du pays ? Mieux valait un pape qu’un roi, même de France, parce que le pape est le chef naturel de la famille italienne ; que la France en Italie, c’est une nation dans une nation. Un écrivain dont l’opinion n’est pas suspecte, M. Libri, avoue que l’asservissement de l’Italie devenait inévitable le jour où François Ier et Charles-Quint l’auraient choisie pour champ de bataille. Comment alors reprocher à la papauté ses généreux efforts pour en chasser l’étranger ? L’attention si puissamment excitée à Rome par la guerre d’Urbin fut un moment distraite par un complot auquel le pape échappa miraculeusement. |