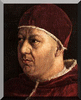HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXIV. — ALLIANCE AVEC LA FRANCE. - 1515.
|
Situation où se
trouve le pape après la bataille de Marignan. - Il est forcé parles
événements de se rapprocher des Français. - Canosse est chargé de traiter
avec le vainqueur. - Entrevue à Londres d’Érasme et de Canosse. - Les
négociations sont entamées, et Léon X obligé de subir les conditions imposées
par François Ier. - Léon X part de Rome pour avoir une entrevue avec le roi.
- Fêtes qu’on fait au pontife à Florence. - Entrevue à Bologne des deux
souverains. - Pâris de Grassi. - Le chancelier Duprat. La victoire de Marignan, on ne saurait se le dissimuler ouvrait à François Ier les portes de Florence et de Bologne, c’est-à-dire qu’elle menaçait Léon X à Rome dans sa souveraineté temporelle, à Florence dans ses intérêts de famille. On se rappelle que les Médicis devaient leur rétablissement aux efforts combinés de l’empereur d’Allemagne et du roi d’Espagne. L’un et l’autre étaient impuissants pour arrêter les progrès du vainqueur. Il n’eût tenu qu’à François II de réveiller en Toscane, contre d’anciens bannis, des ressentiments mal éteints que l’habileté de Julien n’avait pu entièrement assoupir. Savonarole conservait à Florence de nombreux partisans. Les Frateschi, qui s’appelaient en 1513 patriotes, rêvaient une république basée sur celle dont le dominicain avait formulé la constitution. Machiavel croyait que le temps viendrait tôt ou tard où l’on pourrait arracher Florence aux Médicis. Les Médicis, maîtres du pouvoir, avaient habilement pardonné au conspirateur, mais ils refusaient de l’employer. Machiavel, on ne le croirait pas s’il ne l’avait dit dans une lettre confidentielle, aurait consenti volontiers à remuer quelque chose dans l’Etat, ne fût-ce qu’une pierre, et il y en avait plus d’une à Florence ; mais Julien ne voulut pas que le secrétaire de Soderini y mît la main. Redoutait-il l’esprit remuant du Florentin., ou méconnaissait-il les talents de l’écrivain ? C’est ce qu’il est difficile de déterminer. L’oubli ou la défiance paraissait une égale offense à l’âme de Machiavel. Ce qu’il y a de certain, c’est que tout ce qui se décorait du titre de patriote aurait sans doute ouvert la porte de Prato aux Français, fait sonner les cloches du campanile de Giotto en signe d’allégresse, et battu des mains sur le passage de François I", tout comme avaient fait Marsile Ficin et Savonarole, quand Charles VIII fit son entrée dans Florence. On ne trouverait pas dans l’histoire un peuple aussi mobile que le peuple florentin : il ne sait ni se gouverner ni gouverner les autres ; il se dégoûte aussi vite de Michel Lando, le cardeur de laine, que de Côme de Médicis, le père de la patrie ; il chasse et rappelle plusieurs fois les mêmes maîtres, et finit par se donner à Jésus-Christ, qu’on lui propose pour roi, mais dont l’élection, soumise au grand conseil, ne passe qu’à une assez faible majorité. La situation du pape n’était pas sans danger : recourir aux armes paraissait impossible ; Jules II lui-même ne l’aurait pas tenté. Restait la voie des négociations qu’il allait essayer. Le vainqueur était plein de déférence pour le saint-siège. Jeune autant que brave, nous l’avons vu, quand le soleil se couche, à Marignan, se jeter à genoux sur le champ de bataille, et remercier le ciel du succès de la journée. Il connaissait Léon X ; il savait que ce prince prodiguait des encouragements aux lettres, aux sciences et aux arts. De retour de son ambassade à Rome, Budé avait dit à son royal maître tout ce qu’il avait trouvé dans le nouveau pontife d’aménité, de douceur, de piété, de savoir. Naturellement donc le monarque français était disposé à traiter favorablement Sa Sainteté. Il comprenait du reste à merveille que, pour pénétrer plus avant en Italie, il devait se garder de rompre avec le saint-siège, comme l’avait fait trop malheureusement son prédécesseur. Quant au pape, il est probable qu’il eût voulu rester fidèle à la politique de Jules II. S’il abandonnait ses alliés, s’il consentait à se rapprocher de la France, c’est que la nécessité l’y contraignait. D’un moment à l’autre le vainqueur pouvait donner l’ordre de jeter un pont de bateaux sur le Pô, traverser le fleuve, s’emparer de vive force de Parme et de Plaisance, et faire payer bien cher aux États de l’Église l’opiniâtreté de leur chef temporel. Il était évident toutefois que le cœur n’était pour rien dans ce rapprochement forcé. Les alliés du pape, c’étaient ceux de Jules II : l’empereur Maximilien, le roi catholique, surtout les Suisses, qui avaient donné à l’Église de véritables preuves de dénouement. Une alliance contractée sous le canon de Marignan ne pouvait être durable. Aux yeux de Jules Il, la France était l’ennemie naturelle de l’indépendance italienne. Or Léon X était de l’école de cet homme d’État. Quand viendra le moment où Léon X abandonnera François Il’ pour renouer des négociations avec ses anciens alliés, nos historiens crieront à la trahison, sans prendre garde que la papauté ne pouvait pas plus oublier une fidélité qui ne s’était jamais démentie depuis le commencement des hostilités, que sympathiser avec une puissance qui si souvent avait troublé le repos de l’Italie. Depuis vinât ans la France inquiétant le saint-siège. Sous Alexandre VI, elle avait protégé et assisté les barons romains, sujets rebelles de l’Église ; sous Jules II, elle ne s’était pas contentée d’accueillir les cardinaux schismatiques, elle avait affiché sur les murs de ses églises la déchéance du pontife, et flétri du nom de simoniaque l’homme que le sacré collège avait élu à l’unanimité. Elle ne cessait de gravir et de descendre les Alpes, et, dans ses défaites comme dans ses triomphes, de susciter de nouveaux ennemis à l’Italie. Brescia, Novare, Bologne, Milan, Rome elle-même, étaient remplies de ruines qu’elle laissait partout où elle passait. Si l’Allemagne avait reparu avec ses lansquenets en Italie, c’est la France qui les y avait appelés. Voilà les plaintes que Jules Il ne cessa (le faire entendre pendant toute la durée de son pontificat. Ce qu’il est bien important de faire remarquer, c’est que les papes n’ont point été la cause des luttes qui ont ensanglanté l’Italie, et qu’ils en ont été les victimes : ils n’ont pas allumé la guerre, ils voulaient l’éloigner à tout prix, et nous devons nous rappeler les conseils d’abord, puis les menaces, les prophéties enfin qu’Alexandre VI fit entendre à Charles VIII. Faisons de l’histoire et non pas du sentiment, et demandons s’il n’est pas vrai que Louis XII ait fait frapper une médaille où il prophétisait la chute de Babylone, c’est-à-dire de Rome ; si les parlements français n’avaient pas poussé le monarque à briser avec le saint-siège ; si François Ier ne songeait pas à enlever de vive force, s’il était nécessaire, l’arme et Plaisance, que Jules II avait réunies aux États de l’Église ? Que si les temps changent, si le cor d’Uri appelle de nouveau les montagnards suisses sous les drapeaux de Schinner, pour défendre celle qu’ils appellent leur mère ; si un grand capitaine comme Charles-Quint vient offrir un jour son épée au saint-siège, comment -tome refuserait-elle de pareilles avances et de semblables défenseurs ? Avec les Français à Milan, le pape n’aurait pu rester maître à Rome, parce que de Milan : ils pouvaient, comme Charles VIII, demander passage à travers le patrimoine de Saint Pierre, pour réclamer ou conquérir Naples, et envahir la Sicile. On voit d’un coup d’œil combien l’occupation de Milan était grosse de périls pour l’Italie. Elle avait donné à François Ier la Méditerranée jusqu’au golfe de la Spezia, l’Adriatique et Venise., la Savoie et le Piémont, et une partie de la Suisse. Il fallait arrêter le vainqueur : Léon X eut recours aux négociations ; le diplomate pouvait être plus heureux que le guerrier. Léon X avait en France les sympathies de tous les humanistes ; c’est un humaniste qu’il chargea des intérêts du saint-siège auprès de François Ier. Louis Canosse, d’une noble famille de Vérone, représentait, dans les négociations qui s’ouvrirent bientôt à Milan, Léon X, dont il était le légat. C’était un homme adroit, délié, qui savait admirablement tourner une difficulté, par-dessus tout un causeur aimable ; du reste, bon humaniste, et, an besoin, faisant d’excellents vers latins. Il avait su tromper Pœil si fin d’Érasme, ce qui annonçait un véritable talent de diplomate. Quand Érasme était allé chercher en Angleterre des fêtes, et peut-être des florins, car il aimait assez l’argent, il avait fait connaissance à Londres d’André Ammonio de Lucques, qui lui-même cherchait fortune, et qui avait été assez heureux pour plaire à Henri VIII, dont il était le secrétaire latin. Or, en 1510, Louis Canosse descendit incognito chez Ammonio. On disait qu’il venait en Angleterre pour sonder les dispositions de Henri VIII, et peut-être pour le décider à traiter avec la France. Un jour que le philosophe dînait chez le secrétaire de Sa Majesté, il aperçut près d’une cheminée, causant avec son ami, un homme de tournure assez commune, vêtu d’un vieil habit, les cheveux retroussés, le chapeau râpé, et qu’il prit pour l’un des poètes faméliques dont l’Angleterre abondait à cette époque, ou plutôt pour quelque importun qu’Ammonio saurait bien vite éconduire. Il causa sans prendre garde à l’étranger, car le philosophe aimait beaucoup les beaux vêtements : l’étranger ne dit mot et n’écouta pas même. On se met à table ; l’inconnu s’assied à côté du maître de la maison. Érasme, étonné, demande en grec la condition de ce convive. Ammonio répond, dans la même langue, que c’est un riche marchand de la Cité ; à quoi notre philosophe dit en souriant qu’il en a toutes les allures. On continue de causer. Est-il vrai, demande Érasme, très curieux de son naturel, que Léon X ait envoyé secrètement un légat en Angleterre ? — On le dit, répond Ammonio. — Le pape n’a pas besoin certainement de mes conseils, reprend Érasme ; mais, s’il m’avait consulté, peut-être que je lui aurais donné un autre avis. — Ah ! et lequel lui auriez-vous donné ? ajouta Ammonio. — Lequel ! reprend Érasme : au lieu d’une paix entre les deux puissances, qui ne peut pas se traiter si vitement, et qui, du reste, a de graves inconvénients pour la discipline militaire, car elle affaiblit et éteint le courage, j’aurais proposé une belle et bonne trêve de trois ans, par exemple. — Pas trop mal, ajoute Ammonio ; mais, à vous dire vrai, je crois que le légat ne vient pas proposer autre chose. — Est-ce un cardinal, le légat ? demande le philosophe. — Non, répond Ammonio en regardant Canosse, mais il en a l’esprit. — C’est déjà quelque chose, reprend Érasme en souriant. Le marchand, qui n’avait rien dit jusqu’alors, hasarda d’abord quelques mots en italien, puis en latin. Érasme le regardait tout surpris. Mais quel fut son étonnement quand, se tournant de son côté, l’étranger lui dit en style tout cicéronien : Vraiment je suis émerveillé qu’un homme comme vous consente à rester parmi des barbares, à moins que vous ne préfériez être seul ici plutôt que sans rival à Rome ! Érasme, flatté, fit le modeste, et bégaya quelques excuses qui n’eurent pas l’air de convaincre l’étranger. Le lendemain, il retournait chez Ammonio pour connaître le nom du personnage mystérieux. Ammonio le lui dit. Qu’on se peigne l’effroi du pauvre philosophe, qui tremblait en pensant qu’il aurait pu hasarder sur le ministre du pape et sur le pape lui-même quelque plaisanterie mordante, comme il aimait à en faire ; et alors que seraient devenus ses projets de dédicace à Sa Sainteté ? Voilà le négociateur dont Léon X avait fait choix. Canosse, aidé de Charles III, duc de Savoie, soutint les intérêts du pape avec autant de persévérance que de bonheur. Et d’abord, il réussit à faire garantir aux Médicis l’autorité qu’ils exerçaient à Florence. C’était un véritable succès pour le diplomate, car les Médicis, dans la querelle de François Ier avec le duc de Milan, s’étaient franchement déclarés pour Maximilien Sforce. Le plus beau triomphe peut-être que le légat obtint, c’est que les Bentivogli, ces ardents adversaires de Jules II, ne rentreraient pas dans Bologne, qui appartiendrait définitivement au saint-siège. Il fallait une compensation à François Ier, qui se montrait exigeant. On convint, après de longs débats, que le pape rappellerait les troupes de l’Eglise au service de l’empereur contre les Vénitiens, et remettrait à Sa Majesté très chrétienne les villes de Parme et de Plaisance. Le vainqueur ne s’oubliait pas. Ces deux conditions étaient sévères. La première exaltait l’orgueil des Vénitiens, la seconde détruisait en partie la belle œuvre de Jules II ; l’une affaiblissait les forces de l’allié du saint-siège, l’autre fixait les Français en Italie. Plus d’Alpes pour les étrangers ! Léon X refusa longtemps de ratifier le traité. La diète helvétique délibérait à Zurich sur la question de savoir si la Suisse ferait passer de nouveaux secours au duc de Milan déchu. Mathieu Schinner, à Inspruck, pressait de nouvelles levées ; l’empereur ne paraissait pas disposé à céder la Lombardie. On parlementa, on échangea des notes. A la fin, François, mécontent, menaça d’attaquer les Etats de l’Eglise et d’envahir la Toscane. Léon X céda. En apportant à Rome le traité qu’il venait de conclure avec François Ier, Canosse n’oublia pas de raconter au pape la déférence, le respect, l’amour pour le saint-siège, que n’avait cessé de montrer le monarque dans tout le cours des négociations. Ce n’était pas un rôle que jouait le roi de France, car il aimait autant qu’il admirait le caractère de Léon X. Le pape voulut remercier François Ier de ces témoignages de dévouement au saint-siège, dans une lettre où il relève, avec un bonheur infini d’expressions, les belles qualités que le ciel avait départies au jeune prince. C’est de l’adresse, si l’on veut, mais qu’on ne saurait blâmer. S’il lui parle en termes indirects de la victoire de Marignan, c’est pour en attribuer la gloire à Dieu, et pour le conjurer d’utiliser ce triomphe au bonheur de la grande république chrétienne. La lettre finit par un souhait tout cordial : Adieu ! aimez-nous ! Il y avait longtemps que les rois de France n’étaient accoutumés à un langage si plein d’affection : François Ier était bien fait pour le comprendre. Ce prince avait plus d’une fois, pendant le cours des négociations, témoigné le désir de traiter directement avec Sa Sainteté. Léon X consentit avec joie à l’entrevue demandée. Depuis plus d’un siècle, Rome sollicitait l’abrogation de cette pragmatique sanction qui livrait l’élection épiscopale à de capricieuses et funestes influences. Léon X espérait qu’il l’obtiendrait de François Ier. Brantôme a mis en relief, avec sa verve accoutumée de style, les périls que faisait courir à l’Eglise de France cette forme d’élection toute populaire. Le pis étoit, dit-il, quand les chapitres ou les couvents ne pouvoient s’accorder en leur choix, le plus souvent s’entre-battoient, se gourmoient à coups de poing, venoient aux braquemarts, et s’entre-blessoient, voire s’entre-tuoient..... Ils élisoient, le plus souvent, celui qui étoit le meilleur compagnon, qui aimoit plus les..... les chiens et les oiseaux, qui étoit le meilleur biberon ; bref, qui étoit le plus débauché..... Aucuns élisoient quelque simple bonhomme de moine, qui n’eust osé grouiller, ni commander, faire autre chose, sinon ce qui leur plaisoit, et le menaçoient s’il vouloit trop faire du galant et rogue supérieur. D’autres élisoient, par pitié, quelque pauvre hère de moine qui, en cachette, les déroboit, ou faisoit bourse à part, ou mourir de faim ses religieux. Certains évêques élevés et parvenus à ces grandes dignités, Dieu sait quelle vie ils menoient, une vie toute dissolue ; après chiens, oiseaux, fêtes, banquets, confréries, noces et..... dont ils en faisoient.......... Notre plume s’arrête, car les détails que donne ici l’historien sentent par trop le corps de garde : il dit tout ce qu’il sait, tout ce qui lui a été raconté, tout ce qu’il a vu peut-être. Léon X, qui poursuivait dans le concile de Latran l’œuvre de la réformation sacerdotale commencée par Jules II, ne pouvait laisser subsister une forme d’élection qui livrait le sanctuaire à d’aussi graves désordres : l’Eglise est une monarchie, et non point une république. L’entrevue devait avoir lieu à Bologne. François 1- n’aurait pas voulu de Rome, où le pontife eût effacé le monarque : le pape ne voulait pas de Florence, où le moindre trouble pouvait exposer la fidélité douteuse des républicains du jardin Ruccelaï. C’est Pâris de Grassi (Paride de’ Grassi), évêque de Pesaro, qui nous accompagnera dans ce voyage du pape de Rome à Bologne. Il était maître des cérémonies sous Jules II, qui plus d’une fois se permit de rire de la gravité doctorale que l’évêque mettait dans l’exercice de ses fonctions, et qui plus d’une fois encore osa lui désobéir. Pâris de Grassi avait trouvé dans Léon X un pape beaucoup plus docile, qui se prêtait avec une complaisance attentive aux exigences de l’étiquette, et qui se serait bien gardé de se brouiller avec son bon serviteur. Aussi l’évêque avait-il pour son souverain une admiration, un amour, un culte, qu’il témoigne à chaque instant dans son Diarium. Ce diarium est un journal où Pâris enregistre les événements grands ou petits qui se produisent autour de lui. Il fait une amère peinture de son prédécesseur Burchard, auquel il avait bien promis de ne pas ressembler, et il a tenu fort heureusement parole. C’est une belle âme, qui croit difficilement au mal, qui n’invente jamais, qui ne se cache pas derrière un paravent pour surprendre une confidence dont on fera bientôt un véritable roman ; à qui la médisance, la calomnie surtout, paraissent inconnues, et dont tout le rôle se borne à raconter ce qu’il a vu, jamais ce qu’on lui a dit ; et ce qu’il a ru, à ses yeux revêt toujours une forme solennelle. C’est l’homme des petites choses, un autre Penni, qui, dans une cérémonie, son bâton .a la main, met à ranger sur deux lignes mathématiques les membres du sacré collège toute la gravité que Jules II, son ancien maître, mettait à donner audience aux ambassadeurs de la république vénitienne ; écrivain, du reste, de petit style et aux longues phrases ; écolier de sixième fleurissant souvent sa narration de barbarismes et de solécismes ; évêque d’une régularité de mœurs parfaite ; favori qui n’employa jamais son crédit qu’à faire du bien. Le pape quitta Rome, dont il nomma gouverneur ou légat le cardinal Soderini, frère du gonfalonier qu’il avait rappelé de l’exil. Il emmenait vingt cardinaux, plus de trente prélats, ses camériers, une partie de sa maison. Sienne, que devait traverser le cortége, eut peur de tout ce monde qu’il lui fallait héberger et nourrir, et dépêcha un courrier à Sa Sainteté pour la prier de prendre un autre chemin. Jules II aurait fort final reçu sans doute un pareil message : Léon se contenta de changer de route. A Cortone ; Jules Passerini traita magnifiquement le pape. Des députés florentins étaient venus pour lui présenter leurs hommages. II arriva le 26 novembre à Marignolle, où il attendit, dans la maison de plaisance de Jacques Gianfiliazzi, que les préparatifs que Florence faisait pour recevoir le fils de Laurent le Magnifique, et qu’avaient interrompus les pluies, fussent entièrement achevés : heureuse visite, dont le propriétaire voulut éterniser le souvenir dans cette inscription latine, placée sur la chambre à coucher de Sa Sainteté : Dulets
et alta quies decimo pergrata Leoni Hic fuit ; hinc sacrum jam reor esse locum. Gianfiliazzi et ses fils, doctes latinistes, fêtaient dans Léon X l’humaniste beaucoup plus encore que le souverain. Florence s’était mise en frais pour recevoir son glorieux enfant. Les architectes, les peintres, les sculpteurs, les poètes s’étaient présentés en foule, jaloux de témoigner leur reconnaissance au prince éclairé qui régnait à Rome. Les architectes abattirent quelques pans d’anciennes murailles, afin que le cortége papal pût se déployer dans toute sa magnificence ; les humanistes imaginèrent toutes sortes de belles devises et d’inscriptions d’un style antique ; les poètes improvisèrent des canzone en latin et en français, que des chœurs de jeunes filles et de jeunes garçons devaient chanter sur le passage de Sa Sainteté. Jacques di Sandro et Baccio da Montelupo avaient sculpté sur un arc de triomphe divers traits d’histoire ; Julien del Tasso avait élevé sur la place Saint-Félix un autre ara que surmontait la statue de Laurent le Magnifique. San-Gallo, Baccio Bandinelli, François Granacci, se signalèrent par de beaux travaux. Jacques Sansovino avait fait le dessin d’un portail érigé devant Santa-Maria del Fiore, et sur lequel André del Sarto peignit en clair-obscur des sujets historiques. Depuis la mort de Savonarole, le paganisme a relevé la tête à Florence ; il règne dans les lettres et dans les arts. Cette belle école mystique qui venait des montagnes de l’Ombrie, et que le dominicain voulait introduire dans sa ville bien-aimée, n’a duré que quelques jours et s’est éteinte au souffle du naturalisme. Fra Bartolommeo, qui peut-être eût retardé le triomphe du sensualisme, va bientôt mourir. André del Sarto parlait aux yeux, séduisait les sens, et, au lieu de vierges tout idéales et tombées du ciel, peignait, sous le nom de Marie, des femmes dont l’original, reconnaissable à la première vue, habitait l’atelier du peintre. Toutes ces divinités, que Penni nous a décrites en racontant les cérémonies du couronnement de Léon X, se retrouvent sur le chemin que le pape parcourt, depuis la porte de Saint-Pierre Gatolini jusqu’à l’église de Santa-Maria del Fiore. Nous avons, de plus que dans le premier triomphe, un Hercule colossal que Baccio Bandinelli a élevé près des Loges, et un Romulus que Julien del Tasso a placé près du pont de la Sainte-Trinité. Léon X se montrait joyeux de ces témoignages ingénieux d’amour. Il s’arrêtait pour écouter les chants improvisés en son honneur, pour lire les inscriptions latines dont chaque arc triomphal était décoré, pour admirer les inspirations des peintres, des sculpteurs, des architectes ; pour contempler ces colonnes et ces obélisques, ces statues et ces trophées que Florence avait élevés à chaque pas. Quand il aperçut la statue de son père Laurent, il inclina la tête en signe de respect, et l’on vit couler ses larmes. Ses yeux s’étaient arrêtés avec une émotion indicible sur ces mots que portait le piédestal de la statue : Hic est filius meus dilectus. Le peuple, répandu dans les rues, sur des balcons improvisés, et jusque sur les toits, criait : Palle ! palle ! Le trésorier de Sa Sainteté jetait à la foule des pièces de monnaie. Le peuple aurait voulu, comme dans chaque grande cérémonie, saluer de salves d’artillerie le passage du cortége ; mais Pâris de Grassi avait sagement fait interdire ces bruyantes démonstrations de joie. Dans le récit qu’il nous a laissé de l’entrée de Léon X à Florence, on le voit, plus occupé que le héros de la fête lui-même, demander à Sa Sainteté la solution d’une foule de questions relatives au cérémonial, et à chacune desquelles il paraît que le pape répond avec sa grâce accoutumée. On avait oublié à Rome l’ombrelle antique qu’on portait au-dessus du souverain pontife. — Faut-il en commander une nouvelle, très saint-père ? Le pape incline la tête. Ita factum est, dit le maître des cérémonies. — Combien de torches devant le Saint-Sacrement, porté sous un baldaquin par les chanoines de la cathédrale ? Deux cents ? — Même signe. Et fuit contentus. Combien de valises en avant du cortège ? Cinquante au moins ? — Deux cents, dit le pape. — Faudra-t-il faire préparer pour le pape et les cardinaux une collation dans la seconde église où Sa Sainteté s’habillera ? — Léon X répond qu’il faudra consulter à cet égard les cardinaux. Le pauvre évêque de Pesaro fut un moment bien tourmenté. Le gonfalonier ne voulait pas céder le pas aux cardinaux ; le maître des cérémonies riait de cette prétention, que soutenaient énergiquement les prieurs. On fut obligé d’en appeler à Sa Sainteté, qui donna raison à de Grassi. Mais nos sénateurs s’obstinent et vont s’asseoir sur une estrade élevée à la porte de la cité, et, la toque sur la tête, regardent défiler les cardinaux qui vont au-devant du pontife. Le maître des cérémonies ne se déconcerte pas ; il a sa vengeance toute prête. En passant, les cardinaux avertis tiennent les yeux baissés, évitant soigneusement de regarder le balcon sénatorial ; et le gonfalonier et les prieurs,raconte orgueilleusement de Grassi, en furent pour leur vanité punie. Cependant le cortége était arrivé sur la place de la Cathédrale. A l’entrée de l’église, on avait construit une estrade qui s’étendait jusqu’au maître-autel. Le pape s’agenouilla, pria longtemps, bénit les assistants, et se retira dans le monastère de Santa-Maria Novella. Le lendemain, après avoir prié dans l’église de l’Annonciade, il alla visiter le palais de ses pères et embrasser Julien son frère, qui n’avait plus que peu de temps à vivre. II voulut, le premier dimanche de l’Avent, assister au saint sacrifice dans la chapelle des Médicis, dédiée à saint Laurent. L’office achevé, on le vit, les mains jointes, la tête baissée sur la poitrine, s’avancer silencieusement vers cette pierre qui recouvrait ce Laurent de Médicis, la gloire des lettres et de l’Italie, et pleurer au souvenir de ce père bien-aimé. A Cortone, parmi les citoyens que Florence avait envoyés au-devant de Sa Sainteté, Léon X remarqua particulièrement un homme jeune encore, de belle mine, qu’il avait vu deux ans auparavant à Rome. Il se rappela que, sur le refus de Bernard Ruccelaï, qui n’avait pas voulu complimenter le pape sur son exaltation, Guichardin s’était chargé de cette mission dont il s’était acquitté en véritable orateur. Il voulut le revoir à Florence, mais pour lui annoncer qu’il le nommait son avocat consistorial. C’était une belle conquête pour la papauté. Les tribulations du maître des cérémonies n’étalent pas finies. A Bologne, au lieu de ces figures de Florentins épanouies, Léon X ne trouva que des visages tristes. Point d’arcs de triomphe, de statues, de colonnes, d’inscriptions ; mais des rues mies et silencieuses. Si l’on entendait par de rares intervalles quelques cris, c’étaient les cris de : Serra ! serra ! que poussaient des enfants par allusion aux armes des Bentivogli. Pâris de Grassi s’était approché de Sa Sainteté, le visage renversé, et haussant les épaules en signe de tristesse : — Laissez donc, lui dit le pape, il faut les remercier, ils m’ont fait rire. Le pape arriva le 8 décembre à Bologne, et François Ier trois jours après. Les cardinaux attendaient le roi à la porte de Saint-Félix, en robes rouges. Le cardinal de Saint-Georges, évêque d’Ostie, l’ami d’Érasme, la tête découverte, harangua Sa Majesté. Pâris de Grassi avait eu bien soin de lire ce discours, dont il vante le naturel et la simplicité. Le roi, également découvert, répondit en quelques mots remplis d’affection envers Sa Sainteté, dont il se disait le fils soumis ; envers le siège apostolique, qu’il aimait d’un amour filial ; envers les cardinaux, qu’il regardait comme des pères et des frères. Le discours achevé, les cardinaux vinrent l’un après l’autre donner au roi le baiser fraternel. Pâris de Grassi lui disait à voix basse le nom de chacun des prélats. On entra dans Bologne, mais si confusément, que le maître des cérémonies en fut scandalisé : c’est à peine si on daignait l’écouter. Aussi, combien il se plaint des officiers de la suite de Sa Majesté et des princes eux-mêmes, qui marchaient à l’aventure ! Toutes les cloches de la ville étaient en branle ; les trompettes sonnaient des fanfares ; les cors, les tambourins mêlaient leurs bruits divers aux cris du peuple, que la pompe du cortége avait mis en joie. On avait préparé dans le palais un appartement magnifique pour Sa Majesté. Quatre cardinaux dînèrent à la table du roi. Le pape, revêtu de ses habits pontificaux, attendait le monarque dans la salle Diu consistoire, ce jour-là si pleine, qu’on craignit un moment qu’elle ne s’écroulât. Le roi marchait entre deux cardinaux, les plus anciens du sacré collège. La foule était si grande dans les appartements, qu’il resta longtemps comme emprisonné au milieu des flots mouvants des seigneurs italiens et français : il riait de sa mésaventure, tenant la main du maître des cérémonies, qu’il avait pris pour son introducteur. Pâris de Grassi, tout glorieux de cette marque royale de distinction, laisse échapper ici un mouvement de vanité bien pardonnable : Le roi, dit-il, et moi montâmes les marches du trône où le pape était assis. Le roi s’agenouilla, baisa la mule du pape, qui lui prit la main et lui présenta la joue. François Ier adressa au pape quelques chaleureuses paroles, auxquelles Léon X répondit dans un style dont il avait seul le secret, et qui, au témoignage de l’évêque de Pesaro, ce jour-là parut encore plus beau que de coutume. Au signe du maître des cérémonies, le roi prit place à la droite de Sa Sainteté, sur un siège magnifique ; son chancelier Duprat s’approcha, et, la tête découverte, prononça le discours d’obédience. A chaque formule d’hommage, l’évêque de Pesaro avait bien recommandé au roi de France de se découvrir, et le monarque se prêtait avec une docilité exemplaire aux prescriptions du cérémonial : le pape se montra moins exigeant que Pâris de Grassi, et pria François Ier de rester couvert. Le discours du chancelier est un manifeste en l’honneur du saint-siège, dont l’orateur proclame les titres à l’amour non moins qu’à la reconnaissance du royaume de France. C’est en même temps une profession de foi du roi très chrétien envers l’autorité du chef de l’Eglise. Il est beau d’entendre le vainqueur de Marignan s’écrier, par l’organe de son orateur officiel : Très saint-père, — l’armée du roi très chrétien est à vous, disposez-en à votre gré ; — les forces de la France sont à vous ; — ses étendards sont les vôtres. Léon, voici devant vous votre fils soumis, tuus è religione, tuus jure, tuus more majorum, tuus consuetudine, tuus fide, tuus voluntate. L’expression française ne rendrait qu’imparfaitement la valeur du mot latin. Ce fils dévoué, ajoute-t-il, est prêt à défendre en toute occasion vos droits sacrés, et par la parole et par l’épée. L’ombre de Jules II, qui sans doute assistait à cette entrevue, dut tressaillir de joie. Sadolet, lui, fut plus content du monarque que du chancelier, dont la parole manque souvent de cette belle simplicité qu’affectionnait le Modénais. La harangue terminée, le roi s’inclina en signe d’assentiment, et Léon X lui répondit en termes pleins de bienveillance. Il n’avait pas pris pour modèle l’orateur français. Il fut simple, suivant sa coutume, doux, harmonieux, cherchant par un soin peut-être trop curieux à éviter la rencontre de voyelles qui, en se heurtant l’une contre l’autre, font un bruit dont l’oreille est péniblement affectée. Sa Sainteté prit ensuite par la main François Ier, qu’elle conduisit jusqu’à l’appartement où elle devait quitter ses vêtements pontificaux. Le roi s’approcha de la fenêtre, où Léon X vint bientôt le trouver. Pâris de Grassi ne perdait pas de vue les deux souverains : il connaissait Léon X, et il avait peur qu’il ne tombât innocemment dans quelque faute contre le cérémonial romain. Aussi, dans la crainte que le pape ne portât la main à son bonnet, comme l’avait fait Alexandre VI lors de son entrevue avec Charles VIII, il s’approcha tout doucement de Sa Sainteté, et lui dit à l’oreille de bien prendre garde que le vicaire de Jésus-Christ sur la terre ne devait aucune déférence, même à un empereur : ce que Léon X observa fidèlement, ajoute l’évêque, du moins en ma présence. Le pape célébra le saint sacrifice en présence du roi, le 12 décembre, dans l’église de Sainte-Pétrone, où il se rendit processionnellement, précédé du monarque qui marchait au milieu de ses officiers. Quand le pape s’avança vers son trône pour revêtir les habits pontificaux, le roi voulut faire la fonction de caudataire, malgré la vive opposition du pape. Au moment où le pontife-prêtre montait les degrés du maître-autel pour commencer la messe, on vit le roi s’agenouiller et répondre tout bas aux prières du célébrant. Il avait refusé le fauteuil qu’on lui avait préparé. Il resta debout jusqu’à l’élévation, et prosterné, les mains jointes, jusqu’à la communion. La communion du célébrant, du diacre et du sous-diacre terminée, le pape demanda au roi s’il désirait s’approcher de la sainte table. Le roi répondit qu’il n’était pas en état de grâce, mais que plusieurs de ses officiers souhaitaient vivement recevoir le corps de Jésus-Christ de la main de son vicaire sur la terre. Quarante d’entre eux s’avancèrent dévotement vers l’autel ; et comme il n’y avait que trente hosties dans le saint ciboire, il fallut en rompre dix pour satisfaire la dévotion des assistants. « Cependant, dit la relation, ce n’était que la moindre partie des courtisans qui auraient voulu communier de la main de Sa Sainteté. » Le roi fut obligé d’écarter la foule et de ne laisser arriver à la sainte table que les plus illustres de ses officiers. Un d’eux, qui ne pouvait pénétrer jusqu’au célébrant, s’écria : Très saint-père, je serais bien heureux de communier de votre main ; tuais puisque ce bonheur m’est refusé, et que je ne puis lui dire à l’oreille les péchés que j’ai commis, je confesse tout haut que j’ai combattu et rudement Jules II, et que je ne me suis guère inquiété des censures fulminées par Sa Sainteté. — Et moi, dit le roi, j’ai péché comme lui. — Et nous aussi, dirent plusieurs seigneurs ; pardon, très saint-père. Le pape leva la main et leur donna l’absolution. Le roi reprit la parole, et, avec une franchise peut-être trop militaire, dit tout haut : Très saint-père, ne soyez pas surpris que tous ces gens aient été ennemis du pape Jules ; car c’était bien le plus grand de nos adversaires, et one n’avons connu homme plus terrible dans les combats. A vrai dire, il eût été mieux capitaine d’une armée que pape de Rome. Le lendemain, le roi touchait un grand nombre de malades, après avoir communié dans l’église des Dominicains. |