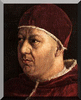HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XXII. — LE GYMNASE ROMAIN. - 1515.
|
Services rendus par
Nicolas V à l’enseignement. - Léon X forme le projet d’agrandir le gymnase
romain. - Règlements anciens introduits dans les universités italiennes. - Le
pape appelle à Rome des professeurs illustres. - Parrasio, Bottigella,
Démétrius Chalcondyle, Favorino, Scipion Fortiguerra. - Encouragements de
toute sorte qu’il prodigue aux maîtres du gymnase. - Ses libéralités à leur
égard. - Chaire spéciale qu’il affecte à l’enseignement de la botanique
appliquée à la médecine dans l’intérêt des pauvres. Depuis un siècle, c’est-à-dire depuis le moment où les lettres commencèrent à donner quelque signe de vie en Italie, la papauté avait formé le projet de restituer à Rome ses collèges littéraires. Eugène IV fit jeter, au milieu de la ville, près de l’église de Saint-Jacques-l’Apôtre, les fondements d’un gymnase où des maîtres habiles devaient enseigner gratuitement les sciences humaines. Nicolas V est une des gloires de son siècle. C’était aux lettres qu’il devait la tiare : il les honora magnifiquement. A Laurent Valla, qui lui avait offert sa traduction de Thucydide, il donna 500 écus d’or ; à Giannozzo Manetti, pour des œuvres de théologie, une pension de 600 écus d’or : à Guarino, pour la traduction de Strabon, 1,500 écus d’or ; à François Filelfe, qui voulait mettre en vers latins l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, il avait promis une belle maison à Rome, une ferme à la campagne, et 10.000 écus d’or qu’il avait déposés chez un banquier, et que le poète devait toucher dès que sa version serait terminée. C’est à l’instigation de ce pontife que Diodore de Sicile, Xénophon, Polybe, Thucydide, Hérodote, Strabon, Aristote, Ptolémée, Platon, Théophraste et un grand nombre de Pères furent traduits en latin. Les lettres, sous le règne de ce prince, donnaient de la gloire et des richesses : aussi Rome était-elle remplie d’humanistes venus des quatre parties du monde. Quand on ouvre un livre écrit à cette époque, on est sûr d’y trouver le nom de picolas V. Poggio, Georges de Trébisonde, Léonard Bruni, Antoine Loschi, Barthélemy da Monte Pulciano, Jean Tortelli, Laurent Valla, Giannozzo Manetti, Nicolas Perotti, François Filelfe, Pierre-Candide Decembrio, Théodore Gaza, Jean Aurispa, ont célébré en vers et en prose la protection que ce grand homme accordait aux savants ; mais nul ne lui a décerné un plus brillant hommage que le protestant Isaac Casaubon, qui le représente levant l’étendard de la science au moment où elle paraissait à jamais ensevelie sous les ruines de Byzance, chassant les ténèbres qui menaçaient le monde, et faisant luire à Rome la lumière des arts et des lettres. Sous le règne de Pie II, des professeurs illustres occupèrent les diverses chaires du gymnase romain. Sixte IV, qui n’avait que 100 écus à donner au traducteur d’Aristote, Théodore Gaza, ne put dépenser qu’une modique somme à l’entretien de cette belle école. Plus heureux, Alexandre VI, cet habile administrateur qui, pendant son pontificat, eut pour principe de payer exactement la pension des docteurs, la solde du soldat, le salaire des ouvriers, agrandit et dota splendidement le gymnase. Jules Il, au milieu de ses sollicitudes guerrières, n’oublia pas l’œuvre de ses prédécesseurs, et, bien loin de détourner, comme le dit Roscoë, les revenus affectés par Alexandre VI à l’entretien de l’université, il donna l’ordre, dans sa bulle de 1512, que certains revenus du Capitole fussent rigoureusement employés aux besoins du gymnase, et assigna 50 ducats d’or pour la célébration annuelle de la fête dei Palilj, ou de l’anniversaire de la fondation de Rome, le 21 avril. Léon X voulut que l’université romaine égalât en splendeur celles que l’Italie citait avec le plus d’orgueil : Pavie, Milan, Bologne, et que Rome régnât sur le monde entier par les lettres comme elle régnait par les arts. Middendorp, dans un livre savant, a donné quelques-uns des règlements que ce pape et ses prédécesseurs firent établir dans l’université romaine. Le gymnase romain était sous le patronage de trois cardinaux, de l’ordre des évêques, de l’ordre des prêtres et de l’ordre des diacres. Il y avait des recteurs et des réformateurs qui, après avoir consulté le pape, étaient chargés du choix des professeurs. Les réformateurs visitaient les classes deux fois par semaine ; le recteur, une ou deux fois par mois, et toujours à des heures et à des jours inconnus. Le recteur administrait les deniers et payait lés professeurs et les bidelli. Les bidelli (appariteurs) étaient des employés chargés de la police matérielle des classes ; ils affichaient à la porte du gymnase le nom des professeurs, l’heure et le jour des leçons. On ne pouvait lire, expliquer au collège aucun ouvrage dont le titre n’eût été préalablement affiché par le bidellus sur les murs de l’école. Dès le XIIIe siècle, l’enseignement était libre et gratuit en Italie ; il était même permis aux élèves de faire des cours, et on leur donnait à cet effet une salle et une chaire. Afin d’attirer les étrangers, on offrait aux étudiants des franchises et des privilèges. D’abord, ils jouissaient de toute espèce de droits de cité ; ils n’étaient assujettis à aucune taxe et ne pouvaient être mis en prison. A Padoue, la ville était obligée de prêter de l’argent aux écoliers qui n’avaient pas de quoi étudier. Le professeur entretenu par la ville pouvait donner des leçons particulières ; mais, s’il se faisait paver, il était sur-le-champ rayé du rôle de l’université. A Naples, au XIIIe siècle, l’université avait des privilèges exorbitants : le maître et les écoliers ne pouvaient être jugés que par un tribunal spécial, formé d’un président et de trois assesseurs. Les papes se distinguent, à cette époque, par la protection qu’ils accordent il l’étude des lettres. Au concile général qui se tint à Lyon en 1245, Innocent IV veut que dans chaque cathédrale, dans chaque église possédant des revenus suffisants, l’évêque et le chapitre nomment un maître pour enseigner gratuitement la grammaire aux enfants pauvres, et qu’au maître soit concédée une prébende dont il jouira tout le temps qu’if exercera les fonctions de pédagogue. Renazzi a publié un document qui prouve qu’en 1319 les élèves en droit canon de l’université de Rome firent casser une élection et nommer le professeur qu’ils avaient choisi. De même, dit un ancien programme universitaire qu’il est dans la maison du Père céleste diverses demeures, plurimæ mansiones, ainsi dans chaque académie une, hiérarchie scolaire : le docteur, le juriste, le professeur. Le docteur a le titre de nobilissimus, le juriste de dominus. S’il est certain que contrister un docteur c’est contrister Dieu, il ne l’est pas moins, dit un autre écrivain, que le docteur qui remplit fidèlement les devoirs de sa charge brillera comme une étoile dans l’éternité. La même gloire est promise au professeur qui fait régulièrement ses leçons ; lui aussi a de graves obligations à remplir. Il ne faut pas qu’il se mêle de choses mondaines et que le marché public entende jamais prononcer son nom : c’est l’homme de la science, qu’il doit distribuer et ne jamais vendre. Sa leçon terminée, tout n’est pas fini pour lui ; il faut qu’il reste encore en chaire pour disputer, causâ disputandi ; pour répondre aux questions que peut lui adresser un écolier qui, à défaut d’obscurités dans un texte, en trouve peut-être ailleurs dont il attend la solution. Le professeur qui, sans motifs raisonnables, négligera de faire sa leçon, outre la responsabilité qu’il encourt devant Dieu, sera puni d’une amende et verra son nom affiché sur les murs de l’école. Le tableau de l’université de Rome, en 1544, existe encore aujourd’hui, écrit sur vélin, en beaux caractères, orné des armes du pape et de figures allégoriques. La Théologie y est représentée avec la double figure de Janus, comme Raphaël a peint la Prudence dans une des chambres du Vatican. Léon X voulut qu’on enseignât, au collège romain, la théologie, le droit canon, le droit civil, la médecine, la philosophie, la botanique, la philosophie morale, la rhétorique, la grammaire, la langue grecque. Sur le tableau dont nous parlons, à côté du nom de chaque professeur est indiquée la somme qu’il reçoit annuellement. Maître Luca de Burgo a 120 florins pour enseigner les mathématiques ; Varino, professeur de grec, 300 florins ; maître Augustin de Sessa, professeur de philosophie, 300 florins. Ce sont les médecins qui sont les mieux rétribués. Maître Archangelo de Sienne a 530, et maître Scipion Lancelloti, 500 florins. Nous savons, grâce à ce curieux document, qu’un professeur de grammaire, espèce d’instituteur primaire, gagnait 50 florins par an, et il y en avait treize, autant que Rome avait de quartiers. Le recteur touchait 100 ducats d’or ; chacun des réformateurs, la même somme ; le bidellus, 100 florins ; enfin le sonneur, 25 florins. C’est le 3 novembre que les cours et les écoles s’ouvraient. Il y avait des leçons le matin, de mane, et le soir, de sero, même les jours de fête. Pandolphe Volfgang, qui professait le droit à Padoue, avait fait un grand bruit en posant, dans une de ses leçons, cette question : Est-il permis de lire, d’écrire, d’étudier les jours de fête ? et il l’avait affirmativement résolue. La question était restée indécise ; Léon, comme on voit, la trancha pour toujours. Chaque science avait plusieurs maîtres ou lecteurs : la rhétorique était enseignée, le matin, par six professeurs ; le soir, par cinq ; les jours de fête, le matin, par trois ; le soir, par quatre. Il n’y avait pas moins de onze professeurs de droit canon, de vingt professeurs de droit civil, de quinze professeurs de médecine, de cinq professeurs de philosophie morale. Dans sa bulle du 19 décembre 1513, Apostolici regiminis, Léon X recommandait aux élèves de s’adonner désormais aux études sérieuses, et de renoncer à cette philosophie mensongère nommée le platonisme, et à cette folle poésie, qui n’étaient propres qu’à gâter l’âme. On voit si nous avions raison de vanter la sollicitude de ce pontife pour les saintes lettres. Tous les professeurs choisis par Léon X étaient non seulement des savants distingués, mais des hommes de vie exemplaire. Le pape, en les appelant à lui, leur disait qu’il en faisait des précepteurs de vertus et de bonnes mœurs plus encore que de belles-lettres, et qu’il leur remettait la charge d’enseigner et de défendre la vérité, c’est-à-dire la religion du Christ, les libertés de l’Église, l’autorité du saint-siège : grande et noble mission, à laquelle nul d’entre eux ne faillit. Voyons si ces maîtres méritaient la confiance du prince. Nous connaissons Inghirami, un des habitués des jardins de Sadolet. Nommé professeur de rhétorique, il n’occupa que peu de temps cette chaire ; Philippe Béroalde lui succéda. Parrasio (Joannes Paulus Parisius), qui lisait le soir, attirait à Rome, comme autrefois à Milan, un grand nombre d’auditeurs : à Milan, Trivulce venait l’écouter, et s’en allait émerveillé de la belle prononciation du professeur. Léon X, qui connaissait la réputation dont Parrasio jouissait en Italie, voulut l’attacher au gymnase, et lui offrit 200 ducats par an : Venez le plus vite que vous pourrez, lui disait-il, je vous recevrai cordialement. La lettre était écrite en beau style, et la phrase merveilleusement cadencée ; car le pape savait qu’il fallait flatter d’abord l’oreille exigeante du docteur. Parrasio laissa son auditoire de Milan, son écolier de cinquante ans, et vint à Rome, où bientôt ses leçons sur les Sylves de Stace attirèrent une foule d’auditeurs. Il dut quitter une ville où il s’était fait d’implacables ennemis. Il paraît qu’il avait un penchant décidé pour la médisance, et qu’il maniait l’épigramme avec une grande habileté. On ne l’épargna pas non plus, et le brillant professeur se changea, sous la plume de ses ennemis, en âne d’Arcadie, en scarabée fétide, et même en vipère au dard acéré. Il est probable que l’apparition de Trivulce aux leçons de Parrasio fut le seul motif des injures adressées au professeur. A Rome, du moins, l’humaniste n’eut pas à craindre ces quolibets de mauvais goût. Léon X exerçait une heureuse influence jusque sur les mœurs littéraires de sa cour : elle était habitée par tout ce qu’il y avait de plus poli au monde, et Bembo, Sadolet, Bibbiena, contribuaient, à l’école de leur maître, à relever l’état d’homme de lettres, qui jusqu’alors n’avait été trop souvent qu’un métier. Le pape voulait que les sciences fissent vivre honorablement ceux qui les cultivaient. Parrasio, un peu fastueux de sa nature, recevait par an 200 écus d’or. Il avait, comme les autres professeurs, ses entrées au Vatican, sa place dans toutes les grandes cérémonies, quelquefois la visite inattendue du pontife, des présents à certains anniversaires, puis l’usage de tous les livres de la bibliothèque pontificale. Le professeur tomba malade, perdit la santé, et ne put plus monter en chaire. Mais qu’avait-il besoin de s’inquiéter de l’avenir ? Léon, dans un de motu proprio, lui assigna une pension de vingt ducats d’or par mois, réversible sur Théodora, la fille de Démétrius Chalcondyle, que le professeur avait épousée. Le bref, écrit par Sadolet, est lui-même un titre de gloire pour Parrasio. Bottigella (Jérôme), qui ne professa le droit que peu de temps, avait la réputation d’un habile juriste. Il sortait de Pavie, où sa mémoire était citée comme un prodige. Il savait par cœur le livre XII du Digeste, une partie du Codex, le IVe livre des Décrétales, les Églogues de Virgile, le VIe livre de l’Énéide, Ovide, Valère Maxime, le VIe livre de l’Histoire Naturelle de Pline, et de sa chaire il jetait toutes sortes de superbes défis aux assistants, auxquels il était prêt à répondre, disait-il, sur le cycle entier des doctrines enfermées dans ces œuvres diverses. C’est assez dire qu’il était théologien, juriste, canoniste, philosophe, naturaliste, poète, historien. Camille Porzio, un des hôtes encore de Sadolet, professait la rhétorique, mais les jours de fête seulement, probablement à cause de cette fièvre qu’il avait gagnée au travail, et qui devait le conduire si vite au tombeau. Il s’était fait aimer de ses élèves, qui pleurèrent en le perdant un ami plutôt qu’un maître. Valeriano (Bolzani), dans cette belle élégie qui a pour titre : Des malheurs des lettrés, a jeté des fleurs sur la tombe de son ami, qui mérita les éloges de Bembo et de Sadolet. Léon X avait compris que, sans l’étude des Pères de l’Orient, le mouvement qu’il voulait imprimer aux sciences théologiques languirait nécessairement. Le gymnase romain eut donc trois professeurs de grec : Augustin Valdo, Basile Chalcondyle et Varino Favorino ; chacun d’eux recevait par an trois cents florins d’or. Démétrius Chalcondyle, le père de Basile, n’en avait que 40, en 1463, à l’université de Padoue ; et Musurus 140, en 1508. Augustin Valdo, ou Baldo de Padoue, ami de Bembo, parlait avec tant de pureté la langue grecque, que plus d’un Hellène, en l’écoutant, se trompait et croyait entendre un compatriote. Basile Chalcondyle promettait d’être une des gloires de la littérature grecque, quand la mort vint le surprendre au milieu de ses livres. Varino, ou Guarino, était élève de Politien, et passait pour l’un des plus grands humanistes de son siècle. En 1495, il enseignait à Florence les grammaires grecque et latine à soixante-cinq florins d’or par an. En parcourant la liste des professeurs du gymnase romain, on est frappé des choix heureux de Léon X. Presque tous les maîtres ont fait leurs preuves dans les universités italiennes ; tous ont étudié sous des hommes habiles ; tous ont en la passion des voyages ; tous ont vu, comme le héros d’Homère, beaucoup d’hommes et beaucoup de cités. Il faut donc les acheter chèrement ; car le pape ne marchande pas, il sait payer la gloire. S’ils résistent à ses offres, il a des tentations auxquelles ils succombent ordinairement ; il leur écrit, comme à Leoniceno, une lettre bien tendre, bien pressante, en quelques lignes où le même mot je vous aime est répété à satiété ; il faut bien que le professeur parte, et dise adieu à ses élèves, à sa patrie, à ses parents. S’obstine-t-il ; alors le pape s’adresse à Sadolet, qui a sa vengeance toute prête : quelques bons bénéfices dont il tient la feuille. S’il cède, des honneurs de toute sorte l’attendent à Rome. Scipion Fortiguerra de Pistoie, si connu dans le monde lettré sous le nom de Carteromachus, est chargé de compléter l’éducation de Jules de Médicis, désigné par le pape pour remplir le siège vacant de Florence. Spagnuoli (le Mantouan), qui assistait au concile de Latran, va représenter dans divers États la cour de Rome. Ce n’est pas la première fois qu’il aura pris fantaisie au pape d’habiller un poète en diplomate ; Valeriano a donc tort de se plaindre du sort des gens de lettres. Poète lui aussi, il dut remplir par l’ordre du chef de l’Église diverses ambassades, et il s’en acquitta à la satisfaction de son maître. Favorino, dont nous parlions tout à l’heure, l’auteur du Thesaurus Cornucopiæ, et Horti Adonidis, recueil alphabétique de règles grammaticales auquel Manuce avait travaillé, reçut d’abord de Léon X le titre de bibliothécaire, puis celui d’évêque de Nocera, dont il avait été nommé archidiacre par Jules Il. La mitre était une juste récompense décernée aux travaux et aux vertus de l’humaniste, qui gouverna dignement son église. Quand Favorino avait dit l’âge d’un manuscrit, Bembo s’inclinait respectueusement ; quand il avait prononcé sur une question littéraire, Sadolet se taisait ; quand il recommandait un sujet à la bienveillance du saint-siège, Léon X faisait expédier, le lendemain même, le bref sollicité. C’est ainsi que Jean-Marie Varani reçut la couronne ducale quelques jours après que Favorino l’eut demandée au pontife. Le savant, à son tour, professait pour le pape une sorte de culte. Dans la préface de sa traduction latine des apophtegmes grecs recueillis par Jean Stobeo, et qu’il dédia à Sa Sainteté, ce n’est pas seulement son livre, ses livres passés, ses livres à venir qu’il offre au pape, mais son corps et son âme. Quand le prince ne peut donner des manuscrits, des statuettes, des tableaux, une mitre, un chapeau rouge, une couronne ducale, il fait cadeau à l’un de ses protégés, professeur à Rome, d’un terrain, où bientôt s’élève une maison élégante sur le fronton de laquelle on lit : Leonis
X, Pont. Maxim. liberalitate, Jacobus
Brixianus Chirurgus Ædificavit Au gymnase romain étaient diverses chaires de médecine ois montèrent des praticiens distingués, Barthélemi de Pisis et Jérôme Eugubio, qui, brouillés un moment et divisés sur quelques points de doctrine, en appelèrent au jugement du monde savant. Attentif au mouvement de la science médicale, et suivant l’exemple de ses ancêtres, Léon X fit venir à Rome les grandes célébrités qui brillaient en Italie. C’est ainsi qu’il s’attacha Bernardino Speroni, lecteur extraordinaire à l’université de Padoue, et Jérôme Sessas, que Paul IV, plus tard, voulut inutilement décorer de la pourpre romaine, que le médecin refusa pour achever en paix son petit livre ascétique : Columba decora. Dans le programme des cours du gymnase nous trouvons une chaire spécialement affectée à l’enseignement de la vertu des simples, ou de ce qu’on nommait la medicina erbaria. Côme Ier, grand-duc de Toscane, fut un des plus ardents protecteurs des sciences botaniques. Par ses ordres, des naturalistes parcoururent les montagnes de la Toscane, les campagnes de Rome, les collines de l’Etna et du Vésuve, cherchant partout à compléter la flore médicale de l’Étrurie. Non content de fonder pour la propagation des plantes sanitaires un jardin près du couvent de Saint-Marc, où plus d’une fois nous avons surpris en prières le frère Savonarole, il s’était mis à étudier le règne végétal avec tant de succès, qu’il consigna dans un livre écrit de sa main les propriétés de quelques-unes des plantes dont il avait expérimenté les vertus. C’est une heureuse idée dont il faut remercier la papauté, que la fondation au collège de la Sapience d’une chaire de botanique appliquée à la médecine, la première dont s’honore l’Italie. Pendant que le professeur étudiait, dans l’intérêt de l’humanité, les vertus de ces plantes dont Dieu para nos champs, des officines s’élevaient à Rome, où le pauvre venait chercher des remèdes qu’on lui délivrait gratuitement. La papauté avait fait quelque chose de plus admirable encore dans le treizième siècle. Quand ces gantelets de fer, ces grands seigneurs feudataires du Saint-Empire, opprimaient leurs vassaux, Rome chrétienne ne se contentait pas de s’interposer entre le maître et l’esclave ; après avoir sauvé la liberté humaine, l’âme, c’est-à-dire, elle cherchait à guérir le corps, et l’un de ses pontifes, Jean XXI, écrivait, sous le nom de Trésor des Pauvres, un petit livre où l’artisan, l’ouvrier, l’homme du peuple, apprenaient, à l’aide de quelques recettes simples, faciles et peu coûteuses, à se délivrer des maladies dont Dieu les visite dans cette vie. |