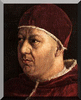HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XX. — LE CONCILE DE LATRAN. - LA PRESSE.
|
Les manuscrits au
moyen-âge. - Difficultés de la science. - Susceptibilité et orgueil de
l’humaniste. - Quelques exemples de querelles littéraires de la renaissance.
- Politien et Mabile, Galeotto et Merula. - La presse ne respecte rien ; elle
attaque jusqu’à la royauté, que Pontano joue dans un de ses dialogues. -
Réflexions sur cette polémique. - On ne saurait nier les services rendus à
l’imprimerie par la papauté. - Ce que de’ Russi fit à Rome pour les ouvriers
typographes. - Plaintes élevées de tontes parts contre les abus de la presse.
- Dangers dont elle menace la société. - Le concile de Latran prend des
mesures pour que le repos de la chrétienté ne soit pas troublé ; mesures
religieuses et sociales. - Décret de Léon X. C’est un rude métier, au moyen-âge, que celui des lettres ; l’apprentissage en est aussi long que difficile. L’imprimerie, qui vient de naître en Allemagne, ne reproduit que lentement encore les chefs-d’œuvre de l’antiquité ; il faut donc chercher dans les manuscrits les procédés syntactiques des langues anciennes. Or, c’est déjà une étude fastidieuse que d’apprendre à. déchiffrer cette écriture monacale, hérissée de signes dont le religieux avait emporté le secret ; puis ces manuscrits sont aussi rares que coûteux. En 1300, la bibliothèque d’Oxford était enfermée tout entière dans un coffre que le chapitre de l’église de Sainte-Marie tenait sous clef ; celle de Paris, au commencement du XIVe siècle, ne possédait que trois écrivains classiques : Cicéron, Ovide et Lucain. Louis, électeur palatin, en 1421, léguait comme un trésor à l’université de Heidelberg sa bibliothèque, composée de cent cinquante-deux volumes, dont trente- neuf sur la théologie, douze sur le droit canon, quarante-cinq sur la médecine, et six sur la philosophie. On comprend le haut prix qu’on devait mettre aux manuscrits. Beccatelli de Palerme, pour acheter un Tite-Live de la main de Pogio, fut obligé de vendre une terre patrimoniale. Jean Manzini se moque d’un savant nommé Andreolo de rachis, qui, pour accroître ses richesses bibliographiques, disait sérieusement qu’il vendrait sa maison et sa femme. Richard de Bary, chancelier d’Angleterre sous Édouard III, donna à l’abbé de Saint-Alban cinquante livres d’argent pour trente à quarante volumes. Jugez de la douleur d’un pauvre enfant qui voit passer dans les mains d’un banquier des livres dont ses épargnes d’une année ne payeraient pas un feuillet ! Les Fugger d’Augsbourg, dont Luther a plus d’une fois maudit l’opulence, possédaient une bibliothèque où, suivant Wolf, les manuscrits brillaient en aussi grand nombre que les étoiles au ciel. Malheureusement ils les prêtaient comme leur argent, à gros intérêts : il fallait être un prince de la science pour pénétrer dans leur bibliothèque, et au moins un duc pour entrer dans leur comptoir. Ils enfermaient sous clef le pain des intelligences ! En vain on frapperait à leur porte, ils n’en donneraient pas une miette. Quelquefois il arrive qu’une âme qui a scandalisé le monde par ses débordements a besoin de ferventes prières ; alors, au moment de mourir, elle fait don à quelque abbaye d’un manuscrit orné de lettres d’or. L’héritier se présente à la grille du monastère, le trésor du défunt à la main : les pères, au son des cloches, viennent recevoir le manuscrit comme ils recevraient un monarque, et l’emportent processionnellement dans leur bibliothèque. Sans ces moines, dont la réforme s’est si souvent moquée, le monde serait resté plongé bien longtemps encore dans les ténèbres, et peut-être que Luther lui-même, qui les immola si cruellement à la risée publique dans ses Propos de table, n’aurait pas trouvé cette Bible latine dont la vue remplit ses veux de larmes. Mais les Fumer allemands et italiens se sont laissé attendrir, et ont eu pitié du pauvre Lazare qui, assis dans leur bibliothèque, en dévore de l’œil tous les trésors ; les frères du couvent, plus charitables encore, ont fait copier pour lui des panes entières d’un codex inédit de l’Iliade. Ne croyez pas que l’épreuve à laquelle est soumise toute intelligence qui veut entrer en communion avec l’antiquité soit terminée : la science ressemble au paradis de Dante, pour y arriver il faut traverser plusieurs cercles. D’abord les dictionnaires existent à peine ; qu’on juge du désespoir, de la souffrance de cet enfant qui, à force d’étude, est parvenu à déchiffrer les signes et peut-être le sens d’une page du divin poème, et qui se voit arrêté tout à coup par un vocable dont la racine est une énigme pour lui ! S’il habite Florence, il ira consulter sans doute quelques-uns des doctes chanoines de la cathédrale qui ont traversé heureusement tous ces limbes où il se trouve emprisonné ; mais demain, en tournant le second feuillet de son manuscrit, il retombera dans les mêmes ténèbres, et il aura besoin pour en sortir du même ange libérateur. Que de mots ainsi, dans un long poème, dont il lui faudra, par des travaux de jour et de nuit, conquérir le sens caché ! Ce n’est pas seulement l’intelligence qui sera chez lui tourmentée : esprit et matière souffriront également ; trop heureux s’il ne laisse pas son âme et son corps à cet autre sphinx qu’on nomme la science. Combien nous sommes heureux aujourd’hui ! Qu’un mot arrête un écolier du XIXe siècle ; assis sur son banc, il trouve à ses côtés un maître muet, mais docile, complaisant, jamais embarrassé ni colère, qui lui donne non seulement les mille acceptions d’une expression, mais souvent le sens d’une phrase tout entière. Presque pas de grammaires non plus où l’élève autrefois pût étudier les règles d’une langue. Otez le rudiment et le lexique, auxiliaires indispensables de quiconque veut connaître les secrets d’un idiome mort ou perdu, qui donc aujourd’hui serait assez courageux pour en affronter les insurmontables difficultés ? L’écolier, au moyen-âge, ressemble assez au voyageur qui s’essayerait sans guide sur les glaciers de la Suisse. Et cependant l’enfant ne perd pas courage : comme le poète d’Ausone, il n’attend pas que l’hirondelle vienne frapper aux vitres de sa chambrette ; il se lève avec le soleil, et, le poème antique sous les yeux, il compare, il note, il assemble, il sépare ; et un beau jour, après des labeurs inouïs, il parvient à se rendre maître de son auteur. Il sait la valeur de tous les mots enfermés dans un chant du Rapsode, et ce chant, c’est Isomère tout entier. Entendre une langue, à cette époque, ce n’est pas en lire couramment les signes ; c’est, au besoin, les reproduire. Et voilà le lauréat qui, lui aussi, se met à chanter en grec et en latin. Ainsi faisaient Ficin, Pic de la Mirandole, Benivieni, Politien, Pontano, Sadolet, Bembo. Mais tout n’est pas fini. Pour être quelque chose dans le monde de l’humaniste, il faut y représenter une triple vie, comme on dit alors ; c’est-à-dire penser, converser, écrire en grec, en latin et en hébreu, et à ces trois langues ajouter des notions sur la physique d’Aristote, la philosophie de Platon, la cabale judaïque, la scolastique et les livres saints. Et, maintenant, ne pardonnerons-nous pas un peu de gloriole à ce laborieux ouvrier qui, comme la fourmi, a formé grain à grain ses provisions de toute la vie ? S’il est riche à son tour, il ne doit rien à personne ; sa fortune est bien acquise, et il a droit d’en être fier : malheur donc à qui oserait y toucher ! Tout ce qu’il acquiert devient or : qu’on n’essaye pas de dénigrer ou de ravir ses trésors, il ne souffre pas plus la médisance que le vol. Il a l’épigramme, le dialogue, l’épître, pour châtier ses adversaires ou ses spoliateurs, qu’ils portent tiare, diadème, hermine ou épée. Dante plongeait ses ennemis dans les flammes éternelles ; le savant de la renaissance n’attend pas l’autre vie pour les tourmenter. Nous connaissons Politien, cet écrivain aux mœurs élégantes de la cour du Magnifique. Il semble qu’un poète qui cherche pour s’inspirer les solitudes de Careggi ; dont l’habitation rurale à Fiesole est enlacée dans des haies de chèvrefeuille et d’aubépine ; qui, au retour des champs, apporte dans sa demeure de Florence toutes sortes de fleurs odorantes ; si parfois il lui arrive de se fâcher, n’aura que de belles colères. Nous allons voir. Sa gloire, et peut-être plus encore l’amitié que lui portait Laurent le Magnifique, blessait au cœur une foule de rivaux qui, voulant à tout prix faire du scandale, se jetaient sur lui comme autant de frelons. Le plus acharné de ces insectes se nomme Mabile, Mabilius. D’abord Angiolo ne veut pas démentir le nom qu’il porte ; il souffre en silence : sa patience est prise pour de la peur ; les bourdonnements continuent et les morsures aussi. Alors l’ange du ciel devient un véritable démon. Luther lui-même, nous le confessons sincèrement, avec son prodigieux talent pour la caricature, n’a jamais fait un moine semblable à l’être créé par Politien, et nous doutons que Dieu ait lui-même réuni dans un seul individu les difformités physiques imaginées par le rhéteur. Ses cheveux crasseux distillent l’oing ; Sa tête est la demeure de vers cadavériques ; sa barbe est rongée par les teignes et d’autres insectes qui y prennent leurs ébats ; ses narines sont couvertes d’une forêt de poils qui étendent sur le menton du malheureux leurs filaments polypeux... Nous n’avons pas la prétention de reproduire dans tous ses détails la peinture de Politien. Nous voudrions, pour l’honneur du rhéteur, que l’épigramme fût restée inédite ; mais il s’en fait gloire comme de l’une de ses plus belles sylves, et la montre à tous ceux qui se rassemblent chez son protecteur. Laurent en rit comme tous les autres. Nous pensions que Mabile allait se cacher : il se montre et cherche à se venger, non point en calomniant cette belle figure que le ciel avait donnée à Politien, mais en le transformant en geai qui vole les plumes du paon, en plagiaire éhonté qui s’approprie la version latine d’Hérodien composée par Tiphernas. Sa fiction, au reste, valait peut-être mieux que celle de son rival, car elle obtint un grand crédit dans le inonde littéraire. Après l’image physique vient le portrait moral de Mabile, et ici Politien parle une langue qu’on n’aurait point osé employer aux soupers de Trimalcion. Si Boileau avait lu l’épigramme, il aurait compris que le latin lui-même peut offenser l’oreille. Nous ne savons pas si Mabile continua sa polémique avec Politien : de nos jours, ce n’est pas avec de l’encre que se laveraient de semblables outrages. Et ce qu’il y a de plus douloureux, c’est que la calomnie ne se tait pas même quand l’humaniste n’est plus ; elle est là, assistant aux derniers moments du moribond, le suivant à l’église, au cimetière, et mêlant ses invectives obscènes aux chants des prêtres, aux prières des fidèles, aux pleurs de toute une ville ; puis, quand une pelletée de terre a été jetée sur la bière du défunt, elle cherche et trouve un imprimeur qui consent à salir un blanc papier de Venise de cette boue fétide. Arrive la postérité, qui, feuilletant le livre, juge le mort d’après l’arrêt posthume qu’a formulé une colère sacrilège. Encore si ces haines entre lettrés avaient été provoquées par quelque grave offense ! Mais, à cette époque de vanités fiévreuses, un mot suffit pour allumer une guerre qui coûte aux deux adversaires des flots d’une encre corrosive. Fifelfe reprend son élève d’avoir imprimé Turcos au lieu de Turcas ; l’élève s’emporte, et se met à écrire contre son maître deux sanglantes épîtres. Galeotto Marzio avait publié, en 1468, un traité de Homine, œuvre de moraliste et de médecin. Merula, professeur à Milan, lit le livre, et se permet de discuter certaines doctrines de l’auteur. Galeotto veut défendre son ouvrage, et prodigue à son critique toutes ces épithètes dont un portefaix napolitain s’amuse, dans un moment de mauvaise humeur, à gratifier un voyageur qui l’a mal payé. Galeotto voudrait que le zoïle ; pour l’honneur des lettres, expirât sous le bâton. Ce n’est pas seulement l’humaniste qui est immolé ainsi impitoyablement aux railleries de la foule : chacun son tour ; après le lettré, le roi. A Naples existait une académie célèbre, dont Gioviano Pontano était le directeur. C’était un esprit distingué que Pontano, qui ressemblait sous plus d’un rapport à Politien. Grammairien, philosophe, historien, orateur et poète, il était infatué de ses talents divers, et d’humeur guerroyante. On connaissait son penchant à batailler, et rarement on essayait de l’attaquer en face : seulement on disait tout bas, car à Naples comme à Florence on aimait à mentir, qu’il avait dérobé au mont Cassin quelques ouvrages de Cicéron, dont il s’était approprié le style et les idées ; mais personne n’eût osé signer de son nom une semblable calomnie. Pontano gardait sa colère et ses vers jusqu’au moment où l’envie prendrait un corps et une âme. Enfin nous ne savons plus quel malheureux Gaulois eut le courage de crier au plagiat. Nous nous attendions à quelque virulente épigramme ; mais cette fois Pontano laisse l’individu pour attaquer la nation. Sait-on ce qu’il fait des Français clans son dialogue intitulé Charon ? — Des gargotiers, des gâte-sauces, des ménétriers, des ivrognes. Pyrichalcus, un des personnages du dialogue, demande à Mercure si l’on ne ferait pas bien de leur planter un clou dans la tête ; à quoi Mercure répond : Le Gaulois n’a pas de cervelle. Lors des querelles de Naples avec le saint-siège, notre gallophobe avait rendu à Ferdinand Ier des services dont il s’exagérait l’importance ; Ferdinand l’en récompensa magnifiquement en le choisissant pour secrétaire. Pontano n’était pas satisfait : on dit qu’il sollicitait un titre de baron, ce qui nous paraît d’autant plus probable qu’il s’était toujours moqué de la noblesse ; ou, suivant un autre historien, une pension sa vie durant, ce que nous croirions volontiers, car dans ses écrits il avait fait constamment profession d’un fier dédain pour l’argent. Comme il ne voyait venir ni le parchemin ni les florins, il se mit en colère et résolut de se venger. Pontano excelle dans ces petits drames connus sous le nom de dialogues, et que la réforme, qui n’a rien trouvé, n’inventa pas dans ses querelles avec Rome, mais dont elle prit à l’Italie l’idée et souvent même l’expression. Évidemment Ulrich de Hutten s’est inspiré de Pontano dans cette comédie à deux ou trois personnages qu’il écrivit pour décrier Jules II. Si l’on voulait bien, on trouverait dans le lauréat de Maximilien plus d’une plaisanterie sur la luxure des moines et la gourmandise des cardinaux, que Pontano se permettait pour rire, et qu’Ulrich imprimait sérieusement. Pontano, donc, imagine une allégorie qu’il appelle l’Âne, où figurent un voyageur, un courrier et un aubergiste, trois hommes des grandes routes qui se mettent l’un après l’autre à célébrer les douceurs de la paix (1481) que le monde italien doit aux talents de l’écrivain. Il faut entendre les bruyantes exclamations de l’aubergiste, qui voit déjà les routes de Naples peuplées d’une foule de pèlerins et de pèlerines d’une vertu plus que douteuse, s’arrêtant dans la salle à manger de son hôtellerie pour y dépenser leur argent ! Mais où est donc Pontano ? Dans son écurie, où il s’amuse, à soixante ans, à panser, à étriller, à caresser son âne. Le voilà qui paraît, et entame avec son jardinier, lui favori des Muses, une dissertation sur l’art de la greffe ; puis arrive le héros de la comédie satirique, accoutré comme le coursier du calesso napolitain un jour de fête : la fleur à l’oreille, sur le dos une couverture de soie, à la bouche un frein doré, le long de l’épine dorsale des rênes dorées également. Alors commence le draine, où Pontano joue le rôle d’un palefrenier. Il s’agit d’étriller l’animal : le pauvre poète s’y prend comme à l’ordinaire, par la queue d’abord, qu’il est obligé de lâcher, parce que son âne ne respecte rien, pas même l’odorat du poète ; il lui tient la tête, l’animal veut le mordre ; il essaye de passer la main sur le dos de la monture, qui se met à ruer. Alors vient la morale : Bien fou qui vent laver la tête d’un âne, car il y perdra et sa peine et son savon. L’âne, c’est Ferdinand. Telle est la fable trouvée par Pontano : elle ne brille pas par l’invention, et, sans quelques détails qui rappellent le trait caustique d’Aristophane, elle serait oubliée depuis longtemps. Après l’avoir lue, on est tenté de s’apitoyer sur le sort du diplomate, sauveur de son pays, et dont les services ont été si mal récompensés. Malheureusement pour la mémoire de l’écrivain, l’histoire est là qui raconte tout ce que la noble maison d’Aragon fit pour Pontano. Or l’ingrat, c’est le poète, qui, au lieu (le fuir avec ses maîtres lors de la conquête de Naples par les Français, va saluer Charles VIII du titre de libérateur. Quand les Français ont été chassés du royaume, le poète reparaît pour se venger de sa trahison, en représentant les vaincus, dans son dialogue de Charon, comme des hommes sans cervelle ni courage. Ce Charon est un dialogue où Pontano a semé l’esprit à pleines mains ; malheureusement il a dû l’écrire dans quelque lupanar napolitain. On trouve dans cette satire une scène où des ombres d’évêques, de cardinaux, de prêtres, de moines, viennent se confesser à Charon avec une effronterie de termes qui fait monter la rougeur au front. Il est probable que Luther aura connu, lors de son séjour à Rome, quelques fragments de ce dialogue. Le moine a pris au sérieux tout le dévergondage du Napolitain, et la réforme a fait comme Luther, sans prendre garde que Pontano n’est là qu’un artiste qui cherche jusque dans son expression à calquer l’antique. Ainsi l’ont fait Bibbiena dans sa Calandra, et Machiavel dans sa Clizia. Qui ne voit que c’est le monde païen que le poète met en scène ? Horace avec Lalagé, Anacréon avec Bathylle, Martial avec la Rome des Césars. C’est une étude, et non point un tableau de mœurs, qu’il veut donner, et dont il a raison de tirer vanité, parce qu’alors la forme est toute l’œuvre. Ne nous montrent-ils pas à chaque page de leurs écrits, ces idolâtres de l’antiquité, que leurs invectives ne sont qu’un jeu d’esprit renouvelé des anciens ? Politien, par exemple, avant ses querelles avec Merula, trace du professeur un portrait séduisant ; à l’entendre, c’est un homme docte dont les leçons serviront à polir les mœurs de la cité, et qui doit par ses livres immortaliser le nom de celui qui la gouverne. Et, quelques jours après, Merula, qui s’avise de douter de la latinité de quelques expressions de Politien, n’est plus qu’un ignorant cherchant à faire du bruit par de honteux penchants. Pontano, qui s’amusait à loger la sottise sous le capuchon monacal, métamorphose, dans son dialogue de Charon, chaque frère en aristotélicien capable, quand il argumente, de changer Charon en âne. Voilà un moine qui ne ressemble pas à celui d’Ulrich de Hutten. Est-ce que ce cardinal chassant son maître d’hôtel, qui n’a pas osé donner soixante écus d’or d’un poisson, ne descend pas en droite ligne de Lucullus/ Vers la fin du XVe siècle, un mal que Fracastor a chanté dans un beau poème exerçait d’affreux ravages en Italie. Hutten, qui croyait échapper aux atteintes de l’affection à l’aide du bois de gaïac, alla bientôt mourir dans une petite île de la Suisse, victime d’un remède dont il avait trop célébré les vertus. D’où venait ce mal ? de Naples, de la France ou de l’Amérique ? C’est ce qu’il est difficile de dire, même aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, il arriva fort à propos pour fournir de nouvelles images au satirique, qui n’en trouvait plus malheureusement dans les hôpitaux des Grecs ou des Romains. Un poète comme Molza meurt-il d’une fièvre lente, la fièvre prend le nom de la lèpre hideuse, et bien longtemps après qu’il a cessé de chanter et de vivre, on voit un écrivain de quelque talent imaginer un drame où il introduit Colomb, Fernand Cortez, Magellan, Vasco de Gama, Améric Vespuce, qui se vantent chacun d’avoir découvert quelque portion du Nouveau-Monde, et demandent qu’Apollon les couronne. Le chancelier du dieu s’apprête à minuter pour chacun d’eux un brevet d’immortalité, quand survient Molza, a la tête pelée, le menton rasé, le nez déchiré, le visage purulent, qui, s’adressant aux juges du tribunal (c’étaient des femmes), s’écrie : Point de couronne ! Voilà les glorieux trophées du monde dont ils se disputent la découverte. Voyez le danger qu’il y aurait à juger les mœurs d’un homme d’après une épigramme même aussi ingénieusement encadrée que celle de Boccalini ! Un jour l’évêque de Fossombrone, Giov. Guidiccione, inquiet de Molza, écrit à son ami Tolomei : Donnez-moi donc des nouvelles de Molza, j’en suis en peine ; on me dit qu’il est malade d’une fièvre aiguë : voudrait-il nous faire tort de son âme pour en enrichir le ciel ? Ce n’est pas le seul éloge des vertus de ce prétendu lépreux que vous trouverez dans les historiens contemporains. Comment croire que Laurent le Magnifique, ce prince de mœurs élégantes, donnât chaque soir le bras, pour aller à l’une de ses maisons de campagne, à Politien, s’il eût ressemblé au poète inventé par Dati ? que le duc de Milan Sforce invitât à sa table un professeur qui aurait représenté tous les vices décrits par le rhéteur florentin ? Non ! le lettré du XVe siècle ne doit pas être jugé d’après de folles épigrammes : l’épigramme a pu servir des vengeances ; mais la vengeance est aveugle et menteuse. Blâmons toutefois ce rire dont on accueillait, à la table de Laurent, des facéties obscènes qu’on a voulu depuis faire passer pour des peintures du monde italien. Laurent donnait un mauvais exemple en les écoutant. Quand Léon X, un des hôtes de cette table ducale, cardinal d’abord, fut élu pape, il comprit qu’il lui fallait imposer silence à des poètes qui remuaient les boues de toutes les voluptés. Si la papauté ne songea pas plus tôt à réprimer les égarements de la presse, c’est que l’imprimerie était à ses yeux une seconde lumière descendue du ciel, et qu’elle n’osait toucher à rien de ce qui venait de Dieu. Etudions en passant ce qu’elle avait fait en faveur de la presse. En 1466, deux Allemands qui connaissaient le secret de Gutenberg, Conrad Sweinheim et Arnold Pannartz, transportèrent à Rome leur imprimerie de Subiaco, où tout récemment ils avaient donné une édition de Lactance. Paul II régnait alors. Jean-André de’ Bussi, évêque d’Aleria, se déclara leur protecteur. Conrad et Arnold établirent leurs ateliers dans la maison des frères Pierre et François de Maximis, à l’aide des secours que leur fit obtenir de’ Bussi. Leurs presses furent bientôt en état de fonctionner ; mais il leur manquait un correcteur habile : l’évêque s’offrit et fut accepté. A partir de 1466 jusqu’en 1472, nos Allemands publièrent un assez grand nombre d’ouvrages latins : d’abord la Grammaire de Donat, puis les Épîtres familières de Cicéron. L’évêque préparait la copie, revoyait les épreuves, faisait l’office de prote, et attachait à chaque ouvrage une préface ou bien une épître dédicatoire de beau style latin, qu’il faut lire parce qu’on y trouve quelques détails curieux. Dans la dédicace des Lettres de saint Jérôme à Paul II, l’évêque remercie Sa Sainteté de la protection qu’elle a bien voulu accorder à ce bel art de l’imprimerie, qui, en multipliant les chefs-d’œuvre de l’antique littérature, en a tellement abaissé les prix, qu’un ouvrage qui coûtait autrefois cent écus d’or en vaut à peine vingt, et bien imprimé encore, et purgé de ces fautes grossières qui le déshonoraient quand il était à l’état de manuscrit. Ailleurs il nous apprend qu’il a mis neuf ans à revoir l’édition de l’Histoire naturelle de Pline (1472) ; et il en faudrait, ajoute-t-il avec une bonhomie charmante, au moins quatre-vingt-dix. Ses protégés n’étaient pas heureux ! Leurs livres, dont on vantait la correction, ne se vendaient guère, et leurs vastes magasins s’emplissaient de jour en jour de raines de papier. Conrad et Arnold eurent recours à ce bon évêque, qui se mit à leur rédiger une supplique qu’il se chargea de mettre, au mois de mars 1472, sous les yeux de Sixte IV, car Paul Il était mort. Très saint-père, disaient les malheureux typographes, nous avons imprimé, pendant notre séjour à Rome, un grand nombre d’ouvrages dont nous allons vous rappeler les titres dans l’ordre de leur publication : Donat, notre premier livre, à l’usage de l’enfance, tiré à 300 exemplaires, Lactance, tiré à 825 ; les Épîtres familières de Cicéron, tirées à 550, etc. Désormais il nous est impossible de subvenir aux dépenses énormes de notre établissement, si les acheteurs nous manquent ; notre maison, bien vaste pourtant, est encombrée de piles de ballots, c’est la meilleure preuve que nous ne vendons pas. Que votre inépuisable charité vienne à notre aide, afin que nous puissions vivre et faire vivre les nôtres. N’est-il pas admirable, ce de’ Bussi qui, après avoir étudié sous Victorin de Feltre, vient à Rome et tombe dans une si affreuse indigence qu’il n’a pas de quoi se faire faire la barbe ? Nommé évêque d’Aleria (en Corse) par Paul II, il aime tant les livres, que, pour les répandre, il fait le métier de prote. Malheureux métier, qui consiste, dit-il, non pas à chercher des perles dans le fumier, mais du fumier parmi les perles. Quand il a passé tout un jour à user ses yeux à ces révisions de textes en diverses langues, il écrit la nuit une longue préface pour chacun des ouvrages dont il est l’éditeur ; une préface en latin de Cicéron, un véritable livre quelquefois ; puis, avant de se mettre au lit, il rédige un placet, qu’il adressera, dans l’intérêt de ses enfants, c’est le nom qu’il donne à ses ouvriers et aux deux maîtres, Sweinheim et Pannartz, tantôt au pape, quand il saura que Sa Sainteté est en fonds, tantôt à quelque riche cardinal, si les pauvres ont tari l’épargne pontificale. En France comme ailleurs, nous avons donné de belles couronnes à l’inventeur de l’imprimerie, pas assez belles encore ; mais nous avons trop souvent oublié les protecteurs de la typographie naissante, bienfaiteurs aussi de l’humanité. Gloire donc à de’ Bussi, ce savant d’une patience angélique, qui passa neuf ans à préparer une édition de Pline l’Ancien, autant de temps peut-être que l’écrivain en avait mis à composer son ouvrage ! Sixte IV lut l’épître de l’évêque, son bibliothécaire à cette époque, et vint au secours des Allemands : mais la papauté était bien pauvre ; elle ne pouvait donner que cent écus au traducteur du de Animalibus d’Aristote, Théodore Gaza, qui de dépit jetait l’argent dans le Tibre. De son côté, le siècle était bien indifférent à l’invention de Gutenberg. Les lettrés romains auraient tenu dans ce petit cabinet où de’ Bussi corrigeait ses épreuves. Il fallut qu’Arnold et Conrad attendissent des temps plus heureux. Qui leur eût dit qu’un seul exemplaire de chaque ouvrage qu’ils avaient publié suffirait un jour pour acheter la plus belle maison de Rome, les aurait étrangement surpris. Ces livres se répandaient, et avec eux la lumière, et, il faut le dire aussi, la satire à la manière de Martial, l’ode libertine, imitée de celle d’Horace, la peinture cynique qu’on devait retrouver dans Pétrone, le paganisme avec toutes ses licences. A toute force on voulait ressembler aux dieux d’Homère. La papauté n’était pas la seule à déplorer l’abus que la presse faisait du plus beau présent que l’homme ait recru de Dieu. Vital de Thèbes, professeur de droit, se plaignait, en 1500, de l’audace de ces typographes qui, alléchés par l’appât d’un gain honteux, ne rougissaient pas de publier des ouvrages où l’auteur parle une langue qu’on n’avait pas même entendue dans les lupercales antiques. Et Gerson disait en chaire qu’il ne voudrait pas plus prier pour Jean de Mung que pour Judas, s’il n’était pas certain que l’auteur du roman de la Rose eût fait pénitence avant de mourir. Barbaro Ermolao, dans une lettre à Merula, dénonçait comme un malheur ces publications frivoles, qui détournaient le public de la lecture des bons écrivains, et demandait qu’aucune page ne fut désormais publiée sans l’approbation de juges compétents. Berthold, archevêque de Mayence, en 1436, avertissait les fidèles de se tenir en garde contre ces livres irréligieux et libertins, traduits du latin en allemand, et qu’on répandait parmi le peuple. Alexandre VI, en 1501, signalait les pamphlets imprimés à Colonne, à Mayence, à Trèves, et défendait d’imprimer aucun écrit s’il n’avait été revêtu de l’approbation du supérieur ecclésiastique. Léon X, à Florence, avait pu juger de la dangereuse puissance de la parole écrite ou imprimée, quand un scribe recueillait, pour soulever la multitude tantôt contre les Médicis, tantôt contre Alexandre VI, les improvisations de Savonarole. Si la loi religieuse eût obligé le moine de déférer toute espèce d’écrit qu’il voulait imprimer à son juge naturel, l’archevêque ; qui sait ? Jérôme ne serait peut-être pas monté sur le bûcher. Que de fois nous avons été attristés en découvrant des recueils formés de pensées diverses, des pamphlets sous forme de feuilles volantes, sans nom d’imprimeur, et qu’un sténographe infidèle a publiés sous le nom du grand orateur. N’est-il pas probable que l’autorité épiscopale, si elle avait été consultée, eût refusé de les approuver ! Aurait-elle laissé circuler ces légendes plus ridicules que pieuses, où Jean-François Pie fait opérer de si grands miracles au frère Jérôme ? Bossuet a dit que la véritable simplicité de la doctrine chrétienne consiste principalement et essentiellement à toujours se déterminer, en ce qui regarde la foi, par ce fait évident : Hier on croyait ainsi, donc encore aujourd’hui il faut croire de même. Il est certain que, dans les premiers temps de l’Église, tout chrétien était obligé de soumettre ses écrits à l’approbation du souverain pontife. Saint Augustin, saint Honorat, saint Julien, saint Césaire, grandes lumières du catholicisme, ont reconnu la loi et s’y sont soumis. Nicolas la consacra en ces termes dans le canon 5e des canons romains : C’est par décret des pontifes de Rome que tout écrit est approuvé ou condamné. Telle fut la législation de l’Église jusqu’à l’époque de l’invention de l’imprimerie. Alors seulement on essaya de s’y soustraire : Léon X voulut la faire revivre. L’Église était rassemblée au concile de Latran, convoqué par Jules Il. Le pape publia sur la presse ce décret célèbre que nous citerons en entier : § 1. Parmi les sollicitudes qui nous pressent, une des plus
vives et des plus constantes est de pouvoir ramener dans la voie de la vérité
ceux qui en sont éloignés, et de les gagner à Dieu, avec ; le secours de sa
grâce. C’est là, sans contredit, l’objet de nos plus sincères désirs, de nos
affections les plus tendres, de notre vigilance la plus empressée. Or nous avons appris, par des
plaintes élevées de toutes parts, que l’art de l’imprimerie, dont l’invention
s’est toujours perfectionnée de nos jours, grâce à la faveur divine, quoique
très propre, par le grand nombre de livres qu’il -net, sans beaucoup de
frais, à la disposition de tout le monde, à exercer les esprits dans les
lettres et les sciences, et à former des érudits dans toutes sortes de
langues, dont nous aimons à voir la sainte Église romaine abonder, parce
qu’ils sont capables de convertir les infidèles, de les instruire et de les
réunir par la doctrine chrétienne à l’assemblée des fidèles, devenait
pourtant une source d’abus par là téméraire entreprise des maîtres de cet art
; que dans toutes les parties du monde ces maîtres ne craignent pas
d’imprimer, traduits en latin, du grec, de l’hébreu, de l’arabe, du chaldéen,
ou nouvellement composés en latin et en langue vulgaire, des livres contenant
des erreurs même dans la foi, des dogmes pernicieux et contraires à la
religion chrétienne, des attaques contre la réputation des personnes même les
plus élevées en dignité, et que la lecture de tels livres, loin d’édifier,
enfantait les plus grands égarements dans la foi et les mœurs, faisait naître
une foule de scandales et menaçait le monde de plus grands encore. § 2. C’est pourquoi, afin qu’un art si heureusement inventé pour la gloire de Dieu, l’accroissement de la foi et la propagation des sciences utiles, ne soit pas perverti en un usage contraire et ne devienne pas un obstacle au salut pour les fidèles du Christ, nous avons jugé qu’il fallait tourner notre sollicitude du côté de l’impression des livres, pour qu’à l’avenir les épines ne croissent pas avec le bon grain, et que le poison ne vienne pas se mêler au remède. Voulant donc pourvoir à temps au mal, pour que l’art de l’imprimerie prospère avec d’autant plus de bonheur qu’on apportera dans la suite plus de vigilance et qu’on prendra plus de précaution ; de l’avis du sacré collège, nous statuons et ordonnons que, dans la suite et dans tous les temps futurs, personne n’ose imprimer ou faire imprimer un livre quelconque dans notre ville, dans quelque cité ou diocèse que ce soit, qu’il n’ait été examiné avec soin, approuvé et signé, à Ronge, par notre vicaire, et dans les diocèses par l’évêque ou tout autre délégué par lui, et avant la science compétente des matières traitées dans l’ouvrage, sous peine d’excommunication. Le décret du concile de Latran est une grande mesure d’ordre, sociale et religieuse. Depuis vingt ans, le duché de Milan a passé sous la domination de maîtres divers ; les grands vassaux du saint-siège, abattus un moment, se sont bientôt relevés ; Venise a trahi chacun de ses alliés ; la Suisse est divisée en deux camps, la plaine et la montagne : la plaine obéit à la France, et la montagne à l’Église ; Gênes a relevé et abattu cinq à six drapeaux ; Naples a suivi ou délaissé Rome, l’Empire n’est jamais resté fidèle au même parti. Laissez la presse libre, et chacun de ces peuples s’en servira pour récriminer contre le passé, excuser sa politique, attaquer ses maîtres, ses vainqueurs ou ses alliés, et continuer dans des livres une lutte qu’on croyait finie faute de combattants. Alors la paix du continent italien et du monde chrétien sera de nouveau compromise. En Italie, où tout sentiment devient une passion, si la presse reste libre, il faut s’attendre à voir se renouveler ces combats à la manière des héros de Pontano, où la parole humaine se traîne dans la fange. Fille de la lumière incréée, la papauté ne pouvait consentir à cette dégradation de l’intelligence. Au moment même où elle était obligée, dans l’intérêt de la famille chrétienne, de prendre des mesures de répression contre la licence de la presse, elle publiait, sous la direction de Béroalde, l’œuvre de l’un des plus grands historiens de l’antiquité, Tacite, dont la plume avait courageusement flétri les scandales de la vie impériale ; puis elle rassemblait les chefs-d’œuvre des littératures grecque et romaine dans le palais du Vatican, dont elle ouvrait la porte à tous les hommes de talent ; enfin elle érigeait, car c’est une véritable création, ce collège de la Sapience, que toutes les universités allaient prendre pour modèle, et où elle appelait ce que l’Italie possédait de plus éminent dans les lettres et dans les sciences. |