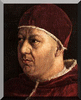HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XVII. — SADOLET. - BEMBO. - BIBBIENA.
|
Sadolet étudie à
Ferrare, s’attache à Virgile, puis à saint Paul. - Il part pour Rome ; entre
d’abord chez le cardinal Caraffa, et, à la mort de ce prélat, chez le
cardinal Frégose. - Caractère de Sadolet. - Sa lettre à Mélanchlhon. - Bembo
se lie à Ferrare avec Sadolet ; part pour la Sicile et apprend le grec sous
Constantin Lascaris ; retourne à Florence, où il fait connaissance de Lucrèce
Borgia. - Bembo à la cour d’Urbin. - Il compose les Asolani. - Idées
esthétiques de Bembo. - Sa théorie sur l’imitation. - Services qu’il rend à
la numismatique. - Il protège Pomponace. - Bibbiena. - Idée de son caractère.
- Étudie Plaute, et le prend pour modèle en écrivant la Calandra. - Ses idées
artistiques. - Sadolet, Bembo et Bibbiena, trois symboles de la vie
intellectuelle que Léon X réunit auprès de sa personne. I. — SADOLET.
Le Quirinal est borné, au nord du Pincio, par un vallon où s’étendaient autrefois les jardins de Salluste ; à l’est du Viminal, par la vallée de Quirin. La pointe du Quirinal se recourbe par une inflexion légère au-dessous de l’église des saints Dominique et Sixte. Trois coteaux s’étendaient jusque sur le Quirinal : le Latiaire, le Mutiel et le Salutaire. Le premier, au sud, où sont les monastères et l’église des saints Dominique et Sixte ; le second où se trouvent les palais Rospigliosi et Pallavicini et la villa Aldobrandini ; le troisième où l’on a édifié le palais pontifical. C’est sur la pente du Quirinal qu’habitait Sadolet, avant que Raphaël eût construit pour l’humaniste cette élégante maison qu’on admire encore à l’extrémité du Borgo-Nuovo. C’est là que Sadolet passait presque chacune de ses soirées ; c’est là le salon en plein vent où il aimait à recevoir ses amis. Il nous dit, dans une de ses lettres adressées à Colocci, les noms de tous ceux qui venaient lui faire la cour, à lui l’un des rois de la pensée de cette époque. Les visiteurs étaient nombreux. Sadolet (Jacques), né à Modène le 14 juillet 1477, est une de ces organisations robustes, au front large, au teint coloré, aux muscles saillants, à la stature athlétique, telles que les pays de montagnes en produisent ordinairement, et comme Jules Romain en a introduit dans sa Bataille de Constantin contre Maxence. Avancé en âne, Sadolet devait ressembler à l’un de ces vieillards que Rubensa placés dans sa Déposition de croix à la cathédrale d’Anvers. Ainsi que Jules II, il avait adopté l’usage de la barbe : la sienne était longue, touffue, coupée en pointe et surmontée de deux moustaches eu demi-cercle. Sans son habit ecclésiastique, il eût été bien difficile de deviner que cette figure hérissée de poils appartint à un humaniste. On eût dit un de ces hommes d’armes au gantelet de fer, dont sa famille avait le glorieux privilège de fournir le monde. Jean, son père, médecin habile, le destinait au droit. A Ferrare professait Nicolas Leoniceno, juriste renommé qui, après sa leçon, réunissait dans son logis quelques écoliers, auxquels il récitait des vers latins de sa composition. Il n’est pas rare alors de trouver des jurisconsultes qui cultivent les muses, témoin Alciati de Milan. Sadolet et Bembo faisaient toujours partie de ces réunions. Il ne paraît pas que ni l’un ni l’autre aient fait de grands progrès dans la science du droit : un penchant impérieux les entraînait tous deux vers les lettres. Sadolet avait adopté Virgile pour son poète. Sur les bancs de l’école il s’amusait à versifier : son poème de Caïo Curtio et Curtio lacu renferme de véritables beautés. L’enfant excelle à décrire la nature physique ; mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que dans les trois cents vers de cette muse de seize ans, rarement vous surprendrez le jet aventureux, l’expression figurée, l’image colorée qu’affectionne un écolier : Sadolet est raisonnable jusque dans ses vers. A dix-huit ans il délaissa Virgile pour Aristote. Quand toutes les belles imaginations de la renaissance se passionnent pour Platon, la prédilection de Sadolet pour l’austère philosophe est un phénomène psychologique curieux à noter : c’est qu’avant tout le Modénais est logicien, et qu’il prise beaucoup plus la raison que l’imagination. Sa devise d’écolier, qu’il inscrira plus tard sur ses livres, c’est une âme tranquille dans un corps chaste : sedatus aninius, spectati mores. Or cette quiétude intellectuelle, ce repos des sens, cette chasteté de termes, il les trouve dans Aristote. Mais il est un philosophe qu’il lui préfère encore : c’est saint Paul ; et dès sa jeunesse il s’est appliqué à chercher dans le grand docteur l’explication de mystères intimes dont la révélation seule, du reste, pouvait lui donner la solution complète. Si Dieu avait fait naître Sadolet dans un couvent, nous l’aurions surpris, comme Savonarole, méditant la nuit au pied d’un autel, car il était porté de sa nature au mysticisme : mais il est probable qu’il n’aurait pas fait le bruit que fit le frère dominicain, parce qu’il aimait la paix intérieure, et ce doux silence que l’âme qui veut s’approcher de Dieu doit par-dessus tout chercher. Nous sommes contents que son père ne l’ait point envoyé, pour terminer ses études, à Florence, ville païenne où le souffle du naturalisme aurait peut-être gâté ce qu’il y avait de virginal dans cette candide nature. Il préféra Rome, et il eut raison. La Providence, qui avait ses vues sur l’enfant, le prit par la main dans ce voyage, et vint avec lui frapper à la porte du cardinal Caraffa. Archevêque de Naples, et décoré par Pie II de la pourpre romaine, Caraffa était vraiment un chrétien des anciens temps, dont la chaste demeure, casta domus, était l’asile du silence, de la prière, des bonnes œuvres, et des vertus domestiques. Sadolet n’eût pas mieux trouvé dans un couvent. Le prélat, pour lequel il avait une lettre de recommandation, le reçut avec une charité tout évangélique ; enivré, dit un historien contemporain, de la modestie répandue, comme une douce odeur, dans les regards, la figure, le maintien et la parole de l’adolescent. Temps heureux vraiment que cette époque de la renaissance, où le maître de la maison regarde dans la sacoche d’un solliciteur, qu’il accueille avec empressement s’il y trouve un auteur latin ! Celle de Sadolet, et jusqu’aux poches de ses vêtements, étaient pleines d’exemplaires de Virgile, de Démosthènes, de Plaute, sortis récemment des presses vénitiennes, et qu’il s’amusait à feuilleter, assis au coin d’un arbre, quand la route l’avait fatigué. A partir de ce jour, il appartint au cardinal. Le prélat voulut en faire un prêtre. Sadolet, qui se sentait une vocation décidée pour le sacerdoce, se mit à étudier la théologie dans les Pères grecs et latins, et surtout dans saint Thomas. Quelques années après, il prononça ses vœux ; vœux d’obéissance, d’amour et de dévouement pour une Église qu’il devait glorifier moins encore par ses talents que par ses vertus. La mort vint rompre trop tôt les liens qui attachaient Sadolet à son bienfaiteur. Mais il ne resta pas longtemps seul : un autre prélat, l’évêque de Gubio, Mgr Frédéric Frégose, lui offrit un asile dans son palais. Or ce palais, véritable demeure des Muses, renfermait ce qu’après Dieu et son prochain, Sadolet aimait le mieux au monde : des manuscrits en toutes langues et de tous les âges, des chefs-d’œuvre de l’imprimerie des Alde, de la prose, des vers, des statues, des tableaux, des médailles, et par-dessus tout un beau jardin bien touffu, et où l’on pouvait se promener et méditer sans être vu ; ajoutez à cela que le maître illustre de la maison entendait le grec, le latin et l’hébreu, si bien que Sante Pagnini lui a dédié sa grammaire hébraïque : voilà pour le savant. Quant à l’homme, Bembo en fait une peinture ravissante. Il dit que l’évêque était doux, affectueux, enjoué, et que quand il parlait l’oreille était charmée autant que le cœur. Pour comble de bonheur, l’humaniste aimait l’Écriture sainte, et saint Paul surtout, qu’il se proposait de commenter. Il ne faut pas croire, comme on l’a souvent répété, que l’exégèse fût une science inconnue avant la réforme. Elle était cultivée en Italie avec succès dans le XVe siècle ; seulement le mot à racine grecque n’était pas encore trouvé. Qu’importe ! la plante, pour exister, n’a pas besoin d’avoir reçu le baptême du botaniste ! Disciple, protégé, ami du cardinal Frégose, au milieu de tous ces morts illustres, Démosthènes, Cicéron, Virgile, Horace, dont il feuilletait les écrits ; en relation avec les artistes qui fréquentaient le palais du cardinal, Sansovino, Fra Gio. rondo, Sdddoma, Bramante, Michel-Ange, Peruzzi ; à table, ayant pour commensal Bembo ; le matin, après la messe qu’il célébrait chaque jour, allant au Campo-Vaccino assister aux fouilles ordonnées par Jules Il ; l’après-midi dans la rue Longhara, où Raphaël travaille avec ses disciples au palais de Chigi ; le soir, sous ses beaux pommiers du Quirinal : quelle félicité nouvelle pouvait rêver Sadolet ! Un jour, il était alors évêque, il écrivit à Mélanchthon une lettre si pleine de termes affectueux, si douce, si caressante, que le professeur de Wittember, émerveillé de tant d’abandon, montra l’épître à tous ses amis. Et voilà Luther qui se met, à table, à faire l’éloge d’une robe violette, pour la première fois de sa vie ; et les Wittembergeois qui croient avoir gagné un évêque ; et l’Allemagne protestante qui copie la lettre pour la répandre ; et les vieux Teutons restés fidèles à la foi de leurs ancêtres, qui sont sur le point de déplorer une nouvelle apostasie. Jean Faber, alors évêque de Vienne, une de ces belles natures qui ne pactisent à aucun prix avec l’erreur, et qui ressemblent à ce Delfini, général de l’ordre des camaldules, que nous avons vu refusant de saluer Savonarole quand le frère eut osé désobéir au pontife romain ; Faber s’émeut, prend une plume, celle-là peut-être dont il s’était servi tant de fois pour répondre aux hérétiques, et il écrit à Sadolet : Mon ami, je vous l’avoue franchement, ce langage si doux, si mielleux que vous parlez à Mélanchthon, a réjoui plus d’un luthérien et contristé plus d’un catholique. Vous avez cru peut-être que la lettre resterait secrète ; voyez combien vous avez été dupe de votre bon cœur : la voilà cette lettre qu’on se garde bien de cacher, mais qu’on montre à tout le monde, et qu’on accompagne, en la’ lisant, de commentaires injurieux pour votre dignité. Mon ami, vous vous êtes cru sans doute plus prudent que saint Paul, qui, de retour du troisième ciel, recommandait à Tite d’éviter l’hérétique. C’était le langage de l’amitié, un peu sévère peut-être, mais plein de franchise. Si Sadolet a péché, qui donc oserait ne pas lui pardonner, en lisant sa réponse à Faber ? Si j’ai écrit à Mélanchthon, ce n’est pas pour m’en faire un ami, mais parce que j’espérais qu’un langage affectueux le gagnerait à nous, et qu’ensuite il nous serait plus facile de ramener nos frères égarés. Oui, cela n’est que trop vrai, j’ai pu oublier le sentiment de ma dignité en écrivant à 11lélanchthon ; je l’oubliais parce qu’il s’agissait de la gloire de Dieu, du salut de mes frères, et de la paix de l’Église. J’ai eu tort, je le confesse ; j’ai péché, comme vous le dites, parce que je ne connaissais pas assez bien l’homme à qui je m’adressais : mais n’accusez pas mon intention ; je voulais par la douceur, en bon chrétien, ramener au bercail du pasteur commun un de nos frères égarés. Si j’ai loué dans Mélanchthon l’homme de lettres, l’écrivain élégant, le professeur habile, je n’ai jamais voulu prendre la défense de l’erreur qu’il soutient : me serait-il défendu de lui écrire ? Les Israélites n’avaient-ils pas commerce avec les publicains ? II. — BEMBO.
L’amitié de Sadolet pour Bembo datait de l’enfance : tous deux s’étaient rencontrés sur les bancs de l’école de droit à Ferrare, et s’étaient sentis attirés l’un vers l’autre par les mêmes goûts, les mêmes instincts, le même amour de la science. Ils se séparèrent, leurs études finies, Sadolet, comme nous l’avons dit, pour aller à Rome, et Bembo pour courir le monde. Fils d’un patricien vénitien qui, à Ravenne, avait relevé le tombeau de liante, Pierre Bembo avait appris le latin sous Alexandre Urticio. Son professeur était un habile humaniste, fou de l’antiquité classique, dont, selon lui, tout était à adorer, mœurs, institutions, théogonie, idiome. Il inspira sans doute à son élève ce culte fanatique pour le paganisme, auquel Bembo, devenu cardinal, ne put entièrement se soustraire. Au moment où l’écolier se prépare à faire voile pour la Sicile, on est étonné de le voir se recommander à la protection des dieux. Nous pardonnerions difficilement à l’enfant son invocation païenne, si dans sa lettre il ne se montrait pas aussi reconnaissant envers le vieil Urticio. L’écolier ne peut se consoler de n’avoir pas embrassé son maître avant de partir pour la Sicile. Sur les flots de cette mer qu’il va traverser, il lui manquera quelque chose, la bénédiction de son professeur : cette piété filiale vaut mieux que le paganisme de Bembo. La Méditerranée lui fut hostile : il souffrit pendant la traversée, et plus encore, à chaque débarquement, dans les mauvaises auberges où il était obligé de s’arrêter. Enfin il atteignit Messine, et descendit chez Constantin Lascaris, qui le reçut affectueusement. Il ne faut pas le confondre avec Jean Lascaris, homme de cabinet, dit l’auteur de la Vie du cardinal d’Amboise, qui avait vieilli sur les livres, qui savait le latin aussi bien que le grec, mais qui n’avait qu’une teinture fort légère des affaires du monde ; savant de petite mine, d’une avarice sordide, qui affectait dans sa table, dans ses meubles, dans ses habits une pauvreté étudiée. Bembo fait un autre portrait de Constantin, qui le reçut avec autant de cordialité que de générosité. Bembo se livra sous ce maître habile à l’étude de la langue hellénique avec une véritable passion ; et trois ans ne s’étaient pas écoulés qu’il écrivait en grec avec une pureté de style tout attique. Ce n’était pas seulement des signes graphiques qu’il était venu demander à Lascaris : d’une famille riche, il allait à la recherche des manuscrits anciens, des vieux tableaux byzantins, des statuettes ou des médailles de l’ancienne Grèce, et chaque jour il augmentait ses trésors. Les courtiers d’antiquités, à cette époque, étaient ordinairement des Israélites, qui faisaient métier d’acheter à vil prix et de revendre fort cher ces fantaisies dont l’humaniste était lui-même si curieux. Quand il dit adieu à Lascaris, Bembo embarqua dans son vaisseau un véritable musée d’antiquités. Il avait alors environ vingt-six ans, et passait pour un des premiers hellénistes de l’époque. A vingt-huit ans il revint à Ferrare, où le duc Alphonse et la duchesse Lucrèce, sa femme, le reçurent avec empressement. Lucrèce Borgia, qu’on a chargée de crimes que n’ouïr peut-être jamais l’oreille d’un casuiste, était alors dans toute la fleur de l’âge. Ce n’était pas seulement, si l’on en croit Bembo, une des étoiles du ciel italien, un modèle de grâces, une beauté qui l’emportait sur Hélène, mais une jeune femme qui à tous les dons de la nature avait voulu joindre ceux de l’âme : Florentine par son doux langage, poète dont les neuf Muses auraient avoué les chants ; une autre Lucrèce, ajoute l’Arioste. Bembo lui dédia ses Asolani. Dans la dédicace de cet ouvrage, l’auteur célèbre avec enthousiasme les charmes, l’esprit, le savoir et les vertus de la duchesse. On se demande comment un jeune homme tel que Bembo, riche, de noble race, connu déjà dans le monde littéraire, aurait osé, à la face de l’Italie, chanter une femme qui eût ressemblé au portrait qu’en ont tracé Sannazar et Pontano. Si ce que Burchard en a dit est vrai, c’était quelque chose d’abominable ! Lisez : voilà Giraldi qui la regarde comme une femme accomplie ; l’austère Serassi qui la doue de toutes les vertus ; l’Arioste qui, dans son épithalame, la compare, sous le rapport des charmes et des mœurs, aux femmes des temps modernes ou anciens, célébrées par l’histoire et la fable ; Antoine Cornazzi qui lui dédie son poème en terza rima sur le Christ et la Vierge ; comment ne pas douter ? Quelqu’un qui s’aviserait de recueillir les témoignages contemporains favorables à Lucrèce formerait un livre d’hymnes comme on n’est composa jamais à la louange d’une femme. Si l’on veut que ce problème historique soit insoluble, il sera bien difficile de ne pas reconnaître la protection et les services qu’elle rendit aux savants. Sa cour était l’asile des lettrés : un humaniste est-il atteint par la pauvreté, s’il a le courage de l’avouer à Lucrèce, il est bien vite secouru. A-t-il une autre grâce à demander ; cherche-t-il une femme qui l’écoute ; Lucrèce est là, jeune, belle, parée, qui fait réciter au lettré ses vers ou sa prose, le soir le présente à la cour, le lendemain l’introduit dans le beau monde, et ne le laisse pas partir sans lui donner des marques d’une munificence toute royale. C’est sous l’inspiration de cette muse que Bembo commença ses Asolani, qu’il vint achever au sommet d’une montagne, dans le château d’Asolo. Les Asolani obtinrent un grand succès ; on dit que Bembo s’était proposé d’imiter les Tusculanes : assurément ni le sujet ni le ton de ces deus ouvrages ne se ressemblent. Si vous avez vu le tableau de Winterhalter, vous pouvez vous faire une idée de la scène des Asolani. C’est le soir, comme dans le Décaméron du peintre ; une foule de jeunes filles et de jeunes hommes assis sur la mousse, au bord d’une claire fontaine, devisent de choses et d’autres. Les héros de cette pastorale sont : Gismondo, Lavinello, Bérénice. Voici comment un de nos plus anciens écrivains, Jean Martin, secrétaire du cardinal Lenoncourt, a décrit le jardin enchanté où Bembo a rassemblé ses personnages : Il estoit my parti en quarré par une belle treille de uignes larve et ombrageuse, qui seruoit d’allée de toutes pars et faisoit tout le circuit de la muraille, estoffée de pierre uiue, espoisse et de longue estendue, où n’y auoit qu’une seule ouuerture respondante sous l’un des bouts de la treille, au deuant de laquelle se tronvoit une baye de grenadiers druz et serrez surpassant en hauteur la poitrine d’un homme ; et au demeurant fort délectable à regarder pour sa continuelle égalité si bien proportionnée qu’il n’y auoit que redire ; de l’autre costé, tout au long du logis de la royne y auoit un beau rang de lauriers feuilliez qui faisoient un demi-arc sur l’allée, tant mignonnement appropriez par le jardinier qu’il sembloit qu’aucune des feuilles n’osast passer leur ordre commandé. Bembo ressemblait à Pic de la Mirandole, que le grand air inspirait. Il voulut connaître la cour d’Urbin, le rendez-vous de tout ce qui s’était fait un nom dans les lettres ou dans les arts. Le duc d’Urbin connaissait ses auteurs classiques comme un écolier de l’université de Padoue, parlait avec une rare pureté le florentin, expliquait Homère à livre ouvert, s’entendait en peinture, en sculpture, et savait assez de philosophie platonicienne pour disputer avec ses hôtes illustres. Élisabeth, sa femme, elle aussi, avait étudié Platon, non pas en pédante, mais en poète : elle lisait les vers avec une voix qui allait à l’âme. Castiglione, dans son livre du Courtisan, il libro del Cortegiano, a recueilli quelques-unes de ces causeries philosophiques qui avaient lieu dans le salon du prince. On y faisait parfois de l’esthétique, et il est curieux de connaître certaines théories de notre écrivain sur la nature du beau. L’opinion de Bembo différait peu de celle de Savonarole, c’est-à-dire de Thomas d’Aquin, que le moine de Saint-Marc avait si bien étudié. Il disait que le beau n’habite qu’en Dieu, que pour l’obtenir il fallait prier ; il ajoutait que le beau renferme nécessairement le bon ; il faisait du beau un cercle dont le bon est toujours le centre. Et comme une sphère ne saurait exister sans un centre, continuait-il, le beau paraît inséparable du bon ; d’où il suit que rarement une âme méchante habite un beau corps. Pour prouver sa théorie, il disait à ses auditeurs : Regardez au ciel ; tons ces astres qui nous envoient la lumière remplissent cette double condition : ils brillent et ils servent. Abaissez vos regards sur la terre ; les arbres qui se couvrent des plus belles fleurs sont aussi ceux qui produisent les plus beaux fruits. Puis il montrait le vaisseau près de prendre la nier, et faisait remarquer combien le mât, la proue, les voiles, la coque charment l’œil, non seulement du marin, mais de tout homme étranger à l’art nautique. Et se laissant entraîner à sa nature poétique : Ciel, terre, mer, fleuves, campagne, arbres, disait-il, tout chante cette essence divine en qui la beauté s’unit toujours à la bonté. Peintres, poètes, orateurs, sculpteurs, philosophes, voulez-vous arriver à la beauté, allez à Dieu : la beauté est le triomphe de l’âme sur le corps. Bembo ne croyait rester à la cour d’Urbin que peu de temps, mais il v trouva tant de séductions, que pour lui les mois, puis les années, s’écoulèrent sans qu’il s’en aperçût. Le palais du duc était comme un caravansérail où s’arrêtaient à chaque instant des capitaines, des courtisans, des peintres, des humanistes et des savants. C’est là qu’il se lia avec Castiglione, avec Raphaël, avec Julien et Jean de Médicis. Le spectacle des montagnes dont Urbin est entouré avait développé dans le Vénitien les germes de poésie qu’il apportait en naissant. On le vit abandonner un instant la langue latine pour écrire en italien. Il avait promis de réhabiliter le toscan, et il tint parole. Il prit pour modèle Pétrarque, dont il rappelle souvent la grâce, et plus souvent encore la mignardise : la langue qu’il parle est claire, limpide, harmonieuse. Après plus de trois siècles, on répète encore dans l’Ombrie quelques-uns de ses sonnets. Mais il n’abandonnait pas la langue latine : il y revenait quand il avait à célébrer quelque chose de grand, comme les vertus de ses bienfaiteurs, le duc et la duchesse, qu’il pleura dans une oraison funèbre où le cœur est encore plus éloquent que le style de l’écrivain. Bembo était en quelque sorte la personnification du paganisme, à l’aide duquel il voulait opérer la rédemption intellectuelle du nouveau monde. Bembo, et avec lui beaucoup de nobles esprits, croyait que les lettres ne pouvaient revivre qu’au moyen d’une formule toute latine qu’il avait trouvée dans Cicéron : c’est par Cicéron qu’il pensait racheter l’homme de ces ténèbres où la scolastique le tenait captif. L’homme, c’est là sa théorie esthétique, ne peut plus créer, il est condamné à imiter qu’il calque donc, et dans sa reproduction plastique il trouvera et le mot et l’idée ; mais c’est par le signe matériel qu’il arrivera à l’esprit. On voit qu’il est loin de cette doctrine spiritualiste qu’il enseignait, lorsqu’il était plus jeune, à la cour d’Urbin. La théorie littéraire qu’il a développée dans une lettre sur l’Imitation, adressée à l’un de ses amis, a quelque chose de spécieux. Au moment où les lettrés étudiaient avec une passion si fervente les beaux écrivains de Rome, il s’était demandé quelle gloire littéraire, parmi toutes les gloires, il tallait faire revivre, et il avait choisi Cicéron ; bien différent en cela de quelques humanistes qu’il avait combattus, et qui voulaient que le style latin moderne fût omnicolore. Bembo exigeait donc qu’on s’attachât de préférence à un écrivain antique, mais du beau siècle, et qu’après une contemplation calme, une étude patiente, une lutte obstinée, on essayât de lui dérober le secret de son style, comme on prend à force de travail la manière d’un peintre. Il disait, après Lazare Buonamici, qu’il eût mieux aimé parler comme Cicéron que d’être pape, et qu’une Tusculane valait un royaume. On sent, en lisant ses lettres latines, combien il a da souffrir pour arriver à ce procédé qui reproduit la phrase du maître avec ses inversions, ses incises et son rythme ; travail malheureux où l’écolier dépensait toutes les nobles facultés qu’il avait reçues du ciel pour rester éternellement écolier. Bembo ressemblait alors au pauvre ouvrier en mosaïque, qui passe sa journée à souder une pierre à une autre pierre de même couleur, et croit avoir reproduit, après trente ans de labeur, le saint Jérôme du Dominiquin, ou ta Transfiguration de Raphaël. Il rongeait, dit pittoresquement Eichhorn, la coque d’une amande, sans arriver jamais jusqu’au noyau. A quoi bon tant de peine inutile, puisque Bembo lui-même eut la gloire de proclamer l’avènement de l’italien, et l’insuffisance d’une langue morte pour exprimer des idées modernes ? Heureusement pour sa gloire qu’il eut le temps de chanter dans l’idiome de Pétrarque. Ses poésies, que nous n’avons à considérer ici que sous le point de vue de l’inspiration, ont mérité les louanges des écrivains les plus habiles. Elles vivront tant que vivra la langue italienne elle-même. Il fut un des premiers humanistes qui, à l’époque de la renaissance, conçurent l’idée de rassembler, comme documents historiques, les images gravées des empereurs ou des consuls de l’ancienne Rome ; il s’attachait surtout à découvrir celles de son auteur favori. Quand on lui apportait une médaille inédite de Cicéron, il la couvrait de baisers et versait des larmes de joie ; il était heureux, et parlait de son bonheur à tous ses amis. C’était entre eux un concert d’exclamations, et Bembo posait sa conquête dans un casier d’ébène qu’un habile ouvrier allemand avait longtemps travaillé. Qdelquefois il arrivait qu’on essayait de tromper l’amateur enthousiaste, mais c’était peine inutile. Bembo était si bien au fait du style numismatique ; il avait si bien gravée dans la tête l’image des figures antiques ; il connaissait si bien les procédés mécaniques de l’art, qu’il n’y avait aucun moyen de le tromper. Un jour Jules II reçut de la Dacie un manuscrit latin tellement chargé d’abréviations, que personne parmi les plus doctes de l’Académie romaine ne pouvait le déchiffrer. Le pape aurait envoyé une ambassade au bout du monda pour avoir l’explication de ces figures hiéroglyphiques. Quelqu’un nomma Bembo comme le seul qui pût les traduire. Sa Sainteté mande en toute hâte le Vénitien, qui se rend au palais, ouvre le volume, et se met à lire couramment comme il eût pu le faire dans un livre ordinaire. L’ouvrage, du reste, ne contenait rien de merveilleux ; ces signes, interrompus à dessein, étaient formés par un sténographe de l’époque ; et qui possédait la clef de quelques abréviations pouvait bientôt deviner le reste. Peu de temps après, Bembo recevait de Sa Sainteté le titre de commandeur de Saint-Jean de Jérusalem à Bologne. C’est assez parler du savant, il faut faire connaître l’homme. Pomponace (Pomponazzi), professeur à Bologne, était un hardi penseur qui, dans son livre de Immortalitate animæ, faisait enseigner à Aristote des propositions que ce philosophe n’a jamais énoncées. Le livre fut brûlé à Venise, après qu’il eut été doctement combattu par Augustin Niphus (Nifé) et Gaspard Contarini, et doctement aussi défendu par Chrysostôme de Casale (Chrys. Javelli, en latin Canapicius). A l’époque de l’élection de Léon X, Pomponace eut la bonne idée d’envoyer son livre à Bembo, qui le lut, et, n’y trouvant aucune proposition hérétique, le soumit au maître du sacré palais, qui, n’y voyant rien non plus de condamnable, dut en appeler à Sa Sainteté. Léon X, après l’avoir examiné, défendit de tourmenter désormais Pomponace, qui conserva sa chaire. Ln lui donnant cette heureuse nouvelle, Bembo avait eu soin de faire passer au professeur quelques trimestres d’une pension qu’on avait négligé d’acquitter pendant la longue guerre qu’il avait soutenue contre un grand nombre’ de théologiens. III. — BIBBIENA. Si vous voulez connaître, non pas le cœur, nous savons tout ce qu’il vaut, mais la figure de Bibbiena, regardez au Vatican dans la camera di Torre Borgia ; Raphaël l’a placé à côté de Léon X ; le peintre en a fait un jeune homme d’une singulière beauté.
Avec ces penchants au rire, il n’est pas étonnant que, dans ses études classiques, Dovizi se fût attaché surtout aux écrivains comiques de l’antiquité. Son auteur favori, c’était Plaute, qu’il portait constamment en voyage, qu’il relisait à chaque instant de loisir, et qu’il savait par cœur. Si jamais il veut mettre en relief une de ces innombrables sottises que le monde promène autour de lui, c’est de Plaute qu’il s’inspirera ; c’est sur la scène qu’il la jouera, et alors vous le verrez reproduire jusqu’aux crudités de langage de son poète favori, par une sorte de folie aussi : pour être antique. De sorte que, lorsqu’on voudra connaître Bibbiena, il faudra bien se garder de le juger d’après son œuvre littéraire. Il sera hardi dans la Calandra jusqu’à la licence, parce qu’à ses yeux la chasteté des termes n’est que de la pruderie. Si la Calandra, cette comédie que Bibbiena composa fort jeune, et longtemps avant qu’il fût entré dans les ordres, ne peut trouver grâce aux yeux. du moraliste, elle a, sous le rapport du style, obtenu les applaudissements de l’Italie tout entière. C’est une des plus heureuses, trop heureuses imitations sans doute, qu’on ait faites de la manière de Plaute. Hâtons-nous de dire que les mœurs de Bibbiena ne ressemblaient nullement à celles qu’il a mises en scène. Si Bibbiena, adolescent, n’avait pas une grande estime pour l’humanité, il savait comprendre en artiste les œuvres qu’elle produit. Il se dédommageait en quelque sorte de ses dédains pour la nature vivante, par son culte pour la matière. Sans être peintre ou sculpteur, il appréciait avec un tact exquis les beautés d’une statue ou d’un tableau. Au premier coup d’œil il disait si la statue était antique, si le tableau était d’un bon maître. Il n’est presque pas besoin de remarquer que Bibbiena, comme Bembo, aimait le paganisme ; qu’adorateur de ce que Lessing appelle l’enveloppe visible, il allait chercher dans la mythologie ses admirations. La poésie chrétienne des artistes ombriens lui était presque inconnue ; il passait devant une œuvre de Giotto sans éprouver d’émotion, parce qu’il prisait avant tout la vie matérielle avec ses fraîches carnations, ses chaudes et brillantes couleurs, ce qui tombe sous les sens ; en un mot, il aurait adoré Rubens. S’il aima Raphaël, c’est moins quand le peintre s’exerçait à représenter des madones que quand il peignait sur les murs de la Farnésine les fables d’Apulée. Bibbiena était un homme de cour accompli. Aussi le cardinal Jean de Médicis l’avait-il employé souvent, et avec succès, pour représenter les Médicis exilés. A Mantoue, lors du congrès tenu dans cette ville pour traiter de la pacification de l’Italie, Bibbiena, qui avait su s’attirer la confiance de Jules II, dont il était le plénipotentiaire, obtint un véritable succès. Léon X l’avait choisi, comme nous l’avons vu, pour son conclaviste. Suivant la coutume, le pape lui fit don de tous les meubles qui garnissaient la maison qu’il occupait sur la place de Navone pendant qu’il était cardinal. Le 23 septembre 1513, il conféra le cardinalat à Jules de Médicis, son cousin ; à Laurent Pucci, nommé dataire par Jules II ; à Innocent Cibo, petit-fils d’Innocent VIII, et à Bernard Bibbiena, qui avait pris les ordres, et qui était alors diacre. Léon X écrivit à Ferdinand d’Espagne une lettre où il vantait la prudence, l’intégrité, les talents, et les vertus de son conclaviste. Voilà donc les trois symboles de la vie intellectuelle que Léon X réunit auprès de sa personne lorsqu’il eut ceint la tiare. Bembo représente l’élément littéraire païen, Bibbiena l’élément artiste païen, Sadolet l’élément chrétien. Bembo veut opérer le réveil de l’esprit à l’aide de Cicéron. A force de chercher le style, il finira par n’adorer que le signe, et il ira, par un étrange anachronisme, jusqu’à mettre au service d’idées toutes chrétiennes des formules toutes mythologiques. Ce culte pour le mot, poussé jusqu’à l’idolâtrie, contribuera toutefois au progrès de l’intelligence en l’attirant vers ces deux inondes romain et grec qu’elle avait délaissés trop longtemps, et où reposaient les véritables sources du beau. Combien il est à regretter qu’il n’ait pas appliqué au christianisme cette théorie esthétique qu’il développait à la cour du duc d’Urbin ! Bibbiena suivra Bembo dans cette voie du naturalisme. Comme aux yeux de Bembo, Cicéron c’est tout le style ; aux yeux de Bibbiena, Scopas ou Praxitèle c’est toute la statuaire. Dans la statue, ce n’est pas l’idée, mais la ligne seule qui le frappe ; et comme il ne trouve cette ligne que dans l’œuvre des Grecs, il méprise toute image taillée par un ciseau chrétien. Ne lui parlez pas de l’expression qu’Orcagna a su rendre si merveilleusement, si la pierre n’a pas été traitée anatomiquement par le statuaire. Sous un point de rue il a raison, car la beauté en sculpture ne saurait exister qu’à la condition de l’alliance de l’expression et du dessin ; mais la ligne le préoccupe trop. Cependant on ne saurait nier, en blâmant ses tendances trop sensualistes, qu’il n’ait rendu de véritables services à l’art en propageant l’étude de la réalité ou du dessin. Entre ces deux hommes aux idées trop exclusives, vient se placer Sadolet, âme calme et réfléchie, dont l’amour pour l’antiquité ne va pas jusqu’au fanatisme ; qui ne s’est pas contenté d’étudier Cicéron et Démosthène, mais qui a médité saint Paul, qui a lu la Bible, qui connaît les Pères. Il est spiritualiste autant qu’on peut l’être à cette époque. Son artiste modèle, c’est Raphaël ; non pas toutefois dans les œuvres qu’il a produites au sortir de l’école du Pérugin, mais dans celles qu’il a créées tout récemment, et où l’on trouve l’expression du peintre de l’Ombrie et les contours des maîtres florentins. Nous sommes sûrs que, tant qu’il restera près de Léon X, l’art ne s’abîmera pas dans le paganisme ; que la théorie sur l’imitation de Bembo ne triomphera pas complètement, et que si la littérature profane a dans le Vénitien un brillant représentant, lui, Modénais, saura favoriser l’étude des saintes lettres, en donnant l’exemple d’une grande chasteté de style, d’un amour éclairé pour le christianisme, et d’une sainte admiration pour la parole révélée. Voilà les trois auxiliaires principaux qu’en montant sur le trône Léon X s’est adjoints afin de travailler à la gloire de la religion, des lettres et des arts. Tous trois sont des hommes de paix et de charité. |
 Les deux hommes qui contresignaient de si belles lettres
étaient Sadolet et Bembo, que Léon X avait choisis pour secrétaires intimes.
Celui qui avait pris une part active aux négociations auprès des cours
alliées du saint-siège était Bernard Bibbiena, que le pape avait nommé son
légat, et qu’il devait bientôt décorer de la pourpre.
Les deux hommes qui contresignaient de si belles lettres
étaient Sadolet et Bembo, que Léon X avait choisis pour secrétaires intimes.
Celui qui avait pris une part active aux négociations auprès des cours
alliées du saint-siège était Bernard Bibbiena, que le pape avait nommé son
légat, et qu’il devait bientôt décorer de la pourpre. Un jour, en 1506, dans cette chaste maison dont nous avons
parlé, Sadolet reçut une lettre charmante de Venise ; elle était de Bembo,
avec lequel il était en correspondance depuis trois ans. Lors de la
découverte du Laocoon dans la vigne de des Fredis, Sadolet publia un poème
qui excita l’admiration des lettrés. On en avait retenti quelques passages qu’on
répétait, comme de nos jours on répéterait le motif d’un opéra de Rossini.
Sadolet voulut connaître l’opinion d’un poète ; il adressa son œuvre à Bembo,
qui lui répondit sur-le-champ :
Un jour, en 1506, dans cette chaste maison dont nous avons
parlé, Sadolet reçut une lettre charmante de Venise ; elle était de Bembo,
avec lequel il était en correspondance depuis trois ans. Lors de la
découverte du Laocoon dans la vigne de des Fredis, Sadolet publia un poème
qui excita l’admiration des lettrés. On en avait retenti quelques passages qu’on
répétait, comme de nos jours on répéterait le motif d’un opéra de Rossini.
Sadolet voulut connaître l’opinion d’un poète ; il adressa son œuvre à Bembo,
qui lui répondit sur-le-champ :  Le cardinal, plus d’une fois, remercia la Providence du compagnon
d’exil qu’elle lui avait amené. Bibbiena avait un fonds de gaîté inépuisable
: il riait de tout, des fatigues de la route, des ardeurs du soleil, de ces
hôtelleries dont Érasme et Bembo se sont si spirituellement moqués ;
caravansérails placés il des intervalles immenses, et où le voyageur était à
peu près sûr de ne trouver ni un bon lit ni une bonne table. Ses amis
appelaient cette disposition à la moquerie de la folie, et disaient qu’il eût
passé pour fou parmi les fous. Sa propension au rire s’explique : à Florence,
il avait vu représenter une comédie où l’homme jouait un bien triste rôle.
Hier, le peuple n’avait pas assez de larmes pour pleurer le premier magistrat
de la cité qu’une mort inopinée venait de ravir à l’amour du peuple ; pas
assez de chants pour célébrer l’avènement au pouvoir de Pierre, fils du
Magnifique ; pas assez de couronnes pour tous ces hommes de science qui
faisaient de lointains voyages afin d’enrichir la bibliothèque du grand-duc
de chefs-d’œuvre littéraires. Aujourd’hui, ce peuple inconstant, après avoir
chassé son maître à coups de pierres, brûle les beaux livres venus de
l’Orient et rassemblés dans le palais bâti par Michelozzi, puis brise des
statues qui faisaient l’admiration des étrangers, parce que tout cela
appartenait au fils de Laurent. Folie ! disait Bibbiena. Il est venu souvent
prier dans ce couvent des dominicains, que les Médicis ont enrichi ; et
aujourd’hui qu’un descendant de cette noble famille, poursuivi par la
populace, vient demander au nom du Christ qu’on lui laisse passer la nuit
dans le dortoir du monastère, un frère le repousse et lui dit :
Le cardinal, plus d’une fois, remercia la Providence du compagnon
d’exil qu’elle lui avait amené. Bibbiena avait un fonds de gaîté inépuisable
: il riait de tout, des fatigues de la route, des ardeurs du soleil, de ces
hôtelleries dont Érasme et Bembo se sont si spirituellement moqués ;
caravansérails placés il des intervalles immenses, et où le voyageur était à
peu près sûr de ne trouver ni un bon lit ni une bonne table. Ses amis
appelaient cette disposition à la moquerie de la folie, et disaient qu’il eût
passé pour fou parmi les fous. Sa propension au rire s’explique : à Florence,
il avait vu représenter une comédie où l’homme jouait un bien triste rôle.
Hier, le peuple n’avait pas assez de larmes pour pleurer le premier magistrat
de la cité qu’une mort inopinée venait de ravir à l’amour du peuple ; pas
assez de chants pour célébrer l’avènement au pouvoir de Pierre, fils du
Magnifique ; pas assez de couronnes pour tous ces hommes de science qui
faisaient de lointains voyages afin d’enrichir la bibliothèque du grand-duc
de chefs-d’œuvre littéraires. Aujourd’hui, ce peuple inconstant, après avoir
chassé son maître à coups de pierres, brûle les beaux livres venus de
l’Orient et rassemblés dans le palais bâti par Michelozzi, puis brise des
statues qui faisaient l’admiration des étrangers, parce que tout cela
appartenait au fils de Laurent. Folie ! disait Bibbiena. Il est venu souvent
prier dans ce couvent des dominicains, que les Médicis ont enrichi ; et
aujourd’hui qu’un descendant de cette noble famille, poursuivi par la
populace, vient demander au nom du Christ qu’on lui laisse passer la nuit
dans le dortoir du monastère, un frère le repousse et lui dit :