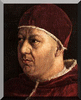HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE XIII. — JULES II, PROTECTEUR DES ARTS ET DES LETTRES.
|
Enfance de Jules II,
qui apprend à connaître Michel-Ange à Florence, et le fait appeler à Rome. -
Entrevue du pape et de l’artiste. - Tombeau de Jules II. - Michel-Ange se brouille
avec Sa Sainteté, et retourne à Florence. - Effroi de Soderini, qui tâche
d’apaiser son compatriote. - Michel-Ange se réconcilie avec le saint-père. -
Il est chargé de faire la statue de Jules II, puis des travaux de la chapelle
Sixtine. - Bramante commence l’église de Saint-Pierre et meurt. - Caractère
de cet artiste. - Protection que Jules II accorde aux arts. - Rome sous ce
pontife. Arbizuola est une maison de campagne délicieusement située dans l’État de Savone, moitié sur le penchant d’une colline, moitié dans une plaine, l’une et l’autre diversement fertiles. Sur le penchant de la colline S’étendaient autrefois des vignes, remplacées aujourd’hui par des oliviers ; dans la plaine étaient des arbres fruitiers, des plantes légumineuses, toutes sortes de beaux végétaux. C’est de cette ferme, habitée au XVe siècle par de riches cultivateurs, que partait deux fois la semaine, au lever du soleil, un pauvre enfant qui conduisait au marché voisin, et souvent jusqu’à Gênes, un batelet chargé de provisions. Quand la monture du fermier ne pouvait porter jusqu’à la nier la récolte de la journée, l’enfant prêtait docilement ses épaules. Souple, obéissant, jamais il rie faisait entendre un seul murmure : tout son bonheur était de revenir de Gênes les poches pleines de testoni, qu’il remettait fidèlement à ses maîtres. Ce jour-là on souriait à l’enfant ; à dîner, après la soupe, il avait un peu de légumes, quelquefois du pain blanc, un sourire de la maîtresse, et des paroles d’encouragement du fermier. Si par hasard il n’avait pas vendu sa charge, alors il trouvait des figures chagrines ; trop heureux quand on ne lui faisait pas expier par de rudes châtiments les torts d’un acheteur que rien n’avait attendri, ni les prières, ni la douce voix, ni les pleurs peut-être du petit messager. Érasme, d’après un historien qui prétend avoir étudié sur des documents inédits les premières années de Julien, nous le représente, au retour du marché, faisant le métier de rameur sur une barque pour gagner sa nourriture quotidienne. Cet enfant, c’est notre Jules II. On voit que la Providence ne l’a pas traité comme Médicis. A Julien du pain noir, un sommeil interrompu, de la paille pour dormir, pour maître un véritable geôlier, point de joie d’intérieur, point de doux regards paternels, point de mère pour lui sourire. Jean de Médicis, au contraire, a tout le bonheur que l’enfant petit rêver en cette vie : un père qui l’aime avec passion, une mère qui l’embrasse et le caresse sur ses genoux, des livres pour hochets, un palais bâti par Michelozzi pour berceau, un jardin plein de fleurs pour école. Dans cette répartition inégale de ses dons, la Providence avait ses vues sur l’avenir de ces deux enfants. Julien avait besoin d’être mené rudement, parce qu’il avait de grandes tribulations à supporter. S’il n’eût pas appris à souffrir, jamais il n’aurait pu tenir tête aux Français. A des soldats qui n’ont peur ni des neiges, ni des -laces, ni des fleuves, ni des montagnes, il fallait pour adversaire un pontife qui eût couché sur la pierre, qui se fût accoutumé à se lever à toute heure de la nuit, qui ne reculât ni devant le bruit du canon ni devant l’odeur de la poudre ; qui, en face d’une coalition contre le saint-siège, formée de presque toutes les puissances du monde chrétien : de la France, de l’Espagne, de l’Allemagne, de Naples, de Venise, de Ferrare, de Bologne, de Florence, ne désespérât jamais de la Providence, et qui fût toujours prêt à verser son sang pour le triomphe de l’Église. Car, ne nous y trompons pas, c’est pour cette Église, qu’il appelle son épouse, que Jules Il luttera toute sa vie ; c’est pour la parer d’or et de diamants, comme il le dit, qu’il s’est fait soldat. Son patriotisme prend sa source dans la religion ; voilà pourquoi Jules est grand jusque dans ses faiblesses, car il ne pouvait point échapper à la loi commune de l’humanité. C’est de l’Italie que la lumière doit se répandre en Europe ; il importe donc que l’Italie vive, car l’esclavage c’est la mort. Qu’elle soit libre, et nous verrons alors cette semence intellectuelle, déposée dans les esprits par les Grecs de Constantinople et les Médicis de Florence, se développer sous Léon X. Il fallait deux choses à l’Italie : un bras et une tête ; le bras pour préparer le sol, la tête pour le féconder. Or Jules eut l’un et l’autre. Dans toutes nos histoires, c’est toujours le cavalier de la Mirandole qu’on, nous montre : Jules cependant fut plus qu’un guerrier. Au moment où le sacré collège décerne par acclamation au cardinal de Saint-Pierre-ès-Liens la plus belle couronne que puisse ceindre une tête humaine, la première image qui se présente au pontife, ce n’est pas les rayons dont elle est entourée, mais la poussière même dont elle est formée. Quand Rome se prosterne à ses pieds, il rêve à ses obsèques ; il mourra bientôt, il lui faut donc un tombeau. Il se rappelle alors que, pendant son séjour à Florence, il voyait quelquefois un artiste qui semblait avoir été abandonné de la Providence ; qui avait lutté contre les préjugés de sa famille et les mauvais traitements de son père, et qui seul, à l’aide d’un peu de mortier ramassé dans les jardins du grand-duc Laurent, était devenu l’égal des plus habiles sculpteurs de l’Italie. A Michel-Ange il n’a pas fallu de maîtres, non plus qu’à Jules II de livres pour trouver, l’un les proportions anatomiques de l’homme, l’autre l’art de mener son siècle. Souvent, à Florence, de la Rovere s’est arrêté dans l’atelier du sculpteur, admirant avec quelle fougue l’enfant traite le marbre, sur lequel il ne s’amuse pas, à l’imitation des ouvriers vulgaires, à tracer des lignes et des contours que le ciseau suivra docilement, mais qu’il attaque, qu’il fouille et fait voler en éclats, et qui, dans moins de quelques heures, va prendre des traits, une figure, un corps, se mouvoir, vivre et respirer. Il s’est exilé de Rome, et sa patrie, cette Italie qu’il aime avec passion, est envahie, mutilée, déchirée par les factions ; la dalle des rues de Florence retentit du bruit des pas de chevaux flamands, espagnols, allemands et français. Que Dieu l’appelle un jour à la papauté, il traitera l’étranger, qu’il eut le tort de favoriser d’abord, comme Michel-Ange traite la pierre ; pour délivrer son pays, il ne s’amusera pas à faire de la finesse, à recourir à la ruse, à se servir des armes ordinaires à la diplomatie ; il marchera droit à l’ennemi, il ceindra le baudrier, il endossera la cuirasse, il prendra l’épée, il fera jouer le canon, et le pays sera sauvé. Il n’y avait en ce moment qu’un jeune Florentin qui pût comprendre Jules II, c’était Michel-Ange Buonarotti, justement celui sur lequel le pape avait jeté les yeux : Jules Il venait de l’appeler à Rome. L’artiste partit de Florence après avoir pris congé de son protecteur le gonfalonier Soderini, qui lui recommanda bien de ne pas brouiller la république avec Sa Sainteté. Soderini connaissait son compatriote, qui n’était pas disposé à se courber même devant la tiare ; dont le cœur était aussi bon que la tête était mauvaise, et qui était fier de son ciseau autant que Pierre de Navarre de son artillerie. Michel-Ange n’avait pas des goûts de grand seigneur, comme Raphaël ; au lieu de se présenter au Vatican escorté d’une foule de pages, il vint dans un accoutrement modeste, seul comme un pauvre ouvrier qui débuterait en sculpture. Au palais pontifical, personne ne se détourna pour le voir passer ; et, quand l’huissier annonça Michel-Ange, aucun murmure de surprise ne se fit entendre : probablement pas un des solliciteurs assis dans la pièce d’attente ne se doutait que cet étranger aux formes un peu rustiques était l’auteur de cette statue de David qui avait à Florence inspiré tant d’hymnes en prose et en vers, et que, dans son enthousiasme irréfléchi, Vasari devait mettre au-dessus de toutes les statues antiques. Cette première entrevue entre le pape et le sculpteur fut ce qu’elle devait être, courte et vive. Jules, après avoir relevé l’artiste qui s’était agenouillé, lui dit le motif pour lequel il l’appelait à Rome. Je te connais, ajouta Jules, car il tutoyait ceux qu’il aimait ; c’est pourquoi je t’ai fait venir ici : je veux que tu fasses mon tombeau. — Je m’en charge, dit fièrement Michel-Ange. — Un magnifique tombeau, reprit le pape. — Il coûtera cher, dit en souriant Buonarotti. — Et combien ? — Cent mille scudi. — Je t’en donnerai deux cent mille. Il n’y avait rien à répondre : l’artiste se contenta de se jeter à genoux, de baisser la tête, et de recevoir la bénédiction du pape. Deux cent mille scudi ! avait dit le pape à haute voix. Ces mots avaient été entendus dans la salle d’attente, en sorte que, lorsque l’artiste sortit de la chambre pontificale, les solliciteurs, les officiers, les prélats, se rangèrent sur deux lignes pour laisser passer le Florentin à qui Sa Sainteté jetait ainsi l’or à pleines mains.
Michel-Ange, en allant au Vatican, était instruit déjà, à ce qu’il paraît, du projet de Sa Sainteté, et d’avance il avait arrangé le plan du mausolée : ce plan était grandiose, et, sans Vasari, le croquis même, tracé de la main de l’artiste, ne nous en eût donné qu’une incomplète idée. Le monument devait avoir pour base un massif parallélogramme de dix-huit brasses de longueur sur douze de largeur. L’extérieur aurait été orné de niches séparées par des termes drapés supportant l’entablement. Chacune de ces figures aurait tenu en chaîne un captif. Ces prisonniers représentaient les provinces conquises par le pape Jules Il, et réduites à l’obéissance des Etats de l’Église. Outre les emblèmes d’art, l’entablement aurait supporté quatre statues colossales : la Vie active, la Vie contemplative, saint Paul et Moïse, entre lesquelles se serait élevé le sarcophage, surmonté de deux statues, l’une représentant le Ciel qui reçoit l’âme de Jules II, l’autre la Terre qui pleure sa mort. En somme, le monument aurait été composé de quarante statues, sans compter les figurines et les ornements. De ces quarante statues, l’artiste n’en a terminé que trois : les deux Esclaves qui sont maintenant au Louvre à Paris, et dont il avait fait don à Robert Sforce, et le Moïse qu’on admire à Saint-Pierre-ès-Liens à Rome ; magnifique création qui, suivant Cicognara, n’a de modèle chez aucune nation de l’antiquité. C’est bien là Moïse, dit le poète Zappi, quand il descend de la montagne le visage resplendissant d’une lumière céleste, quand il apaise les flots mugissants, que la mer à sa voix referme ses abîmes et engloutit les ennemis du Dieu d’Israël. Il est aisé de s’apercevoir, quand on connaît la figure de Jules II, que l’artiste florentin a voulu représenter le pape sous les traits du législateur des Hébreux : c’est le même œil creusé profondément dans une orbite osseuse, la même barbe qui tombe en flots épais sur la poitrine, le même front, haut et lumineux, et largement plissé par l’exercice continu de la pensée. Michel-Ange s’était mis au travail avec son ardeur ordinaire : il voulait se montrer digne de la confiance du pontife, faire bien et aller vite. Jules II aimait ce jeune homme, qui dédaignait de se ployer aux exigences de l’étiquette romaine, qui ne demandait jamais d’audience, et se contentait, quand il venait au Vatican, de jeter son nom aux maîtres des cérémonies. Il riait de tout ce qu’on lui racontait des boutades vaniteuses, de l’humeur guerroyante, des scènes burlesques de son sculpteur, dans le cabaret de la rue des Banchi, plus tard le théâtre des exploits de Benvenuto Cellini, et où la garde pontificale avait da plus d’une fois descendre pour rétablir la paix compromise par les saillies, les bons mots, les concetti et les satires des convives. A cette époque, la terre fouillée enfantait presque à chaque heure de la journée quelque statue nouvelle. Jules II se plaisait à consulter Buonarotti sur le mérite de l’œuvre. Ce sculpteur était une nature merveilleuse : non seulement il savait travailler le marbre, mais il connaissait l’anatomie comme un médecin, peignait en maître, et au besoin composait en italien aussi bien que Laurent de Médicis. Un jour donc, c’était au mois de janvier, en 1506, des ouvriers qui travaillaient à la vigne de Felice des Fredis, sous l’inspection du propriétaire, au-dessus des Thermes de Titus, trouvèrent un bloc de marbre engagé profondément dans une niche, et enveloppé d’une couche de terre, suaire de plus de quinze siècles. A mesure qu’on dégage le marbre, l’ail ravi reconnaît une tête d’homme dont le regard tourné vers le ciel exprime la souffrance ; deus enfants sans vois comme saris mouvement, et des serpents s’enroulant autour des membres nus de ces trois corps qu’ils déchirent de leurs morsures et souillent de leur bave. Un des spectateurs s’émeut à cette scène de douleur muette, sans qu’il en connaisse les acteurs, et se hâte d’aller chercher Sadolet, qui arrive et reconnaît le Laocoon tel que Pline l’a décrit. Bientôt, avertis par Sa Sainteté, accourent Julien de San-Gallo, Jean-Christ. Romano et Michel-Ange. — C’est le Laocoon, s’écrie Julien, le Laocoon dont parle Pline ; mais Buonarotti refuse de reconnaître le groupe original, qui n’était formé que d’un seul bloc, tandis que la copie porte les signes habilement dissimulés de sutures et de raccords, et son opinion semble avoir prévalu dans le monde savant. Quoi qu’il en soit, le groupe qu’on venait de découvrir était un véritable chef-d’œuvre : le sculpteur avait vaincu le poète ; en effet, son drame est plus beau que le drame décrit par Virgile. la douleur de Laocoon, remarque M. de Bonald, est toute chrétienne. Il ne jette pas, comme dans l’Énéide, d’épouvantables cris, clamores horrendos. Sa bouche reste fermée ; son œil seul parle en regardant le ciel, et ce langage paternel déchire le cœur et fait couler les larmes. Schelling, à ce sujet, fait une observation bien juste : c’est que l’art ne doit pas exprimer complètement la passion, autrement l’imagination du spectateur serait condamnée à rester oisive ; tandis que, devant toute représentation matérielle, elle doit conserver son activité, et pouvoir s’élancer hors de la sphère où s’est placé l’artiste. Ne nous étonnons donc pas de tout ce bruit mélodieux que lit naître la découverte du Laocoon : les poètes, en le célébrant dans de beaux vers comme ceux de Sadolet, ne tombaient pas cette fois dans le culte grossier de la matière. Il y a là plus que du marbre travaillé de main de maître ; il y a une douleur ineffable de père, une résignation sublime, une beauté calme qu’aucun sculpteur n’a jamais pu reproduire, un idéal enfin que l’esprit seul peut comprendre. Aussi personne ne s’étonna quand le pape, pour récompenser des Fredis d’une semblable bonne fortune, lui donna une partie du revenu des droits de gabelle imposés aux marchandises qui entraient à Rome par la porte de Saint-Jean de Latran. Le présent était magnifique, mais il ne valait pas celui que donnait à des Fredis dans sa tombe la voix des âmes artistes : l’immortalité. Michel-Ange était une de ces natures fécondes, mais mobiles, qui se passionnent pour une couvre qu’elles délaissent aussitôt que le germe en est créé. Le premier coup de ciseau donné au bloc d’où devait jaillir le sarcophage du pape, Buonarotti parut avoir oublié son marbre et sa promesse. Condivi, témoin un peu suspect, affirme que Bramante, parent de Raphaël, mit à profit l’insouciance paresseuse du sculpteur pour le perdre dans l’esprit de Jules H. Il y avait un moyen infaillible d’irriter Michel-Ange : c’était de lui refuser les scudi qu’on lui avait si libéralement offerts. Sur la foi de la parole du pape, le sculpteur avait fait venir de Carrare des marbres qu’on débarquait à Ripetta, sur le Tibre, et qu’on transportait ensuite à Saint-Pierre. La place en était à moitié remplie : il y en avait le long de l’église de Sainte-Catherine, et jusque dans les corridors du Vatican. Les ouvriers attendaient leur salaire. Michel-Ange monte au Vatican : le pape n’est pas visible. L’artiste rentre à son logis, cherche, fouille, trouve quelques scudi qu’il a rapportés de Florence, et paye ses manœuvres, certain que le lendemain Sa Sainteté le fera rembourser de ce qu’il a dépensé. Le lendemain, il se présente de nouveau, et demande à parler à Jules II. Pardon, dit un huissier, je ne puis pas vous laisser entrer. — Tu ne connais donc pas cet homme-là ? dit un prélat à l’huissier. — Si bien, monseigneur, mais j’obéis aux ordres que j’ai reçus. — En ce cas, dit l’artiste, tu diras à ton maître que s’il veut me parler, il me cherche ailleurs. Et il s’éloigne, descend précipitamment l’escalier du palais, rentre chez lui, charge ses domestiques de vendre ses meubles à des juifs, fait louer trois chevaux de poste, part à toute bride pour Florence, et arrive de nuit à Poggibonzi, château de la république, à dix-huit milles de Rome. C’est là qu’il s’arrête pour prendre du repos et dormir jusqu’au lendemain. Il est plus aisé d’imaginer que d’exprimer la colère de Jules II. Cette belle barbe blanche qu’aimait tant Michel-Ange s’épanouissait sur une poitrine juvénile. A peine l’artiste entrait à Poggibonzi, que cinq sbires descendaient de cheval, pénétraient dans l’appartement du sculpteur, auquel ils enjoignaient de retourner à Rome. Ils parlaient haut et insolemment ; mais Buonarotti, jeune, robuste, plein de courage, avait à ses côtés une bonne épée, à son service deux domestiques dévoués, et au besoin, pour le soutenir, les gens de l’auberge. Il menaça les sbires de les jeter par la fenêtre s’ils usaient envers lui de violence ; les sbires se radoucirent, et le prièrent poliment de prendre connaissance de la lettre dont ils étaient porteurs. Jules II l’avait écrite à la hâte ; elle ne contenait qu’une ligne : Reviens, ou je te chasse. Michel-Ange s’assit, prit de l’encre, et répondit au saint-père, en quatre lignes, qu’il ne retournerait point à Rome ; que, serviteur fidèle et dévoué, il n’avait pas mérité d’être chassé du palais de Sa Sainteté comme un malotru. Les gens du pape reprirent le chemin de Rome, et Michel-Ange, le lendemain, se mit en route pour Florence. Nous connaissons assez Soderini pour nous figurer la frayeur dont il fut saisi, quand Michel-Ange lui raconta la scène de Poggibonzi ; le gonfalonier était aussi peureux qu’Érasme. Chaque jour c’était un nouveau courrier apportant des dépêches de Rome ; une lettre en suivait une autre : le pape voulait absolument qu’on lui rendît son artiste ; mais son langage, bien loin, comme on le prétend, d’être empreint de colère, était plein de douceur et de modération. Michel-Ange, disait-il dans une dépêche adressée aux prieurs de la liberté et au gonfalonier, a peur de revenir ; il a tort, nous ne lui en voulons pas, car nous connaissons les artistes. Promettez-lui en notre nom, s’il revient, l’oubli du passé et nos bonnes grâces apostoliques d’autrefois. Soderini fit appeler Michel-Ange : Sais-tu bien, lui dit-il en lui montrant la dernière lettre de Sa Sainteté, que tu as fait au pape une insulte que le roi de France lui-même n’aurait pas osé se permettre. Il ne s’agit plus de te faire prier. A Rome ! mon enfant ; car pour toi je ne veux pas me mettre le pape sur les bras, et compromettre la république : à Rome ! L’artiste, qui ne voulait pas contrarier son protecteur, ne répondit rien ; mais le lendemain, sans bruit, il fit ses préparatifs de départ. Il allait en Orient, où le Grand Seigneur l’appelait pour jeter un pont qui devait réunir Constantinople à Péra. Ce jour-là, Soderini pressait affectueusement la main de l’artiste, et lui disait : Mais tu n’y penses pas ! En orient, au service du Grand Turc ! J’aimerais mieux trouver la mort en retournant à Rome, que d’aller à Constantinople. Le pape n’est pas méchant ; s’il te rappelle, ce n’est pas pour te punir ; c’est qu’il t’aime et qu’il a besoin de toi ; et puis tu partiras avec le titre d’ambassadeur : voilà qui doit te rassurer, Michel-Ange se sentait ébranlé. Sur ces entrefaites, Bologne se soulève et secoue l’autorité du pape, et iules II part de Rome pour mettre à la raison la ville ingrate, qui devait ses franchises, ses splendeurs, ses libertés au saint-siège, et que le pape vainqueur allait exonérer de cet impôt immoral connu sous le nom de datio delle corticelle, en vertu duquel on prélevait 2 ½ pour % sur la dot de la mariée, et 16 soldi sur l’épargne du mari, si la jeune fille n’apportait aucun douaire. — La conquête de Bologne, pensait Michel-Ange, plus encore que le temps, doit avoir calmé le saint-père : il partit pour Bologne. Un matin qu’il entendait, suivant la coutume de la plupart des artistes, la messe à San-Petronio, il fut reconnu par les palefreniers de service, qui, moitié par force, moitié par persuasion, le conduisirent au palais des Seize, où le pape était à table en ce moment. A la vue de l’artiste, la figure de Jules se couvrit d’une rougeur subite. Te voilà donc, lui dit-il ; au lieu de venir nous trouver, c’est nous qui venons te chercher. Michel-Ange était à genoux, demandant humblement pardon à Sa Sainteté. Le pape, la tête baissée, regardait de côté le suppliant sans mot dire, quand un prélat, à l’instigation du cardinal Soderini, le frère du gonfalonier, s’approcha, et haussant l’épaule : Très saint père, dit-il, il faut lui pardonner ; ces gens-là n’en savent pas davantage. Le pontife releva la tête, et, d’un air de pitié, s’adressant au maladroit personnage : Fi donc ! dit-il, vous lui dites là une sottise que je ne lui aurais pas adressée, moi ; allez-vous-en. Il fallait une victime au pape ; elle venait fort heureusement de s’offrir en sacrifice. Le pape content bénit l’artiste, et la paix fut faite entre les deux puissances. Pour sceller la réconciliation, le pape voulut que Michel-Ange élevât au vainqueur des Bolonais une statue en bronze, qui serait placée en face du palais des Seize. Quelques semaines s’étaient à peine écoulées, que le sculpteur présentait au pontife le modèle en terre cuite de la statue. Il avait besoin de consulter Sa Sainteté. La -nain droite du pontife s’étendait pour bénir : Mais que fera la main gauche, très saint-père ? demandait l’artiste à Jules ; que mettre dans cette main ?.... un livre ? — Un livre ! à moi ! ..... Je ne suis pas un écolier. Je veux une épée, répond Jules II, qui se rappelait sans doute cette antique mosaïque de Saint-Jean de Florence, où le Sauveur, le jour du jugement dernier, de la main droite semble dire aux justes : Venez, les bénis de mon père ; et aux réprouvés, de la main gauche : Allez, maudits, au feu éternel. On connaît le sort de cette statue, que l’épée dont l’avait armée le grand artiste ne put préserver des insultes de la populace, qui la mit en pièces au mois de mai 1514, lors du retour des Bentivogli à Bologne. Michel-Ange, après l’inauguration de la statue, à la fin de décembre 4507, prit le chemin de Rome, où le pape l’avait précédé. Quelques mois plus tard, en 4508, Raphaël, appelé par Jules Il, entrait dans la capitale du monde chrétien, qu’il devait orner de tant de chefs-d’œuvre. Nous essayerons de les décrire en racontant la vie du peintre sous Léon X. Le nombre des étrangers qui se rendaient à Rome chaque année aux cérémonies de la semaine sainte croissait incessamment ; la chapelle qu’avait fait construire Nicolas V était insuffisante pour les recevoir. Sixte IV eut l’idée d’en faire un sanctuaire que la peinture et la sculpture devaient orner à l’envi ; il voulait une œuvre magnifique. Baccio Pintelli, architecte florentin, fut chargé d’exécuter les travaux de cette chapelle, qui prit dès lors le nom même du fondateur, qu’elle a conservé de nos jours. Baccio Pirtelli appela, pour la décorer, les plus grands peintres de l’époque : Sandro Botticelli, Dom. Ghirlandajo, Cosimo Roselli, Luca Signorelli. Derrière l’autel, sur ce vaste espace où se déroule la scène du Jugement dernier, le Pérugin avait peint à fresque, avec son admirable talent, la Naissance de Jésus, celle de Moïse, et l’Assomption de Marie. Jules II n’était pas content ; il voulait une œuvre d’une seule main, grandiose, toute chrétienne, qui couvrit la voûte du sanctuaire. Michel-Ange était là. Or, c’est à peine si notre Florentin connaissait la méthode de peindre à fresque. Aussi, après quelques jours de réflexion, se hâta-t-il de se présenter au Vatican pour supplier Sa Sainteté de jeter les yeux sur un autre artiste. Jules II fut sans pitié ; il lui fallait des fresques de Michel-Ange. L’artiste prend son parti, écrit à Florence, et bientôt voit arriver à Rome, dans son atelier, quelques peintres qui se mettent aussitôt à l’œuvre : pauvres ouvriers que Buonarotti renvoie bien vite, et dont il efface avec la brosse les malheureux essais ! Il travaillera seul ; le voilà qui dresse les échafauds, qui gratte les murs, qui fait tomber lei anciennes peintures, qui prépare sa palette, qui prend son pinceau et commence quelques figures dont il paraît assez content ; mais, en se confondant, les couleurs s’écaillent et se détachent. Qu’on juge de sa douleur et de la joie de ses ennemis ! Alors, le désespoir dans l’âme, il retourne au Vatican ; mais le pape est plus que jamais inflexible. Heureusement Julien de San-Gallo vient au secours de Buonarotti, en lui donnant un procédé pour prévenir la formation de ces bulles qui tantôt restaient sur le mur comme autant d’ombres disgracieuses, tantôt, en se brisant, formaient comme autant de taches sur la muraille. Maître de ce secret, Michel-Ange se remet à l’œuvre, sûr cette fois de lui-même. Quelquefois le pape impatient voulait connaître les progrès de l’œuvre du Florentin ; il arrivait sans se faire annoncer, posait le pied sur l’échelle, et en gravissait les marches soutenu par la main de Michel-Ange. Debout sur l’échafaud, il restait quelques minutes en contemplation devant des peintures dont aucune école n’avait encore offert le modèle. Créations exagérées, fantasques, désordonnées, mais pleines de flamme, et comme Jules II en aurait produit si Dieu l’avait fait peintre. On eût dit que le pape craignait de mourir avant l’achèvement de cette œuvre colossale. Un jour que (lu bas de l’échelle il disait à l’artiste : Quand finiras-tu donc ? Michel-Ange, sans quitter son pinceau, répondit, froidement : Quand je pourrai. — Quand je pourrai, reprit le pape ; tu veux donc que je te fasse jeter en bas de ton échafaud ? Le peintre continua son travail sans s’inquiéter de la menace du souverain pontife ; et il avait raison, car à peine Jules s’était-il touché le front de l’anneau du pêcheur, que sa colère s’apaisait, et qu’il se mettait à sourire comme un doux enfant : tout était oublié. Il est vrai qu’il ne s’agissait pas cette fois de celle qu’il nommait son épouse. Vous pouvez l’offenser personnellement, comme ont fait Borgia, Maximilien, Baglioni ; dites qu’il s’enivre, ainsi que Louis XII le raconte, il sourira, et montrera la carafe d’eau pure qu’il vide deux fois dans un de ses repas qui durent le temps de dire un Pater et un Ave. Mais n’imitez pas Carvajal qui s’est révolté contre l’Église, car il attendrait l’heure de votre repentir pour vous pardonner. Si Jules II obéissait aux sympathies de sa nature en attirant à lui Michel-Ange, il n’oubliait pas les artistes dont l’Italie s’enorgueillissait à si juste titre à cette époque. Presque tous, en apprenant l’exaltation du cardinal de la Rovere, avaient deviné que le pape nouveau, une fois sa grande mission accomplie, la délivrance de l’Italie, voudrait illustrer son règne par de merveilleux monuments. Ils arrivaient donc en foule à Rome, où tous trouvaient du travail et de la gloire. Raphaël, chargé de peindre les chambres du Vatican, avait montré, dans la dispute du Saint-Sacrement, que, sans rival comme coloriste, il pouvait disputer à Michel-Ange la palme du dessin. Bramante avait reçu du souverain pontife l’ordre de démolir l’ancienne basilique de Saint-Pierre et d’édifier à la place un temple qui devait effacer en splendeur celui que Salomon avait autrefois bâti au Seigneur. Saint-Pierre de Rome est l’œuvre de Jules Il. Il en conçut l’idée, il en rêva les proportions gigantesques, malgré, dit un historien contemporain, l’opposition de presque tous les cardinaux, qui ne pouvaient sans douleur voir tomber cette vieille église de Constantin, sanctifiée par les ossements de tant de bienheureux, vénérée dans toute la chrétienté, et le siége de si hauts faits catholiques. A gauche de l’antique basilique s’élevait jadis une colline qu’on nommait la colline des Devins, parce que le peuple, après l’expulsion des Étrusques, était venu, dit-on, y consulter l’oracle sur les destins de Rome. C’est près de là qu’étaient le cirque de héron, les temples d’Apollon et de Mars, la voie Aurélienne, le pont triomphal, orné de statues, de trophées et d’insignes militaires. Le pont que seul pouvait traverser celui qui avait eu les honneurs d’une victoire sur l’ennemi, fut livré au peuple lorsque Constantin transféra le siège de l’empire à Constantinople, et détruit à l’invasion de Rome par les Goths sous Totila. La basilique constantinienne avait reçu toutes sortes de beaux noms. Léon le Grand la nommait la couche glorieuse de la principauté de Saint-Pierre ; Grégoire IX, l’astre de cette terre ; Nicolas III, la tête de l’Église catholique. Bramante fut sans pitié pour l’œuvre impériale ; tout tomba sous les coups de son marteau : colonnes d’albâtre, bas-reliefs rehaussés d’or, statues de marbre, mosaïques grecques. Des peintures de Giotto une seule fut conservée. Après trois ans de travaux préparatoires, on posa la première pierre du nouveau temple. Une messe solennelle fut célébrée ; trente cardinaux y assistèrent. Jules II, en habits pontificaux, descendit dans les fondements de l’un des piliers de la coupole, de celui où se trouve la statue de sainte Véronique, et bénit un bloc de marbre sur lequel était bravée cette inscription : † Ædem prinelpis apostolorum In Vaticano vetustate et situ Squalentem a fundamentis Restituit Julius Ligur. Pont. Max. An. MDVI. Bramante était alors âgé de soixante-deux ans. Il avait achevé les quatre piliers de la coupole, et cintré les arcades qui les lient entre eux ; il se préparait à commencer l’entablement circulaire qui sépare le tambour de la coupole des arcades sur lesquelles il porte, et allait terminer la branche occidentale de la croix, quand il mourut et fut inhumé dans l’église même de Saint-Pierre. Il est malheureux qu’aucune inscription ne rappelle la place où sont ensevelis les restes du grand architecte. Il emportait avec lui le secret de son plan, car c’étaient de simples maçons qu’il avait pris pour l’aider dans des travaux dont il ne voulait partager la gloire avec personne. En mourant, il désigna pour le remplacer Raphaël d’Urbin, auquel furent adjoints Julien de San-Gallo et frère Joconde. A peine les nouveaux architectes eurent-ils jeté un coup d’œil sur l’œuvre de Bramante, qu’ils signalèrent des disproportions évidentes entre la coupole et les piliers destinés à la supporter. La coupole, qui égalait en volume le Panthéon d’Agrippa, était surchargée de colonnes et couronnée d’une lanterne ; les piliers travaillaient et menaçaient de s’ouvrir ; il fallut modifier le plan de Bramante. C’est Bramante qui, à l’inspiration de Jules II, éleva la grande chancellerie et l’église succursale de Saint-Laurent in Damaso, les deux corridors qui unissent les jardins du Belvédère au palais pontifical, la logia ou galerie de douze cents pieds de longueur, et qui, dans le principe, devait s’harmonier avec d’immenses édifices dont il avait jeté les fondements, et que la mort ne lui permit pas d’achever. Bramante était une de ces natures vigoureuses formées sur le type de Michel-Ange et de Benvenuto Cellini. Parfois vous le voyez qui laisse le ciseau pour monter à cheval, couvert d’acier de la tête. aux pieds, et pour suivre à la guerre son maître Jules II. Au camp, lorsqu’il ne se bat pas, il s’amuse à faire des sonnets. L’expédition terminée, il retourne à Rome avec son protecteur, se remet à l’ouvrage, peint, sculpte et construit. Jules II voulait que Rome n’eût pas de rivale dans le monde. Il fallait donc lui donner ce qui manquait alors à toutes les villes, de l’air. Il fit détruire des édifices, élargir des places et tracer des rues. C’est à lui que Rome doit la rue qui porte le nom du pontife, strada Giulia, qui s’ouvrait devant le pont des Triomphes, qu’il avait le dessein de réédifier. La rue des Banchi, en face du pont Saint-Ange, fut construite sous son règne. On lui doit le canal souterrain qui, de San-Antonino, conduit l’eau, à plus de cinquante palmes de profondeur, au jardin du Vatican, le long du Vianato, au Belvédère, au Forno, au Cortile de San-Damaso ; la restauration de l’aqueduc dell’ Acqua Vergine ; la Monnaie, rue des Banchi, où fut frappé, en 1505, le premier giulio ; l’agrandissement du musée du Vatican, où il rit placer le Laocoon, l’Apollon, le torse d’Hercule, l’Ariadne endormie, l’Hercule Commode, la Sallustia Balbia Orbiana, femme d’Alexandre Sévère, sous la figure de Vénus ; diverses chapelles à saint Pierre ès liens, aux douze saints apôtres, à sainte Agnès, lors des murs, dans la Santa Casa de Lorette ; la citadelle de Civita-Vecchia, sur les dessins de Michel-Ange, et celle d’Ostie. Il protégea Balth. Peruzzi, Raphaël, Jean Razzi (Soddoma), Jules Romain. Il établit au Vatican une imprimerie d’où sortirent, sous son règne, un grand nombre de belles éditions d’auteurs classiques. Quand Thomas Inghirami, en face du sacré collège, en racontant la vie de Jules II, s’écria : Cette ville, naguère si pauvre et si mesquine, il en a fait quelque chose de grand, de magnifique, de splendide, digne en tout du nom qu’elle porte ; un murmure approbateur circula parmi les cardinaux. Th. Inghirami était conservateur de la Vaticane. Jules II lui avait donné cette place si justement enviée, pour le récompenser de tous les beaux manuscrits qu’il avait découverts, en 1493, dans la bibliothèque du monastère de Saint-Colomban, à Bobbio. C’est là que Carlo Fea soupçonne qu’existait la République de Cicéron, que le cardinal Maï trouva dans des palimpsestes, où notre conservateur ne l’aurait pas cherchée sans doute. Inghirami avait d’autres titres à la faveur d’un pape que l’art de rassembler ou de découvrir des manuscrits. Il logeait dans son cerveau ce qui manquait à une bibliothèque. On peut en dire autant de monseigneur Maï. Le monde avait alors les yeux sur Rome. A la lueur de cette lumière qu’elle a fait lever, les peuples étrangers commencent à se mettre en route pour visiter l’Italie. C’est l’Allemand qui le premier entreprend ce docte pèlerinage. Mais à peine a-t-il franchi les Alpes, qu’il se met à regretter son pays. Ce sont d’autres mœurs, d’autres habitudes, une autre langue, auxquelles il s’accoutume avec peine. La nature nouvelle qu’il a devant les yeux ne dit rien à son cœur. Où sont ses chênes séculaires, ses ombreuses forêts, ses cascades qui tombent de mille pieds de haut, ses neiges, ses précipices ? Il n’aperçoit plus sa petite violette croissant au pied d’un glacier, ni son rhododendron que le vent agite sur la cime d’un rocher. Fleurs, verdure, végétation, tout vient, passe et meurt vite en Italie. Sa vue s’égare à travers l’espace sans trouver où se reposer. Le jour, la chaleur est étouffante ; la nuit, l’air humide et froid. S’il descend dans une auberge, le vin que l’hôtelier lui sert monte à la tête, et, quand il se remet en route, il faut engager une longue dispute avec l’aubergiste qui veut le rançonner. A-t-il soif en chemin, il ne trouve pas, comme dans son pays natal, des fontaines rustiques improvisées à l’aide d’une branche d’arbre ; le soleil a verdi l’eau qu’il puise dans le creux de la main pour la porter à ses lèvres. Qu’est devenue cette petite vierge, taillée grossièrement par le pâtre, placée à l’angle dit chemin dans un buisson d’églantiers, et devant laquelle il s’agenouillait quand il était fatigué ? S’il entre dans une église, il voit l’or et le marbre étinceler de toutes parts ; mais plus de verre coloré qui porte sur la dalle cette douce lumière si propice à la méditation. Voilà les plaintes qu’exhale notre Allemand, et que Luther n’a cessé de reproduire. Mais l’homme du Nord est injuste ; parce qu’il ne comprend pas la nature méridionale, il la calomnie. C’est bien autre chose quand il arrive à Rome. Il cherche autour de lui ; ses yeux se mouillent de pleurs, et il s’écrie douloureusement : Voyez donc, parmi les prélats et les cardinaux, pas une figure allemande ; il n’y a des Allemands que parmi les valets d’écurie, les porteurs d’eau et les muletiers. Alors le mal du pays le prend ; il quitte Rome, mécontent, irrité, Rome qu’il n’a vue qu’à travers un oculaire infidèle ; et, de retour dans sa Teutonie, il jette aux ultramontains ces insolentes paroles : Oui, le jour luira bientôt où nous ferons expier aux Italiens leurs grossiers dédains, où nous leur apprendrons si nous sommes des barbares, des ignorants, des muets ; notre pays se latinisera, et deviendra latin plus que le Latium lui-même. Voyons si nous trouverons dans un autre enfant de la Germanie inférieure, qui vient visiter à son tour l’Italie, plus de calme et de raison. |