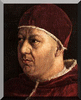HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE VIII. — SAVONAROLE. - 1494-1497.
|
Enfance de
Savonarole. - Il entre et prêche au couvent de Saint-Marc. - Il commente
l’Apocalypse en chaire. - Belles images qu’il en tire. - Ses rapports avec
Laurent de Médicis. - Passe pour prophète. - Sa visite à Charles VIII. -
Ascendant qu’il prend sur les esprits a Florence. - Rédige un projet de
constitution pour la république. - Merveilles qu’il opère par ses
prédications. - Sa guerre au paganisme. - Comment il en triomphe. - Idées
esthétiques du moine. Le jour où Charles VIII quittait Florence, le 17 novembre 1494, pour poursuivre sa grande expédition, mourait Jean Pic de la Mirandole, assez heureux du moins pour ne pas avoir été témoin des outrages prodigués à ses bienfaiteurs. Pic, depuis longtemps, comme nous l’avons dit, ne cherchait plus la vérité dans le vide des grandes routes ; il l’avait trouvée dans une église, au pied d’une croix. Ce n’était plus le savant orgueilleux qui jetait, de Rome, ses fastueux défis aux intelligences de tous les pays ; il disait aujourd’hui, comme Tritheim, aimer c’est savoir, et il aimait vivement.
Je veux vous révéler, leur dit-il, un secret céleste que je n’ai voulu dire encore à personne, parce que je n’étais pas sûr de ce qui m’était annoncé comme je le suis à cette heure. Vous connaissiez tous le comte Jean Pic de la Mirandole, qui demeurait parmi vous à Florence, et qui vient de mourir. Je vous annonce que son âme, grâce aux prières de nos frères et à quelques bonnes œuvres que Pic lit sur cette terre, est en purgatoire : priez pour sa délivrance. Benivieni, le chanoine de Santa-Maria del Fiore, croit au salut de son docte ami, sur la parole de Savonarole. Dieu, dit-il, a dû le révéler en songe à son grand serviteur frère Hieronimo. Le merveilleux philologue repose à côté du poète, dans la même tombe, à Santa-Maria Novella. Jamais deux âmes ne s’étaient si tendrement aimées. Nous allons étudier un homme dont l’influence sur les destinées de la maison de Médicis fut immense. Savonarole est leur mauvais génie. Depuis la mort de Laurent, il n’est pas de jour où le dominicain, du haut de l’une des chaires de Florence, n’ait excité les esprits contre Pierre, leur héritier. Pierre, tant que Savonarole vivra, tentera vainement de ressaisir le pouvoir ; toujours il rencontrera le moine à son poste, veillant comme l’ange à la porte du temple, et prêt à frapper de verges le nouvel Héliodore qui tenterait d’y pénétrer de force. Longtemps Florence n’aura pas d’autre roi que le dominicain : sa robe blanche apaise ou soulève le peuple ; à l’église, on monte jusque sur l’autel pour l’écouter ; dans les rues, il a pour cortége des enfants, qui annoncent par leurs cris de joie la venue de leur père bien-aimé ; à la seigneurie, ses volontés sont des ordres ; au couvent, on se lève la nuit pour voir si sa cellule n’est pas éclairée de quelque lumière surnaturelle ; les femmes malades touchent les franges de sa robe de bure, et se disent guéries ; les poètes eux-mêmes, gens de peu de foi au moyen-âge, sont séduits et croient à ses visions. Il n’est pas dans l’histoire de problème plus mystérieux : Savonarole a fait de véritables passions ; il a des ennemis et des apologistes fanatiques ; pour les uns c’est un bienheureux, pour les autres un factieux. Mais tous confessent que ce fut une des plus grandes lumières de son siècle ; que jamais parole humaine ne fut plus séduisante ; que jamais moine n’eut, aux yeux du monde, de plus admirables vertus ; que jamais prédicateur ne fit couler autant de larmes ; que jamais martyr, au milieu des flammes, n’eut une figure plus radieuse. Jérôme Savonarole naquit à Ferrare le 21 septembre 1452. Enfant, il aimait l’étude et la prière, les couvents, et surtout la blanche soutane des dominicains, les grands prédicateurs de l’époque. Quand l’un d’eux montait en chaire, on était sûr de trouver Jérôme debout en face de l’orateur, dont il suivait tous les mouvements. Un jour qu’il assistait au sermon que prêchait un frère, il se sentit troublé jusqu’au fond du cœur par les paroles de l’orateur, et résolut d’abandonner le monde et de s’ensevelir dans la solitude d’un monastère : il avait alors vingt-deux ans. Sans rien dire à ses parents, il quitte Ferrare le 24 avril, prend la route de Bologne, et vient frapper à la porte du couvent de Saint-Dominique. Quelque temps après il recevait l’habit clérical, et écrivait à son père : — M’aimez-vous ou non ? Si vous m’aimez, comme j’en suis convaincu, vous savez bien qu’il y a en moi deux substances, l’âme et le corps. Préférez-vous le corps à l’âme ? Vous direz non, parce que, sans cela, vous ne m’aimeriez pas réellement ; vous aimeriez en moi la plus vile partie de moi-même : mais, si vous préférez en moi l’âme au corps, vous approuverez le parti que j’ai dû prendre. Ses supérieurs comptaient en faire un professeur, car il avait la parole facile, le geste magnifique, l’œil d’une rare beauté. Savonarole enseigna donc la métaphysique à Ferrare ; mais il s’ennuya bientôt de la langue qu’il était obligé de parler : Aristote le fatiguait par sa sécheresse. Pour trouver un aliment à son imagination rêveuse, il se mit à étudier l’Écriture. La parole de Dieu le charma : il n’eut plus qu’un livre, qu’il lisait la nuit et le jour, l’Ancien et le Nouveau Testament. Ferrare, pressée par les Vénitiens, fut obligée de faire évacuer le couvent des dominicains ; Savonarole, regardé comme une bouche inutile, prit le chemin de Florence. A Florence, au couvent de Saint-Marc, il partagea son temps entre la confession et la prédication : par goût, il quitta bientôt le tribunal de la pénitence pour la chaire ; il comprenait sa vocation. C’est dans l’intérieur du cloître qu’il annonça d’abord la parole divine. Le site était admirablement choisi : pour temple, un jardin tout plein de beaux rosiers de Damas ; pour pavillon, le ciel ; pour auditeurs, des frères aux robes blanches : comment l’orateur n’aurait-il pas été inspiré ? Des jardins de Saint-Marc il passa d’abord à Santa-Maria Novella, cette église que Michel-Ange appelait son épouse ; puis à Santa-Maria del Fiore, le chef-d’œuvre de Brunellesco. Il aimait à commenter l’Apocalypse, parce qu’il trouvait dans le livre de l’Apôtre des images toutes matérielles, telles que le cheval blanc, la coupe de vin empoisonnée, la clef de l’abîme, dont il se servait pour effrayer ses auditeurs. Ce qu’il cherchait surtout, c’était à réveiller de leur sommeil toutes ces âmes de chair réunies autour de lui. On voit qu’il connaissait admirablement son auditoire. A des hommes comme Florence en offrait alors, commerçants enrichis par la fraude, usuriers qui spéculent sur la faim, jeunes seigneurs qui courent les tabagies, le jeu et les femmes ; à des courtisanes qui affichent publiquement leurs désordres ; à des artistes qui cherchent leurs inspirations dans l’Olympe païen ; à des âmes amollies par le luxe, la bonne chère et la débauche ; à des philosophes qui préfèrent à l’Évangile le Criton de Platon, il fallait des épouvantements tout charnels, des menaces sensuelles, des images prises dans le monde visible. L’orateur avait raison de s’armer d’une lanière, d’une épée, d’une coupe empoisonnée : le Christ ne faisait pas autrement sur le perron de ce temple d’où son fouet chassait les vendeurs. La voix sourde et caverneuse du prédicateur, sa figure où, de chaque côté, deux os en saillie semblaient percer la peau, son teint blême, ses doigts décharnés à travers lesquels pouvait passer la lumière, ses yeux azurés surmontés de longs sourcils roux, étaient autant d’instruments de terreur. Souvent, en descendant de chaire, on le voyait essuyer son front tout humide de sueur. Rentré dans son couvent, il se jetait à genoux pour prier. Bientôt on entendait frapper à la porte du monastère : c’était une Madeleine, enveloppée de sa mantille noire, qui demandait à se confesser ; un vieillard qui venait livrer, pour qu’on la brûlât, une peinture lascive ; un usurier dont les poches étaient pleines d’or qu’il offrait de restituer ; des paralytiques qui demandaient à toucher la ceinture du dominicain. On affirmait que sa robe avait plus d’une fois rendu la vie à des moribonds. Cosme l’orfèvre et le noble Strozzi avaient voulu s’en revêtir, nais on la leur avait refusée. Le soir Savonarole retournait à l’église pour prêcher. Il montait en chaire et continuait son commentaire sur l’Apocalypse : c’étaient d’autres images tout aussi saisissantes que celles dont il effrayait son auditoire du matin. Quand, après trois siècles, nous lisons les discours du moine, nous comprenons l’enthousiasme de la multitude : nous aurions fait comme elle ; nous aurions accompagné notre père jusqu’à l’église, nous aurions essayé de toucher un pan de sa robe, de baiser la poussière de ses pieds ; peut-être même que nous aurions cru tout ce qu’on racontait de lui, ses visions nocturnes, le don qu’il avait reçu de guérir les malades par un simple attouchement, son intuition de l’avenir, et son commerce avec les anges. A dire vrai, quelque chose de réellement merveilleux nous aurait attirés vers lui : c’était sa parole, soit qu’il reproche aux Florentins de boire dans la coupe des réprouvés, c’est-à-dire aux eaux corrompues de l’antiquité païenne ; soit qu’il menace tous ces savants qui crient : Vive la voie de Bersabé, c’est-à-dire le chemin qui n’est éclairé par d’autre lumière que celle de la raison ; soit qu’il s’indigne que les Florentins, comme autrefois les Juifs, préfèrent à la manne du désert les poissons d’Égypte, c’est-à-dire à l’or de la parole divine le plomb vil du rhéteur ; soit qu’arrachant à l’artiste un pinceau tout trempé de couleurs païennes, il lui dise : Je ne reconnais plus ma vierge de Bethléem dans cette jeune fille vêtue comme une courtisane, ma vierge qui ne paraissait jamais en public que sous les habits d’une pauvre petite qui cache jusqu’à son visage ; soit que, frappant sur la poitrine de tous ces philosophes amoureux jusqu’à l’idolâtrie de l’antiquité, il la trouve dure comme de la pierre ; soit qu’il se lamente sur l’ingratitude de Florence, et, prêt à pleurer sur elle dans le désert comme les filles de Sion, il s’écrie douloureusement : Florence ! tu ne détruiras pas mon œuvre, car c’est l’œuvre du Christ. Que je meure ou que je vive, la semence que j’ai jetée dans les cœurs n’en portera pas moins ses fruits. Si tes ennemis sort assez puissants pour me chasser de tes murs, je n’en serai point affligé : car je trouverai bien un désert où je pourrai me réfugier avec ma Bible. N’est-ce pas là de la véritable éloquence, ce doux reflet des rayons de l’éternelle lumière ? Quand le cœur de l’auditeur résiste, Savonarole a des paroles qui le remuent bien vite et lui arrachent des larmes, comme le samedi de la seconde semaine de carême, à Santa-Maria del Fiore. L’orateur n’avait pas obtenu son succès ordinaire ; de sa chaire il n’avait entendu aucun sanglot : il lui fallait des pleurs. Il reste un moment silencieux ; puis, se tournant vers l’autel : Je n’en puis plus, s’écrie-t-il, les forces me manquent. Seigneur, ne dors plus sur la croix, exauce mes prières, respice in faciem Christi lui. Ô glorieuse Vierge ! ô saints bienheureux du paradis ! ô anges ! ô archanges ! ô céleste milice ! priez le Seigneur qu’il ne tarde pas plus longtemps à nous écouter. Ne vois-tu pas, ô mon Dieu, que les méchants se réjouissent, qu’ils se moquent de nous ! Ici chacun nous tourne en dérision, nous sommes devenus l’opprobre du monde. Nous avons prié ; que de larmes nous avons répandues, que de soupirs ! Qu’est donc devenue ta providence ? qu’est devenue ta bonté ? que sont devenues tes promesses ? Seigneur, respice in faciem Christi tui. Ah ! ne tarde pas, afin que le peuple infidèle ne dise pas : Où est leur Dieu ? où est le Dieu de ceux qui ont fait pénitence et jeûné ? Tu vois que les méchants deviennent pires de jour en jour, et qu’ils semblent désormais incorrigibles ; étends ta main, et montre ta puissance. Je ne sais plus que dire, je n’ai plus que des larmes : qu’elles éclatent dans cette chaire. Je ne dis pas, Seigneur, que tu nous entendes à cause de nos mérites, mais par l’amour que tu portes à ton Fils : respice in faciem Christi tui. Prends pitié de ton pauvre troupeau ; ne vois-tu pas son affliction, ses souffrances ? Ne l’aimes-tu plus, mon Dieu ! ne t’es-tu pas incarné pour lui ? n’as-tu pas été crucifié, n’es-tu pas mort pour lui ? Si ma prière n’est pas écoutée, ôte-moi la vie, Seigneur. Que t’a fait ton troupeau ? il ne t’a rien fait ; il n’y a que moi de pécheur. Mais, Seigneur, ne renarde pas à mes iniquités ; renarde plutôt à ton amour, regarde à ton cœur, regarde à tes entrailles, regarde à ta miséricorde : miséricorde, ô mon Dieu ! Il fallait bien que les larmes éclatassent. Maintenant comprend-on qu’un moine qui avait visité l’Italie ait osé dire, en face du soleil, que personne avant lui ne savait ce qu’était l’Évangile, ce qu’était le Christ, ce qu’était la rémission des péchés ? Mais les sermons de Savonarole étaient imprimés depuis longtemps, quand Luther proférait ces étranges paroles ! Toutes ces belles images de salut, de rémission, de rédemption, de résurrection dès cette vie, que le dominicain trouvait en chaire, c’était la Bible qui les lui fournissait. Dans ses sermons, rien n’a la voix haute et ne parle librement comme le sang du Christ. Si, par intervalles, son cerveau semble s’épuiser, comme sa voix s’éteindre, c’est dans les bras de la croix, au pied d’un autel, que notre moine va les rafraîchir et les raviver ! Cette parole qui allait saisir toutes les supériorités intellectuelles ou sociales, auxquelles le peuple ne pardonna jamais, les magistrats dans la chambre du conseil, les juges au prétoire, les marchands d’argent au milieu de leurs coffres-forts, les grandes dames dans leurs boudoirs, les artistes clans leurs ateliers, valait à l’orateur d’ardentes sympathies. Malheureusement trop souvent le prêtre s’effaçait devant le tribun ; trop souvent Gracchus se cachait sous la robe du dominicain. Dans un l’État républicain, on peut pardonner au prieur ses emportements contre la tyrannie ; mais dénoncer Laurent de Médicis comme un tyran, c’était outrager l’Esprit-Saint, qui de ses ailes couvrait la chaire du prédicateur. Nous lisons, dans une histoire manuscrite, que Laurent fit un jour prier le père, par cinq des principaux citoyens, de modérer son langage : le prêtre répondit fièrement qu’il continuerait de parler. Le Magnifique le laissa dire. Et quelques jours après, c’était en 1490, le dominicain annonça, en ternies couverts, la mort prochaine du Magnifique. Laurent laissa prophétiser le moine. Savonarole en voulait aux Médicis, dont l’or, disait-il, avait corrompu la population florentine. Lorsqu’il eut été élu prieur de Saint-Marc, on lui conseilla d’aller remercier le Magnifique. Et pourquoi ? demanda le père : qui m’a nommé prieur ? Dieu ou Laurent ? Dieu, n’est-il pas vrai ?.... Je n’irai pas au palais. Laurent prit le parti de venir au couvent. Père, dit un frère à Savonarole, c’est une personne de distinction qui se présente au monastère. — Son nom ? — Père, c’est Laurent de Médicis. — Et qui vient pour prier ? Laissez-lui faire ses dévotions : je ne veux pas qu’on l’interrompe. Il faut que je le voie cependant, disait Laurent à Politien, et que je lui parle. Il imagina de faire déposer par son secrétaire un grand nombre de pièces d’or dans le tronc du couvent. Le frère, en l’ouvrant, jette un cri de surprise et de joie, et court raconter sa trouvaille au prieur. Il n’y avait qu’un prince, et un prince comme le Magnifique, qui pût faire des dons semblables. Laurent disait : Le prieur sera forcé de venir me remercier. Il se trompait : Jérôme, en prenant une à une ces belles pièces, disait : Ceci pour les besoins de notre couvent, ceci pour les pauvres de Saint-Martin, ceci pour faire dire des messes pour le salut du donateur. Ce fut là tout ; il ne prononça pas même le nom de Laurent. On risquerait de méconnaître Savonarole, si l’on ne voyait en lui qu’un des plus merveilleux artistes en parole qui jamais aient existé : son éloquence n’expliquerait pas suffisamment l’ascendant qu’il exerça si longtemps sur le peuple de Florence. Machiavel a dit qu’il fut un homme de science, d’habileté, de courage, qualités dont l’orateur pourrait au besoin se passer, mais que doit posséder quiconque veut gouverner l’opinion. Savonarole aurait pu choisir toute autre condition que celle du cloître : il eût manié le ciseau aussi bien que la plume, le pinceau aussi bien que la parole ; s’il l’avait voulu, il aurait été plus grand philosophe que Ficin, rhéteur plus habile que Politien, et poète plus admirable que Sannazar. En lisant ses sermons, on voit qu’il a sondé toutes les sources littéraires connues de son époque ; qu’il s’est inspiré du Christ, de Moïse, d’Homère, de Platon, d’Aristote ; qu’il connaît ce qu’on nommait alors la doctrine d’Alexandrie ; qu’il a étudié l’astronomie, la physique, la mécanique et les sciences naturelles, et surtout qu’il a médité longtemps sur les lois et les constitutions de la Grèce et de l’Italie antiques. C’est à l’aide de ces lumières toutes naturelles que, plus d’une fois, Jérôme lut dans l’avenir comme dans un livre ouvert : l’étude lui révélait ce que le peuple croyait que l’Esprit-Saint lui soufflait à l’oreille. Longtemps avant l’invasion des Français, il avait annoncé ou prédit, si l’on veut croire au récit de ses panégyristes, la venue de Charles, la chute des citadelles italiennes, et le trot du cheval royal du nom de Savoie, que Dieu devait conduire par la bride jusqu’à Naples. Dès que le Florentin, avec son imagination amoureuse du merveilleux, vit l’armée française franchir les Apennins, il salua du nom de prophète le moine de Saint-Marc. Et vraiment il pouvait croire que Dieu se communiquait à cette créature d’élite, véritable ascète de la Thébaïde, qui prie la nuit et le jour ; à cet ange de pureté, qui n’a jamais levé les yeux sur une femme ; à ce docteur évangélique qui pratique si bien tout ce qu’il prêche. A mesure que l’armée royale s’avançait, il semblait que l’illumination céleste devînt pour Savonarole plus abondante ; son langage était aussi plus transparent. Il disait aux Florentins : n’essayez pas de résister, vos murailles vont tomber ; et en ce moment les forteresses de l’État ouvraient leurs portes au conquérant. Quelques âmes moins enthousiastes que celles qui se pressaient dans l’église de Santa-Maria del Fiore pensaient avoir le secret de l’accomplissement de ces prédictions : c’étaient notre historien Comines, qui connaissait les relations intimes d« moine avec les membres de la seigneurie ; J. Burchard, qui savait que les frères de Saint-Marc, ces grands confesseurs de l’époque, venaient raconter au prieur certaines confidences qu’ils avaient reçues de leurs pénitents, en dehors du saint tribunal ; et les cousins de Pierre de Médicis, qui, chassés de Florence, s’étaient réfugiés à la cour de Charles VIII, dont ils faisaient connaître les projets à Savonarole. Mais le peuple s’obstinait à voir un prophète dans le grand prédicateur. Avouons qu’il en avait le courage. Quand il se trouvait en face des rois, il leur parlait un langage qu’ils n’étaient point accoutumés à entendre, et les rois devenaient peuple et se laissaient subjuguer. Il y a dans la vie manuscrite du frère une magnifique scène dont la peinture aurait pu s’emparer ; mais il faudrait, pour la retracer, le pinceau de Salvator-Rosa. Charles VIII avait imposé Florence à cent mille écus d’or, dont il avait besoin pour marcher en avant. Il avait donné vingt-quatre heures pour qu’on lui comptât cette somme ; les vingt-quatre heures expirées sans que la ville eût payé sa rançon, il menaçait de la mettre à feu et à sang. Les heures s’écoulaient, et les marchands de la rue de Banchi ne voulaient ni prêter ni donner. Le peuple, répandu dans les rues, criait : Misericordia ! misericordia ! Alors une voix se fit entendre du milieu de la foule : Allez, disait-elle, allez à fra Girolamo. Ce fut une inspiration céleste. On va frapper à la porte du moine : J’irai trouver le prince, dit Savonarole au messager. Suivi de deux de ses frères, il se présente en effet à la demeure du roi, mais les officiers refusent de le laisser passer. Le prieur se retire, entre dans l’église de Santa-Maria Novella, prie longtemps, et, prenant à la sacristie un crucifix qu’il cache sous sa robe, suit, mais seul, le chemin de la Via Larga. Cette fois on le laisse entrer, on lui permet de parier à Charles VIII. Le moine et le roi sont en présence. Savonarole, entrouvrant sa robe, saisit le christ qui reposait sur sa poitrine, et le promenant lentement devant l’œil du prince : Sire, lui dit-il, connais-tu cette image ? C’est l’image du Christ mort pour toi, mort pour moi, mort pour nous sur la croix, et qui en mourant pardonnait à ses bourreaux. Si tu ne m’écoutes pas, tu écouteras du moins celui qui parle par nia bouche et qui créa le ciel et la terre, le Roi des rois, qui donne la victoire aux princes ses bien-aimés, mais qui punit ses ennemis et renverse les impies. Il t’humiliera dans la poussière, toi et les tiens, si tu ne renonces à tes projets homicides ; si tu veux, comme tu l’as dit, réduire en cendres cette malheureuse cité, où il y a tant de serviteurs de Dieu, tant de pauvres innocents qui crient et pleurent devant sa face la nuit et le jour. Ces larmes désarmeront la majesté de mon Dieu ; elles seront plus puissantes que toi et tous tes canons. Qu’importe au Seigneur le nombre et la force ? Connais-tu l’histoire de Sennachérib ? Sais-tu que Moise et Josué n’avaient besoin pour triompher que de quelques mots de prière ? Nous prierons si tu ne pardonnes : veux-tu pardonner ? En achevant, le dominicain agitait devant la figure de Charles VIII l’image du Christ. Le prince, comme si cette image eût été de feu, essayait de tourner la tête, mais il était vaincu ; il fit signe qu’il pardonnait. Et, au sortir du palais, Savonarole annonçait au peuple réuni le succès de son ambassade, et criait aux riches : Apportez-moi des grains, du vin, des vêtements, pour ce pauvre peuple qui souffre de la faim, de la soif et du froid. Tout est prodigieux dans l’histoire du moine. Les Médicis chassés, Florence a besoin d’un autre maître ; car, comme nous l’a dit déjà Machiavel, de république Florence n’a pas même l’idée. Un peuple fou de spectacles, de musique, de chevaux, de carnavals, veut à toute force qu’on satisfasse ses goûts : il lui faut donc un roi. liais comment empêcher ce maître de tomber dans la tyrannie ? C’est le problème que cherchait Florence en ce moment, et que devait résoudre le frère de Saint-Marc. Ce n’est pas, du reste, la première fois qu’on frappe à la porte d’un cloître, et qu’on demande à qui l’habite l’aumône d’une charte pour protéger le peuple contre les mauvaises passions d’un despote. Savonarole renonça pour quelques jours à la chaire, se mit à l’œuvre, et improvisa pour Florence une constitution. La ville, jusqu’à présent, avait été gouvernée par des conseils formés d’éléments divers : le peuple avait le sien, la commune aussi. Laurent de Médicis, en 1482, avait créé le conseil des Soixante-Dix, véritable sénat à vie, où il avait fait entrer ses partisans, et dont la chute de Pierre devait amener la dissolution, Savonarole avait pris Venise pour modèle. Il proposait un grand conseil général qui posséderait l’autorité souveraine, mais dont ne pouvait faire partie que le bénéficié, c’est-à-dire celui de qui l’aïeul, le grand-père et le père avaient été admis aux charges de l’État. Comme il était difficile que le grand conseil, formé de mille citoyens, pût s’assembler et fonctionner incessamment, Savonarole imaginait un second conseil appelé des Quatre-Vingts, et pris dans le grand conseil. Les Quatre-Vingts ou richiesli, âgés de quarante ans au moins, dit ici l’auteur d’une histoire récente de Florence, étaient élus de six mois en six mois. Les seigneurs, les collèges, les Huit de garde et balie, les Dix de guerre, les capitaines du parti guelfe et quelques autres magistratures devaient en faire partie. A ce conseil appartenaient l’approbation des lois — qui devaient aller ensuite au grand conseil —, l’élection des commissaires généraux, des ambassadeurs, la décision de la guerre et de la paix, les jugements sur la conduite des capitaines et condottieri, et les affaires les plus importantes de l’État. Le grand conseil n’adoptait ou ne perfectionnait les lois et ne recevait les pétitions privées qu’après qu’elles avaient été approuvées du conseil des Quatre-Vingts. Dotons cette belle mesure d’ordre public que Savonarole fit passer comme une loi d’État : Que tout citoyen qui aurait été condamné pour délit politique pourrait en appeler au grand conseil. Cette charte fut lue par le dominicain, à la cathédrale, devant le peuple et les magistrats. Savonarole, comme il est aisé de le voir dans son projet de constitution, dont les dispositions principales furent adoptées par la commune, est républicain et non pas démagogue. C’était la bourgeoisie, ce qu’on nommait à Florence le grosso popolo, et non la populace, minuto popolo, qui avait renversé les Médicis ; aussi est-ce la bourgeoisie qu’il introduit surtout dans les conseils de la république. Le mode d’élection qu’il adopte est en tout favorable à la propriété. Ce qu’il cherche, c’est une sage liberté s’appuyant, comme il le dit, sur l’ordre, la probité, la religion, l’intelligence, véritables éléments de conversation et de progrès. Pierre est tombé sous les coups du grosso popolo ; Savonarole tombera sous ceux du minuto populo. Dès ce moment, le rôle de Savonarole grandit : le frère de Saint-Marc est prêtre, magistrat, juge et législateur. On le consulte à la seigneurie comme au confessionnal ; c’est l’homme de tous. II faut le dire à sa louange, il est vraiment digne d’admiration. Si vous l’entendiez en chaire demander à son Dieu de prendre pitié de ce peuple florentin qui refuse de se convertir, vous vous sentiriez ému jusqu’au fond du cœur. Écoutez-le donc un moment : Ô Italie ! ô princes de l’Italie ! ô prélats de l’Église d’Italie ! je voudrais que Dieu vous eût tous rassemblés ici ; je vous montrerais qu’il n’est d’autre remède à vos maux qu’une conversion sincère. Et toi, Florence ! ne te souviens-tu plus que jadis je t’annonçais que tes grandes citadelles tomberaient, que tes grands murs s’écrouleraient, et que Dieu prendrait le cheval du vainqueur par la bride et le mènerait ici ? Crois-moi, crois-moi ; je te dis qu’il ne te servirait de rien de t’appuyer sur tes grands rocs et sur tes hautes murailles ; je te dis, Italie, que tu n’as d’autre moyen de salut que de te convertir au Seigneur... Et toi, Florence ! tu devrais bien croire en moi, et tu n’y crois pas. Fais pénitence, je t’en conjure ; autrement, gare à toi ! gare à toi, Florence ! Mais Florence résistait encore. Ville de plaisirs sensuels, de joies mondaines, de spectacles bruyants, où vous la voyez étaler les robes de ses courtisanes, les chevaux espagnols de ses nobles, les bijoux émaillés de ses orfèvres, la soie de ses marchands ; elle ne veut ni jeûner ni faire pénitence : elle restera païenne. Mais le frère ne perd pas courage : il recommence ses prières, ses adjurations, ses menaces. Il se jette aux pieds de ce crucifix où toujours il trouve de nouvelles consolations et quelquefois des inspirations poétiques, qu’il confie à la marne du premier volume que le hasard place à ses côtés. Il a de nouveau recours à ses lamentables images, et, pour attendrir, il se met en scène, comme le fera plus tard notre Bossuet. Ô ingrate Florence ! ô peuple ingrat, ingrat envers ton Dieu 1 J’ai fait pour toi ce que je n’aurais pas voulu faire pour nies frères charnels. Pour eux je n’aurais pas daigné parler à un seul de ces princes qui m’en priaient dans des lettres que je conserve au monastère. Pour toi, je suis allé, à la rencontre du roi de France, et, quand je me trouvai au milieu de ses soldats, je crus être tombé dans les profondeurs de l’enfer ; et je lui dis des choses que tu n’aurais pas ose lui dire, et il s’apaisa. Et je lui dis des choses, à lui grand-prince, que je n’aurais pas osé te dire à toi, et il m’écouta sans colère. Et ce que j’ai fait pour toi, Florence, m’a valu la haine des religieux et des séculiers..... Mais que m’importe ? Convertis-toi, Florence..... Fais ce que je t’ai dit : crucifie-moi, lapide-moi, mais fais ce que je t’ai dit : tue-moi, je mourrai content. J’ai tout fait pour toi, parce que je t’aime à la folie, parce que je suis fou de toi. Ô mon Dieu ! ô mon Jésus crucifié ! oui, je suis fou de ce peuple : pardonne-le-moi, Seigneur. Florence était entraînée : c’est que cette fois, comme le disait l’orateur dans sa langue pittoresque, le prédicateur était le cheval du Christ. Et alors une révolution s’accomplit, qu’on ne peut humainement expliquer. Florence finit par écouter la voix de son père : elle fait pénitence dans les larmes ; on dirait d’une ville aux purs temps du christianisme, où tout ce qui frappe l’œil ou l’oreille exalte la foi et nourrit la piété. Le soir, quand la journée du travail est achevée, vous voyez de longues files d’ouvriers s’acheminer vers l’église, chantant sur le chemin, de peur de distraction, des cantiques dont le moine a retouché les paroles et la musique. Les paroles anciennes étaient trop mondaines, la mélodie trop profane ; toutes deux parlaient trop vivement à l’imagination. Savonarole aimait avec passion nos vieux airs, comme celui du Pange lingua, de l’Ave maris stella, du Veni creator ; il préférait le plain-chant aux accords trop souvent passionnés de la musique d’église. Toutes ces jeunes âmes peuvent prier maintenant au pied de l’autel, sans crainte que leur regard soit souillé par ces nudités qu’étalait hier encore le temple chrétien. Jérôme est sans pitié pour ces peintures de Vierge, faites trop souvent à l’image de quelques jeunes femmes de Florence renommées par leur beauté : il lui faut, à lui, un peintre qui prie avant de commencer son couvre, et qui cherche au ciel son idéal. Car, disait le père, il n’y a pas de beauté sans lumière, et de lumière sans Dieu. Le soir, avant de se coucher, on récitait le rosaire dans chaque famille. Jérôme avait la plus tendre dévotion à la sainte Vierge, qu’il appelait de toutes sortes de doux noms. C’est dans la jeunesse que Savonarole trouva l’instrument le plus actif de sa propagande réformatrice. Il avait conçu l’idée d’une congrégation formée de jeunes gens appartenant aux diverses classes de la société. Qui voulait en faire partie devait observer les commandements de Dieu et de l’Église, se confesser une fois chaque mois et communier ; assister, les dimanches et les fêtes, à la sainte messe, aux vêpres, au sermon ; fuir les mauvaises compagnies, les jeux, les spectacles, les feux d’artifice, les mascarades ; porter des vêtements sans poches de côté, de petits chapeaux rabattus sur l’oreille ; ne pas lire de romans ; ne jamais se montrer aux concerts, ni sur les places publiques aux exercices des acrobates. Sa république chrétienne était admirablement organisée. A chaque quartier appartenait un capo ou magistrat suprême, qui exerçait ses fonctions sous la surveillance de quatre conseillers. Il y avait, dans la confrérie, des pacieri, chargés de maintenir la paix dans les familles ; des ordinatori, qui réglaient l’ordre et la marche des processions ; des correttori, qui réprimandaient les pécheurs ; des lemosinieri, qui, l’escarcelle en main, demandaient l’aumône, qu’ils versaient ensuite dans le tronc des pauvres honteux ; des lavoranti, qui, la semaine de carnaval, devaient construire sur la voie publique des chapelles ornées de fleurs et de lumières, où le passant s’arrêterait pour recommander à Dieu les âmes folles qui l’offensaient en se masquant. On leur recommandait bien d’empêcher qu’on n’élevât dans les rues des stili et des capannucci. Les stili étaient des poutres qui traversaient une rue dans toute sa largeur, et sous lesquelles une dame ne pouvait passer sans donner quelque pièce de monnaie qu’on allait ensuite dépenser au cabaret. Les capannucci étaient de grands arbres dont le pied était entouré d’étoupes, qu’on enflammait le soir, aux cris de milliers de spectateurs qui souvent en venaient aux mains. Les lustratori étaient occupés, le soir, à chercher dans les immondices des rues quelques perles précieuses qu’on y perd souvent, c’est-à-dire des croix, des reliques, des images saintes, qu’ils devaient religieusement rapporter au couvent de Saint-Marc. Mais la dignité la plus importante, dans cette association religieuse, était celle des inquisitori. L’inquisiteur, pendant toute l’année, le dimanche, parcourait les rues, après vêpres, pour confisquer les cartes, les dés et tous les jeux qu’il pouvait trouver : au besoin, il réclamait l’intervention d’un commissaire nommé spécialement pour l’aider dans son ministère. Chemin faisant, l’inquisiteur rencontrait-il une jeune fille vêtue avec trop de coquetterie, il l’arrêtait et lui disait : Au nom du Christ, roi de cette ville ; au nom de la Vierge Marie, sa mère ; au nom des saints anges, quittez ces beaux habits, ou vous vous attirerez la colère du ciel. La pauvre enfant ordinairement ne soufflait mot, et, toute honteuse, retournait au logis pour changer de robe. L’inquisiteur allait frapper à la porte des riches, des usuriers, des banquiers, des marchands, en disant : Me voici : donnez-moi vos anathèmes, c’est-à-dire vos cartes, vos tables de jeu, vos harpes, vos partitions de musique profane, vos sachets ; vos poudres odorantes, vos miroirs, vos nattes et vos frisons, au nom de Dieu et de la sainte Vierge Marie. Si la maîtresse de la maison apportait aussitôt ces trésors de vanité mondaine, l’inquisiteur lui disait : Soyez bénie. Si elle refusait, l’inquisiteur lui disait : Dieu vous maudira. Mais rarement il avait besoin d’appeler à son aide la colère du ciel : les femmes donnaient souvent jusqu’à leurs bijoux. Un moment le couvent de Saint-Marc fut transformé en bazar oriental, où l’on voyait rassemblées toutes les futilités de la mode : des essences de Naples, des parfums de Florence, des miroirs de Venise, des poudres de Chypre, et jusqu’à des faux tours en cheveux. Savonarole voulait offrir en holocauste à son Dieu toutes ces frivolités d’un monde sensuel. Un jour il fit élever sur la place de’ Signori un capannuccio ou mât de trente brasses de hauteur, autour duquel étaient disposées huit pyramides, divisées chacune en quatorze étages, dont le plus large occupait la base inférieure. La première pyramide contenait, sur divers gradins, des modes étrangères offensant la pudeur ; La deuxième, les portraits des belles Florentines, œuvres de peintres de la renaissance païenne : la Bencina, la Morelia, la Maria de’ Lanzi ; La troisième, des instruments de jeux, comme cartes, dés, triomphes, osselets ; La quatrième, des partitions de musique profane, des harpes, des luths, des guitares, des cymbales, des violes, des cornets ; La cinquième, des pommades, des cosmétiques, des parfums, des poudres de Chypre, des miroirs, des nattes, des tours ; La sixième, les œuvres de poètes érotiques anciens et modernes, tels que Tibulle, Catulle, Properce, Pétrarque, Boccace ; La septième, des travestissements, des barbes postiches, des masques. Sur le sommet du capannuccio était assise la figure grimaçante du Carnaval. A dix heures du matin, on vit s’avancer, à travers les rues de Florence, deux lignes d’enfants vêtus de blanc, la tête couronnée de guirlandes d’olivier, tenant à la main des croix peintes en rouge, et chantant des hymnes et des laudes de la composition de Savonarole. Lés fenêtres étaient tendues de tapisseries, les pavés cachés sous des fleurs. Les fronts se découvraient à la vue d’un petit Jésus, œuvre admirable de Donatello, qui reposait couché sur un lit d’or, et d’une main bénissait la multitude, et de l’autre montrait les instruments de son supplice, la croix, la couronne d’épines et les clous. La procession se rendit d’abord à l’église de Saint-Marc, ensuite à la cathédrale, où l’on distribua aux pauvres les aumônes recueillies par les lemosinieri. Puis la foule fit silence, et un frère entonna une hymne pleine de sainte colère contre le carnaval, et toutes les voix crièrent à la fois : Vive Jésus ! C’était comme le prélude des vengeances que les Frati allaient exercer contre la monstrueuse image arborée sur le capannuccio. Les chants finis, la procession se dirigea vers la place de Signori, où devait avoir lieu le supplice du Carnaval. Tout autour du mât on avait amassé des sarments, de la poudre et des étoupes. Quatre capi vinrent, au signal donné, mettre le feu à toutes ces matières. L’arbre s’enflamma et s’écroula bientôt, emportant dans sa chute toutes les pyramides d’anathèmes, au son des fanfares, du canon, des trompettes, et de la voix joyeuse du peuple, qui dominait tous ces bruits divers. Le paganisme était vaincu, et frère Jérôme allait s’agenouiller au pied des autels pour rendre grâces à Dieu. Cherchez dans l’histoire du christianisme une scène plus merveilleuse ! L’art seul protestait en restant dans les voies du paganisme. Il est vrai que Savonarole avait des idées exagérées en esthétique. Il défendait au peintre et au statuaire d’étudier la nature humaine sur la forme vivante, ou sur l’image sans voile que nous avait léguée l’antiquité. L’artiste devait ressembler à Fr. Angelico da Fiesole, qui priait avant de prendre ses pinceaux, et trouvait ses modèles dans les visions que Dieu lui envoyait pendant le sommeil. Un seul peintre se convertit aux théories du dominicain ; ce fut Baccio della Porta, si connu sous le nom de Fra Bartholommeo di San-Marco. |
 A cette triste nouvelle, Savonarole, le moine du couvent
des dominicains, monte en chaire pour rassurer ses auditeurs sur le sort de
cette âme qui avait fait tant de bruit en ce monde.
A cette triste nouvelle, Savonarole, le moine du couvent
des dominicains, monte en chaire pour rassurer ses auditeurs sur le sort de
cette âme qui avait fait tant de bruit en ce monde.