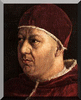HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE VIII. — CHUTE DES MÉDICIS. — 1494-1495.
|
Les princes italiens
favorisent l’expédition de Charles VIII. - Alexandre VI fait de vains efforts
pour arrêter le monarque français. - L’armée française se met en marche,
arrive à Lyon, à Turin, à Pise. - Pierre de Médicis va traiter avec le roi. -
Irritation des esprits à Florence en apprenant la convention signée par
Laurent. - Retour de Pierre à Florence. - Insurrection. - Le cardinal essaye
en vain d’apaiser le peuple. - Il est obligé de fuir. - Le couvent de Saint-Marc
lui ferme ses portes. - Pillage du palais des Médicis. - Entrée de Chartes
VIII à Florence. - Pierre à Bologne. - Le cardinal à Castelio. C’est un triste spectacle qu’offrent, à la veille de l’invasion française, les princes qui règnent en Italie sous le nom de monarques ou de ducs ; au lieu de s’unir contre l’ennemi commun, ils cherchent à le gagner sourdement : ils avaient à la limite de la Péninsule un magnifique boulevard de rocs, de neige et de glace, où ils pouvaient attendre de pied ferme Charles VIII ; mais ils préfèrent rester dans leurs palais. Pas un qui mette sa confiance en Dieu ou dans l’épée que Dieu lui donna ; c’est la peur, la jalousie ou l’ambition qui les mène. Sforce, le duc de Milan, est prêt à reconnaître les droits de Charles VIII sur le royaume de Naples, si le monarque lui laisse l’hermine ducale qu’il a dérobée à son neveu Galéas, et qu’il voudrait emporter dans la tombe ; le roi de Naples redoute l’ascendant de la puissance papale ; s’il pouvait sans trop de honte acheter le repos au prix d’une alliance avec le roi de France, il la signerait demain ; Gênes a de vieilles rancunes contre Venise, sa rivale, et, par vengeance, elle prépare dans les palais Spinola et Doria des logements magnifiques pour la suite du roi ; le duc de Ferrare, Hercule, par haine pour Alexandre VI, s’apprête à saluer la première bannière française qu’il verra flotter en deçà des monts ; Laurent et Jean de Médicis, fils de Pierre-François de Médicis et petit-fils de Laurent l’ancien, frère de Cosme, jaloux de l’autorité de Pierre, leur cousin, ont promis au monarque une forte somme d’argent s’il vient en Italie. La trahison était si manifeste, que Pierre fut obligé de les faire arrêter : ce crime devait être lavé dans le sang ; le tribunal condamna les deux frères à tenir les arrêts. Nulle garde pour les surveiller ; aussi se sauvèrent-ils en France, où l’un d’eux était maître d’hôtel de Sa Majesté. Quelques cardinaux, de la Rovere entre autres ; un évêque, Gentile d’Arezzo ; un noble florentin, Pierre Soderini, garantissaient au monarque, quand il aurait mis le pied en Italie, de prompts secours d’hommes et d’argent. Ainsi tout poussait à cette funeste expédition le malheureux Charles, son âge, sa vanité, ses courtisans, ses ennemis eux-mêmes ; comment résister ? On lui faisait lire des signes dans le ciel, et maître Guilloche de Bordeaux, prophète et poète, écrivait d’avance la glorieuse odyssée du prince qui subjuguerait les Italiens, passerait les mers, relèverait le royaume de la Grèce, et entrerait en triomphateur à Jérusalem. Jean Michel avait des visions prophétiques que Dieu lui envoyait la nuit, et où le roi de France conquérait le tombeau du Christ, et réformait l’Église et le christianisme. Au delà des monts, Jean-Baptiste Spagnuoli, le rival de Virgile, rappelait dans ses vers la prophétie de Saint-Ange, ce carme qui, au treizième siècle, avait annoncé la délivrance du monde par l’épée d’un monarque français. Un seul homme, dans ces grandes circonstances, sut remplir son devoir : ce fut Alexandre VI, qui comprit la pensée de Charles, et tenta, mais vainement, d’empêcher l’invasion de l’Italie. Il faut compter à ce pontife tout ce qu’il a fait de bien. Il essaye d’abord la prière, les représentations, les conseils de l’amitié ; on ne l’écoute pas. II parle plus haut, et, dans un bref apostolique, il fait valoir les droits du saint-siège au gouvernement temporel du pays ; on s’apprête à marcher. Enfin il a recours à la menace ; Charles répond que dès longtemps il a fait un vœu à Monsieur saint Pierre de Rome, et que nécessairement il fallait qu’il l’accomplît au péril de sa vie. Avant d’entreprendre ce voyage vrai mystère de Dieu, suivant l’expression d’un historien contemporain, Charles VIII demanda des prières à ses sujets. Ces prières, qu’on récitait jusque dans les campagnes, étaient ardentes ; ceux qui les adressaient au ciel croyaient fermement que le prince allait combattre les infidèles. On mettait sous la protection de la Vierge et des anges cette nouvelle croisade, qui, semblable à celle du saint roi Louis, remuait profondément les esprits. Le prince se mit en marche ; l’armée qu’il commandait était nombreuse et brillante ; on n’en avait pas encore vu de plus belle. Elle offrait à l’œil un mélange curieux d’armes, de vêtements, d’armures et de bannières. La Suisse avait fourni son contingent : c’étaient des soldats sortis, en partie, des montagnes de l’Uri et de l’Unterwald, qu’on reconnaissait à leurs hallebardes étincelantes au soleil, vieilles armes dont ils s’étaient si bien servis à Morat ; à leurs jupons collants, de deux couleurs, comme ceux qu’on voit de nos jours aux hallebardiers qui gardent le Vatican. Ils portaient un chapeau relevé sur le front et orné de plumes ondoyantes. La Gascogne avait levé six mille arbalétriers lestes, pimpants, et dont le costume théâtral, les mouvements vifs et précipités, l’allure tonte militaire et la figure basanée, frappaient qui les voyait pour ta première fois d’une sorte d’admiration respectueuse. La noblesse était magnifique à voir ; elle était parée de sayons de drap de soie, d’armets empanachés et de chaînes d’or. Les chevaux, fournis en partie par les provinces qui avoisinent la capitale, n’avaient pas l’encolure des chevaux napolitains, mais ils marchaient au soleil et à la poussière sans peine ni fatigue ; ceux que montaient les chefs se distinguaient à leurs housses dorées, à leurs étriers polis comme de l’acier, au drap de couleur qui leur couvrait à demi le corps. Les guerres contre les Anglais nous avaient enlevés la plus belle fleur de nos soldats. Placés à l’avant-garde, les nobles, il faut leur rendre cette justice, avaient reçu les coups les plus furieux ; beaucoup d’entre eux avaient laissé leurs os sur les champs de bataille, ou étaient demeurés estropiés. Dans cette aventureuse expédition, il fallait à Charles des capitaines déterminés ; il les avait cherchés, sans distinction de rang, parmi ses plus braves soldats. On trouvait donc dans son armée des chefs de milice qui n’avaient d’autres titres que ceux que le sang de nos ennemis avait écrits sur leur hallebarde ou sur leur écusson. Le roi comptait sur leur bravoure presque autant que sur l’effet de ces grosses pièces d’artillerie qu’il traînait à sa suite, instruments plus diaboliques qu’humains, comme dit l’historien Guichardin. Partout où se présentait le canon, nous dit le poète, chaque édifice se hâtait de faire la révérence. Partout où la lance de bois de nos soldats s’abaissait, elle faisait un trou, comme le corps de Winkelried à Sempach. L’argent seul manqua d’abord au monarque français, qui en emprunta à la première banque venue, à celle des Sauli de Gênes, mais à gros intérêts pour cent, remarque notre historien Comines, et de foire en foire. Les banquiers italiens ressemblaient à ces Fugger d’Augsbourg, dont s’est si souvent moqué Luther, et qui prêtaient également aux catholiques et aux réformés, moyennant bonne et valable caution. Lyon avait préparé pour le roi des fêtes magnifiques. Il fut là parmi les princes et les gentilshommes, menant joyeuse vie à faire joustes et tournois chaque jour, et, au soir, dancer et baller avec les dames du lieu, qui sont volontiers belles et de bonne grâce. Ce fut à Lyon que le duc de Savoie offrit à Charles un jeune page nommé Bayard, qui saultoit, luttoit, jettoit la barre, et, entre autres choses, chevauchoit ung cheval le possible. Le roi l’accepta, en s’écriant : Par la foi de mon corps, il est impossible qu’il ne soit homme de bien ! Puis, se retournant vers l’un de ses jeunes favoris : Cousin de Ligny, ajouta-t-il, je vous baille le page en garde. Quelques jours après, le page vint prendre à genoux congé du roi, qui lui dit : Picquet, mon ami, Dieu veuille continuer en vous ce que j’y ai veu de commencement ; vous serez Prudhomme. Vous allez dans un pays où il y a de belles dames ; faictes tant que vous arquerez leur grâce ; et adieu, mon amy. L’argent reçu, il ne manquait rien à l’armée d’expédition, pas même l’astrologue de convention, qui se nommait Antoine du Hamelet, et qui, pour lire dans les astres, ne recevait que cent vingt livres par an, c’est-à-dire six fois moins qu’un apothicaire. C’était moins une marche militaire qu’une véritable fête. On laissait à Charles VIII le temps de se reposer de ses fatigues, d’assister aux bals, de danser, de faire sa cour aux belles dames, de donner audience sous des ares de triomphe, d’écouter les louanges des poètes, et d’envoyer des fromages à la reine sa femme. A Grenoble, les rues étaient tendues et parées de tapisseries, et devant, histoires et beaux mystères parfaitement démontrés, désignant l’excellent honneur et louange du roi et de la reine. Le roi quitta la France le 1er septembre. Il était attendu à Turin arec impatience. La régente de Savoie avait, pour le recevoir, pris ses plus beaux atours : Elle estoit habillée d’un fin drap d’or frizé, travaillé à l’antique, bordé de gros saphirs, diamans, rubis, et autres pierres fort riches et précieuses. Elle portoit sur son chef un gros tas d’affiquets subrunis de fin or, remplis d’escarboucles, de balais et hyacinthes, avec des houpes dorées, gros fanons et bouquets d’orfèvrerie mignardement travaillés. Elle avoit à son col des colliers à grands roquets, garnis de grosses perles orientales, des bracelets de même en ses bras, et autres parures fort rares ; et ainsi richement vestue, elle estoit montée sur une haquenée, laquelle estoit conduite par six laquais de pied, bien accoutrés de fin drap d’or broché. Elle avoit à sa suite une bande de damoiselles ordonnées et équipées de si bonne manière, qu’enfin il n’y avoit rien à dire. Le même témoin ne manque pas d’ajouter que toutes les rues estoient tendues de fin drap d’or et de soie et d’autres riches paremens, et garnies de grands échafauds remplis de mystères tant de la loi de nature que de la loi écrite, lestes poétiques et histoires tant du Viel que du Nouveau Testament ; ce qui estoit ainsi continué depuis l’entrée des faux-bourgs de ladite ville jusques au chasteau, auquel le Roy entra pour y loger en très grand triomphe, au son de la mélodieuse harmonie des trompettes et des clairons. Il ne faut pas obmettre que dans ladite ville furent ce jour faits, en quantité d’endroits, plusieurs repeuës franches, où il fut abondamment donné à manger et à boire à tous passans et repassans. A Gênes, sept magnifiques vaisseaux armés de grosse artillerie attendaient l’arrivée de d’Urfé : le duc d’Orléans devait bientôt en prendre le commandement. Le poète Cariteo, en véritable Tyrtée, prenait sa lyre pour exciter l’Italie à repousser l’étranger ; c’est en vain qu’il criait à ses compatriotes : Nobles esprits, Italie bien-aimée, quel vertige vous pousse à jeter le sang latin à d’odieuses nations ? On ne l’écoutait pas, on le laissait chanter ; c’était à qui se précipiterait le plus vite dans la servitude : les villes tombaient comme de véritables châteaux de cartes devant quelques compagnies de frondeurs ou d’arbalétriers. On conçoit la terreur qui les saisissait à la vue de ces soldats, la plupart gens de sac et de corde ; méchants garniments échappés de justice, et surtout fort marqués de la fleur de lys sur l’épaule ; essorillés, et qui cachaient cette mutilation de leurs oreilles, à dire vrai, par de longs cheveux hérissés, barbes horribles, tant pour cette raison que pour se rendre effroyables à leurs ennemis : d’ailleurs, habillés à la pendarde, portant chemises longues qui leur duraient plus de trois mois sans changer ; montrant poitrine velue, pelue, et, à travers leurs chausses bigarrées et déchiquetées, la chair de leurs cuisses. Notre artillerie valait nos hommes ; Paul Jove n’en parle qu’avec effroi. Le 13 septembre le roi entrait à Gênes, le 10 octobre à Plaisance, le 8 novembre à Lucques, le 10 à Pise. Fivizzano, ayant refusé d’ouvrir ses portes, fut attaquée à coups de canon, battue en brèche, prise et saccagée ; le bruit des traitements indignes que le vainqueur avait fait subir à la garnison ainsi qu’aux habitants jeta l’épouvante dans Florence. Sarzanella, fortifiée par Laurent de Médicis, ne fut point effrayée de la chute de Fivizzano ; elle avait pour défenseurs quelques patriotes qui paraissaient décidés à s’ensevelir sous ses ruines ; on les somma de se rendre, ils répondirent à coups de canon aux menaces des Français : malheureusement la garnison était trop peu nombreuse pour résister longtemps, elle dut se rendre. Le sort de l’expédition était en ce moment dans les mains du Magnifique : il fallait au monarque des succès prompts, décisifs ; autrement les peuples italiens revenant de leur surprise, et ne voyant plus dans Charles l’homme envoyé de Dieu pour délivrer la terre sainte, l’ange exterminateur prédit par Savonarole, pouvaient songer à l’arrêter dans sa marche et à lui demander compte de ses projets. Le sang qui avait coulé à Fivizzano et Rapallo criait déjà bien haut ; encore quelques gouttes, et sa voix allait être entendue. A la place de Pierre, Laurent aurait appelé aux armes Florence, les faubourgs et les environs, et, sans attaquer l’armée française, se serait contenté de prendre position sur ses derrières, d’embarrasser sa marche, d’enlever ses convois, de lui dresser des embûches, de l’affamer, de lui faire une guerre de partisan ; niais Laurent avait l’affection du peuple, trésor que son héritier dépensait de jour en jour : Pierre, sang ardent comme son père, aimait le plaisir, et ne savait pas le goûter dans l’ombre ; il avait pour ennemis un grand nombre de maris trompés appartenant en général aux riches familles de Florence. Il avait fait deux fautes qui devaient lui porter malheur : il avait imploré la pitié des juges en faveur de ses deux cousins qu’on avait surpris en flagrant délit de conspiration contre l’État, et il n’avait pas osé faire taire Savonarole. Echappés de leur prison, ses cousins se retirèrent en France à la cour de Charles VIII, épiant du camp ennemi le moment favorable pour renverser le Magnifique, leur parent, qui n’avait pas su demander leur sang ; ils comptaient, non pas sur leur épée, qu’ils n’auraient pas eu le courage de dégainer, mais sur la parole d’un moine ; le moine en chaire valait des bataillons. Un moment Pierre eut la volonté de se défendre ; il avait fait réparer les fortifications de Pise, de Sarzanella ; il avait restauré celles de Florence, creusé des fossés autour de la ville, relevé quelques murailles tombées de vétusté, garni l’arsenal, acheté des armes. Qui payera ces dépenses ? les riches sans doute ; mais ou ils refusèrent de contribuer à la défense de la cité, ou ils acquittèrent leurs taxes en se répandant en murmures contre le Magnifique. La plupart de ces hommes opulents devaient leur fortune aux Médicis : c’étaient des marchands qui, grâce à Laurent, avaient fait d’excellentes affaires avec l’orient, et qui, retirés du commerce, menaient une vie de plaisir, et refusaient insolemment de soutenir le fils de l’homme qui les avait enrichis. Que leur importait que Florence tombât dans les mains de Charles VIII ? Vraisemblablement le monarque aurait besoin d’argent pour continuer son expédition ; ils étaient prêts à lui en prêter aux conditions des Sauli de Gênes, c’est-à-dire à cinquante pour cent. Savonarole, avec sa grande voix, disait au peuple : Un homme viendra qui envahira l’Italie en quelques semaines sans tirer l’épée. Il passera les monts comme autrefois Cyrus : Hæc dicit Dominus Christo meo Cyro, et les rochers et les forts tomberont devant lui. » Le peuple, qui voyait la prophétie du dominicain s’accomplir, riait des vains efforts tentés par Pierre pour arrêter le vainqueur. Pierre, dans ces circonstances, se rappela l’une des maximes que Laurent recommandait à ses enfants : d’exécuter sans délai un projet conçu. Mais il oubliait un autre précepte paternel : de consulter, avant tout, des hommes de jugement et de prudence. Il résolut d’aller trouver Charles VIII : c’était une faute ; son frère le cardinal lui recommandait de ne pas quitter Florence, où, pendant son absence, ses ennemis auraient le temps d’ameuter les mauvaises passions. Une détermination comme celle qu’il prenait était pleine de périls : dans tous les cas il devait s’assurer, à son retour, de forces intérieures assez puissantes pour déjouer les projets de ses adversaires ; c’est ce qu’il ne fit pas Il se tait aux services que sa famille avait rendus à l’Etat, ignorant que rien ne s’oublie si vite qu’un service ; et parce qu’il avait vu tout un peuple accompagnant, les larmes aux yeux, le corps de Laurent à l’église, il croyait que l’ombre du père protégerait le fils : c’était une erreur. Au lieu de passer les heures du soir à relire Virgile, s’il avait feuilleté ces poètes qu’on nomme historiens, il aurait vu que le peuple change souvent de maître pour le plaisir seulement d’en changer, surtout quand le maître est absent. Avant de se rendre dans le camp du roi, Pierre écrivit d’Empoli, le 26 octobre 1494, aux magistrats de la cité, une lettre pleine d’affectueux sentiments. Il conjure les magnifiques seigneurs, au nom des ossements de l’homme qu’ils aimaient d’une si vive tendresse, de prier pour son fils qui les aime de toute son âme. Il leur recommande son frère, et ses pauvres petits enfants, qu’il confie à leur affection, dans le cas où Dieu ne permettrait pas qu’il revoie Florence : c’est son testament de mort qu’il leur lègue, car il est prêt à sacrifier sa vie pour le bonheur de sa cité bien-aimée. Il semble qu’une lettre où l’on ne sait ce qu’il faut admirer le plus, du père, du prince ou du citoyen, devait protéger la destinée de Pierre. La lettre écrite, il quitte Empoli, traverse Pise, et se présente, avec Paul des Ursins, à l’avant-poste de l’armée française. De Pienne et Briçonnet, deux officiers français, furent chargés, au nom du roi, de traiter avec le Magnifique. Pierre tenait de sa race ; il ne manquait ni de courage ni d’habileté : malheureusement il était sous l’influence de funestes préoccupations. Il savait que la résistance de la garnison de Sarzanella avait irrité Charles VIII, qui pouvait faire expier cruellement le sang français versé devant cette place, en pillant Florence, ou en confisquant les marchandises que cette ville avait en dépôt à Lyon et dans d’autres cités du royaume. Une chose certaine, c’est que les marchands de laine florentins, nobles ou roturiers, craignaient pour leurs ballots, et qu’ils n’étaient pas disposés à résister aux armes du monarque ; la lutte eût été trop inégale, quand Sienne, Lucques et Pise étaient décidées à ouvrir leurs portes à la première sommation. Il faut bien croire aussi qu’en traitant avec le roi de France, Pierre comptait sur la protection de nos armes, si ses ennemis intérieurs voulaient le déposséder de sa magistrature. C’est sous l’empire de ce double sentiment de terreur et d’espérance que Pierre entra en pourparler avec les officiers du prince. Ceux qui traictèrent avec le duc m’ont compté, dit Comines, en se raillant et se mocquant de luy, qu’ils estoient ébahis comme il leur accorda si grande chose à quoi ils ne s’attendoient pas. Il est permis de penser que des négociateurs aussi rusés s’étaient bien aperçus du rôle que jouait forcément le Florentin. Ils se montrèrent exigeants, parce qu’ils savaient qu’il ne pouvait rien leur refuser. Ils demandaient qu’on leur livrât Sarzanella, Pietra-Santa, Livourne, Pise : Pierre consentit à toutes les conditions qu’on voulut lui imposer. Quand on apprit dans Florence le traité signé par Médicis, ce fut un cri de réprobation universelle. Les marchands de la rue des Calzajoli paraissaient émus jusqu’aux larmes, mais pas un d’eux ne parlait de déchirer la convention : il était aisé de voir qu’ils étaient indignés qu’un acte semblable eût été signé sans que le chef de l’État les eût consultés ; ils étaient irrités qu’on eût méconnu leur souveraineté, et ils avaient raison. Sur-le-champ la seigneurie dépêcha cinq citoyens au camp royal, Savonarole entre autres, avec ordre de tâcher d’obtenir que le prince modérât la rigueur des conditions imposées à la république. Le moine de Saint-Marc avait une autre mission à remplir ; c’était d’implorer pour sa chère Florence la pitié du vainqueur. On l’introduisit, avec les deux frères qu’il avait voulus pour compagnons de route, dans l’appartement du monarque : Jérôme n’eut pas peur ; il croyait qu’il n’y avait au inonde qu’un monarque, le Dieu du ciel. Venez, dit-il à Charles, venez avec confiance, venez joyeux, car vous êtes l’envoyé de celui qui triompha, pour le salut de l’humanité, sur l’arbre de la croix. Ecoutez-moi, prince : de par la très sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et de par toute la cour céleste, je vous somme de faire miséricorde, à l’exemple de notre divin Maître, à cette Florence où, malgré de nombreux péchés, Dieu conserve des cœurs fidèles. Le serviteur de Dieu qui vous parle vous exhorte à défendre les veuves, les orphelins, les pauvres, et surtout la pudeur des épouses du Christ. Rappelez-vous votre Sauveur, qui, sur le gibet, pardonne à ses bourreaux ; et Dieu étendra votre royaume, ô roi, et il vous donnera la victoire. C’était la seconde fois que Charles VIII entendait le langage de la franchise. A Paris, au moment de se mettre en route, les Parisiens, inquiets, lui disaient : Contemplez, sire, au besoin que vostre république a de vous ; advisez vostre sage et peu de santé. Pensez que fortune peult aussi bien estre contraire qu’elle fut au roi Alphonse en la guerre contre les Genevois et duc de Milan. Le roi avait répondu brièvement aux Parisiens : Ny la charité du pays ni la dévotion de service vers vostre roy vous esmeut à causer cette harangue devant moy, qui ne demande ou prétend demander aucun conseil de vous en Bette affaire. A Pogibonzi, sa réponse fut plus courte encore : il tourna le dos à Savonarole, soit qu’il ne le comprît pas, soit plutôt que le a gentil enfant, bénin de sa nature, n comme dit Comines, n’eût pas la moindre envie de faire du mal à Florence. A peine la députation avait quitté la ville pour se rendre au camp du roi, que des groupes se formaient sur les places publiques et devant les églises. Le nom de Pierre était dans toutes les bouches. Les frati l’accusaient de libertinage et citaient le nom des femmes qu’il avait déshonorées ; les marchands se lamentaient sur le sort de tous ces beaux produits de l’Orient, compromis par son imprudence ; les nobles montraient les vingt-quatre gardes dont il se faisait sans cesse accompagner, cortége inutile qui trahissait de coupables défiances contre les Florentins, et qu’on avait donnés à son père, après la conspiration des Pazzi, pour le préserver du poignard des assassins, mais que le fils aurait dû dissoudre, quand rien ne menaçait son existence ; les ouvriers lui reprochaient ses vêtements faits d’étoffes de soie, et sa négligence à paraître aux assemblées ordinaires. Ailleurs, un conciliabule se tenait, formé d’hommes importants, où François Valori, ardent républicain, proposait la déchéance de Pierre, motivée sur son incapacité notoire, et sur les périls que courait la liberté de Florence, abandonnée à des mains inhabiles. Il parlait de débauches secrètes, de rapts nocturnes, de trahison, de tyrannie. Pas une voix n’essaya de défendre le malheureux citoyen, ou d’invoquer pour lui le souvenir de Cosme et de Laurent. Pierre connaissait les dispositions de Florence : il n’avait pas de temps à perdre, s’il voulait éviter une émeute. Il partit donc, en se faisant suivre d’assez loin par un corps de troupes que commandait des Ursins. Il était environ trois heures du soir, quand il entra, le dimanche 9 novembre 1491, dans Florence. Son premier mouvement fut d’aller au palais de la seigneurie, pour rendre compte vraisemblablement de son entrevue avec le roi de France ; mais il en trouva la grande porte fermée. Il demande les clefs ; on lui signifie qu’il ne peut entrer que par la petite porte, seul et sans armes. Il insiste, on le repousse ; il cherche alors, pour pénétrer dans la salle du conseil, une communication dérobée : peine inutile, tout est gardé. Il revient sur ses pas, et trouve cette fois, en sentinelles devant la grande porte, Luc Corsini, Jacques Nerli et Filippozo Gualterotti. Pierre veut entrer à toute force, il prie et menace : les trois citoyens lui barrent le passage, en l’accablant d’injures. Le peuple, à ce bruit de voix d’hommes, commençait à se rassembler sur la grande place : à la vue de Pierre, il se mit à pousser des cris de fureur ; les enfants ramassaient des cailloux et les jetaient au Magnifique, qui prit le parti de se retirer. Chemin faisant, il trouva Pierre Antoine dell’ Aquila, le gardien des prisons, qui venait lui offrir le secours de quelques amis dévoués. Mais la foule s’amassait, alimentée, ce jour de repos, par des ouvriers qui sortaient de l’office. Elle assaillit le bargello, désarma les gardes, et força le geôlier, au milieu des huées et des cris de vengeance, à ouvrir les prisons : soixante détenus en sortirent, qui vinrent grossir le noyau des mécontents. Enhardis par ces manifestations populaires, les membres de la seigneurie sortirent un à un de leur logis, et vinrent en armes sur la grande place. En ce moment, les cloches de toutes les églises retentirent à la fois : c’était le signal de l’insurrection. Pierre gagna la Via Larga, où il donna l’ordre à des Ursins de marcher avec des soldats sur la place, foyer des mouvements. Son frère devait le précéder en soutane rouge. Le cardinal obéit : arrivé à l’église de San-Bartolommeo, le peuple lui barre le chemin. Jean de Médicis, se rappelant l’acclamation que, le jour de la conspiration des Pazzi, toutes les voix poussaient à l’envi, crie : Palle ! palle ! Le peuple reste muet : le cardinal veut parler, on crie : A bas les traîtres ! Il essaye de faire quelques pas en avant, des piques s’abaissent pour l’arrêter. En ce moment parut le Magnifique : la rue des Calzajoli était toute pleine de révoltés qui, armés de projectiles, le menaçaient de la voix et du geste : il était mort s’il eût tiré l’épée ; il préféra, pour l’apaiser, jeter au peuple quelques pièces de monnaie, mais personne ne se baissa pour les ramasser. Alors il parut comprendre que son rôle était fini, et quitta Florence, emmenant avec lui son frère Julien : tous deux prirent le chemin de Bologne. L’histoire a dû chercher les causes de cette chute si soudaine de Pierre de Médicis, et elle est obligée de confesser qu’elle n’en peut trouver aucune. Comme tous les châtiments que les peuples infligent dans un moment de caprice, celui qui frappa l’héritier de Laurent fut souverainement injuste. Nardi, qui, dans ses Annales, écrit que le salut des libertés de Florence fut la conquête de soixante malfaiteurs dont la multitude brisa les fers, pense que Pierre n’aurait pas perdu sa couronne ducale, si, lors de son retour du camp royal, il avait pris le chemin de la Via Larga, au lieu de prendre celui du Palazzo Vecchio. A quoi donc tiennent les destinées d’un trône, si le pavé que des enfants jettent à la tête de leur roi, qui s’est fatalement trompé de route, devient un arrêt irrévocable de déchéance ? Il est vrai que Nestor ajoute que souventes fois Pierre s’amusait à la chasse, à la voilerie, à faire l’amour çà et là, ne se donnant beaucoup de peine de ce que faisoient les magistrats, allant peu souvent au palais, et ne voulant donner audience aux citoyens qui le demandoient. Mais, dans l’histoire de Florence, il n’est pas un gonfalonier, républicain austère, auquel on lie pût faire de plus graves reproches. La fuite de Pierre fut le signal de vengeances horribles. Le peuple se porte d’abord sur la maison de Guidi, notaire et chancelier des Réformes, et sur celle de Bernard Miniati, provéditeur du Mont, tous deux connus par leur attachement à la famille déchue : on les accusait d’avoir fait hausser le prix du sel. Leur habitation est saccagée de fond en comble. Partout où le peuple, sur son passage, rencontre les armes des Médicis, il les abat au milieu de cris de fureur. Il efface les images de la famille, peintes en 1433 sur le palais du podestat, et sur la porte de la douane en 1478 : il les avait saluées autrefois de ses acclamations, il les poursuit aujourd’hui de ses anathèmes ; autrefois il appelait ceux dont elles retraçaient les traits les pères de la patrie, il leur donne aujourd’hui le nom de traîtres et de tyrans. Cosme avait fait construire, dans la Via Larga, une maison magnifique qui faisait l’admiration des étrangers, vrai théâtre, dit un historien, de gentillesse, de vertus et de lettres. Le peuple en boucha les portes, comme il eût fait à une maison de pestiférés ; une seule fut ouverte pour laisser passer les huissiers et les crieurs chargés de la vente des trésors que cette superbe habitation renfermait. Les acheteurs accoururent. Là se voyoit, continue Nestor, un nombre infini de tapis d’or et de soie et plusieurs aultres rehaulsez de mesme estoffe, oultre des vaisseauls d’or et d’argent, un monde de statues élabourées à l’antique et composez de cuilvre et d’arain. Chose qui finalement flet mal au cœur à plusieurs, specialement quand on se mit à fourrager la bibliothecque, laquelle premièrement le seigneur Cosme, puis son fils Pierre, et récemment Laurent, avoient amplement fournie de bons livres rares, hebrieux, grecs et latins, et à l’augmentation de laquelle tant de bons esprits avoient travaillé, et tant d’hommes peregriné, que la Grèce en estoit presque demeurée vuide.... Le seigneur de Balassart arrive à Florence pour faire le loris du roi en la maison du seigneur Pierre, se met le premier à prendre quand il sceut la fuite de son hoste, disant que la banque que les Médicis avoient à Lyon lui debvoit grande somme de deniers. Entre aultres choses, prit une liasse entière montant à la valeur de six ou sept mille ducats, et deux grandes pièces d’une aultre. Les aultres firent comme lui en une maison en laquelle Pierre avoit serré la plus part de son vaillant. Le peuple pilla tout. La seigneurie eut une partie des plus riches bagues et quelques vingt mille ducats lors trouvés en son banc, sans une infinité de pots d’agathe, de camaïeux taillés en perfection, et bien trois mille médailles d’or et d’argent. Les voilà donc perdus à jamais ces beaux livres rassemblés avec tant d’amour par Ficin, Politien, Pic de la Mirandole, et dont Laurent ne pouvait détacher ses regards mourants ! Quand un de ces trésors de sagesse, de poésie, d’éloquence, après avoir heureusement traversé les mers, tombait de Constantinople à Florence, quelle joie parmi nos lettrés ! que de douces heures ils passaient à le contempler ! Ils annonçaient dette heureuse nouvelle, comme de nos jours nous annonçons quelque événement qui doit changer ou remuer le monde. C’est que, dans ces pages grecques ou latines, les destinées de l’intelligence humaine étaient enfermées ! Et la main d’un enfant livre aux flammes et aux vents les inspirations de Platon, d’Aristote, de Démosthène, de Virgile, de Chrysostome, de nos Pères des deux Eglises, c’est-à-dire toute la substance éthérée dont l’esprit de l’homme peut se repaître, et qu’un pauvre moine nous avait conservée ! Laurent reposait heureusement dans son tombeau. S’il eût vécu, il serait mort de douleur à la vue de ces profanations, lui, le père des doctes, le docte parmi les doctes, ainsi que le nommait Hutten. Le peuple n’est pas satisfait : le voilà qui se porte dans le quartier Saint-Antoine, sur la maison du cardinal, dont il pille et brûle les meubles, les livres, les vêtements, les tableaux, les statues, et qu’il démolit ensuite de fond en comble ; puis sur les beaux jardins de la place Saint-Marc, ce musée où vinrent étudier Fr. Rusticci, Lorenzo di Credi, Jul. Bugiardini, Baccio da Monte Lupo, And. Contucci et Michel-Ange ; il est sans pitié pour les sculptures qu’il renferme, pour les arbres et les fleurs qui leur servent de parure ou d’abri. Quand sa fureur fut assouvie, c’est-à-dire quand il ne resta dans Florence aucune image des Médicis, aucune des statues qu’ils avaient si chèrement payées, aucun des manuscrits qu’ils avaient fait venir à si grands frais de l’Orient, aucun des arbres qu’ils avaient plantés ; que la vente des objets précieux qui leur appartenaient fut close ; que les magistrats se furent fait adjuger les joyaux de famille qu’ils convoitaient ; qu’il n’y eut plus rien du patrimoine ducal à dévaster, à briser, à brûler, à voler ; alors la seigneurie lit publier un bando où elle menaçait d’un châtiment exemplaire quiconque troublerait le repos des citoyens par le meurtre ou le pillage ; et la statue de Judith, œuvre de Donatello, fut solennellement placée devant le palais, comme une leçon ou une menace de la justice populaire. Pendant ces scènes de dévastation, où donc était Savonarole ? Nous aurions voulu le voir monter en chaire pour flétrir ces attentats sacrilèges. La seigneurie n’inquiéta pas les hommes de l’émeute ; pour les amuser sans doute, elle imagina de réhabiliter la mémoire des conspirateurs de 1475. Désormais on put s’appeler Pazzi, et réclamer le sang dont étaient rougies les dalles de Santa-Reparata comme un glorieux blason. Elle rappela Laurent et Jean, fils de Pierre-François de Médicis, qui changèrent leurs armoiries, répudièrent leur nom et prirent celui de Popolani : double lâcheté que les historiens de tous les partis ont eu raison de flétrir ; comme si un front humain eût put rougir de porter les insignes de Cosme et de Laurent ! Cela fait, Florence dut se préparer à recevoir Charles VIII. Il y fit son entrée le 17 novembre 1494. Un riche baldaquin, porté par des jeunes gens de noble famille, attendait à la porte de San-Friano le monarque français, qui montait un cheval magnifiquement harnaché. Le roi traversa le bourg de Saint-Jacques sur l’Arno, le Vieux-Pont, la Vaccheria, la place de la Seigneurie, et, arrivé devant l’église de Santa-Maria del Fiore, descendit de cheval, et fut reçu par le clergé. Ficin était chargé de complimenter le prince. La harangue du néoplatonicien ne manque pas d’adresse. Ficin feint de croire que l’Italie n’est qu’une terre de passage que traverse l’armée française pour aller conquérir la Terre-Sainte. Voici, dit-il au roi, le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous. Prince, vous avez entrepris un merveilleux voyage : vous allez restituer au Sauveur des hommes cette sainte Jérusalem que les Barbares tiennent en leur pouvoir..... Vous voici dans votre Florence, que vous édifierez de votre piété ; Florence, la ville des fleurs, toute pleine aujourd’hui de lis. Chanoine par la grâce du cardinal, peut-être que Ficin aurait pu laisser tomber quelques mots de pitié sur la grande infortune de son bienfaiteur : t’eût été un acte de courage dont l’histoire lui aurait tenu compte ; mais, à son âge, on peut avoir peur du peuple. La harangue achevée, le prince entra dans l’église, et alla faire sa prière sur les marches du grand autel, pendant que le peuple, suivant la coutume, s’amusait à mettre en pièces le dais sous lequel avait marché sa majesté. Charles VIII remonta bientôt à cheval, et prit le chemin du palais des Médicis, que la seigneurie s’occupait, depuis deux jours, à réparer. Pierre était à Bologne avec ses deux frères Jean et Julien. Bentivoglio, qui gouvernait la ville, avait de grandes obligations à Laurent de Médicis ; il les oublia, et reçut froidement ses héritiers, en homme qui avait peur de se brouiller avec la république. Monseigneur, disait-il à Pierre, en lui montrant le palais de Bologne garni de canons, avouez que vous ne seriez pas là, si vous en aviez eu de semblables. La plaisanterie était cruelle. Pierre y répondit en homme d’esprit : Monseigneur, si vous aviez vu derrière vous un escadron armé comme celui que,je voyais déjà venir de San-Pier Scarreggi, vous auriez fait comme moi. Bentivoglio était impitoyable pour l’exilé : il ne voulait pas même lui permettre de rêver une restauration. Vous cherchez à franchir un mur qui croulera sous vous, lui disait-il, quand Pierre parlait de rentrer dans sa patrie. Pierre prit son parti, et, suivi de quelques serviteurs, quitta Bologne et gagna Venise. Là, son premier soin, avant de se rendre au sénat, fut de demander à un ancien agent de sa famille cent ducats pour acheter des vêtements ; l’homme d’affaires voulait une caution : le malheureux, qui n’avait que sa parole à donner, ne put rien obtenir. Le sénat fit à Pierre le don gratuit d’un vêtement : c’est une belle page dans son livre d’or. Pour échapper aux révoltés, le cardinal avait été obligé de quitter sa soutane rouge et de prendre la robe de franciscain. Caché sous le capuchon monacal, il alla frapper à la porte du couvent des dominicains pour demander l’hospitalité : le frère portier le reconnut et refusa d’ouvrir au petit-fils de Cosme, le bienfaiteur du monastère. Le cardinal s’éloignait tristement, quand, au coin de la rue del Giglio, il aperçut le secrétaire de Laurent : Que fais-tu là, Bernard ? lui demanda le cardinal. — Je cherchais votre éminence, dit le jeune homme. Et tous deux prirent le chemin de l’exil. Quelques jours après, ils trouvaient à Castello un asile chez les Vitelli. |