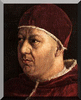HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE VI. — RETOUR À FLORENCE. — 1492-1493.
|
Affliction que la
mort de Laurent cause à Rome. - Lettres du cardinal à son frère Pierre. -
État des esprits à Florence. - Le cardinal retrouve ses anciens amis à
Florence. - Témoignage de sa reconnaissance envers les professeurs. - Roderic
Borgia est nommé pape et prend le nom d’Alexandre VI. - Comment le peuple
romain accueille cette nomination. La mort inattendue de Laurent causa dans Rome autant de surprise que de douleur : Innocent VIII versa des larmes comme s’il eût perdu l’un des siens. Les membres du sacré collège vinrent, dans cette triste journée, témoigner au cardinal leurs regrets et leur admiration pour l’homme que venait de perdre l’Italie ; les artistes se montrèrent inconsolables, presque tous mêlant à l’expression de leur chagrin de funestes présages pour l’avenir de Florence. A la première nouvelle du cruel événement qui venait de le frapper au cœur, le cardinal s’était hâté d’écrire à Pierre son frère ; il lui disait : Je n’ai que des larmes ; cette mort m’empêche de parler, et ne me permet que de pleurer : c’est un père que nous perdons, et quel père ! Jamais on n’en trouvera qui aimât si tendrement ses enfants !... Mais quelque chose me console, c’est de trouver en vous un second père. C’est à vous désormais de commander, à moi de recevoir vos ordres. Mon cher Pierre, je vous en conjure, soyez envers tous, et surtout envers les vôtres, libéral, affable, doux ; c’est le moyen de gagner les cœurs et de les garder. Je vous fais ces recommandations, non pas que je doute de vous, mais pour obéir au titre sacré de frère ; c’est mon devoir. Au milieu de mes angoisses, je trouve quelque adoucissement à ma douleur dans l’empressement des Romains qui, les yeux pleins de larmes, viennent me visiter, dans toutes ces figures où se peint la tristesse, dans le deuil de la cité, dans ces démonstrations unanimes d’intérêt, et par-dessus tout dans la pensée que vous me restez, vous sur qui je me repose avec une confiance que je ne saurais vous exprimer. Peu de jours après, l’image de Florence apparaît au cardinal, qui essuie ses larmes et écrit à son frère : C’est assez de pleurs, montrez-vous homme, et levez les yeux vers Laurent, qui vous regarde du haut des cieux. Il lui tardait de revoir Florence ; il emportait de Rome, avec les sympathies populaires, des témoignages éclatants de la bienveillance du souverain pontife. Innocent VIII le nommait légat du saint-siège apostolique en Romagne, et plus tard en Étrurie. Il récompensait ainsi dans le fils les services que le père avait rendus à la papauté. Peut-être aussi que, lisant dans l’avenir, il voyait approcher le jour où Florence retomberait dans sa maladie héréditaire, l’inconstance : Jean annonçait une nature virile capable de mettre un peuple remuant à la raison. Délivrés de leur maître, les Florentins commençaient à bouger. N’osant point encore se rassembler sur la place publique, où les images de Cosme et de Laurent semblaient les effrayer, ils se réunissaient dans l’église où prêchait Savonarole. La parole du dominicain devenait d’heure en heure plus hardie ; il ridiculisait les Médicis quand il ne les flagellait pas jusqu’au sang ; plein de ce qu’on nommait son dieu, il annonçait des tempêtes prochaines, l’apparition imminente des bandes françaises en Italie, le châtiment exemplaire de l’Étrurie. Il appelait Rome une ville de péché que Dieu s’apprêtait à punir ; et, pour détourner la vengeance céleste qu’il était chargé d’annoncer, il demandait des prières. Au cloître, il faisait ce qu’il recommandait en chaire : il ne buvait que de l’eau, ne mangeait que du pain noir, passait les nuits dans l’oraison, et fustigeait sa chair. Sa figure portait les traces de ses jeûnes ardents ; elle était pale, décharnée ; son œil bleu roulait dans deux orbites osseuses ; sa tête n’avait presque plus de cheveux. Les dominicains parlaient de ses visions, de ses extases, des miracles qu’il opérait ; le peuple se découvrait en le voyant ; quelques humanistes même étaient séduits, Benivieni, entre autres, l’ami de Pic et de Politien. Un parti nombreux, formé d’âmes exaltées, impressionnables, amoureuses du merveilleux, et connu sous le nom de Frateschi, ne dissimulait ni sa haine contre les Médicis, ni ses espérances révolutionnaires, ni son enthousiasme pour le prophète que Dieu venait de susciter. Parmi les Frateschi, il y avait des rêveurs, des républicains, des prêtres, des nobles et des marchands. Pour neutraliser ces éléments de trouble, Florence aurait eu besoin d’un autre homme que Pierre de Médicis. Longtemps avant sa mort, Laurent, dans ses entretiens avec ses amis, parlait hautement de ses craintes sur l’intelligence de son fils, auquel il reprochait deux grands défauts, l’imprudence et la fatuité. Le père voyait mieux que le professeur, qui donnait à son élève jusqu’aux vertus du grand Cosme ! Pierre concevait vivement ; malheureusement sa première idée était toujours fausse, et il s’en infatuait comme s’il eût été éclairé d’une illumination céleste. Le Florentin lui était absolument inconnu : au lieu de l’étudier dans la nature vivante, il l’avait cherché dans l’histoire. Il croyait le peuple qu’il allait gouverner, semblable à celui que Cosme maîtrisait si facilement il y avait cinquante ans : nais dans cet intervalle une grande révolution s’était accomplie ; un pauvre ouvrier de Mayence avait trouvé l’imprimerie, et plus d’idées nouvelles avaient été remuées en Italie par la seule apparition d’un livre de Platon, que les couvents n’en avaient suscité dans les disputes de tout un siècle. L’examen, fruit de la diffusion des livres, avait fait naître le doute ; du doute à la révolte, en politique comme en religion, il n’y a qu’un pas, et Savonarole allait le premier le franchir. Pierre ne semblait pas comprendre la puissance de ce moine sur des masses qui commençaient à lire. Il croyait que sa mission, à lui, était d’amuser le peuple par des spectacles, de l’étourdir à force de fêtes, de continuer son père et son aïeul, d’aimer comme eux les chevaux, d’être galant auprès des femmes, et libéral jusqu’à la prodigalité, jetant l’or à ses courtisans, certain qu’en cas de danger il n’aurait besoin que d’appeler à son secours tous ceux qu’il aurait comblés de bienfaits : pauvre enfant qui avait le malheur de croire à la reconnaissance ! Quand quelques sombres pensées venaient le tourmenter, il regardait sur la façade des maisons les belles statues élevées aux princes de sa famille, et se mettait à rêver l’éternité de la dynastie des Médicis. A cette heure, il y avait à Florence un jeune homme du nom de Machiavel qui aurait pu le détromper ; mais il n’avait garde de le consulter. Le cardinal, en arrivant à Florence, retrouva la plupart des anciens habitués du palais de la Via Larga : tous étaient restés fidèles à la mémoire du Magnifique ; quelques-uns même achevaient, en l’honneur du défunt, des vers que la douleur n’avait pas encore permis de terminer. Ils avaient raison de pleurer leur bienfaiteur ; Pierre les oubliait ou les négligeait. Un moment plus tard, et la petite lampe de Marsile Ficin allait mourir faute d’huile. Jean de Médicis se hâta de se démettre, en faveur de son professeur, du canonicat qu’il possédait à Santa-Maria del Fiore. Ficin, reconnaissant, disait à son élève : Vous ne voulez donc pas que je regrette Laurent ? Le néoplatonicien avait toujours conservé sa fraîche imagination ; il aimait encore à se laisser emporter à travers l’espace sur les ailes de ses étoiles chéries ; seulement il n’y restait pas aussi longtemps. Redescendu sur la terre, il s’occupait d’enseigner, dans sa Triple vie, à prolonger l’existence : le médecin avait remplacé le poète. Le temps avait chanté la couleur de ses rêves, ainsi que celle de ses cheveux. Platon était bien encore un dieu pour lui, mais un dieu dont il permettait que l’on contestât l’immortalité : l’âge le ramenait à celui dont le soleil n’est que l’ombre, comme il l’écrivait à ses amis. Politien, tout en conservant son goût pour les fleurs, avait quitté la villa Careggi, et, de retour à Florence, ne pouvait, quelque effort qu’il fit, se consoler de la perte de son noble ami. On lui faisait expier les faveurs ducales, sa fortune passée, sa gloire, ses triomphes, en attaquant ses mœurs, sa foi et la source de ses inspirations. L’arrivée du cardinal vint un moment faire trêve à la douleur d’Angelo, qui se remit à chanter ; mais l’inspiration ne revenait pas, sa muse n’était plus là. Nous nous rappelons Chalcondyle, qui pendant quelque temps avait donné des leçons de grec au fils de Laurent : le professeur, malade et infirme, avait perdu presque tous ses écoliers, qui s’étaient attachés à Politien. Père de nombreux enfants, c’est à peine s’il pouvait les nourrir. Tout le temps que vécut Laurent, il ne s’inquiétait pas plus que l’oiseau ne s’inquiète pour ses petits : Laurent, c’était sa providence, bonne mère qui prenait soin de tous les exilés byzantins. La mort de son protecteur bien-aimé l’avait laissé dans un dénuement complet. Dieu veillait sur le professeur : au moment où il allait se désespérer, Jean, son élève, revint. Chalcondyle avait des dettes, Jean les acquitta ; des filles qu’il chérissait tendrement, Jean les maria et les dota ; une maison assez lourde, Jean l’entretint à ses frais. Maintenant vienne la dernière heure du vieil exilé, nous sommes assurés qu’il ne mourra pas de faim. Il y avait à Florence un grand nombre de Grecs, pensionnaires du Magnifique. Rien ne leur manquait autrefois, ni le pain matériel, ni le bois en hiver, ni les vêtements, ni les livres. Laurent était généreux, et payait les lettrés en grand prince. A cette heure, presque tous étaient tombés dans la misère ; quelques-uns même avaient été obligés pour vivre de vendre jusqu’à leur poète divin, Homère, qu’ils ne quittaient pas même à table. Ce fut un heureux événement pour eux que l’arrivée du cardinal ; ils reprirent leur vie accoutumée, insouciante et folle. Pic de la Mirandole, à l’abri du besoin, n’avait rien à demander à son ancien élève ; mais il souffrait dans son âme, et cherchait des consolations. Le bruit des propositions affichées par notre philologue sur les murailles de Rome n’était point encore apaisé ; Pic se tourmentait de cette accusation d’hérésie dont on voulait le flétrir ; la parole même d’Innocent VIII, toute-puissante qu’elle était, n’avait pu le guérir entièrement de ses terreurs. C’est qu’il n’avait pas encore appris au pied du crucifix à mépriser les jugements des hommes. Pour échapper à la calomnie, il se proposait de s’exiler de nouveau, c’est-à-dire de s’étourdir dans ce bruit, et de se cacher dans cette poussière des grandes routes où sa vie s’était presque consumée. Il devait donc voyager encore ; mais, sur le point de reprendre son bâton de pèlerin, il alla presser la main de son élève : c’était son dernier adieu avant de quitter cette terre. Au retour, en passant devant l’église de Santa-Maria del Fiore, l’envie lui prit d’entrer pour prier, ne se doutant point que Dieu l’attendait là ; qu’au pied de l’autel où il s’était agenouillé, il devait trouver la paix de l’âme, le calme des sens, le vrai bonheur ! Pauvre jeune homme, qui possédait vingt-deux langues et ne connaissait pas celle que l’ignorant parle si bien à Dieu l Du moins emportait-il avec lui une bien douce joie : aucun de ses amis ne lui avait été infidèle. Si le ciel, comme il le croyait alors, appelait un jour Jean de Médicis sur la chaire de Saint-Pierre, il était bien sûr que la robe blanche du pontife l’abriterait contre les attaques de ses ennemis, comme la robe rouge du cardinal le faisait en ce moment contre les vaines terreurs qui l’obsédaient. Le protecteur de Pic de la Mirandole, Innocent VIII, était malade ; à la nouvelle des dangers qui menaçaient les jours du pontife, le cardinal partit pour Rome accompagné de Paul des Ursins : il apprit en route la mort du pape. C’est un des pontifes qui ont eu le plus à se plaindre de l’ingratitude des hommes : vivant, on lui reprochait d’être trop faible ; mort, on l’accusa d’énormités qu’il n’avait jamais commises ; et parce qu’il s’est trouvé je ne sais quel juif qui, à l’aide du sang tout chaud d’un enfant, voulait ranimer les forces éteintes du moribond, crime que le pape avait ordonné de punir, on n’a pas craint de faire d’Innocent VIII un homicide : accusation odieuse, imaginée comme tant d’autres par la méchanceté de quelque pamphlétaire. Heureusement l’histoire, pour juger un homme, ne va pas fouiller dans un journal écrit sous des préventions déplorables ; elle consulte le peuple. Le peuple a répondu en montrant tout ce qu’avait fait pour lui Innocent VIII : en le nourrissant dans les temps de disette, qui revenaient si souvent alors ; en fondant de nombreux asiles où il pouvait se loger, pauvre et malade. Rome, disons-le de nouveau, lui doit de beaux établissements de charité : sous son règne, ces prisons infectes où souvent le prévenu trouvait la mort avant le jugement furent assainies et aérées ; l’âme y fut soignée comme le corps ; la justice pontificale était prompte autant qu’impartiale ; le pauvre cessa de se plaindre des lenteurs des tribunaux ordinaires, et, innocent ou coupable, le prévenu vit son sort décidé dans quelques semaines. Malheureusement trop souvent malade et souffrant, Innocent VIII ne put protéger efficacement son peuple contre les brigandages des grandes familles. Les obsèques du pape furent célébrées, avec la pompe accoutumée, le 9 du mois d’août ; le lendemain les cardinaux entraient au conclave, et Rome était, comme à chaque interrègne de cette époque, le théâtre de vols et de meurtres ; ses rues retentissaient de bruits de stylet ; la demeure de chaque prince de l’Église était transformée en véritable citadelle, armée de mousqueterie et de canons, de peur d’attaques nocturnes. Le pape nommé, le nouveau gouverneur faisait pendre quelques bandits, et la ville respirait. Les cardinaux étaient peu nombreux, vingt environ. Un moment le choix paraissait douteux : quelques cardinaux portaient Ascagne Sforce, prélat d’une haute naissance, allié aux grandes familles de l’Italie, mais d’un caractère pusillanime et mou ; le plus grand nombre paraissait incliner pour Roderic Borgia, que son oncle Calixte III avait revêtu de la pourpre. II leur semblait que, dans les circonstances difficiles où l’Italie se trouvait, le monde avait besoin d’une âme fortement trempée, n’ayant peur ni de l’étranger qui menaçait l’indépendance ultramontaine, ni des grands qui ensanglantaient de leurs querelles la Romagne et la ville sainte elle-même, ni du mauvais vouloir de tous ces princes qui portaient couronne ducale, alliés douteux du saint-siège, qu’ils étaient prêts à soutenir ou à combattre suivant leurs intérêts. Ils croyaient que, le salut du pouvoir temporel de la papauté pouvant être compromis dans la lutte qui allait s’agiter en deçà des Alpes, il fallait une tête plus forte que celle qui venait de quitter la tiare ; ils se décidèrent pour Borgia, qui prit le nom d’Alexandre VI. Jean de Médicis, au bœuf dont parle Corio, devenu lion après son exaltation, aurait préféré un agneau ; mais ce lion, si l’on s’en rapporte au témoignage d’un historien qui n’a jamais passé pour prodiguer la louange, entrait aux affaires alliant la prudence à la sagacité, la pénétration à l’art de persuader, la persévérance à l’activité. Dans ces temps difficiles, un homme du caractère d’Alexandre dut être regardé comme un instrument providentiel ; son élection n’a donc rien que de naturel. Le peuple lui-même sanctionna le choix du conclave ; dans l’une des inscriptions qu’il avait improvisées, il comparait les deux princes qui sous le même nom avaient régné dans le monde romain, n’accordant à l’un, à César, que l’humanité, de l’autre, faisant un dieu. Cæsare
magna fuit, nunc Roma est maxima : Sextus Regnat Alexander ; ille vir, iste deus. Dans un autre transparent, il disait : Honneur et gloire à Alexandre le magnifique, le sage, le grand. Alexandro sapientissimo, Alexandro magnifacentissirno, Alexandro in omnibus maximo. Ces cris du peuple à l’exaltation du pontife, c’est aussi de l’histoire. Si le cardinal Roderic eût ressemblé tout à fait au Borgia de Burchard, il nous semble que le peuple aurait eu la pudeur de se taire ; du moins il n’aurait pas fait un dieu d’un homme de scandale ; il n’aurait pas appelé du nom de très saint un prêtre renommé par ses débauches : ou bien alors scandales et débauches étaient des mystères cachés à tous les regards ; et comment Roderic a-t-il pu se dérober à l’œil de celui qui lit à travers les murailles, et qui devine ce qu’il n’a pas vu ? ceci est un phénomène dont l’historien a droit de demander la raison. Nous comprenons, si nous avons bien étudié Alexandre VI, la joie que le peuple fait éclater en ce moment. Opprimé par l’aristocratie romaine, il appelle un libérateur, et il donne d’avance le nom de dieu à celui qui le délivrera de la tyrannie des vassaux de l’Eglise. Quelquefois il arrivait qu’un de ces grands seigneurs descendait tout armé dans la boutique d’un pauvre ouvrier, dont il emportait les outils ou l’épargne, souvent même la fille. Le malheureux demandait justice au pape, mais le brigand avait une excellente monture, et il échappait. Le peuple, quand la tiare fut donnée à Borgia, respira comme le malade qui voit arriver le médecin. Avec Borgia, plus de châteaux imprenables, plus de repaires inaccessibles, plus de cotte de mailles introuable : voilà l’homme dont le peuple avait besoin ; il trouvait que le bourreau s’était trop longtemps reposé. — Suis-je pape, vicaire de Jésus-Christ ? demanda le cardinal Roderic quand on vint lui annoncer le résultat du scrutin. — Oui, très saint père, répondit le cardinal de Sforce, et nous espérons que cette élection donnera gloire à Dieu, repos à l’Église, allégresse à la chrétienté. — Et nous, reprit Sa Sainteté, nous espérons dans le secours d’en haut ; le fardeau dont nous voilà chargé est bien pesant, mais Dieu nous accordera, comme autrefois à saint Pierre, quand il mit dans la main de l’apôtre les clefs des cieux, la force de le porter : sans l’assistance divine, qui donc oserait s’en charger ? mais Dieu est avec nous, il nous a promis son esprit. Vous, mes frères, nous ne doutons pas de votre soumission envers le chef de l’Eglise ; vous lui obéirez comme le troupeau du Christ obéit au premier pasteur. Le 11 du mois d’août 1492, le pape fut conduit en grande pompe dans l’église de Saint-Pierre : la chaleur était étouffante. Pendant les cérémonies d’intronisation, Alexandre pâlit plusieurs fois : il souffrait, et sa tête reposait presque constamment sur l’épaule d’un de ses cardinaux. Parmi ceux qui assistaient à cette grande fête, était le camaldule Delfini, l’un des maîtres de Jean de Médicis, qui vit le spasme du pape, et ne put s’empêcher de faire à son élève les réflexions philosophiques que lui inspirait ce spectacle’. Assurément il n’aurait pas voulu, pour son enfant, de la tiare, au prix d’une seule de ces gouttes d’eau qui tombaient de la figure du pontife. A peine le pape avait-il béni le peuple, que les cardinaux qui s’étaient opposés à son élection se hâtaient de quitter Rome. Jean Colonne gagnait la Sicile ; Julien de la Rovere, Ostie, dont il était évêque et gouverneur, et qu’il changeait en véritable place de guerre ; et Jean de Médicis, Florence. L’Italie était dans l’attente de grands événements : elle croyait à une invasion prochaine des Français, mais elle ne s’effrayait pas. Le bruit courant au delà des monts que Charles VIII ne devait traverser l’Italie que pour s’embarquer à Naples, et porter de là la guerre chez les Turcs. Ficin lui-même, comme nous le verrons, partageait cette erreur populaire. En chaire, Savonarole fixait le jour où l’étranger passerait les Alpes, et faisait consigner sa prophétie dans les archives de la république. Dans les vues de la Providence, l’étranger, disait-il, avait une double mission à remplir : le châtiment des tyrans, et la réforme de l’Eglise ; et, au nom du ciel, il défendait sous peine de péché de s’opposer à la marche du conquérant, cet homme de Dieu, à qui rien ne pouvait résister. |