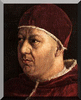HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE IV. — JEAN DE MÉDICIS A ROME. - MORT DE LAURENT. - 1492.
|
Arrivée de Jean de Médicis à Rome. - Il est reçu par le pape. - Sa lettre à son père. - Les cardinaux romains La Rovere, Piccolomini, Borgia, et leur caractère. - Rome et Florence poursuivent également l’affranchissement de la pensée. - Travaux archéologiques de Pomp. Leto, avec lequel se lie le cardinal de Médicis. - L’Académie romaine un moment dispersée par Paul II, et pourquoi. - Aquilano, P. Cortese. - Plan de conduite que Laurent trace à son fils. - Mort de Laurent. - Jugement sur ce prince. Le cardinal avait un devoir à remplir, c’était de porter, aux pieds d’Innocent VIII l’expression de sa reconnaissance et de celle de son père. Le pape, qui aimait les Médicis, avait dit à Pierre Alamanni, ambassadeur de la République : Reposez-vous sur moi du soin de la fortune de messire Jean, que je regarde comme mon fils. Innocent favorisait les lettres ; et si, dans le cours de son pontificat, il ne put les honorer comme il l’aurait voulu, c’est qu’il en fut empêché par des soucis domestiques qui abrégèrent son existence. Jean de Médicis quitta Florence et partit pour Rome. En s’éloignant de son père il ne put réprimer ses larmes ; Laurent, de son côté, se séparait avec chagrin de son fils l’avenir l’effrayait, il redoutait l’humeur des Florentins, l’ingratitude de la noblesse, la faiblesse de Pierre son fils, et par-dessus tout l’éloquence de Jérôme Savonarole. Le prieur de Saint-Marc avait en chaire l’audace d’un tribun : il attaquait la forme du gouvernement, les institutions nouvelles, les mœurs des Médicis ; il prêchait une religion de pauvreté, de macérations, de silence. Le peuple l’écoutait, et applaudissait aux colères de l’orateur contre les grands. Les esprits pratiques estimaient que cette parole de moine, secondée par les mauvais instincts de la populace, jetterait tôt ou tard la société dans le désordre et mettrait le pouvoir lui-même en péril. Ils avaient fait part de leurs craintes au prince, qui s’était contenté d’en rire. Laurent le philosophe avait laissé prêcher le frère, soit qu’il se méprît sur la puissance du dominicain, soit qu’il se fiât trop aveuglément à sa bonne étoile, ou, comme le pensent la plupart des historiens, que les mesures énergiques convinssent peu à cette nature, amoureuse de plaisirs et de repos. Jean était accompagné dans son voyage à Rome par Philippe Valori, André Camino et Delfino le Camaldule, que son père avait voulu lui donner pour compagnons de route, hommes de bonnes mœurs et de savoir ; quelques nobles citoyens s’étaient joints au cortége. Il coucha le soir à l’abbaye de Passignano ; le lendemain il visita Sienne. La ville le reçut avec toutes sortes d’honneurs : Si je voulais raconter ici, dit l’auteur de la relation latine de l’itinéraire, les hommages dont notre cardinal a été l’objet, un jour ne suffirait pas. Par ordre du sénat, les boutiques et tavernes avaient été fermées ; personne au logis ; les ouvriers, les magistrats étaient répandus dans la ville et hors des murs : on eût dit de l’entrée d’un pape. Sienne voulut faire lés frais du voyage jusqu’à San-Quirico. Jean coucha le lendemain à Acquapendente et traversa Viterbe, où François Cibo, son beau-frère, l’attendait pour l’accompagner jusqu’à Rome, où il arriva le 22 avril. Un peuple nombreux l’attendait, malgré la pluie battante qui tombait depuis plusieurs heures. il descendit dans le couvent de Sainte-Marie, après avoir fait une courte prière à la chapelle du monastère. Le lendemain, il reçut la visite des cardinaux, qui le conduisirent au palais du souverain pontife. Le pape l’embrassa affectueusement, et lui adressa quelques paroles pleines de grâce comme il les savait dire. La pluie n’avait pas cessé ; le cardinal et sa suite retournèrent au palais Médicis au milieu d’un véritable déluge : le carrosse alors ne s’employait que dans les cérémonies papales, et le parapluie était presque un meuble de luxe. Au consistoire, les cardinaux remarquèrent la tenue modeste, la parole brève, l’air digne du fils de Laurent ; dans la rue, ce qui frappa le plus, ce fut sa figure. A cette époque où la forme allait être réhabilitée en Italie, on comprend que Jean de Médicis dût attirer les regards. Il ressemblait alors à quelqu’une de ces belles statues dans la fleur de l’âne que Pomponio Leto trouvait fréquemment dans Rome souterraine. Les peintres, les sculpteurs, les artistes en général qui le regardaient passer, ne pouvaient se lasser de contempler cette taille souple, cette harmonie dans les traits, cette jambe droite et nerveuse, cette main de neige, cette figure gréco-romaine, cet œil bleu de ciel, cette tête forte reposant sur deux épaules évasées, cette lèvre légèrement enflée, et toutes ces belles proportions dont le type semblait être perdu. Ils rêvaient je ne sais quelle divinité traversant les mers pour s’abattre à Rome et y relever le culte de la matière. Il faut leur pardonner, à ces hommes de chair, cet enthousiasme pour la forme. L’adolescent avait fait une étude sérieuse de la langue italienne, qu’il parlait avec un charme particulier : sa phrase était légèrement cadencée, son accent tout à fait siennois ; on eût dit de la musique. A peine a-t-il été présenté à Sa Sainteté, que, tout plein de son bonheur, il se hâte d’en faire le récit à son père. C’est le premier acte de la vie privée du jeune homme ; il faut le recueillir soigneusement, pour y surprendre, à côté d’une joie qui n’a rien de fastueux, l’élan d’un véritable amour filial. Bonne santé, mon père... J’ai fait mon entrée à Rome vendredi matin, accompagné, depuis Sainte-Marie jusqu’au palais pontifical, et depuis le palais jusqu’au Campo di Fiore, de tous les cardinaux et de toute la cour, et d’une grande pluie. Notre saint-père m’a reçu très gracieusement ; je ne lui ai adressé que peu de mots. Le pape m’attendait le lendemain en audience particulière. Sa Sainteté m’a parlé on ne peut plus tendrement. Je ne puis rien vous dire de plus, sinon que je -n’efforcerai de me rendre digne de vous : De me proloqui ulterius nefas. Je me recommande à vous non altro. Jean, votre fils. Parmi les cardinaux qui formaient son cortége, quelques-uns étaient sans signification personnelle ; d’autres, au contraire, étaient comme des symboles vivants des instincts de l’époque. François Piccolomini, neveu de Pie II, représente les lettrés, Roderic Borgia le peuple, Julien de La Rovere l’Eglise. Piccolomini ne se mêle guère aux mouvements des affaires temporelles, il ne recherche que la conversation des savants. Pape, si Dieu lui donne de longs jours, il marchera sur les traces d’Aneas Sylvius, et comme lui il avancera le règne des lumières. Borgia, nouveau Louis XI, n’est dominé que par la pensée d’affranchir le peuple de l’oppression des grands : s’il arrive à la tiare, on peut être sûr qu’il sera sans pitié pour tous ces feudataires qui tiennent Rome en captivité ; homme d’Etat qui à de grandes qualités unit des passions dont il a puisé le germe en Espagne ; âme énergique qui ne reculera, pour briser ses tyranniques vassaux, ni devant la ruse ni devant le sang ; parent dévoué jusqu’au fanatisme aux intérêts de sa famille, son auxiliaire contre l’aristocratie romaine. Julien de La Rovere sait les besoins politiques et intellectuels de son époque ; il aime les lettres, mais d’un amour intéressé, et il s’en servira, quand Dieu l’aura fait roi, comme d’un instrument de gloire ou de puissance nationale. A la vue de ce prélat, qui monte un cheval comme un reître, qui porte la cotte de mailles comme Sickingen, qui manie l’épée en véritable condottiere, il est aisé de deviner que Julien saura protéger les droits temporels de l’Eglise, et que, si jamais puissance ultramontaine traverse les Alpes pour envahir l’Italie, il défendra son pays en soldat courageux. Si vous le visitez, vous ne trouverez chez lui aucune de ces figures toutes marquées d’un type commun de famille, comme celles qui se pressent dans l’antichambre de Borgia. La Rovere n’a pas de parents servez l’Eglise, vous serez son fils bien-aimé. Il est facile de juger les caractères de ces trois hommes par leur entourage personnel : le cardinal du titre de Saint-Pierre ès Liens a pour favori un pauvre moine ; l’archevêque de Valence a pour courtisan César Borgia ; François Piccolomini a pour ami Pomponio Leto. Jean s’attacha de prédilection à Julien de La Rovere. A Rome et à Florence, à l’heure où nous parlons, on poursuivait également la rédemption de la pensée humaine, mais par des voies diverses. Florence la cherchait dans Platon, Rome dans la pierre ; l’une et l’autre, par des chemins différents, tendaient au même ternie, l’antiquité. A Florence, la route où s’était jeté Ficin était peut-être plus fleurie, plus lumineuse, plus séduisante, niais plus longue assurément ; l’imagination était sa seule compagne à travers ce mystérieux passé où il poussait ses auditeurs : elle seule, avec ses rêves dorés, devait adoucir les fatigues du voyage, ranimer les forces épuisées, enchanter les heures de nuit et de jour. Rien qui réveillât dans l’âme des élèves de Ficin le sentiment national, qui surexcitât la pensée, qui peuplât l’espace d’êtres connus. Ficin, leur guide, chantait pour eux des hymnes, qui parlaient à l’oreille comme un doux concert, mais dont les sons étaient fugitifs comme ceux de la musique ; tandis que Pomponio Leto, avec les grandes ombres dont il trouvait les noms écrits sur la pierre, faisait assister l’âme à un drame vivant où, à chaque inscription, elle pouvait lire le récit de quelque exploit militaire, de quelque grande pensée matérielle, d’un antique triomphe de la civilisation sur la barbarie, et quelquefois d’une belle création intellectuelle. Ficin n’avait pour auditeurs que des esprits distingués. Le peuple refusait de s’associer à ses admirations, faute de le comprendre, tandis qu’il pouvait se mêler en corps et en âme à ces évocations archéologiques où, tous les matins, le conviait Pomponio Leto : une frise, une corniche, un fragment de statue, étaient autant de livres ouverts où le savant taisait lire à ses disciples les gestes du passé. Comme Ficin, il avait aussi sa petite lampe qu’il allumait longtemps avant le lever du soleil pour aller à la recherche d’une vieille inscription. A cette époque, notre antiquaire n’avait pas besoin de fouiller bien avant dans la terre ; un coup de pioche au Campo-Vaccino, et l’inscription apparaissait : il la sciait, l’enveloppait dans les plis de son manteau troué, et se hâtait de regagner le Quirinal, où l’attendaient ses élèves. Pomponio plaçait la pierre sur une petite table, et alors commençait une scène de nécromancie. L’ombre dont la pierre avait conservé le souvenir, évoquée par la voix du professeur, ressuscitait, et Pomponio, en poète bien plus qu’en archéologue, racontait la vie du revenant. Si dans son existence terrestre l’ombre avait revêtu le manteau du philosophe, il faisait l’histoire de la secte à laquelle elle avait appartenu ; si elle avait manié la lyre, il récitait quelques-uns des vers qu’elle avait laissés ; si elle s’était assise dans la chaire du magistrat, il donnait une idée de l’œuvre de juriste à laquelle elle avait travaillé ; si elle avait tenu l’épée, il faisait le récit des batailles où elle s’était trouvée : son cours embrassait à la fois l’histoire, la philosophie, l’archéologie et la morale. Quelquefois on le trouvait au fond de l’un de ces grands cimetières, où la pioche n’avait point encore pénétré, dans l’attitude d’un homme en extase, le cœur suffoqué par les sanglots, la poitrine haletante, l’œil mouillé de larmes. Au bruit des pas de l’étranger, Pomponio se relevait ; on eût dit un spectre, à la vue de cette tête blanchie avant l’âge, de ces joues amaigries par l’étude, de ce corps dont un habit rapiécé couvrait à peine la nudité. La science a des reproches à faire à Pomponio : quand, dans ses courses à travers les ruines, il n’avait rien trouvé, qu’il rentrait au logis le manteau vide, alors sa tête se montait, et, pour ne pas être obligé de confesser qu’il avait perdu sa journée, il inventait une inscription et improvisait le testament de Lœtus Cuspidius et l’épitaphe du poète Claudien, que Rabelais faisait réimprimer à Lyon, chez Gryphe, en 1582, et dont Barnabé Brisson, en ses Formules, et Antoine Augustin, en ses Dialogues, n’ont pas eu de peine à démontrer la fausseté. Barthélemi Platina, tout-puissant à la cour pontificale, avait fait obtenir à son ami Pomponio une petite maison sur la déclivité de ce mont qu’on appelle Quirinal. Cette habitation, toute rurale, toute silencieuse, ressemblait un peu à celle que Politien a chantée, c’est-à-dire qu’elle reposait dans une corbeille de verdure, qu’elle était abritée du soleil par des bosquets de lauriers, et du bruit de Rome par d’épaisses murailles. On ne croirait pas, si le fait n’était attesté par tous les historiens, qu’un jour cet asile des muses fut envahi par une populace armée qui se mit à briser, dans sa fureur aveugle, tout ce qui en faisait l’ornement, c’est-à-dire les débris antiques que Pomponio y rassemblait depuis tant d’années. On n’épargna ni la verdure qui reposait l’ail du maître, ni le bois de lauriers à l’ombre desquels il s’asseyait le soir. Le printemps, en revenant, fit reverdir le parterre, et quelques gouttes d’eau rendirent la vie aux lauriers ; mais les marbres furent plus difficiles à retrouver : il eût été impossible à Pomponio de les remplacer à prix d’argent, lui qui, au témoignage de son ami Platina, était si pauvre, que s’il eût perdu deux œufs, il n’aurait pas eu de quoi s’en procurer deux autres. Ceci se passait en là84, dans une révolution dont Rome fut le théâtre. Heureusement le professeur avait autant d’amis qu’il comptait d’élèves : ses disciples se répandirent dans la campagne, et bientôt eurent retrouvé de nouvelles pierres, de nouvelles statues, de nouvelles inscriptions ; et le professeur reprit ses leçons sur la Rome souterraine, un moment interrompues. Marc-Antoine Sabellico, Conrad Peutinger et André Fulvio continuèrent les travaux de leur maître. Le vieux Pomponio, avec sa barbe mal peignée et ses vêtements troués, craignait de se montrer aux visiteurs qui venaient frapper à chaque heure du jour à sa demeure du Quirinal : il était si heureux dans son musée lapidaire ! — Dites que je n’y suis pas, faisait-il répondre à l’un de ces importuns ; nié prend-on pour un ours ou pour un lion ? L’ours avait trop d’obligations à Laurent de Médicis pour éconduire le cardinal ; Jean était d’ailleurs l’élève de Politien, avec lequel l’archéologue entretenait un commerce épistolaire, et il savait aussi que l’adolescent aimait les lettres latines. Or Pomponio, le maître de William Lilly, tout en s’occupant de ressusciter la pierre, s’était attaché à reproduire quelques classiques latins : Silius Italicus, qu’il avait publié à Rome en 1471 ; Terentius Varro, à Venise en 1474 ; Quintus Curtius, etc. : comment lui refuser sa porte ? Jean vit donc et fréquenta Pomponio. Ce fut ce savant qui le premier, à Rome, eut l’idée de fonder un cercle littéraire, sous le nom d’Académie, où se réunissaient chaque semaine tous ceux qui s’occupaient d’arts, de science ou de philosophie ; il avait pris pour modèle l’institution platonicienne formée à Florence sous les auspices des Médicis. A Rome, ceux qui s’associèrent à l’œuvre de Pomponio étaient des âmes folles de paganisme, qui renoncèrent à porter le nom qu’elles avaient reçu le jour de leur baptême pour prendre celui de quelque personnage antique Philippe Buonaccorsi s’appela Callimaque ; Marc le Romain, Asclépiade ; Marino le Vénitien, Glaucus ou Glocco ; comme si le nom, dit l’Arioste, faisait le poète. A tout prendre, c’était un innocent caprice dont la papauté ne dut guère s’effrayer ; mais il parait que les Muses n’étaient pas seules fêtées dans cet institut littéraire, et qu’on y évoquait parfois des souvenirs républicains qui ne pouvaient plaire au saint-siège : on y rêvait la restauration de la république romaine, et peut-être des superstitions païennes. Paul II fit arrêter quelques-uns des académiciens, entre autres Platina et Pomponio Leto. On reproche au pontife d’avoir usé contre les coupables de rigueurs trop sévères ; on veut que, dans sa haine contre les lumières, il ait inventé des crimes, afin d’exiler quelques fanatiques dont il avait peur. Paul a trouvé dans Platina, l’un des membres de cette association, un ardent accusateur, dont le protestantisme n’a fait que reproduire les plaintes, sans oublier surtout celle que l’historien a formulée contre l’intelligence du pape ; mais un écrivain moderne a fait ressortir tout ce que ce reproche d’ignorance avait de mensonger. Il n’est guère plus possible de croire, quand on lit les preuves amassées dans la dissertation de Mgr Quirini, à l’imbécillité d’un pape qui lit les historiens antiques, qui de sa bourse aide les jeunes gens de famille dans leurs études, qui paye généreusement les professeurs, et qui conçoit surtout l’idée d’un collège d’abréviateurs au nombre de soixante-dix, dont l’occupation principale sera de réviser et de corriger les actes publics publiés en latin. Quoi qu’il en soit, les débris de cette académie, dispersés en diverses contrées, se retrouvèrent à Rome à l’exaltation de Sixte IV. Buonaccorsi, après un long exil, reparut au Quirinal, portant toujours le nom de Callimaque, qu’il faisait suivre cette fois de l’épithète d’experiens, par allusion aux fortunes diverses qu’il avait éprouvées dans ses longs voyages. A la cour de Pologne, il avait trouvé dans Casimir un généreux protecteur ; au moirent où nous parlons, il était ambassadeur de ce prince auprès d’Innocent S’III, à Rome. Il retrouva son ami Pomponio, usé par l’âge, niais toujours fidèle à ses pierres, qu’il aimait comme à vingt ans. La mort avait moissonné quelques-uns de leurs anciens collègues, mais les vides s’étaient bien vite remplis ; on recommençait à cultiver les lettres. Paul Cortese, le nouvel hôte de Pomponio, achevait, à vingt-trois ans, son dialogue célèbre de Hominibus doctis, et rassemblait les matériaux de ses quatre livres de sentences, recueil d’homélies dans le genre des Postilles du docteur Luther. Un des grands reproches que Martin a faits à nos moines, c’est d’être restés embarrassés jusqu’à l’époque de la réforme dans les langes de Scot. Cortese cependant, dans ses Discorsi volgari, a répudié la méthode aristotélicienne ; il ne procède pas par syllogismes, niais expose simplement le sujet, qu’il développe à l’aide de l’autorité et de la raison. Ainsi donc, c’est l’Italie qui devait la première échapper à la scolastique. A quoi donc se réduisent les plaintes éloquentes de Luther ? Il paraît que Paul Cortese, dans son zèle pour les lettres, voulut que Rome eût une double tribune d’où rayonnerait au loin la lumière. Il essaya de fonder un autre cercle académique, mais qui n’eut pas de succès ; toutefois rien ne prouve qu’il déserta la maison de Pomponio Leto. A cette époque, la poésie italienne commençait à fleurir à Rome : elle avait pour représentant Séraphin Aquilano, que protégeait le cardinal Ascagne Sforce. Aquilano avait fait une étude particulière de Dante et de Pétrarque. Un des premiers, il imagina de s’accompagner sur le luth en improvisant ; musicien habile, il cachait sous les sons de son luth les défauts de sa versification. Ses succès firent éclore une multitude de poètes qui, bien moins inspirés encore que Séraphin, la lyre en main, chantaient de pitoyables vers ; rapsodes nomades qui employaient, pour séduire le peuple, la langue vulgaire, réveillant ainsi le culte de la muse nationale. Poète, musicien, archéologue, philosophe, Jean de Médicis devait se plaire à Rome. Il fut longtemps un des habitués des réunions de Pomponio. À Rome, il continua le genre de vie modeste qu’il menait à Florence : il se levait de bonne heure, cherchait quelque église écartée pour faire sa prière du matin, et rentrait à son palais, où ne tardaient pas à venir quelques amis dévoués. Il n’avait oublié ni son père, ni ses frères, ni les lettrés, ni ses professeurs, avec lesquels il entretenait une correspondance suivie. Florence tenait toujours une large place dans ses affections. Il était heureux quand, accompagné de Pomponio, il avait découvert quelque beau marbre dont il pouvait faire présent à sa ville natale. Sa table était frugale comme celle de son père : pendant le repas, il se faisait lire quelque histoire des temps passés ; après le dîner, il aimait à se promener dans la vieille Rome ; point de recherche dans ses vêtements, qui étaient demeurés d’une propreté exquise. Ses serviteurs l’aimaient, car il était bon, doux et affable ; les pauvres ne l’imploraient jamais en vain ; Innocent VIII l’entretenait souvent. Jean obéissait aux conseils de son père. Peu de temps avant sa mort, Laurent avait tracé pour son fils un plan de conduite qui semble l’œuvre de quelque sage retiré du inonde. Mon premier désir est que vous n’oubliiez jamais à qui vous devez les faveurs dont vous avez été comblé : ce n’est ni votre prudence, ni votre mérite, qui vous ont fait cardinal, mais Dieu seul dans son admirable bonté. Le meilleur moyen de vous acquitter envers Dieu est de mener une conduite exemplaire..... Il serait honteux pour vous, et pour moi bien douloureux, qu’à l’âge où l’on songe à former sa raison et sa conduite, vous démentissiez les espérances que vous aviez données. Tâchez donc d’alléger le fardeau que vous portez, en persévérant dans ces études qui conviennent si bien à votre état de vie. L’an passé, j’éprouvai une bien douce consolation on vous voyant souvent approcher du tribunal de la pénitence et de la sainte table : persévérez ; c’est le moyen de rester dans les bonnes grâces du ciel. Vous voilà donc à Rome : il vous sera bien difficile de suivre les conseils de votre père ; outre les mauvais exemples, vous allez trouver des courtisans de corruption. Vous ne pouvez vous dissimuler que les faveurs que vous avez obtenues à votre âge ont excité l’envie : ceux qui n’ont pu vous arrêter dans la voie des honneurs n’oublieront rien pour vous perdre dans l’estime publique, en vous faisant choir dans cette fosse où ils sont eux-mêmes tombés : votre âge ne les servira que trop. Vous devez d’autant plus chercher à éviter cet écueil, que la vertu est assez rare dans le sacré collée : pourtant il y a parmi les cardinaux des hommes de doctrine et de sainte conduite ; voilà ceux que vous devez prendre pour modèles..... Fuyez, comme on fuit Charybde et Scylla, l’hypocrisie ; point de folle ostentation ni dans votre conduite ni dans vos discours..... Vous le savez, rien n’est si difficile que de savoir converser avec des hommes de caractères divers : à cet égard, que vous recommander ? Avec les cardinaux et les autres personnes de condition, vous serez décent et réservé. Que votre conscience interrogée soit toujours en état de vous rendre ce témoignage, que jamais vous n’avez eu l’intention d’offenser personne. A Rome, du reste, mon avis est que vous devez plus souvent ouvrir l’oreille que la bouche..... Vous êtes le cardinal le plus jeune du sacré collège, et peut-être de tous les cardinaux créés jusqu’à ce,jour ; vous devez donc vous montrer le plus empressé, le plus modeste, et ne jamais vous faire attendre à la chapelle du consistoire ou dans les députations. Vous saurez bientôt ceux dont la vie est le plus ou le moins exemplaire. Fuyez ceux dont la conduite est décriée, dans l’intérêt des mœurs d’abord, et par respect pour l’opinion. Dans votre train de maison, cherchez la décence plutôt que l’éclat ou la richesse..... Point de bijoux ni de soie, cela ne convient pas à des gens de votre sorte ; mais des livres et des antiques, un domestique décent et peu nombreux. Recevez, plutôt que d’être reçu chez les autres ; qu’on ne voie à votre table que des mets simples et communs. Faites de l’exercice : dans votre état, l’infirmité arrive bien vite quand on ne sait pas la prévenir..... Une habitude que je vous recommande surtout, c’est de vous lever de bonne heure : cela fait du bien d’abord à la santé ; puis cela est nécessaire dans votre profession, où vous êtes obligé d’assister à l’office, de vous livrer à l’étude, de donner audience, etc. Autre conseil que je vous donne : le soir, en vous couchant, rappelez-vous le travail du lendemain ; c’est le meilleur moyen de n’être pas pris au dépourvu. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, que Fabroni appelle avec raison le chant du cygne, Laurent rendit le dernier soupir. Un moment il avait cru que Dieu lui permettrait de quitter les affaires, et, loin de Florence, de vivre quelques années encore, dans l’une de ses villas, au milieu de tout ce qu’il chérissait le plus sur cette terre, ses enfants, ses amis et ses livres. Mais son heure était arrivée : à quarante-quatre ans il se mettait au lit’ pour quitter à jamais ce monde dont il était la gloire. Une fièvre dont Politien a décrit le funèbre caractère ne lui laissa plus de repos. Les médecins accoururent : d’abord, Leoni de Spolète, qui essaya vainement les remèdes ordinaires ; puis Lazare le Tessinois, dont la renommée était grande, et qui, dans un mélange de substances minérales et végétales, crut avoir trouvé une héroïque formule ; mais sa science devait être impuissante. Dès qu’il sentit les approches de la mort, le Magnifique voulut se réconcilier avec Dieu. Il fit appeler son confesseur, le vieux Bosso, qui ne le quitta plus. Le lendemain, autour d’une petite table recouverte d’une nappe blanche, et sur laquelle s’élevait, entre des chandeliers d’argent, l’image du Christ, ses serviteurs à genoux attendaient l’heure où, le prêtre apporterait au malade le corps de Jésus-Christ. Quand il parut, tenant dans ses mains la sainte hostie, Laurent se leva sur son séant et, les mains jointes, murmura ces mots de tendre piété : Non, je ne souffrirai jamais que celui qui me créa, qui me racheta de son sang, vienne à moi ; c’est à moi d’aller à lui : levez-moi, je vous en prie, que j’aille à mon Sauveur. Le prêtre et les assistants prièrent longtemps, après quoi le prince reçut le viatique. Pendant cette suprême cérémonie, les lèvres du moribond ne cessaient de s’ouvrir pour prier : Mon Dieu, disait-il, ayez pitié de moi, pauvre pécheur ; que le sang que vous avez offert à votre père sur l’autel du sacrifice, pour la rédemption des hommes, me compte dans l’éternité. Quand il eut rempli ses devoirs de chrétien, il voulut entretenir son fils en particulier : les assistants s’éloignèrent. Laurent resta seul avec Pierre, auquel il fit ses dernières recommandations. L’enfant écoutait en silence ; il promit d’obéir aux ordres du mourant. Laurent étendit ses mains défaillantes sur la tête de son héritier et le bénit. Un moment après, on annonça Politien, qui, à la vue de ce corps passé en quelques heures à l’état de cadavre, ne put réprimer un mouvement d’effroi, et tourna la tête pour pleurer. C’est toi, Angiolo, dit le moribond à son ami en tâchant de sourire ; approche donc. Et il agitait convulsivement la main pour l’attirer à lui : Politien la prit et la baisa dévotement, puis la posa sur le lit, et passa dans l’antichambre afin de donner un libre cours à ses sanglots. Il revint bientôt. Laurent, d’un œil inquiet, cherchait dans l’appartement une figure dont l’absence lui faisait mal. Où donc est Pic ? murmura-t-il avec un profond soupir ; est-ce qu’il n’est pas là ? — Il a craint d’importuner votre seigneurie, répondit Politien. — Oh ! qu’il vienne, reprit le duc, je veux le voir. Pic, averti, vint bien vite, et se précipita sur la main que lui tendit l’auguste malade, pendant que Politien, courbé sur le lit, étreignait de ses bras les genoux du prince. Laurent interrompit cette scène muette en s’adressant à Pic : Mon ami, lui dit-il d’une voix défaillante, j’ai voulu vous voir pour la dernière fois ; je mourrai content maintenant. Et changeant aussitôt de conversation : J’aurais bien voulu que Dieu m’eût laissé vivre jusqu’au jour où j’aurais pu compléter votre bibliothèque... En ce moment parut Savonarole. — Monseigneur, dit le dominicain, je viens pour vous exhorter à demeurer ferme dans la foi catholique. — C’est bien ma résolution, dit le prince. — Promettez-moi de mener une vie toute chrétienne, si Dieu vous rend la santé. — Oh ! je vous le promets, dit le Magnifique. — Et de supporter la mort avec courage, s’il veut que vous mouriez. — Que sa volonté soit faite ! dit Laurent. Comme le moine s’éloignait, le prince le rappela. — Mon frère, lui dit-il, je vous pardonne, donnez-moi votre bénédiction. Savonarole le bénit. C’est Politien qui nous a donné tous ces détails. Son récit diffère de celui où quelques historiens nous représentent le moine de Saint-Marc s’éloignant sans vouloir absoudre le malade qui refuse de rendre la liberté à Florence. Si cette scène, comme on l’a dit, s’est passée sans autres témoins que le prêtre et le pénitent, que penser de Savonarole qui divulgue les secrets de la confession ? Heureusement pour la mémoire de frère Jérôme, la narration de Jean-François Pic, neveu du glorieux Pic, n’est qu’une fable. La dernière heure du Magnifique approchait : il perdit l’usage de la parole ; ses lèvres s’ouvraient pour prier, mais aucun son n’arrivait à l’oreille des assistants. Sur un signe qu’il fit de l’œil, on approcha de sa bouche un crucifix qu’il embrassa tendrement, puis il pencha la tête et rendit le dernier soupir. Jamais, dit Machiavel, à Florence, ni même en Italie, n’était mort un prince aussi sage et qui fût plus digne de regrets. Ce trépas, qui devait être la source de tant de calamités, fut marqué dans le ciel par des signes merveilleux. Machiavel fait allusion à ces prodiges physiques, dont parlent les contemporains : la chute du tonnerre sur le temple de Santa-Reparata, les feux nocturnes qui illuminèrent la villa Careggi, la lutte d’ombres d’une grandeur extraordinaire, les voix qu’on entendit dans l’espace, les éclairs à travers une atmosphère lucide, et le suicide du médecin Pierre Leoni, qui se jeta dans un puits. Le corps fut transporté de Careggi à Florence, et enseveli dans l’église de Saint-Laurent. Jamais trépas n’avait fait couler autant de larmes : le peuple faisait à haute voix l’oraison funèbre du prince ; les poètes récitaient les vers les plus connus de son Ambra ; les philosophes disaient sa joie quand Jérôme Roscio lui donna la première effigie de Platon ; les sculpteurs parlaient de ces beaux jardins auprès de Saint-Marc, où il avait rassemblé des marbres antiques, studio où Michel-Ange allait chaque matin s’inspirer ; les peintres célébraient son amitié pour Ghirlandajo et tes élèves de ce maître, François Granacci et Torrigiano ; les humanistes rappelaient le souvenir de cette table modeste où, à l’heure des repas, venaient s’asseoir tous ceux qui avaient un nom dans les lettres et dans les arts, et où ses fils, arrivés les derniers, n’avaient d’autre place que celle qu’ils pouvaient y trouver ; les savants vantaient ses soins à rassembler des manuscrits antiques pour en doter la bibliothèque qu’il voulait fonder avant de mourir ; les mères citaient les scènes intérieures de famille où il s’amusait à jouer au bouchon avec ses fils, ou à promener sur le dos ses jeunes filles, amusements que la gravité de Machiavel a eu tort de blâmer ; l’un retraçait le talent du prince à conter, sa conversation grave et sévère, et, quand le sujet l’exigeait, toute pleine de sel, mais de ce sel dont était imprégné le flot d’où Vénus était sortie ; un autre citait les soupers du prince chez Ugolin Verino ; les chanoines du Dôme rappelaient sa piété, sa foi vive et tendre, les tombeaux qu’il avait fait élever aux hommes qui avaient rendu des services à l’État ; les courtisans vantaient son affabilité ; ses serviteurs, sa bonté. Au milieu de ce doux concert s’élevaient à peine quelques voix sévères pour blâmer son goût pour le spectacle, son penchant aux plaisirs, le paganisme qu’il avait introduit dans l’art, ces fêtes de carnaval où il ne se contentait pas d’assister, mais qu’il avait chantées dans des vers que la morale ne pouvait toujours approuver : louanges et blâmes que l’histoire doit recueillir sous peine de manquer à sa mission, mais dont elle a droit d’apprécier la valeur. Les louanges décernées en ce moment au mort qui, la tête découverte, traverse les rues de Florence, étaient l’élan spontané d’affections populaires ; le blâme était une protestation dictée moins par le sentiment religieux, trop souvent offensé par le prince, que par l’esprit de parti. Il y avait à Florence des âmes qui méditaient la chute des Médicis, en expiation des maux qu’elles prétendaient que cette famille avait faits à leur patrie ; ces âmes, exaltées par la prédication de Savonarole, et, pour la plupart, entretenues aux dépens du Magnifique, calomniaient les morts, en attendant qu’elles pussent chasser les vivants. Du moins, pas une de ces natures ingrates n’appartenait au parti des lettrés. La poésie fut admirable à cette heure ; elle se ressouvint que Laurent lui avait donné en abondance de l’ombre, des bois, du soleil, des livres ; elle le paya en beaux vers : c’était son or, à elle ! Le plus généreusement récompensé par le prince, Politien fut aussi celui qui chanta le plus haut les vertus ducales. Car, pendant qu’on menait le corps à sa dernière demeure, il disait : Qui pourra prêter à mes yeux une source intarissable de larmes, afin que je pleure la nuit, que je pleure le jour ? Ainsi se lamente le ramier séparé de sa colombe, et le cygne qui va mourir, et le rossignol. Lorsque le peuple, excité par Savonarole, chassera ses maîtres, il ne respectera, dans son aveugle colère, ni la colombe, ni le rossignol, ni le cygne du poète : on enlèvera à Politien jusqu’à ses livres. |