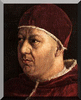HISTOIRE DE LÉON X
CHAPITRE II. — LES MAÎTRES DE JEAN DE MÉDICIS. - MARSILE FICIN. - PIC DE LA MIRANDOLE. - POLITIEN.
|
MARSILE FICIN enfant,
adolescent. - Il traduit Platon, et refait sa version, d’après les conseils
de Musurus. - Il explique en chaire les doctrines du philosophe. - Son
disciple Mercati. — PIC DE LA MIRANDOLE. Son portrait tracé par son neveu. -
Il étudie à Bologne. - Se met à parcourir le monde. - Est trompé par des
Juifs. - Son voyage à Rome. - Il est accusé d’hérésie, et protégé par Innocent
VIII. - Accusé de nouveau à la mort de ce pape, et défendu par Alexandre VI.
- Ses sentiments religieux. — POLITIEN. Sa villa de Fiesole. - Ses goûts. -
Il professe l’éloquence latine à Florence. - Son portrait, par Paul Jove. -
Ses Sylves. - Idée de son style. - Sa liaison avec le Magnifique. - Influence
de ces lettrés sur Jean de Médicis. I. MARSILE FICIN.
Un moment toutefois, l’enfant fut menacé d’être arrêté sur cette route de lumière qu’il avait rêvée. Son père voulait en faire un médecin. Cosme sourit à cette idée : Le ciel, dit-il au docteur, vous a créé pour guérir les corps, mais votre fils est destiné de Dieu à guérir les âmes. Il n’y avait rien à répondre. Marsile revint à son soleil et à ses livres. On avait apporté de Venise à Florence divers manuscrits de Platon : le Magnifique en acheta quelques-uns dont il fit présent a son protégé, qui, dès ce moment, délaissa les muses pour la philosophie. Dans sa ferveur pour Platon, l’adolescent oubliait l’heure des repas, ses amis les lettrés, son Mécène, et Florence elle-même. Cosme cependant entretenait toujours le feu de la petite lampe, qui brillait plus longtemps que de coutume. Les veilles nocturnes de Ficin étaient si longues, qu’il tomba dans un véritable marasme. On craignait pour ses jours. La voix de l’amitié eut peine à faire comprendre à l’écolier qu’un peu de repos lui était nécessaire pour rétablir des forces épuisées par l’étude. Marsile céda, et renonça pour quelques mois à ses chants du matin, à ses promenades sur les bords du fleuve, à ses causeries avec les humanistes florentins, à ses visites au Magnifique, à Platon, son maître : la santé revint. C’était en 1456. Après deux années entières employées à sonder les mystères de la nouvelle philosophie, Marsile vint au palais ducal pour lire, devant une docte assemblée dont Cosme était le président, quelques pages des Institutions platoniciennes, qu’il avait divisées en quatre livres, et qu’il se proposait de mettre bientôt sous presse. La lecture achevée, Cosme hocha la tête en souriant. Marsile comprit le signe muet, ferma son manuscrit, dit adieu à ces rêves de gloire qui l’avaient soutenu pendant son travail, et promit, avant de rien publier, d’apprendre le grec, qu’il ne savait qu’imparfaitement. II avait alors vingt-trois ans. Il tint parole. Platina, dit-on, fut le nouveau maître qu’il choisit : ses, progrès murent rapides. Cette fois il pouvait faire à son aise des songes, car il connaissait la langue hellénique comme un rhapsode de Samos. Il refait sa version, et c’est au juge le plus compétent qu’il veut la montrer, à Marcus Musurus, le maître de Lascaris. Il apportait avec lui deux ou trois feuillets de sa traduction nouvelle. Musurus, en lisant ces belles pages, écrites avec une patience de calligraphe ou de jeune fille, s’amusait à jouer avec son écritoire. Ficin, impatienté, interrompt le lecteur : — Voyons donc, lui demande-t-il d’un ton suppliant, qu’en pensez-vous ? — Voilà, dit Musurus en répandant l’encre en guise de poudre d’or sur le manuscrit qu’il rend tout noirci à l’auteur. Tout autre que Ficin se serait emporté : heureusement il avait lu dans le Timée d’admirables préceptes sur la colère, et il n’aurait pas voulu pécher contre Platon. Donc, sans mot dire, il retourne à la petite habitation rurale que Cosme lui a donnée dans la villa Carreggi, et se remet une troisième fois à l’ouvrage. L’œuvre s’étend, grandit, et reste cachée aux regards jusqu’à l’époque de la mort de son bienfaiteur. Pierre venait de succéder à Cosme, et Ficin ne s’était pas aperçu du changement de règne : heureusement pour les lettres, la dynastie des Médicis avait encore de longs jours à vivre. Pierre avait voulu continuer Cosme : par ses soins, une chaire s’éleva où Marsile monta pour expliquer Platon. On ne se douterait pas de toutes les belles choses qu’il trouvait dans le fils d’Ariston : la Sainte-Trinité, le Verbe de saint Jean l’Évangéliste, la Création de Moïse, l’Eucharistie de saint Paul. II faisait du philosophe un génie céleste qui avait eu l’intuition des mystères enfermés dans nos saints livres. Est-il besoin de dire qu’il plaçait dans son paradis l’écrivain antique que Jésus, dans sa descente aux enfers, venait arracher aux limbes purificateurs pour le couronner de l’auréole de bienheureux ? Il avait renoncé aux formules de salutation ordinaire, et il n’appelait ses auditeurs que mes frères en Platon. A ses yeux, le Criton était un second Évangile tombé du ciel. Ses élèves partageaient son enthousiasme et ses croyances. Reuchlin et Agrippa, après avoir suivi ses leçons, quittèrent Florence pour retourner en Allemagne. L’Allemagne devait à son tour opérer sa résurrection intellectuelle, mais en oubliant et quelquefois en calomniant la terre où. ses enfants avaient reçu la lumière. Parmi les auditeurs de Ficin, Michel Mercati se faisait remarquer par une expression indicible de mélancolie qu’il portait constamment aux leçons du professeur : il doutait. L’avenir le tourmentait, et l’existence de l’âme après cette vie était un problème dont il demandait vainement la solution à ses savants amis : ses amis le ramenaient toujours à Platon. Malheureux qui ne savait pas lire l’immortalité de la pensée dans cette intelligence qui, chaque semaine, développait si poétiquement en chaire les harmonies du monde spiritualiste ! Il avait besoin de croire cependant, car le doute le faisait souffrir. Un jour qu’il discutait avec Ficin sur les destinées futures de l’homme : — Maître, lui dit-il, faisons un pacte. — Et lequel ? répondit le professeur. — Que celui qui mourra le premier vienne dire à l’autre s’il y a quelque chose là-haut ; et, en prononçant ces mots, Mercati regardait tristement le ciel. Ficin prit la main de Mercati et inclina la tête. L’historien continue ainsi ce récit, qui rappelle une ballade de Bürger : A quelque temps de là, un matin, quand tout dormait dans Florence, Mercati est réveillé par le bruit des pas d’un cheval et la voix rauque d’un cavalier qui crie : Mercati ! L’homme du doute se lève, entrouvre sa fenêtre, et aperçoit, sur un cheval blanc, un fantôme qui du doigt lui montre !e ciel en murmurant : Michel ! Michel ! cela est vrai ! Mercati descend précipitamment l’escalier, pousse la porte, regarde de tous côtés ; la vision avait disparu. Il se rappelle alors le pacte qu’il a fait avec Ficin, et prend le chemin de la demeure du néoplatonicien. Il frappe. — Que voulez-vous ? demande une vieille femme. — Parler à mon ami Ficin. — Mon maître vient de mourir, dit la servante ; priez Dieu pour son âme. Le légendaire termine là son drame, sans nous dire si Mercati continua de douter. II. JEAN PIC DE LA MIRANDOLE. A côté de cette âme inquiète venait quelquefois s’asseoir, attentive à la parole du maître commun, une autre intelligence à la recherche également de la vérité, mais prête à l’embrasser quand elle aurait eu le bonheur de la trouver. Aux yeux du monde, Dieu en avait fait une créature d’élite : c’était quelque chose de plus beau peut-être que Raphaël. Pic de la Mirandole, nous dit son neveu, avait la taille souple et élancée, les chairs d’un blanc mat, l’œil d’un blets marin, la chevelure blonde et touffue, les dents d’une blancheur de perle. Il y avait dans toute sa personne un mélange de douceur angélique, de pudique modestie, de bienveillance attrayante qui charmait les regards et attirait les cœurs. A ces dons un peu trop féminins Pic en joignait d’autres plus dignes d’être célébrés : une imagination orientale, une parole colorée, une âme d’artiste qui se laissait emporter à toutes les émotions de la peinture, de la musique ou de l’éloquence ; une sensibilité exquise, et par-dessus tout une mémoire qui tenait du prodige. On lui lisait une page d’Homère, et il la répétait en changeant l’ordre des vers. Quelques mois lui suffisaient pour posséder le dictionnaire entier d’un idiome : à dix-huit ans il savait vingt-deux langues. Parfois, après ses repas, il improvisait, devant son commensal Benivieni, tout un nouveau chant de l’Enfer ou du Paradis ; et, le lendemain, Florence, dans l’admiration, ne savait qui saluer, des vers de Dante, son vieux poète, retrouvés après trois siècles, ou du mensonge de son improvisateur.
Malheureusement, comme toutes les natures vaniteuses, Pie aimait à prêter l’oreille à la louange et se laissait prendre au piège de la flatterie. Il voyageait, suivant sa coutume, quand il vit venir de loin une caravane d’Israélites à longues barbes et à robes flottantes, qui allaient de ville en ville pour vendre des manuscrits recueillis dans leurs pérégrinations. On s’assied sur l’herbe, on parle, on dispute. Pic est dans l’enchantement. On lui offre soixante codices hébreux, composés par Esdras, et qui renferment, lui dit-on, les arcanes de la philosophie cabalistique. A cette époque de curieuses investigations, c’était une opinion accréditée que le peuple juif gardait cachée, dans des livres fermés aux profanes, la doctrine des mages de l’ancienne loi. Comme le Faust de Goëthe et Pic croyait trouver dans un parchemin la source ou l’âme peut apaiser sa soif éternelle. Il ne se doutait pas encore que les mystères de la vie humaine, de sa destinée, de son avenir, sont écrits en lettres d’or dans un livre que le Christ nous a légué en mourant : l’Evangile était à ses pieds, et il ne se baissait pas pour le ramasser. Jugez de la joie de notre Ahasvérus, quand, au prix de tout ce qu’il possédait d’or dans sa bourse de cuir, il se crut en possession de secrets dont, à son tour, il pourrait faire l’aumône à ses semblables ; car il était généreux comme on l’est à son âge. On devine qu’il avait été trompé. Ces traditions d’Esdras n’étaient qu’un amas de gloses dérobées au Talmud, aux écrits des rêveurs de l’Arabie et de la Grèce ; mais c’était pour lui de l’or et de la lumière. Le voilà donc, heureux, qui prend le chemin de la capitale du monde chrétien. C’est là qu’il se propose de convier à un cénacle philosophique toutes les intelligences de l’Europe. A Rome, où régnait Innocent VIII, protecteur des lettres, Pic fut accueilli avec enthousiasme. Il étonna le pape, le sacré collège, les lettrés, par sa science lexicologique ; il répondait en hébreu, en chaldéen, en grec, en latin, et dans presque tous les idiomes vivants. Sans perdre un moment, il se mit à formuler neuf cents thèses, chacune formée de diverses propositions, qu’il jetait comme autant de défis, non pas à ce monde de robes noires qui balayaient les bancs de l’école, mais au monde des théologiens, des prêtres, des philosophes. Il y avait dans ces thèses de la physique, de l’histoire naturelle, de la médecine, de la théologie, de la cabale. Aristote y était accouplé à Isaac de Narbonne, Platon à Abamanon de Babylone, saint Thomas à Moïse l’Égyptien, Scot à Mahumet de Tolède, saint Augustin à Adélando l’Arabe. Viennent maintenant les disputeurs, Pie est tout prêt : voilà du pain, du vin, un bon lit, qu’il leur offre dans l’hôtellerie de la grande route ; personne ne se présenta. Il se mit à chercher à travers les rues de Rome ; personne non plus qui voulût se commettre avec un tel jouteur. Que faire ? publier ses thèses : c’est le parti qu’il prit. Mais il avait irrité l’amour-propre des savants : l’amour-propre essaya de se venger. On fouilla dans ce chaos de propositions ; on en tira treize qu’on déféra au souverain pontife comme entachées d’hérésie. A ce mot de funèbre présage, notre juif errant s’émeut et s’agenouille pour prier, les mains jointes, celui qui lit au fond des cœurs, de le défendre contre les préventions ou la jalousie de ses ennemis. La prière était trop ardente pour qu’elle ne fût pas écoutée. Innocent VIII lut cette apologie, écrite avec une foi tout enfantine ; il en fut touché, et défendit d’inquiéter Pic de la Mirandole. On se tut, et la papauté eut la gloire de protéger la liberté de penser dans une des plus hardies intelligences de l’époque. C’est un beau triomphe pour la tiare. Voltaire n’en a pas parlé : notre devoir, à nous, était d’en rappeler le souvenir. Jeune encore, il riait de ses amis qu’il voyait courir comme de véritables enfants après des bulles de savon. Un jour qu’Ange Politien chantait en poète le bonheur que procurent les lettres : — Insensé, lui dit-il en se penchant sur l’épaule de son maître, qui te fatigues à chercher dans la science ce que tu ne saurais trouver que dans l’amour divin. Parfois cependant il sentait en son âme l’aiguillon de la vanité : il regardait autour de lui sur sa table de travail, où reposait une cassette d’ébène, et il disait à Benivieni : — Je ne conçois pas le péché de murmure contre Dieu, à moins cependant que je ne perdisse cette petite boite où sont enfermées mes élucubrations. La science moderne, en ouvrant la cassette du mort, a, souri de pitié. Elle hausse les épaules quand on lui parle aujourd’hui du bruit que Pie fit autrefois parmi ses contemporains ; elle se moque du titre de monarque de la cabale qu’on donnait à Pic ; elle conteste même, dans son dénigrant scepticisme, jusqu’à ce don de vingt-deux langues que l’Esprit-Saint aurait soufflé dans ce merveilleux cerveau ! Passons-lui son sourire, son incrédulité et ses moqueries. Pic, quoi qu’elle en dise, n’en resta pas moins une des individualités les plus puissantes du quinzième siècle. Dans ses thèses insolentes de omni re scibili, s’il y a du sable, il y a de belles perles aussi. En traitant des animaux et des plantes, Pic enseigne que leurs germes se développent à l’aide d’une vertu prolifique : pressentiment instinctif de la décomposition des corps et du principe de l’organisme vital. Tout en s’élevant contre l’astrologie judiciaire, il affirme que le magicien antique, c’est-à-dire le sage, possédait de véritables notions sur les phénomènes naturels ; qu’au ciel et sur la terre il n’existe pas de force cachée que la science ne puisse s’approprier : et, parmi ces forces occultes que l’homme un jour maîtrisera inévitablement, il semble indiquer la vapeur, l’électricité et le magnétisme minéral. Pic n’avait-il pas raison de trembler pour sa cassette ? Que de trésors elle enfermerait s’il eût vécu de nos jours ! Il dut quitter Rome. Cette victoire avait coûté à ses adversaires trop d’humiliation pour qu’il espérât jouir en paix de sa gloire. Il reprit sa vie des champs, il revit son beau soleil, il retrouva sa tente poudreuse, il dormit comme autrefois sous son étoile protectrice, il aspira de nouveau cet air ambiant qui dilatait ses poumons et fertilisait son cerveau. A peine avait-il touché le sol de la France, qu’il apprit à la fois la mort d’Innocent VIII, l’exaltation de Borgia sous le nom d’Alexandre VI, et le réveil de ce spectre coiffé du bonnet de docteur, et qui de la ville sainte lui criait : — A Rome, hérétique. — A Rome donc ! se dit-il. Heureusement il se rappela qu’avant de ceindre la tiare, Borgia s’était fait applaudir au barreau d’Espagne, et il résolut de demander des juges au nouveau pape. Il y a ici une belle page dans la vie de Borgia. Voici donc qu’à trois cents lieues de la ville éternelle, un pauvre voyageur, assis tristement dans une misérable auberge de village, prend un peu d’encre et écrit au pape, c’est-à-dire à ce qu’il y a au monde de plus grand : car le pape, comme le remarque Voltaire, c’est l’opinion au moyen-âge. Il se plaint qu’on ravive cette tache d’hérésie qu’Innocent VIII avait eu soin de laver lui-même ; il dit que, nourri du lait de la sainte Enlise romaine, il aime cette Enlise comme sa nourrice et sa mère, qu’il veut vivre et mourir catholique ; il demande qu’on lui donne des juges, et proteste de sa soumission et de son obéissance au saint-siège. Alexandre nomme sur-le-champ une commission. L’œuvre des neuf cents propositions est soumise à un examen sévère. Cette fois ce sont des théologiens qui ont pris part au mouvement spiritualiste dont Florence donna le signal, que la papauté a choisi pour présider à cette enquête religieuse. L’innocence de Pic est reconnue solennellement. Ce fut un bien beau jour pour notre jeune homme que celui où il put placer en tête de ses thèses la bulle d’Alexandre VI ! Sa foi triomphait, il était heureux ! Car, dans ce tourbillon de joies mondaines, de voluptés intellectuelles, de poussière et de vanités, où il s’était laissé emporter, jamais il n’avait oublié l’eau de son baptême : l’ange s’était fait homme plus d’une fois, mais les ailes lui restaient. A trente ans, il s’en servait pour remonter au ciel. Las d’errer à travers l’espace, il secouait la poussière des grandes routes, dénouait sa ceinture de cuir, jetait bas son bâton de pèlerin, se réfugiait dans le sanctuaire, et, devant l’autel de la Vierge, disait adieu au monde, aux lettrés, à la cabale, ses ardentes amours, et passait le reste de ses jours dans la prière et l’exercice des vertus les plus austères du christianisme. III. ANGE POLITIEN. Ange Politien a d’autres instincts : vous ne le trouverez pas sur les grands chemins, à la recherche de cette montagne d’aimant que Paracelse et Jean de la Mirandole poursuivent presque en même temps. Il habite une villa assise sur le sommet d’une rampe de verdure, d’où l’œil domine la cité méonienne et les longs méandres de l’Arno à travers les campagnes étrusques. Et dans cette retraite de Fiesole, que Laurent a faite à Politien, il n’y a pas seulement de beaux arbres, de lointains horizons, de fraîches brises, mais du vin, et un vin que le rhéteur vante à son ami Ficin :
A la cour du Magnifique, nul lettré n’aima d’un amour plus vif les champs, la verdure, les fleurs et le soleil : le bruit de Florence tourmentait son cerveau ; même lorsque le poète n’avait pas besoin d’inspiration, qu’il ne cherchait ni le mètre ni la quantité, que les ailes reployées il travaillait en compilateur à coordonner les Pandectes, il lui fallait le repos des champs, le murmure des oiseaux, le silence de ta solitude. C’est derrière des haies d’églantiers, dans une cabane enveloppée d’aubépines, assis à une petite table odorante de fleurs, qu’il a composé presque tous ses ouvrages. Il était né en 1454, à Monte-Pulciano, et descendait des Cinci ou Ambrogini. Quand on eut pour maître de philosophie platonicienne Marsile Ficin, de philosophie aristotélicienne Argyropulo, de grec Andronic le Thessalonicien, de latin Cristoforo-Landino, et que, comme Angelo, on naquit avec un amour ardent du travail, avec un cerveau que les plus longues veilles ne peuvent fatiguer, avec une mémoire qui retient jusqu’à des chiffres, avec une imagination qui illumine jusqu’à l’explication d’un texte, on est sûr de son avenir ; on n’a plus besoin que de marcher devant soi : le ciel et la terre vous appartiennent. A vingt-neuf ans il professait à Florence l’éloquence latine. Son cours était fréquenté par une foule d’intelligences qui se sont fait un nom dans les lettres. Pierre Ricci, Varino Favorino, Bernard Ricci, Scipion Cartéromaque, étaient ses auditeurs assidus. Jean Pic de la Mirandole vint plus d’une fois pour l’écouter. C’est des bancs de son école que sortit cette pléiade d’humanistes dont Érasme a glorifié les travaux : Guillaume Grosin, qui fut depuis professeur de grec à Oxford ; Thomas Linacre, l’ami du chancelier Morus ; Denis, le frère de Reuchlin ; les deux fils de Jean Tessira, chancelier du roi de Portugal. Pic, en rappelant le souvenir de ses triomphes de professeur, ne peut réprimer un mouvement de vanité bien pardonnable dans un rhéteur. Vraiment, écrit-il à l’un de ses amis, je ne sais pas si, depuis mille ans, maître d’éloquence latine compta pareil nombre d’écoliers. Quand pour la première fois on apercevait en chaire ce professeur, au nez difforme, à l’œil gauche louchant disgracieusement, au col mal emboîté ; c’est Paul Jove, historien contemporain, qui a tracé cette silhouette ; il était impossible de retenir un mouvement involontaire de dépit ou de surprise : mais lorsque Politien ouvrait la bouche, son organe doux et vibrant, sa parole, véritable bouquet de fleurs, varios spargens flores, et sa phrase parfumée de sel attique, salsa comitas, avaient bientôt fait oublier les torts de la nature. Il s’enthousiasmait aisément, et savait faire passer dans l’âme de ses auditeurs les émotions diverses qui l’agitaient. Il aimait à expliquer les poètes bucoliques. Trouvait-il dans l’un d’eux quelque allusion au bonheur des champs, il posait son livre et commençait une improvisation pleine d’un coloris tout champêtre. Il n’oubliait ni la voix susurrante du pin, ni le sifflement du vent qui balance l’ombelle conique du cyprès, ni le gazouillement de l’onde à travers les cailloux colorés, ni les jeux de l’écho qui redit les vers du poète. Tableau ravissant qu’il faut reproduire dans la langue de l’auteur, faute de pouvoir le traduire. Sa leçon finie, il prenait souvent par le bras son docte ami Laurent de Médicis, et tous deux s’acheminaient à pied vers Fiesole, par une fraîche soirée dont il chantait les charmes, au milieu de la route, pour se reposer. C’est à Fiesole qu’il a composé plusieurs de ses Sylves, le Rusticus, le Manto, l’Ambra, qu’il lisait le lendemain à ses élèves, et qu’on aurait prises pour quelques poèmes antiques, s’il avait songé à surprendre l’oreille par l’imitation de la phraséologie virgilienne. Vrais il faut lui rendre cette justice, qu’il ne copie ni ne calque. Il a, comme humaniste, une personnalité latine qu’on ne lui contestera jamais : peut-être même le soin trop vigilant d’écarter de sa phrase tout mot dont la source eût été facile à deviner, a-t-il jeté dans sa composition des caprices qui sentent trop l’étude. Son style, sous ce rapport, ressemble assez à sa villa de Fiesole, où, pour faire de l’effet, le jardinier du Magnifique émondait au ciseau la haie vive, travaillait en cône le hêtre, emprisonnait le ruisseau, ménageait à l’œil des repos, des surprises, des accidents : travail d’ouvrier chez le jardinier et chez le rhéteur que le souffle inspirateur de la nature vient trop rarement vivifier. Parfois cette manie d’individualité lui fait commettre des fautes étranges : c’est ainsi que dans son Orphée, tragédie lyrique, au lieu d’un chœur aux dieux d’Homère, il imagine un hymne en l’honneur de son protecteur, le cardinal Gonzague, que le héros du poème vient chanter sur la rampe en face du trou du souffleur. Gonzague était l’un des Mécènes de Politien, mais qui s’obstinait aussi dans sa personnalité, toute distincte de celle de l’ami d’Horace ; grand seigneur qui payait en monnaie de cuivre des vers qu’Auguste achetait au poids de l’or : mais nous doutons qu’Horace ait jamais consommé autant de vêtements que son rival de la renaissance. Heureusement Angelo avait une autre providence à son service, qui se laissait attendrir par les beaux vers. Les sots ! disait Politien à Laurent ; ils rient des haillons qui me couvrent le corps et des sandales trouées qui montrent mes pieds à nu. Ils me plaisantent sur ce que ma chaussure n’emprisonnant plus mes doigts laisse à l’air un plus libre cours. Mon vêtement a perdu son lustre et son duvet, la corde seule reste encore, et la maudite traîtresse atteste qu’elle est formée des fils les plus grossiers, les derniers qui restaient à la brebis tondue à ras. Ils rient, et ne font plus de cas de moi. Ils disent que mes vers ne sont point de ton goût. Laurent, envoie-moi donc une de tes belles robes. A Wittenberg, un moine, qui eût été poète s’il l’eût voulu, disait aussi à l’électeur : Ma soutane s’en va, donnez-moi donc quelques pièces de drap noir pour m’en faire une autre ; mais Sa Grâce ne se pressait guère, tandis que le Magnifique de Florence cherchait tout aussitôt dans sa garde-robe, et faisait remettre à Politien un vêtement de drap de Venise, que le poète, sans même le donner au tailleur, endossait sur-le-champ ; et le peuple de s’écrier : C’est un habit de Son Altesse : il faut que les vers d’Angelo soient bien beaux, puisque le Magnifique l’habille si richement ! Le poète avait besoin de remercier son bienfaiteur : il invoquait l’assistance de Calliope, qui descendait de l’Olympe, et, ne reconnaissant plus son favori, tant il était richement vêtu, se hâtait de regagner le ciel ; Politien se frappait inutilement le cerveau, le vers reconnaissant ne venait pas. Mais tout le monde ne regardait pas, comme cette plébécule dont parle Politien, au vêtement du poète. Sa petite maison, près de l’église Saint-Paul dont il était prieur, était chaque matin assiégée d’une foule de visiteurs qu’il n’avait pas la force d’éconduire. Il a peint d’une manière fort comique le malheur de celui qui avait un nom littéraire à cette époque. En voici un qui vient frapper à ma porte, un glaive à la main dont il ne peut lire les lettres mystérieuses ; un autre qui veut absolument une inscription pour son cabinet d’études ; un troisième qui attend une devise pour sa vaisselle ; d’autres qui me demandent des épithalames, des chansons ; c’est à peine si j’ai le temps d’écrire ! Dieu me pardonne, il faut interrompre jusqu’à la lecture de mon bréviaire. Il nous fallait donner une idée des penchants des maîtres de Jean de Médicis. Marsile Ficin représente le néoplatonisme alexandrin, mais dans des tendances catholiques ; — Pic de la Mirandole, la mystique judaïque, mais rattachée au dogme chrétien ; — Politien, la rhétorique païenne, mais assouplie an style de la renaissance. II était impossible que l’élève échappât à l’influence individuelle de ses professeurs. Il dut prendre à l’un son amour pour Platon, à l’autre ses fantaisies rêveuses d’imagination, au troisième son culte pour l’antiquité. Si donc jamais un jour Dieu l’appelle à Rome pour gouverner l’Eglise, nous sommes sûrs d’avance que nous retrouverons dans le Florentin couronné les traits les plus saillants de ces trois grandes natures. Comme Marsile, un moment il rêvera des inondes imaginaires, doués d’une force cachée personnelle ; comme Pic, il aimera la vie des champs, le grand air, l’espace ; comme Politien, il cherchera la solitude, les fleurs et le soleil : trois belles âmes dont il reflétera les vertus ; ami chaud et dévoué comme Politien, sensible comme Pic de la Mirandole, doux comme Ficin. Ce n’est pas sans motif que la Providence, si elle a des vues sur Médicis, a placé près de lui ces trois caractères de lettrés. En ce moment l’Allemagne travaille à secouer le joug de l’école. Elle s’est peu mêlée au mouvement intellectuel qui agite à cette heure l’Italie ; restée en deçà des Alpes, elle ignore ce qui se passe dans le monde ultramontain : elle croit, et c’est le sujet ordinaire de ses plaintes, que la papauté s’est donnée corps et âme à Aristote. A l’entendre s’exprimant plus tard par la voix de son lauréat Ulrich de Hutten, le syllogisme, qui a tué l’imagination, qui pèse comme du plomb sur la pensée, qui arrête l’essor de l’esprit humain, et qu’un de ses plus glorieux enfants comparera bientôt à la monture d’Abraham, qu’il faut attacher au bas de la montagne quand on veut sacrifier sur les hauts lieux, c’est-à-dire pénétrer dans l’œuvre de Dieu ; le syllogisme règne en maître dans les écoles d’Italie. Ces plaintes, dont elle n’a pu vérifier la justesse, car elle ne s’est pas mise à voyager, ont soulevé contre la papauté de graves intelligences. Dieu s’apprête à leur donner un démenti. Architecture, peinture, poésie, éloquence, musique, sous Léon X, tout s’avivera à la nature visible : l’antiquité, dans ses créations matérielles, sera le moule à l’aide duquel tout ce qui se sentira âme d’artiste voudra reproduire ses émotions. L’idée pourra souffrir de ce culte trop exclusif pour le symbole, niais la plastique y gagnera : et, pour s’en convaincre, il suffit de jeter un regard sur quelques-unes des peintures Frate Angelico, si ravissantes d’expression, mais où la vie se réfugie tout entière dans la tête ; et sur les reliefs d’Orcagna, où l’on dirait qu’il n’y a dans l’être humain qu’un élément, au lieu de cette double individualité, l’âme et le corps, que Dieu lui donna en le créant. Supposez à la place de Léon X un homme doué d’ailleurs d’éminentes vertus, niais de race germanique, comme Adrien d’Utrecht, qui, à tous ces artistes accourus pour le fêter lors de son entrée à Rome, eût préféré, ainsi qu’il le disait, un cortège de paralytiques ; alors notre petite lampe de Ficin serait morte faute d’aliment, et Platon aurait traversé les mers pour retourner en Orient, et les grandes vues de Dieu sur les destinées du monde intellectuel n’auraient pu s’accomplir ; et une portion notable de l’humanité, l’Allemagne, qui aspirait de tous les élans de sa nature vers les mondes rêvés par le fils d’Ariston, aurait pu se plaindre avec raison que Rome, loin de la suivre, voulait l’arrêter dans cette voie de rédemption spirituelle. N’accusons pas toutefois Adrien VI : avec le temps les besoins de la société changent ; l’art une fois retrouvé, il fallait un homme du Nord qui l’arrêtât sur le penchant de ce naturalisme où il menaçait de se précipiter. |
 Marsile Ficin naquit à Florence en 1433, et dans ce siècle
Marsile Ficin naquit à Florence en 1433, et dans ce siècle
 Son père, seigneur de la Mirandole, voulut qu’il étudiât à
Bologne. Le droit canon, qu’on enseignait à tette université, ne pouvait
plaire à une imagination comme la sienne. Pic aimait par-dessus tout l’air et
la liberté. II ferma ses livres et courut le monde. Comme Luther, quelques
années plus tard, il cheminait à pied, sans autre boussole le jour que
l’horizon, et la nuit que les étoiles, le havresac sur le dos, le bâton de
pèlerin à la main. Mais, tandis que le fils du mineur de Mœhra s’arrêtait au
bas de chaque fenêtre pour demander le pain du bon Dieu, le fils de
Gianfrancesco, la bourse pleine, le cœur joyeux, sûr de la Providence et de
son chemin, errait à l’aventure, se mêlant à ces processions d’écoliers dont
les routes universitaires étaient embarrassées, couchant sous la tente de
toile du bohémien qui faisait métier de dire l’avenir, ou enfourchant le
cheval qu’un reître lui avait vendu pour vivre. Partout il dépensait
follement son argent, ruinait sa santé, compromettait son existence au milieu
de cette société mouvante de verriers, de forgerons, de sorciers, de
bourreaux, de fossoyeurs, de magistrats, de prêtres, de jeunes filles, dont
il étudiait les mœurs, les habitudes, les superstitions, donnant la moitié de
son or pour quelques pages de la grammaire d’un idiome qu’il apprenait chemin
faisant, et qu’il parlait au bout de quelques mois. Cette vie de périls, de
sensations, d’exaltation, de mouvements matériels et spiritualistes,
convenait à cet adolescent amoureux fou de ce fantôme nuageux et
insaisissable qu’on appelle, dans la langue de la physique, feu follet, et
gloire dans celle de l’artiste. Marche, pauvre jeune homme, puisque marcher
est ton châtiment ; mais, quand il en sera temps, Dieu saura bien t’arrêter !
Son père, seigneur de la Mirandole, voulut qu’il étudiât à
Bologne. Le droit canon, qu’on enseignait à tette université, ne pouvait
plaire à une imagination comme la sienne. Pic aimait par-dessus tout l’air et
la liberté. II ferma ses livres et courut le monde. Comme Luther, quelques
années plus tard, il cheminait à pied, sans autre boussole le jour que
l’horizon, et la nuit que les étoiles, le havresac sur le dos, le bâton de
pèlerin à la main. Mais, tandis que le fils du mineur de Mœhra s’arrêtait au
bas de chaque fenêtre pour demander le pain du bon Dieu, le fils de
Gianfrancesco, la bourse pleine, le cœur joyeux, sûr de la Providence et de
son chemin, errait à l’aventure, se mêlant à ces processions d’écoliers dont
les routes universitaires étaient embarrassées, couchant sous la tente de
toile du bohémien qui faisait métier de dire l’avenir, ou enfourchant le
cheval qu’un reître lui avait vendu pour vivre. Partout il dépensait
follement son argent, ruinait sa santé, compromettait son existence au milieu
de cette société mouvante de verriers, de forgerons, de sorciers, de
bourreaux, de fossoyeurs, de magistrats, de prêtres, de jeunes filles, dont
il étudiait les mœurs, les habitudes, les superstitions, donnant la moitié de
son or pour quelques pages de la grammaire d’un idiome qu’il apprenait chemin
faisant, et qu’il parlait au bout de quelques mois. Cette vie de périls, de
sensations, d’exaltation, de mouvements matériels et spiritualistes,
convenait à cet adolescent amoureux fou de ce fantôme nuageux et
insaisissable qu’on appelle, dans la langue de la physique, feu follet, et
gloire dans celle de l’artiste. Marche, pauvre jeune homme, puisque marcher
est ton châtiment ; mais, quand il en sera temps, Dieu saura bien t’arrêter ! Viens ici, mon cher Ficin, si la
chaleur de Careggi te fatigue ; accepte l’hospitalité que je t’offre : doux
ombrages, bonne chère et vin parfumé, voilà ce que tu trouveras à Fiesole. En
fait de vin, tu sais que je suis quelque peu connaisseur : Pic lui-même, avec
toute sa science de gourmet, ne m’apprendrait pas grand’chose
Viens ici, mon cher Ficin, si la
chaleur de Careggi te fatigue ; accepte l’hospitalité que je t’offre : doux
ombrages, bonne chère et vin parfumé, voilà ce que tu trouveras à Fiesole. En
fait de vin, tu sais que je suis quelque peu connaisseur : Pic lui-même, avec
toute sa science de gourmet, ne m’apprendrait pas grand’chose