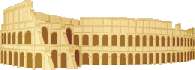L’HISTOIRE ROMAINE À ROME
INTRODUCTION.
|
On récrira toujours l’histoire ; car l’idéal historique, pas plus que l’idéal de l’art ou de la poésie, ne sera jamais complètement réalisé. Il semble qu’il ne devrait pas en être ainsi, il semble que les faits étant connus, on pourrait écrire, une fois pour toutes, une histoire définitive. Mais les faits ne sont pas l’histoire, ils n’en sont que l’enveloppe, comme le marbre de la statue ; de même que le sculpteur doit dégager la statue du marbre qui l’enveloppe, l’historien doit faire sortir des faits la forme et la vie. Qui connaîtrait toutes les causes des événements. qui pénétrerait dans le caractère des hommes et dans l’esprit des temps, qui pourrait découvrir l’enchaînement de ces causes, ranimer les hommes, faire revivre les temps, celui-là serait en état d’écrire une histoire définitive ; mais celui-là ne serait pas un homme, car il aurait une clairvoyance et un pouvoir de résurrection sans limites, il serait dieu. La clairvoyance des hommes est bornée et leur pouvoir de résurrection a des limites. Il en résulte que nul ne comprend un temps et ne le revivifie tout entier ; chacun pénètre par un côté dans le passé ; chacun apporte sa lumière dans cet abîme qui aura toujours ses ténèbres, et concourt à cette reconstruction des siècles que nul n’achèvera. Je crois avoir aperçu sous un jour nouveau l’histoire du
peuple romain, en la contemplant du sein de Rome même. Sur ce sol mémorable où j’ai vécu, j’ai demandé une intelligence plus nette et plus vive de la vie du peuple romain à la topographie, aux monuments, au spectacle du présent lui-même, qui à Rome contient des débris et comme des ruines du passé. La disposition et la physionomie des lieux ne sont pas sans intérêt pour l’histoire. Les événements observés sur place sont mieux déterminés et plu, vivants. Leur souvenir acquiert une précision et une réalité qui les rend présents et comme visibles ; si un récit fait dans ces conditions ne gagne pas lui-même en précision et en réalité, ce sera la faute de l’historien. Comme en visitant une contrée on arrive ù un sentiment plus intime et plus vrai, même des faits que les livres pourraient enseigner, ainsi on atteint mieux à un passé dont on touche les restes, et ce que j’appellerai la présence réelle aida à le recomposer. Pour moi, j’avoue que je n’avais jamais eu une vue claire des scènes du Forum avant d’avoir déterminé exactement la disposition respective du Comitium, où se réunissaient les patriciens ; du Forum proprement dit, réservé aux tribus plébéiennes ; de la curie, lieu des assemblées du sénat, dominant le Comitium ; de la tribune, placée entre le Comitium et le Forum. Cette disposition bien comprise, l’histoire de ces débats orageux des deux ordres qui fut toute l’histoire intérieure de Rome au temps de sa liberté ai)-parait comme un drame animé dont pas un détail n’échappe au spectateur, dont son âme partage toutes les agitations et suit toutes les vicissitudes. Le jeu même des institutions politiques de Home est mieux
compris quand on sait où se tenaient les diverses assemblées ; la distinction
des comices par curies, par centuries, par tribus est. mieux saisie par l’esprit,
quand on va du Comitium au champ de Mars et qu’on revient au Forum. Et puis,
la vivacité de l’impression, si elle est juste, ne fait-elle pas partie de sa
vérité ? Le but de l’histoire est de nous transpor-1u r au sein des faits qu’elle
raconte ; en les étudiant là où ils s’accomplirent, nous sommes plus complètement
transportés au milieu d’eux. Ils prennent alors une évidence singulière ; on
voit ce qu’on lit. Est-ce donc la même chose de lire le récit de la monde Servius
Tullius, de la mort de Virginie, du dévouement des Fabius, ou de se dire : c’est
ici que, suivant la tradition, Tullie fit passer son char sur le cadavre de
son père ; c’est de ce côté du Forum, près des boutiques qui étaient là, que
Virginius frappa sa fille ; voila le chemin que prirent les Fabius pour aller
à la porte Carmentale. A qui pourrait-il être indifférent de reconnaître l’endroit
par où les Gaulois furent au moment de surprendre le Capitole, de savoir où
était le champ de Cincinnatus, où tombèrent les Gracques, où César fut frappé
? N’est-ce pas faire revivre pour soi ces événements célèbres, que de suivre
le char de Tullie, les pas de Virginius, le chemin des Fabius, l’ascension
nocturne des Gaulois, de visiter Cincinnatus dans son champ, d’accompagner
Gracchus dans sa fuite, d’escorter César, allant de Ce n’est pas tout. L’imagination, excitée par le spectacle des lieux, anime l’intelligence ; ce que l’on voit aide à découvrir ce qu’on ne voit pas, et d’un sol longtemps contemplé avec l’émotion et la curiosité qu’il inspire, sortent des enseignements inattendus. Ces enseignements peuvent être d’une nature très positive : l’état des lieux, surtout leur état ancien, explique souvent les faits dont ils ont été le théâtre. Quand il est conforme aux traditions qui s’y rattachent, il établit sinon la vérité, l’antiquité ale ces traditions, il prouve du moins qu’elles sont indigènes et n’ont pas été imaginées après coup. Des résultats importants peuvent naître de l’étude attentive des localités historiques ; le rôle considérable qu’ont joué les Sabins et le faible rôle qu’ont joué les Romains dans la formation de la société romaine m’ont été révélés d’abord par la petitesse du Palatin. On peut, sur une carte, se former une idée très juste de l’extension respective des collines dé Home ; mais elle frappe tout autrement quand, durant des années, on a contemplé et parcouru cris collines ; ce qui le prouve, c’est que jusqu’ici elle n’ait jamais frappé personne, et que des conséquences, pour moi évidentes, de ces données topographiques, n’en avaient pas été tirées. Les monuments aussi, soit encore présents par leurs ruines, soit dont l’emplacement seul est connu, offrent à l’histoire des éclaircissements que rien ne saurait remplacer ; ils parlent aux yeux ou à l’imagination, ils disent ce qui n’est aussi bien dit nulle part. Un pan de mur à demi écroulé qui se tient par la force du ciment, un bout de voie rencontré dans la campagne déserte, une liane d’aqueduc qui l’a traverse à l’horizon, un tronçon de statue, un fragment de bas-relief où respirent la simplicité ut la fermeté, en apprennent plus que bien des phrases sur la puissance et l’énergie du peuple romain. Ces débris de constructions, ces tronçons de statues, repartent immédiatement la pensée vers le siècle dont elles expriment le génie particulier, et donnent une intuition rapide et sûre de ce génie ! L’architecture est, comme les inscriptions et le
médailles, un témoin contemporain, qui dépose de ce qu’il a vu, et qui
souvent donne un démenti sans réplique aux conclusions présentées par les
avocats de tel ou. tel système, dans ce débat sur le passé, toujours pendant
au tribunal de la postérité. On peut nier l’existence de Romulus dans une
université d’Allemagne ; c’est plus difficile quand on voit de ses yeux un
mur qui n’a pu être que le mur de la petite Rome du palatin. On peut contester
de loin au peuple étrusque l’influence sur la civilisation romaine que les
anciens lui attribuent ; mais on est ramené à les croire en voyant de ses
yeux combien l’architecture étrusque ressemble à celle de l’époque des rois ;
en retrouvant dans celle-ci l’appareil des murs qu’on a observés à Fiésole ou
à Volterra, et dans l’indestructible voûte de l’égout de Tarquin, la voûte
étrusque. On est plus frappé aussi de la proximité de cette civilisation
antérieure, quand tous les jours, en passant le Tibre, on va dans l’antique
Étrurie. Comment douter de l’agrandissement de Rome sous les rois étrusques, lorsqu’on
mesure la différence de la bourgade de Romulus, bornée au Palatin et de la
ville des Tarquins qui embrasse huit collines ? Comment ne pas sentir
fortement la différence de la république et de l’empire en comparant la
simplicité, la sévérité ales petits temples de la première avec la splendeur
des édifices gigantesques du second. Les matériaux même des constructions
font apparaître soudain le caractère de l’âge qu’ils indiquent. Le rude
Pépérin reporte à l’époque des rois et de la république ; en présence des
marbres de Outre l’esprit général d’un temps qu’elle fait connaître, l’histoire des monuments se rattache souvent à un événement particulier ou à un ensemble d’événements dont elle dessine la physionomie et précise le sens. Les trois enceintes de Rome correspondent à trois moments de sa destinée : à son berceau, à sa première grandeur et à sa ruine. L’absence de murailles au temps où la domination de Rome semble assurée est un signe de sa puissance et de sa sécurité. Celles qu’élève Aurélien annoncent que l’heure de la sécurité est passée et que Rome commence à se sentir menacée par les barbares. Un reste de l’égout de Tarquin subsiste pour attester la grandeur de son règne et les durs travaux imposés à la multitude qui amenèrent sa chute ; pour marquer la fin di, la tyrannie et le commencement de la liberté. Sous la république, chaque temple rappelle une victoire à l’occasion de laquelle il a été voué et inauguré ; la création ou la. continuation des routes, qui partent de Rome et vont de tous côtés, marquent la direction et le progrès de la conquête. L’histoire de la tribune est toute l’histoire de la liberté romaine ; d’abord voisine du Comitium patricien vers lequel les orateurs, même en parlant au forum plébéien, se tournaient toujours jusqu’à Caïus Gracchus, elle fut transportée dans le bas forum par César, qui voulait en toute chose séparer Rome de son passé, et réduire la démocratie à elle-même pour en avoir meilleur marché. César mourut, mais, avant de mourir, il avait tué la liberté ; la tribune devait en suivre le sort, et comme elle expirer sur les marches du temple de César, symbole du despotisme divinisé. Les lieux et les monuments peuvent donc raviver en nous le sentiment historique en l’éclairant ; ils sont donc tout ensemble la poésie et le commentaire de l’histoire. Mais pour pouvoir en faire usage, il fallait les bien
connaître et savoir où les trouver ; pour suivre d’un pas assuré l’histoire
sur son terrain, il fallait que ce terrain fut solide ; pour l’éclaircir par
les monuments, il fallait que la place de ces monuments fut fixée d’une
manière certaine. Ici, avant d’arriver à mon sujet, j’ai rencontré sur ma
route un travail préparatoire qui présentait de grandes difficultés ; car les
dénominations des monuments leur ont été données longtemps au hasard, et souvent
contre le témoignage exprès des auteurs qui en parlent. Comme ils disent que
le temple de Jupiter Tonnant était sur le Capitole, on le plaçait au pied du
Capitole ; comme ils nous apprennent que le temple de Vesta était voisin de l’extrémité
du Forum con le reconnaissait dans un édifice très éloigné du Forum ; comme
nous savons que l’on déterminait l’heure de midi en regardant le soleil du
haut des marches de Je suis parvenu, grâce à ce travail, à m’orienter dans Outre les lieux et les édifices publics ou privés dont la position est connue, on trouve à Rome d’autres monuments qui nous rendent une autre portion de la vie antique : ce sont les statues qui remplissent les musées, les galeries, les villas. Elles nous offrent tous les types des personnages divins, et nous pouvons, grâce à eux, replacer dans chaque temple l’image de la divinité à laquelle il était consacré. Là, nous rencontrons aussi l’élite de la population romaine, les personnages les plus illustres sont représentés par leurs statues ou leur bustes ; tous ces portraits des hommes et des femmes célèbres de Rome, en nous offrant la reproduction de leurs traits, nous donnent comme un équivalent de leurs personnes. Si nous avons besoin d’eux, ils viennent passer devant nous et introduire sur la scène du drame les acteurs. Au bout d’un certain nombre de visites dans les collections, loin sont devenus des connaissances ; on s’accoutume à vivre familièrement au milieu d’eux, et par la pensée on les replace dans leur maison, comme les dieux dans leurs temples. A force de les voir, et revoir, on se pénètre de leur caractère que leur physionomie révèle presque toujours et, que leur fréquentation habituelle l’ait connaître à l’historien presque aussi bien que celui de ses contemporains. A force de les regarder, on finit par lire leur âme dans leurs traits. Les œuvres de la sculpture rassemblées à, Rome en plus grand nombre que partout ailleurs, complètent encore autrement la notion de son histoire, dont l’histoire de l’art fait partie. En effet, on retrouve à Rome toutes les phases de l’art romain. On peut le dire de l’architecture, puisqu’on y voit des monuments du temps des rois, du temps de la république et du temps de l’empire. On peut le dire aussi de la sculpture. Toutes les époques
de la sculpture romaine, qui fut d’abord étrusque, puis grecque, y sont
représentées. On peut y suivre son origine, ses progrès, sa décadence, depuis
On peut aussi, sans sortir de Rome, se faire une idée des
principaux types de l’art grec et des plus célèbres ouvrages de Phidias, de
Polyclète, de Myron, de Praxitèle, de Lysippe, dont on y rencontre des copies
qui souvent sont elles-mêmes des chef-d’œuvres. Cela est encore un retour
vers Les villas modernes sont elles-mêmes une reproduction assez fidèle des villas de l’antiquité. Souvent elles sont situées au même endroit, comme à Rome la villa des Médicis, qui a succédé aux jardins de Lucullus ; la villa Massimi, aux jardins de Salluste, et la villa Pamphili, à ceux de Galba ; comme à Frascati, les villas charmantes semées sur les pentes de Tusculum, ainsi qu’au temps de Cicéron. Depuis ce temps jusqu’à nos jours, les villas n’ont pas beaucoup changé. C’est le même mélange de statues, d’eaux et de verdure ; ce sont encore les arbres taillés en murailles vertes. Se promener dans une villa de Rome, c’est se promener dans l’antiquité. Enfin, la portion vivante de Rome représente aussi à sa
manière cette antiquité qu’on y trouve partout. Les temps et les
gouvernements l’ont changée à bien des égards, mais le type physique est
resté. Tout le monde a reconnu ici dans les rues le profil des consuls
romains et des impératrices romaines. Dans les montagnes voisines, la
ressemblance est plus frappante encore, et là surtout il s’y joint celle de
telle ou telle partie du vêtement ou de la chaussure, de tel usage, de tel
jeu de telle dévotion même. Je n’ai jamais négligé d’indiquer ces piquantes
analogies, qui sont des réminiscences. Je n’ai point voulu par là confondre
le paganisme avec le christianisme, ni les rapprocher ; mais montrer ce qui
appartenait à mon sujet l’antique paganisme romain vivant encore en partie
dans Armé de ce triple flambeau, guidé par l’étude des lieux, des monuments et des mœurs, je me suis enfoncé dans les ténèbres de l’antiquité romaine. J’ai même osé remonter au delà de Romulus, et tenté de faire l’histoire du sol romain avant Rome. Je crois être, parvenu non seulement à retrouver les
traces des établissements antérieurs à celui de Romulus, mais à reconnaître l’étendue,
à déterminer la place, à faire pour ainsi dire la carte topographique de ces
établissements que fondèrent des Latins sur le Capitole, des Sicules sur le Palatin,
des Ligures sur l’Esquilin, des Pélasges et des Sabins Aborigènes sur les
huit collines qui devaient composer Et, parmi les monuments dont il reste des ruines, j’en ai trouvé qui, par leur première origine, bien éloignée de leur construction dernière, se rapportent à ce passé antéromain. Les huit colonnes du temple de Saturne marquent la place où s’éleva l’autel de Saturne à l’époque du règne de ce dieu, c’est-à-dire à l’époque où la vie sédentaire du cultivateur remplaça dans le Latium la vie errante du chasseur. Les trois colonnes du temple de Castor et Pollux se dressent dans un lieu consacré très anciennement par le culte des Dioscures. Ce culte, aussi bien que celui de Pan, auquel fut voué primitivement l’antre Lupercal, de Déméter, de Vesta, de Vulcain, dont les sanctuaires furent remplacés depuis par les temples de Cérès et de. Vesta, par l’autel du Vulcanal, ce culte faisait partie de la religion de ces mystérieux Pélasges qui apparaissent dans un age antérieur à la civilisation hellénique en Grèce et en Asie, qui n’ont laissé en. Italie qu’une grande mémoire, des murs gigantesques, et quelques noms de lieux, entre autres celui de Roma. Les environs du Palatin, où ont été ces sanctuaires,
formaient le centre religieux de Ainsi, à Rome, chaque colline a son histoire avant que l’histoire romaine ait commencé. Cette résurrection de Je ne pouvais retrancher d’une histoire romaine à Rome cette préface, dans laquelle la considération des lieux joue un si grand rôle. Peut-être i trouvera-t-on quelque attrait de découverte dans ces régions lointaines du passé sur lesquelles la tradition poétique a jeté son charme, et qui, par un usage, par un trait de mœurs qui subsistent, par une superstition encore vivante, viennent toucher au présent. Ceux qui, marré mes efforts pour donner à un tel sujet l’intérêt de curiosité et d’imagination qu’il avait pour moi, s’effrayeraient de l’aborder, peuvent sauter par-dessus ces curieuses origines de Rome et ne commencer qu’à Romulus. L’histoire des rois est aussi une histoire toute locale. La formation même de la société romaine et l’organisation politique du peuple romain se rattachent aux destinées des diverses collines. Romulus, et par conséquent les Romains, ne possèdent que le Palatin ; les Sabins règnent sur tout le reste. De là l’inégalité nécessaire et réelle, bien que méconnue, de la race latine et de la race sabine ; de là trois rois sabins après Romulus ; de là la part beaucoup plus considérable qu’on ne l’a cru jusqu’ici des Sabins dans la religion, la constitution, la population même de Rome. A Rome, presque tous les grands cultes sont sabins ; le patriciat, impossible parmi les bandits du Palatin, est sabin ; la plupart des grandes familles sont sabines. Parmi tous les hommes célèbres de la république, un seul peut-être est d’extraction latine, César. Le Palatin, la seule colline originairement romaine de home et une des plus petites, est flanqué de deux collines beaucoup plus étendues, le Cælius et l’Aventin. Ces deux collines ne lardent pas à devenir latines comme lui, après que Tullus Hostilius a transporté sur le Cælius les Albains, parmi lesquels sont les Jules, et qu’Ancus Martius a établi sur l’Aventin les populations de plusieurs villes du Latium. Ces populations vaincues, et pour cette raison ne jouissant pas de l’égalité politique, sont les plébéiens primitifs, comme l’a vu Niebuhr : le Cælius et l’Aventin sont leur berceau. Les Romains, qui ont été refoulés sur le Palatin, mais qui n’ont pas été vaincus ; les Romains, jusque-là dépendants des Sabins, s’appuient désormais sur des populations latines comme eux et auxquelles ils donnent leur nom. Le Palatin s’appuie sur ses deux voisins, le Cælius et l’Aventin. En regard des cinq collines sabines : le Quirinal et le Capitole, unis alors par une langue de terre qui n’a disparu qu’au temps de Trajan, le Viminal, qui est peu de chose, l’Esquilin et le Janicule, sont trois collines latines : le Palatin, le Cælius et l’Aventin, ces deux dernières, l’Aventin surtout, fort considérables. Ces trois collines sont plébéiennes, puisqu’elles sont latines. Le Palatin, pour la raison que je viens de dire, bien que la plus petite, est la principale des trois. Mais voilà qu’aux rois sabins succèdent des rois étrusques. Le nouveau Capitole étrusque détrône le vieux Capitole sabin du Quirinal. Que feront les rois étrusques ? Ils feront ce qu’ont, fait les anciens rois de France quand ils émancipaient les communes pour résister aux seigneurs, ce qu’ont fait les barons d’Angleterre quand ils se mirent à la tête des communes pour lutter contre les rois. Ils chercheront, contre ce qui est fort et qu’ils craignent, un appui dans ce qui est faible et qu’ils né craignent point. Ils chercheront un appui dans la plebs latine contre l’aristocratie sabine. Le Capitole étrusque fraternisera avec le Palatin romain, la royauté étrusque avec les plébéiens de l’Aventin et du Cælius. Sous le premier Tarquin, les tentatives de fusion entre les deux races échoueront en partie contre les résistances sabines. Mais le second roi étrusque, Mastarna, ce condottiere qui a porté le nom de Servius Tullius, accomplira cette fusion par la substitution des tribus locales aux tribus nationales, par sa constitution à la grecque, fondée sur le principe du cens, dans laquelle les distinctions de race et de naissance sont effacées, et l’unique mesure des droits politiques est la propriété. Chose bien remarquable, le même roi qui fonde l’unité politique de Rome crée son unité matérielle en renfermant les huit collines dans une seule enceinte. Tarquin le Superbe voudra détruire l’œuvre de Servius, et il périra. Tel est le rôle politique de la royauté étrusque. C’est aussi un rôle civilisateur. Les Étrusques étaient beaucoup plus civilisés que les Sabins et les Latins. On le voit par les grands monuments qu’ils élevèrent : le
temple de Jupiter et le cirque. lis entourent le Forum de portiques,
construisent ce vaste système d’égouts dont il subsiste un si imposant
débris, l’extrémité de Tarquin le Superbe décime l’aristocratie sabine et écrase les plébéiens latins de travaux intolérables. Patriciens et plébéiens, Sabins et Latins, s’unissent contre lui. Sa chute, opérée en commun, scelle l’union et consomme la fusion des deux races. Tels sont, brièvement indiqués, les résultats auxquels m’a conduit l’étude des faits, contrôlée par l’observation des lieux. Je dois dire : que ce contrôle a été favorable à la vérité de l’histoire primitive de Rome. Pour moi, cette histoire, qu’aujourd’hui quelques-uns rejettent absolument, bien que remplie d’inexactitudes et de lacunes, est vraie dans son ensemble. Il n’a pas fallu un grand effort d’esprit pour s’apercevoir que beaucoup de choses dans cette histoire étaient impossibles et absurdes ; on n’avait pas attendu pour cela Niebuhr, dont la gloire n’est point., comme on le dit souvent, d’avoir rejeté ce que d’autres avaient rejeté avant lui : sa gloire est d’avoir cherché, avec l’admirable sagacité dont il était doué, à reconstituer l’organisation politique de Rome à cette époque dont il semblait parfois ne vouloir rien connaître, tentative dans laquelle il a échoué souvent et quelquefois a merveilleusement réussi. Mais ne pas tout croire, est-ce une raison de tout nier. Qui donne le droit de repousser les témoignages que nous a transmis l’antiquité et auxquels l’antiquité a ajouté foi ? Pourquoi tout serait-il faux dans les origines de Rome, même dans ce que nous apprennent sur les populations qui ont précédé Romulus, les traditions recueillies par Caton, Varron, Verrius Flaccus, pourvu que nous apportions dans la discussion une critique prudente qui, j’en conviens, leur a souvent manqué ? Quel intérêt avaient-ils à faire figurer dans les antécédents de Rome des peuples obscurs comme les Sicules, les Ligures, les Aborigènes, des peuples, de leur temps, étrangers à l’Italie comme les Pélasges, s’il ne leur était arrivé, par des voies que nous ignorons, quelque débris plus ou moins altéré de vieux souvenirs ? Ces témoignages ont pris pour moi une grande valeur quand je les ai trouvés conformes à l’état ancien des lieux, rappelé lui-même par d’antiques solennités religieuses, comme la fête du Septimontium, rapportée à sept collines qui ne sont pas les sept ou plutôt les huit collines de l’histoire ; comme les sacrifices dans les chapelles des Argéens, attachés à des sommets depuis lors abaissés ou disparus. Des monuments même restent de cet âge primordial. La venue
des Pélasges est confirmée par les murs pélasgiques découverts en Italie et.
tout près de Rome, confirmation d’autant plus frappante, que les auteurs qui
racontent les migrations des Pélasges n’ont pas connu ou n’ont pas remarqué l’existence
de ces murs et leur ressemblance avec ceux de l’Asie et de Je dirai la même chose de tout ce qui, dans l’histoire de Romulus, n’appartient pas au merveilleux. Pourquoi les Romains auraient-ils imaginé pour leur ville une origine, si vraisemblable du reste, mais si peu glorieuse, en supposant qu’elle avait été d’abord un asile de brigands et de réfugiés ! Quand on se fabrique une généalogie, ce n’est pas ainsi qu’on procède, et je crois aux parchemins des familles féodales dont les aïeux ont détroussé pur la grande route ou ont été pendus. Ici encore la tradition est confirmée par un aspect des lieux qui n’existait plus à l’époque où on l’aurait inventée, et qui lui donne une date plus ancienne et une certaine authenticité. A cette époque, la vallée entre le Palatin et le Quirinal avait été desséchée par les Tarquins ; les eaux ne venaient plus noyer le pied du Palatin ; on n’eût pas fait apporter par les eaux les enfants exposés, jusqu’à l’antre Lupercal. Ce que la tradition nous apprend de la demeure des différents rois, et que la postérité n’avait nul intérêt à supposer gratuitement, me paraît devoir être pris en considération ; car toutes ces demeures sont dans un rapport très frappant avec le rôle attribué à ces rois, avec leur provenance réelle, même quand cette provenance, que l’induction découvre, n’a pas été connue de l’antiquité. Enfin presque tout dans la tradition primitive de Rome a un caractère indigène. C’est évidemment une tradition native qui appartient à la race, parce qu’elle tient au sol. N’y voir, comme l’a fait par exemple M. Schlegel, que des fables grecques importées, c’est en méconnaître la nature. Je croirai cela quand je croirai qu’on a apporté l’Illissus à Rome et qu’il s’est appelé le Tibre. Le grand argument que font valoir ceux qui m’admettent rien de l’histoire de Rome sous les rois, c’est qu’il n’y avait pas d’historiens à cette époque. Cela est certain, et Beaufort ne les a pas attendus pour établir que, jusqu’à la seconde guerre punique, Rome n’a point eu d’historiens véritables. S’ensuit-il donc qu’on ne sache absolument rien de l’histoire romaine avant Annibal ? C’est le cas de dire que qui veut trop prouver ne prouve rien ; car, si la conclusion qu’on lire de l’absence incontestable d’historiens proprement dits à Borne avant le sixième siècle est rigoureuse, ce n’est pas seulement l’époque des rois qu’il faut supprimer, mais trois siècles à peu près de la république. 11 faut nier Brutus, dont la statue était au Capitole, et
dont le buste, qui paraît si ressemblant, y est encore ; Coriolan, quand le
temple de Le bon sens se révolte contre cette radiation téméraire de cinq siècles de l’histoire romaine admis par les Romains, et, dans leur ensemble, par les plus savants hommes et les plus grands génies des temps modernes ; il se révolte surtout quand on lit ces choses non dans le cabinet d’un savant allemand ou d’un homme d’État d’Angleterre, si distingués qu’ils soient, mais à Rome, en présence des lieux dont la configuration ancienne est toujours parfaitement d’accord avec le récit des historiens ; en présence des monuments dont les débris sont également d’accord avec ces récits, récits qui peuvent être aussi incomplets ? mais ne sont pas plus imaginaires que les ruines, et que la crédulité des âges n’a pas davantage construits. C’est que l’histoire n’est pas seulement dans les historiens ; c’est que si, avant le sixième siècle, Rome n’a pas eu d’histoire proprement dite, elle a eu la tradition orale, les documents publics et privés ; elle a eu des récits traditionnels et des chants historiques, les traités et les actes publics, les annales des pontifes, les éloges des morts et les mémoires des familles. L’histoire n’existait pas, mais on possédait les sources de l’histoire. La tradition orale mérité une certaine confiance ; si en
se transmettant elle s’altère, elle conserve souvent avec une ténacité
incroyable des portions de vérité : trop facilement admise au dix-septième
siècle et trop légèrement rejetée au dix-huitième, elle est pour l’impartialité
du dix-neuvième l’objet, non d’une crédulité aveugle, mais d’une critique
sérieuse. Cette critique distingue avec soin la tradition naïve, sincère,
instructive par là même dans ses involontaires erreurs, et la fiction lui
invente ou falsifie sciemment. La tradition orale a, sous son nom germanique
de Saga (ce qu’on dit), pris dans ce siècle une
importance véritable ; elle est venue se placer entre les chants populaires,
qui sont On peut dire des chants primitifs ce que j’ai dit. du
récit traditionnel. Ils contiennent toujours une portion de vérité, quoique
peut-être moins grande, car l’imagination y a plus de, part. Mais dans ces
chants-là l’imagination n’invente pas l’ensemble des faits comme il arrive
dans les poésies artificielles des âges avancés. Le poète raconte ce qu’il a
vu ou entendu à des contemporains qui le savent comme lui et ne goûteraient
point une pure fiction. Il chante pour tous, et il est la voix de tous ; la
muse primitive est fille de Mnémosyne, De tels chants ont existé à Rome, Caton nous l’atteste.
Ils n’ont jamais été rassemblés en un corps d’épopée, ils sont toujours
restés détachés comme les ballades héroïques de Les familles avaient aussi leurs traditions particulières, qu’elles conservaient avec soin, aussi bien que leurs arbres généalogiques, les images de leurs ancêtres et les inscriptions qui les accompagnaient. Ces traditions se perpétuaient par les oraisons funèbres dans lesquelles les familles célébraient la gloire des défunts illustres, comme le montre l’exemple de César, qui, prononçant l’éloge de sa tante Marcia, avait soin de rappeler qu’elle descendait du roi Ancus et que les Jules venaient en droite ligne de Vénus. On voit que tout n’était pas authentique dans ces généalogies, et Cicéron remarque que la vanité des familles a beaucoup corrompu l’histoire. Cela ne prouve point que les éloges funèbres ne l’aient pas servie. Bien que Bossuet ait trop célébré les vertus de la princesse palatine, ses oraisons funèbres seraient des documents précieux à défaut d’une histoire du siècle de Louis XIV, et l’éloge du grand Condé ne renseignerait pas trop mal sur Rocroy. La vanité des familles romaines a dû aussi falsifier quelques détails des événements racontés dans leurs Mémoires. Mais la falsification de faits très connus ne pouvait être bien grande et n’empêche pas que les Mémoires aient dû contenir beaucoup de ces traits caractéristiques d’un homme et d’un temps, qui ont permis aux anciens annalistes et par suite à Tite Live, à Denys d’Halicarnasse, à Plutarque, venus après eux, de peindre les personnages et de retracer les faits historiques avec cette vivacité, et, si je puis dire ainsi, cette individualité qui à elle seule éloigne l’idée d’une histoire imaginaire, car l’imagination livrée à elle-même est toujours vague et abstraite, la réalité seule est précise et vivante. Comme l’a si bien dit Boileau : Le
faux est toujours fade, ennuyeux, languissant, Mais
la nature est vraie et d’abord on la sent. La fausseté partielle des récits conservés dans les familles n’ôte donc point à ces récits, pris en masse, leur valeur historique. Les jugements quelquefois follement injustes de Saint-Simon n’altèrent pas la véracité générale de ses mémoires. On a fait une thèse pour relever les inexactitudes de César dans ses Commentaires : quand la thèse aurait raison sur tous les points, il ne faudrait pas pour cela brûler les Commentaires, et on aurait toujours beaucoup à y apprendre. Enfin il y eut, dès l’origine, à Rome, sinon une histoire officielle, du moins des annales officielles rédigées par le grand prêtre, où furent consignés tous les événements qui, par un côté ou un autre, tenaient à la religion, — et à Rome presque tout tenait à la religion : — l’érection des temples, l’introduction des nouveaux cultes, les prodiges, qui étaient souvent des événements naturels, comme un hiver rigoureux, une maladie contagieuse, une famine, enfin des faits dans lesquels nous ne verrions rien de religieux : la cherté du blé. D’autres recueils officiels[3] contenaient la suite des magistratures et par là les éléments d’une chronologie. A leur tête il faut citer les fastes consulaires et triomphaux, dont une grande partie a été, retrouvée gravée sur des tables de marbre qu’on peut voir au Capitole ; dans les fastes triomphaux sont indiqués les noms des peuples que le triomphateur a vaincus : véritables annales de la conquête romaine ! Joignez à cela les lois et les traités gravés sur le bronze et conservés dans les temples, dont plusieurs sont cités comme remontant :au temps des rois, et encore existant sous l’empire, ce qui prouve qu’ils ne périrent pas tous dans l’incendie de Rome par les Gaulois, lequel n’atteignit point le Capitole, où un certain nombre ,de ces monuments furent toujours déposés, et vous comprendrez comment la vérité historique a pu se trouver dans les annalistes qui ont puisé à toutes ces sources et dans les écrivains qui ont écrit d’après les annalistes, comme Tite Live et Denys d’Halicarnasse. J’ai donc ou le droit de faire entrer dans mon !histoire les cinq premiers siècles de Rome, et il aurait été cruel pour moi d’y renoncer, car durant ces siècles l’histoire romaine m’appartenait tout entière ; sous les rois elle n’a jamais dépassé beaucoup l’horizon que la vue embrasse du haut du Capitole, et ne l’a guère dépassé non plus pendant le premier âge de la république. J’ai donc pu, souvent par ma fenêtre, suivre le peuple romain dans sa vie orageuse du Forum, du Comitium, de la curie, du champ de Mars, que j’avais sous les yeux, et dans ses guerres et ses conquêtes, dont mon regard embrassait presque toujours le théâtre ; mais maintenant ce théâtre en s’agrandissant s’éloigne et va m’échapper. A partir du sixième siècle, l’histoire romaine quitte Rome et ses environs ; elle va dans l’Italie centrale et méridionale, en Macédoine, en Grèce, en Orient ; je ne puis l’y suivre, car elle n’est plus à Rome. Ç Cependant elle revient aussi quelquefois m’y chercher : Annibal apparaît sous les murs. Scipion, accusé dans le Forum, monte au Capitole ; si je ne trouve pas à Rome son tombeau, j’y trouve la sépulture de sa famille, sa maison et son image. Et puis même ces guerres lointaines ne seront pas entièrement étrangères à notre récit, car elles auront un contrecoup à Rome. Le Forum s’émeut de ce qui se passe au bout du monde ; un temple s’élève pour chaque triomphe ; les triomphes eux-mêmes viendront nous apporter un reflet magnifique des conquêtes les plus lointaines du peuple romain. Sans sortir de Rome, nous assisterons à l’effet qu’y produiront les défaites et les victoires, au désespoir dompté par le courage après la bataille de Cannes, à l’enthousiasme populaire qui accueillera le vainqueur d’Asdrubal. Nous apprendrons l’histoire militaire de ces temps comme un citoyen qui serait demeuré dans Rome l’aurait apprise. Mais tandis que les guerres glorieuses se poursuivent au loin, les dissensions civiles ne nous rendront que trop l’histoire, l’histoire véritable du dernier siècle de la république, l’histoire des dissensions fatales et de la corruption toujours croissante qui ont amené sa fin. La scène de ces dissensions est à Rome. C’est sur le
Capitole au pied du temple de C’est à Rome que les deux terribles représentants de l’aristocratie et de la démocratie, Sylla et Marius, se livrent, sur le mont Esquilin, un combat dans lequel Marius est vaincu en présence du trophée élevé à sa victoire sur les Cimbres. Nous n’avons ras à suivre Marius dans le marais de Minturnes et suries ruines de Carthage, mais nous le voyons arriver sur le mont Janicule, furieux de ce qu’il a souffert. Rome, pendant qu’il y séjourne, est noyée dans le sana. Sylla revient à son tour, il écrase à la porte Colline l’armée de l’Italie soulevée contre la tyrannie de Rome, et qui venait, comme elle disait, étouffer la louve dans son marais. Quatre mille prisonniers sont égorgés dans la villa Publica ; les proscriptions commencent ; le bassin de Servilius, à l’entrée du Forum, est hérissé de têtes coupées. Tel est l’aspect que Rome a pris pendant les proscriptions. Quand Sylla est allé dans son grand tombeau du champ de Mars attendre César et Auguste, ses voisins de sépulture et ses successeurs à la toute-puissance, qu’il a eu l’audace de déposer, la vie publique reparaît ; le Forum, muet et sanglant sous Sylla, appartient de nouveau à la parole, ou au moins la parole le dispute à la violence. C’est le dernier âge de la république, c’est l’époque de César et de Pompée, de Caton et de Cicéron, époque d’un intérêt incomparable, où la liberté qui va périr enfante encore de grandes luttes, de grands caractères, de grands hommes ; époque dont j’ai cherché ailleurs (César, scènes historiques) à mettre en relief, mieux que je ne pouvais le faire en passant dans cette histoire, le mouvement et la vie. La république meurt chez elle et sa brillante agonie se passe à Rome. Ici tous les intérêts que peut présenter le point de vue historique propre à ce livre se trouvent réunis. Les lieux des événements ne sont jamais ignorés, et les
personnages de ce temps ne sauraient faire un pas sans qu’il nous soit
possible de les suivre ; nous pouvons les surprendre à domicile, car la demeure
de presque tous nous est connue et le choix de ces demeures n’est pas chose
indifférente. César, descendant des Jules et de Vénus, le plus grand seigneur
de Rome, ayant compris très jeune que la démocratie, quand elle n’est pas
fière, était l’alliée naturelle de la tyrannie, a jeté les yeux sur elle pour
en faire son instrument, et il est allé se loger dans le quartier populaire
de Les monuments jouent un rôle important dans la lutte des
ambitions qui se disputent la république. Pompée élève son théâtre[4], premier grand
édifice public offert par un particulier aux plaisirs du peuple. A cette
captation magnifique, César répond en ouvrant son forum. Il oppose le forum
de César à celui du peuple romain. Pompée, toujours vaniteux, avait élevé au
sommet ries gradins de son théâtre un temple à Vénus victorieuse, car il
pensait sans cesse à ses victoires, si complaisamment énumérées dans une
inscription placée par lui dans son temple de Minerve, celui auquel l’église
de Le forum de César est la seule œuvre monumentale qu’il ait eu le temps d’exécuter, la seule par conséquent dont on puisse espérer de trouver des restes. Mais d’autres monuments ne sont que des pensées de César réalisées après lui. Il faut lui rendre non seulement la curie et la basilique Juliennes, qui portèrent du moins son nom, mais le grand temple de Mars, qu’il voulait élever et qui fut le temple de Mars vengeur ; son théâtre, qui fut le théâtre de Marcellus ; le Colisée même, dont il avait conçu le projet, projet qui ne fut mis à exécution que sous les Flaviens. L’aspect du Tibre au-dessus de Rome rappelle que César voulait changer son cours, et, le portant à droite, gagner ainsi l’espace d’un champ de Mars nouveau, pour pouvoir construire dans l’ancien une Rome nouvelle. A tâté de ces marques de sa grandeur, on trouve aussi dans les monuments de Rome des souvenirs moins beaux pour lui. La basilique Æmilia fut bâtie par Æmilius Paullus avec les millions de César, qui l’avait acheté, comme il avait acheté Curion, auteur du fameux théâtre mobile. La première basilique avait été bâtie par Caton l’Ancien ; on avait passé de Caton à Æmilius Paullus et à Curion. Enfin huit colonnes du temple de Saturne, de ce vieux temple de l’âge d’or, sont encore debout pour rappeler le vol avec effraction au moyen duquel César mit la main sur le trésor public. De ces deux monuments, l’un est le fruit, de ses corruptions, l’autre le témoin de ses violences. Tout le drame de sa mort est écrit, pour ainsi dire, sur le sol de Rome. César a été mis à mort dans la curie de Pompée, qui tenait
à son théâtre. Le corps de César a été brûlé au pied des rostres qu’il avait
transportés vers l’extrémité orientale du Forum, non loin de Le Forum, à cette époque, a repris l’importance qu’il avait eu autrefois ; elle allait disparaître avec la liberté. Mais alors l’histoire du temps y est presque tout entière. Pompée y vient intimider Cicéron plaidant pour Milon. Il y paraît dans la tribune à côté de César pour appuyer ses lois démagogiques, avec une candeur de mauvais citoyen dont Caton lui annonce en vain les suites pour lui-même. Caton y lutte énergiquement contre la multitude gagnée à César ; il y est traîné des rostres jusqu’à l’arc de Fabius ; le corps du factieux Clodius y est brûlé, et une partie des édifices du Forum est incendiée à cette occasion ; Cicéron y est tour à tour applaudi et insulté. A l’ancienne tribune de la république il prononça le plus grand nombre de ses discours ; à la nouvelle tribune établie par César il prononça ses véhémentes philippiques contre Antoine. Antoine y répondit en faisant placer la tête coupée du grand orateur dans cette même tribune. L’empire, dont César fut le véritable fondateur, l’empire approche, et on le sent venir. Le théâtre de Pompée voit des combats et des exhibitions d’animaux étrangers, comme en verra le Colisée ; la statue de Pompée, si c’est bien la sienne, en style héroïque et portant un globe dans sa main, semble une statue d’empereur ; l’existence des citoyens opulents s’entoure d’un luxe qui est loin de l’austérité républicaine, l’usage du marbre s’introduit dans la décoration de leurs maisons ; les jardins de Lucullus, de Crassus, de Salluste, sont déjà de l’époque qui va suivre, à tel point que tous trois ont pu devenir des jardins impériaux. Demain, le portique de Metellus sera le portique d’Octavie. Ainsi, en étudiant les monuments de Rome, on passe de la république à l’empire comme les Romains y passèrent eux-mêmes, sans s’en apercevoir. Cette transition s’opéra facilement, grâce à la lassitude universelle et à l’hypocrisie consommée d’Auguste. Mon jugement sur Auguste est celui de Machiavel, de Montesquieu, de Voltaire, de Gibbon ; mais le préjugé des collèges est contre moi. Il s’est établi aussi depuis quelque temps une mode de réhabiliter l’empire romain, car il avait besoin de réhabilitation. Je me suis permis de ne pas tenir compte de ce paradoxe ; j’en suis resté à l’opinion commune, voilà ma hardiesse ; on avait mis le cœur à droite, je l’ai remis à gauche : ce n’est pas ma faute s’il ne convient point à tout le monde qu’il soit à sa place. L’apologie de l’empire romain serait-elle dictée par une préférence universelle pour l’empire, alors elle serait, selon moi, bien maladroite ; car plus on admirerait ailleurs cette forme de gouvernement, plus on devrait, ce me semble, défendre tout autre empire de ressembler à celui-là. C’est l’aveuglement des partis de prendre, pour la cause
qu’ils ont embrassée, la responsabilité d’iniquités dont il vaudrait mieux la
dire innocente. C’est ainsi que certains catholiques revendiquent, Quant à Auguste, nous avons, pour le juger, Tacite, Suétone et Plutarque. Si ces auteurs nous faisaient défaut, nous aurions ses monuments et ses portraits. Ce qui nous reste de ses monuments est caractéristique. Le théâtre de Marcellus, l’entrée du portique d’Octavie, les trois colonnes du temple de Mars vengeur, montrent qu’une transition s’accomplit dans l’art romain, comme dans la société romaine ; le premier de ces monuments retient encore la simplicité toute grecque de l’architecture républicaine ; les deux autres, et surtout le troisième, inaugurent la magnificence vraiment romaine de l’ère impériale. Mais il en est un plus significatif encore : c’est le mur d’enceinte du forum d’Auguste ; ce mur est une illustration d’un passage de Suétone. Suétone nous apprend qu’Auguste, ne voulant point user du droit d’expropriation forcée contre des particuliers qui ne se souciaient pas de vendre leur terrain, aima mieux donner une forme irrégulière à son forum. Le mur de ce forum existe encore, et il se détourne en effet, témoignant d’un de ces ménagements dont usait Auguste pour masquer son usurpation de tous les droits. Il est curieux de trouver là un produit et une image de la politique d’Auguste, oblique aussi et biaisant toujours, comme la muraille de son forum. La politique d’Auguste paraît encore dans le soin de donner le nom des membres de sa famille, de Livie, sa femme, d’Octavie, sa sœur, de Lucius et Caius, ses petits-fils, aux édifices construits par lui, pour attacher la reconnaissance des Romains à la dynastie qu’il espérait, mais qu’il ne put fonder. Elle paraît surtout dans le soin qu’il eut constamment de continuer les plans de César, d’achever sa basilique et sa curie, de dédier à la vengeance tirée de ses meurtriers le temple de Mars qu’il avait projeté et qu’Auguste consacra à Mars vengeur, de placer son propre forum auprès du forum de César, s’efforçant toujours de s’accoler à cette grande mémoire. Auguste, qui avait été cruel quand la cruauté lui avait été utile, cessa de l’être dès qu’elle ne lui servit plus à rien, et l’univers oublia qu’il l’avait été. L’histoire semble parfois l’oublier aussi ; mais on est forcé de se le rappeler en présence de ses portraits, dans lesquels, quand la flatterie ne les a pas trop idéalisés, on retrouve toujours un air méchant et faux l’air méchant d’Octave, l’air faux d’Auguste. Des nombreux édifices d’Agrippa, le plus célèbre et le seul conservé est le Panthéon, dédié à Auguste par une adulation dont son affectation de modestie repoussa l’hommage excessif. La rude ex-pression du visage d’Agrippa étonne chez ce serviteur éminent d’Auguste, qui eut toujours tarit de soin de lui complaire en s’effaçant devant lui ; mais peut-être cet air était-il pris à dessein tut ne fut-il qu’une habileté de plus. A Rome, le despotisme porta rapidement ses fruits naturels. Après Auguste vint Tibère, après Tibère, Caligula. Tibère continua Auguste. Ce fut la même politique avec un caractère ; plus sombre, et cette différence qu’Auguste fut cruel au commencement et Tibère à la fin. Auguste, qui affectait pour sa demeure comme pour ses vêtements, la modestie et la simplicité, était allé habiter, dans une partie assez retirée du Palatin, la maison de l’orateur Hortensius. Tibère se logea tout près, plus à l’ouest. On ne parle pas de la magnificence de cette demeure, et je doute qu’elle ait été grande. Tibère vécut loin de Rome, d’où sa figure est absente. Il y bâtit peu. Le camp des prétoriens, dont l’enceinte et les baraques subsistent, fut construit par Séjan dans l’absence de Tibère et peut-être contre lui. Après le despotisme prudent d’Auguste et de Tibère vient le despotisme désordonné de Caligula. Ses traits sont beaux, mais sa physionomie dure et cruelle. Il jette un regard farouche sur le monde. Le coin nord-ouest du Palatin, où étaient les maisons des principaux citoyens, à la fin de la république, fut envahi par le palais de Caligula. Le pouvoir absolu, qui s’était déguisé jusque-là, se montrait maintenant la face découverte ; de là un pont insensé, jeté obliquement sur le Forum, fut rejoindre le Capitole, pour que le dieu Caligula pût aller commodément converser avec son collègue Jupiter ; ce pont touchait le temple de Castor et Pollux, entre les images desquels l’empereur fou allait fraternellement s’asseoir. Claude, homme bizarre, humain et cruel tour à tour, éloquent et stupide, qui savait à fond l’histoire étrusque et ne savait pas ce que faisait Messaline ; qui se plaisait au spectacle de la torture et abolit les sacrifices humains en Gaule ; qui s’emportait contre les gladiateurs lorsqu’ils refusaient de mourir, et le premier fit une loi pour protéger les esclaves contre leurs maîtres ; Claude passe tout simplement pour un imbécile. Il est impossible d’être de cet avis en voyant sa figure, qui ne manque ni d’élévation, ni d’intelligence. l’abjection où l’on maintint sa jeunesse déprava une nature grossière, mais douée à certains égards. Quelques uns de ses bustes expriment une profonde tristesse, comme s’il sentait douloureusement sa dégradation. Ces bustes m’ont forcé de faire une étude nouvelle sur cet homme singulier. Les travaux utiles accomplis par Claude m’avertissaient aussi, malgré ses absences, de ne pas le prendre pour un idiot ; car un idiot eût été l’auteur des deux plus grands ouvrages de l’empire : le port d’Ostie et l’émissaire du lac Fucin, que l’on travaille aujourd’hui à rétablir. Le jardin des Passionnistes sur le Cælius, d’où l’on a une si admirable vue, est planté sur l’emplacement d’un temple élevé à Claude par Agrippine. Ce temple citait plus vaste qu’aucun de ceux qu’on avait élevés jusqu’alors. Ce n’était pas, de la part d’Agrippine, faire trop pour un mari qu’elle avait l’ait dieu. Eu ce qui concerne Claude, l’histoire monumentale rectifie ou du moins complète l’histoire écrite ; quant à Néron, ces deux histoires se confirment l’une l’autre admirablement : ses portraits ressemblent à son caractère, dont le fond était la vanité d’un artiste manqué. Ces portraits sont de deux sortes : dans les uns, Néron a l’air béat d’un acteur applaudi ; dans le autres, l’air féroce d’un auteur sifflé ; il est aussi représenté en Apollon, idéal de l’apothéose qu’il rêvait. Son seul monument est le palais des Mille et une nuits
qu’il construisit pour son usage. Après Néron passent Galba, Othon et Vitellius, leur histoire est courte comme le fut leur puissance ; heureusement leurs portraits sont là pour les faire bien connaître. L’énergie et la cruauté de Galba se retrouvent dans la dureté de ses traits. Othon est beau ; sa beauté, qui commença sa fortune, se fait voir dans les portraits de l’ami de Néron et de l’amant de Poppée. Vitellius est gras, mais il ne faut pas voir en lui seulement le goinfre inoffensif ; un buste souvent reproduit, admirable d’exécution, mais qui peut-être appartient à la renaissance, a fait prévaloir sa réputation de sensualité sur le renom de cruauté qu’il méritait aussi bien et que d’autres portraits lui restituent. Ces trois empereurs n’ont point laissé de monuments ; cela même est un monument de la brièveté de leur empire. Le Forum, dont la vue évoquait de si beaux souvenirs, est chanté dès lors par de hideuses mémoires : le meurtre cruel du cruel Galba, le meurtre ignoble de l’ignoble Vitellius. Une famille de parvenus sabins, les Flaviens, relève d’abord l’âme attristée et comme humiliée par le spectacle de ces misérables empereurs que la soldatesque proclame et que la populace égorge. Jamais physionomie n’exprima mieux que la physionomie matoise de Vespasien la nature d’un personnage historique ; Vespasien, habile, prosaïque, ironique, qui savait administrer et mépriser les hommes. Celui qui en mourant se moquait de sa propre divinité, a eu les honneurs d’un temple en partie conservé. Némésis, qui a passé son niveau sur tant de monuments consacrés par l’adulation, semble avoir été désarmée par ce railleur de sa propre apothéose. Titus, dont les commencements furent mauvais, dont le règne fut court et insignifiant, a dans l’histoire une réputation au moins très exagérée de beauté et de suprême bonté ; ses portraits les moins idéalisés, surtout sa statue du Vatican, par la vulgarité de sa personne et l’expression plus narquoise qu’élevée de ses traits, démentent cette double erreur. Domitien fut peut-être le plus pervers des empereurs car,
comme ses portraits l’attestent et comme le ferait supposer son attachement
au culte de la déesse de La plus grande ruine de Rome est celle de cet amphithéâtre auquel travaillèrent les trois Flaviens, qui porta toujours leur nom dans l’antiquité et s’est appelé, depuis les bas temps seulement, le Colisée. Cet amphithéâtre et les thermes de Titus nous révèlent toute la politique de cette famille habile. La mémoire de Néron, encore chère à la multitude, qui aime si facilement les tyrans, importunait les Flaviens ; ils voulurent en finir avec cette mémoire. Le Colisée fit disparaître les célèbres étangs de Néron ; les thermes de Titus s’élevèrent sur un de ses palais, et on se hâta d’enfouir dans les chambres de ce palais, comblées de décombres et dont on ne se donna pas même le temps de retirer les objets les plus précieux, le souvenir et la popularité de Néron. Nerva est le premier des bons et Trajan le premier des grands empereurs romains ; après lui il y en eut deux maîtres, les deux Antonins. Trois sur soixante-dix, tel est à Rome le bilan des gloires morales de l’empire. Cette fois, par exception, l’iconographie est trompeuse : la grandeur de l’âme de Trajan ne se reflète pas dans ses traits assez vulgaires, mais elle pela !e dans les monuments de son règne comme dans les actes de sa vie. On peut reconstruire par la pensée, à l’aide des débris qui en restent, son forum et sa basilique. Quand on contemple la colonne de marbre encore intacte qui portait sa statue et s’élevait sur sa cendre, œuvre où tout est admirable, la matière, la construction, les bas-reliefs, on se réjouit que tant de magnificence, d’art et de goût, consacré à un souverain qui en était si digne, ait été conservé par la naïve dévotion du moyen âge, qui croyait que Dieu avait ressuscité Trajan à cause de ses vertus, afin qu’il eût le temps de se faire chrétien. Ici, ce que nous apprend l’histoire romaine est parfaitement d’accord avec ce que nous enseigne l’histoire de l’art et l’histoire des ruines. Parce qu’Adrien a succédé à Trajan et parce que les Antonins ont succédé à Adrien, il faut se garder de le confondre avec lui et avec eux. Adrien fut un dilettante spirituel, mais un prince corrompu et méchant ; les chefs-d’œuvre qui ont reproduit les traits d’Antinoüs, le nom de ce favori écrit en hiéroglyphes sur un obélisque à côté de celui de l’impératrice Sabine, proclament l’impudeur d’une honteuse passion affichée à la face du monde. La bouche et le regard d’Adrien expriment, avec la finesse et la pénétration, la sécheresse et la dureté. Les restes du beau temple de Vénus et de Rome, dont Adrien fut l’architecte, rappellent le meurtre d’Apollodore, mis à mort pour punir fine épigramme. Dans la villa Adrienne, ce produit et pour ainsi dire ce recueil de ses souvenirs de voyage, apparaît vivement, parmi les ombrages et les ruines, la maladie affreuse et vengeresse qui vint l’y frapper et qui lui faisait désirer de mourir saris l’oser. Juste accomplissement de l’arrêt d’un vieillard qui, condamné par lui sans motif, avait demandé aux dieux de condamner Adrien à vouloir et à ne pouvoir mourir. Son mausolée, lui-même un souvenir d’Orient, ce monument d’une grandeur inutile et le pont qu’il rit construire uniquement pour arriver à ce mausolée achèvent de peindre la vanité égoïste de son âme par la vanité colossale de son sépulcre. On voit à côté des empereurs les portraits de leurs femmes, de leurs mères, de leurs sœurs, de leurs filles. Je préférerais, aux images de toutes ces impératrices et de toutes ces princesses, celle de la mère des Gracques, qui était dans le portique d’Octavie. Cependant on s’arrête avec respect devant la première Agrippine, l’épouse de Germanicus, assise avec une si noble simplicité et dont le visage exprime si bien la fermeté virile. L’autre Agrippine, la mère de Néron, nous présente une beauté plus parfaite, beauté coupable qu’elle fit servir à son ambition pour séduire un vieil oncle et peut-être un fils. Poppée est bien la jolie idole que devait élever puis briser un caprice de Néron. Julie, fille de Titus, laide et vaine, ne nous offre rien qui puisse excuser le caprice incestueux de Domitien ; de plus, elle a une affreuse coiffure, dont la bizarrerie disgracieuse avertit que le goût s’en va. Plautine, la femme, Marciane, la sœur, Matidie, la nièce de Trajan, ne sont guère mieux coiffées ; elles ont l’air honnête et commun. Seule de la famille, Sabine respire la distinction et l’élégance : ce fut une personne lettrée qu’on accusa de trop aimer les gens de lettres. Les épouses d’Antonin et de Marc-Aurèle, bien que mariées à la philosophie, ne s’en montrèrent pas assez éprises dans la personne de leurs époux. Antonin le sut et s’y résigna ; Marc-Aurèle l’ignora toujours. On voit à Rome le temple d’Antonin et de la première Faustine et leur apothéose. On y voit aussi celle, de la seconde : elle était charmante ; en regardant son portrait on conçoit les illusions de Marc-Aurèle sur une épouse qui abusa à son égard de la permission de tromper un mari. Ces deux Antonins furent admirables ; la vertu humaine ne saurait aller plus loin. Marc-Aurèle eut de plus le mérite d’être guerrier. Ses guerres contre les Germains sont retracées sur sa colonne par des bas-reliefs dont la perfection moins grande fait voir que depuis ceux de la colonne trajane l’art a déjà décliné. La statue équestre de Marc-Aurèle, d’une majesté si douce, si paisible, dont le geste est un geste clément, fait plaisir à rencontrer sur le Capitole ; bien qu’en bronze, elle a été épargnée, au moyen âge, parce qu’on la croyait une statue de Constantin. Erreur honorable pour Constantin. La bonté des trois règnes longs et presque consécutifs de Trajan, d’Antonin et de Marc-Aurèle est la plus foudroyante condamnation du despotisme, car trois empereurs à peu près parfaits n’améliorèrent nullement l’empire romain. Ce qui est foncièrement mauvais le demeure toujours ; après Marc-Aurèle vint Commode : on n’avait rien gagné. Commode ressemble par le visage à Marc-Aurèle, dont l’âme était si différente de la sienne. La réputation de Faustine avait besoin de cette preuve de la légitimité de son fils. Pour la seconde fois nous trouvons, par exception, l’application qu’on peut faire de l’iconographie à l’histoire en défaut : rien clans Commode n’annonce le fou sanguinaire ; il a l’air d’un beau satisfait de lui-même et des autres. Je passe Pertinax, Didius Julianus et son règne d’un moment, les rivaux éphémères de Septime Sévère, pour arriver à cet empereur africain, comme le disent sa chevelure un peu crépue et ses traits qui n’ont rien de romain. Septime Sévère conserva l’amour de sa province et voulut qu’un monument qui s’appelait le Septizonium annonçât le palais impérial à ses compatriotes venant d’Afrique par la voie Appienne et entrant dans Rome par la porte Capène. Il eut un arc de triomphe et le méritais. Cet arc existe aujourd’hui ; l’architecture en est encore belle, la sculpture en est déjà grossière. Son fils Caracalla fut un fou féroce dans le genre de Commode. Ses bustes au col de travers, à la figure grimaçante, sont ainsi parce qu’il a exigé qu’ils fussent ainsi. Caracalla voulait que ses portraits eussent l’air furieux ; il s’est chargé de léguer sa caricature à la postérité. Dans le petit nombre de ceux où le programme impérial n’a pas été suivi, on voit qu’il ressemblait à son frère Geta, ce frère qu’il fit mourir, et qui, à en juger par sa mine, ne valait guère mieux que lui. Le nom de Geta, effacé de l’arc de Septime Sévère, d’un autre monument à Rome, et en Égypte des inscriptions hiéroglyphiques, atteste un acharnement du Fratricide contre la mémoire de sa victime, né peut-être de l’importunité d’un remords. Les Thermes de Caracalla sont après le Colisée la plus
grande ruine de Rome. C’est de même un monument consacré, selon le génie de l’empire,
aux plaisirs de la multitude. Les combats de gladiateurs, sanguinaire nais mâle
divertissement, appartiennent à Julia Pia, cette Syrienne élevée au trône par Septime Sévère, à cause de sa beauté, offre un type nouveau d’une finesse et d’une distinction un peu étrangères. Sa sœur Mœsa, les deux filles de celle-ci, Julie Sohemias et Julie Mammée, ont comme elle un genre de coiffure plein d’élégance. Ces belles et intrigantes étrangères prennent dans la politique une importance qui est nouvelle à Rome. Elles font lus empereurs comme Théodora et Marozia, au moyen âge faisaient les papes. Par elles arrivèrent à l’empire tee jeune, beau et stupide prêtre syrien qui prit le nom d’Hélagabale, et Alexandre Sévère, dont les traits respirent la faiblesse et la douceur. Maximin, un hercule dalmate, gigantesque et vorace, succède au généreux fils de Mammée. Puis viennent les empereurs de la décadence, dont on peut voir les figures dans la curieuse galerie des bustes impériaux, au Capitole. A mesure qu’on avance, le travail du sculpteur devient plus grossier, l’expression des bustes plus inquiète et plus sombre ; c’est que la civilisation baisse et que les barbares approchent. Quelques honnêtes empereurs, Claude le Gothique, Tacite, Probus, se détachent dans cette foule, mais ils sont venus trop tard ; le sénat les nomme quelquefois, les soldats les assassinent presque toujours. En général, ils n’ont pas le temps ou le loisir d’élever des monuments. Constamment occupés pendant leurs règnes rapides à défendre Rome menacée toujours de plus près, ils ne songent point à l’embellir. De Gallien, il est resté un arc de triomphe qu’un flatteur lui éleva dans ses jardins. Ironie du hasard ! c’est sous Gallien, à qui fut dédié cet arc de triomphe encore conservé, que se consommèrent l’envahissement et la dislocation de l’empire. Aurélien, Dioclétien, Maxence font exception. De ceux-là il reste des monuments et des monuments considérables, épaves de ce grand naufrage de l’empire romain. Ces monuments prouvent ce qu’a déjà montré l’arc de Septime Sévère, et ce que font voir également les monuments de l’Égypte ; combien le beau dans l’architecture survit au beau dans la sculpture. Les bustes de ces temps sont plus ou moins barbares ; les débris du palais du Soleil, élevé sur le Quirinal par Aurélien, qui fut un empereur énergique, sont d’une telle beauté qu’on a peine à les croire contemporains des monuments de Palmyre auxquels ils ressemblent par la grandeur des dimensions, mais qu’ils surpassent de beaucoup par le style. Dioclétien fut un second Vespasien. L’air de son visage rappelle celui de cet empereur. Comme lui positif, habile, il méprisait les hommes, qu’un jour il dédaigna de gouverner. Il fit un effort immense et inutile pour tuer le christianisme et organiser l’empire, deux impossibilités. Les thermes qui portent son nom, mais qui en réalité furent l’œuvre collective des quatre Augustes et des deux Césars qui se partageaient le monde romain, et dont aucun ne vécut dans Rome que ses maîtres commençaient à abandonner, ces Thermes attestent par leur étendue et par le grand aspect de ce qui en subsiste, surtout de la salle dont Michel-Ange a fait une des plus belles églises de Rome, ce que l’architecture était encore au temps de Dioclétien. Une des plus belles églises de Rome faite avec une, salle des Thermes qui portent le nom du plus acharné persécuteur des chrétiens, quel triomphe et quelle noble vengeance du christianisme ! Le dernier empereur païen de Rome, Maxence, élève encore un cirque en grande partie conservé de nos jours, et la majestueuse basilique, dont le tiers, qui seul subsiste, forme une des plus imposantes ruines de Rome. Cette basilique, construite par le dernier des empereurs païens et dédiée au premier empereur chrétien son vainqueur, montre le monde passant du paganisme au christianisme à la suite de la mémorable victoire remportée par Constantin sur Maxence à trois lieues de Rome. Je m’arrêterai à Constantin, car l’histoire de De Constantin lui-même, qui appartient à cette histoire et qui a déserté Rome, je dirai peu de choses ; je n’aurai à parler que de sa remarquable statue et de son arc de triomphe, monument de transition orné par l’empereur chrétien, qui ne l’était probablement pas beaucoup alors, de bas-reliefs païens empruntés à un monument de Trajan et portant une inscription qui renferme une profession de foi assez ambiguë, dont la partie effacée et récrire l’était probablement encore plus. Je renvoie aussi à l’histoire de Avril, 1861, sur la roche Tarpéienne. |