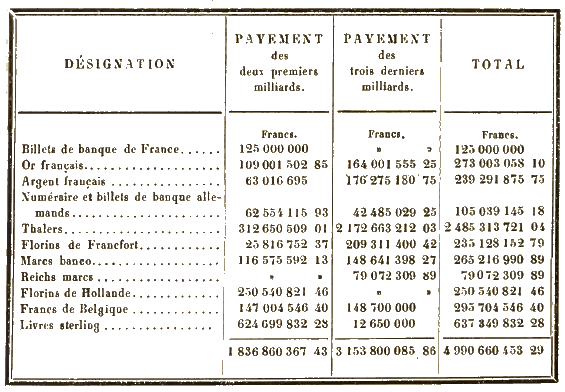LA GUERRE DE 1870
CAUSES ET RESPONSABILITÉS — TOME SECOND
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
|
I ASSEMBLÉE NATIONALESéance du 17 février 1871. PROPOSITION DES DÉPUTÉS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN, DE LA MOSELLE ET DE LA MEURTHE RELATIVE A LA NON-ALIÉNATION DE L'ALSACE ET DE LA LORRAINE. M. KELLER. — Je suis convaincu, messieurs, que la proposition que je viens déposer sur le bureau de la Chambre, et que vous me permettrez de vous lire, aura votre assentiment unanime ; car il s'agit ici de notre honneur, de notre unité nationale, et, sur ce point, il ne saurait y avoir de dissidence dans une Assemblée française. (Mouvement.) La voici : Les soussignés, représentants à l'Assemblée nationale, déposent sur le bureau de la Chambre la proposition suivante : L'Assemblée nationale prend en' considération la déclaration unanime des députés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de la Meurthe. La proposition, ainsi que la déclaration que je vais avoir l'honneur de vous lire est signée par MM. Léon Gambetta, Humbert, Küss, Saglio Varroy, Titot, André, Tachard, Rehm, Édouard Teutsch, Dornès, Hartmann, Ostermann, Laffize, Deschange, Billy, Bardon, Viox, Albretch, Alfred Kœchlin, Charles Bœrsch, Grandpierre, Chauffour, Rencker, Melsheim, Brice, Grosjean, Berlet, Schneegans, Seheurer-Kestner, Ed. Bamberger, Noblot, A. Bell, Ancelon et Keller. Voici maintenant, messieurs, la déclaration qui nous est dictée par le vote unanime de nos électeurs, et que nous vous demandons de prendre en sérieuse considération. Elle est un élément sérieux des négociations qui vont s'ouvrir, puisqu'elle est l'expression de la volonté des populations, et qu'au temps où nous sommes, en pleine civilisation, il ne saurait être question de disposer des peuples sans leur assentiment. (Très bien ! très bien ! — applaudissements.) Nous soussignés, citoyens français, choisis et députés par les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de la Meurthe pour apporter à l'Assemblée nationale de France l'expression de la volonté unanime des populations de l'Alsace et de la Lorraine, Après nous être réunis et en avoir délibéré, Avons résolu d'exposer dans une déclaration solennelle leurs droits sacrés et inaliénables, afin que l'Assemblée nationale, la France et l'Europe, ayant sous les yeux les vœux et les résolutions de nos commettants, ne puissent consommer ni laisser consommer aucun acte de nature à porter atteinte aux droits dont un mandat ferme nous a confié la garde et la défense. En effet, messieurs, nous ne sommes ici que pour cela ; nos électeurs ne nous ont envoyés ici que pour attester que nous sommes et que nous resterons à jamais Français. (Nouveau mouvement.) DÉCLARATION : I. — L'Alsace et la Lorraine ne veulent pas être aliénées. Associées depuis plus de deux siècles à la France, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, ces deux provinces, sans cesse exposées aux coups de l'ennemi, se sont constamment sacrifiées pour la grandeur nationale ; elles ont scellé de leur sang l'indissoluble pacte qui les rattache à l'unité française. Mises aujourd'hui en question par les prétentions étrangères, elles affirment à travers les obstacles et tous les dangers, sous le joug même de l'envahisseur, leur inébranlable fidélité. Tous unanimes, les citoyens demeurés dans leurs foyers comme les soldats accourus sous les drapeaux, les uns en votant, les autres en combattant, signifient à l'Allemagne et au inonde l'immuable volonté de l'Alsace et de la Lorraine de rester françaises. (Bravo ! bravo ! à gauche et dans plusieurs autres parties de la salle.) II. — La France ne peut consentir ni signer la cession de la Lorraine et de l'Alsace. (Très bien !) Elle ne peut pas, sans mettre en péril la continuité de son existence nationale, porter elle-même un coup mortel à sa propre unité[1] en abandonnant ceux qui ont conquis, par deux cents ans de dévouement patriotique, le droit d'être défendus par le pays tout entier contre les entreprises de la force victorieuse. Une Assemblée, même issue du suffrage universel, ne pourrait invoquer sa souveraineté pour couvrir ou ratifier des exigences destructives de l'intégrité nationale. (Approbation à gauche.) Elle s'arrogerait un droit qui n'appartient même pas au peuple réuni dans ses comices. (Même mouvement.) Un pareil excès de pouvoir, qui aurait pour effet de mutiler la mère commune, dénoncerait aux justes sévérités de l'histoire ceux qui s'en rendraient coupables[2]. La France peut subir les coups de la Force, elle ne peut sanctionner ses arrêts. (Applaudissements à gauche.) III. — L'Europe ne peut permettre ni ratifier l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine. Gardiennes des règles de la justice et du droit des gens, les nations civilisées ne sauraient rester plus longtemps insensibles au sort de leurs voisines, sous peine d'être à leur tour victimes des attentats qu'elles auraient tolérés. L'Europe moderne ne peut laisser saisir un peuple comme un vil troupeau ; elle ne peut rester sourde aux protestations répétées des populations menacées ; elle doit à sa propre conservation d'interdire de pareils abus de la Force. Elle sait d'ailleurs que l'unité de la France est aujourd'hui, comme dans le passé, une garantie de l'ordre général du inonde, une barrière contre l'esprit de conquête et d'invasion. La paix faite au prix d'une cession de, territoire ne serait qu'une trêve ruineuse et non une paix définitive. Elle serait pour tous une cause d'agitation intestine, une provocation légitime et permanente à la guerre. Et quant à nous, Alsaciens et Lorrains, nous serions prêts à recommencer la guerre aujourd'hui, demain, à toute heure, à tout instant. (Très bien ! sur plusieurs bancs.) En résumé, l'Alsace et la Lorraine protestent hautement coutre toute cession. La France ne peut la consentir ; l'Europe ne peut la sanctionner. En foi de quoi, nous prenons nos concitoyens de France, les gouvernements et les peuples du monde entier à témoins que nous tenons d'avance pour nuls et non avenus tous actes et traités, vote ou plébiscite, qui consentiraient abandon en faveur de l'étranger de tout ou partie de nos provinces de l'Alsace et de la Lorraine. (Bravos à gauche.) Nous proclamons par les présentes à jamais inviolable le droit des Alsaciens et des Lorrains de rester membres de la nation française (Très bien !) et nous jurons, tant pour nous que pour nos commettants, nos enfants et leurs descendants, de le revendiquer éternellement et par toutes les voies, envers et contre tous usurpateurs. (Bravo ! bravo ! — Applaudissements redoublés à gauche.) II RAPPORT DU COMTE DE BISMARCKADRESSÉ AU ROI EN FÉVRIER 1870 SUR LA CANDIDATURE DU PRINCE LÉOPOLD DE HOHENZOLLERN AU TRÔNE D'ESPAGNE. La couronne d'Espagne, dit Robert de Keudell[3] dans son livre sur Bismarck et sa famille, a été offerte quatre fois en 1869 et 1870 au prince héritier Léopold de Hohenzollern à l'instigation du conseiller d'État don Eusebio Salazar y Mazzaredo, et par lui personnellement. La première offre fut déclinée purement et simplement. A la seconde, le prince Antoine répondit (septembre 1869) que la demande pourrait être examinée de plus près, si le gouvernement espagnol avait la certitude d'une approbation simultanée de l'empereur Napoléon et du roi Guillaume. Le prince lui-même en avisa l'empereur Napoléon ; celui-ci ne jugea pas à propos de donner son opinion. Lors de son troisième voyage en Allemagne, Salazar vint à Berlin, avant fin février, et remit au chancelier une lettre confidentielle du maréchal Prim qui, à l'époque, dirigeait la politique espagnole. Le même jour, le hasard voulut que j'eusse un rapport à faire. Lorsque j'eus terminé, le chancelier me dit : Faites condamner ma porte. Je viens de recevoir une lettre du maréchal Prim au sujet du trône d'Espagne. Il faut que j'aie ma tranquillité pour méditer la chose. Le lendemain il me dicta les
phrases suivantes, qui devaient être libellées dans un rapport non officiel
adressé au roi : I. Avantages que la Prusse et l'Allemagne auraient à ce que le prince héritier Léopold de Hohenzollern acceptât la couronne d'Espagne. — Cette acceptation amènerait un accroissement très sensible des sympathies entre deux nations dont les intérêts ne se heurtent nulle part, et dont les relations amicales sont susceptibles d'un développement considérable. Les Espagnols pourraient éprouver un sentiment de reconnaissance à l'égard de l'Allemagne, si on leur évite l'état anarchique où ils craignent de tomber. Pour les rapports avec la France, il serait avantageux d'avoir à son autre extrémité un pays sur les sympathies duquel nous pourrions compter et avec les sentiments duquel la France aurait à compter. Supposons que, dans une guerre entre l'Allemagne et la France, la situation en Espagne soit ce qu'elle était sous Isabelle la Catholique ; supposons d'autre part qu'il y existe un gouvernement favorable à l'Allemagne : la différence entre ces deux situations s'élèvera pour nous jusqu'à deux corps d'armée. Dans le premier cas, des troupes françaises seraient relevées par des troupes espagnoles ; dans le second cas, les Français devraient laisser un corps d'animée sur la frontière d'Espagne. Les sentiments pacifiques de la France vis-à-vis de l'Allemagne seront toujours proportionnels aux dangers que présentera la guerre. Nous ne pouvons pas compter sur de bonnes dispositions durables, mais plutôt sur l'examen des faits importants qui feront préjuger de l'issue de la guerre. Politique commerciale : De même qu'en Roumanie la dynastie allemande a favorisé les rapports commerciaux entre l'Allemagne et ce pays sans côtes, de même le règne d'un souverain d'origine allemande ranimerait dans la presqu'île ibérique le commerce jadis florissant entre l'Allemagne et l'Espagne, commerce qui a notoirement souffert de l'attitude politique de la Prusse lors de divers incidents en Espagne. Autre avantage : Le prestige de la dynastie des Hohenzollern, le légitime orgueil avec lequel la Prusse regarde sa maison royale, avec lequel l'Allemagne entière s'habitue de plus en plus à nommer ce nom comme une propriété de la nation, cet élément de fierté nationale qui réside dans le prestige manifeste de la dynastie, contribuera dans une large mesure à développer le sentiment monarchique, si cette maison souveraine prend en Europe une place qui n'a d'analogie que dans les antécédents de la maison de Habsbourg. Cet élément de fierté n'est nullement à dédaigner dans la situation actuelle de l'Allemagne ; c'est un élément de satisfaction et de consolidation. II. Un refus aurait plusieurs conséquences désagréables. — Les Espagnols seraient gravement offensés de ce que l'on repousse une couronne qui occupe à juste titre une grande place dans l'histoire, et une nation comme l'Espagne, qui demande à être sauvée de l'anarchie, en lui refusant le roi qui parait lui convenir le mieux — il serait tout à fait en dehors des luttes de partis —. Décliner l'offre pour des raisons personnelles paraîtrait bien dur ; ce serait refuser le salut à une nation de seize millions d'habitants, qui se trouve dans une pareille détresse. Les chances d'une république en Espagne grandiraient alors sensiblement, événement qui pourrait avoir sa répercussion en France. On ne saurait répondre absolument par la négative à la question de savoir si, en s'accroissant, les dangers d'une république pour la France ne pousseraient pas à la violation de la paix. Pour tous les mécontentements en Espagne, pour tous les dangers du côté de la France, l'opinion publique en Allemagne rendrait responsables les promoteurs du refus. III. Aussi, je considérerais l'acceptation comme utile dans l'intérêt de la paix et de la satisfaction dans notre pays ; je la considérerais comme la solution la moins dangereuse de la question espagnole. — La suppression de la question orléaniste et républicaine a pour la France une valeur essentielle. D'après les indications qui nous sont parvenues, l'élection es assurée par plus des trois quarts des électeurs. La circonstance qu'une aussi grande nation que l'espagnole manifeste sa volonté avec une majorité si considérable, et voisine de l'unanimité, pèsera d'un grand poids dans la balance. Elle rappelle des incidents du même genre en Angleterre, lors de l'élection de la maison régnante aujourd'hui au lien et place des Stuarts expulsés, et en Russie, lors de l'élévation au trône de la maison Romanov. La légitimité du droit en vertu duquel règnent les dynasties d'Angleterre et de Russie, est, sans aucun doute, moins contestable que le procédé brutal de Louis XIV, procédé qui consista à déloger les Habsbourg de l'Espagne au profit des Bourbons, ou que la révolution sous Ferdinand VII, qui fit passer la couronne sur la tête d'Isabelle. La réapparition de la reine Isabelle sur le trône me paraîtrait extrêmement préjudiciable aux intérêts monarchiques en Europe. Un genre de vie comme celui de cette princesse, on ne l'aurait pas toléré une année en Angleterre. Ce qui milite en faveur des tendances monarchiques des Espagnols, c'est qu'ils ont supporté trente-six années la domination des reines Christine et Isabelle, après tous les bouleversements postérieurs à 1808, et tous les mauvais gouvernements dont ils étaient affligés depuis cent ans. Le roi futur peut tabler sur cet esprit monarchique. Je soumis sans tarder le brouillon d'un rapport au roi où la forme seule était un peu modifiée, mais la dictée reproduite quant au fond. Dans les Souvenirs du roi Charles de Roumanie, ajoutait Keudell, on cite un mémoire adressé au roi par Bismarck ; le résumé qu'on en donne permet de conclure à l'identité de ce travail avec le mien[4]. III LETTRE DU COMTE DE BISMARCK AU Dr LOTHAR BUCHERJuin 1870. Dans une lettre publiée par l'historien espagnol Pirola — Histoire continentale —, Bismarck écrivait en juin 1870 au D' Lothar Rucher au sujet de l'offre faite par le maréchal Prim au prince Léopold du trône d'Espagne : Il est possible que nous voyions une fermentation passagère en France et sans doute il est nécessaire d'éviter tout ce qui pourrait la susciter et l'augmenter. Cela étant ainsi, conviendrait-il d'ajouter mon nom dans la relation de ces négociations ? .le crois que non et qu'au contraire on devrait mettre nia personne en dehors de tout. En vérité, je ne suis pas engagé officiellement. Il s'agit d'un acte volontaire de la nation espagnole d'une part, et de l'autre, d'un prince qui est majeur, maître de ses actions et simple particulier. S'il a eu ou non des raisons pour se faire donner le consentement de son père et du chef de sa famille, ceci est une question d'ordre privé et non une affaire d'État. Consulter le roi sur de semblables projets est le devoir du ministre de la Maison royale. Mais je ne l'ai pas aidé de mes avis en tant que président du Conseil des ministres, mais seulement en tant que chargé des Affaires étrangères, à titre d'homme de confiance, de même que les autres serviteurs de l'État qui sont dans le secret. Pour moi, je crois que le gouvernement espagnol fera mieux de ne publier que la lettre du général Prim du 17 février et la réponse[5]. Nous aurons ainsi une position inexpugnable devant le publie européen. Si l'on fait du bruit en France, nous demanderons avec simplicité : Que voulez-vous ? Voulez-vous dicter les décisions de la nation espagnole et d'un particulier allemand ? Ce sera alors l'occasion d'utiliser ce que vous, docteur, me proposez. Sans doute, on criera à l'intrigue ; on sera furieux contre moi, sans pouvoir préciser le point d'attaque. Il ne s'agit, ce sera nia réponse, que d'une question de politique concernant le général Prim. J'ai répondu à sa lettre. J'espère qu'il ne doutera pas de mes plus respectueux sentiments pour sa personne, ni de mon adhésion au projet dont la réalisation ne dépend plus que de lui et des Cortès. Je n'ai pas amené l'affaire à ce point sans des inconvénients considérables que M. Goma, avec sa connaissance du terrain, pourra se figurer et expliquer au général. Cette lettre écrite au docteur Lothar Bueher, qui avait été en avril 1870 avec le major de Versen faire un voyage d'exploration en Espagne pour y étudier la situation exacte et les pronostics de l'élection royale, expose sans détours, comme l'a fait remarquer M. Léonardon (Prim, p. 184), le thème de la politique bismarekienne. Pour que le coup de théâtre eût absolument réussi, il aurait fallu que la candidature subitement présentée aux Cortès et le vote enlevé dans les brefs délais prévus par la Constitution eussent rendu vaine toute opposition de la France et en même temps lié l'Espagne à la Prusse. Le coup manqua par la prorogation des Cortès. Il devenait difficile de dissimuler le nom du candidat. Prim avait tout essayé pour en faire un mystère absolu. Le 11 juin, il avait dit aux Cortès : On me permettra de ne pas prononcer son nom, car ce ne serait pas prudent. Cela pourrait entraîner des complications et au surplus j'ai engagé nia parole d'honneur. Et voici que plusieurs personnes ayant été mises dans la confidence, le nom de Léopold est connu le 1er juillet. Prim est inquiet : Labeur perdu, s'écrie-t-il, candidature perdue ! Et Dieu veuille que ce ne soit que cela ! Il va le lendemain avouer la chose au baron Mercier de Lostende, notre ambassadeur. On sait le reste[6]. IV Paris, le 6 juillet 1870. Note sommaire pour l'empereur sur la situation de l'armée[7]. Quinze jours après l'ordre donné par l'empereur, on aura formé deux armées comptant : 350.000 hommes de toutes armes. 875 bouches à feu, avec 1er et 2e approvisionnement. Il resterait :
A ces forces, il y a lieu d'ajouter, dès le premier jour, 100.000 hommes de garde nationale mobile habillés, équipés, armés et organisés avec leurs cadres. A partir de l'ordre impérial, il faudrait environ trois semaines pour .faire venir d'Afrique sur le Rhin les trois régiments de zouaves, les trois régiments de tirailleurs, et les remplacer en Algérie par quatre régiments d'infanterie de ligne. Il faudrait plus d'un mois pour faire venir à Marseille et Toulon les quatre régiments de chasseurs d'Afrique. J'ai l'honneur de demander à l'empereur de vouloir bien me donner ses ordres à l'heure même où la résolution de Sa Majesté sera arrêtée. Le ministre de la Guerre, Maréchal LEBOEUF. Il ressort, observe k comte de la Chapelle, des états de situation fournis par les ministres de la Guerre, en 1869 comme en 1870, que l'empereur devait compter sur un effectif de 588.000 combattants. De ce chiffre il y avait à retrancher : 75.000 hommes du contingent de la classe de 1869, lesquels devaient être habillés et incorporés le 1er juillet 1870, mais qui, n'étant pas instruits, devaient rester quelque temps dans les dépôts ; 50.000 hommes jugés nécessaires pour l'Algérie, et 63.000 hommes, comprenant les cadres et les anciens soldats qu'il fallait également laisser dans les dépôts. Ces défalcations faites, mais en diminuant le nombre des troupes à l'intérieur, en rappelant la brigade de Civita-Vecchia, on pouvait envoyer à la frontière 400.000 hommes. Les forces de l'Empire se trouvaient donc ainsi réparties :
Comme il était possible de diminuer les troupes de l'Algérie de 20.000 hommes, en n'y laissant que 30.000 hommes, on pouvait avoir en France, en sus de 400.000 hommes envoyés à la frontière, un noyau de 20.000 anciens soldats qui, réunis aux 138.000 laissés dans les dépôts, pouvaient former les 4es bataillons des régiments en campagne. La question se résumait donc à savoir si cet effectif de 400.000 combattants était suffisant pour résister aux forces de l'Allemagne du Nord. N. B. — La Confédération disposait de 980.000 hommes et pouvait dès le début de la guerre mettre 480.000 hommes en ligne, alors qu'en réalité nous en eûmes à peine 230.000. — H. W. V RAPPORT DU BARON DE WERTHER AU ROI DE PRUSSEENTRETIEN DU DUC DE GRAMONT AVEC LE BARON DE WERTHER (extrait) Paris, 12 juillet 1870. ... Vers trois heures moins un quart, l'ambassadeur de Prusse se fit annoncer, et je le fis aussitôt introduire dans mon cabinet. M. le baron de Werther était pour moi une fort ancienne connaissance : je l'avais en pour collègue pendant près de neuf ans à la Cour de Vienne, et j'avais toujours entretenu avec lui des relations amicales. Je le considérais et le considère encore comme un homme sincèrement ami de la paix, et j'étais persuadé qu'il seconderait mes efforts dans ce sens. Mieux informé que la plupart de ceux qui ont agité les questions personnelles et les griefs auxquels la presse française et étrangère a si souvent mêlé le nom du baron de Werther, je ne m'associe pas aux jugements sévères dont il a été l'objet. J'ai toujours rencontré chez lui le désir d'être conciliant et la volonté d'être sincère. Cette déclaration me semble un devoir, au moment où, dans le cours de ce récit, je vais être obligé de contredire plusieurs des assertions du rapport qu'il adressa au roi après notre entrevue. Ce rapport, inexact sur quelques points, fidèle et correct sur tous les autres, a été écrit, j'en suis intimement convaincu, avec la plus entière bonne foi, et je crois même pouvoir ajouter, avec de bonnes intentions. Ceux qui ont pratiqué longtemps la diplomatie savent par expérience tout le soin, toutes les précautions que réclame le compte rendu d'un entretien sérieux dans lequel chaque mot, chaque phrase ont une portée mesurée et calculée. Certains agents sont tellement pénétrés de la nécessité de se mettre en garde contre les entraînements de la plume, au moins aussi dangereux que ceux de la parole, qu'il leur arrive souvent, dans les circonstances graves, de porter leur rapport chez le ministre des Affaires étrangères dont ils ont à reproduire le langage, de lui en donner lecture et de lui demander : Est-ce bien là ce que vous m'avez dit, ce que vous avez voulu me dire ? Ai-je bien saisi votre pensée ? L'ai-je fidèlement rendue ? Et ce n'est qu'après cette épreuve décisive qu'ils expédient leur courrier. Plus d'une fois je m'en suis bien trouvé et j'ai pu, grâce à cette précaution, établir et maintenir l'authenticité de ma correspondance[8]. Je suis donc, en cette circonstance, comme le travailleur qui connaît les difficultés du travail et dont les jugements ne peuvent avoir l'âpreté des sentences prononcés par ceux qui n'ont jamais pratiqué ce qu'ils jugent[9]... Rapport adressé par le baron de Werther au roi de Prusse.Paris, le 12 juillet 1870. Je suis arrivé à Paris ce matin, à dix heures passées, accompagné d'un courrier du comte Benedetti, le baron de Bourqueney. M. le duc de Gramont m'a envoyé immédiatement son chef de cabinet, le comte de Faverney, pour me faire demander si je pourrais aller voir aujourd'hui le ministre. Je répondis aussitôt que j'étais prêt à le faire, et je fus reçu par le duc de Gramont avec l'affabilité accoutumée et telle qu'on doit l'attendre de deux anciennes connaissances. Avant de rapporter notre entretien, je ferai observer qu'il fut interrompu par l'arrivée de l'ambassadeur d'Espagne qui avait à faire une communication officielle. Cette communication consistait en un télégramme du prince Antoine de Hohenzollern (le père) on il déclarait que son fils, le prince héritier, en présence des complications que soulevait sa candidature, renonçait au trône d'Espagne et en avait fait parvenir directement avis au maréchal Prim. Notre entretien, engagé par le duc de Gramont, roula principalement sur l'objet soulevé par M. Benedetti, savoir : que Sa Majesté royale, par l'autorisation accordée à la candidature Hohenzollern, sans s'en être en aucune façon entendue préalablement avec le gouvernement impérial français, ne s'était pas rendu compte qu'elle avait en cela blessé la France. Il me demanda s'il en était effectivement ainsi. Je lui expliquai que Sa Majesté Royale n'eut pas pu refuser cette autorisation formellement, du moment que le prince de Hohenzollern se sentait disposé à accepter la couronne qui lui était offerte, et que, eu égard aux relations de famille du prince avec l'empereur, Sa Majesté n'eût pas pu croire que cette candidature fût mal accueillie en France. Le duc de Gramont me cita les exemples du duc de Nemours pour le trône de Belgique, et du prince Alfred pour le trône de Grèce, comme des cas où pareille autorisation avait été refusée. Je repoussai l'analogie avec le cas présent. Le duc de Gramont continua en nie disant que la France, comme la plus proche voisine de l'Espagne, devait avoir un intérêt à l'occupation du trône de ce dernier pays. Le secret qui avait été gardé sur les négociations de la candidature Hohenzollern n'avait pu que blesser beaucoup ici, et cela d'autant plus que la Cour des Tuileries avait constamment montré les plus grands égards pour notre gouvernement dans toutes les questions politiques. Cette conduite avait profondément blessé les esprits en France, et l'on en trouvait l'expression dans le sentiment de la Chambre, laquelle était malheureusement réunie en ce moment, ce qui aggravait la question. Le duc de Gramont ajouta qu'il considérait la renonciation du prince de Hohenzollern au trône d'Espagne comme une chose secondaire, car le gouvernement français n'aurait jamais permis son installation, mais il craignait qu'il ne subsistât, par le fait de notre conduite, une mésintelligence permanente entre nos deux pays. Ce germe devait être détruit, et il fallait se placer à ce point de vue que, dans notre conduite envers la France, nous n'avions pas employé des procédés amicaux, ainsi que cela avait été reconnu, à sa connaissance, par toutes les grandes puissances. A parler sincèrement, il ne voulait pas la guerre, mais des rapports bons et amicaux avec la Prusse, et il me savait viser au même but : nous devions donc rechercher ensemble s'il y avait un moyen d'exercer de ce côté une influence d'apaisement, et il s'en remettait à mon appréciation sur la question de savoir si le véritable expédient ne serait pas une lettre du roi à l'empereur[10]. Il en appelait au cœur chevaleresque de Sa Majesté Royale, qui accorderait son juste consentement. Il ne s'agirait que de dire dans cette lettre que Sa Majesté Royale, en daignant autoriser le prince Léopold de Hohenzollern à accepter la couronne d'Espagne, n'avait pas cru heurter les intérêts ni la dignité de la nation française ; que le roi s'associait à la renonciation du prince de Hohenzollern et qu'il le faisait avec le désir et l'espoir de voir disparaitre dès lors tout sujet de dissentiment entre nos deux gouvernements. Telles étaient les paroles destinées à être livrées à la publicité[11], pour amener l'apaisement du sentiment du pays, que devait contenir cette lettre ; mais il ne devait pas y être question, observa M. de Gramont, des relations de parenté avec l'empereur. Cet argument blessait ici d'une façon particulière. J'ai fait observer au duc de Gramont qu'une pareille démarche serait rendue extrêmement difficile par les explications données par lui le 6 de ce mois à la Chambre des députés ; elles contenaient des déclarations qui avaient dit froisser profondément Sa Majesté le roi. Le duc de Gramont voulut combattre cette objection en me faisant remarquer que la Prusse n'avait nullement été nommée, et que son discours avait été indispensable en ce moment pour calmer la surexcitation de la Chambre. En cet instant, le ministre de la Justice, M. Émile Ollivier, intervint dans notre entretien, dont le duc de Gramont lui fit connaître le sujet. M. Émile Ollivier soutint, d'une façon pressante, la nécessité salutaire d'agir dans l'intérêt de la paix, et me pria instamment de soumettre à Sa Majesté le roi l'idée d'une lettre dans ce sens. Tous deux me dirent que si je ne croyais pas pouvoir l'entreprendre, ils se verraient obligés de charger le comte Benedetti de soulever cette question. Les deux ministres, en faisant ressortir qu'ils avaient besoin d'un arrangement de ce genre pour calmer l'émotion des esprits, en égard à leur situation ministérielle, ajoutèrent qu'une telle lettre les autoriserait à se porter défenseurs contre les attaques qui ne manqueraient pas de surgir contre Sa Majesté le roi. Tous deux me firent remarquer finalement qu'ils ne pouvaient me dissimuler que notre conduite dans l'affaire hispano-Hohenzollern avait beaucoup plus surexcité la nation française qu'elle n'avait occupé l'empereur. Dans notre conversation, le duc de Gramont émit cette remarque, qu'il croyait que le prince de Hohenzollern avait renoncé sous l'impulsion de Sa Majesté le roi ; je contredis cette opinion, et je déclarai la renonciation comme émanant certainement de la propre initiative du prince de Hohenzollern. Dans leur vif désir de hâter les choses, les deux ministres désiraient que je communiquasse cet entretien par voie télégraphique, mais je ne le jugeai pas nécessaire. Veuillez agréer, etc. Signé : WERTHER. VI Rapport officiel sur ce qui s'est passé à Ems, rédigé sous la surveillance du roi Guillaume.13 juillet 1870. Le 9 du mois courant, le comte Benedetti sollicita du roi, à Ems, une audience qui lui fut accordée sur-le-champ. Pendant cet entretien, le ministre demanda que le roi ordonnât au prince héritier de Hohenzollern de retirer son acceptation de la couronne espagnole. Le roi répondit que, comme il était intervenu dans toute cette affaire uniquement comme chef de famille et nullement comme. roi de Prusse, et connue, en conséquence, il n'avait point donné d'ordre pore accepter la candidature au trône, il ne pouvait pas non plus ordonner le retrait de celle-ci. Le 11, le ministre français demandait et obtenait une deuxième audience, pendant laquelle il chercha à exercer une pression sur le roi, afin que celui-ci engageât le prince à renoncer à la couronne. Le roi répliqua que le prince était libre de ses résolutions, et que quant à lui, il ne savait même pas où le prince qui se proposait, disait-il, de faire un voyage dans les Alpes, se trouvait en ce moment. A la promenade des Sources, dans la matinée du 13, le roi remit au ministre un numéro extraordinaire de la Gazette de Cologne, qu'il venait de recevoir lui-même, et qui contenait une dépêche télégraphique particulière de Sigmaringen sur le désistement du prince. Le roi ajouta que, pour sa part, il n'avait pas encore reçu de lettre de Sigmaringen, mais qu'il croyait pouvoir en attendre une dans la journée. Le comte Benedetti répondit que déjà dans la soirée de la veille il avait reçu de Paris la nouvelle du désistement. Le roi considéra alors la question connue vidée, lorsque l'ambassadeur demanda inopinément au roi qu'il donnât l'assurance positive de n'accorder jamais plus son consentement, si éventuellement la candidature en question revenait sur l'eau. Le roi refusa absolument. Il maintint ce refus, lorsque le comte Benedetti revint itérativement et d'une manière de plus en plus pressante sur sa proposition. Néanmoins, le comte Benedetti sollicitait quelques henrys plus tard une troisième audience. Comme il lui fut demandé de quel objet il s'agissait, l'ambassadeur fit répondre qu'il désirait revenir sur la question qui avait été agitée dans la matinée. Par ce motif, le roi refusa mie nouvelle audience, attendu qu'il n'avait pas d'autre réponse à donner et que, à partir de ce moment, toutes les négociations devaient avoir lien par l'entremise des ministres. Le roi a satisfait au désir du comte Benedetti de pouvoir prendre congé de lui à son départ, en saluant le ministre le 14 à son passage par la gare, lorsqu'il allait se rendre à Coblence. Ainsi le ministre a obtenu du roi trois audiences qui ont eu chaque fois un caractère d'entretien particulier, le comte Benedetti ne prenant jamais le caractère de mandataire on de négociateur. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) Rapport du colonel Radziwill au roi de Prusse sur ce qui s'est passé à EmsLe 13 juillet 1870. Dans la matinée du 13 juillet, à la suite d'un entretien entre S. M. le roi et le comte Benedetti, à la promenade des Sources, Sa Majesté me fit l'honneur de m'envoyer l'après-midi, vers les deux heures, chez le comte avec la communication suivante : Sa Majesté a reçu, il y a une heure, par une communication écrite du prince de Hohenzollern à Sigmaringen, la confirmation complète de ce que le comte lui-même a communiqué le matin, comme l'ayant appris directement de Paris, au sujet du désistement du prince Léopold à sa candidature au trône d'Espagne. Par là, Sa Majesté considère cette question comme terminée. Après que j'eus exécuté cet ordre, le comte Benedetti dit que, depuis son entretien avec le roi, il avait reçu une dépêche de M. de Gramont qui le chargeait de solliciter nue audience de Sa Majesté et de lui recommander encore une fois le vœu du gouvernement français, c'est-à-dire : 1° D'approuver le désistement du
prince de Hohenzollern ; 2° de donner l'assurance qu'également dans l'avenir
cette candidature ne serait plus reprise. Sa Majesté a fait alors répondre par mon entremise au comte qu'elle approuvait le désistement du prince Léopold dans le même sens et dans la même étendue qu'elle avait approuvé antérieurement l'acceptation de la candidature. Sa Majesté avait reçu la communication écrite de la part du prince Antoine de Hohenzollern, qui avait été autorisé à cet effet par le prince Léopold. Quant au second point : l'assurance pour l'avenir, le roi ne pouvait que s'en référer à ce qu'il avait répliqué personnellement dans la matinée au comte. Le comte Benedetti accepta cette réponse de Sa Majesté avec reconnaissance et déclara que, comme il y était autorisé, il la ferait connaître à son gouvernement. Mais, en ce qui concerne le second point, il devait, comme l'en chargeait expressément la dernière dépêche de M. de Gramont, maintenir sa demande d'un nouvel entretien avec le roi, ne fût-ce que pour entendre de nouveau les mêmes paroles de Sa Majesté, d'autant plus que cette dernière dépêche renfermait de nouveaux arguments qu'il désirait soumettre au roi. Sa Majesté fit répondre à Benedetti, par mon entremise, après le dîner, vers les cinq heures et demie et pour la troisième fois, qu'elle était obligée de refuser absolument d'entrer dans de nouvelles négociations au sujet de ce dernier point (une assurance qui lierait pour l'avenir.) Ce que Sa Majesté avait dit ce matin était son dernier mot dans cette affaire, et l'ambassadeur pouvait s'y référer purement et simplement. En réponse à l'assurance que positivement on ne devait pas compter sur l'arrivée du comte de Bismarck à Ems pour le lendemain, le comte Benedetti déclara que, de son enté, il se contenterait de cette déclaration de S. M. le roi. Signé : A. RADZIWILL. Lieutenant-colonel et aide de camp de S. M. le roi. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) VII SCRUTIN SUR LA PROPOSITION DE MM. JULES FAVRE ET BUFFETRELATIVE A LA COMMUNICATION DES DÉPÊCHES AU CORPS LÉGISLATIF
Ont voté POUR :
Ont voté CONTRE :
N'ont pas pris part au vote :
Absents par congé :
VIII DÉCLARATION DU COMTE DE BISMARCKAU BUNDESRATH Berlin, le 16 juillet 1870. Les événements qui, pendant la dernière quinzaine, ont fait passer l'Europe d'une tranquillité complète à une guerre colossale, se sont accomplis en présence de tout le monde, de sorte qu'une analyse de la situation actuelle ne sera qu'une revue de faits déjà connus. On sait les communications faites par le président du Conseil des ministres d'Espagne, le 11 du mois dernier, à la séance des Cortés constituantes ; on sait aussi la dépêche circulaire de M. le ministre espagnol des Affaires étrangères du 7 du mois courant qui a été publiée par les journaux ; on sait enfin l'explication de M. Salazar y Mazarredo, parue à Madrid le 8 du mois courant, que le gouvernement espagnol depuis plusieurs mois fit négocier avec Son Altesse le prince héréditaire Léopold de Hohenzollern sur l'acceptation de la couronne d'Espagne : que ces négociations, dont M. Salazar a été chargé, se passaient sans participation, ni intervention d'un gouvernement quelconque[12], tout directement avec le prince lui-même cl avec son éminent père, et que Son Altesse se décida enfin d'accepter la candidature au trône. S. M. le roi de Prusse, qu'on en avait informé, ne crut pas devoir s'opposer à une décision prise par un prince majeur, après mûre réflexion et avec le consentement de son père. Ces faits ont été complètement inconnus à la direction des Affaires étrangères de la Confédération du Nord et au gouvernement de S. M. le roi de Prusse. C'est seulement par le télégramme de Havas, parti de Paris, le 3 du mois courant, qu'ils apprirent que le ministère espagnol était résolu à offrir la couronne au prince. Le 4 de ce mois, M. l'ambassadeur impérial de France se présenta au ministère des Affaires étrangères. Par ordre de son gouvernement, il exprima l'effet fâcheux produit par la nouvelle, à Paris, confirmée par le maréchal Prim, concernant l'acceptation de la candidature par le prince. En même temps, il demandait si la Prusse participait à cette affaire. M. le secrétaire d'État répondit que cet incident n'existait pas pour le gouvernement prussien, et que celui-ci ne saurait donner de renseignements sur de pareilles négociations entre le président des ministres d'Espagne et le prince. Le même jour, M. l'ambassadeur de la Confédération à Paris eut une conférence sur le même sujet avec M. le duc de Gramont, à laquelle assistait M. le ministre Ollivier. M. le ministre impérial de France annonça également le mauvais effet produit par la nouvelle. Ou ne saurait dire si la Prusse était initiée dans les négociations, mais l'opinion publique pourrait le supposer, et dans le mystère qui les entourait, elle voyait une conduite ennemie non seulement du coté de l'Espagne, mais aussi de la part de la Prusse. Si cet événement s'accomplissait, il était propre à compromettre la paix. Par conséquent on en appelait à la sagesse de S. M. le roi de Prusse qui ne consentirait pas à une pareille combinaison. M. le ministre prit pour une bonne chance cette circonstance que M. l'ambassadeur ayant obtenu, huit jours avant, un congé pour aller rejoindre S. M. le roi de Prusse, à Ems, fixât son départ pour le lendemain. Il serait donc possible d'exprimer les impressions toutes fraîches qui s'étaient produites à Paris. Enfin le ministre lui demanda de faire parvenir ses communications par voie télégraphique. M. l'ambassadeur pouvait, en réponse à cette ouverture, dire qu'il ne savait rien de tout cet incident. Il se chargea cependant de porter à la connaissance de S. M. le roi les communications qui venaient de lui être faites. L'ambassadeur se mit en route pour Ems, le 5 du mois courant. Il aurait suspendu son voyage en présence des circonstances impérieuses, s'il n'avait cru devoir répondre au désir d'avoir aussi vile des instructions que de pouvoir donner les explications voulues. Le jour de son départ, M. Cochery interpellait le Corps législatif sur la question espagnole. Le lendemain, M. le duc de Gramont répondait à cette interpellation, avant que M. l'ambassadeur pût envoyer une nouvelle quelconque d'Ems à Paris. La réponse de M. le duc commençant par dire que l'on ne connaissait pas encore les détails des négociations, fut remarquable par la phrase que le gouvernement français, obligé de respecter les droits d'un peuple voisin, ne croyait pas devoir supporter qu'une puissance étrangère, en portant un de ses princes sur le trône de Charles-Quint, osât troubler l'équilibre des forces européennes au détriment de la France et compromettre son intérêt et son honneur. Après une telle déclaration, il était impossible à M. l'ambassadeur de faire parvenir des renseignements à l'avis. Son substitut par intérim, informé le 9 du mois courant de l'état de la situation ainsi que M. l'ambassadeur de France, en avait informé lui-même le du même mois. L'incident, lui avait-t-on dit, ne regarde ni la Prusse ni l'Allemagne, mais l'Espagne et les candidats à son trône, avec lesquels le maréchal Prim a fait directement entamer des négociations sans que la Prusse y prenne part. S. M. le roi de Prusse, respectant la volonté de l'Espagne et celle du prince, n'a voulu exercer aucune influence sur ces négociations ; par conséquent Elle n'a ni soutenu ni préparé hi candidature. Sur ces entrefaites, le gouvernement français ordonna à son ambassadeur, accrédité près Sa Majesté et près la Confédération et qui se trouvait à Wildbad, de se rendre à Ems. M. le comte Benedetti fut reçu avec bienveillance par Sa Majesté, le 9 juillet, malgré le séjour du roi aux bains et l'absence de ministres qui paraissait n'admettre aucune demande officielle, adressée à Sa Majesté. Les communications de l'ambassadeur s'accordaient avec l'ouverture que M. le duc de Grainent avait faite au baron de Werther. S'adressant à la sagesse de Sa Majesté, l'ambassadeur le pria d'envoyer au prince une interdiction et de lui dire ne mot qui rendrait la paix à l'Europe. Ou lui répondit que le trouble, dont l'Europe serait agitée, ne proviendrait pas de la conduite de la Prusse, mais de la déclaration du gouvernement impérial faite au Corps législatif. On désigna comme étant hors de la question d'Etat la position que S. M. le roi, comme chef de famille, avait prise dans toute cette affaire, et on a exclu toute influence sur les princes de Hohenzollern comme une irruption dans leurs résolutions légitimes dont ils étaient libres. C'est ainsi que voyant tomber la responsabilité sur lui, s'il maintenait sa candidature en face de la situation actuelle, le prince a fait un acte de sa propre volonté. Le 12 du mois courant, il a renoncé à cette candidature et il a laissé à la nation espagnole toute sa liberté d'initiative. Le gouvernement prussien n'a reçu la première nouvelle de cette démarche que de Paris. L'envoyé d'Espagne remettait le télégramme du prince entre les mains de M. le duc de Gramont, au moment où celui-ci recevait M. le baron de Werther. Le 11 du mois courant, notre ambassadeur avait quitté Ems, et, le 12, il arrivait à Paris. Dans un entretien qui eut lieu le même jour, M. le duc de Gramont lui déclara qu'il regardait la renonciation comme une question secondaire, car la France n'aurait jamais permis au prince de monter sur le trône. La chose principale, c'était l'offense qui avait été infligée à la France, en ce que Sa Majesté le roi de Prusse avait permis au prince d'accepter la candidature sans s'être concerté avec la. France. Comme un moyen suffisant d'aplanir cette offense, le ministre exigeait une lettre de S. M. le roi, adressée à S. M. l'empereur des Français, dans laquelle on dirait que S. M. le roi, en donnant ladite permission n'avait pas cru compromettre les intérêts et la dignité de la France, et qu'elle s'associait au désintéressement du prince. Un jour plus tard, M. le comte Benedeti rencontra S. M. le roi à Ems, et il lui demanda d'approuver le désistement du prince et de se rendre garant pour qu'à l'avenir cette candidature ne fût pas acceptée. S. M. le roi a refusé alors de recevoir de nouveau M. le comte Benedetti. Outre cette demande, M. le duc de Gramont exigeait de l'ambassadeur de la Confédération du Nord une lettre d'excuses adressée par S. M. le roi à l'empereur Napoléon. Il ne me reste à ajouter à ce récit qu'une seule remarque. Les négociations du gouvernement espagnol avec le prince ont été officieusement portées à la connaissance de S. M. le roi de Prusse, sous la condition expresse de les tenir secrètes. Cette négociation ne regardant ni la Prusse, ni la Confédération, Sa Majesté accepta cette condition, et, en conséquence, Elle n'a pas annoncé à son gouvernement cet événement qui n'était pour elle qu'une affaire de famille. Sa Majesté s'attendait, tant que cela serait nécessaire, que le gouvernement espagnol on les candidats à son trône s'accorderaient à cet égard avec d'autres gouvernements. Les rapports qui existent depuis longtemps entre l'Espagne et la France, les relations personnelles qui lient l'empereur des Français à la maison princière des Hohenzollern, présentaient aux partis intéressés le plus simple moyen d'une entente indirecte. Les gouvernements confédérés comprendront bien que, dans de pareilles circonstances, la Présidence de la Confédération ne s'attendait pas à ce que la candidature Hohenzollern fit beaucoup de peine au gouvernement français, dont les intérêts dans la question espagnole se bornent, il nous semble, à mettre obstacle à la propagande républicaine ou au parti orléaniste. Si le Cabinet français avait voulu seulement employer les bons offices de la Prusse pour ladite candidature, il aurait trouvé le plus simple et le meilleur moyen pour arriver à ce but, c'est-à-dire dans une entente confidentielle avec le gouvernement prussien. Le discours prononcé par M. le duc de Gramont au Corps législatif a enlevé toute possibilité d'entamer une pareille entente. L'accueil que ce discours a trouvé dans ladite Assemblée, l'attitude que le gouvernement français avait prise depuis cette époque et ses exigences exorbitantes ne laissaient plus de doute à la. Présidence de la Confédération que le gouvernement français pensait seulement soit à nous humilier, soit à provoquer la guerre. Il nous était impossible d'opter pour la première alternative. Une, guerre entre l'Allemagne et la France est inséparable de grandes calamités, et la pression qui aura poussé la Prusse à faire la guerre sera un grand crime contre les intérêts de l'humanité. L'opinion publique en Allemagne l'a bien reconnu. Nous en avons la .preuve dans l'irritation du sentiment national qui se manifeste en Allemagne. Il ne nous reste à choisir qu'entre la guerre et une garantie de la part de la France contre le retour de pareilles menaces pour la paix et le bien-être de l'Europe. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) IX Réponse du roi de Prusse à l'Adresse du magistrat du conseil municipal de Berlin.18 juillet 1870. C'est pour moi une bien grande satisfaction, messieurs, de vous voir réunis ici dans ce sérieux moment. L'Adresse que vous me remettez au nom de nia capitale, exprime, d'une façon satisfaisante, les grandes impressions que nous éprouvons. Sa vérité m'a profondément ému. Vous avez raison. Je ne porte pas la responsabilité de cette guerre. Dieu le sait, j'en suis innocent. On m'a provoqué. J'ai dû repousser la provocation. La réponse a mis l'étincelle... La réception qui m'a été faite dans toutes les villes et dans tous les pays que j'ai traversés pour revenir ici, l'assentiment qui m'a été donné de tous les points de l'Allemagne et même au delà des mers, l'accueil que j'ai reçu ici vendredi soir à mon retour, m'ont élevé le cœur et donné confiance. Mon peuple a de lourds sacrifices à faire. Il ne faut pas se le dissimuler. Nous avons été gâtés par la prompte victoire obtenue avec l'aide de Dieu dans deux guerres heureuses. Nous n'en sortirons pas à si bon marché cette fois. Mais je sais ce que je puis attendre de mon armée et de ceux qui courent à leur drapeau. L'outil est aigu et tranchant ; le succès qu'on obtiendra en s'en servant est dans la main de Dieu. Je sais aussi ce que feront ceux qui, comme vous le remarquez si bien dans votre Adresse, seront appelés à panser les blessures, à adoucir les peines et les douleurs que la guerre apporte avec elle. Ce que vous m'avez dit au nom de ma capitale, je vous le répète, messieurs, m'est allé au cœur et m'a fait grand bien. Je vous en suis très reconnaissant et vous prie de transmettre aux habitants de la Ville mes sincères remerciements de l'accueil qu'ils m'ont fait à mon retour et dont je. n'avais pas eu l'idée. (Archives diplomatiques, 1871-72, tome Ier.) X Le comte de Bismarck aux représentants de la Confédération de l'Allemagne du Nord à l'étranger.Berlin, le 18 juillet 1870. Monsieur, l'attitude des ministres français aux séances du Sénat et du Corps législatif, du 15 du mois courant, et les altérations de la vérité qui y ont été commises, avec le caractère solennel de déclarations officielles, ont fait tomber le dernier voile qui cachait des intentions au sujet desquelles personne, jugeant sans parti pris, ne pouvait plus avoir de doute, depuis que l'Europe étonnée avait entendu deux jours auparavant de la bouche du ministre français des Affaires étrangères, que la France ne se contentait point du désistement volontaire du prince héréditaire et qu'elle aurait encore à négocier avec la Prusse. Pendant que les autres puissances européennes examinaient quelle attitude elles prendraient en présence de cette phase nouvelle et inattendue et comment elles exerceraient peut-être une influence conciliante et médiatrice dans ces prétendues négociations, dont personne ne pouvait supposer la nature ni l'objet, le gouvernement français, par une déclaration publique et solennelle, laquelle en dénaturant des faits connus, ajoutait de nouvelles offenses aux menaces du 6 courant, a poussé les choses à une extrémité, qui rendait tout arrangement impossible, en enlevant aulx puissances amies toute occasion d'intervention et en rendant la rupture inévitable. Déjà, depuis une semaine, nous ne pouvions plus douter que l'empereur ne fût absolument décidé à nous placer dans une situation qui ne nous laissât d'autre choix que la guerre on une humiliation que le sentiment d'honneur d'aucune nation ne saurait supporter. Si nous avions pu concevoir encore des doutes, ils auraient disparu par le rapport du ministre du roi, relativement à son premier entretien avec le duc de Gramont et M. Émile Ollivier, après son retour d'Ems, entretien pendant lequel le premier qualifia le désistement du prince héréditaire de question de détail, tandis que les deux ministres exprimèrent l'espoir que S. M. le roi écrirait à l'empereur Napoléon une lettre d'excuses dont la publication serait de nature à apaiser les esprits excités en France. Je joins une copie de ce rapport à la présente ; il se passe de commentaires. Les insultes de la presse gouvernementale française anticipèrent sur le triomphe que l'on cherchait à obtenir. Mais le gouvernement sembla craindre que la guerre ne lui échappât néanmoins. Il s'empressa donc de déplacer la question par ses déclarations du 15 du mois courant ; de la mettre sur un terrain où il n'y avait plus d'intervention possible et de nous prouver, ainsi qu'à tout le inonde, qu'aucune concession dans les limites du sentiment d'honneur national ne suffirait pour maintenir la paix. Mais comme personne ne doutait et ne pouvait douter que nous voulions sincèrement la paix, et que quelques jours auparavant nous considérions la guerre connue impossible ; connue tout prétexte pour une guerre faisait défaut et que même le dernier prétexte créé artificiellement, violemment, s'était évanoui de lui-même ; comme il avait été inventé sans nous ; comme, en conséquence, il n'y avait aucune raison de guerre, il ne resta aux ministres français, — pour se justifier en apparence devant leur propre peuple dont la majorité est disposée à la paix et qui a besoin de la paix, — il ne leur resta qu'à faire accroire aux deux Chambres représentatives et par elles au peuple, en dénaturant on en inventant des faits dont la fausseté leur était officiellement connue, que la nation avait été offensée par la Prusse, afin d'exciter les passions et de provoquer une telle explosion qu'ils pussent alléguer avoir été entrainés. C'est une tâche douloureuse que de voir dévoiler cette série de contre-vérités. Heureusement, les ministres français ont abrégé cette tâche en refusant d'accorder la communication réclamée par une partie de l'Assemblée de la note ou de la dépêche, en préparant ainsi le public à apprendre que cet office n'existe aucunement. Il en est réellement ainsi. Il n'existe point de note on dépêche par laquelle le gouvernement prussien aurait annoncé aux Cabinets de l'Europe le refus de recevoir le ministre français. Il n'existe rien, en dehors du télégramme des journaux[13] que tout le monde connaît, et qui a été communiqué, d'après le texte des journaux, aux gouvernements allemands et à quelques-uns de nos représentants près des gouvernements non allemands, afin de les informer de la nature des prétentions françaises et de l'impossibilité de les admettre. Ce télégramme ne renferme en outre rien de blessant pour la France. Le texte de cette dépêche télégraphique se trouve ci-joint (dépêche d'Ems)[14]. Des communications ultérieures sur cet incident n'ont été adressées par nous à aucun gouvernement. Quant au fait du refus de recevoir le ministre français, afin de pouvoir placer cette allégation dans sa véritable lumière, j'ai été autorisé par Sa Majesté à vous transmettre les deux documents ci-joints, avec la demande de les communiquer au gouvernement auprès duquel vous avez l'honneur d'être accrédité ; le premier de ces documents est un exposé rigoureusement exact, rédigé sur les ordres et sons l'approbation immédiate de S. M. le roi des événements qui ont eu lieu à Ems (v. n° VI). Le second est le rapport officiel de l'aide de camp de service de S. M. le roi touchant l'exécution de la mission qui lui avait été donnée (n° VII). Il serait inutile de faire ressortir que la fermeté avec laquelle l'arrogance française a été repoussée, était entourée, tant en ce qui concerne le fond que la forme, de la courtoisie la plus complète, laquelle répond tout aussi bien aux habitudes personnelles de S. M. le roi qu'aux principes de politesse internationale envers les représentants de souverains et de nations étrangères. Quant au départ de notre ministre, je fais seulement observer, — comme le Cabinet français le savait d'ailleurs officiellement, — ne s'agissait point d'un rappel, mais d'un congé sollicité par le ministre pour des motifs personnels, et que celui-ci a remis les affaires entre les mains du premier conseiller de légation, qui l'avait déjà fréquemment remplacé, et qu'il en a donné notification, comme cela se pratique habituellement. L'allégation, d'après laquelle S. M. le roi attrait communiqué au chancelier fédéral soussigné la candidature du prince Léopold est également inexacte ; j'avais reçu accidentellement et confidentiellement connaissance, par une des personnes privées qui prenaient part aux négociations, de l'offre espagnole. Si, par conséquent, tous les motifs invoqués par les ministres français pour établir que la guerre était inévitable, s'évanouissent ; s'il est ainsi établi que tous ces motifs sont complètement dénués de fondement, — il ne nous reste malheureusement que la nécessité de rechercher les véritables motifs dans les traditions les plus mauvaises de Louis XIV et du premier Empire, stigmatisées depuis un demi-siècle par les populations et les gouvernements du monde civilisé, qu'un certain parti en France inscrit encore sur sa bannière ; mais auxquelles nous croyions que Napoléon III avait heureusement résisté. Comme causes déterminantes de cc véritable phénomène, nous ne pouvons découvrir malheureusement que les instincts les plus mauvais de la haine et de la jalousie au sujet de l'autonomie et du bien-être de l'Allemagne, joints au désir de tenir terrassée la liberté à l'intérieur en précipitant le pays dans des guerres avec l'étranger. Il est attristant de penser que par une lutte colossale, comme la surexcitation nationale, la grandeur et la puissance des deux pays font entrevoir, le développement pacifique de la civilisation et du bien-être national qui allait sans cesse croissant, sera entravé, empêché pendant plusieurs années. Mais, devant Dieu et devant les hommes, nous devons en rejeter la responsabilité sur ceux qui, par leur attitude criminelle, nous obligent à accepter la lutte pour l'honneur national et la liberté de l'Allemagne. Pour une cause aussi juste, nous pouvons espérer avec confiance en l'aide de la Providence ; de même que nous sommes désormais, grâce aux marques toujours croissantes d'un dévouement empressé, de l'assistance de toutes les nations allemandes et que nous pouvons compter que pour cette guerre, provoquée de propos délibéré et sans droit, la France ne trouvera point d'alliés. BISMARCK. (Archives diplomatiques, 1871-1872, tome Ier)[15]. XI Discours du roi de Prusse à l'ouverture du Reichstag.Berlin, le 19 juillet 1870. Honorés membres du Reichstag de la Confédération de l'Allemagne du Nord, Le jour où, lors de votre dernière réunion, je vous ai souhaité ici la bienvenue au nom des gouvernements confédérés, j'ai pu, avec gratitude mêlée de joie, attester qu'avec l'aide de Dieu, le succès n'avait pas manqué aux efforts faits par moi en vue de répondre aux vœux des peuples et aux besoins de la civilisation en prévenant toute perturbation de la paix. Si néanmoins des menaces de guerre et un danger de guerre ont imposé aux gouvernements confédérés le devoir de vous convoquer en une session extraordinaire, en vous-mêmes, comme en nous, demeurera vivante la conviction que la Confédération de l'Allemagne du Nord s'est appliquée à utiliser la force populaire de l'Allemagne, non pas pour compromettre la paix générale, mais pour lui donner un puissant appui et que si, actuellement, nous faisons appel à cette force populaire pour protéger notre indépendance, nous ne faisons qu'obéir à la voix de l'honneur et du devoir. La candidature d'un prince allemand au trône d'Espagne, candidature à la naissance et à l'abandon de laquelle les gouvernements confédérés sont demeurés également étrangers, et qui, pour la Confédération de l'Allemagne du Nord, n'avait pas d'autre intérêt que celui de voir les gouvernements d'une nation amie y rattacher l'espoir de donner à un pays longtemps éprouvé les garanties d'un gouvernement régulier et pacifique, a fourni au gouvernement de l'empereur des Français le prétexte de poser un cas de guerre d'une façon depuis longtemps inconnue dans les usages diplomatiques, et, après la disparition de ce prétexte, de maintenir un cas de guerre avec un mépris du droit des peuples aux bienfaits de la paix, dont l'histoire des souverains antérieurs de la France offre déjà des exemples. Si, dans les siècles précédents, l'Allemagne a supporté en silence les atteintes portées à son droit et à son honneur, elle ne les a supportées que parce que, dans son déchirement, elle ne savait pas combien elle était forte. Aujourd'hui que le lien d'une union morale et légale, lien que les guerres de l'indépendance ont commencé à établir, unit ensemble, avec une connexité qui sera d'autant plus étroite qu'elle durera plus longtemps, les membres de la famille allemande ; aujourd'hui que les armements de l'Allemagne ne laissent plus de porte ouverte à l'ennemi, l'Allemagne porte en elle-même la volonté et la force de se défendre contre les nouvelles violences de la France. Ce n'est pas l'outrecuidance qui me dicte ces paroles. Les gouvernements confédérés, ainsi que moi-même, agissent dans la pleine conscience que la victoire et la défaite sont entre les mains du Dieu des batailles. Nous avons, d'un regard calme et clair, mesuré la responsabilité qui, devant le jugement de Dieu et des hommes, incombe à celui qui pousse à des guerres de dévastation deux grands et paisibles peuples habitant au mur même de l'Europe. Le peuple allemand et le peuple français, ces deux peuples qui jouissent chacun au même degré des bienfaits de la civilisation chrétienne et d'une prospérité croissante, et qui aspirent à ces bienfaits, sont appelés à une lutte plus salutaire que la hale sanglante des armes. Mais les hommes qui gouvernent la France ont su, par une fausse direction — Missleitung — calculée, exploiter pore leurs intérêts et leurs passions personnelles l'amour-propre — Selbstgefühl — légitime, mais irritable, dut grand peuple qui est notre voisin. Pins les gouvernements confédérés ont la conscience d'avoir fait tout ce que leur honneur et leur dignité leur permettaient de faire pour conserver à l'Europe les bienfaits de la paix, plus il est évident aux yeux de tous que l'on nous a mis le glaive dans la main, et plus grande est la confiance avec laquelle, nous appuyant sur la volonté unanime des gouvernements allemands du Sud, comme des gouvernements du Nord, nous nous adressons au patriotisme et au dévouement du peuple allemand, pour le convier à la défense de son honneur et de son indépendance. Suivant l'exemple de nos pères, nous combattrons pour notre liberté et pour notre droit contre la violence de conquérants étrangers ; et dans ce combat, où nous ne poursuivrons pas d'autre but que celui d'assurer à l'Europe une paix durable, Dieu sera avec nous comme il a été avec nos pères ! (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) XII Le Sourd à M. le comte de Bismarck.Berlin, le 19 juillet 1870. Le soussigné, chargé d'affaires de France, en exécution des ordres qu'il a reçus de son gouvernement, a l'honneur de porter à la connaissance de Son Excellence M. le ministre des Affaires étrangères de S. M. le roi de Prusse la communication suivante : Le gouvernement de S. M. l'empereur des Français, ne pouvant regarder que comme une entreprise dirigée contre la sécurité territoriale de la France le projet d'élever un prince prussien au trône d'Espagne, s'est trouvé dans la nécessité de demander à S. M. le roi de Prusse l'assurance qu'une telle combinaison ne pourrait se réaliser avec son assentiment. S. M. le roi de Prusse s'étant refusé à donner cette assurance, et ayant témoigné au contraire à l'ambassadeur de S. M. l'empereur des Français qu'il entendait se réserver, pour cette éventualité comme pour toute autre, la faculté de consulter les circonstances, le gouvernement impérial a dît voir dans la déclaration du roi une arrière-pensée menaçante pour la France comme pour l'équilibre des forces en Europe. Cette déclaration a été aggravée encore par la notification faite aux Cabinets du refus de recevoir l'ambassadeur de l'empereur et d'entrer dans aucune explication nouvelle avec lui. En conséquence, le gouvernement de Sa Majesté Impériale a jugé qu'il avait l'obligation de pourvoir immédiatement à la défense de son honneur et de ses intérêts compromis ; et résolut à prendre à cet effet toutes les mesures commandées par la situation qui lui est faite, il se considère dès à présent, comme étant en état de guerre avec la Prusse. LE SOURD. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) N. B. — M. Émile Ollivier dit que cette déclaration de guerre fut libellée d'une manière assez maladroite par les commis des Affaires étrangères et ne fut même pas lue au Conseil. Elle rut communiquée uniquement pour la forme et sans discussion aux Assemblées et envoyée à la Prusse le 19 juillet. Au fond, ajoute M. Ollivier, elle ne nous donnait pas l'initiative de l'attaque. Nous l'avions prise à la tribune dès le 15. (L'Empire libéral, t. XIV, p. 500.) XIII Le comte de Bismarck au comte de Bernstorff à Londres.Berlin, le 19 juillet 1870. Le gouvernement impérial français nous a fait remettre par son chargé d'affaires le document officiel de déclaration de guerre, dont copie ci-jointe. C'est la première et la seule communication officielle que nous ayons reçu du gouvernement français dans toute cette affaire qui a occupé le monde depuis quinze jours. Les raisons qui y sont données pour la guerre qui nous est déclarée sont les suivantes : Le refus de S. M. le roi de donner l'assurance que l'avènement au trône d'Espagne d'un prince prussien ne pourra avoir lieu avec son consentement, la prétendue notification faite aux Cabinets du refus de recevoir l'ambassadeur de l'empereur ou d'entrer dans aucune explication nouvelle avec lui. Nous n'avons qu'à répondre ceci : S. M. le roi, respectant complètement la liberté et l'indépendance de la nation espagnole, ainsi que le libre droit de décision des princes de la maison de Hohenzollern, n'a jamais eu la pensée d'élever le prince héréditaire au trône d'Espagne. Les demandes faites à Sa Majesté de promesses pour l'avenir étaient injustifiables et présomptueuses. Attribuer au roi des desseins ultérieurs ou une intention hostile à l'égard de la France, ce n'est qu'une invention gratuite. La prétendue notification aux Cabinets n'a jamais été faite, pas plus que le refus de traiter avec l'ambassadeur de l'empereur. Bien au contraire, l'ambassadeur n'a jamais cherché à entrer dans des négociations officielles avec le gouvernement royal, mais seulement à discuter la question personnellement et secrètement avec Sa Majesté, à Ems. La nation allemande, en dedans et en dehors de la Confédération de l'Allemagne du Nord, considère les demandes du gouvernement français connue tendant à lui infliger une humiliation que la nation ne peut pas supposer, et qu'ainsi la guerre, qui n'était jamais entrée dans les desseins de la Prusse, nous est imposée par la France. Le monde civilisé tout entier verra que les raisons données par la France n'existent pas et ne sont que des prétextes inventés. La Confédération de l'Allemagne du Nord et les gouvernements de l'Allemagne du Sud qui sont alliés avec elle, protestent contre l'invasion non provoquée du territoire allemand et la repousseront par tous les moyens que Dieu a mis en leur pouvoir. Signé : BISMARCK. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) XIV Discours du comte de Bismarck au Reichstag.Berlin, le 20 juillet 1870. Des affaires urgentes étant survenues, je vous prie, messieurs, d'excuser mon retard. Je m'étais proposé de soumettre aujourd'hui au Reichstag la collection des documents qui concernent la guerre, et qui se trouvent en la possession du gouvernement ; mais je ne les ai pas encore entre les mains et les attends d'un moment à l'autre. En attendant, je dois déclarer qu'il est presque sans exemple qu'un événement d'une telle importance européenne se soit accompli et ait été préparé entre les diverses Cours, en donnant lieu à un nombre aussi restreint de ces documents où l'histoire de l'avenir puisera ses informations. En effet, nous n'avons reçu du gouvernement impérial de France qu'une seule pièce officielle : c'est la déclaration de guerre arrivée hier. A notre connaissance, cette déclaration est la première et l'unique note du gouvernement français qui nous ait été communiquée depuis que le ministre français nous a demandé — le 4 ou le 5, je crois — ce que nous savions de l'affaire de la candidature, et que nous lui avons répondu que nous n'en savions rien. Tontes les conversations que M. le comte Benedetti — que celui-ci ait fait valoir ou non sa qualité d'ambassadeur en France — a eues en tête-à-tête, et dans une ville de bains, avec Sa Majesté, mon très gracieux maître, sont, comme le sait toute personne au courant des affaires internationales, des entretiens d'une nature particulière et de nulle valeur pour les relations de gouvernement à gouvernement. Toutes les déclarations personnelles qu'on a essayé
d'arracher à S. M. le roi dans des causeries, sans doute bienveillantes,
déclarations qui peut-être auraient pu être obtenues, si Sa Majesté ne
gardait pas dans sa vie privée sa fermeté de caractère habituelle, n'auraient jamais été des actes politiques, mais seulement
l'expression d'idées personnelles, tant que le monarque ne les aurait pas
confirmées en sa qualité de souverain, et n'eût pas manifesté par là son
désir de leur donner la valeur d'actes politiques. Après avoir fait les remarques préalables au sujet de la déclaration de guerre de la France, je jette un coup d'œil sur les autres documents, qui se composent surtout de communications du ministre des Affaires étrangères, faites à ne moment où ii n'était plus possible de réparer le niai, et dans le but d'expliquer aux mitres gouvernements comment les choses se sont développées. Toutefois ces documents ne sauraient rester dans l'ordre où ils se trouvent maintenant, et je prie M. le Président de permettre que je m'entende avec le Bureau sin la rédaction des imprimés. Parmi ces communications se trouve le fameux télégramme des journaux, télégramme qui, en dernier lieu, a été pour le ministère français l'unique déclaration de la guerre, et que celui-ci n'a pu faire servir au but voulu qu'en le désignant connue une note du gouvernement royal adressé aux autres gouvernements. Je ne veux pas m'engager dans la définition du mot note ; mais ce qui est vrai, c'est que la communication d'un télégramme de journal, destiné à orienter nos représentants auprès des gouvernements allemands et de tous les Cabinets que nous croyons amis, à informer les uns et les autres de l'état actuel des choses et à les convaincre que nos dispositions, au moment où nous pensions être arrivés aux limites tracées par l'honneur national, étaient plus fermes qu'on ne le supposait. C'est qu'une communication de journal a été publiquement qualifiée de note par les ministres français. Ces ministres se sont bien gardés de céder aux instances des rares membres de l'opposition de Paris qui ont gardé leur lucidité d'esprit, et de produire le document en question. (Écoutez ! écoutez !) L'édifice tout entier et surtout la base de la déclaration de guerre se seraient écroulés, si la représentation nationale avait eu connaissance de ce prétendu document et de sa forme. (Très bien ! Bravo !) Ce n'était pas un document, c'était un télégramme servant d'information. Les numéros 2 et 3 sont des expositions déjà publiées par les journaux des événements d'Ems, événements qui, au fond, ne sont pas politiques, mais ont une assez grande importance au point de vue de l'histoire de la situation. Vous les connaissez déjà par les journaux, messieurs, mais leur valeur augmente par le fait que, vu leur origine, ces pièces ont été classées parmi les documents officiels. La quatrième pièce — un rapport adressé de Paris par M. de Werther le 12 juillet — est un document officiel destiné à circuler entre les autorités prussiennes, mais non entre la Prusse et la France. L'ambassadeur fédéral rendait compte dans ce rapport d'un entretien qu'il avait eu avec le ministre des Affaires étrangères et le garde des Sceaux M. Ollivier ; il nous faisait connaître la demande inacceptable que vous connaissez. Le roi devait écrire une lettre d'excuses (rires) dont le contenu était indiqué. Je n'ai répondu officiellement à ce sujet à l'ambassadeur qu'en lui exprimant ma conviction qu'il avait mal compris les communications verbales du ministre français ; qu'il me paraissait absolument impossible que des ouvertures de cc genre eussent été faites (très bien !) et, qu'en tous cas, comme ministre responsable, je me refusais à soumettre son rapport à l'examen de Sa Majesté. (Applaudissements.) Si le gouvernement français croit devoir nous faire des communications de ce genre, il peut les rédiger et nous les faire remettre ici, à Berlin, par son ambassadeur. (Très bien !) La circulaire du 18 juillet, qui portait les pièces dont je viens de parler à la connaissance des gouvernements allemands et autres, est le cinquième document. Le sixième, le septième et le huitième, relatifs à un essai d'intervention fait par un gouvernement ami, celui de la Grande-Bretagne, sont le texte anglais et la traduction d'une lettre écrite le 17 juillet par l'ambassadeur anglais et la réponse du chancelier à cette lettre. Comme cette réponse n'est pas encore connue de la Chambre je m'empresserai de la lire. Vous pourrez vous convaincre, messieurs, que le ministre fédéral des Affaires étrangères, même à ce dernier moment, ne s'est pas départi de sa modération et de ses dispositions pacifiques. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) N. B. — Voir, pour réponse à ces allégations audacieuses du chancelier allemand, le chapitre sur la dépêche d'Ems (tome Ier). XV Adresse du Reichstag au roi de Prusse en réponse au discours du trône.Berlin, le 20 juillet 1870. Très haut, très puissant et très gracieux seigneur ! Les paroles si élevées que Votre Majesté nous a adressées au nom des gouvernements confédérés trouvent dans le peuple allemand un puissant écho. Tous les Allemands n'ont plus dans ce moment solennel qu'une pensée et qu'une volonté. La haute dignité, dont Votre Majesté a fait preuve en rejetant les demandes inouïes de l'ennemi, a rempli la nation d'un joyeux orgueil. Celui qui croyait nous humilier, engage maintenant notre patrie dans une guerre qu'il appuie sur les plus mauvais prétextes. Le peuple allemand n'a pas d'autre désir que de vivre en paix et en bonne amitié avec toutes les nations qui respectent son honneur et son indépendance. Comme au temps glorieux des guerres de l'indépendance, un Napoléon nous force aujourd'hui à combattre pour la cause sainte de notre droit et de notre liberté. Aujourd'hui, comme alors, tous les calculs, fondés sur la méchanceté et la trahison des hommes, seront déjoués par la force morale et la volonté énergique du peuple allemand. La fraction du peuple français que l'ambition et la jalousie égarent appréciera trop tard les tristes résultats que la lutte sanglante qui va s'engager aura pour tous les peuples. La partie sensée de ce peuple n'a pu réussir à empêcher de commettre le crime dirigé contre le bien-être de la France et les relations fraternelles des peuples. C'est une lutte grande et difficile, que celle qui attend le peuple allemand ; celui-ci le sait. Mais nous avons confiance dans la bravoure et le patriotisme de nos frères armés et dans la volonté inébranlable qu'un peuple uni a de sacrifier tous les biens d'ici-bas, plutôt que de souffrir qu'un conquérant étranger fasse courber la tète à un Allemand. Nous avons confiance dans la direction expérimentale du roi, du héros à cheveux blancs, du général allemand auquel la Providence a départi le droit de terminer à la fin de sa vie la grande lutte qu'il a commencée comme adolescent, il y a plus d'un demi-siècle. Nous avons confiance en Dieu dont la justice punit les criminels. Des bords de la mer au pied des Alpes, le peuple s'est levé à l'appel de ses princes réunis par une seule pensée. Aucun sacrifice ne sera trop lourd pour lui. L'opinion publique du inonde civilisé reconnaît la justice de notre cause. Des nations amies regardent notre victoire connue devant les affranchir de la pression qu'exerce sur eux l'ambition bonapartiste et amener l'expiation des injustices dont elles sont victimes. Le champ de bataille où triomphera le peuple allemand sera enfin pour lui le terrain honoré de toutes les nations, sur lequel il fondera sa libre et pacifique unité. Votre Majesté et les gouvernements allemands confédérés nous voient prêts, ainsi que nos frères du Sud. Notre honneur et notre liberté sont en jeu. Il s'agit du repos de l'Europe et du bien-être des peuples. Pénétrés du plus profond respect, nous sommes et serons toujours les plus dévoués et les plus fidèles sujets de Votre Majesté royale. Les membres du Reichstag de la Confédération de l'Allemagne du Nord. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) XVI Le roi de Prusse au roi de Bavière.Berlin, le 20 juillet 1870. A la réception du télégramme de votre ministère, j'ai immédiatement pris le commandement de l'armée bavaroise, que j'ai réunie au troisième corps d'armée placé sons les ordres du prince royal. Par une insolence inouïe, nous avons été jetés de la paix la plus profonde dans la guerre. Votre attitude, vraiment allemande, a électrisé aussi votre peuple. L'Allemagne est unie mieux que jamais. Que Dieu bénisse nos armes dans les hasards de la guerre ! Je vous exprime ma vive reconnaissance du maintien fidèle des traités sur lesquels s'appuie l'Allemagne. Réponse du roi de Bavière.Votre télégramme fait naître en moi l'écho le plus joyeux. Les troupes bavaroises entreprendront la lutte, pleines d'enthousiasme, à côté de leurs glorieux compagnons d'armes, pour l'honneur et les droits de l'Allemagne. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) XVII Ordonnance du roi de Prusse pour fixer un jour de prières.Berlin, le 21 juillet 1870. Par suite d'une agression arbitraire, je suis forcé de dégainer mon épée pour repousser cette agression à l'aide de la puissance dont dispose toute l'Allemagne. Je suis complètement tranquille devant Dieu et devant les hommes de n'en être nullement la cause. J'ai la conscience nette sur l'origine de cette guerre et je suis sûr devant Dieu que notre cause est juste. C'est une lutte sérieuse qui va s'engager ; elle imposera à mon peuple et à toute l'Allemagne d'énormes sacrifices, mais je la commence en élevant mes yeux vers Dieu qui sait tout, et en invoquant son tout-puissant secours. Je dois déjà remercier Dieu de ce qu'au premier bruit de la guerre, un seul sentiment s'est manifesté dans tous les cœurs allemands, celui d'un armement général contre l'agression et celui d'une confiance consolante dans une victoire accordée par Dieu à notre juste cause. Mon peuple va se mettre à côté de moi pendant cette lutte, comme il s'est mis autrefois à côté de mon père reposant en Dieu. C'est en lui que j'ai confiance et je demande à mon peuple d'en faire autant. Je m'incline devant Dieu en reconnaissant sa grâce et je suis sûr que mes sujets et mes compatriotes en font autant que moi. En conséquence, j'ordonne de célébrer une journée de prières extraordinaires, mercredi prochain, 27 juillet, de dire l'office divin aux églises et de s'abstenir de toutes affaires et de tout travail en tant que les circonstances le permettront. J'ordonne également des prières, pendant tout le temps de la guerre, aux offices divins solennels, afin que Dieu nous conduise à la victoire, qu'il nous accorde sa grâce pour que nous agissions en chrétiens même contre nos ennemis et qu'il nous permette d'arriver à une paix durable conforme à l'honneur et à l'indépendance de l'Allemagne. GUILLAUME. Au ministre des Cultes, de Mulher. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) N. B. — Le Conseil du 15 mars 1870, auquel le roi de Prusse se garde bien de faire allusion, avait envisagé aussi bien les intérêts politiques de la Prusse que les intérêts de l'Espagne. — H. W. XVIII Dépêche circulaire adressée par le duc de Gramont aux représentants de la France à l'étranger.Paris, 21 juillet 1870. Monsieur, Vous connaissez déjà l'enchaînement des faits qui nous ont conduits à une rupture avec la Prusse. La communication que le gouvernement de l'empereur a portée, le 15 de ce mois, à la tribune des grands corps de l'État et dont je vous ai envoyé le texte, a exposé à la France et à l'Europe les rapides péripéties d'une négociation dans laquelle, à mesure que nous redoublions nos efforts pour conserver la paix, se dévoilaient les secrets desseins d'un adversaire résolu à la rendre impossible. Soit que le Cabinet de Berlin ait jugé la guerre nécessaire pour l'accomplissement des projets qu'il préparait de longue date contre l'autonomie des États allemands, soit que, peu satisfait d'avoir établi au centre de l'Europe une puissance militaire devenue redoutable à tous ses voisins, il ait voulu mettre à profit la force acquise pour déplacer définitivement à son avantage l'équilibre international, l'intention préméditée de nous refuser les garanties les plus indispensables à notre sécurité aussi bien qu'à votre honneur, se montre avec la dernière évidence dans toute sa conduite. Voici, à n'en pas douter, quel a été le plan combiné contre nous. Une entente préparée mystérieusement par des intermédiaires inavoués devait, si la lumière n'eût été faite avant l'heure, mener les choses jusqu'au point on la candidature d'un prince prussien à la couronne d'Espagne aurait été soudainement révélée aux Cortès assemblées. Un vote enlevé par surprise avant que le peuple espagnol eût eu le temps de la réflexion, proclamait — on l'a espéré du moins le prince Léopold de Hohenzollern héritier du sceptre de Charles-Quint. Ainsi, l'Europe se serait trouvée en présence d'un fait accompli, et, spéculant sur notre déférence pour le grand principe de la souveraineté populaire, on comptait que la France, malgré un déplaisir passager, s'arrêterait /devant la volonté ostensiblement exprimée d'une nation pour laquelle on sait toutes nos sympathies. Dès qu'il a été instruit du péril, le gouvernement de l'empereur n'a pas hésité à le dénoncer aux représentants du pays comme à tous les Cabinets étrangers. Contre cette manœuvre, le jugement public de l'opinion devenait son plus légitime auxiliaire. Les esprits impartiaux ne se sont trompés nulle part sur la véritable situation des choses ; ils ont vite compris que si nous étions péniblement affectés de voir tracer à l'Espagne, dans l'intérêt exclusif d'une dynastie ambitieuse, un rôle si peu fait pour la loyauté de ce peuple chevaleresque, si peu conforme aux instincts et aux traditions d'amitié qui l'unissent à nous, nous ne pouvions avoir la pensée de démentir notre constant respect pour l'indépendance de ses résolutions nationales. On a senti que la politique peu scrupuleuse du gouvernement prussien était ici seule en jeu. C'est ce gouvernement, en effet, qui, ne, se croyant pas lié par le droit commun et méprisant les règles auxquelles les plus grandes puissances ont eu la sagesse de se soumettre, a tenté d'imposer à l'Europe abusée une extension si dangereuse de son influence. La France a pris en main la cause de l'équilibre, c'est-à-dire la cause de tous les peuples menacés comme elle par l'agrandissement disproportionné d'une maison royale. En agissant ainsi, se plaçait-elle, comme on a voulu le faire croire, en contradiction avec ses propres maximes ? Assurément non. Toute nation, nous aimons à le proclamer, est maîtresse de ses destinées. Ce principe, hautement affirmé par la France, est devenu l'une des lois fondamentales de la politique moderne. Mais le droit de chaque peuple, comme de chaque individu, est limité par le droit d'autrui, et il est interdit à une nation, sons prétexte d'exercer sa souveraineté propre, de menacer l'existence ou la sécurité d'un peuple voisin. C'est dans ce sens qu'un de nos grands orateurs, M. de Lamartine, disait en 1847, que lorsqu'il s'agit du choix d'un souverain, un gouvernement n'a jamais le droit de prétendre et a toujours le droit d'exclure. Cette doctrine a été admise par tous les Cabinets, dans les circonstances analogues à celles où nous a placés la candidature du prince de Hohenzollern, notamment en 1831 dans la question belge ; en 1830 et en 1852 dans la question hellénique. Dans les affaires belges, c'est la voix de l'Europe elle-même qui s'est fait entendre, car ce sont les cinq grandes puissances qui ont décidé. Trois Cours qui avaient pris en main la cause du peuple hellène, s'inspirant d'une pensée d'intérêt général, étaient convenues déjà entre 'elles de ne point accepter le trône de Grèce pour un prince de leur famille. Les Cabinets de Paris, de Londres, de Vienne, de Berlin et de Saint-Pétersbourg, représentés dans la Conférence de Londres, s'approprièrent cet exemple ; ils en firent une règle de conduite pour tous dans une négociation où était engagée la paix du monde, et rendirent ainsi un solennel hommage à cette grande loi de la pondération des forces qui est la base du système politique européen. Vainement, le congrès national de Belgique persista, malgré cette résolution, à élire le duc de Nemours. La France se soumit à l'engagement qu'elle avait pris et refusa la couronne apportée à Paris par les députés belges. Mais elle imposa, à son tour, la nécessité qu'elle subissait en frappant d'exclusion la candidature du duc de Leuchtenberg, que l'on avait opposée à celle du prince français. En Grèce, lors de la dernière vacance du trône, le gouvernement de l'empereur combattait à la fois la candidature du prince Alfred d'Angleterre et celle d'un autre duc de Leuchtenberg. L'Angleterre, reconnaissant l'autorité des considérations invoquées par nous, déclara, à Athènes, que la reine n'autoriserait pas son fils à accepter la couronne de Grèce. La Russie fit une déclaration semblable pour le duc de Leuchtenberg, bien qu'à raison de sa naissance ce prince ne fût pas considéré absolument par elle, comme membre de la famille impériale. Enfin, l'empereur Napoléon a spontanément appliqué les mêmes principes dans une note insérée au Moniteur du lei septembre 1860, pour désavouer la candidature du prince Murat au trône de Naples. La Prusse, à qui nous n'avons pas manqué de rappeler ces précédents, a paru un moment céder à nos justes réclamations. Le prince Léopold s'est désisté de sa candidature ; on a pu se flatter que la paix ne serait pas troublée. Mais cet espoir a bientôt fait place à des appréhensions nouvelles, puis à la certitude que la Prusse, sans retirer sérieusement aucune de ses prétentions, cherchait seulement à gagner du temps. Le langage d'abord hésitant, puis décidé et hautain du chef de la maison de Hohenzollern, son refus de s'engager à maintenir le lendemain la renonciation de la veille, le traitement infligé à notre ambassadeur, auquel un message verbal a interdit toute communication nouvelle pour l'objet de sa mission de conciliation, enfin la publicité donnée à ce procédé insolite par les journaux prussiens et par la notification qui en a été faite aux Cabinets, tous ces symptômes successifs d'intentions agressives ont fait cesser le doute dans les esprits les plus prévenus. L'illusion est-elle permise, quand un souverain qui commande à un million de soldats, déclare, la main sur la garde de son épée, qu'il se réserve de prendre conseil de lui seul et des circonstances ? Nous étions amenés à cette limite extrême où une nation qui sent ce qu'elle se doit ne transige plus avec les exigences de son honneur. Si les derniers incidents de ce pénible débat ne jetaient pas une assez vive lumière sur les projets nourris par le Cabinet de Berlin, il est une circonstance, moins connue jusqu'à ce jour, qui donne à sa conduite une signification décisive. L'idée d'élever au franc d'Espagne un prince de Hohenzollern n'est pas nouvelle. Déjà, au mois de mars 1869, elle avait été signalée par notre ambassadeur à Berlin, qui était aussi invité à faire savoir au comte de Bismarck continent le gouvernement de l'empereur envisagerait une éventualité semblable. M. le comte Benedetti, dans plusieurs entretiens qu'il avait eus à ce sujet, soit avec le chancelier de la Confédération de l'Allemagne du Nord, soit avec le sous-secrétaire d'État chargé de la direction des Affaires étrangères, n'avait pas laissé ignorer que nous ne pourrions admettre qu'un prince prussien vint à régner au delà des Pyrénées. Le comte de Bismarck, de son côté, avait déclaré que nous ne devions nullement nous préoccuper d'une combinaison que lui-même jugerait irréalisable, et en l'absence du chancelier fédéral, dans un moment où M. Benedetti avait cru devoir se montrer incrédule et pressant, M. de Thile avait engagé sa parole d'honneur que le prince de Hohenzollern n'était pas et ne pouvait pas devenir un candidat sérieux à la couronne d'Espagne. Si l'on devait suspecter la sincérité d'assurances officielles aussi positives, les communications diplomatiques cesseraient d'être un gage de paix européenne ; elles ne seraient plus qu'un piège on un danger. Aussi, bien que notre ambassadeur transmit ces déclarations sous toutes réserves, le gouvernement de l'empereur avait-il jugé convenable de les accueillir favorablement. Il s'était refusé à en révoquer en doute la bonne foi, jusqu'au jour où s'est révélée tout d'un coup la combinaison qui en était la négation éclatante. En revenant inopinément sur la parole qu'elle nous avait donnée, sans même tenter aucune démarche pour se dégager envers nous, la Prusse nous adressait ne véritable défi. Éclairés dès lors sur la valeur que pouvaient avoir les protestations les plus formelles des hommes d'Etat prussiens, nous avions le devoir impérieux de préserver, dans l'avenir, notre loyauté contre de nouveaux mécomptes par une garantie explicite. Nous devions clone insister connue nous l'avons fait, pour obtenir la certitude qu'une renonciation qui ne se présentait qu'entourée de distinctions subtiles, était, cette fois, définitive et sérieuse. Il est juste que la cour de Berlin ait devant l'histoire la responsabilité de cette guerre, qu'elle avait les moyens d'éviter et qu'elle a voulue. Et dans quelles circonstances a-t-elle recherché la lutte ? C'est lorsque, depuis quatre ans, la France, lui donnant le témoignage d'utile modération constante, s'est abstenue, avec tin scrupule peut-être exagéré, d'invoquer contre elle des traités conclus sous la médiation même de l'empereur, mais dont l'oubli volontaire ressort de tous les actes d'un gouvernement qui songeait déjà à s'en affranchir au moment où il y souscrivait. L'Europe a été témoin de notre conduite, et elle a pu la comparer à celle de la Prusse pendant le cours de cette période. Qu'elle prononce aujourd'hui sur la justice de notre cause ! Quel glue doive être le sort des batailles, nous attendons sans inquiétude le jugement de nos contemporains, comme celui de la postérité. Recevez, etc. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) XIX Dépêche circulaire adressée par le duc de Gramont aux représentants de la France à l'étranger.Paris, le 24 juillet 1870. Monsieur, Le Cabinet de Berlin a fait publier, au sujet des négociations d'Ems, divers documents au nombre desquels se trouve une dépêche de M. le baron de Werther, rendant compte d'une conversation que nous avons eue ensemble durant son dernier séjour à Paris. Ces pièces ne représentent pas, sous son véritable aspect, la marche suivie par le gouvernement de l'empereur dans ces circonstances. et le rapport de M. de Werther m'attribue notamment des paroles que je crois de mon devoir de rectifier sur plusieurs points. M. l'ambassadeur de Prusse, dans notre entretien, s'est particulièrement étendu avec moi sur cette considération que le roi, en autorisant la candidature du prince de Hohenzollern, n'avait jamais eu l'intention de blesser l'empereur et n'avait jamais supposé que cette combinaison pût porter ombrage à la France. J'ai fait observer à mon interlocuteur que s'il en était ainsi, une pareille assurance donnée serait de nature à faciliter l'accord que nous recherchions. Mais je n'ai point demandé que le roi écrivît une lettre d'excuses, comme l'ont prétendu les journaux de Berlin dans leurs commentaires officieux[16]. Je ne sautais non plus souscrire aux appréciations que M. le baron de Werther me prête au sujet de la déclaration du 6 juillet. Je n'ai point admis que cette manifestation aurait été déterminée par des nécessités parlementaires. J'ai expliqué notre langage par la vivacité de la blessure que nous avions reçue et je n'ai nullement fait valoir la position personnelle des ministres comme motif déterminant de leur conduite. Ce que j'ai dit, c'est qu'aucun ministère ne pouvait conserver en France la confiance des Chambres et de l'opinion en consentant à un arrangement qui ne contînt pas une garantie sérieuse pour l'avenir. Je dois ajouter, contrairement au récit de M. de Werther, que je n'ai point séparé l'empereur de la France. Bien dans nies paroles n'a pu autoriser le représentant de la Prusse à supposer qu'une étroite solidarité d'impressions ne régnât pas entre le souverain et la nation tout entière. Ces réserves faites, j'arrive au reproche principal qu'élève contre nous le Cabinet de Berlin. Nous aurions volontairement, a-t-on dit, porté la discussion auprès du roi de Prusse, au lien de l'engager avec son gouvernement. Mais lorsque, le 4 juillet, suivant mes instructions, notre chargé d'affaires s'est présenté chez M. de Thile pour l'entretenir des nouvelles qui nous étaient parvenues d'Espagne, quel a été le langage de M. le sous-secrétaire d'État ? Selon ses expressions mêmes, le gouvernement prussien ignorait complètement cette affaire, et elle n'existait pas pour lui. En présence de l'attitude du Cabinet qui affectait de se désintéresser de l'incident pour le considérer comme regardant uniquement la famille royale de Prusse, que pouvions-nous faire, sinon nous adresser au roi lui-- même ? C'est ainsi que, contre notre volonté, nous avons dit inciter notre ambassadeur à se mettre en communication avec le souverain, au lieu de traiter avec son ministre. J'ai assez longtemps résidé dans les Cours européennes pour savoir combien ce mode de négociation est désavantageux, et tous les Cabinets ajouteront foi à mes paroles, quand j'affirmerai que nous. avons suivi cette voie uniquement parce que toutes les autres nous étaient fermées. Nous regrettons que M. le comte de Bismarck, aussitôt qu'il a connu la gravité du débat, ne se soit pas rendu à Ems pour reprendre son rôle naturel d'intermédiaire entre le roi et notre ambassadeur, mais l'isolement dans lequel Sa Majesté a sans doute voulu rester, et que le chancelier a vraisemblablement trouvé bon pour ses desseins, est-ce nous qui en sommes responsables ? Et si, comme le fait remarquer le Cabinet de Berlin, la déclaration de guerre qui lui a été remise par notre chargé d'affaires constitue notre première communication écrite et officielle, à qui donc en est la faute ? Adresse-t-on des notes aux souverains ? Notre ambassadeur pouvait-il se permettre une telle dérogation aux usages, quand il traitait avec le roi, et l'absence de tout document échangé entre les deux gouvernements, avant la déclaration de guerre, n'est-elle pas la conséquence nécessaire de l'obligation où l'on cons a mis de suivre la discussion à Ems au lieu de la laisser à Berlin, où nous l'avions d'abord portée ? Avant de clore ces rectifications, je relèverai une dernière observation du Cabinet prussien. D'après un télégramme de Berlin, publié par les journaux du 23, MM. de Bismarck et de Thile, contestant ne passage de nia dépêche circulaire du 21 juillet, déclareraient que depuis le jour où ils ont entendu parler de la demande adressée au prince de Hohenzollern, la question de la candidature du prince au trône d'Espagne n'a jamais été entre eux et M. Benedetti l'objet du moindre entretien, soit officiel, soit particulier. Dans la forme où elle se produit, cette affirmation est ambiguë ; elle semble se référer uniquement aux rapports de notre ambassadeur avec le ministère prussien, postérieurs à l'acceptation du prince Léopold. En ce sens, elle ne serait pas contraire à ce que nous avons dit cons-mêmes : mais si l'on prétend l'étendre aux communications antérieures, elle cesse d'être vraie, et pour l'établir, je ne puis mieux faire que de citer ici une dépêche, en date du 31 mars 1869, adressée par notre ambassadeur M. le comte Benedetti, à M. le marquis de la Valette, alors ministre des Affaires étrangères. Berlin, 31 mars 1869. Monsieur le Marquis, Votre Excellence m'a invité hier, par le télégraphe, à m'assurer si la candidature du prince de Hohenzollern au trône d'Espagne avait tin caractère sérieux. J'ai en ce matin l'occasion de voir M. de 'l'hile, et j'ai cru pouvoir lui demander si je devais attacher quelque importance aux bruits qui avaient circulé à ce sujet. Je ne lui ai pas caché que je tenais à être exactement informé, en lui faisant remarquer qu'une pareille éventualité intéressait trop directement le gouvernement de l'empereur pour qu'il ne fût pas de mon devoir d'en signaler les dangers dans le cas où il existerait des raisons de croire qu'elle peut se réaliser. J'ai dit à mon interlocuteur que mon intention était de vous faire part de mon entretien. M. de Thile m'a donné l'assurance la plus formelle qu'il n'a, à aucun moment, eu connaissance d'une indication quelconque pouvant autoriser une semblable conjecture, et que le ministre d'Espagne à Vienne, pendant le séjour qu'il a fait à Berlin, n'y aurait pas même fait allusion. Le sous-secrétaire d'État, en s'exprimant ainsi, et sans que rien dans ce que je lui disais frit de nature à provoquer une pareille manifestation, a cru devoir engager sa parole d'honneur. Suivant lui, M. Rands se serait borné à entretenir le comte de Bismarck, qui tenait peut-être à profiter du passage de ce diplomate pour se renseigner sur l'état des choses en Espagne, de la manière dont elles s'engageaient en ce qui concerne le choix du futur souverain. Voilà, en substance ce que M. de l'hile m'a appris, en revenant à plusieurs reprises sur sa première déclaration qu'il n'avait été et qu'il ne saurait être question du prince de Hohenzollern pour la couronne d'Espagne. Veuillez agréer, monsieur le marquis, l'assurance de ma haute considération. Signé : BENEDETTI. Après cette citation, je crois superflu d'entrer dans plus de développements sur un point que nous devons considérer comme définitivement acquis[17]. GRAMONT. XX Lettre du Pape au roi de Prusse.Majesté, Dans les graves circonstances où nous nous trouvons, il vous paraîtra peut-être insolite de recevoir une lettre de moi ; mais Vicaire sur la terre du Dieu de paix, je ne puis faire moins que de vous offrir ma médiation. Mon désir est de voir disparaître les préparatifs de guerre et d'empêcher les maux qui en sont la conséquence inévitable. Ma médiation est celle d'un souverain qui, en sa qualité de roi, ne peut inspirer aucune jalousie en raison de l'exiguïté de son territoire, mais qui pourtant inspirera confiance par l'influence morale et religieuse qu'il personnifie. Que Dieu exauce mes vœux et qu'il exauce aussi ceux que je forme pour Votre Majesté, à laquelle je désire être uni par les liens de la même charité. Plus P. P. IX. Du Vatican, le 22 juillet 1870. P.-S. — J'ai écrit également à Sa Majesté l'empereur des Français. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) XXI Lettre du roi de Prusse au Pape.Berlin, le 30 juillet 1870. Très Auguste Pontife, Je n'ai pas été surpris, mais profondément ému, en lisant les paroles touchantes tracées par votre main pour faire entendre la voix du Dieu de la paix. Commuent mon cœur pourrait-il ne pas écouter un appel aussi puissant ? Dieu m'est témoin que ni moi ni mon peuple n'avons désiré ni provoqué la guerre. En obéissant aux devoirs sacrés que Dieu impose aux souverains et aux nations, nous prenons l'épée pour défendre l'indépendance et l'honneur de la patrie, et nous serons toujours prêts à la déposer dès que ces biens pourront être sauvegardés. Si Votre Sainteté pouvait m'offrir, de la part de celui qui, si inopinément, a déclaré la guerre, l'assurance de dispositions sincèrement pacifiques et des garanties contre le retour d'une semblable atteinte à la paix et à la tranquillité de l'Europe, ce ne sera certainement pas moi qui refuserai de les recevoir des mains vénérables de Votre Sainteté, uni comme je suis avec Elle par des liens de la charité chrétienne et d'une sincère amitié. GUILLAUME. (Archives diplomatiques,
1811-1872, tome Ier.) XXII Proclamation de Napoléon III au peuple français.22 juillet 1870. Français, Il y a dans la vie des peuples des moments solennels où l'honneur national, violemment excité, s'impose comme une force irrésistible, domine tous les intérêts et prend seul en main la direction des destinées de la Patrie. Une de ces heures décisives vient de sonner pour la France. La Prusse, à qui nous avons témoigné, pendant et depuis la guerre de 1866, les dispositions les plus conciliantes, n'a tenu aucun compte de notre bon vouloir et de notre longanimité. Lancée dans une voie d'envahissement, elle a éveillé toutes les défiances, nécessité partout des armements exagérés et fait de l'Europe un camp où règne l'incertitude et la crainte du lendemain. Un dernier incident est venu révéler l'instabilité des rapports internationaux et montrer toute la gravité de la situation. En présence de nouvelles prétentions de la Prusse, nos réclamations se sont fait entendre. Elles ont été éludées et suivies de procédés dédaigneux. Notre pays a ressenti une profonde irritation et aussitôt un cri de guerre a retenti d'un bout de la France à l'autre. Il ne nous reste plus qu'à confier nos destinées au sort des armes. Nous ne faisons pas la guerre à l'Allemagne dont nous respectons l'indépendance. Nous faisons des vœux pour que les peuples qui composent la grande nationalité germanique disposent librement de leurs destinées. Quant à nous, nous réclamons l'établissement d'un état de choses qui garantisse et assure l'avenir. Nous voulons conquérir une paix durable, basée sur les vrais intérêts des peuples, et faire cesser cet état précaire où toutes les nations emploient leurs ressources à s'armer les unes contre les autres. Le glorieux drapeau que nous déployons encore une fois devant ceux qui nous provoquent est le même qui porta à travers l'Europe les idées civilisatrices de notre grande Révolution. Il représente les mêmes principes. Il inspirera les mêmes dévouements. Français, Je vais me mettre à la tête de cette vaillante armée qu'anime l'amour du devoir et de la patrie. Elle sait ce qu'elle vaut, car elle a vu dans les quatre parties du monde la victoire s'attacher à ses pas. J'emmène mon fils avec moi malgré son jeune âge. Il sait quels sont les devoirs que son nom lui impose, et il est fier de prendre sa part dans les dangers de ceux qui combattent pour la patrie. Dieu bénira nos efforts. Un grand peuple qui défend une cause juste est invincible. NAPOLÉON. XXIII Proclamation de l'empereur à l'armée.Metz, le 28 juillet 1870. Soldats, Je viens me mettre à votre tête pour défendre l'honneur et le sol de la patrie. Vous allez combattre une des meilleures armées de l'Europe, mais d'autres, qui valaient autant qu'elle, n'ont pu résister à votre bravoure. Il en sera de même aujourd'hui. La guerre qui commence sera longue et pénible, car elle aura pour théâtre des lieux hérissés d'obstacles et de forteresses ; mais rien n'est au-dessus des efforts persévérants des soldats d'Afrique, de Crimée, de Chine, d'Italie et du Mexique. Vous prouverez une fois de plus ce que peut une année française, animée du sentiment du devoir, maintenue par la discipline, enflammée par l'amour de la Patrie. Quel que soit, le chemin que nous prenions hors de nos frontières, nous y trouverons les traces glorieuses de nos pères. Nous nous montrerons dignes d'eux. La France entière vous suit de ses vœux ardents et l'univers a les yeux sur vous ; de nos succès dépend le sort de la liberté et de la civilisation. Soldats, que chacun fasse son devoir et le Dieu des armées sera avec vous. NAPOLÉON. XXIV Proclamation du roi de Prusse.Berlin, le 25 juillet 1870. De toutes les races qui habitent la patrie allemande, de toutes les classes du peuple, en deçà comme au delà de l'Océan, j'ai reçu de la part de communes, de corporations, de sociétés et de particuliers, à l'occasion de la lutte pour la défense de l'honneur et de l'indépendance de l'Allemagne qui va s'engager, des preuves si nombreuses de dévouement et d'abnégation, que c'est pour moi un besoin de porter publiquement témoignage de cet accord des esprits allemands et de joindre à l'expression de mon royal remerciement l'assurance que je rends au peuple allemand fidélité pour fidélité et que je resterai constant dans mes sentiments. L'amour pour la commune patrie et le soulèvement unanime des races allemandes et de leurs princes ont concilié toutes les opinions et fait disparaître toutes les dissidences. Unie comme elle ne l'a sans doute jamais été, l'Allemagne doit trouver dans son unanimité comme dans son droit la garantie que la guerre lui procurera une paix durable et que de cette sanglante semence sortira une moisson bénie de Dieu : la liberté et l'unité de l'Allemagne. (Archives diplomatiques, 1871-1872, tome Ier). XXV Proclamation du roi de Prusse au peuple prussien.Berlin, le 31 juillet 1870. A mon peuple, En me rendant aujourd'hui à l'armée, afin de combattre pour l'honneur de l'Allemagne et pour la conservation de nos biens les plus précieux, je veux, en considération de l'élan unanime de mon peuple, accorder une amnistie pour tous les crimes et délits politiques. J'ai chargé le ministre d'État de me soumettre un décret à cet effet. Mon peuple sait comme moi, que la rupture de la paix, ni aucune provocation à la guerre ne sont certainement venues de notre côté. Mais provoqués, nous sommes décidés comme nos pères, en mettant notre ferme confiance en Dieu, à soutenir la bitte pour le salut de la patrie. GUILLAUME. XXVI Proclamation du roi de Prusse à l'armée.Mayence, le 2 août 1870. Soldats, Toute l'Allemagne animée par le même sentiment se trouve sous les armes contre un État voisin qui nous a déclaré la guerre sans motif et par surprise. Il s'agit de la défense de notre patrie et de nos foyers menacés. Je prends le commandement de nos armées réunies et je vais marcher contre un adversaire qu'un jour nos pères ont combattu glorieusement dans la même situation. L'attention pleine de confiance de toute la patrie ainsi que la mienne, est fixée sur vous. Dieu sera avec notre juste cause. GUILLAUME. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) XXVII Ordre du jour du prince Frédéric-Charles.Quartier général, Hambourg, le 6 août 1870. Soldats de la deuxième armée ! Vous mettez le pied sur le sol français. Sans aucune raison, l'empereur Napoléon a déclaré la guerre à l'Allemagne, et son armée est notre ennemie. Le peuple français n'a pas été consulté sur son intention de faire une guerre sanglante aux Allemands, ses voisins ; par conséquent, nous n'avons aucun motif d'être ses ennemis. N'oubliez pas de prouver aux habitants paisibles de la France que ; dans notre siècle, deux peuples civilisés, même à la guerre, savent respecter les droits de l'humanité. Montrez aux Français que le peuple allemand est non seulement grand et brave, mais aussi civilisé et généreux vis-à-vis de l'ennemi. FRÉDÉRIC-CHARLES, prince de Prusse. (Archives diplomatiques,
1871-1872, tome Ier.) XXVIII Proclamation de l'impératrice régente.Paris, le 7 août 1870. Français, Le début de la guerre ne nous est pas favorable ; nos armes ont subi un échec ; soyons fermes dans ce revers, et hâtons-nous de le réparer. Qu'il n'y ait parmi nous qu'un seul parti, celui de la France ; qu'un seul drapeau, celui de l'honneur national. Je viens au milieu de vous, fidèle à ma mission et à mon devoir ; vous me verrez la première au danger pour défendre le drapeau de la France. J'adjure tous les bons citoyens de maintenir l'ordre. Le troubler serait conspirer avec nos ennemis. Palais des Tuileries, 7 août, onze heures du matin. EUGÉNIE. XXIX Proclamation du roi de Prusse à son armée.Hambourg, le 8 août 1870. Soldats, Déjà une grande partie de notre armée, occupée à poursuivre l'ennemi refoulé après de sanglants combats, a passé la frontière. Aujourd'hui et demain, plusieurs corps d'année vont entrer sur le territoire français. J'attends de vous que vous tiendrez à honneur de vous signaler en pays ennemi, surtout par l'excellente discipline dont jusqu'à ce jour vous avez donné le glorieux exemple. Nous ne faisons pas la guerre aux habitants paisibles de la France et le premier devoir d'un soldat loyal est de protéger la propriété privée, de ne pas souffrir que la haute réputation de notre armée soit atteinte, ne fût-ce que pour un fait isolé de manque de discipline. Je compte sur l'esprit élevé qui anime l'armée. Je ne compte pas moins sur la sévérité et la circonspection de tous les chefs. GUILLAUME. (Archives diplomatiques,
1871-72, tome Ier.) XXX PROCLAMATION DU PRINCE ROYAL DE PRUSSEHABITANTS DE LA LORRAINE Nancy, le 18 août 1870. L'Allemagne fait la guerre à l'empereur des Français et non aux Français. — La population n'a pas à craindre qu'on prenne des mesures hostiles. Je m'occupe de rendre à la nation et spécialement à la ville de Nancy les moyens de circulation interrompue par l'armée française. J'espère que l'industrie et le commerce vont être rétablis et que toutes les autorités resteront à leur place. Je ne demande pour la nourriture de l'armée que le surplus des provisions qui n'est pas nécessaire pour la nourriture de la population française. La nation paisible, et principalement la ville de Nancy, doivent compter sur les plus grands ménagements. Le commandant de la 3e armée, FREDÉRIC-GUILLAUME, prince royal de Presse. (Archives diplomatiques,
1871-12, t. II.) XXXI Le comte de Granville à lord Lyons, à Paris.Foreign-Office, 10 août 1870. Mylord, l'ambassadeur de Prusse m'a plusieurs fois entretenu de divers bruits sur lesquels il a cherché à se renseigner auprès de moi. Le premier est qu'un traité avait été conclu entre la France et l'Italie, en vertu duquel cette dernière devait fournir à la France cent mille hommes et aurait obtenu le droit d'occuper Rome après la paix. J'ai dit au comte de Bernstorff que je ne croyais pas à l'existence d'un pareil traité ; que le gouvernement italien avait communiqué à celui de la reine qu'il avait reçu une telle demande de la France et qu'il désirait obtenir l'aide du gouvernement de Sa Majesté britannique pour résister à cette pression. Sur la réponse que, quoique ce ne fût pas la politique actuelle de l'Angleterre de prendre des engagements positifs pour une neutralité combinée, cependant elle serait prête, si par là elle pourrait aider l'Italie à résister à cette pression extérieure, à s'accorder avec l'Italie, pour que ni l'une ni l'autre n'abandonnassent la neutralité sans un échange d'idées, et sans s'annoncer réciproquement tout changement de politique. Le gouvernement a donné son assentiment chaleureux à cet arrangement. Un autre bruit était la négociation d'une alliance entre la France et l'Autriche combinée avec une organisation armée de la Gallicie. J'ai annoncé au comte de Bernstorff que j'avais cru nécessaire d'avertir le gouvernement autrichien que beaucoup de circonstances avaient créé des soupçons sur la neutralité dans l'esprit des gouvernements russe et prussien ; mais que j'avais reçu du gouvernement autrichien l'assurance qu'il était libre de tout engagement et qu'il serait prêt à se concerter avec le gouvernement de Sa Majesté pour une neutralité continue. Quant au troisième bruit du traité secret signé à Vienne entre la France, l'Autriche, l'Italie et la Turquie pour se garantir mutuellement leurs territoires et pour se réunir à la France dans le cas de revers essuyés par cette dernière, je ne pouvais que dire que je n'en avais aucune connaissance et que je ne croyais pas qu'un tel traité eût été signé. Le comte de Bernstorff a aussi appelé mon attention sur le Danemark que la Prusse craint de voir engagé dans cette guerre par la pression de la France ; le roi de Danemark désire être soutenu contre cette pression, et le Cabinet de Saint-Pétersbourg désirait faire, de concert avec l'Angleterre, une démarche en commun à Paris à cette fin. Mais j'ai rappelé à Son Excellence que je lui avais déjà trois fois suggéré combien il serait désirable que la Prusse enlevât au Danemark, par un arrangement amical, la tentation de céder aux sollicitations de la France, et j'ai ajouté que, la semaine dernière, j'avais obtenu l'autorisation du Cabinet de faire dire au baron Brunnow que je serais prêt à me concerter avec lui sur le temps et la manière de faire une représentation à la France pour l'engager à ne pas pousser le Danemark à une politique tellement contraire aux intérêts de ce pays. Je suis... Signé : GRANVILLE. (Archives diplomatique,
1871-1872, tome Ier.) N. B. — Ce n'est que le 19 juillet que le gouvernement français avait eu l'idée de s'adresser au Danemark et avait confié cette mission au duc de Cadore. Notre ministre arriva trop tard, le 3 août. Quoique plein de bonne volonté pour notre cause, le Danemark, en raison de sa faiblesse et des menaces dont il était l'objet de la part de l'Angleterre comme de la Prusse, ne put agir et fut forcé de se réfugier dans la neutralité. Et cependant la population danoise, ennemie de la Prusse, avait offert 30.000 hommes, auxquels 30.000 Français réunis auraient été de force à s'emparer de Kiel et à marcher sur Hambourg. L'expédition devait être confiée au prince Napoléon, mais l'opposition formelle de l'amiral Rigault de Genouilly qui refusa d'accorder au prince la hante main sur la Hotte, fut une des causes de l'échec de l'expédition. H. W. XXXII CAPITULATION DE SEDANCONSEIL D'ENQUÊTE DES CAPITULATIONS Extrait du procès-verbal de la séance du 4 janvier 1871. Le conseil d'enquête, Vu le dossier relatif à la capitulation de la place de Sedan ; Vu le texte de la capitulation ; Sur le rapport qui lui en a été fait ; Ouï MM. les généraux de division : de Wimpffen, ex-commandant en chef de l'armée de Châlons ; Lebrun, ex-commandant en chef du 19e corps de ladite armée ; Ducrot, ex-commandant en chef du 1er corps de ladite armée ; Donay, ex-commandant en chef du 7e corps de ladite armée ; Après en avoir délibéré ; Exprime comme suit son avis motivé sur la capitulation de la place de Sedan : Sans se préoccuper des causes plus politiques que militaires qui, après la réorganisation encore fort incomplète de l'armée de Châlons, ont déterminé le gouvernement de la Régence à prescrire l'expédition très dangereuse tentée par cette armée pour secourir le maréchal Bazaine, le Conseil n'a pas non plus à apprécier la manière dont cette expédition a été conduite, jusqu'au moment on, par suite de sa blessure, le maréchal de Mac-Mahon, qui en avait le commandement, le remit au général Ducrot, l'un de ses lieutenants. Les troupes de l'armée de Châlons, déjà peu sûres d'elles-mêmes à leur départ du camp, avaient éprouvé des retards dans leur marche par suite de l'incertitude dans le plan de campagne et de l'irrégularité dans les distributions. Les mauvais temps qui les assaillirent, les surprises de l'ennemi, la défaite du 5e corps leur portèrent une atteinte morale qui les avait singulièrement affaiblies et ébranlées ; aussi, faut-il bien le constater, elles arrivèrent assez en désordre à Sedan. Le général Ducrot, aminci le maréchal remit le commandement après sa blessure, se rendait compte de la situation, et voyant le danger que courait l'armée française en se laissant enserrer dans Sedan, prescrivit aussitôt des dispositions de retraite sur Mézières, seule direction dont la route lui paraissait libre en cet instant. Mais à peine une heure s'était-elle passée et ses ordres recevaient-ils un commencement d'exécution, que le général .de Wimpffen, se prévalant d'une lettre qui lui avait été remise par le ministre de la Guerre, réclama le commandement en chef, et désapprouvant les mesures prises pour le général Ducrot, sans avoir encore un plan bien arrêté, ainsi qu'il le dit lui-même, 'nais comptant sur les péripéties de la bataille pour tenter une combinaison moins désastreuse, prescrivit de reprendre les positions abandonnées par suite des premiers ordres. Dès lors, le général de Wimpffen assuma toute la responsabilité du commandement. Ce changement d'impulsion ébranla encore davantage la confiance de l'armée et y mit le désordre. Le nouveau général en chef ne put ou ne sut se faire complètement obéir. Le 1er corps ne conserva pas toutes ses positions, aussitôt occupées par l'ennemi, et le 7e fut, ainsi que lui, refoulé sin Sedan, où ils apportèrent l'un et l'autre une telle confusion qu'on dut fermer les barrières de la place. Pendant que ces événements se passaient, le général de Wimpffen, voyant la vigoureuse résistance du 12e corps et que l'attaque des Bavarois sur Bazeilles se ralentissait et faiblissait même, avait conçu le projet de concentrer toutes ses forces sur sa droite et de percer la ligne ennemie en se portant sur Carignan et Montmédy. Dans ce but, il avait prescrit au 1er corps de venir le rejoindre et au 7e de soutenir la retraite. Ces corps, nous l'avons vii, par suite de leur retraite précipitée sur Sedan, étaient loin de pouvoir répondre à son attente ; toutefois, le général de Wimpffen, à la tête d'une partie des troupes de la marine, de deux bataillons de zouaves et du 45e régiment, s'était jeté sur l'ennemi et se portait sur Balan pour faire coopérer au mouvement les troupes placées de ce côté, quand, arrivé sur l'emplacement où il les supposait, il ne trouva plus personne ; le 12e corps était également rentré à Sedan. Le général de Wimpffen, en allant à la porte de Balan, rencontra le général Lebrun qui, suivi d'un homme portant un drapeau parlementaire, allait demander l'armistice. Le général en chef fit abaisser ce drapeau, et, à la tête de deux cents hommes qu'il put réunir, se rua sur l'ennemi, mais, reconnaissant bientôt son impuissance, rentra lui-même à Sedan. Lors du refoulement des différents corps sur la place, l'empereur, dans la pensée d'arrêter une inutile et plus longue effusion de sang, et sans consulter le général en chef ni les commandants de corps, ainsi qu'ils l'ont unanimement déclaré au Conseil, avait fait arborer le drapeau blanc sur la citadelle. Lorsqu'il se porta sur Balan, pour y faire un dernier effort, le général en chef avait été abordé par un officier d'ordonnance de l'empereur qui l'invitait à se rendre au quartier général ennemi, pour y traiter de la capitulation ; il avait refusé de se charger de cette mission ; cependant, après sa dernière tentative, il céda aux instances de son souverain. Le Conseil peut facilement apprécier la funeste influence qu'exerça sur l'armée ce changement de trois généraux en chef différents à quelques heures d'intervalles et le défaut de suite dans les opérations qui en furent la conséquence ; il peut juger les combinaisons qui se produisirent successivement, les chances de succès qu'elles présentaient. Il est de son devoir de dire que le projet du général Ducrot était le plus rationnel, car, en admettant que la concentration sur la gauche pût réussir, ce qui était difficile, il est vrai, et qu'après un vigoureux effort, l'on pût s'ouvrir la route de Mézières, on pouvait, tout au moins, concevoir l'espoir de saurer une bonne partie de l'armée en se jetant sur le territoire belge. Il doit constater également qu'en réclamant le commandement en chef de l'armée, par suite de la lettre du ministre de la Guerre, sans avoir de plan arrêté, ainsi qu'il le dit lui-même, ou dans l'espoir, après avoir jeté les Bavarois dans la Meuse, de venir battre l'aile droite des Allemands, ou, enfin, de s'ouvrir un passage sur Carignan on Montmédy, le général de Wimpffen a fait preuve de conceptions trop peu plausibles ou justifiées pour ne pas avoir une grande partie de la responsabilité des funestes événements qui amenèrent la capitulation. Mais il importe de bien définir la part de responsabilité qui incombe à ce général dans l'acte même de cette capitulation, et les termes dans lesquels elle fut rédigée. Or, il paraît bien prouvé au Conseil que le souverain, en faisant hisser le drapeau blanc sur la citadelle, sans avoir pris l'avis du général de Wimpffen, le dégageait de toute responsabilité sous ce rapport, et l'assumait tout entière. Le Conseil doit donc louer le général de Wimpffen de s'être constamment opposé à cette capitulation, mais il doit dire aussi qu'ayant accepté de la négocier, il a eu tort de ne pas faire maintenir le principe consenti par l'ennemi, lors de la première entrevue (et dont il avait donné connaissance au Conseil tenu le matin même), de laisser tous les officiers en possession de leurs armes et bagages, article malheureusement modifié en faveur des seuls officiers, qui, en se retirant dans leurs foyers, donneraient leur parole d'honneur de ne pas servir contre l'ennemi pendant la guerre. Le Conseil blâme vivement le général de Wimpffen d'avoir admis cette exception, contraire à l'article 256 du décret du 13 octobre 1863, lequel prescrit aux officiers de ne jamais séparer leur sort de celui de leurs soldats, exception qui tend à affaiblir, chez les officiers, k sentiment du devoir et de résistance à l'ennemi, et n'est qu'une prime à la faiblesse. Pour extrait conforme : Le Président du Conseil d'enquête, BARAGUET D'HILLIERS. XXXIII MÉMOIRE MILITAIRERÉDIGÉ SOUS LE MINISTÈRE DU MARÉCHAL NIEL EN VUE D'UNE GUERRE AVEC L'ALLEMAGNE[18] ILa première question qui se présente dans l'hypothèse d'une guerre avec l'Allemagne, conduite par la Prusse, est celle-ci : Que fera l'ennemi au premier moment ? Se tiendra-t-il sur sa base générale du Rhin, où il est solidement établi, et attendra-t-il que la France manifeste ses projets ? Ou bien, résolu à prendre l'offensive, viendrait-il avec ses corps tout organisés prendre position, dès le début, sur les bases actives et fortifiées qu'il possède devant nos frontières, c'est-à-dire devant la basse Alsace et sur le front et le flanc de la Lorraine pour tenter immédiatement l'invasion de notre pays ? L'état actuel des esprits dans les années prussiennes, la confiance exagérée que leur ont donné leurs succès de 1800 et qu'augmente encore la supériorité attribuée par elles à leur armement, l'espérance qu'elles auraient de surprendre la France au milieu de préparatifs et de mouvements incomplets, tout noirs porte à penser que l'ennemi prendra le second parti et ne nous laissera pas l'initiative de l'attaque. C'est donc particulièrement la défensive du pays que nous allons traiter dans ce mémoire, tout en exposant ensuite ce qui nous paraîtrait devoir être fait, dans le cas où les circonstances nous conduiraient à prendre une offensive résolue dans diverses directions. La partie de nos frontières comprise d'une part entre le Rhin et la Moselle, d'autre part entre la Moselle et la Mense et entre la Meuse et la Sambre[19] serait celle que menaceraient particulièrement les armées allemandes. Leurs forces agissant de concert, en vertu des traités d'alliance récemment conclus, seront assez considérables pour qu'on puisse les supposer opérant concentriquement de différents cotés ; et il est vraisemblable que nous pourrions avoir affaire aussi vers le haut Rhin, à une année du sud de l'Allemagne qui, renforcée d'un contingent prussien, passerait le fleuve à Bâle ou aux environs, envahirait la haute Alsace et chercherait à pénétrer plus loin, soit par les Vosges, soit par la trouée entre les Vosges et le Jura. Mais ce ne serait là qu'une opération accessoire et secondaire dont nous aurions raison au moyen du corps défensif français qui aurait pour base et pour appui le camp retranché de Belfort. Nous reviendrons sur ce point après avoir envisagé les lignes d'invasion plus menaçantes, celles qui auraient pour objectif surtout la basse Alsace et la Lorraine, contrées qui ont été à diverses époques un des principaux théâtres de nos guerres. Cette partie de la frontière française, entre le Rhin et la Moselle, est encore, en ce qui noirs concerne, dans l'état ou l'ont mise les événements de 1815 et les traités de Vienne. Mais les Allemands y ont pris contre nous une attitude beaucoup plus agressive et dangereuse que jamais. Qu'on nous permette de rappeler ce qu'écrivait en 1837 le
lieutenant général Dode, dans un rapport à la Haute Commission de défense instituée
l'année précédente : ... Ce côté de la France,
disait-il, est sans contredit le plus vulnérable et
le plus menacé. Nos voisins l'ont toujours signalé comme l'entrée la plus favorable
à leurs desseins, s'ils avaient à exécuter une troisième invasion chez rions.
Les travaux qu'ils ont fait exécuter sur la partie de leur territoire qui
nous fait face ont pour but de corroborer ce plan d'attaque et développent
encore leurs vues... L'Allemagne tend
d'ailleurs à se centraliser et à former un corps plus compact et plus
homogène. La fusion des intérêts commerciaux qui s'opère sons nos yeux eu ce
montent (1837) sur ce vaste territoire, produira dans un avenir plus
éloigné une fusion d'intérêts politiques, qui fera de ce grand corps, faible
autrefois par ses divisions, une tuasse très redoutable... Après trente années ces prévisions viennent de se réaliser complètement. La situation même s'est notablement aggravée, car les places fortes fédérales, élevées devant notre frontière de la Lorraine et du Rhin, vont être désormais aux mains d'une seule puissance : celle qui dirigerait les opérations militaires, la Prusse, et cette ceinture de fer qui nous étreint pèsera sin nous d'un poids plus lourd. En outre, l'existence des nombreuses voies ferrées qui, partant des divers passages du Rhin, viennent converger sur les points fortifiés, a créé des dangers nouveaux, par la facilité de concentration rapide des troupes d'invasion. Il y a donc une nécessité impérieuse de s'occuper des moyens de défendre cette frontière. Principaux passages du Rhin dont l'ennemi dispose avec ponts et têtes de ponts. — Toutes les forces de l'Allemagne dur Nord peuvent être portées très promptement sur la rive gauche du Rhin par les voies de fer qui aboutissent aux divers points de passage du fleuve. Ces passages principaux sont ceux de : 1° Maxau, à 8 kilomètres en aval de Lauterbonrg, pont de bateaux sur lequel passe le chemin de fer de Carlsrnhe à Landau ; 2° Germersheim, pont de bateaux avec double tête de pont fortifiée ; 3° Manheim, pont de bateaux et pont fixe qui s'achève pour le passage du chemin de fer ; 4° Worms, pont de bateaux ; 5° Mayence, place puissamment fortifiée, pont de bateaux et pont fixe pour le chemin de fer de la rive gauche du Mein ; 6° Coblentz, double tête de pont fortifiée, pont de bateaux et pont fixe ; 7° Bonn, pont de bateaux ; 8° Cologne, pont de bateaux et pont fixe ; 9° Dusseldorf, pont de bateaux et pont fixe. Lignes d'opération de l'ennemi pour une invasion de la France. — Les lignes de voies ferrées en communication avec ces divers passages et menaçantes pour la France, sont : 1° Pour l'invasion de la basse Alsace : la ligne Rastadt-Carlsruhe-Landau, la ligne Mayence-Neustadt-Landau-Wissembourg ; 2° Pour l'invasion de la Lorraine : les trois lignes Mayence-Kaiserlautern-Sarrebruck, Mayence-Neunkirchen-Sarrebruck-Trèves-Sarrelouis-Sarrebruck, toutes trois venant aboutir à la vaste gare de Sarrebruck disposée pour cette grande concentration et se prolongeant sur notre territoire par la ligne de Forbach-Saint-Avold-Metz ; 3° Enfin, la ligne Trèves-Luxembourg et entre la Moselle et la Mense, la ligne Cologne-Aix-la-Chapelle-Spa-Luxembourg, ces deux lignes se prolongeant par une voie ferrée également sur Thionville et Metz et sur Longwy et Arlon. La marche stratégique des forces allemandes contre la France comprendrait peut-être aussi une ligne d'opérations à leur extrême droite, par les voies de fer qui, partant de Dusseldorf, passent par Aix-la-Chapelle, Liège, Namur, Charleroi, à travers la Belgique[20]. Ce pays chercherait assurément à faire respecter sa neutralité. L'intérêt de la France ne serait pas de la violer ; mimais les Prussiens pourraient n'avoir pas le même scrupule, eu égard à l'avantage qu'il y aurait pour eux à être maîtres sur la ligne dont nous parlons, des citadelles de Liège et Namur, qui leur seraient d'un puissant secours, soit pour jalonner leur ligne d'opérations, soit comme appui dans les luttes dont la Belgique serait le théâtre. Cette ligne d'opérations les conduirait droit sur notre frontière où existe la trouée de l'Oise, direction la plus courte à suivre pour marcher sur Paris. Il est donc prudent de tenir compte de cette éventualité d'attaque. On voit, d'après les facilités de mouvements rapides et de concentration, que leurs lignes ferrées donneraient aux Allemands, qu'ils pourraient, dès le premier moment de la guerre, avoir quatre bases d'opérations distinctes, établies immédiatement devant nos frontières jusqu'à les toucher pour ainsi dire, savoir : devant la basse Alsace, Landau et Germersheim ; devant la Lorraine, Sarrebruck et Sarrelouis, sur la Sarre ; au flanc gauche de la Lorraine, Luxembourg et devant la trouée de l'Oise, Namur et Charleroi. Ces quatre bases seraient d'ailleurs reliées très directement entre elles par des voies ferrées : la ligne Namur-Charleroi qui court parallèlement à la frontière française, la ligne Luxembourg-Trèves-Sarrelouis-Sarrebruck et la ligne Neunkirchen-Neustadt par Kaiserlautern, indépendamment des routes de terre remplissant le même objet, telle que la route de Sarrebruck à Landau, par Deux-Ponts et Pirmasens. Cette situation est grave ; elle appelle toute notre attention et nous dicte ce que nous avons à faire. Forces que l'ennemi pourrait mettre en mouvement contre nous au premier moment de la guerre. — Nous supposons que l'ennemi, au premier moment de cette guerre, ne présenterait pas moins de 390.000 hommes en totalité, sur les quatre points que nous venons de considérer, savoir : devant la basse Alsace, 80.000 hommes ; sur la Sarre, devant le centre de la Lorraine, où serait la branche principale d'opérations, 160.000 hommes ; sous Luxembourg, 70.000 hommes ; en Belgique[21], 80.000 hommes. Admettons en outre que le corps qui passerait le Rhin à Bâle serait de 70.000 hommes, cela ferait un total de 460.000 hommes, auquel nous pouvons, dans les circonstances actuelles, évaluer les forces allemandes qui pourraient agir contre nous dans les premières phases de la lutte. Forces françaises à opposer aux premiers efforts de l'ennemi. — A ces forces, nous devons pouvoir opposer : 1° Une armée du Rhin — l'aile gauche en basse Alsace —, 60.000 hommes ; 2° Une année de la Moselle, 140.000 hommes, placée devant le grand débouché de Sarrebruck et détachant deux de ses corps sur Thionville ; 3° Une année du Nord, ou de la Mense, 60.000 hommes indépendamment des garnisons, des places fortes de cette frontière ; 4° Nous devons avoir en outre une armée de réserve de 120.000 hommes établie sur la base Reims-aillons. La première de ces villes serait transformée, par des ouvrages de campagne, en une grande place de manœuvres, et l'armée qui s'y appuierait pourrait se porter par les voies ferrées soit sur le Nord, soit sur la Lorraine, soit vers Langres ; 5° Aile droite de l'armée du Rhin — dans la haute Alsace — 60.000 hommes. Pour ces quatre armées — du Rhin, de la Moselle, du Nord et de réserve — nous atteignons un total de 440.000 hommes, sans compter bien entendu, ni les garnisons des places fortes, ni la deuxième réserve à constituer dans Paris[22]. Abordons les détails et voyons quels devront être les positions et les mouvements de nos différentes armées par rapport à celles qui leur seront opposées. Dans la basse Alsace. Aile gauche de l'armée du Rhin. — L'armée ennemie a pour base Landau et Germersheim, sa droite s'étendra jusqu'à Pirmasens au moyen d'un corps qui la reliera avec son armée de la Sarre. Partant de cette base, elle attaquera la basse Alsace à la fois par les montagnes entre Bitche et Wissembourg et le Rhin, parce qu'elle a intérêt à appuyer sa gauche au fleuve, afin de ne pas être coupée de ses passages de communication avec la rive droite. Mais tout en considérant que le gros de ses forces opérera sans doute par la plaine à l'est de Wissembourg, parce que là le pays est ouvert et se prête bien aux mouvements de la cavalerie et de l'artillerie, et aussi parce que l'ennemi est maître de plusieurs belles routes et du chemin de fer, il faut admettre qu'il fera aussi des efforts sérieux par sa droite contre le pays montagneux à l'ouest de Wissembourg, par le haut des vallées de la Lauter et de la Sauerbach, comme les Alliés l'avaient fait en 1793. Car, s'il y a nécessité impérieuse pour nous de lier toujours les mouvements de notre année du Rhin à ceux de l'année de la Moselle, l'ennemi doit tendre naturellement à contrarier ce but et il doit penser qu'il pourrait y réussir par l'opération que nous indiquons. Première position de l'armée du Rhin. — L'armée française de la basse Alsace occuperait au moment de la guerre la ligne de la Lauter, 'sa droite à Lauterbourg, sa gauche à Wissembourg et à la position du col du Pigeonnier, sur la route de Bitche. Elle pourrait même, si elle n'avait pas devant elle un ennemi très supérieur en forces, occuper de ce côté la belle position de Nothwiller, qui a une action sur le haut de la vallée de la Lauter et de la Sauerbach et qui, en 1793, a été longtemps tenue avec avantage par les républicains. Mais pour peu que l'ennemi prenne une offensive décidée, cette ligne de la Lauter ne serait réellement pas tenable. Sa gauche, comme nous l'avons dit ci-dessus, est exposée à être tournée ; les deux postes qui la jalonnent — Wissembourg et Lanterbourg — n'ont que très peu d'importance et ne pourraient être défendus sérieusement[23]. Notre armée ne trouverait pas là une ligne de bataille avantageuse et ne devrait pas y attendre une lutte générale. Cette opinion, qui a été celle de la plupart des militaires expérimentés et des commissions de défense qui se sont occupés de la question, est d'autant plus fondée que la ligne de la Lauter, susceptible d'être tournée par sa gauche, est aussi menacée à dos sur sa droite par un passage du Rhin que tenterait devant Selz un corps auxiliaire ennemi parti de Rastadt, qui n'est qu'à 7 kilomètres du fleuve. Notre armée ne serait donc pour ainsi dire, qu'en observation sur la ligne de la Lauter, et si l'ennemi, en forces supérieures, se décidait à marcher en avant, il faudrait ne pas chercher à faire là une résistance de front. Il faudrait refuser la droite, et il est probable que notre gauche même ne pourrait résister longtemps autour de Wissembourg et qu'elle serait contrainte d'abandonner aussi ce point, malgré l'inconvénient qu'il y aurait à laisser ainsi l'ennemi maître de la première partie de la route qui se dirige de Wissembourg sur Bitche par le col du Pigeonnier. Cette route, il est vrai, sera maîtrisée plus loin par le corps de 7 à 8.000 hommes qu'il importera de placer sous l'appui de Bitche et qui réunira ses efforts à ceux de la gauche de l'armée d'Alsace pour défendre la tête des Vosges. Position défensive de l'armée du Rhin. — L'armée fera donc, en se repliant de Wissembourg, un changement de front et viendra se couvrir de l'un des affluents de ces montagnes au Rhin, et tout d'abord de la Lauerbach, cours d'eau assez important qui descend de Fischbach à Lembach, passe à Wœrth et longe la tête de la forêt de Haguenau. Dans ce mouvement, la gauche devra faire tout son possible pour tenir Lembach même, afin que l'armée reste toujours étroitement liée aux Vosges. Autrement, l'ennemi s'attacherait à la séparer de l'armée de la Moselle en l'isolant de Bitche et en interceptant ses communications à travers la chaîne par la route de Niederbronn d'abord, et par celle d'Ingweiler ; puis, poursuivant sa marelle, il pourrait même la couper de sa communication avec Phalsbourg. C'est ici le lieu de faire remarquer combien il est essentiel que notre armée de la basse Alsaee ne cesse pas de s'appuyer aux Vosges et qu'elle ne se laisse pas rejeter sur Strasbourg et peut-être acculer au Rhin. Son rôle est de défendre le mieux possible cette partie du pays contre l'invasion en conservant toujours la possibilité de lier ses opérations avec celles de l'armée de la Moselle et de venir en aide à celle-ci au besoin. Si elle est forcée de se retirer, il faut qu'elle maintienne constamment sa ligne naturelle de retraite à travers les Vosges et sa communication directe avec l'intérieur de la France pour aller concourir à la défense générale. Elle ne doit pas sacrifier ce devoir à la pensée de protéger Strasbourg, cette place pouvant être momentanément abandonnée aux seuls efforts de sa garnison calculée en conséquence et secondée par sa patriotique population[24]. Si, à la suite de quelques revers, cette garnison est bloquée par l'ennemi, on peut toujours espérer qu'un retour de fortune nous permettra de venir la dégager, comme en 1793, sur ce même théâtre de guerre, les républicains l'ont fait pour Landau. L'armée se repliant de la ligne de la, Lauter viendra s'établir sur la rive droite de la Sauerbach. Il existe là une belle position de bataille couverte sur sa droite par la forêt de Haguenau et le poste de Haguenau même[25], sur son front par la rivière où l'on peut faire des retenties d'eau, sur la gauche par les contreforts des Vosges. Cette position a une étendue de 9 à 10 kilomètres : elle est longée en avant par une belle route, et en arrière par le chemin de fer de Haguenau à Niederbronn. Elle se développe sur nue longue crête bien dégagée et dominante. Les points de solide résistance vers sa gauche sont Frœschwiller et Wœrth, où il y aurait quelques ouvrages de fortification de campagne à élever. Il faudrait aussi en avoir nu ou deux en avant du front, sur la rive gauche, notamment près du village de Gunstett. On les aurait construits dès le début de la guerre. La forêt de Haguenau, rendue impénétrable par de nombreux abatis et certaines dispositions défensives appuieraient solidement la droite. C'est cette position qu'occupaient, mais en sens inverse, les Autrichiens en décembre 1793, lorsque le général Hoche, combinant le mouvement de son armée du Rhin que commandait Pichegru, vint se jeter entre eux et les Prussiens, et détermina leur retraite en les battant sur leur droite et leur enlevant les redoutes qu'ils avaient établies vers Frœschwiller et Weill !, opération dont le résultat-fut le débloeus de Landau. Notre armée sur cette position de Wœrth, bien plus favorable polir nous qu'elle rie l'était pour les Autrichiens, pourrait soutenir une lutte contre des forces supérieures avec grandes chances de succès. En occupant cette belle ligne de défense, on maîtrise la communication de Wœrth à Bitche, on ouvre à plus forte raison la route impériale entre Haguenau, Bitche et la Lorraine par Niederbronn, direction que va suivre le chemin de fer en construction, et on donne la main à l'armée de l'autre versant des Vosges. De là aussi on menace sérieusement la droite et les derrières de l'ennemi, s'il tentait de pénétrer entre la forêt de Haguenau et le Rhin et de pousser sur Strasbourg. Nous aurions d'ailleurs laissé un fort détachement dans Haguenau, qui petit être considéré comme un bon poste de guerre. Si ce détachement était forcé de se replier, il se retirerait d'abord sur Wendenheim, point de bifurcation des chemins de fer qui aurait été organisé défensivement et de là sur Strasbourg. Encore un mot sur la position de Wœrth. Pendant que notre armée du Rhin l'occuperait, elle pourrait, à un moment donné et sans se compromettre, se dégarnir d'une ou deux divisions qui seraient dirigées rapidement à travers les Vosges pour renforcer l'aile droite de l'armée de la Moselle engagée dans une bataille et frapper un coup décisif. Une marche de nuit suffirait pour ce mouvement. Si l'armée du Rhin était contrainte par les efforts de l'ennemi à abandonner la position de la rive droite de la Sauerbach, elle se retirerait derrière la Moder d'abord, puis sur la ligne de la Zorn, derrière le canal de la Marne au Rhin, où se trouve le chemin de fer qu'elle aurait grand intérêt à protéger, sa gauche s'appuyant toujours aux Vosges, son centre à Hochfelden, sa droite à Brumath et à Wendenheim qui est le nœud des deux voies ferrées. Cette ligne, bien moins importante à conserver en 1793 qu'aujourd'hui, fut occupée et tenue par l'armée de Pichegru et les Autrichiens ne purent l'en débusquer. Ce mouvement de retraites successives de l'armée du Rhin suppose que l'armée de la Moselle se serait de son côté retirée aussi de la première position qu'elle occupera entre Sarreguemines et Saint-Avold. Alors, le petit corps intermédiaire, qui manœuvrait sous l'appui de Bitche, aurait fait également sa retraite, mais par la crête même des Vosges en suivant une route qui s'y développe par la Petite-Pierre et il serait venu occuper le plateau de Phalsbourg, nœud principal de la communication entre les deux armées. La place de Phalsbourg est précieuse comme point central de défense et d'appui sur la chaîne des Vosges et pour assurer un moyen de communication avec Strasbourg. Il aurait fallu qu'on disposât à l'avance sur ce plateau, tant au nord qu'au sud, quelques ouvrages de campagne, de façon à étendre l'action de la place sur la vallée de la Zintzel au nord et la vallée de la Zorn au sud, dans laquelle passent à la fois le canal, le chemin de fer de Strasbourg et une bonne route. Il est de toute nécessité de maîtriser ces vallées par lesquelles les Alliés en 1814 ont tourné Phalsbourg, surtout celle de la Zorn. On aurait dans celle-ci pris le soin de réorganiser et d'armer le vieux château de Lutzelbourg ; puis de le rattacher à Phalsbourg en construisant un bon ouvrage en terre sur le plateau intermédiaire dit des Trois Maisons. Ces dispositions défensives seraient soutenues par des détachements de la garnison et des corps de partisans que fournirait la patriotique population de ce pays. Sur les autres passages des Vosges entre Bitche et Phalsbourg, nous ne demandons pas d'ouvrages de fortification, même passagère. En effet, déjà en 1814 et 1815, l'ennemi avait traversé et parcouru les Vosges, en se servant des passages existant alors, aussi librement que s'il n'y avait pas eu de montagnes. Cela lui serait bien plus facile à faire encore aujourd'hui, puisque les Vosges ont été sillonnées partout de chemins de fer forestiers et autres. Si l'on y faisait des ouvrages défensifs, il faudrait en établir partout, et immobiliser sur ces points une partie de nos forces et de nos ressources en armement et en vivres. Seulement, il sera bon de préparer quelques obstacles, comme abatis et coupures, sur certains points et notamment au débouché des Vosges dans l'Alsace, ne fût-ce que pour assurer, en retardant la marche de l'ennemi, le mouvement de flanc que pourraient faire nos troupes du Rhin pour se porter en Lorraine. Nous terminons ce que nous voulions dire ici des Vosges par quelques mots extraits d'un ordre de l'empereur Napoléon 1eF à son ministre de la Guerre en date du 9 mai 1815, alors qu'on préparait aussi la mise en état de défense de cette frontière : Il est des cas où les Vosges sont la retraite de l'armée du Rhin ; il en est d'autres où les Vosges menacent les derrières de l'armée de la Moselle. Cela est encore parfaitement vrai aujourd'hui et justifie ce que nous avons proposé ci-dessus. N. B. — Suivent, dans ce mémoire si intéressant, des détails sur les opérations probables de l'armée de la Moselle, — offensive, défensive et retraite successive, s'il y avait lieu, — sur les autres manœuvres de l'armée du Nord ou de l'armée de la Meuse, enfin sur les opérations à tenter dans la haute Alsace par l'armée du Rhin contre l'armée du sud de l'Allemagne, puis sur la retraite de nos troupes en cas d'insuccès sur Belfort et Vesoul. Le mémoire visait une seconde partie relative à l'hypothèse d'une offensive de nos forces, tant sur la rive gauche du Rhin qu'au delà de cc fleuve. Cette partie ne figure point dans le texte que nous avons eu sous les yeux. Il résulte de cet important travail que l'état-major avait envisagé depuis longtemps toutes les hypothèses de l'envahissement de l'Alsace et des Vosges et proposé des mesures sérieuses tant en effectifs qu'en fortifications ou points défensifs, mesures qui ne furent malheureusement pas exécutées. H. W. XXXIV CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'ORDRE DE BATAILLE À SUIVRE EN 1870.IIAu mémoire du général Colson étaient jointes des considérations générales provenant du maréchal de Mac-Mahon, commandant le 1er corps de l'armée du Rhin le 27 juillet 1870, qui méritent d'être examinées avec attention et qui concernent l'ordre de bataille à suivre, le rôle de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie. On remarquera que l'état-major avait la croyance formelle que notre artillerie était supérieure à l'artillerie prussienne par la mobilité et la rapidité de son tir. Les premiers engagements démontrèrent, hélas ! combien le canon se chargeant par la culasse avait de supériorité sur notre canon rayé et quelle erreur regrettable fut commise par les comités spéciaux qui repoussèrent le canon Reffye et n'acceptèrent que la mitrailleuse. ARMÉE DU RHIN 1er corps ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE DU MARÉCHAL DE MAC-MAHON AVEC SES GÉNÉRAUX, 27 JUILLET 1870 L'étude de la campagne de 1866 nous fait voir que l'ordre de bataille de 1805 est encore aujourd'hui ce qu'il faut conseiller et ce qu'il y a de plus parfait. L'exemple d'Austerlitz nous prouve aussi que, dans la division, il vaut mieux placer une brigade en première ligne et l'autre en deuxième ligne, que d'employer les brigades accolées. L'ordre en colonnes par bataillons, avec des tirailleurs pour éclairer ces colonnes, permet de fournir des feux sur la ligne de bataille, tout en conservant dans la main du chef de bataillon des réserves suffisantes pour enlever, au moment décisif, les positions occupées par l'ennemi. Dans la campagne de 1866, les Prussiens, dont l'armement était de beaucoup supérieur à celui de leurs adversaires, avaient adopté la colonne de compagnie ; ils ont voulu par là imiter ce que nous avons fait en Afrique, en Crimée et en Italie, c'est-à-dire individualiser le combat et développer l'initiative de leurs soldats. Un auteur militaire prussien, dans un écrit qui a paru en 1868, a fait remarquer les dangers qui peuvent résulter de l'adoption de cette colonne de compagnie ; il conclut à la nécessité d'organiser en arrière de la première ligne, de fortes réserves qui puissent parer à tous les événements, soit qu'il s'agisse de la défense ou de l'attaque d'une position C'est qu'en effet la colonne de compagnie a pour résultat d'égrener les troupes, qui se portent d'instinct sur la ligne de bataille, et de détruire l'unité d'action ; en un mot, il n'y a plus que des tirailleurs en grande bande fournissant des feux très nourris, mais dont la ligne peut être percée, d'autant plus facilement qu'elle est plus mince et que la première ligne, la deuxième et souvent les réserves sont confondues. Il sort de là pour nous un enseignement : c'est qu'il faut que les troupes soient toujours dans la main de leurs chefs et les tirailleurs suivis de réserves assez fortes pour enlever les positions que l'on a devant soi. Dans ce même écrit, l'auteur, spéculant sur la furia francese, prévoit le cas où nous attaquerons de front baïonnettes lancées, comme nous avons l'habitude de le faire et il dit : Si nos ennemis nous font ce plaisir, leur affaire est faite ! Gardons-nous bien de nous laisser aller à cet entraînement irréfléchi ; que nos soldats, au contraire, qui ont entre les mains un fusil portant plus juste et plus loin que celui de nos adversaires, sachent en tirer tout le parti possible. Il faut qu'ils soient bien convaincus que le fusil prussien n'a d'effet utile que jusqu'à la distance de 500 mètres et que le leur est encore très meurtrier à celle de 1.000 mètres. Cette supériorité de notre armement aura pour résultat, si nous savons en profiter, de surélever le moral de nos troupes et de détruire celui de nos ennemis, résultat que les mitrailleuses et l'artillerie, dont il sera parlé plus loin, contribueront également à amener. Infanterie. Il faut bien se garder des règles fixes en ce qui concerne l'ordre de la bataille. A la guerre, l'imprévu joue un grand rôle et l'essentiel est d'y faire toujours face. Le chef d'une troupe doit, avant tout, tirer parti du terrain qu'il a à attaquer ou à défendre ; toutefois, il est nécessaire de poser quelques principes généraux dont on ne craindra pas de s'écarter, lorsque les circonstances l'exigeront. Le rôle des tirailleurs s'est accru en raison de la précision du nouveau fusil, parce que leur tir est supérieur à celui des troupes en ligne. En général, ne bataillon sera couvert par deux compagnies, ayant chacune une section en tirailleurs et une section en réserve. Les réserves auront non seulement pour mission de soutenir les tirailleurs, mais encore de gagner du terrain en avant et de franchir la ligne, toutes les fois qu'il le faudra. Ainsi donc deux compagnies seront généralement en tirailleurs, précédant la première ligne ; cette première ligne sera composée de troupes de la 1re brigade, à l'exception du bataillon de chasseurs qui formera la réserve de la division. Comment les troupes de la première ligne seront-elles disposées ? En colonnes par pelotons, on en colonnes doubles ; mais de préférence en colonnes doubles. La colonne double se ploie et se déploie très rapidement, beaucoup plus rapidement que la colonne simple, et c'est là ce qui constitue sa supériorité sur la première. Sur le champ de bataille, il faut éviter les manœuvres, car le temps pendant lequel la troupe les exécute, est toujours un moment critique pour elle : ployer et déployer le bataillon, là doivent se borner autant que possible les mouvements. La première ligne sera donc généralement en colonnes doubles, à demi-distance et à intervalle de déploiement ; en plaine, elle se tiendra à 500 mètres en arrière des tirailleurs ; en pays accidenté, la distance dépendra des plis du terrain et les chefs de bataillon sauront en profiter pour abriter leur troupe. La deuxième ligne, composée de la 2e brigade, sera également en colonnes doubles, à 500 mètres en arrière de la ire, prête à se porter en première ligne ; cependant, si elle avait à souffrir de l'artillerie ennemie, il faudrait la déployer. Enfin, en arrière de la deuxième ligne, se trouvera le bataillon de chasseurs qui constituera, comme il a déjà été dit, la réserve de la division. Cavalerie. La cavalerie divisionnaire n'aura pas seulement à éclairer les troupes d'infanterie ; pendant les péripéties du combat, elle aura souvent à agir : qu'un bataillon ennemi batte en retraite, elle devra s'élancer à sa poursuite, le sabrer et le détruire. Pour qu'elle puisse jouer ce rôle, la cavalerie divisionnaire se trouvera à portée du général de division, défilée, autant que possible, des feux de l'ennemi et prête à agir au moment propice. Elle se portera alors en avant, en passant par les intervalles ; les tirailleurs se resserreront rapidement pour lui livrer passage, et ce mouvement sera toujours possible, lorsqu'elle se portera en avant. Ce qu'il y a d'indispensable, c'est de lui ménager une retraite, si elle est ramenée ; à cet effet, les tirailleurs devront se grouper par escouades. Artillerie. A chaque division d'infanterie sont attachées trois batteries, une de mitrailleuses et deux de 4 de campagne. Il paraît utile ici de recommander aux généraux de division de n'employer les mitrailleuses que dans les engagements sérieux et non dans des affaires d'avant-garde. Cet engin de guerre très puissant, dont une instruction qui a été donnée à tous les généraux de division fait connaître les effets terribles, pourra, s'il est utilisé d'une manière intelligente, frapper le moral de nos adversaires et leur enlever l'audace qui leur a si bien réussi en 1866. Notre artillerie du reste a, sur l'artillerie prussienne, l'avantage de la mobilité et de la rapidité du tir ; sous ce rapport également nous avons la supériorité : il faut que chacun en soit bien convaincu. Au début d'une action et aux grandes distances les batteries de mitrailleuses tireront d'abord sur les batteries ennemies, de manière à paralyser leur feu et à les démonter : elles peuvent les atteindre jusqu'à la distance de 2.200 mètres. Mais lorsque des masses d'infanterie arriveront à une portée de 1.500 mètres environ, c'est sur elles qu'elles chercheront à concentrer tout leur feu : cent cinquante balles, arrivant en même temps sur une colonne avec une force de pénétration considérable, doivent produire un effet foudroyant. Quant aux batteries divisionnaires, elles prendront position d'après les indications du général de division, qu'elles soient réunies ou séparées suivant les circonstances. Toutefois, il paraît essentiel que les chefs d'escadrons, qui les commandent, jouissent d'une certaine initiative, en ce qui concerne l'établissement de leur troupe et la direction à donner au tir. Le général de division se bornera à indiquer le point à battre et l'effet à produire ; le commandant de l'artillerie, avec ces données générales, prendra les mesures de détail, sous sa responsabilité, pour remplir la mission qui lui aura été assignée. Les batteries d'artillerie, pour avoir toute leur liberté d'action, doivent être protégées ; il convient de leur donner rune escorte, qui tienne à distance les tirailleurs de la ligne ennemie on qui résiste à la cavalerie, qui tenterait de les enlever. Quelle sera cette escorte ? Une section de chasseurs à pied dont l'effectif variera de soixante à soixante-quinze hommes, semble mie force suffisante. Cette section sera toujours la même, de façon à ce qu'il s'établira entre la batterie et son escorte une confraternité salutaire. Les chasseurs à pied prendront bientôt l'habitude de se placer, de manière à garantir la batterie ; et d'un autre côté, lorsque la batterie devra se porter aux allures vives d'une position à une autre, elle pourra facilement transporter son escorte qui, sans cela, ne saurait la suivre et continuer de la protéger. Chaque homme est pourvu de quatre-vingt-dix cartouches ; il est bien essentiel de lui apprendre à les ménager et à ne tirer que dans de bonnes conditions. Cependant, on a dît prévoir le cas où une troupe aurait épuisé sa provision : de là, des réserves divisionnaires de munitions. Chaque bataillon a une réserve de cartouches, renfermée dans ne caisson à deux roues. Il n'est pas admissible que cette voiture suive le bataillon dans toutes les phases du combat et reste, pendant l'action, sur la ligne de bataille ; d'un autre côté, il faut que cette réserve de cartouches ne soit pas trop éloignée des combattants. Faut-il la placer avec les batteries divisionnaires ? ou bien en arrière de la division avec le bataillon de chasseurs à pied ? Il n'y a pas de règle fixe à poser à cet égard : les généraux de division et de brigade prendront telle mesure que les circonstances. leur conseilleront, les voitures d'une même brigade étant réunies sur un même point, sous la protection d'un petit détachement d'infanterie. XXXV Note sur l'infériorité de notre artillerie en 1870.Pourquoi, en 1870, nous
sommes-nous présentés avec une artillerie aussi inférieure à celle de nos
adversaires ? Aussitôt après la campagne de 1866 où les canons rayés prussiens, se chargeant par la culasse, avaient paru sur le champ de bataille, on comprit bien, en France, l'infériorité de nos vieux canons de 12 et de 4 et l'on se mit à étudier de nouveaux modèles, mais sans conviction, sans ardeur ; car dans les sphères officielles on se montrait hostile d'une part au chargement par la culasse, d'autre part à l'utilisation des grandes portées. Aussi, les expériences furent-elles conduites avec la lenteur particulière qui caractérise les bureaux, les comités, les commissions, les conseils, etc., toute cette bureaucratie technique si dangereuse par son inertie. L'empereur, qui était peut-être préoccupé des événements et voulait aboutir à bref délai, voyant que la question n'avançait pas, se décida à charger le lieutenant-colonel de Reffye, l'inventeur de la mitrailleuse, d'établir deux modèles de canons de campagne, l'un léger, l'autre plus lourd de réserve sous les conditions suivantes[26] : le bronze comme métal à canon, la poudre noire comme charge de tir. La France ne pouvait pas alors faire l'acier à canon et il dit été trop long de trouver une nouvelle poudre et de créer un approvisionnement ; cela pressait. Ce problème, posé au mois de décembre 1868, et qui paraissait insoluble à presque tous les artilleurs, était résolu seize mois après : au mois de mai 1870, deux pièces de 7 et deux pièces de 4 étaient mises en expérience à Versailles ; les essais furent interrompus par la guerre. Cependant, l'étude faite par le lieutenant-colonel de Reffye était assez complète pour que le matériel de 7, fabriqué dans des usines improvisées, mal outillées pendant la guerre même, se soit montré au moins égal au matériel allemand, notamment au plateau d'Avron. Eh bien, l'hostilité contre le chargement par la culasse et les grandes portées était telle dans certains esprits que, pendant le siège même de Paris, sous le feu pour ainsi dire, le général d'artillerie Susane écrivait dans une brochure la phrase suivante : Les artilleurs préfèrent, pour la guerre de campagne, les canons se chargeant par la bouche et tirant à 3.000 mètres aux canons à longue portée qui se détraquent ! Telle était la mentalité des sphères officielles et du personnel dirigeant ! Comment s'étonner que les essais de 1866 à 1870 n'aient rien produit ? Si l'empereur avait pris plus vite la décision de confier à un homme et non aux organes du ministère de la Guerre, la mission d'établir un matériel, nous eussions été prêts en 1870 et nous aurions opposé nix ennemis une artillerie au moins aussi puissante que la leur. Tel est le résultat de l'inertie administrative et technique ! A cette note qui émane d'un général éminent et d'une très haute compétence en matière d'artillerie, il faut ajouter à titre de renseignement l'étude faite en février 1868 sur le canon de 4 en acier de la maison Krupp et le canon de 9 pouces (228 mm., 6) en acier fondu. L'examen des brochures sur les épreuves de ce canon, envoyées à l'empereur Napoléon par le chef de l'usine Krupp, Henri Haas, fut fait par les soins du général Le Bœuf, président du comité d'artillerie, et aboutit à cette constatation qu'on ne saurait affirmer encore que ces canons présentassent une sécurité absolue contre les éclatements. Le Bœuf ajoutait que si les expériences, commencées à Versailles des deux canons en bronze se chargeant par la culasse, avaient un résultat définitif favorable, il n'y aurait plus lieu de se préoccuper de la question de l'acier. Donc en 1868, le nouveau canon était déjà à l'étude et en 1870 on se mit en campagne avec l'ancien. (Voir Papiers de la famille impériale, pièce CXX.) H. W. XXXVI L'INDEMNITÉ DE GUERRE EN 1871EXTRAITS DU RAPPORT AU NOM DE LA COMMISSION DU BUDGET DE 1875 SUR LE PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ DE GUERRE ET SUR LES OPÉRATIONS DE CHANGE QUI EN ONT ÉTÉ LA CONSÉQUENCE Par M. Léon SAY Membre de l'Assemblée nationale Séance du 5 août 1874. Les préliminaires de paix signés à Versailles, le 26 février 1871, avaient stipulé dans l'article 2 le paiement de 5 milliards de francs, dont un milliard en 1871, et le reste dans un espace de trois années. Il n'était fait, dans ce document, aucune mention de la nature de la monnaie dans laquelle les versements devaient être effectués ; cc n'est que quelques jours plus tard, lors de la signature de la convention de Ferrières, le 11 mars 1871, qu'il est parlé, dans l'article 15, du thaler au cours de 3 fr. 75 et du florin d'Allemagne au cours de 2 fr. 15 comme pouvant servir au paiement de la contribution de guerre. L'article 7 du traité de paix signé à Francfort, le 10 mai 1871, précisait davantage les époques et les formes du payement. Les échéances étaient déterminées comme il suit : Trente jours après le rétablissement de l'ordre
Le gouvernement français devait, en outre, payer le 3 mars de chaque année les intérêts au taux de 5 pour 100 l'au sur les trois derniers milliards, tout en conservant la faculté, à charge de prévenir trois mois à l'avance, de devancer par des acomptes l'échéance finale du 2 mars 1874. Dans le cas où le gouvernement français userait de cette faculté, les intérêts devaient cesser de courir à partir du jour de l'anticipation. Quant au mode de payement, il consistait en or ou en argent, en billets de banque d'Angleterre, de la banque de Prusse, de la banque royale des Pays-Bas, de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables de premier ordre, valeurs comptant sur ces mêmes pays. Le change du thaler était fixé à 3 fr. 75 et celui du florin d'Allemagne à 2 fr. 15, comme nous l'avons vu plus haut, en vertu de l'article 15 de la convention de Ferrières[27]. Mais pour les autres. valeurs, on en avait pas déterminé le change, par cette raison qu'elles n'étaient pas libératoires. Elles pouvaient être données en payement mais le montant n'en était porté en compte que pour le produit net en thalers ou en florins de la négociation que se réservait de faire le gouvernement allemand. C'est ce qui résulte du paragraphe 3 des observations contenues dans le protocole de signature des conventions de Berlin, signé le 12 octobre 1871 et ainsi couru : 3° Il a été convenu que les lettres de change, domiciliées autre part qu'en Allemagne, que la France a remises on remettra au gouvernement allemand, ne passeront en compte que pour les sommes lutinant le produit net de leur réalisation, déduction faite des frais de recouvrement. Le cours du change des valeurs remises, servant de base au calcul à établir entre les deux pays, sera celui du jour de la réalisation par l'Allemagne des lettres de change. Il y a lieu de faire remarquer, enfin, que la valeur de la portion cédée du chemin de fer de l'Est fixée à 325 millions de francs par le paragraphe 6 de l'article 1er des articles additionnels au traité de paix du 10 tuai 1871, devait être déduite du second demi-milliard du montant de l'indemnité, et que par exception aux dispositions rapportées ci-dessus, 125 millions purent être versés en billets de la Banque de France, conformément à une convention spéciale signée à Francfort le 21 mai 1871. Si on ajoute qu'une somme de 98.400 francs, rendue par le gouvernement allemand à la ville de Paris par suite du règlement définitif de la contribution des 200 millions, a été portée en compte au gouvernement français on voit que la situation pouvait s'établir comme il suit :
La différence, soit 4.549.901.600 francs restait à payer en numéraire ou en valeurs allemandes, en un certain nombre de versements. Ces énormes versements ne pouvaient, en aucun cas, donner lieu à l'ouverture d'un compte courant. Ils devaient être faits à des dates fixées par les traités ou déterminées par des avis donnés trois mois à l'avance. Plus tard, et par la convention signée à Versailles le 29 juin 1872, relativement au payement des trois derniers milliards, le gouvernement français fut autorisé à faire des anticipations de 100 millions de francs au moins après un avis donné un mois à l'avance, mais jamais il ne lui fut permis de verser des acomptes en compte courant. Il résulte de ces diverses stipulations : 1° Que les payements faits par le gouvernement français, en valeurs anglaises ou hollandaises, en tin mot en valeurs autres qu'allemandes, étaient convertis en valeurs allemandes aux frais du 3ouvernenment français par le gouvernement allemand ; 2° Que les effets allemands appartenant au gouvernement français ne pouvaient pas, au fur et à mesure de leur échéance, donner lieu à des versements en compte ; mais que les fonds encaissés aux échéances diverses de ces effets devaient être déposés chez les correspondants du Trésor français, pour figurer dans des versements dont la date et l'importance avaient être fixés à l'avance. Les époques de versement ont été ultérieurement changées et avancées par la France pour obtenir une évacuation plus prompte du territoire, mais le mode de payement a toujours été soumis aux deux obligations indiquées plus M'in. Aux 4.549.901.600 francs, à payer en numéraire ou en valeurs allemandes, il faut ajouter les intérêts, soit 301.145.078 fr. 44 ; de sorte que la dette totale s'est élevée à 5.301.145.078,44 francs, dont il a payé en compte 325.098.400 fr., et le reste 4.976.046.678,44 fr. a dit être payé : 125.000.000 francs en billets de Banque de France, et 4.851.047.678 fr. 44 en numéraire ou valeurs allemandes. Le montant total des sommes remises à l'Allemagne par le Trésor français a dépassé ce chiffre de 14.613.774 fr., 85, sur lesquels le gouvernement allemand a remboursé 700.000 francs, et a fourni pour compte 13.772.566 fr. 29 ; la différence, soit 141.208 fr. 57, reste à régler. En résumé : La dette en principal s'élevait à 5.000.000.000 francs. En intérêt : Au 2 mars 1872 : 150.000.000,00 Au 2 mars 1873 : 128.600.200,81 Au 5 septembre 1873 : 22.544.871,63 Soit au total : 5.301.145.078,44 francs. Le Trésor a remis en compte ou en valeurs 5 315 758 853 fr. 29. Ce qui excédait le chiffre total de la dette de 14.613.774,85 francs Cet excédent a été réduit par un remboursement de 700.000 frs, soit à : 13.913.774,85 francs. Il reste à régler une somme en suspens de : 141.208,56 frs ; la différence, soit 13.772.566,29 francs. Est représentée par l'escompte d'effets non échus, remis en payements, escompte montant à : 2.412.317,40 francs. Et par les pertes sur réalisation et frais de négociation de valeurs remises au gouvernement allemand en devises étrangères et converties en monnaie allemande au compte du gouvernement français : 11.360.248,89 francs. Ensemble : 13.772.516,29 francs. Les comptes rendus publiés en Allemagne portent à 1.484.551.274 thalers le montant des sommes reçues de la France, ce qui, à raison de 3 fr. 75 par thaler, représente 5.567.067.277 fr. 50 ou, en plus des sommes indiquées plus haut, 251.308.424 fr. 50. Cette différence s'explique par les contributions de guerre imposées aux villes de France, y compris celle de Paris, contributions que nous n'avons pas fait figurer dans le compte que nous établissons en ce moment. L'opération totale a été divisée en deux parties, celle des deux premiers et celle des trois derniers milliards. L'opération des deux premiers milliards a commencé le 1er juin 1871 et a été close par le payement des intérêts sur les trois milliards restant dus, le 6 mars 1872. Elle s'est effectuée au moyen de deux compensations et de seize versements. On a compté comme un seul versement la suite des versements partiels auxquels ont donné lieu le payement du solde du premier, des second et troisième demi-milliards, parce que ces versements ont dû être effectués à Strasbourg, au fur et à mesure de l'envoi, qui était fait à l'agent français qu'on y avait délégué, des monnaies allemandes, de l'or et de l'argent français et des valeurs de portefeuille. Chaque payement était clos par un reçu allemand, lorsque le comptage était terminé. Ce comptage a toujours été long, et pour les monnaies allemandes, en particulier, il ne s'élevait pas à plus de 800.000 francs par jour. L'opération des deux premiers milliards a compris, tant en capital qu'en intérêt, 2 milliards 161.958.767 fr. 43. Les compensations — valeur du chemin de fer de l'Est et prise en compte du solde redit par l'Allemagne à la Ville de Paris — se sont élevées à : 325.098.400 francs, les billets de la Banque de France numéraires et valeurs à : 1.836.860.367,43, soit ensemble : 2.161.958.767,43 La somme de 1.836.860.367 fr. 43 se décompose comme il suit :
L'opération des trois derniers milliards a commencé le 29 août 1872 et a été close le 5 septembre 1813 Elle s'est effectuée au moyen de dix-sept payements. Elle a compris, tarit en capital qu'en intérêts 3.153.800.085 fr. 86. Cette somme se décompose comme il suit :
Si on réunit ces deux tableaux en un seul, on a la composition suivante de la somme de 4.990.660.453 fr. 29.
Le rapport de M. Léon Say indiquait ensuite : 1° L'époque et le montant des versements faits à l'Allemagne en numéraire, billets de banque on valeurs, 2° La preuve que les fonds destinés au paiement de l'indemnité de guerre n'avaient jamais servi aux dépenses générales des budgets et avaient été employés aussi rapidement que possible à la libération de la dette qui devait amener la libération du territoire ; 3° Comment les ressources réalisées avaient été transformées pour pouvoir être employées dans les versements à l'Allemagne, c'est-à-dire comment on avait procédé pour faire passer le montant de l'indemnité de guerre de France en Allemagne ; 4° Comment s'était opéré le dépôt des capitaux appartenant au Trésor chez ses correspondants à l'étranger ; 5° Comment, des procédés employés par le gouvernement français pour réunir les ressources destinées à payer les 5 milliards, le plus productif avait été l'acquisition de lettres de change ; 6° Enfin le mouvement des affaires internationales expliqué par l'importation et l'exportation des marchandises, du numéraire on des titres de 1867 à 1873. Après l'exposé savant et minutieux de ces opérations qui faisait le plus grand honneur à sa compétence et à sa haute intelligence des affaires financières, M. Léon Say disait que les choses s'étaient passées pour l'opération qui avait pour but le paiement de l'indemnité de guerre comme si les 5 milliards avaient été remis à Berlin en titres de rente et comme si les Français avaient envoyé leurs épargnes à Berlin, de même qu'ils les envoyaient auparavant en Italie, aux Etats-Unis, en Autriche et en Turquie pour acheter de la rente italienne, américaine, on turque, on des actions et obligations des chemins de fer autrichiens. Il concluait ainsi : Après avoir terminé l'exposition
des faits, il est facile d'en tirer une conclusion générale. La France est un pays où il se
fait des épargnes annuelles dans des proportions considérables ; elle n'a
cessé d'en faire au milieu de ses malheurs que pendant nu temps très court,
et encore pendant cet espace de temps l'arrêt des épargnes n'a-t-il pas été
général. Dès la fin de 1871, pendant toute
l'année 1872, le cours antérieur des choses s'est réformé ; le flot des
épargnes a recommencé à monter. Un emploi tout naturel de ces ressources
nationales s'est offert dans les grands emprunts français qui ont jouté le rôle
que les émissions de valeurs étrangères avaient joué les années précédentes. C'est une grande consolation que d'assister à un pareil spectacle ; car on y trouve le secret de notre force vive. li n'est pas douteux que par la continuation de ce mouvement les épargnes françaises ne rétablissent, s'il ne l'est déjà, notre stock métallique et qu'après l'avoir reconstitué, elles ne sollicitent un emploi dans des entreprises industrielles nouvelles à l'intérieur ou à l'étranger. L'opération des 5 milliards n'a réussi que parce qu'elle a pu être, pour ainsi dire, moulée sur les facultés du pays, au fuir et à mesure que ces facultés se sont révélées. Le succès de cette opération sans précédent tient à la prudence, mêlée à une sorte de témérité, avec laquelle elle a été conduite. Il fallait agir vite pour arriver promptement à la libération du territoire, assez vite pour employer toutes les épargnes réelles et tout le change possible, assez prudemment pour ne pas dépasser une limite au-delà de laquelle on aurait eu à se débattre contre une crise financière des plus graves et une crise monétaire qui aurait pu renouveler les désastres du papier-monnaie, heureusement inconnus en France depuis soixante-quinze ans. Tout a été combiné avec une
grande sagesse et un rare bonheur. C'est un titre d'honneur de plus pour le
grand citoyen qui avait reçu cette tâche de l'Assemblée nationale, tâche
qu'il a accomplie le 15 mars 1873, lorsque son gouvernement a cru pouvoir
proposer à l'Assemblée de fixer au 5 septembre suivant le terme du dernier paiement
de l'indemnité de guerre, et le 20 mai 1873, lorsque les dernières mesures
ont été arrêtées par lui avec la Banque de France, Il appartenait au gouvernement nouveau, institué par l'Assemblée nationale le 24 mai 1873, d'achever la libération du territoire et de rendre définitivement la France à elle-même. Mais on ne saurait finir l'histoire de l'opération financière dont rions achevons le compte rendu, sans rendre aux agents du Trésor et à l'administrateur éminent qui a dirigé le mouvement des fonds, la justice qui leur est due. Dans une situation unique, où tout était à créer, où il fallait improviser tous les jours, où les agents du Trésor devaient se transformer en banquiers, en cambistes, en acheteurs et vendeurs de métaux précieux et souvent ne pas reculer devant les plus grosses responsabilités, personne n'a été au-dessous de sa tâche. L'administration française en a reçu un nouvel éclat. XXXVII LES DRAPEAUX DE METZIEXTRAIT DU RAPPORT DU MARÉCHAL BARAGUEY D'HILLIERS AU NOM DU CONSEIL D'ENQUÊTE SUR LA CAPITULATION DE METZ 12 avril 1872 ... Le maréchal Bazaine affirme qu'au Conseil du 26 octobre, il donna au général Soleille, commandant en chef de l'artillerie, l'ordre verbal de faire prendre dans les corps d'armée et porter à l'Arsenal pour y être détruits, les drapeaux des régiments. Cet officier général déclare ne pas se souvenir qu'un ordre verbal lui ait été donné à ce sujet. Il produit au Conseil d'enquête la copie des ordres qu'il a adressés à la date du 27 aux généraux commandant l'artillerie des corps d'armée et au colonel directeur de l'Arsenal. Il prescrivait aux premiers, conformément à l'ordre du maréchal, de faire prendre les drapeaux dans les corps d'armée et de les faire porter à l'Arsenal ; il ordonnait au directeur de l'Arsenal de recevoir les drapeaux et de les conserver pour être inventoriés avec le matériel de la place ; nulle mention n'était faite de leur destruction. Les commandants de corps ayant refusé de livrer leurs drapeaux sur une simple communication transmise par le général commandant en chef de l'artillerie, le maréchal leur envoya l'ordre écrit de faire porter les drapeaux à l'Arsenal le 28 au matin, les informant par lettre qu'ils y seraient brûlés. Mais cette lettre ne fut écrite et expédiée que le 27 au soir après le départ du général Jarras pour le château de Frescati. Le maréchal savait donc que l'ordre qu'il donnait de verser les drapeaux à. l'Arsenal pour y être détruits le 28 au matin, c'est-à-dire après la capitulation signée, ne pourrait être exécuté à ce moment sans violation des stipulations consenties. Aussi le 28, écrivait-il au colonel de Girels, directeur de l'Arsenal, de conserver les drapeaux et de ne les rendre sous aucun prétexte, et qu'il le rendait personnellement responsable. Le maréchal essaie en vain de dégager sa responsabilité dans cette affaire en se plaignant de la lenteur avec laquelle ses ordres furent exécutés... Depuis le 25 au soir, le maréchal était informé que l'une des clauses de la capitulation stipulerait la remise des drapeaux à l'ennemi. Or, le protocole ne fut signé que le 27 à dix heures du soir. Le temps ne manquait donc pas pour les détruire avant la signature de la capitulation et, dans tous les cas, le maréchal n'avait qu'à faire prévenir les corps de ne pas en opérer le versement à l'Arsenal et de procéder eux-mêmes à cette destruction. Il se serait ainsi soustrait loyalement à l'humiliation de les livrer. Au contraire, le 28, il faisait prévenir le général de Stiehle que 41 drapeaux avaient été réunis à l'Arsenal pour lui être remis. Il y en avait réellement 53 inventoriés par le directeur de l'artillerie et afin qu'il ne restât pas trace aux yeux de l'ennemi de l'ordre dont l'exécution l'eût privé de ce trophée, il faisait enlever du registre de correspondance la page MI cet ordre avait été transcrit... Le Conseil blâme le maréchal d'avoir livré à l'ennemi les drapeaux qu'il pouvait et devait détruire, et d'avoir mis ainsi le comble à l'humiliation de braves soldats dont son devoir était de sauvegarder l'honneur. (Cf. le Rapport du général de Rivière, le Résumé général et les séances du Conseil de guerre de Trianon des 28 et 29 novembre et 1er décembre 1873.) IIRÉQUISITOIRE DU GÉNÉRAL POURCET Après avoir raconté la triste affaire des drapeaux de Metz et révélé les manœuvres et les subterfuges indignes du maréchal Bazaine qui enleva perfidement à ses soldats les glorieux emblèmes qu'ils voulaient défendre au prix de leur vie, le général Pourcet ajoute : L'armée du Rhin, dans toutes les batailles livrées par elle, ne laissa aux mains des Prussiens ni un aigle ni un canon. En revanche, elle leur enleva un drapeau et deux pièces d'artillerie. Voilà les véritables trophées de la campagne ! Le général flétrit la conduite du commandant en chef qui obéit à l'injonction hautaine du vainqueur et livra 53 drapeaux qui allèrent décorer le quartier général allemand, et obligea ainsi nos malheureux soldats, conduits en captivité, à subir le douloureux spectacle de cet insultant triomphe. Qu'est-ce que le drapeau ? disait avec émotion le général Pourcet. Faut-il le redire encore, après tant d'autres dont vous avez vu couler ici les larmes plus éloquentes que des phrases ? A coup sûr, le drapeau est quelque chose qui leur tenait au cœur, à ces hommes de forte trempe et de haut courage, puisqu'ils suffoquaient au seul souvenir de ces heures d'angoisses, pendant lesquelles nue indigne intrigue les enveloppait et dérobait à leur vigilance les trophées qui ornent aujourd'hui les églises et les basiliques de Berlin ! Quelques-uns vous l'ont dit : ces drapeaux cachés dans des fourgons et cachés à tous les regards, c'était comme un lambeau de leur honneur, comme une part de leur âme qu'on leur arrachait et ceux qui les escortaient avaient l'air de conduire le deuil de la patrie. C'était en effet le deuil de sa gloire éclipsée, le deuil de son bonheur perdu !... XXXVIII Lettres de Napoléon III à l'impératrice.ISedan. Quartier impérial, 2 septembre 1870. Ma chère Eugénie, Il m'est impossible de te dire ce que j'ai souffert et ce que je souffre. Nous avons fait une marche contraire à tous les principes et au sens commun ; cela devait amener une catastrophe. Elle est complète. J'aurais préféré la mort à être témoin d'une capitulation si désastreuse et cependant, dans les circonstances présentes, c'était le seul moyen d'éviter une boucherie de 60.000 personnes. Et encore si tous nies tourments étaient concentrés ici ! Je pense à toi, à notre fils, à notre malheureux pays. Que Dieu le protège ! Que va-t-il se passer à Paris ? Je viens de voir le roi. Il a eu les larmes aux yeux en nie parlant de la douleur que je devais éprouver. Il met à ma disposition un de ses châteaux près de Hesse-Cassel. Mais qu'importe où je vais ! Je suis au désespoir. Adieu, je t'embrasse tendrement. NAPOLÉON. IIBouillon, le 2 septembre 1870. Ma chère Eugénie, Après les malheurs irréparables dont j'ai été témoin, je pense aux dangers que tu cours et je suis bien inquiet des nouvelles que je recevrai de Paris. La catastrophe qui est arrivée devait avoir lieu. Notre marche était le comble de l'imprudence et, de plus, elle a été très mal dirigée. Figure-toi une armée entourant une ville fortifiée et étant elle-même entourée par des forces supérieures. Au bout de quelques heures nos troupes ont voulu rentrer en ville. Alors, la ville s'est trouvée remplie d'une foule compacte et sur cette agglomération de têtes humaines, les obus pleuvaient de tous côtés, tuant les personnes qui étaient dans les rues, renversant les toits, incendiant les maisons. Dans cette extrémité, les généraux sont venus me dire que toute résistance était impossible. Plus de corps constitués, plus de munitions, plus de vivres ! On a tenté de faire une trouée, mais elle n'a pas réussi... Je suis resté quatre heures sur le champ de bataille. La marche d'aujourd'hui au milieu des troupes prussiennes a été un vrai supplice. Adieu, je t'embrasse tendrement. NAPOLÉON. (Mémoires du docteur Th.
Evans, p. 203-204.) XXXIX Lettre du prince impérial à M. Taine après la lecture de son livre sur l'Ancien régime.Camden Place, Chislehurst, le 8 octobre 1877. Monsieur, Tous ceux qui sont désireux de s'éclairer sur la situation de notre pays et de rechercher les causes de l'instabilité de notre état social vous doivent de la reconnaissance pour votre ouvrage sur les Origines de la France moderne. On 'ne peut exposer d'une manière plus séduisante le résultat de plusieurs années de recherches laborieuses et de méditations profondes. J'ai tenu à m'acquitter personnellement de ma dette de gratitude en vous écrivant ces lignes. Non seulement votre livre est venu répondre à un besoin de mon esprit, mais il m'a donné une véritable satisfaction de cœur. Éloigné de mon pays, j'y vis du moins par la pensée et grâce à vous, monsieur, j'ai pu passer de longues heures en France. Croyez, je vous prie, à mes meilleurs sentiments. NAPOLÉON. Taine répondit au prince le 16 octobre que son étude avait été faite par lui en simple historien, n'ayant jamais pris part aux luttes politiques et placé en dehors de tout esprit de parti. Il constatait que les Français avaient encore besoin de savoir l'histoire de la Révolution, comme celle du Consulat et de l'Empire. Il regrettait que les sciences historiques, morales, politiques et économiques fussent arriérées chez nous et connue engourdies, mais il comptait sur l'École des Hautes Études et sur l'École libre des Sciences politiques pour combler cette lacune. Mon livre, disait-il, n'est qu'un document parmi ceux qui sortiront de cette école, un mémoire à consulter par les hommes qui, sont ou peuvent devenir des hommes d'État. J'ai rencontré souvent de pareils Mémoires aux Archives : leur but était atteint quand ils étaient lus par les cinq ou six personnes qui pouvaient en faire usage. Je voudrais que cela m'arrivât et puisque vous m'avez lu, monseigneur, cela commence à m'arriver. (Correspondance de M.
Taine, t. IV, 38 à 40.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||