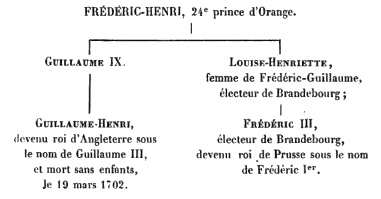L'EUROPE ET LES BOURBONS SOUS LOUIS XIV
AFFAIRES DE ROME. — UNE ÉLECTION EN POLOGNE. — CONFÉRENCES DE GERTRUTDENBERG. — PAIX D'UTRECHT
CHAPITRE XV.
|
Conséquences du voyage de Bolingbroke. — La Savoie, le Portugal et la Prusse se séparent tour à tour de la grande alliance. — Victor-Amédée II et sa politique. — Jean V et l'Angleterre. — L'Électeur de Brandebourg. — Son ambition. — Ses prétentions. — Points sur lesquels elles portent. — Nature et examen de chacune de ces prétentions. — Origine des droits de Frédéric Ier sur le duché de Gueldre, sur la principauté d'Orange et sur celle de Neufchâtel. — Situation de la Hollande. — Elle accorde la réparation demandée par Louis XIV. — Parfaite entente des ambassadeurs réunis à Utrecht. — Prétentions de la Hollande. — Discussion de ces prétentions. — Rôle qu'elle aurait pu jouer dans les négociations. — Considérations sur sa politique. — Importance majeure du traité d'Utrecht pour la Grande-Bretagne. — Avantages immenses que cette puissance en a retirés. — Conséquences du traité d'Utrecht pour la France et pour Louis XIV. — Ce qu'a été ce traité pour la France. — Questions secondaires soumises au congrès. — Duché de Luxembourg. — Princesse des Ursins. — Pic de la Mirandole. — Le seigneur de Forbin. — Prétentions du duc de la Trémouille, du duc de Saint-Pierre et de la maison de Condé. — Démarche du roi de Prusse en faveur des protestants. — Sa demande n'est pas accueillie par Louis XIV. — Intolérance de Louis XIV. — Signature des divers traités. — Causes qui empêchent Polignac de les signer. — Publication de la paix à Paris. — Fêtes en l'honneur de la paix. Le voyage de Bolingbroke produisit à Utrecht une profonde impression. Il affermit la situation des ministres français et anglais, et il contribua à anéantir les dernières espérances des représentants de la Hollande et de l'Allemagne. Toutefois leur résistance survécut à leurs illusions, et ils la prolongèrent même après avoir été convaincus de son entière inutilité. Il n'en fut pas de même des autres alliés. Parmi les six nations qui composaient la grande alliance, l'Angleterre s'était la première détachée du formidable faisceau. La Savoie, le Portugal et la Prusse imitèrent successivement cet exemple, mais sans être entraînés par le même mobile. L'Angleterre n'avait considéré que le nouvel intérêt européen. Le Portugal céda au désir, qui lui était déjà naturel, de suivre dans sa politique la direction anglaise ; la Prusse fut séduite par les satisfactions pour la première fois accordées à son ambition naissante, et la Savoie, déterminée par la certitude que son avidité ne pouvait pas espérer de plus belles dépouilles. Étant entrées dans la coalition pour des intérêts secondaires et particuliers, ces trois puissances s'y étaient maintenues même après que l'intérêt général et européen avait été satisfait. Mais elles durent s'en séparer dès qu'elles comprirent que la prolongation d'une lutte, dont l'issue devenait d'ailleurs douteuse, ne leur procurerait pas des avantages plus considérables. Le duc de Savoie se prononça le premier, non sans avoir longtemps hésité et longuement débattu les conditions d'une entente avec la France. Ce prince, le plus rusé et le plus perfide des alliés, qui avait deux fois manqué à ses engagements et, pendant trois années, dirigé une armée française, quoique déjà lié par un traité avec les impériaux, montra autant de duplicité dans le cours des négociations que durant la guerre. Satisfaire ses convoitises fut son unique et constante préoccupation. Il sut, par son représentant à Londres, flatter la reine Anne et la disposer habilement à défendre la cause du Piémont avec autant d'insistance que celle de l'Angleterre. Initié, dès le revirement de la politique anglaise, aux actes les plus secrets, il participa à la fois, à Londres, aux délibérations qui, depuis 1710, tendaient vers la paix[1], et, en Hollande, aux mesures destinées à la rendre impossible. Ses ambassadeurs à Utrecht suivirent la même tactique, et, malgré les récriminations de leurs collègues, ils nouèrent avec les plénipotentiaires français des relations qu'aucun des événements auxquels nous venons d'assister ne put rompre. Mais ni ces rapports journaliers, ni de souterraines manœuvres, ne pouvaient amener une solution. L'espoir d'obtenir plus encore que n'offrait Louis XIV retenait Victor-Amédée II parmi ses ennemis, et son avidité insatiable produisait sur la marche des négociations le même effet que l'implacable ressentiment de la Hollande. Afin de prescrire des bornes à cette avidité, le gouvernement anglais envoya à Turin le fameux comte de Peterborrouw, devenu tory par haine de Marlborough, que son humeur vagabonde avait fait l'hôte de toutes les nations[2], et dont le caractère plein d'originalité comme de franchise, aussi fier qu'impétueux et plus ardent encore que mobile, devait le rendre propre à accomplir un très-grand nombre de missions avec autant de succès[3] qu'il avait montré de courage à la tête des armées. Peterborrouw aborda le duc de Savoie avec des allures toutes militaires, et il le combattit, sur ses lenteurs et ses tergiversations, avec l'aisance un peu brusque et la célérité d'un homme qui se presse vers le but parce qu'il sait en avoir plus d'un à atteindre. Victor-Amédée ayant affecté de redouter les représailles de la maison d'Autriche, s'il se ralliait à Louis XIV, Peterborrouw, qui connaissait le peu de sincérité de ces appréhensions, parut néanmoins les accepter, et fit remarquer qu'en ce cas la France viendrait au secours du Piémont avec ses troupes, tandis que l'Angleterre le soutiendrait au moyen de ses subsides. L'envoyé de Bolingbroke termina en déclarant au duc de Savoie que, s'il hésitait plus longtemps, il perdrait, aux yeux de la reine, les bénéfices de sa situation, et, la paix faite avec l'Angleterre, il resterait exposé aux, justes exigences de Louis XIV. Ce langage modifia complètement la conduite du duc de Savoie et celle de ses représentants à Utrecht. Il abandonna les chimériques prétentions, de peur de voir un jour rejetées les légitimes demandes, et, sans insister sur la possession de Briançon et de Barcelonnette[4], il accepta les Alpes comme devant être la naturelle frontière des deux États. Puis il rompit avec la grande alliance[5], qui lui valait le titre de roi, la Sicile plus tard échangée contre la Sardaigne, et une avantageuse rectification de sa frontière du nord, et qu'il abandonna, bien convaincu qu'en y demeurant il n'obtiendrait pas de conditions plus favorables. Moins exigeant et moins avide, mais aussi peu digne d'intérêt par sa conduite, le despotique roi de Portugal se retira avec beaucoup moins de bonheur d'une guerre où il avait essuyé des affronts humiliants et de désastreuses défaites. Battu à Almanza et à Villaviciosa, ayant perdu l'opulente Rio Janeiro, prise par Duguay-Trouin, privé ainsi d'une grande partie de son armée et de ses principales ressources coloniales, Jean V n'eut bientôt plus d'espoir que dans l'exécution des promesses de l'archiduc Charles[6]. Mais celui-ci, qui devait lui donner l'Estramadure, avait, à la mort de Joseph son frère, quitté l'Espagne qu'il s'était d'ailleurs aliénée, et prenait possession du trône impérial. Ce départ, et le revirement opéré dans la politique anglaise, ayant fait de Jean V le seul représentant dans la Péninsule du parti autrichien, ce prince, qui n'avait jamais eu les passions acharnées de la grande alliance, et qui se trouvait trop éloigné du cœur même de la coalition pour en recevoir le contact fortifiant, devint indifférent pour une entreprise qui ne l'avait jamais directement intéressé, à laquelle il avait fait, de tous les alliés, les plus durs sacrifices, et dont il prévoyait être le seul qui n'en retirerait aucun profit. Jean V était d'ailleurs puissamment entraîné par l'exemple de l'Angleterre à laquelle, par le funeste traité de Methuen[7], son prédécesseur avait enchaîné pour cent ans le commerce et l'industrie du Portugal, et, par une conséquence presque inévitable, sa politique. Il suivit donc la voie tracée par une nation déjà en quelque sorte dominatrice de la sienne. Il signa une trêve avec Philippe V, retira ses troupes de l'Estramadure, et il fit savoir, par ses représentants à Utrecht, à ceux de la reine Anne, qu'il réduisait ses prétentions à l'acquisition de quelques territoires sur les deux rives du fleuve des Amazones. Le comte de Strafford et l'évêque de Bristol ayant fermement appuyé cette demande, Louis XIV consentit à l'admettre, et le Portugal se retira de la grande alliance[8], agrandi de quelques possessions lointaines, mais après avoir essuyé des désastres, ruiné ses finances et s'être condamné à graviter pendant un siècle autour de la Grande-Bretagne ! Les demandes de la Prusse étaient plus importantes que celles du Portugal, et surtout bien plus étroitement liées aux plus chers intérêts de sa dynastie. Devant son existence principalement au protestantisme et aux sécularisations ecclésiastiques du seizième et du dix-septième siècle, la Prusse n'avait pas reçu encore la consécration du droit. Ayant représenté jusque-là en Allemagne le mouvement nouveau du monde, et introduit la première dans l'État la liberté de conscience, elle en avait fait son principe. Mais, tout en voulant se maintenir dans l'esprit de son origine, elle nourrissait la naturelle ambition de s'élever au rang des grandes puissances, d'être reconnue par elles, et, pour cela, de s'introduire en égale dans le grand congrès alors réuni à Utrecht. C'était comme une parvenue, parmi les monarchies, qui demandait ses lettres de noblesse aux vieilles puissances de l'Europe. Ce titre de roi, que l'électeur de Brandebourg avait ambitionné depuis son arrivée au pouvoir, il s'en était emparé, dès 1701[9], avec le consentement intéressé[10] de l'imprudent empereur d'Allemagne[11] qui avait cependant refusé de le reconnaître pour duc séculier cinq ans auparavant. Mais ni la pompe éblouissante avec laquelle le nouveau monarque se fit sacrer, ni l'appareil de luxe et de magnificence dont il s'entoura, en imitant servilement la cour de Versailles[12], ne purent donner du lustre à cette trop récente couronne. La majesté et le prestige d'un trône ne s'improvisent pas, et c'est du temps seul qu'ils sont l'œuvre. Je vais jouer le rôle d'une reine de théâtre, dit l'électrice en se rendant à la cérémonie ordonnée par son ambitieux époux. Celui-ci le comprit sans l'avouer ; mais, à défaut de la consécration du temps dont il était privé, il rechercha l'adhésion de tous les souverains de l'Europe, et il en fit une des conditions essentielles de son consentement à la paix[13]. Là ne se bornaient point ses prétentions, et à un progrès si considérable dans sa fortune Frédéric Ier voulait faire correspondre un notable agrandissement dans ses possessions. Ses demandes portaient sur trois points également délicats, aussi contestés les un que les autres, et qui, avant d'être traités d'une manière définitive par la diplomatie, avaient déjà été débattus et profondément étudiés par la justice. Le souverain de Prusse revendiquait la propriété, dans les Pays-Bas, de la partie espagnole du duché de Gueldre, en France, de la principauté d'Orange, et, dans la Suisse, de celle de Neufchâtel[14]. Déjà possesseur du duché de Clèves, du comté de la Marck et de celui de Ravensberg, en vertu de la transaction conclue à Clèves, avec le duc de Neubourg[15], le 9 septembre 1666, Frédéric Ier désirait non-seulement arrondir ces trois territoires, mais aussi voir confirmer un droit de propriété pour lequel, bien que l'empereur Léopold eût, en 1678, ratifié la transaction de Clèves, ni ce souverain ni ses successeurs n'avaient jamais consenti à donner d'investiture. La confirmation du traité de 1666 ne faisait naître aucune objection. Il n'en était point de même de l'annexion de la partie espagnole du duché de Gueldre ; non pas que l'obstacle fût suscité par l'Espagne, qui, contrainte de renoncer aux Pays-Bas, ne se souciait point de conserver quelques territoires aussi lointains et de si minime importance. Mais ils étaient depuis longtemps le but des convoitises de la Hollande qui s'en était assuré la possession par le traité de barrière signé secrètement, le 29 octobre 1709, entre les torys et les Provinces-Unies. Il était impossible au cabinet de Londres de dépouiller cet allié pour en satisfaire un autre. Mais, ce traité ayant été déjà, ainsi que nous l'avons vu[16], vivement attaqué par le nouveau ministère et le parlement, et déclaré contraire aux intérêts de la Grande-Bretagne, il fut rompu. Les États de la possession desquels il avait prématurément disposé pouvaient donc être partagés d'une manière opportune et satisfaisante entre le roi de Prusse et les Provinces-Unies. Tandis que Frédéric Ier basait ses prétentions à la partie espagnole du duché de Gueldre sur la conquête et sur sa convenance, il réclamait la principauté de Neufchâtel comme héritier de la maison d'Orange, par la princesse Louise-Henriette, sa mère[17]. Il n'était pas seul à invoquer les droits du sang, et jamais principauté n'a provoqué autant de compétitions que celle de Neufchâtel au commencement du dix-huitième siècle. Parmi les prétendants, les uns, comme la comtesse de Mailly, le comte de Barbançon, le marquis d'Alègre et le prince de Montbéliard, tiraient leur droit de la maison de Châlons ; les autres, tels que le roi de Prusse et les princes de Nassau-Dietz et de Nassau-Siegen, soutenaient que la maison de CM-Ions s'était fondue dans celle de Nassau-Orange, dont ils étaient les représentants. Enfin les plus nombreux tenaient leur titre de la maison de Longueville, soit par un testament, comme le prince de Conti, soit par leur naissance, comme madame de Lesdiguières, le duc de Villeroi, le comte de Matignon et le prince de Carignan-Savoie. Un arrêt du parlement de Paris avait validé le testament fait en faveur du prince de Conti par le dernier descendant de la maison de Longueville[18]. Mais les États de Neufchâtel, sans tenir compte de cet arrêt, avaient jugé qu'on ne peut, dans un testament, disposer d'une province comme de son bien, et, niant les droits du prince de Conti, ils lui avaient préféré la duchesse de Nemours, sœur consanguine de leur dernier souverain. C'est en 1707, au moment où mourut cette princesse, ne laissant aucune postérité, que s'élevèrent de nouveau, et avec plus d'ardeur encore, les prétentions du roi de Prusse et celles de ses nombreux antagonistes. De hautes raisons politiques déterminèrent les fiers bourgeois de Neufchâtel à se prononcer en faveur de Frédéric Ier. Sa religion conforme à celle du pays, l'appui des autres cantons protestants, la crainte très-fondée,. si l'on désignait un des compétiteurs français, de voir Louis XIV s'emparer de cet État, ainsi qu'il l'avait fait pour la principauté d'Orange, et la certitude que ce danger, presque inévitable avec un sujet dépendant à u roi de France, serait écarté par le choix d'un prince tout-puissant et que soutiendraient d'ailleurs l'Angleterre et la Hollande contre les entreprises d'un trop ambitieux voisin, enfin le naturel désir d'avoir un protecteur qui fût assez éloigné pour ne pas céder à la tentation de devenir un maître, firent préférer le roi de Prusse. Un jugement provisionnel du 10 novembre 1707 l'avait déclaré l'héritier le plus proche des anciennes maisons régnantes[19], et lui avait confié l'administration de la province de Neufchâtel jusqu'au jour où un congrès général en réglerait le sort définitif. Frédéric P' produisait, pour revendiquer la principauté d'Orange, les mêmes titres que pour celle de Neufchâtel. Mais il avait rencontré un dangereux compétiteur en Jean-Guillaume le Frison, prince de Nassau-Dietz[20], et que Guillaume III d'Angleterre, prince d'Orange, avait fait son héritier en 1702. A ces deux prétendants s'était joint le prince de Conti, représentant la maison de Longueville. Pendant qu'ils remplissaient l'Europe dé leurs contestations et de leurs plaintes, Louis XIV, faisant valoir l'hommage de cette principauté, qui avait été rendu, en 1475, par Guillaume VII à Louis XI, comme dauphin du Viennois[21], déclara, qu'à défaut d'héritiers directs mâles, elle était dévolue à la couronne. Un arrêt du parlement de Paris était intervenu qui, confirmant cette doctrine, avait adjugé au prince de Conti le domaine utile d'Orange, et le haut domaine au roi de France. Toutefois, le roi de Prusse et les enfants de Jean-Guillaume de Nassau persistaient dans leur revendication, et, tandis que ceux-ci la soutenaient dans de longs mémoires adressés aux plénipotentiaires réunis à Utrecht[22], le premier la faisait entrer au nombre des conditions sans lesquelles il n'acceptait pas la paix[23]. De ces quatre demandes, les deux seules qui concernaient le titre de roi et la principauté de Neufchâtel, pouvaient être accueillies. Mais, maintenir ses Prétentions sur la totalité de la dépouille espagnole dans le duché de Gueldre, et surtout espérer posséder, dans le cœur même de la France, une province qui revenait à la couronne, non-seulement par sa situation, mais encore selon les usages les plus anciens et les traditions les plus respectées de la monarchie, c'était révéler de bien bonne heure une envahissante ambition. L'Angleterre sut l'arrêter, et Bolingbroke termina par ces mots une dépêche adressée au représentant du roi de Prusse à Utrecht[24] : Ce qui se passe depuis quelque temps change tout à fait notre système pour les affaires du Nord. En ami sincère, je vous confierai mon opinion qui est que la reine parlera dans ces quartiers par la bouche de son amiral. Vous venez de nous ôter une grande dépense qui nous pesait extrêmement[25]. Une partie de ce que nous épargnerons sera appliquée à la marine. Menace opportune, menace adroite, car les puissances du Nord devaient craindre que la Suède, abaissée par les défaites de Charles XII, ne fût relevée, grâce à l'assistance anglaise, et ne leur devînt de nouveau redoutable ! Cette utile intervention eut l'effet qu'en espérait le cabinet de Londres[26], et Frédéric Ier quittait à son tour la coalition, reconnu roi par toute l'Europe, maintenu en qualité de prince de Neufchâtel et ayant accru et fortifié ses possessions du côté des Pays-Bas. C'est ainsi, c'est par cet audacieux empressement à profiter des querelles religieuses comme à s'immiscer habilement dans les luttes territoriales, que ce royaume nouveau grandissait avec une telle rapidité, et que Frédéric Ier, dont le père avait reçu du roi de Pologne l'investiture du duché de Prusse, fut l'aïeul du grand Frédéric ! Ces trois défections successives, dues à l'exemple et à l'influence de la Grande-Bretagne, ébranlèrent l'obstination de la Hollande, qui demanda à renouer les conférences interrompues depuis l'insulte publique ordonnée par un de ses représentants à Utrecht[27]. Son isolement presque absolu n'était pas la seule cause de cette modération inaccoutumée. Elle commençait à ressentir les nombreuses blessures reçues durant la guerre, et que, dans l'ardeur de la lutte et l'ivresse de la passion, elle avait ignorées ou négligées. Une dépopulation considérable et un complet abandon de l'industrie, des finances si désorganisées qu'une longue période de paix et d'économie ne suffit point pour les rétablir entièrement, une marine si affaiblie que, depuis lors, il n'a pas été possible de lui rendre le rang où l'avaient élevée Tromp et Ruiter, un commerce tellement restreint qu'aucun effort n'a pu dans la suite l'étendre bien davantage[28] : telles étaient les plaies profondes que la guerre de la succession d'Espagne laissait à cet État si récemment émancipé, et qui devaient épuiser et absorber ses forces naissantes. En même temps que diminuaient les ressources, s'accroissaient les charges, et, tandis que jusqu'alors l'Angleterre avait fourni des subsides pour une partie des armées de la coalition, la Hollande était maintenant contrainte de solder les troupes mercenaires qui s'étaient séparées du duc d'Ormond au moment de la suspension d'armes[29]. Enfin, l'opinion publique, quelques efforts que fissent les whigs pour continuer à l'égarer, appréciait mieux les intérêts réels des Provinces-Unies, et la vérité, longtemps méconnue par la passion ou dissimulée par l'intrigue, commençait à se faire jour et à pénétrer dans les masses. Avant d'accueillir la demande des Provinces-Unies, qui était déjà une soumission, Louis XIV exigeait la réparation, dont il avait lui-même déterminé la forme. Les États généraux y condescendirent. Déjà ils avaient adressé aux ambassadeurs français un mémoire dans lequel, sans avouer ni condamner le comte de Rechteren, ils déclaraient qu'une affaire de cette nature ne devait pas être un obstacle à la négociation de la paix ; que leur intention n'avait jamais été de manquer de respect à un aussi grand prince que le roi de France ; et que, pour marquer leur sincérité, ils consentaient à ce que le comte de Rechteren ne fût plus envoyé aux conférences d'Utrecht[30]. Louis XIV n'ayant pas estimé cette déclaration suffisante, Vanderdussen, le baron de Renswoude et le comte de Kniphaussen, plénipotentiaires des provinces de Hollande, d'Utrecht et de Groningue, se présentèrent, au nom des États généraux, chez le maréchal d'Huxelles, et là, en présence de Polignac, de Ménager, des secrétaires de l'ambassade et de nombreux personnages, ils lurent l'acte de réparation qu'avait demandé Louis XIV. Il y était dit que Rechteren n'avait jamais reçu aucun ordre qui pût autoriser la conduite qu'il avait tenue ; que les États généraux la désapprouvaient et seraient très-fâchés si Sa Majesté pouvait croire qu'ils eussent en intention de manquer au respect qui lui était dû ; que la commission de Rechteren cesserait, et que, suivant la constitution du gouvernement hollandais, leurs hautes puissances écriraient aux États de la province d'Overyssel de nommer un autre plénipotentiaire[31]. Après une telle démarche, qui fut constatée par un acte envoyé au cabinet de Versailles, Polignac avait le droit d'écrire à Torcy : Nous prenons la figure que les Hollandais avaient à Gertruydenberg, et ils prennent la nôtre. C'est une revanche complète[32]. Toutefois, si la revanche était complète dans les situations, elle ne le fut pas dans les procédés, et les représentants de Louis XIV s'efforcèrent d'adoucir[33], par l'aménité et la distinction de leurs manières, ce qu'il y avait d'amer et de mortifiant dans la réparation accordée. Ils y parvinrent, et l'abbé de Polignac surtout montra autant de généreuse bienveillance envers les humiliés d'Utrecht, qu'il avait opposé de résistance énergique aux impitoyables et despotiques adversaires de Gertruydenberg. Dès lors, les rapports de tous les ambassadeurs furent empreints d'une urbanité exquise et de la plus gracieuse cordialité. Seul le tenace comte de Zinzerdoff, isolé dans sa politique, voulut l'être également dans la vie privée[34], et s'exclure des fêtes qui marquèrent la fin des conférences. Mais, entraîné par ses collègues, il fut contraint de dissimuler son maussade désappointement sous une joie apparente, et de contribuer aux plaisirs communs par sa présence et par ses réceptions. L'arrivée à Utrecht de la brillante duchesse de Saint-Pierre[35], sœur du marquis de Torcy, donna plus d'éclat encore à ces fêtes, qu'elle anima de sa verve française, et qui, multipliées par elle[36] avec une fastueuse prodigalité que rendait facile l'immense fortune de son époux, ne furent interrompues que peu de temps avant la signature des traités[37], et par la mort du roi de Prusse. La conduite nouvelle des Provinces-Unies et le sacrifice qu'elles avaient su s'imposer en se soumettant aux réparations exigées par Louis XIV rendirent tout d'abord le ministère anglais favorable à leurs prétentions territoriales[38]. Naguère sur le point de signer la paix sans cette opiniâtre et intraitable puissance, il se sentit ramené par l'opinion publique vers cet ancien allié devenu tout à coup plus modéré, et qui, en embrassant enfin la politique anglaise, faisait oublier qu'il l'avait jusqu'alors obstinément combattue. Renonçant à l'ambition de posséder Lille, les Provinces-Unies persistaient à réclamer les places de Condé et de Tournay, outre celles de Menin, de Furnes, de Knocke, de Loo, d'Ypres et de Dixmude, que Louis XIV consentait à leur céder, et qui devaient former, contre les envahissements redoutés de la France, la barrière si ardemment désirée depuis 1672. Les demandes relatives au commerce étaient plus considérables encore. Les Hollandais exigeaient les privilèges commerciaux concédés aux Français en Espagne, l'exemption du droit d'entrée[39] établi sur les vaisseaux étrangers, et la substitution du tarif modéré de 1664 au tarif plus favorable à la France de 1699. De ces trois articles, Louis XIV accordait les trois premiers, bien qu'il privât ainsi la marine marchande de France d'un moyen de protection qui lui était alors très-nécessaire. Mais, ne voulant pas détruire quelques-unes des branches fort importantes du commerce français, il déclara qu'il continuerait à appliquer le tarif de 1699 aux quatre marchandises pour lesquelles le commerce non privilégié des négociants français était impossible, c'est-à-dire aux sucres, aux draps, aux baleines et aux salaisons. Les Provinces-Unies ayant persisté dans leurs exigences, le gouvernement de la Grande-Bretagne eut à faire connaître son opinion. Il se refusait à soutenir la demande de Condé[40] et il approuvait celle de Tournai[41], mais, en ce qui touchait au traité de commerce, il ne pouvait pas, si complète que fût la réaction opérée à Londres en faveur de la Hollande, prêter son appui à de telles prétentions. Il commença par tâcher d'obtenir de Louis XIV la cession de Tournai. Celui-ci se résignait avec peine à abandonner cette ville, que son histoire rattache aux temps les plus anciens de la monarchie française et dont le nom est glorieusement mêlé à celui de nos premiers rois. Néanmoins deux considérations l'y déterminèrent[42]. La santé chancelante de la reine Anne faisait redouter le prochain avènement de l'électeur de Hanovre au trône de la Grande-Bretagne, et, comme une conséquence presque inévitable, un changement de ministère et de politique. D'un autre côté, l'âge avancé de Louis XIV et les malheurs multipliés qui avaient frappé la famille royale rendaient prochainement certaine une minorité avant laquelle il était urgent d'assurer la paix d'une manière' définitive. Il consentit donc à l'abandon de Tournai. Dès lors, Strafford et l'évêque de Bristol mirent une telle insistance à faire départir les Hollandais de la demande de modification de tarif, et les menacèrent avec une telle énergie de terminer isolément l'œuvre d'un congrès réuni depuis plus d'une année, qu'ils cédèrent et furent contraints de renoncer à celle de leurs prétentions à laquelle ils attachaient peut-être le plus d'importance[43]. Utile et saisissant exemple des dangers qu'offre une politique inspirée par la passion étroite et mesquine 1 La Hollande avait tenu en son pouvoir à Gertruydenberg les destinées de la France. Si, au lieu de se repaître du spectacle de son abaissement et de ses humiliations, elle l'avait relevée de sa chute, qui ne pouvait être que passagère, et replacée au rang qui lui appartient parmi les nations, la Hollande aurait été l'arbitre de l'Europe et serait sortie de cette longue lutte avec d'immenses avantages et plus d'honneur. Mais, n'apercevant pas les larges et grandes vues, et poursuivant une vengeance vaine et stérile, elle s'est laissé enlever par l'Angleterre un rôle qu'elle n'a essayé qu'alors, mais trop tard, de remplir, et, au moment où elle aurait dû se consolider au rang de première puissance, qu'elle avait longtemps occupé, elle en est tombée tout à coup, et a vu s'ouvrir pour elle l'ère de la décadence ! Les glorieux résultats, que la persistante inimitié de la Hollande n'avait pu retirer de la guerre de la succession d'Espagne, la Grande-Bretagne les obtenait par la seule force de la situation politique où les torys avaient eu le génie de la placer. La première, et quand les autres alliés mettaient le plus violent acharnement à accabler Louis XIV vaincu, la nation anglaise avait écouté la voix des pénétrants politiques qui lui démontraient l'urgente nécessité de la paix pour l'Europe, les avait élevés au pouvoir et constamment fortifiés de l'inébranlable appui de son assentiment. Ainsi soutenus, les nouveaux ministres s'étaient hardiment séparés de la grande alliance, et, faisant de l'intérêt européen l'unique base de leur politique, ils l'avaient défendu durant les négociations tantôt contre la coalition trop impitoyable, tantôt contre la France pouvant devenir de nouveau trop menaçante. Cet intérêt européen valant mieux que les intérêts particuliers et distincts pour lesquels combattaient les autres puissances, et le lien qui les unissait étant rompu, elles résistèrent quelque temps encore isolément, mais sans succès, et elles durent bientôt abandonner la lutte et entrer dans la voie tracée par l'Angleterre. Mais à celle-ci, d'où était partie l'impulsion, appartint l'influence définitive, et c'est elle seule qui dicta les conditions de la paix d'Utrecht. Elle s'y préoccupa jusqu'au dernier jour de la grande cause qu'elle représentait, et rien ne put être conclu[44] avant que le duc de Shrewsbury[45] et lord Lexington, ses ambassadeurs, n'eussent été témoins[46], l'un à Paris et l'autre à Madrid, de l'enregistrement, par les parlements et par les cortès, des renonciations de Philippe V à la couronne de France, et des ducs de Berry et d'Orléans à celle d'Espagne. Mais l'Angleterre devait rechercher aussi les avanta.ges propres à son commerce, et, après avoir su prendre et su conserver la direction de la politique européenne, recueillir les fruits de son audacieuse et de son efficace intervention. Elle les obtint si précieux, qu'ils furent le principe et la source de la prospérité commerciale et maritime qu'elle a atteinte depuis cette époque. S'établissant à Gibraltar et à Port-Mahon, elle s'emparait de la domination de la Méditerranée. Par le traité de l'Assiento[47] elle accaparait le monopole de la traite des nègres. A ses pécheurs elle donnait l'île de Saint-Christophe, et, tandis que le port de Dunkerque était comblé, ses colonies s'accroissaient de Terre-Neuve, de la baie d'Hudson, de l'Acadie[48], et elle couvrait de ses comptoirs les rivages des deux océans sillonnés par ses vaisseaux. Si considérables que fussent pour l'Angleterre les résultats matériels de la guerre de la succession d'Espagne, ils l'étaient moins encore que ses conséquences morales. Elle habituait en effet l'Europe à voir les Iles-Britanniques intervenir directement dans les luttes continentales dont leur situation géographique semble devoir les écarter, et auxquelles, depuis longtemps, elles étaient restées étrangères. A l'inaction paresseuse et à l'humiliante subordination à la France des derniers Stuarts, succédait une politique active, hardie, indépendante, et qui, outre les avantages procurés par le succès, donnait le lustre et le prestige qui s'attachent à l'heureux accomplissement d'une grande mission. A quelques attaques qu'aient été plus tard en butte, de la part des whigs parvenus au pouvoir avec Georges Ier, les auteurs de cette glorieuse paix, il n'en est pas moins incontestable qu'ils ont admirablement servi leur pays. S'ils ont encouru ensuite le blâme passager de leurs injustes contemporains, ils ont mérité l'estime durable de la postérité qui doit placer leur nom, et surtout celui de Bolingbroke, parmi ceux des plus grands hommes de l'Angleterre. Pour la France, au contraire, le traité d'Utrecht fut une limitation. Destiné à contenir dans de justes bornes l'ambition de Louis XIV, comme soixante-cinq ans auparavant avaient été rendues irréalisables les menaçantes prétentions de la maison d'Autriche, le traité d'Utrecht fut, pour la maison de Bourbon, ce qu'avait été, pour celle d'Autriche, la paix de Westphalie. Aussi éloigné, dans ses stipulations, des dangereux projets de Louis XIV que des folles visées de la coalition victorieuse, ce traité terminait cette longue lutte, comme on avait pu le projeter dans les rares moments où la sagesse avait imposé silence à la passion. Il donnait à la France le droit d'avoir sur le trône d'Espagne une dynastie amie, mais il empêchait que l'exercice de ce droit ne devint un danger pour l'Europe. Ce dénouement, indispensable au repos de tous, ne put être empêché par aucun des adversaires. Louis XIV, pour vouloir trop obtenir, avait été sur le point de tout perdre, de même que la coalition, par son acharnement même à le poursuivre, avait fait naître la nécessité de le sauver. C'est ainsi que les passions des hommes exercent de l'influence sur les événements les plus considérables, aussi bien que sur les plus futiles, et que souvent les politiques doivent la réparation de leurs fautes, moins à l'expérience acquise qu'aux fautes plus grandes encore de leurs ennemis. Mais, si le traité d'Utrecht, rapproché de la situation désespérée dans laquelle se trouvait la France en 1710, apparaît comme un merveilleux résultat et comme la condamnation la plus éloquente de l'inhabile opiniâtreté des alliés, on peut aussi, en se rappelant les débuts de la guerre qu'il terminait, le considérer comme une juste punition infligée à l'imprudente conduite de Louis XIV. La plupart des clauses de ce traité étaient en effet le redressement d'un des torts du trop orgueilleux monarque. En traitant Jacques II, réfugié en France, comme le véritable souverain de l'Angleterre, il avait adressé une menace à la révolution de 1688, et aujourd'hui il était contraint d'accepter cette révolution et de reconnaître la succession protestante qu'elle avait appelée au trône. En persistant à donner le titre de roi au chevalier de Saint-Georges et en le nommant Jacques III, il avait aggravé l'offense, autant que prolongé le danger pour la tranquillité de l'Angleterre, et aujourd'hui il était contraint de renvoyer de France ce prince infortuné, qui ne devait trouver qu'à Rome un asile certain. En maintenant, par un acte solennel de sa volonté, les droits de son petit-fils à la couronne de France, au moment où il l'envoyait régner en Espagne, il avait jeté un défi à l'Europe, et aujourd'hui il était contraint de révoquer cet acte téméraire, et de soumettre cette révocation à la confirmation de ses parlements. Enfin, dans toute la première partie de son règne, il avait impérieusement soumis à sa politique celle des derniers Stuarts et contribué ainsi à leur impopularité, et aujourd'hui c'était cette même nation, délivrée du joug de la France et redevenue indépendante, qui, au milieu d'une guerre soutenue avec l'aide de presque toute l'Europe, et à l'apogée de son triomphe, le sauvait du danger le plus grave et lui offrait la paix. Aucune des sévères leçons de la fortune n'a donc manqué à Louis XIV, et ses fautes ont été expiées dans le cours des négociations comme durant la guerre. Mais le vieux monarque a eu du moins la consolation de conserver les belles provinces conquises pendant sa jeunesse, de voir la maison d'Autriche à jamais exclue de Madrid, et, s'il n'avait plus pour héritier qu'un enfant, du moins a-t-il pu lui transmettre un trône raffermi, et espérer pour lui une paix rendue aussi utile par son jeune âge, que nécessaire par les souffrances profondes du pays. Ces intérêts majeurs n'absorbèrent pas toute l'attention des plénipotentiaires réunis à Utrecht. La solution de nombreuses questions moins importantes leur fut aussi demandée, et ce grand tribunal européen vit comparaître devant lui tous ceux qui, dépossédés, poursuivaient la revendication de leurs droits, ou, ambitieux, espéraient, dans ce bouleversement général des territoires, obtenir quelque satisfaction pour leur vanité. Tantôt c'était le duc de Montmorency réclamant[49] le duché de Luxembourg, comme représentant, par Marguerite-Charlotte, son aïeule, le dernier héritier mêle de ce duché[50]. Tantôt la princesse des Ursins, qui, ne se contentant pas de sa suprême influence et de son indirecte autorité, en ambitionnait le réel exercice, et ne craignait point de convoiter une souveraineté dans les Pays-Bas[51]. Tantôt encore c'était François Pic de la Mirandole, se plaignant de ce que le duc de Modène lui avait enlevé sa principauté[52], ou bien le seigneur de Forbin, déjà possesseur des villes de Saint-Remy et de Saint-Cannat, et revendiquant, dans le duché de Bar, la propriété du marquisat de Pont-à-Mousson, en sa qualité de descendant de René d'Anjou, duc de Bar et comte de Provence[53]. La question relative aux principautés d'Orange et de Neufchâtel valut aux ambassadeurs assemblés à Utrecht l'envoi des protestations du duc de Luynes, du comte de Matignon, de la duchesse de Lesdiguières, des marquis d'Alègre et de Viteaux, du comte de Barbançon et des princes de Conti, d'Yssenghien et de Nassau-Siegen[54]. Ce ne furent pas les seules. Tandis que le chevalier de Saint-Georges protestait contre la reconnaissance de la révolution de 1688 et maintenait, sous le nom de Jacques III, ses droits au trône d'Angleterre[55], le duc de la Trémouille constatait les siens au royaume de Naples, comme descendant en ligne directe de Charlotte d'Aragon, issue du premier mariage de Frédéric d'Aragon et d'Anne de Savoie[56]. En même temps le duc de Saint-Pierre réclamait le duché de Sabionnette, acquis de l'Espagne, puis enlevé par l'Autriche[57], et la maison de Condé faisait valoir les droits sur le duché de Montferrat[58], qu'elle tenait d'Anne de Gonzague, femme du prince palatin et mère de la princesse de Condé. Ces demandes, inutiles protestations du droit contre la force, ou vaines espérances d'une ambition présomptueuse, ne pouvaient pas aboutir. Fondées, pour la plupart, sur des titres d'hérédité incontestables, elles rencontraient un obstacle invincible dans la situation des puissants usurpateurs. Au surplus, s'ils s'étaient agrandis par des moyens illégaux, il y avait, pour leur maintenir ces conquêtes, de hautes raisons politiques. Il ne convenait pas en effet de multiplier le nombre de ces principautés qui, appartenant à un souverain étranger, quoique englobées dans un vaste État, sont tentées de changer de maître, et, après avoir été constamment un sujet de troubles et un danger, deviennent souvent une cause de guerre. Une touchante lettre du roi de Prusse ne fut pas accueillie avec plus de faveur. Elle en méritait cependant bien davantage et par la justice de la cause qu'elle défendait, et par la générosité des sentiments qui y étaient exprimés. De son lit de mort, et sachant que la paix allait être conclue, Frédéric Ier supplia la reine de la Grande-Bretagne d'obtenir de Louis XIV un adoucissement au sort des réformés. Déjà le roi de Prusse, dans les conditions dont il avait fait dépendre sa rupture avec la grande alliance, avait souhaité que Louis XIV accordât la liberté de conscience à ses sujets, et fit élargir tous ceux qui, à cause de la religion réformée, étaient détenus dans les prisons, couvents et galères[59]. Il avait alors présenté cette observation avec des ménagements infinis et une excessive prudence. Mais, dans ce moment solennel qui précédait la mort de peu de jours, Frédéric Ier, négligeant toute considération d'intérêt particulier, atteignit, dans ses sentiments et dans son langage, une grandeur et une éloquence inaccoutumées. C'est son âme, affranchie de toute crainte et dégagée des influences terrestres, qui resplendit dans ces dernières pages, où sont décrites en termes pathétiques les souffrances des malheureux réformés persécutés pour la défense de leur foi, gémissant sous un joug insupportable, et dont la vie est dix fois pire que la mort même[60]. La reine Arme, qui, quelques mois auparavant, avait envoyé à Utrecht le marquis de Miremont, afin d'y soutenir les intérêts des protestants de France[61], intervint de nouveau en leur faveur, et joignit sa voix à celle de Frédéric Ier. Bolingbroke adressa un pressant appel au marquis de Torcy, le suppliant de jeter un coup d'œil de compassion sur tant de malheureux et faisant remarquer combien cette action, digne du grand cœur et de la piété du roi, serait la marque la plus essentielle que Sa Majesté pût donner de sa considération pour la reine de la Grande-Bretagne[62]. Mais ni les adjurations d'un moribond, ni les instances d'une souveraine, à laquelle Louis XIV était pourtant redevable du salut de la France, ne purent fléchir la volonté de l'intolérant monarque. Outre qu'il aurait considéré comme un acte de faiblesse de céder, sur des questions intérieures, à l'intervention, même amicale, des autres puissances, il ne voulait à aucun prix se départir du droit, et renoncer à ce qu'il croyait son devoir, de punir en criminels d'État ceux qui ne se soumettaient point entièrement à la religion catholique. Etre rebelle à l'autorité des dogmes de l'Église, c'était alors l'être aussi à l'autorité royale, et, dans le cœur même de la France, le nombre des ennemis de Louis XIV s'accroissait ainsi de tous ceux dont son orthodoxie faisait des exilés ou des martyrs. Cette conduite, impolitique autant qu'inhumaine, devait être longtemps encore celle de la monarchie. En vain, de l'esprit du temps sortaient déjà des pensées de tolérance. L'opiniâtreté du pouvoir allait continuer à lés repousser, et seule une révolution devait introduire dans les institutions françaises une liberté tellement essentielle, qu'on ne peut concevoir aujourd'hui, qu'à une époque si rapprochée de nous, on l'ait refusée à notre pays. Toutes les questions soumises au congrès ayant été résolues et les derniers obstacles aplanis, le grand acte du traité d'Utrecht fut enfin consommé dans la mémorable journée du lundi 41 avril 1713, et dans la nuit qui la suivit. Deux seulement des ambassadeurs de la France, Huxelles et Ménager, eurent l'honneur de la représenter dans ce moment solennel. Polignac, créé cardinal, venait de quitter Utrecht, sa nouvelle dignité ne lui permettant pas d'occuper la place de second plénipotentiaire, et le maréchal d'Huxelles n'ayant aucun motif d'abandonner le premier rang[63]. Mais là n'était pas la plus importante cause de son départ. Promu au cardinalat sur la demande du chevalier de Saint-Georges, qui, prince catholique, avait conservé auprès du pape le droit de provoquer des nominations de cardinaux[64], Polignac ; par un sentiment de délicate réserve, ne voulut pas[65] signer un traité qui excluait pour toujours la maison de Stuart du trône d'Angleterre. Après avoir rempli avec éclat les obligations de sa charge, il satisfaisait ainsi à celles de la reconnaissance, et, quoique ayant efficacement participé aux rudes et persévérants travaux d'un tel congrès, il savait résister au séduisant désir d'associer son nom à l'œuvre qui les couronnait. Une dernière invitation de souscrire à cette œuvre ayant été adressée aux représentants de l'Autriche, et le comte de Zinzerdoff ainsi que le baron de Kirkner ayant formellement refusé leur adhésion[66], les ambassadeurs des autres puissances prirent acte des offres faites par Louis XIV à l'Empereur. Il fut décidé que les Pays-Bas espagnols, qui lui étaient destinés, seraient placés sous la garde de la Hollande jusqu'au moment où il consentirait à adhérer aux conditions convenues. A deux heures de l'après-midi, furent signés les traités de paix et de commerce entre la France et la Grande-Bretagne, et, aussitôt après, ceux de la France avec la Savoie. Les signatures furent apposées sur le traité du Portugal à huit heures du soir, et sur celui de la Prusse, à onze heures. Un dernier examen et la collation des deux traités de paix et de commerce entre la France et la Hollande ne permirent pas de les signer avant deux heures après minuit[67]. Le lendemain, le bruit du canon célébrait à Utrecht ce dénouement pacifique, et de nombreux courriers allaient l'annoncer à toute l'Europe[68]. Le 14 avril, à huit heures du soir, Louis XIV en apprenait la nouvelle du chevalier de Beringhen, envoyé par le maréchal d'Huxelles[69]. Le 14 mai, les ratifications étaient reçues à Versailles, et le 22, la publication de la paix se faisait à Paris avec les formes solennelles usitées dans l'ancienne monarchie. Jérôme Bignon, prévôt des marchands, se transporta entouré d'archers et de hérauts d'armes dans les divers quartiers de la ville, et proclama lui-même le grand événement[70]. Partout il fut accueilli par des transports d'allégresse, et le peuple oublia un moment les misères et les charges dont il venait d'être accablé. Les principales maisons furent, le soir, illuminées, et, dans les quartiers pauvres, des feux, allumés au milieu des rues, témoignèrent de la joie publique. Le duc du Maine, qui était venu de Sceaux chez le duc de Rohan, afin de voir passer le cortège du prévôt, fut témoin de cette joie[71], et, en retraçant ce tableau à Louis XIV, il dut effacer de son esprit le triste souvenir des douloureuses crises et des émeutes qui avaient assombri les dernières années. Le surlendemain, un Te Deum était chanté à l'église Notre-Dame ; et, dans la soirée, tandis qu'un feu d'artifice était tiré sur la place de Grève et qu'une musique de vingt-quatre violons[72] excitait la gaieté populaire, le duc de Tresmes, gouverneur de Paris, réunissait à l'Hôtel de Ville, avec les personnages les plus éminents, les ambassadeurs de presque toutes les puissances de l'Europe. |